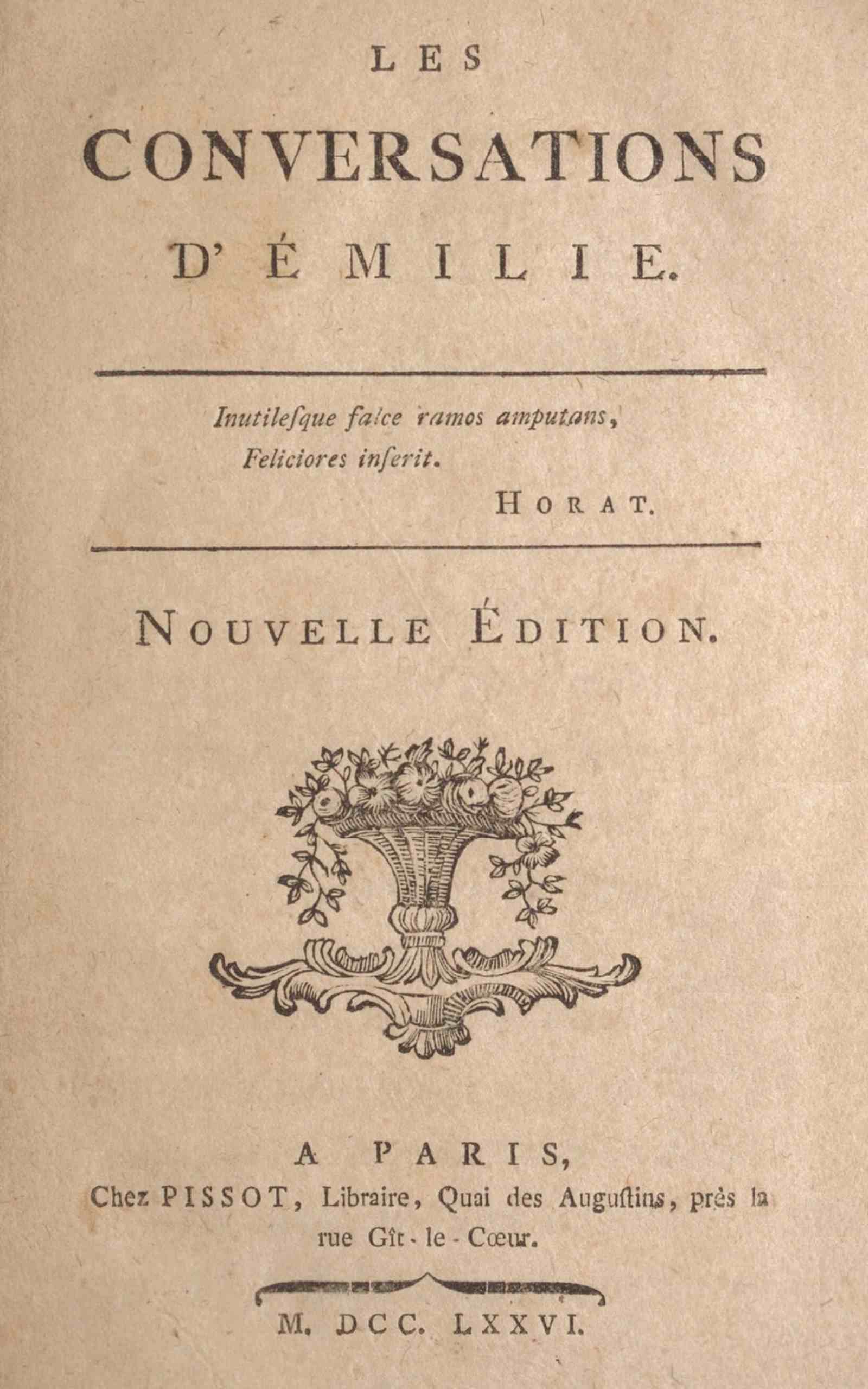
Title: Les conversations d'Émilie
Author: marquise d' Épinay Louise Tardieu d'Esclavelles
Release date: November 29, 2025 [eBook #77364]
Language: French
Original publication: Paris: Pissot, 1776
Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))
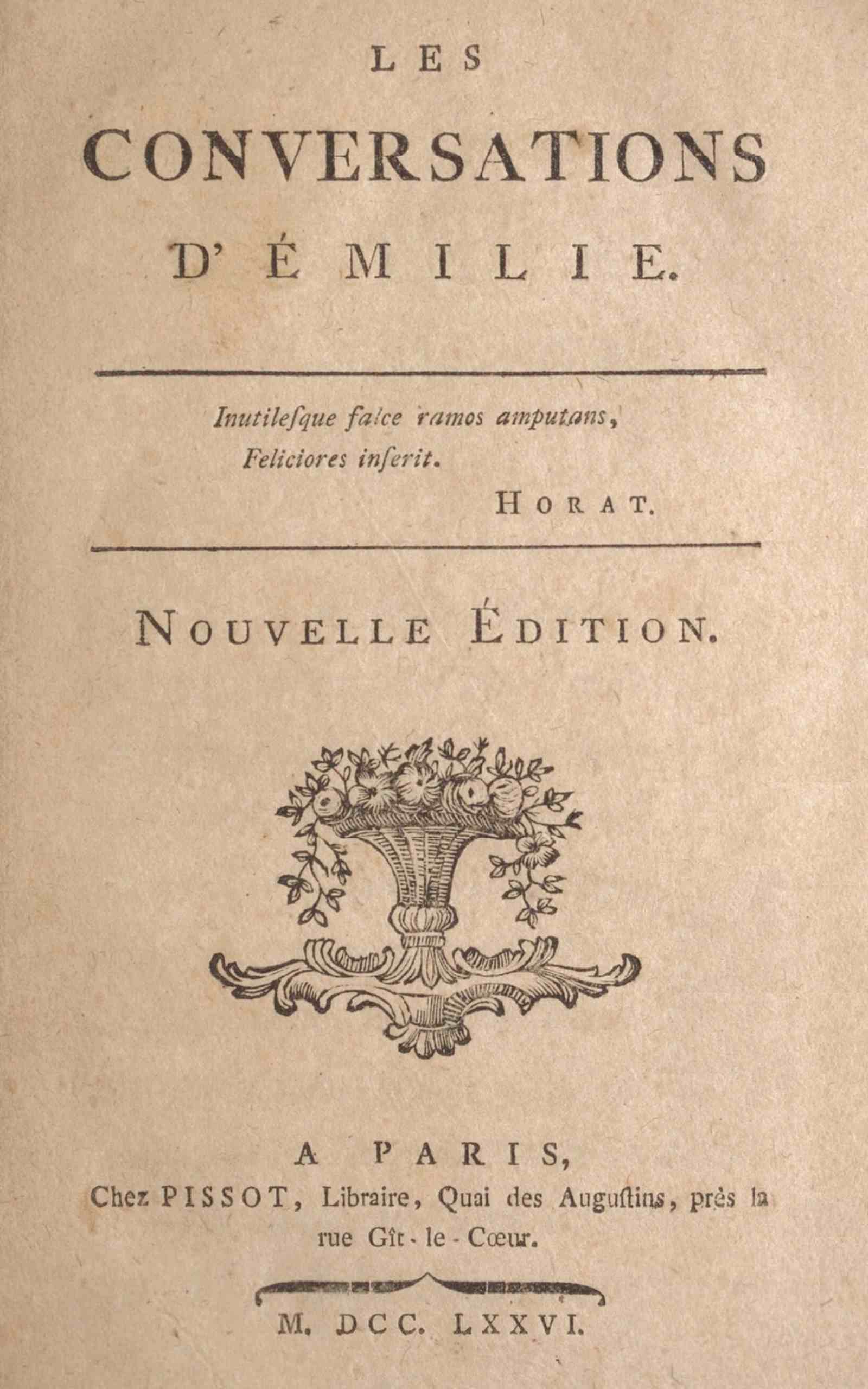
CONVERSATIONS
ENTRE
UNE MERE ET SA FILLE.
Inutilesque falce ramos amputans,Feliciores inserit.Horat.
Nouvelle Édition.
A PARIS,
Chez PISSOT, Libraire, Quai des Augustins, près la
rue Gît-le-Cœur.
M. DCC. LXXVI.

Vous m’aviez désolée, Monsieur, en me disant l’autre jour que mes Dialogues n’étoient pas au point où je les croyois. Vous m’avez rassurée, en m’apprenant que vous n’y apperceviez ni un plan d’éducation, ni même beaucoup de liaison entre les idées. C’est que je ai pas eu la prétention de proposer un nouveau plan d’éducation, ni la hardiesse de n’écarter de celui que des parents sages suivent communément dans l’éducation des Filles. Je n’ai voulu faire qu’un Traité de remplissage, si vous me permettez de parler ainsi, & montrer comment les heures perdues, les moments de délassement peuvent être employés par une Mere vigilante à former l’esprit d’un Enfant & à lui inspirer des sentiments honnêtes & vertueux. Il ne s’agit donc ici ni de plan ni de systême.
Cependant, sous ce point de vue même, l’éducation doit être divisée, comme dans un systême bien conçu & bien lié, en plusieurs époques, & il faudroit faire un travail différent pour chacune. On peut en marquer trois principales. La premiere finit à l’âge de dix ans, la seconde à quatorze ou quinze ans ; la troisieme doit durer jusqu’à l’établissement de l’enfant.
Suivant ce plan, je n’aurois encore essayé à travailler que pour la premiere époque où il s’agit de présenter à l’esprit des idées simples, de lui enseigner & de l’aider à les déveloper, & de profiter souvent d’une niaiserie pour le conduire à des réflexions solides & sensées. Le travail pour les deux autres époques seroit infiniment plus sérieux, & je ne sçais si j’aurai la force de le tenter lorsque l’âge de ma Fille pourra l’exiger.
Cette confession faite, je vous abandonne, Monsieur, ces Dialogues. Faites-en l’usage qu’il vous plaira, puisque vous pensez qu’ils pourront être utiles à d’autres enfants. A Paris ce premier Janvier 1774.


CONVERSATIONS
ENTRE
UNE MERE ET SA FILLE.

Emilie.
Maman, j’ai bien étudié mon Catéchisme, trouvez-vous bon que je travaille auprès de vous ?… Ah ! Maman, venez, venez, j’entens le tambour. Ce sont les singes qui passent.
La Mere.
Mettez-vous à la fenêtre avec votre bonne, mon enfant, quand ils seront passés, vous viendrez travailler.
(Emilie va à la fenêtre, ensuite elle revient.)
Emilie.
Maman ? je les ai vus ; pourquoi n’êtes-vous pas venue les voir ? Est-ce que vous ne les aimez pas ?
La Mere.
Pas beaucoup. Tenez, voilà votre ouvrage, vous broderez jusqu’à cette fleur.
Emilie.
Oui, Maman ; mais pourquoi n’aimez-vous pas les singes ? Moi, je les aime bien.
La Mere.
Pourquoi les aimez-vous ?
Emilie.
C’est qu’ils sont drolles, ils m’amusent, ils ont une mine !… des grimaces !
La Mere.
Si vous les voyiez de près, ils ne vous amuseroient pas autant ; ils sont d’un naturel méchant, ils sont traîtres, malins, voleurs…
Emilie.
Bon !… C’est dommage… mais comme je les vois par la fenêtre, ils ne me feront pas de mal ; ils ont une drolle de mine… je voudrois pourtant bien les voir de près.
La Mere.
Et qu’est-ce que c’est qu’un singe ? Puisque vous les aimez, vous devez sçavoir ce que c’est ?
Emilie.
Oui, sûrement ? c’est un animal.
La Mere.
Est-il fait comme un chien, comme un chat ?
Emilie.
Mais non, Maman, il est fait comme un singe.
La Mere.
A quel animal trouvez-vous qu’il ressemble le plus ?
Emilie.
Je ne sçais pas, Maman, voulez-vous bien me le dire ?
La Mere.
C’est à l’homme ; il en a la figure ; les mains, les pieds…
Emilie.
Est-ce que l’homme est un animal ?
La Mere.
C’est un animal raisonnable.
Emilie.
Pourquoi dites-vous un animal raisonnable, Maman ?
La Mere.
C’est la maniere dont on s’exprime pour distinguer l’homme des bêtes ; parce que l’homme est la seule créature qui ait l’usage de la raison & de la parole.
Emilie.
Les hommes sont donc des animaux ? Cela est drolle ! & nous, Maman, sommes-nous aussi des animaux ?
La Mere.
Quand je dis l’homme, j’entens toutes les créatures humaines ; quand je dis un homme, je désigne seulement alors une créature humaine du genre masculin, & quand je dis une femme, je désigne une créature humaine du genre féminin.
Emilie.
Ah, Maman, voilà Rosette qui mange ma robe !… mais, Maman, les chiens ne parlent pas ?
La Mere.
Non, ils n’ont ni l’usage de la raison, ni celui de la parole ; ils sentent comme nous la douleur ; ils souffrent & se plaignent quand on leur fait mal.
Emilie.
Qu’est-ce qu’ils font, les chiens ?
La Mere.
Ils gardent leurs maîtres, & pour les en récompenser, leurs maîtres les nourrissent & ont soin d’eux.
Emilie.
Et les hommes, pourquoi sont-ils dans le monde ?
La Mere.
Pour y vivre en société.
Emilie.
Et que font-ils toute la journée ?
La Mere.
Ils s’aident mutuellement dans leurs besoins, dans leurs affaires, & même dans leurs plaisirs.
Emilie.
Et celui qui n’aideroit pas les autres que lui en arriveroit-il ?
La Mere.
Que les autres ne l’aideroient pas, qu’il ne seroit bon à rien, que bientôt il ne seroit ni aimé, ni estimé, ni recherché ; que bientôt il manqueroit de tout, & qu’il finiroit par mourir d’ennui, de besoin & de chagrin.
Emilie.
Il faut donc être utile aux autres pour être heureux ?
La Mere.
C’est un des moyens les plus sûrs pour arriver au bonheur.
Emilie.
Qu’est-ce que c’est que le bonheur ?
La Mere.
C’est ce que vous éprouvez, mon enfant, quand vous êtes contente de vous, & que vous avez satisfait à ce que nous exigeons de vous.
Emilie.
J’entens, quand j’ai été bien obéissante & que j’ai bien fait mes devoirs ; mais quand je serai grande, je n’aurai plus de devoirs à faire, je n’aurai donc plus d’occasion d’être heureuse ?
La Mere.
Chaque âge a ses devoirs, ses occupations, ses plaisirs…
Emilie.
Maman, voyez mon ouvrage, il n’est pas mal.
La Mere.
Est-il fini ? Je vous ai dit ne pas quitter votre place que votre tâche ne fût faite.
Emilie.
Mais pourquoi cela, Maman ?
La Mere.
Parce qu’il faut s’accoûtumer à faire de suite ce que l’on fait, & à ne point passer sans raison d’une occupation à une autre.
Emilie.
Mais, Maman, c’est que…
La Mere.
Point de raisonnement, quand je vous ai dit ce que vous devez faire, il faut vous y soumettre sans replique.
Emilie.
Maman, je vais vous obéir ; mais permettez-moi de vous demander pourquoi vous voulez bien dans de certains moments que je vous fasse des questions, & que je dise tout ce qui me passe par la tête, & que vous ne voulez pas le souffrir dans d’autres.
La Mere.
Quand nous causons ensemble, soit pour votre instruction, soit pour votre amusement, vous pouvez avec liberté & avec confiance me communiquer toutes vos idées ; alors je vous répons, & vos questions ne sont point déplacées ; mais lorsque je vous prescris votre conduite, vous devez obéir sans replique.
Emilie.
Pourquoi cela, Maman ?
La Mere.
Par respect & par confiance. M’avez-vous jamais vu exiger rien de vous qui ne fût pour votre bien ?
Emilie.
Non, Maman.
La Mere.
Je me suis toujours assujettie autant que votre âge le permet à vous expliquer les raisons des ordres que je vous donne ; vous le sçavez, d’où viendroit donc votre répugnance à m’obéir.
Emilie.
Cela est vrai, Maman, & je vous assure qu’à l’avenir je vous obéirai sans repliquer ; mais aussi quand nous causerons, vous me permettez de vous dire tout ce que je voudrai.
La Mere.
Oui, je vous le permets, mais seulement quand nous causerons.
Emilie.
Causons-nous à présent, Maman ?
La Mere.
Mais il me semble qu’oui, qu’en pensez-vous ?
Emilie.
Oh ! je m’en vais vous dire bien des choses… Maman ? mais pourquoi suis-je au monde ?
La Mere.
Voyez, dites-moi cela vous-même.
Emilie.
Je n’en sçais rien.
La Mere.
Et qu’est-ce que vous faites toute la journée ?
Emilie.
Mais je me promene, j’étudie, je saute, je bois, je mange, je ris, je cause avec vous quand je suis bien sage.
La Mere.
Eh bien, voilà jusqu’à présent pourquoi vous êtes au monde ; c’est pour boire, manger, dormir, rire, sauter, grandir, vous instruire, voilà ce que vous avez à y faire, & à mesure que vous grandirez, vos occupations & obligations changeront ; au lieu d’être au monde pour sauter, danser & être à charge aux autres, vous y serez pour travailler, pour être utile, pour remplir d’autres devoirs & jouir d’autres amusements.
Emilie.
Etre à charge aux autres ? est-ce que je suis à charge ?
La Mere.
Sans doute, puisque vous êtes un enfant.
Emilie.
Mais un enfant, c’est une personne.
La Mere.
Un enfant c’est un enfant qui deviendra avec le temps une personne raisonnable.
Emilie.
Mais qu’est-ce que je suis donc à présent que je suis un enfant.
La Mere.
Comment ! vous avez cinq ans & vous n’avez pas encore réfléchi à ce que vous êtes ? tâchez de trouver cela toute seule.
Emilie.
Maman, je ne trouve rien.
La Mere.
Un enfant est une créature foible dans la dépendance de tout le monde, un enfant est ignorant, étourdi, foible, innocent, importun & indiscret.
Emilie.
Quoi, j’ai tous ces défauts.
La Mere.
Ce sont ceux de votre âge. Vous voyez qu’un enfant ne doit les soins qu’on prend de lui qu’à la tendresse de ses parents, & qu’il ne peut être qu’à charge & insupportable aux autres.
Emilie.
Il me semble que je ne suis pas si foible.
La Mere.
La moindre personne peut vous renverser d’un coup de poing, peut vous tuer, vous anéantir.
Emilie.
Mais est-ce qu’un enfant ne peut pas se défendre comme un autre ?
La Mere.
La foiblesse l’en empêche, son ignorance & son étourderie ne lui permettent pas de prévoir ni d’éviter le danger. Il a besoin d’avoir sans cesse auprès de lui quelqu’un qui le garde, qui le protége, qui le garantisse ; personne n’a même interêt à se donner ce soin qui est très-pénible, parce que l’enfant n’a rien en lui qui en dédommage, & ce n’est que par sa douceur, par sa soumission, par ses égards pour ceux qui lui rendent des services, qu’il peut se flater de les voir continuer ; car s’il a de l’humeur, s’il répond avec dureté, si ce n’est pas son cœur qui lui fait sentir l’obligation qu’il a à tous ceux qui ne lui font pas de mal, il sera bientôt abandonné de tout le monde ; & alors il seroit bien à plaindre.
Emilie.
Mais, Maman, ma bonne n’est-elle pas obligée d’avoir soin de moi ?
La Mere.
Votre bonne a soin de vous parce que je l’en ai chargée ; mais je ne peux pas l’obliger à vous aimer si vous ne vous rendez point aimable, & si vous aviez de l’humeur, de la dureté, de l’ingratitude pour elle, je suis trop juste pour exiger qu’elle vous rende des soins que vous reconnoîtriez si mal, & je lui défendrois même d’approcher de vous.
Emilie.
Alors je m’habillerois toute seule.
La Mere.
Croyez-vous le pouvoir ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
Voyons, défaites votre fourreau, votre collier.
Emilie.
Voilà mon collier défait.
La Mere.
Votre fourreau, à présent.
Emilie.
Ah ! je l’ôterai bien toute seule… Maman, voulez-vous bien défaire les agraffes ?
La Mere.
Non, vous devez tout faire seule, puisque vous supposez que vous n’avez personne pour vous aider.
Emilie.
Mais je ferai bien le reste.
La Mere.
Il vous faut donc quelqu’un pour défaire vos agraffes ? Remettez votre collier.
Emilie.
Maman, je ne peux pas.
La Mere.
Il vous faut donc quelqu’un pour renouer votre collier. Jugez par cet essai combien vous avez besoin de votre bonne ! Combien vous devez craindre de la rebuter & qu’elle ne vous laisse ; car si elle vous quittoit par votre faute, personne ne voudroit vous aider.
Emilie.
Mais vraiment, Maman, je serois bien à plaindre ; je n’avois jamais pensé à cela : je ne pourrois ni me lever, ni me coucher, ni rien faire toute seule.
La Mere.
Vous voyez donc bien que quand on est dans le cas d’avoir besoin de tout le monde, il faut être polie, reconnoissante, corriger son humeur, profiter des leçons & des avis qu’on vous donne, & sentir que quand on vous corrige, c’est une preuve d’intérêt & d’amitié, & un moyen qu’on vous procure pour vous faire aimer.
Emilie.
Je n’avois jamais pensé à tout cela.
La Mere.
C’est qu’à votre âge on est étourdie & qu’on ne prévoit rien.
Emilie.
Mais à présent je prendrai garde à moi, & j’aimerai bien plus ma bonne, puisqu’elle a eu tant de peine avec moi. Mais, Maman, il y a bien des choses que je ne sçais pas, n’est-ce pas ?
La Mere.
Non-seulement il y a bien des choses que vous ne sçavez pas ; mais vous voyez bien que vous ne sçavez rien, puisque vous ne sçavez ni ce que vous êtes, ni ce que vous faites en ce monde.
Emilie.
Oh ! je le sçais à présent, & je ne l’oublierai pas. Voilà ma tâche finie, Maman, voulez-vous voir mon ouvrage ?
La Mere.
Voyons… il est bien. Vous pouvez jouer si vous êtes lasse de causer.
Emilie.
Maman, puisque vous êtes contente, je vous en prie, je vous demande en grace de me faire un grand plaisir.
La Mere.
Quoi ?
Emilie.
Contez-moi l’histoire de cette Dame dont vous parliez hier au soir avec mon Papa.
La Mere.
Volontiers. Quand vous êtes raisonnable, je n’ai rien à vous refuser. Cette Dame étoit veuve d’un homme de condition. A sa mort, elle étoit restée sans bien avec une fille & un garçon…
Emilie.
Comment s’appelloit-elle ?
La Mere.
Vous ne la connoissez pas.
Emilie.
Mais sa fille ?
La Mere.
Elle s’appelloit Julie. Elle lui dit un jour : « Mon Enfant, je ne suis point riche, je viens de m’épuiser pour faire entrer votre frere au service. Jusqu’à présent il s’est distingué des jeunes gens de son âge par sa sagesse & son émulation. Il fera son chemin, je l’espere, & il pourra un jour vous être utile ; mais pour vous, vous n’avez rien. Je ne suis point en état de vous donner des maîtres, ni de vous procurer des talents agréables. Ce n’est donc que de vos vertus, de votre émulation à acquérir les qualités qui vous manquent, que vous pouvez attendre des secours. Je vous aiderai des lumieres que l’expérience & la connoissance du monde m’ont données. Si vous ne vous faites pas aimer, si vous n’interessez pas par vos qualités personnelles, vous ne trouverez point d’établissement à faire, vous ne vous marierez pas. »
Emilie.
Pourquoi, Maman, cette Dame lui dit-elle cela ?
La Mere.
Parce qu’elle n’étoit pas riche, & que quand on n’a rien, il faut être meilleure qu’une autre pour être recherchée ; car si vous êtes pauvre & méchante, on n’a rien de mieux à faire qu’à vous laisser là.
Emilie.
Je ne voudrois pas d’un mari qui fût pauvre & méchant.
La Mere.
Vous devez donc trouver tout simple qu’on ne veuille pas d’une femme pauvre & méchante.
Emilie.
Cela est vrai. Eh bien, Maman ?
La Mere.
Eh bien ! Julie étoit malheureusement d’un mauvais caractére, boudeuse, paresseuse, sujette à l’humeur, s’en prenant toujours aux autres de ses torts, ingrate envers sa mere, qui la voyant incorrigible, fut obligée de la mettre dans un Couvent. L’exemple de son frere n’avoit pu la changer. Il avoit le plus grand respect pour sa mere ; il ne l’approchoit jamais sans lui en donner des marques ; il avoit une extrême confiance en elle. Sa plus grande peur étoit de lui déplaire. Pour Mademoiselle Julie, elle manqua un mariage considérable, parceque les informations qu’on fit à son sujet au Couvent lui furent si défavorables qu’on n’en voulut pas malgré sa jolie figure, qui avoit séduit d’abord.
Emilie.
Et qu’est devenue Mademoiselle Julie ?
La Mere.
Elle est restée au Couvent, & y sera toute sa vie.
Emilie.
Mais elle se corrigera peut-être ?
La Mere.
A un certain âge, ma fille, on ne se corrige plus. Quand on n’a pas fait ses efforts dès l’enfance, cela devient presque impossible.
Emilie.
Etoit-elle Jolie, Mademoiselle Julie ?
La Mere.
Fort jolie ; mais elle n’étoit pas aimable.
Emilie.
Il vaut donc mieux être aimable que jolie. Cependant… Maman, suis-je jolie ?
La Mere.
Jusqu’à présent vous ne l’êtes pas.
Emilie.
Mais pourquoi donc tout le monde dit-il que je suis charmante ?
La Mere.
Je vous dirai cela demain. Allez jouer avec votre bonne en attendant la promenade, & amusez-vous bien, puisque vous avez bien travaillé.


Emilie.
Maman, comment s’appelle… ce n’est pas cela que je voulois dire… Maman, vous m’avez promis de me dire une chose, voulez-vous bien me la dire ?
La Mere.
Qu’est-ce que c’est, mon enfant ?
Emilie.
Mais pourquoi, si je ne suis pas jolie, me dit-on toujours que je suis charmante ?
La Mere.
On peut être charmante sans être précisément jolie, & l’on peut être très-jolie sans être charmante ; car…
Emilie.
Ah ! je sçais, je sçais, Maman ; pour être charmante, il faut être sage, modeste, ne parler qu’à propos, n’être pas importune, n’est-ce pas, Maman, vous m’avez dit cela ?
La Mere.
Cela est vrai. Dites-moi si vous êtes jolie ou charmante ?
Emilie.
Mais… je crois qu’oui.
La Mere.
Lequel des deux ?
Emilie.
Jolie, Maman.
La Mere.
Qu’est-ce que c’est que d’être jolie ?
Emilie.
J’entens quelque chose, mais je ne sçais comment dire.
La Mere.
C’est d’être fort blanche, c’est d’avoir de beaux yeux, un nez bien fait, une jolie bouche ni trop petite ni trop grande, enfin des traits bien proportionnés ; l’ensemble de toute la figure agréable, les cheveux bien plantés, ne point faire des grimaces, n’avoir l’air ni boudeur, ni ricannant, avoir l’air affable & modeste.
Emilie.
Comme ma cousine ?
La Mere.
Oui ; avez-vous tout cela ?
Emilie.
Mais non pas tout.
La Mere.
Vous n’êtes donc pas jolie.
Emilie.
Mais pourquoi presque tous ceux qui viennent ici le disent-ils ?
La Mere.
N’avez-vous jamais entendu dire à d’autres enfants comme vous, qu’ils étoient charmants, aimables, quoiqu’ils ne le fussent pas ?
Emilie.
Je ne sçais pas, je n’y ai pas pris garde.
La Mere.
Mais ne vous a-t-on jamais louée, quoique vous ne le méritassiez pas ? pensez-y bien.
Emilie.
Je cherche. Je crois que cela pourroit bien être ; mais dans le moment où l’on me donnoit des louanges, je croyois les mériter, ou je crois plutôt que j’avois bien peur que vous ne disiez le contraire, Maman… Ah ! tenez, je croyois aussi une fois qu’on se moquoit de moi.
La Mere.
Ce n’étoit rien de tout cela. C’est une politesse fausse & mal entendue qui fait qu’on se croit obligé lorsqu’on va dans une maison de louer tout ce qui s’y trouve depuis la maîtresse jusqu’au petit chien. Vous avez vu des gens à qui ma chienne alloit mordre les jambes, dire également qu’elle étoit charmante. Croyez-vous que ce compliment fût bien sincére & que Rosette le méritât ?
Emilie.
Oh ! pour cela non.
La Mere.
Eh bien ceux qui vous disent que vous êtes jolie, que vous êtes charmante, ne le pensent pas plus de vous que de Rosette, ou ne sçavent pas plus si vous le méritez mieux qu’elle, ou du moins ne se soucient pas de le sçavoir.
Emilie.
Mais c’est bien bête de parler pour ne pas dire vrai.
La Mere.
Vous avez raison, il vaut bien mieux se taire. Aussi j’ai vu toutes les jeunes personnes qui pensent bien, ne faire aucun cas de ces sortes de compliments, & souvent même s’en trouver offensées. Il est bien sot ou bien leger de tenir ces propos ; mais il seroit bien plus sot encore de les croire, & de s’en glorifier.
Emilie.
Ah ! Maman, je n’y serai plus attrapée… Mais… quand je suis bien sage, il est pourtant vrai alors que je suis charmante ; car ma bonne me l’a dit, & vous aussi, Maman.
La Mere.
Quand vous êtes raisonnable, nous vous disons que si vous étiez toujours ainsi, vous seriez charmante, parce qu’alors vous l’êtes en effet ; mais vous ne sçavez point encore qu’on n’est point charmante avec une conduite inégale, & que si vous voulez mériter cette réputation avec le temps, il faut être tous les jours un peu plus raisonnable.
Emilie.
Maman, je le serai toujours ; à commencer d’aujourd’hui je vais être parfaite.
La Mere.
Qu’entendez-vous par-là ?
Emilie.
J’entens faire toujours bien.
La Mere.
Vous croyez donc cela bien aisé ?
Emilie.
Oui, Maman, il n’y a qu’à vouloir.
La Mere.
Et comment vous y prendrez-vous ?
Emilie.
En faisant toujours ce que ma bonne & vous me direz, & ne faisant pas autre chose.
La Mere.
Commencez donc par vous bien tenir.
Emilie.
Oui, Maman ; est-ce comme cela ?
La Mere.
Oui, & tournez vos pieds. Voilà qui est bien. Avez-vous écrit cette après-dînée pendant que j’ai eu du monde ?
Emilie.
Oui, Maman, mais je n’ose vous montrer mon écriture, car elle est si mal !… si griffonnée !…
La Mere.
Ah, vous n’aviez pas pris encore la résolution d’être parfaite… tenez, voilà déja vos pieds dérangés, & votre tête…
Emilie.
Les voilà remis. Maman, voulez-vous me permettre de recommencer ma page, je suis sûre que je la ferai très-bien.
La Mere.
Volontiers. Mettez-vous près de cette table… Êtes-vous bien ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
Vous tenez mal votre plume… votre tête est de travers… votre écriture n’est pas plus droite… vous vous impatientez ? prenez garde, l’impatience ne va pas avec la perfection… J’en suis fâchée, mais cette page n’est pas meilleure que l’autre.
Emilie.
Mais comment faut-il donc faire ? Je vais recommencer.
La Mere.
Non, vous avez assez étudié aujourd’hui. Il faut mettre le temps à tout. Il faut vous appliquer pour faire tous les jours un peu moins mal ; mais on ne peut pas apprendre à écrire dans un jour, ni même se corriger en si peu de temps. Vous avez déja oublié ce que nous avons dit hier sur votre âge, & sur ce que vous aviez à faire dans le monde.
Emilie.
Ah ! pardonnez-moi, je m’en souviens bien : j’y suis pour m’instruire, sauter, danser…
La Mere.
Oui, & pour croître, grandir, former votre corps, votre cœur, votre esprit. Dites-moi, Emilie, dépend-il de vous de devenir grande comme moi tout-à-l’heure… d’ici à demain, par exemple ?
Emilie.
Non sûrement, Maman.
La Mere.
Eh bien, vous n’êtes pas plus la maîtresse de bien écrire & de vous rendre raisonnable en un jour, que de devenir tout d’un coup aussi grande que moi.
Emilie.
Il faut donc que j’attende que je sois grande pour être raisonnable ?
La Mere.
Plus vous ferez d’efforts pour le devenir & plutôt vous y parviendrez ; mais il y a la raison de votre âge, qui est la seule à laquelle vous puissiez prétendre.
Emilie.
Quelle est donc la raison de mon âge ?
La Mere.
A présent, c’est de sentir ce que vous êtes, & de reconnoître que vous ne pouvez rien, qu’aidée des autres.
Emilie.
C’est d’être soumise & reconnoissante, n’est-ce pas ?
La Mere.
Oui, c’est de vous appliquer à apprendre les choses qu’on vous enseigne qui sont proportionnées à votre âge & à l’ouverture de votre esprit. C’est de me donner votre confiance entiere, puisque vous convenez que je ne vous ai jamais trompée.
Emilie.
Ah ! cela est bien vrai, Maman ; mais après, qu’est-ce que je ferai ?
La Mere.
Après ? Peu-à-peu vous grandirez ; votre esprit se dévelopera ; vos connoissances augmenteront, & vous deviendrez avec le temps une personne raisonnable.
Emilie.
Oui, parce que j’aurai travaillé à corriger mes défauts.
La Mere.
Et vous acquerrez une force sur vous-même, qui est ce qu’on appelle vertu, & sans laquelle on ne peut se promettre ni bonheur, ni estime, ni succès ; mais vous ne serez pas parfaite.
Emilie.
Mais pourquoi cela ? quand est-ce donc que je le serai ?
La Mere.
C’est un avantage qui n’est point donné à l’homme, de même que vous avez vos défauts, notre âge a les siens, & nous travaillons tous comme vous à nous corriger pour notre propre satisfaction, & pour conserver l’estime des autres.
Emilie.
Qu’est-ce que c’est que l’estime des autres ?
La Mere.
C’est l’approbation que les autres donnent à notre bonne conduite, & que les personnes que nous connoissons le moins, ou celles mêmes qui auroient des raisons de ne pas nous aimer, ne peuvent nous refuser.
Emilie.
Je n’entens pas cela, Maman. Comment peut-on approuver quand on ne connoît pas les gens ?
La Mere.
Dites-moi ; que pensez-vous de ces deux enfants dont je vous ai conté l’histoire hier ? de Mademoiselle Julie, par exemple ?
Emilie.
Ah, je crois, que c’est un méchant enfant !
La Mere.
Et de son frere, quelle opinion en avez-vous ?
Emilie.
Je pense qu’il est bien aimable, bien vertueux, bien sage.
La Mere.
Eh bien, cette bonne opinion que vous avez de lui sur ce que vous avez appris de sa bonne conduite, c’est de l’estime. Et cependant vous ne le connoissez pas.
Emilie.
Eh bien, je le connois à présent.
La Mere.
Vous ne le connoissez que de réputation, mais cela ne s’appelle pas connoître, puisque vous ne l’avez jamais vu.
Emilie.
Maman, aurez-vous la bonté de me conter encore une histoire aujourd’hui ?
La Mere.
Non, mon enfant, il est tard, nous allons nous promener, & s’il ne nous vient personne nous continuerons de causer tout en marchant. Sonnez pour qu’on nous apporte nos mantelets.


Emilie.
Maman, j’ai attrapé une mouche !… Ah, qu’elle est brillante !
La Mere.
Oui, elle est belle.
Emilie.
Je m’en vais lui ôter les aîles pour qu’elle ne s’en aille pas, & je la nourrirai.
La Mere.
Doucement, attendez ! Vous a-t-elle mordue ? Vous a-t-elle blessée ?
Emilie.
Non, Maman.
La Mere.
Et pourquoi donc lui faire du mal ?
Emilie.
Mais cela ne lui en fait pas.
La Mere.
Cela lui en fait autant que si l’on vous coupoit un pied ou une main. Parce que vous ne l’entendez pas crier, vous supposez qu’elle ne souffre pas, vous vous trompez. C’est une créature tout comme vous, elle souffre tout comme vous, & il ne vous est pas permis de lui faire du mal.
Emilie.
Mais si elle m’avoit mordue !
La Mere.
Il est permis de se défendre, & si elle vous eût blessée, vous auriez pu la tuer ; mais elle ne vous a rien fait.
Emilie.
Je ne voulois pas la tuer, Maman ; je voulois la nourrir, & prendre soin d’elle.
La Mere.
C’est à-peu-près comme si le premier passant vouloit s’emparer de vous pour vous élever & vous nourrir. S’il commençoit par vous couper le pied, de peur que vous ne vous enfuyiez, comment trouveriez-vous cela ?
Emilie.
Je n’y consentirois pas.
La Mere.
Mais si vous n’étiez pas la plus forte, il faudroit bien vous y soumettre. Eh bien voilà comme vous avez fait avec cette mouche ; vous avez été la plus forte, vous l’avez prise, vous alliez sans moi lui couper les aîles, & vous auriez été toute étonnée demain de la trouver morte.
Emilie.
J’en aurois été fâchée.
La Mere.
Voyez comme elle souffre.
Emilie.
Mais cela est vrai, elle souffre.
La Mere.
Cette pauvre bête ! pensez à la peine que vous auriez, si l’on vous tenoit comme cela suspendue par un bras.
Emilie.
Cela me feroit mal.
La Mere.
Pouvez-vous n’être pas sensible au plaisir de lui rendre la liberté ? Laissez-la vîte aller retrouver ses camarades, jouissez de ce plaisir…
Emilie.
Je le veux bien, mais…
La Mere.
Souvenez-vous toujours, Emilie, qu’on ne doit se prévaloir de sa force que pour secourir les plus foibles, & non pour les opprimer. Voilà comme on se fait aimer, & comme on se procure du bonheur à tous les instants ; c’est en faisant toujours du bien, & jamais du mal volontairement.
Emilie.
Mais moi, je ne veux faire du mal à personne, je m’en vais la laisser envoler… ah ! voyez, Maman, comme elle est bien aise !
La Mere.
Oui. Vous avez le plaisir d’avoir fait du bien ; n’êtes-vous pas plus contente que si cette pauvre bête fût morte par votre faute ?
Emilie.
Oui, Maman, j’en aurois été bien fâchée.
La Mere.
Voyez ce que vous deviendriez, si tous ceux qui sont plus forts que vous, vous faisoient un petit mal ? Je suis plus forte que vous, votre bonne est plus forte que vous.
Emilie.
Mais, vraiment oui, tout le monde est plus fort que moi.
La Mere.
Eh bien, si nous n’aimions pas tous à faire du bien, & si au lieu de trouver du plaisir à vous garantir du mal, & à protéger votre foiblesse, nous nous divertissions à vous pincer, à vous tirer les oreilles, à vous arracher les cheveux, que deviendriez-vous ?
Emilie.
Ah, Maman, que je serois malheureuse !
La Mere.
Voyez donc combien il est important de contracter de bonne heure ce plaisir de faire du bien ; car à votre tour, vous serez la plus forte, & si votre cœur ne répugne pas à faire du mal, tout le monde vous haïra. Jusqu’à présent vous n’avez guere de supériorité que sur les mouches, servez-vous-en pour leur faire du bien.
Emilie.
Je n’oublierai pas cela, Maman ; je ne sçavois pas qu’une mouche souffrît comme nous ; mais est-ce qu’il y a autant de mal à faire souffrir une mouche qu’une personne ?
La Mere.
Non. Mais il faut s’accoûtumer à respecter la nature jusques dans ses moindres productions. Une mouche, un hanneton, un chien, un arbre, tout cela est son ouvrage.
Emilie.
Moi aussi, je suis son ouvrage…
La Mere.
Si vous arrachez une aîle ou une patte à cette mouche, il n’est pas en votre pouvoir de réparer le mal que vous lui avez fait. Si vous arrachez l’écorce de cet arbre, il n’est pas en votre pouvoir de l’empêcher de périr, c’est comme si l’on vous arrachoit la peau.
Emilie.
Cela leur fait donc bien du mal ?
La Mere.
Sans doute ; vous ne devez donc pas leur nuire sans nécessité & sans raison ; vous ne pouvez même y trouver aucun plaisir. C’est l’ignorance, c’est l’étourderie de votre âge qui fait faire aux enfants comme vous tant de mal sans le sçavoir ; mais à présent que je vous ai appris ce que c’est qu’une mouche, un arbre, &c. vous n’aurez plus de pareils torts, sans quoi vous donneriez une bien mauvaise idée de votre cœur.
Emilie.
Oui, on diroit que je suis cruelle, que je suis méchante, n’est-ce pas, Maman ?
La Mere.
On seroit fondé à avoir de vous l’opinion que l’on conçut de Domitien…
Emilie.
Qu’est-ce que c’est que Domitien ?
La Mere.
C’étoit un Empereur Romain qui dans son enfance n’avoit d’autre plaisir que de tuer des mouches, & de faire du mal à tous les animaux. On n’avoit jamais pu l’en corriger.
Emilie.
J’aurois bien mauvaise opinion d’un enfant qui ne veut pas se corriger.
La Mere.
Vous avez raison. Aussi Domitien devint toujours plus méchant, & lorsqu’il fut Empereur, il n’employa son autorité, son pouvoir qu’à tourmenter les hommes, & à leur faire autant de mal qu’il en avoit fait aux mouches dans son enfance. Il commit des crimes affreux. Il fut cruel & atroce. Il finit par être assassiné, & son nom est encore aujourd’hui en exécration.
Emilie.
Je le crois, il le mérite bien. Maman, je voudrois bien lire son histoire.
La Mere.
Vous la trouverez dans l’histoire Romaine, nous la lirons ensemble ; & je vous ferai aussi celle de Titus, qui a été le modèle des hommes par sa vertu & sa bonté. Quand il avoit passé un jour sans faire du bien, il disoit : Mes amis, j’ai perdu ma journée !
Emilie.
On devoit bien l’aimer ! Etoit-ce aussi un Empereur Romain ?
La Mere.
Oui, il avoit regné avant Domitien ; & vous me direz ce que vous pensez de l’un & de l’autre.
Emilie.
Oh ! je crois que j’aimerois mieux Titus… Ah, Maman, il pleut, vîte, vîte, allons-nous-en.
La Mere.
Et pourquoi ? Il fait très-chaud ; il ne tombe que quelques gouttes, la pluie ne durera pas, nous pouvons rester ; nos habits sont de toile & ne se gâteront pas.
Emilie.
Mais la pluie me tombe sur le nez, je n’aime pas cela.
La Mere.
Comme cela ne peut vous faire de mal, je vous conseille de vous faire à cette petite contrariété. Voulez-vous passer pour une mijaurée ?
Emilie.
Mais non, Maman… puisque vous y restez, j’y resterai bien aussi. Maman… puis-je faire du bien à quelque chose, moi ?
La Mere.
Sûrement.
Emilie.
Et à quoi ? Comment ? Voulez-vous bien me l’apprendre ?
La Mere.
Premierement, vous pouvez faire du bien à votre bonne par votre sagesse, votre docilité, votre douceur.
Emilie.
Ah, c’est bon !
La Mere.
Quand vous n’êtes pas raisonnable, quand vous avez de l’humeur dans mon absence, vous l’affligez, vous l’obligez à parler sans cesse, cela la fatigue & lui fait mal ; & c’est une bien mauvaise récompense que vous lui donnez des soins qu’elle prend de vous. D’ailleurs comme nous avons le cœur bon & compatissant, c’est un spectacle fâcheux & qui nous afflige de voir une petite fille qui se tourmente, & qu’on est obligé de punir pendant qu’on desireroit pouvoir lui rendre la vie douce & heureuse.
Emilie.
Mais si ma bonne vouloit me laisser faire tout à ma fantaisie, elle ne se tourmenteroit pas. Qu’est-ce qui en arriveroit ?
La Mere.
Il en arriveroit qu’elle manqueroit à son devoir, qu’elle perdroit ma confiance, & qu’elle seroit mécontente d’elle-même, parce qu’elle auroit à se reprocher tout le mal qui vous arriveroit.
Emilie.
Est-ce qu’il m’arriveroit du mal ?
La Mere.
Pouvez-vous en douter ? Toutes les fois que vous vous promenez dans le jardin, par exemple, si on vous laissoit faire, vous mangeriez tout le fruit ou meur ou verd que vous trouveriez à votre portée, & vous vous rendriez malade, peut-être même à en mourir.
Emilie.
Oh ! oui, j’entens cela, je sçais bien que si on ne m’empêchoit pas de manger du fruit entre mes repas, cela me feroit mal.
La Mere.
Mais vous ne le sçavez que parce qu’on vous en a avertie, & comme cela ne vous a pas suffi, on vous en a empêché. Je vous ai donné une gouvernante pour suppléer à la raison & à l’expérience qui vous manquent.
Emilie.
Vous êtes bien bonne, Maman. Tenez ; vous aviez raison, voilà déja la pluie passée… Mais tout ce qu’on m’apprend, Maman, c’est pourtant parce que vous le voulez, & si vous me laissiez faire quand je ne veux pas étudier, alors je ne serois pas tourmentée ?
La Mere.
Non ; mais je le serois moi, parce que j’aurois manqué à mon devoir & je serois malheureuse.
Emilie.
Est-ce que vous avez aussi des devoirs, Maman ?
La Mere.
Sans doute, il est de mon devoir de vous corriger de vos défauts, de vous en montrer les inconvénients, de vous punir quand vous faites mal ; sans quoi lorsque vous serez grande, vous auriez à me dire : Maman, j’ai des défauts qui rendent les autres & moi-même malheureux, il est trop tard à présent pour me corriger ; vous m’avez gâtée en me laissant faire à ma fantaisie, c’est votre faute si je suis si méchante ; votre complaisance m’est bien nuisible, & je finirois ma vie avec le regret d’avoir fait un mal que je ne pourrois pas réparer. Ainsi voilà encore un bien qu’il est en votre pouvoir de faire, c’est de profiter de mes avis, pour me préparer une vieillesse paisible & heureuse. J’emporterai au tombeau la satisfaction de n’avoir pas donné des soins à une ingrate, & je me glorifierai de toutes les vertus que vous vous efforcerez d’acquerir.
Emilie.
Ah, Maman… que je vous embrasse !… comme je veux être sage, comme je veux vous aimer ! Maman, dites-moi ; dites-moi, je vous prie, toutes les façons dont je puis faire du bien ?
La Mere.
Vous pouvez secourir les pauvres.
Emilie.
Comment, je n’ai pas d’argent.
La Mere.
Je ne vous en refuse pas pour cet usage ; mais il y a plus d’une maniere de les secourir ; en vous montrant sensible à leurs peines, & les consolant quand ils souffrent ; en leur parlant honnêtement, lorsque vous êtes forcée de refuser l’aumône qu’ils vous demandent ; en leur montrant le regret de ne pouvoir les satisfaire.
Emilie.
Mais cela ne leur donne rien.
La Mere.
Il est vrai ; mais si vous ajoûtez un refus dur & brusque à leur malheur, vous l’augmentez. Il est déja assez humiliant pour eux de tendre la main pour demander, sans augmenter leur honte par votre dureté ! Il n’y a que ceux qui demandent sans besoin, sans nécessité, qui ne méritent point de ménagement.
Emilie.
Pourquoi, Maman ?
La Mere.
Parce que c’est la paresse ou la bassesse de leur ame qui les y engage, & alors on ne doit ni leur donner, ni avoir d’égards pour eux, parce qu’il ne faut pas encourager les vices.
Emilie.
Ceux qui ne sont pas des pauvres & qui demandent autre chose que de l’argent, ont-ils tort ? Moi, par exemple, Maman, est-ce que je fais mal de vous demander quelque chose ?
La Mere.
Non, on peut demander à son pere & à sa mere tout ce dont on a besoin ; on le doit même ; mais on ne doit rien demander ni recevoir d’aucun autre. Les personnes bien nées y attachent tant de honte, qu’elles aimeroient mieux se passer de tout, que de le demander à d’autres qu’à leurs pere & mere.
Emilie.
Mais je ne comprens pas cela !
La Mere.
Etes-vous en état de rendre les présents qu’on pourroit vous faire ? d’en faire aux autres de même valeur ?
Emilie.
Non, puisque je n’ai rien.
La Mere.
Vous ne devez donc pas en recevoir, parce que vous contractez une obligation que vous que pouvez pas acquitter.
Emilie.
Mais si j’avois de l’argent ?
La Mere.
Il seroit bien plus court d’acheter vous-même ce que vous desireriez, que d’en avoir l’obligation à d’autres.
Emilie.
Et pourquoi ? Est-ce une honte de demander ce qu’on a envie d’avoir ?
La Mere.
C’est que vous vous mettez dans le même rang, & au même degré d’humiliation que ces pauvres qui demandent sans nécessité. Croyez-vous qu’il soit bien flateur d’inspirer le sentiment de la pitié ?
Emilie.
Non.
La Mere.
Ceux qui demandent par nécessité font pitié ; ceux qui demandent sans nécessité inspirent le mépris.
Emilie.
Je suis bien aise de sçavoir cela.
La Mere.
Rentrons, Emilie, il se fait tard. Nous allons à présent faire du bien à toutes ces pauvres plantes qui souffrent de la sécheresse. Il faut les arroser.
Emilie.
Est-ce que les plantes souffrent ?
La Mere.
Certainement. Voyez comme elles sont flétries & desséchées par l’ardeur du Soleil ! Elles ont soif. Elles sont aussi une production de la nature. J’aime à leur faire du bien.
Emilie.
Et les plantes sont-elles aussi un animal ?
La Mere.
Non ; on les appelle végétaux.
Emilie.
Qu’est-ce que cela veut dire, Maman ?
La Mere.
Ce que c’est ? Tenez, je m’en vais vous l’apprendre. Allez là-bas, cueillez cette tige d’épinard que vous voyez plus haute que les autres. Apportez-la-moi.
Emilie.
Elle est toute pleine de petits grains.
La Mere.
On recueille tous ces petits grains que l’on appelle graine ou semence, on les fait sécher au Soleil pour en ôter toute l’humidité ; ensuite on la met dans la terre, & cela s’appelle semer la graine. Quand elle y a été quelque temps, elle pousse une herbe semblable à celle-cy. Tout ce qui se met en terre en graine, ou pepin, ou noyau, & qui pousse au bout d’un temps plus ou moins long des racines, des feuilles, des fleurs, des fruits, des épis, des tiges, &c., s’appelle végétal.
Emilie.
Un arbre est-ce… quoi ! Maman, qu’est-ce que c’est ?
La Mere.
C’est un végétal.
Emilie.
Mais un arbre n’a pas de graine.
La Mere.
Pardonnez-moi, je vous la ferai voir. Mais allez vous deshabiller, & vous viendrez m’aider à arroser ces plates-bandes.

La Mere.
Qu’avez-vous, Emilie, vous êtes triste ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
Est-ce que vous n’êtes pas bien aise de me revoir ?
Emilie.
Pardonnez-moi ; mais…
La Mere.
Eh bien ?
Emilie.
Maman, je ne mérite pas que vous ayez la bonté de causer avec moi aujourd’hui.
La Mere.
Pourquoi cela, ma fille ?
Emilie.
C’est que pendant tout le temps que vous avez été absente… Tenez, Maman, permettez-moi de ne pas vous le dire. Je suis si humiliée de ce que j’ai fait, que je n’ai pas le courage de l’avouer.
La Mere.
Dès que vous sentez votre faute & que vous en êtes affligée, j’espere que vous vous corrigerez & que cela ne vous arrivera plus.
Emilie.
Oh, je vous le promets bien, Maman ! J’ai prié ma bonne de me le rappeller si je l’oubliois, afin de me mieux conduire ; car je suis trop mal à mon aise.
La Mere.
Vous avez raison ; c’est là le vrai secret pour vous corriger. Il n’y a que les méchants qui ne se souviennent pas du mal qu’ils ont fait. Quand les honnêtes gens ont eu un tort, ils se le rappellent toujours, afin de n’y plus retomber. Mais dites-moi donc la faute que vous avez faite. Vous sçavez que vous ne devez me rien taire, & qu’autant il est important pour votre réputation de cacher vos défauts aux autres, autant il est nécessaire de me les avouer.
Emilie.
Je dois vous obéir, Maman, & je vais vous dire tout. Eh bien, Maman, je n’ai rien fait, mais rien du tout, du tout, de ce que vous m’aviez ordonné : j’ai toujours joué, toujours baguenaudé, & je n’ai pas étudié.
La Mere.
Est-ce que votre bonne ne vous a pas engagée à travailler ?
Emilie.
Pardonnez-moi, Maman, ma pauvre bonne s’est donné bien de la peine pour m’y engager ; mais je ne sçais où j’avois l’esprit, je ne l’ai pas écoutée, & c’est ce qui me fait le plus de peine ; car c’est bien mal.
La Mere.
Vous avez raison ; mais j’espere au moins que vous n’avez pas mal reçu ses avis.
Emilie.
Oh non, Maman, je sçais bien que ce seroit vous manquer de respect, puisque c’est par votre ordre qu’elle me parle.
La Mere.
Eh bien ! qu’est-ce qu’il faut faire à présent ; car vous sçavez bien qu’il ne suffit pas d’être fâchée d’une faute commise, il faut la réparer.
Emilie.
Cela est vrai, Maman ; mais comment faire ? Je ferai tout de suite la pénitence que vous voudrez.
La Mere.
Ce n’est pas par une pénitence que l’on répare le temps perdu. Puisque vous avez employé à jouer le temps destiné à l’étude, ne trouvez-vous pas juste d’employer à l’étude le temps où vous jouez ordinairement ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
Il faut donc vous mettre à lire avec bien de l’attention. Vous allez lire tout haut auprès de moi, & les mots que vous n’entendrez pas, vous m’en demanderez l’explication.
Emilie.
Maman, je m’en vais sonner pour que ma bonne apporte mon Livre.
La Mere.
Non, cela ne vaut pas la peine de la déranger. Prenez un Livre sur ces tablettes ; celui que voilà au coin sur la seconde planche d’en bas.
Emilie.
Celui-là, Maman ?
La Mere.
Oui, apportez-le-moi.
Emilie.
Maman, ce sont des contes moraux.
La Mere.
Tant mieux, cela m’amusera.
Emilie.
Lequel lirai-je ?
La Mere.
Le premier.
Emilie.
Ah !… Maman…
La Mere.
Eh bien, quoi ?
Emilie.
C’est la… lisons le second, Maman !
La Mere.
Non, pourquoi ?
Emilie.
Maman, c’est la mauvaise fille.
La Mere.
Eh bien, nous verrons si elle ressemble à quelqu’un de notre connoissance.
Emilie.
Lirai-je tout haut ?
La Mere.
Sans doute, & prononcez bien.
Emilie lit.
« Dans une Ville de Province, presqu’aussi riche & aussi peuplée que Paris, un homme de qualité retiré du service vivoit avec sa femme. Ils tenoient un état considérable dans cette Ville & dans leur Terre qui en étoit peu éloignée. Ces deux époux s’aimoient tendrement, & adoroient tous deux une petite fille de sept ans, qui étoit le seul enfant qui leur restât de trois qu’ils avoient eus. Ils donnoient tous leurs soins à son éducation ; mais comme l’enfant n’y répondoit pas, ils prirent tous deux le parti de se retirer entierement dans leur Terre, ils quitterent la Ville pour n’être point distraits des soins que demandoit une éducation aussi difficile. Leurs amis blâmerent cette résolution ; mais la crainte de faire tort à la réputation de leur enfant, en dévoilant aux autres ses mauvaises dispositions, leur fit cacher les vrais motifs de leur retraite. Chacun raisonnoit diversement sur cet événement. Il y a toute apparence, disoit l’un, que leurs affaires sont dérangées, & il falloit bien que cela arrivât. Ils font une dépense excessive ! une table ouverte ! leur bourse au service de tout le monde ! C’est fort bien fait d’être généreux, mais il faut pourtant compter avec soi-même, sans quoi vous voyez ce qui en arrive. Mais non, répondoit un autre, ils payent bien exactement ; leurs affaires sont en ordre, mais je croirois plutôt que le Comte d’Orville est jaloux de sa femme. — Bon, jaloux ? Elle est si raisonnable, c’est la sagesse même… » Maman, qu’est-ce que c’est que d’être jaloux ?
La Mere.
Ma fille, c’est avoir la peur de n’être pas préféré aux autres.
Emilie.
Est-ce joli d’être jaloux ?
La Mere.
Non, cela fait bien du mal.
Emilie.
Oh ! je ne veux pas être jaloux…
La Mere.
Il faut dire jalouse.
Emilie.
Mais il y a jaloux dans le Livre.
La Mere.
C’est qu’on attribue ce défaut à un homme. Continuez de lire.
Emilie continue.
« C’est la sagesse même. J’en conviens, reprenoit un autre ; mais il faut un motif pour prendre un parti aussi violent, & ils n’en donnent point ; ils ont même annoncé qu’ils ne recevroient personne, excepté quelques amis très-intimes, & tout cela ne se fait pas sans raison. Mais, Messieurs, disoit le plus raisonnable de tous, pourquoi se presser de juger, pourquoi vouloir pénétrer dans les affaires des autres ? Et si c’étoit pour veiller de plus près à l’éducation de leur fille, que le Comte & la Comtesse d’Orville renoncent au grand monde, qu’en diriez-vous ? — Bon, quelle apparence ! si c’étoit-là leur motif, ils le diroient ; mais quitter tous les agréments de la vie pour une petite fille de sept ans ! quelle extravagance ! On donne à cela de la soupe, des maîtres, le fouet quand cela s’avise de raisonner, une poupée pour qu’elle vous laisse en repos : voilà à quoi pere & mere sont obligés. Quand ils font davantage, ils ont bien de la bonté. D’autant que j’ai sçu par un Valet qui a servi dans la maison, que cette petite fille est entêtée & maussade, ainsi elle ne vaut pas la peine que ses parents s’en occupent tant… » Ce Laquais-là étoit bien bavard.
La Mere.
Ils le sont tous.
Emilie.
A la place de M. le Comte d’Orville, je l’aurois bien fait taire.
La Mere.
Comment auriez-vous fait, & de quel droit empêcher un homme de dire ce qu’il a vu ?
Emilie.
Mais il ne faut dire du mal de personne.
La Mere.
Cela est vrai ; mais on ne peut pas toujours empêcher les autres de parler. Ne seroit-il pas plus court de se bien conduire, afin que ceux qui ne peuvent pas s’empêcher de parler, n’ayent que du bien à dire. Quand on se conduit mal, on s’expose à la médisance.
Emilie.
Quoi ? quand j’ai fait une faute, tous vos domestiques vont le dire, Maman ?
La Mere.
Mais quand vous faites bien, vous ne craignez pas les bavards. Il faut donc faire toujours le mieux possible, pour n’avoir pas l’inquiétude de ce qu’on dit de vous.
Emilie.
Je vais continuer, Maman. (Elle lit.) « Monsieur & Madame d’Orville n’ignorerent pas tout ce que l’on disoit d’eux ; mais contents d’eux-mêmes, & dans l’espérance de former au bien leur fille, ils partirent, résolus de ne revenir que quand ils pourroient la montrer dans le monde sans inconvénient pour elle. Pour mieux exciter son émulation, ils emmenerent avec eux une de leurs petites niéces à-peu-près de l’âge de leur fille, qu’on appelloit Pauline de Perseuil. Madame d’Orville prit une pauvre fille de condition dont elle connoissoit le caractére & les mœurs ; elle lui assura un sort, & en fit la gouvernante de sa fille & de sa niéce. » Qu’est-ce que c’est que les mœurs, Maman ?
La Mere.
C’est un mot qui exprime tout seul le résultat de toute la conduite d’une personne. On dit les bonnes mœurs, les mauvaises mœurs, les mœurs douces, &c…
Emilie lit.
« Mademoiselle d’Orville étoit paresseuse, volontaire, entêtée, n’avoit aucun sentiment de tendresse pour ses parents, & n’étoit occupée toute la journée que de ses joujoux & de sa parure. Dès qu’on vouloit l’appliquer à l’étude ou causer avec elle, pour lui apprendre ses devoirs, l’humeur s’en mêloit ; elle pleuroit, elle crioit, & il n’y avoit point de jour où elle ne subît deux ou trois punitions humiliantes. Pauline au contraire étoit douce, polie avec tout le monde ; elle ne recevoit pas un avis sans en être reconnoissante, & sans remercier la personne qui le lui avoit donné. Elle faisoit des progrès dans tout ce qu’on lui apprenoit ; enfin, elle étoit aimée & chérie de tout le monde, comme la petite d’Orville en étoit détestée. Celle-cy étoit jalouse de la préférence qu’on donnoit à Pauline, & elle n’avoit pas l’esprit de voir qu’il ne tenoit qu’à elle de se faire aimer de même en corrigeant ses défauts & son humeur ; mais elle aimoit mieux s’en prendre aux autres de ses torts que de se rendre justice. Son pere & sa mere lui disoient sans cesse : Ma fille, vous serez toute votre vie malheureuse. D’autres parents, moins bons que nous, vous auroient déja abandonnée ; il ne tient qu’à vous de jouir du sort de votre cousine. Voyez comme elle est heureuse ! C’est qu’elle est sage & qu’elle suit nos avis. Mademoiselle d’Orville écoutoit à peine ce qu’on lui disoit, & retournoit à l’étude ou au jeu sans être corrigée. Elle passa ainsi quatre ou cinq ans toujours dans les pleurs, dans l’humeur & en pénitence. Ses parents la voyant incorrigible, userent avec elle de la plus grande rigueur, & Mademoiselle d’Orville devint si malheureuse, qu’elle commença à faire des réflexions. Sa cousine avoit acquis toutes sortes de talents. Elle avoit beaucoup lu, beaucoup appris ; elle commençoit à jouir du fruit de la peine qu’elle s’étoit donnée, elle comprenoit à merveille toutes les conversations qu’elle entendoit, lorsqu’elle étoit en compagnie, & lorsqu’elle se trouvoit seule, elle ne s’ennuyoit jamais, parce qu’elle s’occupoit de ses talents. La musique, le dessein, l’ouvrage ; elle passoit d’une occupation à une autre ; & n’étant jamais desœuvrée, elle n’avoit jamais d’humeur.
« Un jour que Monsieur & Madame d’Orville se promenoient dans leur jardin avec leur fille & leur niéce, il arriva que la petite d’Orville répondit une impertinence à sa cousine. Le pere & la mere, après l’avoir obligée à demander excuse à Pauline, l’envoyerent dans sa chambre. Il falloit passer par le salon pour y aller. Un homme & deux femmes qui achevoient une partie de jeu y étoient restés. La petite d’Orville qui le sçavoit n’osa jamais passer devant eux ; elle s’assit en dehors sur les marches du perron, & ne remuoit pas de peur d’être apperçue. En effet, ceux qui étoient dans le salon ne la soupçonnoient pas d’être si près. Ils parloient d’elle. Quelle différence, disoit une de ces Dames, de Pauline à la petite d’Orville. Pauline est douce, sensible, prévenante, remplie de talents ; elle est d’un caractére charmant : la petite d’Orville est maussade, méchante ; elle est insensible, paresseuse, ignorante ; elle n’aime personne, & personne ne l’aime, ni ne l’aimera jamais. J’ai vingt fois conseillé à son pere de la mettre dans un Couvent pour toute sa vie. Qu’est-ce qu’on peut faire d’un si mauvais sujet dans le monde ? — Pour moi, disoit l’autre Dame, elle me fait tant de mal à voir, que quand elle paroît je tourne la tête de l’autre côté. Ah, la vilaine petite fille ! Est-il possible que cette enfant ne soit pas touchée du chagrin qu’elle donne tous les jours à son pere & à sa mere ? J’ai vu Madame d’Orville pleurer de douleur de l’entêtement & du mauvais caractére de sa fille. Vous avez bien quelques reproches à vous faire, Monsieur le Baron, disoit-elle à l’homme qui jouoit avec elle ; il y a de l’inhumanité à vous de jouer, de causer avec elle, comme si elle le méritoit. La petite d’Orville n’a pas l’esprit de voir que vous vous moquez d’elle, que vous vous amusez de ses ridicules & de ses défauts, & que vous vous embarrassez fort peu de ce qu’elle deviendra. Ma foi, Madame, reprit le Baron, ce n’est ni ma fille, ni ma niéce ; Dieu me préserve d’avoir jamais une femme comme elle, mais elle ne mérite nul égard ; ainsi je m’en amuse. Si je croyois qu’il y eût la moindre ressource dans son caractére, je ne la traiterois pas comme une marionnette… » Ah ! ah ! cela est bon à sçavoir. Je connois quelqu’un qui cause, & qui rit toujours, toujours avec moi, que je sois sage ou non, apparemment qu’il me regarde aussi comme une marionnette.
La Mere.
Cela pourroit bien être, jugez-en vous-même.
Emilie.
Oh ! j’en suis persuadée ; mais voyons la suite, Maman, cela est fort interessant ! (Elle lit.) « Une marionnette… Cette conversation frapa Mademoiselle d’Orville, & lui ouvrit les yeux sur sa conduite. Elle avoit alors douze ans ; elle sentit qu’il étoit plus que temps de se corriger. Elle entra dans le salon fondant en larmes. Elle se jetta aux pieds de ces Dames. Oui, Mesdames, dit-elle, je mérite tout ce que vous avez dit ; mais je vous demande grace, je veux absolument me corriger. Je veux qu’on dise à l’avenir autant de bien de moi que de ma cousine. Ne m’abandonnez pas ! Aidez-moi, je vous en conjure, à me faire pardonner de papa & de maman que j’ai rendu malade ! Oh, que je suis malheureuse ! Que je suis indigne de ses bontés ! Jamais, jamais je ne pourrai réparer mes torts, Mesdames, je n’ose paroître… Elle avoit le visage contre terre, elle sanglottoit, mais ses pleurs ne couloient plus, comme auparavant, par dépit & par humeur ; son cœur étoit vraiment touché & ses larmes étoient celles du repentir. Les Dames étonnées de ce changement, mais touchées de l’aveu qu’elle faisoit elle-même de ses fautes, (car c’étoit la premiere fois qu’elle avouoit ses torts,) commencerent à en prendre meilleure opinion, elles la releverent. Une d’elles lui dit : Mademoiselle, si vous êtes vraiment touchée, si vous sentez vos torts comme je l’espere pour vous, vous pourrez vous corriger & devenir aussi aimable que votre cousine, mais vous avez bien du chemin à faire. J’avoue que je ne répondrois pas de vous, & si j’étois votre mere, je voudrois voir avant de vous pardonner, si ces bonnes résolutions dureroient… » Maman !
La Mere.
Quoi ?
Emilie.
Cette Dame est bien dure ; je crois que ses enfants sont bien malheureux.
La Mere.
Elle n’en avoit pas.
Emilie.
Ah ! tant mieux !… Oh, je crois moi, que Mademoiselle d’Orville se corrigera. Voyons ! (Elle lit.) « Mademoiselle d’Orville lui dit : Madame, je ne demande pas que mon papa & maman me traitent comme ma cousine ; mais seulement qu’ils me permettent de me jetter à leurs pieds, qu’ils m’aident, & vous aussi, Mesdames, à réparer mes torts. Et vous, Monsieur, dit-elle au Baron, vous verrez que je ne suis pas une marionnette : & que je mérite autant d’égards que ma cousine. Mademoiselle, lui répondit le Baron, comme vous ne vous respectiez pas vous-même, il me semble que les autres pouvoient s’en dispenser aussi. Je mérite toutes ces humiliations, reprit Mademoiselle d’Orville ; mais patience. L’autre Dame, qui n’avoit pas encore parlé, dit tout bas à son amie : Si vous aviez eu des enfants, vous ne seriez pas si sévere avec celle-cy, & vous l’aideriez à se maintenir dans ses bonnes résolutions. Un repentir sincere mérite d’être encouragé… » Ah, la bonne Dame je l’aime !… Où est-ce que j’en suis ? Ah !…
« Un repentir sincere mérite d’être encouragé. Elle prit Mademoiselle d’Orville par la main. Venez, ma chere petite, lui dit-elle, voilà le premier moment où je me suis interessée à vous. Je vais vous mener à votre maman. La petite d’Orville se jetta dans ses bras : Madame, lui dit-elle, que je vous ai d’obligations ! je vous assure que vous ne vous en repentirez pas.
« Mademoiselle d’Orville n’avoit plus cette contenance insolente qui révoltoit tout le monde contre elle. Elle n’osoit approcher de son pere & de sa mere. Elle trembloit, non pas comme auparavant de la peur de la punition, mais de la honte que lui inspiroient ses torts. Ils la reçurent avec indulgence ; elle en fut pénétrée de reconnoissance. Sa mere la serra tendrement dans ses bras, & lui disoit : Ah, mon enfant, je t’en conjure, ne te rens pas malheureuse ! que tes résolutions soient durables, & n’aies point à te reprocher la mort de ta mere ! Ta conduite a détruit ma santé ! Que deviendrois-tu, si tu me perdois par ta faute ? Tu serois un objet d’horreur ! Personne ne voudroit te voir ! Tout le monde te fuiroit & tu te fuirois toi-même, mais tes remors te suivroient par-tout ! La petite d’Orville fondoit en larmes, sanglotoit & serroit sa maman en criant : Maman ! Maman ! Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi ! je veux tout réparer !
« En effet, de ce moment elle s’appliqua à vaincre son caractére. Elle eut plus de peine qu’une autre, mais elle y parvint. Elle étudioit jour & nuit, & en deux ans de temps elle eut une legére teinture de tout ce que sa cousine sçavoit à fonds, car le temps perdu ne peut se réparer entierement ; mais on lui sçut gré des efforts qu’elle faisoit, & sur-tout d’avoir réprimé son caractére. On commença à lui marquer de l’estime & des égards. Le Baron ne la traita plus en enfant ; il ne cherchoit plus à polissonner avec elle. Il lui parloit avec le respect & la décence que les hommes observent & doivent aux Demoiselles, & auxquels ils ne manquent jamais sans qu’il y ait de leur faute. Monsieur & Madame d’Orville pressés d’effacer la mauvaise réputation que malgré leurs précautions leur fille s’étoit faite, quitterent le séjour de leur Terre. Ils revinrent en Ville, & bientôt tout le monde s’empressa de donner à Mademoiselle d’Orville les éloges qu’elle méritoit. On va incessamment la marier, & l’on ne doute pas qu’elle ne fasse un établissement avantageux. Pauline s’est mariée l’année derniere. Elle a sur sa cousine la supériorité des talents & de la science, parce qu’elle n’a pas, comme elle, perdu cinq années de temps qui sont bien précieuses, & dont Mademoiselle d’Orville n’a connu le prix que quand il n’en étoit plus temps. » Voilà tout, Maman. Je n’avois jamais lu cette histoire toute entiere.
La Mere.
Eh bien, qu’en dites-vous ?
Emilie.
Je dis qu’il ne faut pas perdre son temps comme Mademoiselle d’Orville.
La Mere.
Vous voyez donc que vous avez eu tort de perdre votre matinée, car elle est passée, de même que tous les jours où vous avez mal fait vos devoirs. Est-il en votre pouvoir de faire revenir tous ces jours-là ?
Emilie.
Mon Dieu non, Maman, mais je ferai bien à l’avenir ?
La Mere.
Mais ce qui est passé est passé. Mettez-vous à votre table, & écrivez jusqu’au dîner.
Emilie.
Maman, je voudrois vous demander quelque chose sur ce que j’ai lu.
La Mere.
Cette après-dînée nous en causerons en nous promenant si vous êtes raisonnable.
Emilie.
Mais s’il vous vient du monde ?… Maman, j’ai envie de faire lire cette histoire à une certaine personne… à un Monsieur, qui m’apporte toujours des oranges de la part de M. Arlequin ; vous sçavez bien ?
La Mere.
Oui, je sçais bien ; mais je ne crois pas que cela soit nécessaire.
Emilie.
Pourquoi, Maman ?
La Mere.
Nous dirons cela tantôt. Vous n’avez que le temps d’écrire avant le dîner, ne le perdez pas !


Emilie.
Maman, Maman, embrassez-moi !
La Mere.
Très-volontiers. Vous me direz, sans doute, pourquoi.
Emilie.
Oui, Maman ; c’est que je le mérite bien. C’est que je suis bien sçavante à présent, je sçais trois choses de plus.
La Mere.
Trois choses, mais vraiment c’est beaucoup de choses. Sont-elles belles ? Sont-elles utiles ?
Emilie.
Vous allez voir, Maman, c’est que je sçais qu’il y a quatre Eléments, le feu, l’eau, la terre & l’air.
La Mere.
Bon !
Emilie.
Oui, Maman, c’est très-vrai. Et puis élément veut dire principe qui fait agir. Vous voyez que je l’ai bien retenu. Mais ce n’est pas tout.
La Mere.
Eh bien ?
Emilie.
Tenez, Maman, écoutez. Il y a trois choses encore qu’on appelle les trois regnes ; le regne végétal, que vous avez eu la bonté de m’expliquer l’autre jour ; ce sont les fruits, les arbres, tout ce qui se seme ou se plante ; vous sçavez bien ? Et puis le regne minéral, qui sont les pierres, l’or, l’argent, le fer, qu’on appelle mines, & qui se forment au fond de la terre ; & puis le regne animal, qui sont tous les animaux, les bêtes, les poissons, les oiseaux & les hommes, & voilà de quoi tout le monde est composé.
La Mere.
Et c’est pour tout cela qu’il a fallu vous embrasser ?
Emilie.
Oui sûrement, ma chere maman, est-ce que vous n’êtes pas bien aise, bien contente de moi ? Je sçais tout ce qu’il y a dans le monde à présent.
La Mere.
Vous croyez cela ?
Emilie.
Mais, oui, Maman ; est-ce qu’il y a encore autre chose ?
La Mere.
Et à qui avez-vous l’obligation de cette belle science ?
Emilie.
Maman, j’aurai l’honneur de vous le dire. Mais dites-moi donc, ma chere Maman, si vous n’êtes pas bien contente de moi ?
La Mere.
Je le suis de votre émulation & du plaisir que vous avez en croyant m’en avoir fait. Je vous en sçais très-bon gré, je vous en remercie même, parce que cela me prouve que vous cherchez à me plaire. Mais, ma chere Enfant, si vous voulez me faire un bien plus grand plaisir encore, il faut oublier tout cela.
Emilie.
Pourquoi donc, Maman ?
La Mere.
C’est que vous ne comprenez pas un mot de ce que vous croyez si bien sçavoir, & que rien n’est si dangereux à votre âge que de parler de choses qu’on n’entend pas ; il en arrive toutes sortes d’inconvénients.
Emilie.
Mais pardonnez-moi, Maman, j’entens très-bien tout ce que j’ai appris.
La Mere.
C’est ce que nous allons voir. Reprenons un peu ce que vous avez dit. Sçavez-vous qu’il y a de quoi causer huit jours, avant de comprendre un seul des grands mots dont vous m’avez fait une si belle litanie.
Emilie.
Ah ! tant mieux. Maman, j’aime tant à causer avec vous ; & puis il pleut depuis ce matin ; j’espere qu’il ne viendra personne, nous aurons bien du temps.
La Mere.
Profitons-en. Eh bien, vous dites donc qu’il y a quatre Eléments.
Emilie.
Oui, Maman, le feu, l’air, l…
La Mere.
Oh ! doucement, je ne vais pas si vîte, moi, je dis comme Monsieur Gobemouche, entendons-nous.
Emilie rit de tout son cœur.
Monsieur Gobemouche… c’est un drolle de nom. Qu’est-ce que c’est que Monsieur Gobemouche ?
La Mere.
C’est un original qui n’a que faire à notre conversation, nous en parlerons une autre fois. Nous disions qu’il y a quatre Eléments, & n’y en a-t-il que quatre.
Emilie.
Je ne sçais pas, on ne m’en a montré que quatre.
La Mere.
Et qu’est-ce qu’ils font ces quatre Eléments que vous connoissez ?
Emilie.
Ah ! j’avois oublié… ils font aller le monde.
La Mere.
Mais qu’est-ce que c’est que le monde ?
Emilie.
Mais, Maman, c’est tout cela ; c’est Paris, c’est le bois de Boulogne, c’est Saint Cloud… Voilà tout.
La Mere.
Voilà tout ce que vous en connoissez. Eh bien, vos quatre Eléments font donc aller Saint Cloud & le bois de Boulogne ? Mais comment cela ?
Emilie.
Ah ! je ne sçais pas.
La Mere.
Bon, voilà déja votre science en défaut ! Tâchons de nous remettre un peu sur la voie. Voyons qu’est-ce qu’il y a dans le monde que vous connoissez ? De quoi est-il composé ? qu’est-ce que vous y voyez ?
Emilie.
Des champs, des maisons, des rivieres, des hommes, des animaux ; est-ce cela, Maman, qui est le monde ?
La Mere.
Oui, il y a de tout cela dans le monde. Mais le ciel, les astres & beaucoup d’autres choses dont je ne vous parlerai pas encore en font aussi partie. Revenons à nos moutons. Vous m’avez parlé de rivieres. Qu’est-ce que c’est que des rivieres ?
Emilie.
C’est de l’eau.
La Mere.
Mais voilà de l’eau dans cette caraffe ; est-ce que c’est une riviere ?
Emilie.
Non, Maman ; mais une riviere, c’est pourtant de l’eau.
La Mere.
Cela est vrai, il y a de l’eau dans une riviere ; mais pour que cette eau forme une riviere qu’est-ce qu’il faut ?
Emilie.
Ah ! je le sçais, je m’en souviens, ma bonne me l’a dit. D’abord elle sort de terre, elle forme un petit ruisseau, & puis ce petit ruisseau augmente, augmente, & puis quand il est bien grand, on l’appelle riviere. N’est-ce pas cela, Maman ?
La Mere.
A la bonne heure. Une riviere est donc composée d’une grande quantité d’eau qui suit son cours…
Emilie.
Qu’est-ce que cela veut dire qui suit son cours ?
La Mere.
Cela veut dire qu’elle ne se perd pas dans la terre depuis l’endroit où elle en est sortie, jusqu’à ce qu’elle trouve une autre riviere où elle retombe, & où elle se perd.
Emilie.
Ah ! ah ! & la Seine, où est-ce qu’elle se perd ?
La Mere.
La Seine va tomber dans la mer, & à cause de cela on l’appelle un fleuve. Voilà la différence des fleuves aux rivieres. Les fleuves retombent dans la mer, & les rivieres retombent dans d’autres rivieres.
Emilie.
Mais on dit pourtant la riviere de Seine.
La Mere.
Cela est vrai, mais c’est un fleuve. Ah çà, il y a une heure que nous parlons & d’eau & de riviere, & il n’est pas bien sûr encore que nous nous entendions. Qu’est-ce que c’est que de l’eau ?
Emilie.
C’est ce qui sert à boire, à faire du thé.
La Mere.
Vous me dites là son usage, mais vous ne me dites pas ce que c’est.
Emilie.
Maman, je ne le sçais pas ; je vous prie de vouloir bien me le dire.
La Mere.
Ah ! je sçavois bien que votre science étoit une science de perroquet, dès qu’on vous change la demande, vous n’y êtes plus, & c’est une preuve que vous n’attachez nulle idée à ce que vous dites. L’eau est un des quatre Eléments de la nature.
Emilie.
Ah ! cela est vrai.
La Mere.
Mais ces quatre Eléments, qui font aller le monde, à ce que vous dites, comment s’y prennent-ils pour le faire aller ?
Emilie.
Ah, Maman, cela n’y étoit pas !
La Mere.
Comment cela n’y étoit pas ? où cela n’étoit-il pas ?
Emilie.
Dans le Livre où j’ai appris.
La Mere.
Vous avez appris dans un Livre ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
Emilie, sonnez. Qu’on apporte de l’eau froide dans une petite jatte.
Emilie.
Pourquoi faire, Maman ?
La Mere.
Vous allez voir. (On apporte une jatte d’eau sur la table.) Venez ici, Emilie, approchez votre main, & voyez comme cette eau est froide.
Emilie.
Oui, c’est bien froid.
La Mere.
Je vais mettre mes mains dans cette jatte, & je les y laisserai tandis que nous allons parler d’autres choses, ensuite vous verrez. Dites-moi, qu’est-ce que c’est que ce Livre qui vous a rendu si habile ?
Emilie.
Maman, vous sçavez bien qu’hier, quand vous m’avez amenée à Paris, vous m’avez descendue au Palais Royal avec ma bonne, pendant que vous alliez à vos affaires.
La Mere.
Eh bien !
Emilie.
J’ai trouvé Mademoiselle Louise, c’est ma bonne amie, Maman, vous sçavez bien ; elle m’a montré un joli petit Livre qu’on lui a donné pour apprendre & pour s’amuser. Il est joli !… il est tout bleu, & il y avoit cela dedans ; & je l’ai appris bien vîte, parce que j’ai dit, Maman sera bien surprise, & cela lui fera plaisir.
La Mere.
Emilie, si vous voulez être bien raisonnable, nous ne nous quitterons plus, & vous ne sortirez plus sans moi.
Emilie.
Ah, Maman, que je serai aise ! Oh je vais être bien sage ; mais pourquoi donc êtes-vous fâchée de ce que j’ai appris les Eléments & les… les quoi donc ? Comment est-ce que l’on appelle ce que j’ai appris encore ?
La Mere.
C’est que je ne veux pas faire de vous un perroquet.
Emilie.
Un perroquet ! c’est un oiseau ?
La Mere.
Oui, c’est un oiseau qui répéte les mots qu’il a entendus, mais qui ne sçait ce qu’il dit, parce qu’il ne peut pas comprendre les mots qu’il prononce, & quand vous répétez ce que vous avez entendu dire à tort & à travers, comme cela vous arrive souvent, vous êtes comme un perroquet.
Emilie.
Mais, Maman, quand je demande l’explication des choses que je n’entens pas, je ne suis pas comme un perroquet.
La Mere.
Cela est vrai ? mais il y a des choses que l’on ne sçauroit vous expliquer, parce que vous n’êtes point en âge de les comprendre ; ce que l’on pourroit vous dire ne serviroit qu’à brouiller vos idées, ou vous en donneroit de fausses. Par exemple, vous sçavez très-bien lire à présent ; mais avant que vous le sçussiez, si l’on avoit commencé à vous faire lire un mot en entier sans vous faire connoître vos lettres, qu’est-ce qui en seroit arrivé ?
Emilie.
Je crois que je n’aurois pas pu.
La Mere.
Pardonnez-moi ; le mot Maman, par exemple, à force de vous le montrer & de vous le faire prononcer, toutes les fois que vous auriez retrouvé ce mot dans un Livre, vous l’auriez enfin reconnu, & vous auriez dit, c’est Maman ; mais vous n’auriez pas sçu que par-tout où vous auriez trouvé une M & un a, cela fait Ma, que par-tout où vous auriez trouvé M, a, n, cela faisoit man. De même si l’on commence par vous expliquer aujourd’hui nombre de mots qui demandent des connoissances que vous n’avez point encore, vous n’en serez pas plus avancée que si l’on vous avoit fait lire par routine & par mémoire, sans vous apprendre à épeler.
Emilie.
Ah ! cela est vrai, Maman, je comprens cela.
La Mere.
Voilà pourquoi il est si essentiel de ne rien faire, absolument rien sans ma permission. Voilà pourquoi je ne vous laisse pas lire dans tous les Livres, & pourquoi je ne vous laisse pas causer avec toutes sortes de personnes. Et voilà pourquoi, Emilie, je vous recommande tant de ne jamais vous servir de termes & de mots que vous ne comprenez pas, avant de m’en avoir demandé l’explication, soit que vous les ayez lus, soit que vous les ayez entendu dire.
Emilie.
Et pourquoi, Maman, ne faut-il demander qu’à vous ?
La Mere.
C’est que personne ne prend à vous un aussi grand interêt que moi. C’est que les questions des enfants fatiguent & importunent tout autre que leur mere, & pour s’en débarrasser, on leur répond souvent la premiere chose qui vient en tête, qu’elle soit juste ou non.
Emilie.
Fort bien, on m’attrape donc quand je demande aux autres ce que je n’entens pas ?
La Mere.
Cela arrive très-souvent, & lorsque l’on a une fois une idée fausse dans la tête, il est très-difficile de la détruire, sur-tout à votre âge où vous n’êtes pas en état d’en sentir le défaut.
Emilie.
Maman, voilà qui est fait, je ne passerai plus un mot que je n’entens pas sans vous le demander, & je ne le demanderai qu’à vous, puisque vous voulez bien m’instruire… & puis je dois vous obéir.
La Mere.
Voilà ce qui s’appelle de la raison.
Emilie.
Et puis vous ne m’attrapez pas, vous Maman, vous ne m’avez jamais trompée… mais pourquoi donc avez-vous toujours les mains dans cette eau ?
La Mere.
Vous souvenez-vous comme elle étoit froide quand on l’a apportée ?
Emilie.
Oui, Maman, elle étoit bien froide.
La Mere.
Eh bien, touchez-la à présent.
Emilie.
Ah ! elle ne l’est plus. Vos mains l’ont échauffée.
La Mere.
Et comment cela s’est-il fait ?
Emilie.
C’est que vous aviez chaud.
La Mere.
Mais qu’est ce qui fait que j’avois chaud ?
Emilie.
Je ne sçais pas.
La Mere.
Qu’est-ce qui vous réchauffe quand vous avez froid ?
Emilie.
C’est le feu. Mais on n’a pas de feu dans le corps.
La Mere.
Pardonnez-moi, on y a du feu, & si l’on n’en avoit pas, on ne pourroit pas vivre ; le sang se glaceroit dans les veines & l’on mourroit. Ce feu s’accroît & ensuite diminue avec l’âge, & voilà pourquoi le vieux bon homme que vous avez vu l’autre jour ne pouvoit pas se rechauffer, quoique nous souffrions tous de la chaleur.
Emilie.
Oh ! ce pauvre bon homme, je m’en souviens, comme il trembloit ; ma bonne lui fit boire du vin. Il n’avoit donc plus de feu dans le corps ? Mais moi, ai-je du feu ?
La Mere.
Sans doute ; mais nous y avons aussi de l’eau.
Emilie.
Bon !
La Mere.
Sûrement, quand vous pleurez, qu’est-ce qui tombe de vos yeux ?
Emilie.
Ah ! cela est vrai ; les larmes, c’est de l’eau.
La Mere.
Si l’on n’avoit pas cette eau qui dans le corps humain s’appelle liqueur, on mourroit desséché comme les plantes que vous voyez flétries & prêtes à périr, quand la pluie ne les secoure pas.
Emilie.
Voilà pourquoi vous les arrosez, n’est-ce pas, Maman ?
La Mere.
Et voilà pourquoi vous buvez ; c’est pour entretenir…
Emilie.
Ah !… mais, Maman, pourquoi est-ce que j’ai soif, puisque j’ai de l’eau dans le corps ?
La Mere.
On a plus ou moins de soif, suivant que le feu qui nous anime est plus ou moins fort & qu’il nous desséche plus ou moins.
Emilie.
C’est donc pour l’éteindre qu’il faut boire ?
La Mere.
Non, c’est pour maintenir l’équilibre nécessaire à la vie entre les solides & les liquides.
Emilie.
Je n’entens pas cela, Maman.
La Mere.
Je le crois bien ; aussi je ne vous ai répondu que pour vous faire voir qu’il y a des choses au-dessus de votre entendement, & dont il vaut mieux remettre l’explication à un autre temps. Reprenons où nous en étions. Vous voyez que le feu & l’eau sont nécessaires à la vie ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
A présent, retenez votre respiration… bouchez-vous bien la bouche & le nez.
Emilie.
Maman, j’étouffe, je ne peux pas.
La Mere.
Vous voyez donc bien que l’air est aussi nécessaire à la vie que le feu & l’eau. Mais ce n’est pas tout, Emilie. Notre chair est une matiere qui est sujette à la corruption, & lorsqu’elle est desséchée, elle tombe en poussiere & devient terre.
Emilie.
Oui, Maman, j’ai vu cela dans mon Catéchisme historique.
La Mere.
Eh bien, cette terre, le feu, l’air & l’eau sont les principes de la vie. Si vous étiez privée d’une de ces choses, vous ne pourriez pas vivre, comme je vous l’ai fait voir.
Emilie.
Cela est vrai.
La Mere.
Et ces quatre choses, le feu, l’eau, la terre & l’air sont ce qui donne la vie à tout ce qui existe dans la nature.
Emilie.
Mais ce n’est donc pas des Elements, comme dit ce Livre ?
La Mere.
Pardonnez-moi, on appelle la terre, le feu, l’air & l’eau, les quatre Elements de la nature, parce qu’élément veut dire principe d’une chose, ce qui lui fait être ce qu’elle est. A présent, vous entendez bien qu’élément veut dire principe d’une chose ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
Eh bien, on dit aussi les éléments d’une science, les éléments de l’écriture, les éléments de la lecture. Qu’est-ce que cela veut dire, par exemple, les éléments de l’écriture ?
Emilie.
Mais, ce n’est pas le feu, la terre…
La Mere.
Non ; ce sont les éléments de la nature, ceux-là.
Emilie.
Mais on ne m’a pas dit les autres.
La Mere.
Qu’est-ce que nous sommes convenues qu’éléments vouloient dire ?
Emilie.
Eléments veut dire principes.
La Mere.
Eh bien, qu’est-ce que c’est que les éléments de l’écriture ?
Emilie.
Ah ! c’est-à-dire les principes de l’écriture.
La Mere.
Cela est vrai, quand on dit les éléments d’une science, on entend les principes d’une science, & quand on dit les quatre éléments de la nature, on entend le feu, l’eau, la terre & l’air, qui sont les principes de la vie.
Emilie.
A présent, j’entens bien, & je ne l’oublierai pas… Maman, vous avez donc lu tous les Livres ?
La Mere.
Je ne vous en donne point à lire sans les avoir lus, & je vous en ai dit la raison.
Emilie.
Je m’en suis bien apperçue ; car l’autre jour en lisant l’histoire de la mauvaise fille, vous sçaviez que cette Dame que je trouvois si méchante n’avoit pas d’enfants… A propos, Maman, pourquoi n’est-il pas nécessaire que nous fassions lire cette histoire à un certain Monsieur qui polissonne toujours avec moi ?
La Mere.
C’est que j’espere que vous serez bientôt assez raisonnable pour qu’on ne polissonne plus avec vous.
Emilie.
Mais, Maman, si vous lui disiez que vous ne voulez pas ?
La Mere.
Ne vous rappellez-vous pas que le Baron répondoit à Mademoiselle d’Orville, que comme elle ne se respectoit pas elle-même, il croyoit que les autres pouvoient être dispensés de la respecter.
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
C’est donc la faute d’une Demoiselle quand les hommes ont un air trop libre avec elle, & c’est votre faute quand on polissonne avec vous.
Emilie.
Mais comment faut-il donc faire pour se faire respecter ?
La Mere.
Il faut rester assise auprès de sa mere ou à sa table à s’amuser. Il ne faut point courir par la chambre comme une folle, en jettant ses bras par-dessus la tête, & levant les pieds d’une maniere indécente. Il ne faut pas adresser la parole aux hommes ; mais quand ils vous parlent, il faut seulement leur répondre poliment, & avec assez de sérieux pour montrer que vous ne voulez pas qu’on vous approche ; & toutes ces attentions sur soi-même & sur son maintien s’appellent la pudeur.
Emilie.
Mais, Maman, pourquoi ne voulez-vous pas dire à ces Messieurs que j’ai de la pudeur ?
La Mere.
C’est qu’ils ne me croiroient pas en vous voyant vous conduire comme vous le faites. Lorsqu’on en a, elle se voit bien sans qu’il soit besoin de le dire, & il ne faut pas qu’on croie que c’est moi qui vous empêche de vous familiariser avec les hommes ; il faut que ce soit votre contenance, votre conduite qui leur en impose ; car si elle se trouvoit contraire à mes propos, tout ce que je dirois ne vous garantiroit de rien, & on croiroit que ma tendresse pour vous m’empêche de vous voir comme vous êtes.
Emilie.
Cela est vrai. Mais, Maman, tout ce que vous dites est vrai.
La Mere.
Si vous en êtes persuadée, comme je l’espére, vous en profiterez. Mais j’ai encore une autre vérité à vous apprendre, qui est une suite de ce que nous venons de dire, c’est qu’une Demoiselle bien née…
Emilie.
Qu’est-ce que c’est qu’une Demoiselle bien née ?
La Mere.
C’est-à-dire, qui a des dispositions naturelles à la vertu & un desir très-vif de fuir le mal.
Emilie.
Eh bien, Maman, qu’est-ce que fait une Demoiselle bien née ?
La Mere.
Elle doit s’accoûtumer de bonne heure à n’avoir pas de garde plus sûre qu’elle-même ; c’est à vous à en imposer, ce n’est pas à moi. Car si c’est moi qui oblige les hommes à vous respecter, vous voyez bien que si je suis un instant éloignée de vous, ils ne vous craindront plus, & c’est votre ressentiment qu’il faut leur faire craindre, ce n’est pas le mien.
Emilie.
Allons, je prendrai bien garde à moi, & je ferai le mieux que je pourrai.
La Mere.
Vous voyez bien aussi que si vous faisiez lire l’histoire de la mauvaise fille, vous vous exposeriez à vous faire dire que vous lui ressemblez à beaucoup d’égards. Il vaut bien mieux vous corriger de votre étourderie, de votre legéreté, & vous verrez que vous n’aurez plus besoin alors de me prier de faire des leçons aux autres.
Emilie.
Maman, je croyois… Ah ! Maman, à propos j’ai oublié… ma bonne m’a dit de vous prier, si vous envoyez à Paris, de faire passer chez la Couturiere ; elle n’a pas apporté ma robe neuve, elle l’avoit promise pour aujourd’hui.
La Mere.
Eh bien, apparemment qu’elle n’est pas finie, ce sera pour un autre jour.
Emilie.
Oh ! c’est que je serai bien heureuse quand j’aurai ma robe neuve.
La Mere.
Eh ! qu’est-ce qu’une robe neuve peut faire au bonheur ?
Emilie.
C’est que je suis bien aise d’être parée.
La Mere.
Est-ce que vous n’avez jamais eu de chagrin les jours où vous avez été bien parée ? N’avez-vous jamais pleuré avec une robe neuve ?
Emilie.
Oh, pardonnez-moi !
La Mere.
Est-ce que l’on vous accorde tout ce que vous voulez les jours de parure ?
Emilie.
Non pas toujours.
La Mere.
Est-ce que mes amis, est-ce que moi-même, nous faisons plus d’attention à vous, quand vous avez une belle robe ?
Emilie.
Mais non, Maman.
La Mere.
Quelles sont les occasions où l’on s’occupe le plus de vous ? où l’on vous accorde tout ce que vous desirez, & où vous éprouvez cette satisfaction intérieure qui fait que vous êtes si contente de vous, de moi & des autres ?
Emilie.
C’est quand je n’ai point d’humeur, quand j’ai été bien obéissante, & que j’ai rempli tous mes devoirs… Là… tout couramment sans chercher à me distraire.
La Mere.
Vous voyez donc bien qu’une robe neuve ne rend pas heureuse ; car vous avez beau être parée, vous n’en avez pas été moins chagrine quand vous avez eu des reproches à vous faire ; & je vous ai vu très-gaie, très-contente avec un petit fourreau de toile, souvent même à la fin du jour assez sale ; mais puisque nous y sommes, cherchons un peu, quelles sont les conditions nécessaires au bonheur ?
Emilie.
Oui, cherchons… J’allois dire quelque chose, mais je crois que je me trompe.
La Mere.
Qu’est-ce que cela fait ? dites toujours ! Ce n’est qu’en me disant tout ce qui vous passe par la tête que vous apprendrez à penser juste.
Emilie.
Oui, Maman, mais si je dis mal ?
La Mere.
Eh bien, je vous en avertirai.
Emilie.
Maman, c’est que je voulois dire, cherchons les éléments du bonheur !
La Mere.
Eh bien, vous auriez très-bien dit ; car c’est précisément ce que je veux que vous trouviez.
Emilie.
Mais le bonheur, c’est une chose… Je voudrois le sçavoir… Mais non, ce n’est pas une science.
La Mere.
C’est la premiere de toutes les sciences ; celle qui importe le plus aux hommes de connoître.
Emilie.
Est-elle bien difficile à apprendre ?
La Mere.
Très-difficile & même impossible aux méchants, mais très-aisée pour ceux qui se servent de leur raison.
Emilie.
Ah ! Maman, j’espére qu’elle ne sera pas difficile pour moi.
La Mere.
Je l’espére aussi. Nous avons déja dit que les beaux habits ne rendoient point heureux ; voyez votre bonne, elle n’a pas de beaux habits, elle n’est point riche ; eh bien, la croyez-vous heureuse ?
Emilie.
Oh ! sûrement, Maman, car elle rit & chante toujours. Je ne l’ai jamais vue triste.
La Mere.
Tous ces paysans, tous ces domestiques que vous voyez danser les Dimanches à la porte du bois de Boulogne, vous les voyez contents ; vous les voyez rire, ils ne sont point riches ; ce n’est qu’à force de travailler toute la semaine qu’ils gagnent de quoi vivre & de quoi se vêtir eux & leurs enfants. Vous m’avez souvent parlé de leur gaieté, nous pouvons donc conclure que les richesses ne sont sûrement pas nécessaires au bonheur.
Emilie.
Mais qu’est-ce qui fait que tous ces pauvres gens sont contents ?
La Mere.
Voyez, dites-moi votre idée.
Emilie.
Mais je crois, c’est parce qu’ils ont bien travaillé & parce que l’on est content d’eux.
La Mere.
Vous avez raison. Eh bien, quel sera donc le premier élément du bonheur dans tous les âges & dans toutes les conditions ?
Emilie.
Ce sera d’avoir rempli son devoir & d’être content de soi, n’est-ce pas, Maman ?
La Mere.
Cela est certain, on peut avoir tous les avantages réunis, bien des richesses, une bonne santé, & n’être point heureux ; mais sans bien, avec une santé foible telle que vous m’en voyez, on peut se trouver heureux, car le vrai bonheur dépend de nous-mêmes.
Emilie.
Oui, il n’y a qu’à être bien sage.
La Mere.
Et il n’y a pas de bonheur quand on n’a pas rempli ses devoirs, parce qu’alors on n’est content ni de soi, ni des autres.
Emilie.
Voilà pourquoi les méchants ne sont pas heureux, n’est-ce pas, Maman ?… Bon, voilà du monde !
La Mere.
Je n’en suis pas fâchée ; nous avons assez causé aujourd’hui, & il est temps que vous alliez apprendre votre Évangile & achever vos études.
Emilie.
Maman, j’ai encore quelque chose à vous dire sur ce bonheur que je n’entens pas bien ; demain vous me permettrez de vous le dire, n’est-ce pas ?
La Mere.
Oui, si vous avez mérité que nous causions ensemble.


La Mere.
Eh bien, Emilie, qu’est-ce que vous vouliez me dire ?
Emilie.
Quoi ? Maman, je ne sçais pas.
La Mere.
Il y avoit quelque chose sur le bonheur que vous n’entendiez pas.
Emilie.
Maman, je ne m’en souviens plus.
La Mere.
Ce sera pour quand vous vous en souviendrez.
Emilie.
Si vous eussiez eu la bonté de causer hier & avant-hier avec moi, ma chere Maman, je m’en serois souvenue ; mais à présent…
La Mere.
Et qu’est-ce qui m’en a empêché ?
Emilie.
Maman, je le sçais bien, c’est ma faute, c’est que je ne l’ai pas mérité. J’avois pourtant grande envie de bien faire, mais je n’ai jamais pu.
La Mere.
Et pourquoi n’avez-vous pas pu ?
Emilie.
Je ne sçais pas, Maman, je n’étois pas en train d’étudier. Quand je voulois mettre les yeux sur mon Livre, mon esprit s’en alloit je ne sçais où !
La Mere.
Mais, mon Enfant, si l’on avoit toujours égard à la disposition où l’on se trouve, on ne feroit jamais rien. C’est une raison pour s’appliquer davantage, pour se donner plus de peine ; mais ce n’est pas une raison pour ne rien faire.
Emilie.
Mais, Maman, on n’est pas toujours disposé à étudier, Papa vous l’a dit.
La Mere.
Croyez-vous que je sois toujours disposée à causer ou à jouer avec vous ? Vous m’avez vu souvent malade & souffrante, ou la tête remplie d’affaires ; eh bien, je les oublie pour m’occuper même de vos amusements. Si j’écoutois alors mes dispositions, je vous renverrois, vous, votre poupée & votre petit ménage.
Emilie.
Mais comment donc faire ?
La Mere.
Il faut s’accoûtumer à vaincre sa paresse & à faire ce que l’on doit faire, quelque chose qu’il en coûte. Je vous l’ai déja dit, c’est cet effort que l’on fait sur soi-même qui s’appelle vertu.
Emilie.
Maman, je tâcherai…
La Mere.
Il faut, lorsque vous vous sentez portée à la distraction, demander vous-même à votre bonne à vous placer de maniere que vous ne voyiez rien de ce qui se passe dans la chambre. Il faut, si vous apprenez par cœur, apprendre tout haut, afin qu’elle vous avertisse s’il vous prend une distraction, & si vous cessez de répéter, sans vous en appercevoir ; il faut enfin montrer de la bonne volonté si vous voulez qu’on ait pour vous de l’indulgence. Il dépend toujours de vous de ne pas vous laisser aller à l’humeur & à l’opiniâtreté.
Emilie.
Oh, je le sens bien. Je sens que j’ai mérité mes punitions. Aussi, Maman, je suis bien heureuse qu’il ne soit venu personne ; car je n’aurois jamais osé me montrer. Maman, vous m’avez promis que vous ne le diriez pas.
La Mere.
Oh, certainement ! La bonne réputation d’une jeune personne est tout son bien ; c’est ce qu’elle doit chérir comme sa vie, & lorsqu’une fois l’on est prévenu contre elle, il lui est si difficile de la réparer que je n’ai garde d’aller dire vos défauts tant que j’aurai espérance de vous voir corriger.
Emilie.
Pourquoi la bonne réputation d’une jeune personne est-elle ce qu’elle doit chérir le plus, Maman ?
La Mere.
Pourquoi êtes-vous fâchée, quand on vous parle des fautes que vous avez faites ?
Emilie.
C’est que je voudrois qu’on dît toujours du bien de moi !
La Mere.
Et pourquoi ?
Emilie.
Mais c’est que c’est humiliant de mal faire ; on croiroit que je ne vaux rien.
La Mere.
Eh bien, voilà pourquoi la bonne réputation est précieuse, c’est qu’on ne peut pas se passer de la bonne opinion des autres.
Emilie.
On ne peut pas s’en passer ? Et pourquoi ?
La Mere.
Vous le voyez, puisque vous ne pourriez pas souffrir qu’on crût que vous ne valez rien. Ne sommes-nous pas convenues ces jours passés que les hommes avoient besoin les uns des autres ?
Emilie.
Oui, maman !
La Mere.
Pourriez-vous vous trouver à votre aise avec quelqu’un qui auroit mauvaise opinion de vous ?
Emilie.
Non sûrement.
La Mere.
C’est sur l’opinion que l’on a d’une personne, qu’on mesure l’estime ou l’amitié qu’on lui accorde, & l’on ne connoît une jeune personne que par sa réputation.
Emilie.
Comment cela, Maman ?
La Mere.
C’est qu’elle ne paroît dans le monde qu’environnée de ses parents ; on ne l’entend presque pas parler ; on ne la voit jamais agir ; on ne peut avoir d’opinion sur elle que par ce que l’on en entend dire par ceux qui l’approchent dans l’intérieur de la maison.
Emilie.
Oui, par les domestiques.
La Mere.
Par les domestiques, par les maîtres, & par tous ceux qui la voient de près.
Emilie.
Mais si tous ces gens-là ne disent pas vrai ?
La Mere.
Le mensonge est un vice si affreux qu’il ne se rencontre pas communément ; & pour un menteur, il se trouve vingt honnêtes gens, amis de la vérité, qui le démasquent.
Emilie.
Qu’est-ce que cela veut dire, qui le démasquent ? Est-ce que le mensonge met un masque ?
La Mere.
Non, c’est une façon de parler. Vous sçavez bien qu’un masque cache les traits du visage ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
Comme un menteur veut être cru, on dit qu’il emprunte les traits de la vérité…
Emilie.
Oh oui, & ceux qui prouvent qu’il a menti, le démasquent. Mais, Maman, est-ce qu’un mensonge est toujours découvert ?
La Mere.
Toujours ; un peu plutôt, un peu plus tard, la vérité se découvre.
Emilie.
Et puis le menteur est bien attrapé, n’est-ce pas ?
La Mere.
Attrapé & puni autant qu’on le peut être ; car il prouve qu’il est bête d’avoir cru qu’il pouvoit faire passer le mensonge pour la vérité ; il est deshonoré, il perd la confiance de tout le monde ; on ne le croit plus, & personne ne veut avoir affaire à lui.
Emilie.
Mais pourquoi deshonoré ?
La Mere.
Parce que c’est un vice bas, un vice avilissant, qu’on ne suppose pas aux gens bien nés.
Emilie.
Qu’est-ce que c’est que des gens bien nés ?
La Mere.
Je vous l’ai déja dit ; ce sont ceux qui naissent avec le penchant à la vertu. On se sert aussi de cette expression pour désigner tous ceux qui ne sont pas nés d’un état obscur & bas.
Emilie.
Et qu’est-ce que c’est que d’être deshonoré ?
La Mere.
C’est d’avoir perdu l’estime de ses semblables, soit par ses actions, soit par sa façon de penser ; c’est de s’être dégradé & d’avoir mérité de descendre dans l’opinion des autres au-dessous de l’état où le sort nous a mis.
Emilie.
Mais, Maman, les domestiques diront… si vous les priez de ne rien dire de ce que j’ai fait.
La Mere.
Fi donc ! Vous voudriez vous abbaisser à prier des domestiques de ne pas parler de vous ? Voyez comme une faute peut avilir.
Emilie.
Mais, s’ils le disent, cela me fera tort !
La Mere.
Ce sera la suite nécessaire de vos fautes. On ne les répare pas par une bassesse, c’en seroit une de plus & bien plus humiliante ; & voilà pourquoi il est si essentiel de n’en pas faire. Croyez-moi, corrigez-vous bien vîte ! Que vos actions, que votre contenance marquent votre repentir, & faites mieux à l’avenir, vous ne craindrez pas qu’on parle de vous ; ou, comme je vous l’ai déja dit, si l’on veut absolument parler, on n’aura que du bien à dire.
Emilie.
Si je n’avois pas pleuré & crié comme une petite folle, ils n’en auroient rien sçu.
La Mere.
Qu’est-ce que cela fait ? En auriez-vous été moins coupable ?
Emilie.
Non ; mais…
La Mere.
Le mal est-il qu’on ait sçu votre faute ou que vous l’ayez commise ?
Emilie.
C’est que je l’aie faite.
La Mere.
Est-ce que vous pouvez vous pardonner d’avoir mal fait, quand même votre faute resteroit ignorée ? Ne voyez-vous pas que si vous prenez l’habitude de faire des fautes ignorées, vous en ferez bientôt de publiques ?
Emilie.
Pourquoi cela, Maman ?
La Mere.
Parce que tout est habitude, mon Enfant. Le premier jour que nous arrivons à la campagne, & que nous quittons Paris, êtes-vous aussi en train de courir & de vous promener que quand nous y avons passé plusieurs mois, & que vous vous êtes promenée tous les jours ?
Emilie.
Non, Maman.
La Mere.
La premiere fois que vous avez joué au volant, y avez-vous joué aussi long-temps, & avez-vous jetté votre volant aussi haut que vous l’avez fait depuis ?
Emilie.
Non, Maman.
La Mere.
Qui est-ce donc qui vous a donné la facilité d’y jouer comme vous le faites à présent, & de faire des promenades aussi longues sans vous fatiguer ?
Emilie.
Je ne sçais pas.
La Mere.
C’est qu’en vous promenant tous les jours vous acquerez la force de faire tous les jours un peu plus de chemin, & vous parvenez enfin à faire de très-grandes promenades sans vous fatiguer, parce que vous fortifiez votre corps par un exercice continuel.
Emilie.
Maman, si j’étois plusieurs jours sans marcher, je ne pourrois donc plus aller à Saint Cloud ?
La Mere.
Cela vous seroit beaucoup plus difficile, & vous reviendriez si lasse que cela vous dégoûteroit peut-être de la promenade. Vous éprouvez la même chose pour vos leçons ; quand vous avez été quelques jours sans apprendre par cœur, vous n’apprenez plus aussi facilement.
Emilie.
Oui, parce que j’en ai perdu l’habitude, n’est-ce pas ?
La Mere.
Oui, & il en est de même de l’exercice des vertus comme de l’exercice du corps & de l’esprit.
Emilie.
Bon !
La Mere.
Oui, sans doute ; si vous ne vous exercez pas seule & volontairement à bien remplir vos devoirs, sans prendre garde à la disposition où vous vous trouvez, & sans penser à la punition & à la récompense, vous n’acquerrez jamais de force sur vous-même, & vous ferez des fautes en public, parce que vous n’aurez pas contracté l’habitude de bien faire étant seule.
Emilie.
Eh bien ! je sens cela, par exemple. Cela est vrai, quand j’ai bien fait plusieurs jours de suite, j’ai moins de peine à étudier ; & quand j’ai bien étudié, je n’ai pas d’humeur.
La Mere.
C’est que rien n’en donne tant que d’être mécontent de soi.
Emilie.
Cela pourroit bien être.
La Mere.
Prenez donc l’habitude de faire toujours le mieux qu’il vous sera possible, & pour ne pas vous endormir sur le danger des fautes cachées, faites-vous une loi de ne me jamais rien taire de ce que vous ferez, que cela soit bien ou mal.
Emilie.
Oui, Maman, je vous le promets, je vous dirai tout.
La Mere.
Est-ce que vous n’avez pas remarqué une chose ?
Emilie.
Quoi, Maman ?
La Mere.
C’est qu’une faute a toujours des suites fâcheuses, & qu’on n’en est pas quitte pour dire, je ne la ferai plus.
Emilie.
Ah, je n’avois jamais remarqué cela !
La Mere.
Voyez vous-même. Repassez dans votre esprit tous les torts que vous avez eus, & vous connoîtrez bientôt que quand même votre faute seroit restée ignorée, elle auroit eu des suites fâcheuses pour vous.
Emilie.
Mais quand j’ai eu de l’humeur & de l’impatience, si on ne l’avoit pas sçu, qu’est-ce qui m’en seroit arrivé ?
La Mere.
Premierement, que l’humeur & l’impatience nuisent à la santé ; que tout ce que l’on fait avec humeur & impatience est mal fait & maussade. Que quand on s’y laisse aller, on prend par dépit & par déraison toujours le plus mauvais parti dans ce que l’on a à faire. Il en est de même lorsque vous n’étudiez pas ; en vous voyant rester ignorante, il ne seroit pas difficile de deviner que vous n’avez pas répondu à l’éducation qu’on vous donne.
Emilie.
Tout se sçait donc, Maman ?
La Mere.
Oui, tôt ou tard tout ce qui est se découvre & se sçait.
Emilie.
Hier, Maman, quand je me suis levée, j’ai dit à ma bonne : aujourd’hui je jouerai toute la journée, & je serai bien heureuse ; & point du tout, toutes les fois que je dis cela, cela va mal.
La Mere.
Ce n’est pas de faire le projet d’être heureuse qui vous porte malheur, c’est que vous vous trompez sur les moyens.
Emilie.
Qu’est-ce que c’est que de se tromper sur les moyens ?
La Mere.
Quand vous voulez aller promptement de la porte de Boulogne à la Muette, quel chemin prenez-vous ?
Emilie.
Je vais tout droit au rond de Mortemar, puis encore tout droit à la Muette.
La Mere.
Et si, voulant arriver promptement, vous preniez d’abord le chemin de la porte Maillot pour vous rendre par des allées détournées au rond de Mortemar ?
Emilie.
Mais, je n’y arriverois pas si vîte.
La Mere.
Et pourquoi ?
Emilie.
C’est qu’il y a plus de chemin.
La Mere.
Vous voyez donc bien que vous vous tromperiez sur les moyens d’arriver promptement, & c’est à-peu-près de même que vous vous trompez sur les moyens d’arriver au bonheur.
Emilie.
Mais qu’est-ce qui fait cela ?
La Mere.
Votre legéreté & votre ignorance. C’est que vous n’avez pas des idées assez justes sur ce qui vous est utile, & que vous entendez mal vos interêts.
Emilie.
Et comment faut-il faire pour les bien entendre ?
La Mere.
Il faut causer avec moi comme nous causons, & faire votre profit de ce que je vous dis.
Emilie.
Oui, il ne faut pas faire comme le petit Duplessis qui ne fait jamais ce que sa mere lui dit ; aussi son pere le bat toute la journée, à ce qu’on dit, car je ne l’ai pas vu, moi ; je ne sçais pas ce que font les Laquais. Vous m’avez dit qu’il ne falloit pas leur parler sans nécessité… Maman… bon ! je ne sçais plus ce que je voulois dire. Irons-nous promener aujourd’hui ?
La Mere.
S’il fait beau.
Emilie.
Oh ! je crois qu’il fera beau ; il faut aller bien loin, bien loin. Ah !… si vous voulez, Maman, nous irons boire du lait, & puis vous me direz comment il faut faire pour ne me plus tromper sur les moyens.
La Mere.
Et sur quels moyens voulez-vous apprendre à ne vous plus tromper ?
Emilie.
Mais sur ce que nous avons dit ; Maman, c’est pour n’être pas attrapée quand je veux être heureuse, & que je me propose de jouer toute la journée.
La Mere.
Mais, premierement, vous ne seriez pas heureuse si vous jouiez toute la journée.
Emilie.
Pourquoi donc ?
La Mere.
C’est que le jeu ne vous fait plaisir qu’autant qu’il vous délasse de votre étude.
Emilie.
Je crois pourtant que c’est bien joli de jouer toujours.
La Mere.
Si vous n’aviez autre chose pour votre amusement que votre poupée & votre petit ménage, n’en seriez-vous pas bientôt lasse ?
Emilie.
Oui, mais je change de jeu.
La Mere.
Et vous vous en lassez de même.
Emilie.
Ah ! cela est vrai pourtant ; car lorsque quelquefois j’ai joué toute la journée, il y a des moments où je ne sçais plus que faire de mon corps.
La Mere.
Le nombre des amusements est très-borné, & pour y trouver toujours du plaisir, il faut les faire précéder du travail & d’occupations sérieuses ; alors on n’est jamais désœuvré ni ennuyé.
Emilie.
Oui, je joue toujours avec grand plaisir quand j’ai travaillé… mais, Maman, vous sçavez donc tout ce que je pense ?
La Mere.
A-peu-près.
Emilie.
Ah, comment faites-vous ?
La Mere.
N’est-il pas vrai que l’objet de tous vos desirs est de vous éviter de la peine & de vous procurer du plaisir ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
Quand vous étudiez mal, avec négligence, avec paresse, quelle est l’idée qui vous occupe alors ? Quelle en est la cause ?
Emilie.
C’est que d’apprendre me donne de la peine.
La Mere.
Et que vous aimeriez mieux aller jouer, chanter, danser, &c.
Emilie.
Cela est vrai.
La Mere.
C’est donc pour fuir la peine & pour avoir plutôt du plaisir que vous étudiez mal ? Eh bien, qu’est-ce qui en arrive ?
Emilie.
Ah, il en arrive tout le contraire ! Quand j’ai mal étudié, j’étudie plus long-temps ; l’humeur me prend, je sais tout de travers, & je ne joue pas.
La Mere.
Et quand vous êtes entêtée, & que vous suivez vos fantaisies sans égard pour ce que j’exige de vous, quelle est votre idée ?
Emilie.
C’est que ce que je veux me fait plaisir, & que ce qu’on exige de moi ne m’en fait pas.
La Mere.
C’est donc pour fuir la peine & pour vous procurer du plaisir ? Et qu’en arrive-t-il ?
Emilie.
Que je m’attire une bonne pénitence, que la peine dure tout le jour, & qu’il n’est plus question de jeu ni de plaisir.
La Mere.
Et quand vous étudiez bien, & que vous êtes docile, qu’en arrive-t-il ?
Emilie.
Oh, que mes devoirs sont bientôt faits, que je suis heureuse, heureuse !… Tenez, ma petite Maman, je sens là quelque chose dans mon cœur qui me rend si aise, si aise !… Oh, comme je suis gaie & contente !
La Mere.
Vous voyez donc bien que quand vous n’êtes pas raisonnable, vous vous trompez sur les moyens qui menent au bonheur. Lorsque vous vous sentez le desir de contenter une fantaisie que je desapprouve, ou quelque chose que je vous défens ; si vous vous disiez, au lieu du bien que je cherche, il va m’arriver malheur, si je m’obstine ; & si au contraire je céde, j’aurai un bonheur plus grand que celui auquel je renonce.
Emilie.
Et lequel donc ?
La Mere.
Le plus grand de tous, celui qui n’est au pouvoir de personne de vous faire perdre, quand une fois vous l’avez.
Emilie.
Maman, dites-moi donc vîte ce que c’est ; je vous en prie.
La Mere.
Celui d’être contente de vous, de sentir là, au cœur, ce qui vous rend si aise.
Emilie.
Oh ! c’est vrai, c’est le plus grand plaisir quand j’ai là, au cœur, je ne sçais quoi qui me fait rire toute seule, comment cela s’appelle-t-il, Maman ?
La Mere.
Cela s’appelle la joie de la bonne conscience.
Emilie.
Qu’est-ce que c’est que la conscience ?
La Mere.
C’est un sentiment intérieur qui nous avertit malgré nous de notre conduite.
Emilie.
Quoi ? Est-ce que cela parle ?
La Mere.
Oui, cela crie au-dedans de nous, & nous met mal à notre aise quand nous avons fait une faute, même ignorée, & cela nous fait rougir des louanges qu’on nous donne quand nous ne les méritons pas.
Emilie.
Et quand nous les méritons, qu’est-ce qu’elle dit, la conscience ?
La Mere.
Elle nous rend la louange agréable. Mais elle nous rend heureux toute seule, & indépendamment de l’approbation des autres. Voilà pourquoi une faute est tout aussi fâcheuse quand elle est ignorée que quand elle est connue, & voilà pourquoi une bonne action nous donne tout autant de satisfaction quand elle est cachée que quand elle est sçue ; c’est qu’au moment où l’on s’y attend le moins notre conscience nous fait un reproche, ou nous approuve, & nous met bien ou mal à notre aise.
Emilie.
Je l’ai entendue quelquefois, je crois ; mais je ne sçavois pas ce que c’étoit.
La Mere.
Vous ne sçauriez trop l’écouter ni trop chercher à entendre ce qu’elle vous dit. C’est un guide sûr. C’est un ami que nous avons toujours en nous, & qu’on ne sçauroit trop ménager. Il faut vous accoûtumer à questionner cet ami en vous-même plusieurs fois dans le jour.
Emilie.
C’est drolle, quelque chose qui parle comme cela tout bas en nous-mêmes. Je vous promets, Maman, que je lui parlerai tous les jours, je lui dirai, ma conscience, êtes-vous contente ?
La Mere.
Emilie, il est l’heure de quitter votre ouvrage & de vous mettre à l’étude.
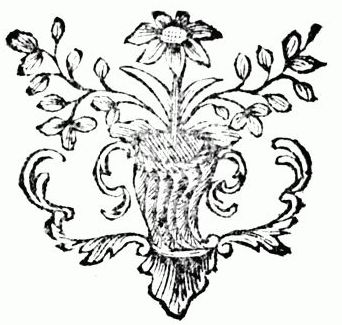

Emilie.
Maman, sçavez-vous que le petit Duplessis est mort ?
La Mere.
Oui, je le sçais.
Emilie.
C’est donc pour cela que sa mere est venue ce matin ?
La Mere.
Oui. Et sçavez-vous la cause de la mort de son fils ?
Emilie.
Non, Maman.
La Mere.
Il est mort pour s’être obstiné à cacher à sa mere une faute qu’il avoit faite.
Emilie.
Comment donc cela, Maman ?
La Mere.
Il y a environ cinq ou six semaines que cette pauvre femme ayant à sortir, avoit enfermé son enfant dans sa chambre. Elle lui avoit défendu de monter sur les chaises. Dès qu’il fut seul, il monta sur un fauteuil, & de-là sur la commode, pour prendre des confitures qu’il avoit vu mettre sur une planche. Il en mangea, & en descendant il tomba sur la tête & se fit grand mal ; mais il n’en voulut rien dire, de peur d’être grondé. Quelque temps après, il lui prit de grands maux de tête & de la fiévre. On le questionna beaucoup, pour sçavoir s’il n’avoit pas fait de chûte. Ne prévoyant pas la conséquence de ce qu’il avoit fait, il soûtint toujours qu’il ne lui étoit rien arrivé, & enfin ce n’est que deux jours avant sa mort qu’il avoua tout ; mais il étoit trop tard. Le dépôt étoit formé dans la tête, & il n’y avoit plus de reméde.
Emilie.
Et s’il l’avoit dit tout de suite ?
La Mere.
On auroit pu le sauver. Vous voyez bien, Emilie, qu’une faute cachée n’en est pas moins une faute, & pour être ignorée, n’en a pas moins ses effets dont un enfant ne peut pas prévoir les conséquences souvent funestes.
Emilie.
Je le vois bien, Maman.
La Mere.
Et voilà pourquoi il faut me dire tout ce que vous faites, afin que je juge pour vous des suites de vos démarches, & que je vous les fasse connoître.
Emilie.
Oui, Maman, je vous dirai tout. Mais pourquoi sa mere est-elle si affligée, puisqu’il étoit si méchant ?
La Mere.
C’est qu’une mere espere toujours que son enfant se corrigera, tant par les avis qu’on lui donne que par sa propre expérience.
Emilie.
Maman, voulez-vous bien me dire ce que c’est que l’expérience ?
La Mere.
Ce sont les connoissances que nous acquerons par le souvenir de ce qui nous est arrivé. Par exemple, votre expérience vous a montré qu’on est malheureux quand on ne fait pas le sacrifice de ses fantaisies à ses devoirs.
Emilie.
Bon ! Voilà encore un mot que je n’entens pas. Qu’est-ce que c’est que sacrifice ?
La Mere.
On en fait pour soi & pour les autres. Ceux que l’on fait pour soi consistent à renoncer à un avantage présent auquel nous attachons beaucoup de prix, pour s’en procurer un autre souvent plus éloigné.
Emilie.
Comment cela, Maman ?
La Mere.
Quand vous obéissez sur le champ & sans replique, lorsque je vous dis de cesser votre jeu & d’aller travailler, vous faites le sacrifice d’un plaisir présent, pour vous en procurer un plus grand, qui est de remplir vos devoirs.
Emilie.
Ah ! oui, j’entens bien cela à présent.
La Mere.
Cela s’appelle sacrifier son plaisir à son devoir. Et les sacrifices que l’on fait aux autres consistent à renoncer à un plaisir ou à un avantage pour leur en procurer. C’est ce qu’on appelle la bonté. Quelquefois même on consent à son propre dommage, on s’attire des peines volontaires pour procurer aux autres un très-grand bien, & cela s’appelle ou de la générosité ou de l’héroïsme, suivant que l’objet du sacrifice est plus ou moins grand.
Emilie.
Maman, me permettez-vous de vous demander une chose ?
La Mere.
Dites.
Emilie.
Pourquoi avez-vous fait entrer la femme Duplessis dans votre cabinet ?
La Mere.
Qu’est-ce que vous trouvez de singulier à cela ?
Emilie.
Mais vous l’avez fait asseoir.
La Mere.
Pourquoi pas ?
Emilie.
Mais vous lui avez donné votre main. Elle s’est mise à pleurer, & les larmes vous sont venues aux yeux ; vous l’avez appellée mon enfant.
La Mere.
Qu’est-ce que vous concluez de tout cela ? Qu’est-ce que vous imaginez ?
Emilie.
Mais je crois qu’elle étoit bien affligée, & que vous vouliez la consoler.
La Mere.
Cela est vrai.
Emilie.
Je croyois qu’il ne falloit pas causer avec les domestiques.
La Mere.
Non, il ne faut pas causer avec eux sans nécessité ; mais la premiere de toutes les nécessités est de consoler ceux qui ont de la peine, & particulierement nos domestiques.
Emilie.
Et pourquoi cela, Maman ?
La Mere.
Puisqu’ils sont soumis à nos ordres, puisqu’ils nous servent, puisqu’ils nous donnent journellement des preuves de zéle & d’attachement, il est bien juste que nous nous chargions de leur bonheur autant qu’il dépend de nous.
Emilie.
Cela est vrai. Mais comment faire, puisqu’on ne joue pas avec eux ?
La Mere.
En n’exigeant pas d’eux plus qu’ils ne peuvent faire, en les payant exactement, en les soignant dans leurs maladies, & en les consolant quand ils ont de la peine, en ne les laissant pas d’ailleurs manquer à leur devoir, en les tenant dans le respect ; en un mot, en se conduisant avec eux comme un pere juste & bon le fait avec ses enfants.
Emilie.
Maman, vous êtes donc le pere de toute la maison ?
La Mere.
Votre pere & moi, nous sommes les chefs de la maison ; je suis votre mere, & j’en tiens lieu à tous ceux qui sont sous mes ordres.
Emilie.
Voilà donc pourquoi tout le monde vous obéit ?
La Mere.
Oui. Chaque maison est regardée comme une famille, chaque famille a un chef qui la gouverne, à qui on est convenu de s’en rapporter, qui protége, qui veille aux interêts de chacun, & à qui chacun est soumis.
Emilie.
Et moi, Maman, qu’est-ce que je suis ?
La Mere.
Vous êtes un des membres de la famille.
Emilie.
Comment un des membres ? Je suis un membre, moi ?
La Mere.
C’est une façon de parler, comme on désigne celui qui est le premier de la famille & qui la gouverne par le chef, qui veut dire tête, on continue la comparaison, & l’on dit les membres pour désigner les autres personnes qui composent la famille.
Emilie.
Mais les domestiques sont donc mes freres ?
La Mere.
Comme hommes nous sommes tous freres, c’est-à-dire, que toute créature humaine mérite notre bienveillance…
Emilie.
Maman, que veut dire bienveillance ?
La Mere.
Le mot même vous l’explique. Bien vouloir, vouloir du bien.
Emilie.
Ah, c’est vrai ! Eh bien, Maman, il faut donc vouloir du bien à tout le monde ?
La Mere.
Sans doute, si vous voulez que tout le monde vous veuille du bien. Mais ensuite il y a différents états, différentes classes dans la société. Chacune vit entre elle dans l’égalité, & lorsque nous avons à faire aux hommes des autres classes, nous nous conduisons avec eux suivant leur rang. S’ils sont d’une classe au-dessus de la nôtre, nous leur devons de la déférence, du respect ; s’ils sont au-dessous, nous leur marquons de la bonté, de la protection, &c.
Emilie.
La classe, c’est comme au Couvent, n’est-ce pas ?
La Mere.
Pas tout-à-fait, mais cela en donne l’idée. De même qu’au Couvent il y a la classe des grandes pensionnaires, la classe des petites, la classe des novices, &c. de même dans le monde il y a la classe des gens de la Cour, celle des Militaires, celle de la Magistrature, &c. On range dans la même classe les personnes de la même profession. Par exemple, tous les Militaires, qui ne sont pas décorés, sont de la même classe que votre papa.
Emilie.
Qu’est-ce que c’est que décoré ?
La Mere.
C’est d’avoir les Ordres du Roi, le Cordon bleu, le Cordon rouge, &c.
Emilie.
A propos, Maman, je voulois toujours demander ce que c’étoit que le Roi, je l’ai toujours oublié.
La Mere.
C’est le chef d’une grande famille.
Emilie.
Mais qu’est-ce que c’est ? Pourquoi est-ce que tout le monde est obligé de lui obéir ? Est-ce que nous sommes de sa famille ? tout le monde est-il de sa famille ?
La Mere.
Nous sommes une des familles qu’il gouverne.
Emilie.
Bon ! il est donc le chef de toutes les familles ?
La Mere.
Oui, tous les habitants d’une Ville ou d’un Village sont partagés par familles. Un pays est composé de beaucoup de Villes & de Villages. Un royaume est composé de plusieurs pays, & le Roi est le chef de tout son Royaume.
Emilie.
Quoi ? de toutes les familles ?
La Mere.
Oui.
Emilie.
Il a bien des affaires.
La Mere.
Il en a tant qu’il ne peut pas les faire seul.
Emilie.
Et comment fait-il donc ?
La Mere.
Il choisit des personnes à qui il donne sa confiance, & qui gouvernent son Royaume sous ses ordres, & on est obligé de leur obéir lorsqu’ils parlent au nom du Roi.
Emilie.
Tenez, c’est comme votre Maître d’hôtel à qui vous dites le matin tout ce que vous voulez qu’on fasse dans la maison.
La Mere.
Précisément.
Emilie.
Et ceux qui gouvernent pour le Roi, les appelle-t-on aussi des Maîtres d’hôtel ?
La Mere.
Non, ce sont des Ministres, des Gouverneurs, des Intendants. Ils ont différents titres suivant leurs fonctions.
Emilie.
Mais est-ce que tout son Royaume est obligé de venir tous les matins sçavoir de ses nouvelles, comme je viens sçavoir des vôtres ?
La Mere.
Avec un peu de réflexion, vous verriez que cela est impossible. D’ailleurs tous ses Sujets ne sont pas admis à cet honneur. Il n’y a que les Princes de son sang, c’est-à-dire ses parens, & la Noblesse de son Royaume qui aient le droit de lui faire leur cour.
Emilie.
On lui doit donc bien du respect ?
La Mere.
Autant que vous m’en devez & par la même raison.
Emilie.
Et Monsieur le Dauphin, c’est son fils ?
La Mere.
Dauphin est le titre qu’on donne à l’héritier du thrône de France, c’est-à-dire à celui qui doit être Roi après celui qui regne.
Emilie.
C’est beau d’être Roi !
La Mere.
Oui, car il est le maître de faire du bien à tout le monde.
Emilie.
Il est donc bien heureux ; on le doit bien aimer ?
La Mere.
Sans doute, & c’est la récompense de tous ceux qui font du bien.
Emilie.
Je ne l’ai jamais vu. Pourquoi ne vient-il pas vous voir, Maman, puisque vous avez le droit de lui faire votre cour ?
La Mere.
Le Roi ne va voir personne.
Emilie.
Pourquoi ? Est-ce qu’il est malade ?
La Mere.
C’est qu’il est par sa dignité si fort au-dessus des autres qu’il n’est pas d’usage qu’il accorde cet honneur à des particuliers.
Emilie.
Qu’est-ce qui fait qu’on est Roi ? Tout le monde peut-il être Roi ?
La Mere.
C’est suivant les pays. En France, c’est le plus proche parent du Roi qui lui succede, & pour vous dire la même chose dans les termes d’usage, en France la couronne est héréditaire : dans d’autres pays le peuple se choisit & s’élit un Roi ; c’est ce qui s’appelle un royaume électif. Chaque royaume a ses loix & ses usages.
Emilie.
Maman, est-ce que papa ne tient pas aussi lieu de pere à ses domestiques ?
La Mere.
Certainement. Qu’est-ce qui vous en feroit douter ?
Emilie.
C’est que c’est toujours vous qui ordonnez tout dans la maison.
La Mere.
C’est que lorsqu’une femme, par sa conduite & par sa vigilance, a mérité la confiance de son mari, il lui abandonne le soin de l’intérieur de la maison, & se contente du soin des affaires qui ne peuvent se traiter qu’au dehors.
Emilie.
Qu’est-ce que cela veut dire, les affaires du dehors ?
La Mere.
Il faut mettre cette question au nombre de celles dont vous ne pouvez pas encore comprendre l’explication. Nous la renverrons à un autre temps.
Emilie.
Maman, vous m’avez dit que vous me diriez ce que c’est que Monsieur Gobemouche.
La Mere.
Cela ne vient pas trop à propos ; mais n’importe, c’est le nom qu’on donne aux gens qui n’ont point d’avis à eux, qui n’entendent rien aux choses dont ils parlent, & qui veulent cependant en paroître instruits, & moyennant cela, pour ne pas montrer leur ignorance, ils ne disent que des mots qui ne signifient rien.
Emilie.
Comment font-ils donc ?
La Mere.
Comme vous faites quelquefois, ils parlent au hazard.
Emilie.
Oh, je m’en corrigerai ; je ne parlerai plus de ce que je n’entens pas. Je ne veux pas qu’on m’appelle Mademoiselle Gobemouche. Je voulois encore vous demander autre chose… Ah ! Maman, quand est-ce que je lirai l’histoire de Titus & celle de Domitien ?
La Mere.
Tout-à-l’heure, si vous voulez, aussi-tôt que vous aurez fini votre ouvrage.
Emilie.
Oh ! Maman, j’en ai encore un grand bout à finir, si vous vouliez, je lirois à présent, car cela ne sera pas fait d’une demi-heure.
La Mere.
Non, je veux que vous finissiez votre ouvrage.
Emilie.
Maman, je vais le finir, me permettez-vous de vous demander pourquoi je ne puis pas lire à présent ; car il me semble que je finirois tout aussi bien mon ouvrage après avoir lu ?
La Mere.
A douze ou quatorze ans, cela seroit fort égal ; mais ne croyez pas que cela le soit à présent.
Emilie.
Mais pourquoi, Maman ?
La Mere.
C’est que l’habitude de ne point interrompre ce que l’on fait est très-essentielle à prendre & doit influer sur toute votre vie. C’est que vous êtes dans l’âge où l’on prend le plus facilement les habitudes que l’on conserve, & que si vous n’en prenez pas de bonnes dès-à-présent, il vous en coûteroit beaucoup pour les prendre par la suite. Souvenez-vous qu’il ne faut point passer sans raison d’une occupation à une autre.
Emilie.
Oui, quand je joue, par exemple, il ne faut pas m’interrompre pour travailler, & quand je travaille il ne faut plus penser à jouer, sans quoi je ne ferois rien qui vaille.
La Mere.
Et quand vous quittez votre ouvrage, il faut le serrer, de même que quand vous quittez vos jeux, il ne faut rien laisser traîner des choses qui ont servi à votre amusement.
Emilie.
Oui, il faut remettre chaque chose à sa place, cela donne l’esprit d’ordre. Vous voyez bien, Maman, que je retiens bien ce que vous me dites.
La Mere.
Mais il ne suffit pas de retenir les mots, il faut les mettre en pratique.
Emilie.
Maman, cela viendra.
La Mere.
Ma fille, cela ne viendra pas si vous ne commencez pas dès-à-présent.
Emilie.
Maman, permettez-moi encore une petite, petite question.
La Mere.
Et c’est ?
Emilie.
A quoi sert-il d’avoir l’esprit d’ordre ?
La Mere.
C’est que sans cela on ne sçait jamais ce qu’on fait, & que cela fait gagner du temps, qui est une chose très-précieuse.
Emilie.
Comment cela fait-il gagner du temps ?
La Mere.
Quand vous laissez traîner toutes les choses qui servent, soit à votre travail, soit à votre amusement, qu’est-ce qui arrive, lorsque vous voulez les retrouver ?
Emilie.
Que je ne sçais plus où elles sont, parce que les domestiques les ont rangées je ne sçais où, & que je ne sçais plus où les prendre.
La Mere.
Eh bien, comment faites-vous pour les retrouver ?
Emilie.
Je les cherche.
La Mere.
Mais vous perdez du temps en les cherchant.
Emilie.
Cela est vrai.
La Mere.
Et c’est du temps fort mal employé ; car si vous les eussiez rangées la veille, vous les retrouveriez tout-de-suite.
Emilie.
Cela est vrai.
La Mere.
Et les trouvez-vous toujours ?
Emilie.
Non, il y en a souvent de perdues.
La Mere.
Et vous n’avez jamais pensé que c’étoit par votre faute ?
Emilie.
Mais c’est la faute des domestiques. Pourquoi ne rangent-ils pas ce qu’ils trouvent ?
La Mere.
Et pourquoi voulez-vous qu’ils mettent plus d’importance aux choses qui vous appartiennent, que vous n’y en mettez vous-même ? Ils ne sont pas fondés à croire que ce que vous laissez traîner mérite d’être conservé.
Emilie.
Cela est encore vrai.
La Mere.
Ainsi voilà deux fautes pour une : celle de perdre par votre négligence & votre manque de soins des choses qui vous appartiennent, & l’injustice de vous en prendre aux autres de la faute que vous avez faite. Eh bien, quand on n’a pas l’esprit d’ordre, les idées se perdent & se confondent dans la tête comme vos joujoux dans la chambre, on ne sçait ce qu’on dit, & l’on passe pour une folle ou pour une bête. Comprenez-vous à présent à quoi l’esprit d’ordre est bon ?
Emilie.
Oui, Maman !… Voilà mon ouvrage fini.
La Mere.
Allons, il est tard, nous pouvons passer dans ma chambre, & nous y lirons l’histoire des deux Empereurs que vous voulez connoître.

Emilie.
Maman, il y a bien long-temps que vous ne m’avez conté d’histoire.
La Mere.
Il est vrai.
Emilie.
Si vous voulez avoir la complaisance de m’en dire une : j’ai été bien raisonnable.
La Mere.
Je le veux bien. Tout en nous promenant je vous conterai l’histoire de deux petits Messieurs ; mais c’est à condition que vous me direz ce que vous pensez de leur conduite.
Emilie.
Oh ! oui, Maman, je vous le promets. Etoient-ils bien aimables, bien sages ?
La Mere.
Vous le verrez. Prenons par cette allée. Le chemin est beau, & nous ne rencontrerons personne qui nous interrompe.
Emilie.
Eh bien, Maman ?
La Mere.
Eh bien, ma fille. Deux peres de famille d’une condition médiocre, mais honnête & aisée, établis en province, avoient chacun un fils. Ces deux jeunes gens très-bien élevés & liés d’amitié à l’exemple de leurs peres, résolurent un jour, chacun de leur côté & sans se communiquer leurs desseins, de quitter la maison paternelle & d’aller chercher fortune à Paris.
Emilie.
La maison paternelle, c’est la maison de son papa, n’est-ce pas, Maman ?
La Mere.
Oui.
Emilie.
Comment ? Ils vouloient s’en aller sans permission ? Mais cela étoit bien mal ! Et s’en aller tout seuls, tout seuls ?… Ils étoient donc fous ? Qu’est-ce qu’ils vouloient devenir ?
La Mere.
Ils avoient pourtant tous deux une forte raison pour rester chez eux. L’un étoit sourd, l’autre sans être tout-à-fait aveugle voyoit à peine à se conduire. Il eût été à propos de remédier à ces accidents avant que de se mettre en route. Pour vivre dans le monde, on n’a pas trop de ses deux yeux & de ses deux oreilles.
Emilie.
Oh ! je crois que non. Je parie que ces deux petits Messieurs sont de méchants garçons, n’est-ce pas, Maman ?
La Mere.
Vous jugez bien vîte. Est-ce que vous voudriez qu’on décidât de votre conduite & de votre caractére sur une folie qui vous auroit passé un moment par la tête ?
Emilie.
Non, Maman !
La Mere.
Attendez donc que vous sçachiez l’histoire de ces ceux jeunes gens pour arrêter votre opinion, & si elle doit leur être défavorable, vous ferez bien encore de supposer que leur aventure a pu être exagérée.
Emilie.
Pourquoi cela, Maman ?
La Mere.
C’est qu’on ne sçauroit trop être en garde contre les propos qui peuvent nuire, & quand il s’agit de condamner les autres, il faut réfléchir long-temps avant d’établir son jugement. Ne desirez-vous pas qu’on en agisse ainsi avec vous ?
Emilie.
Oui sûrement, Maman. Eh bien, qu’est-ce qu’ils firent ?
La Mere.
Quoique leur infirmité, d’abord peu considérable, augmentât tous les jours, elle ne put arrêter leur projet. La jeunesse est ardente, & souffre impatiemment les conseils. Elle ne doute de rien. Son imagination lui répond de ses succès, & la raison est presque toujours la derniere consultée.
Emilie.
Est-ce que la raison est comme la conscience ? Est-ce qu’elle parle aussi ?
La Mere.
Suivre les avis qu’on vous donne, c’est écouter la raison. « Que ferai-je dans la maison de mon pere ? » disoit le sourd qui s’appelloit Daucourt.
Emilie.
Ah ! j’avois bien envie de sçavoir son nom, & je suis bien aise de ne pas le connoître.
La Mere.
« Puis-je espérer un sort digne de moi, disoit-il ? Je suis grand, bien fait, j’ai du mérite & de l’esprit. Ici, je vis ignoré, & sous le prétexte que j’ai l’oreille un peu difficile, on prétend me borner à une vie obscure, on me reproche ma surdité pour me refuser les éclaircissements que je demande ; mais je sçaurai m’en passer, je ne perdrai plus mon temps à écouter, & je vais faire mon chemin par moi-même. »
Emilie.
Il a bonne opinion de lui, Monsieur Daucourt. Il ne veut plus perdre son temps à écouter !
La Mere.
Je connois des gens qui ne le disent pas, mais qui font de même.
Emilie.
Qui donc, Maman ?
La Mere.
Cherchez bien… Vous ne dites mot ? Quand on ne profite pas des avis que l’on reçoit, c’est comme si l’on disoit qu’on ne veut pas perdre son temps à écouter. Ne connoissez-vous personne dans ce cas ?
Emilie.
Oh ! pardonnez-moi, Maman, j’entens bien ; c’est de moi dont vous voulez parler.
La Mere.
Il faut prendre garde, Emilie, de ne pas condamner dans les autres les fautes dont on peut être coupable.
Emilie.
J’y prendrai garde, Maman.
La Mere.
Vous venez de tomber là dans la même faute que Daucourt. Il s’étoit persuadé qu’on ne lui parloit jamais, parce qu’il n’entendoit point ; il se moquoit des défauts de son camarade, & il ne voyoit pas les siens. « Si j’étois aveugle comme lui, disoit-il, je ne me plaindrois pas d’être négligé. Sans yeux, on n’est bon à rien. Il ne sçait d’ailleurs que ce que je lui ai appris, & il ne peut se flater d’en sçavoir jamais davantage. Son accident ne peut se cacher, & on peut très bien ignorer le mien. La nature m’en a dédommagé, par une pénétration d’esprit peu commune. Je parie que la plûpart de ceux qui me connoissent sont encore à s’appercevoir de ma prétendue surdité. Il y a une maniere de prendre part à tout sans y rien concevoir. Un sourire, un signe de tête, un mot jetté à propos suivant l’air & le geste de ceux qui parlent, tout cela m’a donné la réputation d’un homme qui entend très-finement. »
Emilie.
Mais, c’est comme Monsieur Gobemouche cela.
La Mere.
Précisément. « J’ai vu souvent, continuoit-il, les gens les plus graves rire de mes bons mots, & le seul reproche que j’ai eu à faire à mes oreilles, c’est de n’avoir pas toujours entendu l’éloge qu’on faisoit de moi. »
Emilie.
Voilà un drolle de corps ! Je parie qu’il faisoit bien des quiproquo.
La Mere.
Est-ce que vous sçavez ce que c’est qu’un quiproquo ?
Emilie.
Oui, Maman, c’est un coq-à-l’âne.
La Mere.
Et qu’est-ce que c’est qu’un coq-à-l’âne ?
Emilie.
Mais c’est de dire une chose qui n’est pas ce qu’on dit.
La Mere.
Voilà assurément une définition bien claire ! Tâchez un peu de vous expliquer d’une maniere plus précise ; car enfin on parle pour être entendu.
Emilie.
Mais, Maman, vous sçavez bien ce que je veux dire.
La Mere.
Quand cela seroit, cela ne suffit pas. Voyons, dites-moi ce que c’est qu’un quiproquo ou un coq-à-l’âne.
Emilie.
Mais, tenez, Maman, c’est quand vous dites une chose, & que moi je me suis trompée, j’en ai entendu une autre, & je répons à ce que j’ai entendu.
La Mere.
Cela devient un peu plus clair ; mais donnez-moi un exemple de ce que vous venez de dire.
Emilie.
Maman, si vous disiez, par exemple, en parlant de moi, voilà une petite Demoiselle bien raisonnable, & puis il passeroit une autre petite Demoiselle qui croiroit que vous parlez d’elle, & qui diroit, Madame, vous avez bien de la bonté, elle feroit un quiproquo. N’est-ce pas cela, Maman ?
La Mere.
Oui, cela n’est pas mal.
Emilie.
Maman, j’ai bien envie de sçavoir la fin de l’histoire.
La Mere.
Tandis que Daucourt s’occupoit de ses projets, Sainville (c’étoit le nom de l’aveugle) tenoit conseil de son côté. « La surdité de mon voisin m’afflige, disoit-il, il sera obligé de passer sa vie chez son pere. Que faire dans le monde quand on n’entend point ? »
Emilie.
Fort bien ! En voilà encore un qui voit le défaut d’un autre, & je parie qu’il ne voit pas le sien.
La Mere.
Cela est vrai. « Pour moi, disoit-il, si j’ai la vue un peu foible, j’ai en revanche écouté de toutes mes oreilles. J’ai acquis des connoissances & de la mémoire. Daucourt est orgueilleux & opiniâtre ; je suis docile & me soumets sans peine aux volontés des autres. Par-là j’ai trouvé le secret de me servir de leurs yeux. Ils voient pour moi, & me dispensent du soin de me gouverner. Avec le secours de bons guides, je me tirerai toujours d’affaire. On peut compter sur l’assistance des autres, quand on veut s’y fier. »
Après avoir ainsi tracé leur plan, ils ne tarderent pas à le mettre en exécution. Ils quitterent la maison paternelle, & prirent chacun une route différente. L’aveugle muni d’un guide, & le sourd se reposant sur son mérite.
Emilie.
Ah ! voyons ce qu’ils vont devenir.
La Mere.
Le premiere journée, Sainville accusa son guide d’avoir choisi le chemin le plus long & le plus pénible ; mais étant arrivé le soir à la Ville, où il devoit prendre place dans un carrosse public, il se reprocha le peu de confiance qu’il avoit dans les hommes & se sçut mauvais gré d’avoir soupçonné son conducteur.
Comme ses occupations pendant la route se réduisoient à monter en carrosse le matin & à descendre le soir, il employa son temps à refléchir sur sa position. Le résultat de ses méditations fut que dans un pays policé, il étoit fort aisé de se passer de ses yeux.
Emilie.
Qu’est-ce que c’est qu’un pays policé ?
La Mere.
C’est un pays où chacun vit en tranquillité, sans crainte que son voisin lui nuise & trouble l’ordre.
Emilie.
L’ordre de qui ?
La Mere.
Le bon ordre. On appelle ainsi la paix & la tranquillité qui résulte de la vigilance & des soins de ceux qui gouvernent.
Emilie.
Comment ? Est-ce que nous sommes gouvernés ?
La Mere.
Il ne vous souvient déja plus de ce que nous avons dit la semaine passée sur le Roi & sur ses Ministres.
Emilie.
Ah ! oui… mais il y a quelque chose que je n’entens pas : Maman : dites-moi, je vous prie, quel rapport le Roi & les Ministres ont-ils à ce que nous disions tout-à-l’heure ?
La Mere.
Vous l’allez voir. Que disions-nous l’autre jour qu’étoit le Roi ?
Emilie.
Le pere d’une grande famille.
La Mere.
Qu’est-ce que fait un pere de famille dans sa maison ?
Emilie.
Il gouverne tout.
La Mere.
Et en gouvernant tout, il établit les régles de conduite pour chacun, ce qui fait que l’ordre & la sûreté sont établis dans sa maison.
Emilie.
C’est donc cela qui s’appelle policé ?
La Mere.
C’est ce qui s’appelle la police, & l’on dit, une Ville bien ou mal policée. Or dans chaque Ville le Roi établit un Magistrat qui s’appelle Lieutenant de Police, chargé du soin de veiller à la sûreté des particuliers, & de punir ceux qui voudroient la troubler, tels que les voleurs, les brigands, les tapageurs, &c.
Emilie.
J’entens toujours parler de voleurs ; mais je ne sçais ce que c’est.
La Mere.
C’est que vous ne me l’avez pas demandé. Un voleur est un homme qui s’empare ou par force ou par adresse de ce qui ne lui appartient pas ; & comme il n’est pas permis d’user du bien des autres comme du sien, chacun est interessé dans la société à le découvrir, & lorsqu’il est découvert, il est puni.
Emilie.
Maman, qu’est-ce que vous disiez de Monsieur Sainville, je ne m’en souviens plus.
La Mere.
Je disois, qu’il prétendoit qu’on pouvoit très-bien se passer de ses yeux dans un pays bien policé.
Emilie.
Mais pourquoi cela ?
La Mere.
« Cela seroit, disoit-il, une peine de plus que d’en avoir de bons. Il faudroit en faire usage pour obliger ceux qui ont comme moi la vue mauvaise, & qui sont en cela bien plus heureux qu’on ne pense, puisqu’ils menent une vie dégagée de tous soins. »
Emilie.
Il étoit donc bien paresseux ?
La Mere.
Avec ces réflexions, il prit un jour le devant à pied, pour rejoindre le carrosse à l’endroit où l’on devoit dîner. Il s’étoit assuré un guide ; sans souci du côté des accidents, il marchoit gaiement, écoutoit les propos de son conducteur, & s’occupoit de l’avenir agréable qu’il se préparoit. Cependant la fatigue commença à se faire sentir, & le tira de cet état de contentement. Bientôt son guide fut obligé de lui avouer qu’il n’avoit jamais fait cette route, & qu’il ne sçavoit au juste où ils étoient. « Mais j’apperçois quelques maisons, ajoûta-t-il ; nous sommes plus heureux que nous ne pouvions l’espérer. — N’en doutez point, répondit Sainville ; c’est l’endroit où nous voulions nous rendre. — Du moins, reprit l’autre, on nous y dira le chemin qu’il faudra tenir. »
En arrivant dans le Hameau, ils se trouverent détournés de la route de plus de quatre lieues ; mais en revanche, ils furent bien reçus par un vieillard & son accueil consola notre aveugle. Il ne fut plus question que de bien dîner pour gagner ensuite avant la nuit la Ville où le carrosse devoit s’arrêter.
Avant de poursuivre sa route il fallut s’assurer d’un autre guide. Sainville remercia le sien de ses peines, & même du hazard qui les avoit égarés & conduits chez un hôte si honnête. Il craignit de ne pouvoir jamais remplacer un aussi bon conducteur.
Le fils du vieillard prit sa place. Ce jeune homme marqua d’abord à Sainville beaucoup de surprise de son goût pour les voyages. Il lui donna ensuite de très-bons conseils sur les précautions qu’il avoit à prendre & sur la prudence qu’il devoit apporter au choix de ses guides. Sainville, ennuyé de ses leçons, regretta un moment son premier conducteur qui l’avoit entretenu de choses plus agréables ; mais se faisant bien vîte à la maniere de son nouveau compagnon, il ne tarda pas à être enchanté de sa morale.
Le chemin néanmoins, lui paroissoit long. Il marchoit, il est vrai, sans obstacle ; mais accoûtumé depuis long-temps à rencontrer des pierres & à se heurter, ce changement même le surprit. Il en parla à son conducteur qui lui répondit, qu’il avoit choisi, non la route la plus courte, mais la meilleure. « Quand on est aveugle, dit-il, on ne sçauroit aller trop lentement & trop sûrement ; les guides les plus habiles ne peuvent toujours vous faire éviter le mauvais pas ; il s’agit donc de prendre la route la moins embarrassée. » Sainville charmé de ce discours, comprit que son premier compagnon, avec ces propos & ses contes, n’avoit été qu’un étourdi, & qu’il avoit trouvé en celui-cy un ami sage & sincere. Il conçut pour lui autant d’estime que de reconnoissance. Leur entretien les conduisit à la Ville, où ils apprirent que le carrosse avoit passé. Il fallut continuer la route à pied, & après avoir marché jusqu’à la nuit, ils furent obligés de s’arrêter dans un Village, sans avoir pu rejoindre le carrosse.
Le lendemain Sainville, ne voulant point abuser de la bonté de son guide, en prit un nouveau, qui gagna aussi promptement ses bonnes graces. Celui-cy remarqua d’abord la générosité de notre aveugle, & cette remarque augmenta son zéle. Il vanta à Sainville la connoissance qu’il avoit des chemins & du pays. Il lui fit, pour le réjouir, la description de tous les endroits où ils passoient ; mais il lui apprit aussi l’aventure de plusieurs voyageurs qui avoient été volés sur cette route.
« Il est imprudent à vous, lui dit-il en finissant, de garder votre bourse ; c’est à celui des deux qui voit clair, à la porter. Si nous sommes attaqués, vous êtes sans défense ; mais n’ayant rien sur vous, il ne peut vous arriver aucun malheur. Quant à moi, il me reste la ressource de fuir, de sauver votre argent, & de venir vous reprendre quand le danger sera passé. » Sainville ne put s’empêcher d’admirer cette prévoyance. « Est-il possible, s’écria-t-il, que mes guides n’aient point songé à me garantir d’un danger si évident, & qu’ils m’aient exposé par leur imprudence à prendre tout ce que j’ai ! Si je conserve ma bourse, ce n’est pas à eux que j’en aurois l’obligation. » Il se hâta de la mettre en sûreté entre les mains de son ami du jour, & lui confia qu’il avoit encore une Lettre de change cousue par précaution dans la doublure de sa veste.
Le guide, approuvant sa prudence, l’avertit bientôt qu’il y avoit devant eux un ruisseau assez large. « Déshabillons-nous, dit-il, nous en serons plus legers ; je commencerai par passer vos habits, & je reviendrai ensuite vous transporter de l’autre côté. » Sainville, touché de reconnoissance, se déshabilla sans balancer, & dans le même instant il se sentit saisi par le corps & plongé dans une riviere profonde. La frayeur du danger lui ôta l’usage des sens ; il ne revint à lui que long-temps après. Il apprit alors qu’il étoit dans une cabane de pêcheurs, auxquels il devoit la vie & tous les secours qui la lui avoient conservée.
Assez long-temps malade, il eut le temps de faire des réflexions sur la méchanceté des gens qui voient clair. Ces réflexions le dégoûterent des voyages ; & après avoir recouvré ses forces, il sollicita & obtint de son pere le pardon de son double aveuglement. Ainsi de retour dans la maison paternelle, il resta toute sa vie persuadé de trois vérités : La premiere, que le choix d’un conducteur est une chose très-difficile, mais en même-temps très-essentielle pour un aveugle. La seconde, que quand on ne peut s’en passer, il vaut mieux rester chez soi. La troisieme, que quand on a trouvé un bon guide, il ne faut jamais s’en séparer.
Emilie.
Est-ce que c’est tout, Maman ?
La Mere.
C’est toute l’histoire de Sainville.
Emilie.
Et Daucourt ?
La Mere.
Nous en parlerons après. Voyons d’abord ce que vous pensez de celui-cy.
Emilie.
Je pense qu’il a raison.
La Mere.
Qui ?
Emilie.
Sainville.
La Mere.
Et en quoi ?
Emilie.
Mais en ce qu’il dit à la fin, que quand on a trouvé un bon guide, il faut le garder.
La Mere.
Etes-vous bien convaincue de cela ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
En ce cas, vous ne donneriez pas votre confiance au premier venu ?
Emilie.
Non sûrement. Mais je ne ferai pas comme Sainville, moi ; je n’irai pas voyager toute seule.
La Mere.
Est-ce que l’on n’a besoin de conseils que pour voyager ?
Emilie.
Mais je ne sçais pas… je crois pourtant… Tenez, Maman, je ne sçais pas ce que je veux dire.
La Mere.
A quoi pensez-vous que servent les conseils ?
Emilie.
Mais à se bien conduire, à ne point faire de fautes ; & puis aussi à apprendre ce que l’on ne sçait pas.
La Mere.
Vous voyez donc bien qu’il n’est pas nécessaire de voyager pour avoir besoin de conseils. Tout le monde en a besoin ; mais tout le monde n’est pas en état d’en donner aux autres. Il ne faut accorder sa confiance qu’à ceux que l’on connoît bien, lorsque leur conduite nous a prouvé qu’ils ne nous en donneront pas de mauvais.
Emilie.
Oui, j’entens bien cela. Par exemple, Maman, je dois ne donner ma confiance qu’à vous, parce que je suis sûre que vous ne me tromperez pas, & que vous avez une patience, une patience… Mais à propos, Maman, & Monsieur Daucourt, qu’est-ce qu’il est devenu ?
La Mere.
Je m’en vais vous le dire. Il voyageoit seul comme vous sçavez. Il s’étoit pourvu d’un cheval avec lequel il se mit en route. La premiere journée se passa fort heureusement. Il arriva le soir dans un bourg & descendit à l’hôtellerie pour y passer la nuit. En vain lui demanda-t-on ses ordres. Daucourt n’aimoit pas les questions.
Emilie.
Je le crois bien, car il étoit sourd ; il ne les entendoit pas.
La Mere.
Pour les éviter, il se hâta de signifier qu’il vouloit être tranquille. Ainsi après avoir soupé il congédia tout le monde ; & comme il étoit plus que jamais enyvré de ses grands projets, il se mit à y rêver, il se coucha tard. Il ne s’apperçut qu’alors du besoin qu’il avoit de ses hardes.
Emilie.
Et pourquoi faire, dès qu’il alloit se coucher ?
La Mere.
Il avoit au moins besoin de son bonnet de nuit.
Emilie.
Où étoit-il donc ?
La Mere.
Dans sa valise. Et comme on lui avoit demandé s’il n’avoit besoin de rien, & qu’il n’avoit rien répondu, elle étoit restée sur le dos de son cheval.
Emilie.
Ah, c’est bien fait ! & comment fit-il ?
La Mere.
Toute la maison étoit endormie ; il fallut qu’il descendît lui-même pour tirer de sa valise ce qui lui étoit nécessaire. Le bruit qu’il fit éveilla les Valets. Ne recevant point de réponse à leurs questions, ils crurent avoir à faire à un voleur & agirent en conséquence. Daucourt meurtri de coups, démêla, non sans beaucoup de difficulté, les causes d’un traitement si étrange.
Emilie.
Comment ! ils le battirent ?
La Mere.
Oui, sans doute. Les Valets le virent détacher la nuit la valise qui appartenoit à un étranger logé chez eux ; ils le prirent pour un voleur, ils le battirent.
Emilie.
Et quand ils le reconnurent, ils furent sûrement bien fâchés ?
La Mere.
Oui, mais l’homme étoit battu, & l’on se moquoit de lui.
Emilie.
Et qu’est-ce que fit Daucourt ?
La Mere.
Le lendemain il se mit en route d’assez mauvaise humeur, sans juger cependant moins favorablement de sa sagacité & de sa prudence.
Emilie.
Ah ! je parie qu’il lui arrive encore quelque malheur. Ce sera bien fait, n’est-ce pas, Maman, puisqu’il ne se corrige pas ?
La Mere.
Le hazard ne le servit pas mal pendant quelques jours. Il ne fit que très-peu d’étourderies. Il questionnoit beaucoup, devinoit assez juste, & ses succès lui persuaderent plus d’une fois qu’il entendoit comme un autre. Mais ce bonheur dura peu. Le quatrieme jour de son voyage les habitants des Hameaux écartés l’avertirent qu’il s’étoit égaré, & lui conseillerent de regagner promptement le grand chemin pour se soustraire aux brigands dont leur canton étoit rempli. Daucourt prit, à son ordinaire, cet avis pour un compliment, & s’applaudissant de son talent de deviner, il continua sa route avec plus de confiance que jamais.
Emilie.
Oh, le drolle de corps qui prend un avis pour un compliment !… Maman, je suis lasse. Voulez-vous que nous nous asséyons ?
La Mere.
Volontiers. Bientôt il se vit attaqué. Il n’est point de sourd qui n’entende le langage des voleurs…
Emilie.
Comment est-ce qu’ils parlent donc ?
La Mere.
Ils ne parlent pas beaucoup ; ils fouillent dans les poches sans cérémonie. Daucourt fut dépouillé. Cette aventure l’affligea. Il reprit pourtant courage, & se reposant sur son mérite, il se persuada qu’une fois arrivé à Paris, il ne pourroit manquer sa fortune. « Ces malheureux, disoit-il, reculent mes espérances. A pied, je ne sçaurois faire la même diligence ; mais enfin il ne s’agit que de gagner Paris. On y connoît le prix des talents, & cela doit me suffire. » En se consolant ainsi, il arriva dans une petite Ville, où il résolut de passer la nuit. Son premier soin fut de s’adresser à un usurier.
Emilie.
Qu’est-ce que c’est qu’un usurier ?
La Mere.
C’est un homme qui prête de l’argent à ceux qui en ont besoin, à condition qu’on lui rendra le double de ce qu’il a prêté.
Emilie.
Est-ce qu’il y a des gens comme ça ? Ils sont donc bien riches ?
La Mere.
Ils le deviennent par ce moyen à-peu-près comme les voleurs quand ils ont fait une forte capture.
Emilie.
Oui, mais s’ils sont pris, les voleurs sont punis, parce qu’il n’est pas permis de voler. Vous m’avez dit cela, Maman !
La Mere.
L’usure n’est pas plus permise que le vol. Mais laissons cela, & pour aujourd’hui contentez-vous de sçavoir que Daucourt fit à cet usurier un récit touchant de son aventure, & qu’il lui proposa de lui avancer de l’argent à compte de la fortune qu’il espéroit de faire à Paris. L’usurier s’apperçut encore plus vîte de la surdité de Daucourt & de sa sotise, que de son besoin d’argent. Il n’en étoit pas à son coup d’essai. Il lui fit faire par écrit une reconnoissance de l’argent qu’il alloit lui prêter. Il emporta le billet & promit de lui donner dans peu de ses nouvelles. En effet, Daucourt se vit arrêté une heure après & conduit en prison. Sa surprise fut égale à son courroux, & s’il n’apprit point le sujet de son infortune, ce ne fut pas faute de questions, mais faute d’entendre les réponses. Il sçut enfin, par un interrogatoire en forme, qu’il étoit condamné à payer sur son billet cinquante pistoles qu’il n’avoit pas touchées. On lui apprit par la même occasion qu’il étoit sourd, mais il ne voulut jamais convenir ni de sa dette ni de sa surdité. Livré à ses réflexions dans une prison assez désagréable, il commença à se plaindre de sa destinée, & s’occupa principalement des réglements qu’il conviendroit de faire pour garantir les voyageurs de la brutalité des valets, de l’attaque des voleurs & de la friponnerie des usuriers ; trois especes d’hommes auxquels il attribuoit tous les malheurs du monde.
Cependant il se familiarisa insensiblement avec l’idée qu’il pouvoit bien être un peu sourd. De nouvelles réflexions (on a tout le loisir d’en faire dans la prison) vinrent à l’appui du premier soupçon. Daucourt ne put se dissimuler que s’il eût voulu se croire sourd & en convenir, il auroit évité presque tous les malheurs qui lui étoient arrivés. Il pensa encore que les jeunes gens, pour sçavoir si leurs projets étoient bons ou mauvais, ne faisoient pas mal de s’adresser à ceux que l’expérience a mis en état d’en juger. Il se condamna sur-tout d’avoir entrepris de jouer un rolle, sans consulter un pere dont il avoit reçu tant de marques de bonté. Il se détermina enfin à lui apprendre ses malheurs & ses fautes. Ce pere étoit indulgent. Il suffisoit que son fils fût malheureux & repentant pour lui faire oublier ses écarts. Il pardonna. Daucourt eut la permission de revenir auprès de lui, où il mene actuellement une vie tranquille, bien convaincu qu’il faut avoir des oreilles pour entendre, & qu’on a besoin de conseils, quand on veut réussir dans un monde qu’on ne connoît point.
Emilie.
Il lui a fallu bien des choses pour apprendre qu’il étoit sourd.
La Mere.
A quoi croyez-vous qu’on doive attribuer les malheurs qui lui sont arrivés ?
Emilie.
Je crois, Maman, que c’est qu’il avoit trop bonne opinion de lui… Mais je pense à une chose ; être entêté, n’est-ce pas comme si l’on étoit sourd ?
La Mere.
Précisément. Quand vous êtes entêtée, vous ne suivez que votre idée, & vous croyez sçavoir d’avance tout ce qu’on va vous dire. Vous vous croyez plus sage & plus habile que ceux qui vous parlent.
Emilie.
Cela est vrai. Et puis quand je vois que j’ai tort, je ne veux pas en convenir. Oh ! je veux me corriger ; il ne sera pas dit que je ressemblerai à Monsieur Daucourt.
La Mere.
Emilie, si vous êtes reposée, nous nous en retournerons.
Emilie.
Comme il vous plaira, Maman… Maman, je crois que j’aime mieux Monsieur Daucourt que Monsieur Sainville.
La Mere.
Et pourquoi ?
Emilie.
Il est plus drolle, & puis… Cependant ils ont tort tous deux… Je ne sçais pas, mais je l’aime mieux.
La Mere.
Ne seroit-ce pas parce qu’il vous ressemble un peu ?
Emilie.
Peut-être bien… Mais il s’est corrigé, & je me corrigerai aussi… Maman, nous avons assez causé ; si vous permettez, je vais courir un peu.
La Mere.
Je le veux bien ; mais courez dans cette allée, & ne me perdez pas de vue.


Emilie.
Maman !
La Mere.
Que voulez-vous, Emilie ?
Emilie.
Ah !… vous écrivez… j’en suis fâchée.
La Mere.
Pourquoi ?
Emilie.
Mais à qui écrivez-vous donc ?
La Mere.
C’est à quelqu’un à qui j’ai affaire & que vous ne connoissez pas.
Emilie.
Et qu’est-ce que vous lui mandez ?
La Mere.
Qu’est-ce que cela vous fait ?
Emilie.
Rien, mais c’est pour le sçavoir.
La Mere.
Vous voyez bien que votre curiosité est indiscrete & sans objet.
Emilie.
Comment donc, Maman ?
La Mere.
Ecoutez-moi ! Lorsque vous me parlez tout bas des choses qui vous intéressent, si une de vos petites amies, de vos compagnes venoit vous interrompre & vous demander ce que nous disons, qu’est-ce que vous diriez ?
Emilie.
Je dirois qu’elle est bien curieuse, & que cela ne la regarde pas.
La Mere.
Vous croyez donc qu’elle commettroit une faute contre la politesse & la discrétion ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
Eh bien ! vous venez de commettre la même faute avec moi, & bien plus grande encore, car vous me devez plus d’égards que votre petite amie ne vous en doit.
Emilie.
Mais vous ne causiez pas tout bas, Maman, vous écriviez ?
La Mere.
L’écriture est la conversation des absents. C’est le seul moyen que l’on ait de leur communiquer ses idées ; l’on confie alors ses secrets au papier : voilà pourquoi tout ce qui est écrit est sacré. On ne doit pas plus se permettre de lire les papiers que l’on trouve sous sa main, quand ils ne nous sont pas adressés, que d’écouter deux personnes qui parlent bas.
Emilie.
C’est donc bien mal d’écouter, je ne le sçavois pas ?
La Mere.
Vous devez le concevoir, puisque vous trouveriez mauvais que vos compagnes vous écoutassent quand vous me parlez.
Emilie.
Oui ; & il faut faire pour les autres comme nous voulons qu’ils fassent pour nous. Je sçais bien cela.
La Mere.
Souvenez-vous donc que ce seroit manquer à l’honnêteté, à la probité, à toutes les loix de l’honneur & de la société, que de lire un papier adressé à un autre, & d’écouter ce que l’on dit avec dessein de n’être pas entendu.
Emilie.
Tous les jours j’apprens quelque chose de nouveau.
La Mere.
Mais ce n’est pas pour sçavoir à qui j’écris que vous êtes venue ?
Emilie.
Mon Dieu non ; je suis bien fâchée d’avoir fait cette sotte demande. Je vous promets Maman que je ne serai plus curieuse de ce qui ne me regarde pas. Mais je crois que ce que j’ai à dire nous fera causer bien long-temps, & si votre Lettre est pressée, Maman…
La Mere.
Elle ne l’est pas. Attendez-moi ici, je vais revenir.
Emilie.
Vous allez donc serrer vos papiers, Maman ? Mais vous ne serez pas long-temps ?
La Mere.
Non.
Emilie.
C’est bon ; je vais rêver pendant ce temps-là à tout ce que j’ai à dire…
La Mere.
Allons, prenons notre ouvrage, & voyons ce qui nous occupe.
Emilie.
Maman, c’est que j’ai toutes mes idées barbouillées ; ma tête est sens dessus dessous.
La Mere.
Eh bien, il faut tâcher d’y remette l’ordre. Voyons !
Emilie.
Par exemple, vous m’avez dit, Maman, qu’il falloit que j’eusse une confiance entiere en vous.
La Mere.
Je ne vous ai jamais dit cela.
Emilie.
Comment ?
La Mere.
Je vous ai prouvé par votre expérience que vous vous étiez toujours bien trouvée d’avoir une confiance entiere en moi. Je vous ai montré plus d’une fois, & toujours par votre expérience, que vous vous étiez nui à vous-même, lorsque vous vous étiez cachée de moi. Mais je vous ai laissé libre de juger de ce qui étoit le plus avantageux pour vous, ou de la réserve ou d’une confiance entiere, & vous avez eu le bon esprit de sentir que vous me la deviez ; mais je ne vous ai jamais dit, il faut me la donner.
Emilie.
Mais c’est la même chose.
La Mere.
Point du tout ; car le jour que vous ne vous trouverez pas bien d’avoir en moi une entiere confiance, il ne tiendra qu’à vous de me la retirer ; au lieu que si je vous avois dit, il faut me donner votre confiance, ce seroit un ordre, & vous ne seriez pas maîtresse de me la retirer.
Emilie.
Cela est vrai.
La Mere.
Observez en passant par ce petit exemple, qu’il est très-important de bien sçavoir la signification des termes dont on se sert & qu’on emploie dans la conversation ; sans quoi il arrivera que vous direz une chose & que j’en comprendrai une autre.
Emilie.
Je parie que voilà ce qui brouille mes idées ?
La Mere.
Cela pourroit bien être. Mais ce n’est pas ma faute ; car je vous ai assez recommandé de ne laisser passer aucun mot sans me demander ce qu’il signifie.
Emilie.
Cela est vrai ; mais c’est que je les sçais tous à-peu-près…
La Mere.
Voilà encore une expression qui n’est pas exacte. Vous voulez dire que vous comprenez à-peu-près la signification de tous les mots, & ce n’est pas cela que vous dites, car on peut sçavoir un mot, un terme, sans comprendre toute l’étendue de sa signification. Mais laissons cela. Vous dites donc ?…
Emilie.
Je voulois dire d’abord, Maman, que j’ai une confiance entiere en vous, que je vous dis tout, mais tout, tout, & j’ai remarqué…
La Mere.
Eh bien ?… Qu’avez-vous remarqué ?
Emilie.
J’ai remarqué quelque chose.
La Mere.
C’est ?
Emilie.
Je n’ose pas dire.
La Mere.
Vous n’avez donc pas une confiance entiere en moi ?
Emilie.
Mais pardonnez-moi ; mais c’est que… Allons, je m’en vais le dire.
La Mere.
Ce que vous avez à me dire est donc bien humiliant, bien honteux ?
Emilie.
Oh non, Maman, du tout !
La Mere.
Il n’y a pourtant que ces sortes d’aveux qui puissent coûter à faire.
Emilie.
Ah, Maman, ne pensez pas cela, je m’en vais vous le dire bien vîte ; c’est que j’ai remarqué que vous ne me disiez pas tout.
La Mere.
Et qu’est-ce que je ne vous ai pas dit ?
Emilie.
Mais je ne sçais pas…
La Mere.
Mais encore avez-vous eu occasion de remarquer que je vous aye rien caché de ce qui vous intéresse ?
Emilie.
Non, Maman.
La Mere.
C’est donc sur les choses qui ne vous regardent pas que je vous ai fait des mysteres ?
Emilie.
Oui, Maman ; c’est quand vous parlez tout bas avec des personnes de vos amis, quand vous recevez des Lettres, & puis d’autres choses comme cela.
La Mere.
Et vous croyez donc que je manque de confiance en vous ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
Ah ! il faut vous rassurer & vous montrer que j’ai toute celle que votre âge peut permettre. Qu’est-ce que c’est que la confiance ; car il faut toujours convenir de nos termes pour être sûres que nous nous entendons ? Répondez-moi.
Emilie.
C’est de tout dire à quelqu’un, de n’avoir rien de caché pour lui.
La Mere.
Et qu’est-ce qui détermine en nous cette confiance pour une personne plutôt que pour une autre ?
Emilie.
Je n’entens pas, ou pour mieux dire, je ne comprens pas.
La Mere.
Qu’est-ce qui vous donne de la confiance en moi, par exemple ; qu’est-ce qui fait que vous me dites tout ce que vous pensez & tout ce que vous faites ?
Emilie.
C’est que je vous aime, Maman.
La Mere.
Cela ne suffit pas, ma fille. Vous aimez vos freres ; vous aimez vos petites compagnes, & vous ne leur dites pas tout ce que vous pensez, & vous avez raison. Voyez pourquoi vous avez plus de confiance en moi qu’en eux ?
Emilie.
C’est que vous ne m’avez jamais trompée, Maman, & que je suis bien sûre que vous ne direz à personne ce que je vous dis.
La Mere.
Vous croyez donc le secret & la discrétion indispensables pour inspirer la confiance ?
Emilie.
Très-sûrement, Maman.
La Mere.
Si j’allois confier aux autres tout ce que vous me dites, je perdrois votre confiance, vous n’en auriez plus en moi.
Emilie.
Je crois que je n’en pourrois plus avoir.
La Mere.
Eh bien ! vous devez donc trouver tout simple que je ne vous parle pas des affaires des autres, puisque je ne leur parle pas des vôtres.
Emilie.
Mais c’est que je voudrois bien sçavoir tout.
La Mere.
Pourquoi faire ? Il faut être si réservée pour ce qui ne nous regarde pas ! si discrette pour ne pas parler des affaires d’autrui, de peur de nuire sans le sçavoir en nous en mêlant sans nécessité, qu’il est bien plus heureux de n’en rien sçavoir.
Emilie.
Mais c’est que cela amuse.
La Mere.
Cela amuse les gens désœuvrés, comme les enfants & les ignorants. Il n’y a guere que ceux-là qui soient curieux ; ils sont bavards, redisants & dangereux.
Emilie.
Et pense-t-on d’eux comme cela dans le monde ?
La Mere.
Oui ; on les craint, on les fuit.
Emilie.
Il faut encore que je me souvienne de cela. Mais, Maman, vous, vos affaires, pourquoi ne me les dites-vous pas ?
La Mere.
Parce que vous n’êtes point en âge de les entendre & de les connoître, parce que votre âge est celui de la legereté, de l’indiscrétion, & qu’il faut que vous ayez mérité ma confiance, comme j’ai mérité la vôtre, pour que je vous la donne.
Emilie.
Ah ! Maman, je vous promets que je ne dirai rien de ce que vous me direz.
La Mere.
Pour que je puisse m’y fier, il faut d’abord cesser d’être curieuse, & puis j’essayerai votre discrétion par des secrets proportionnés à vos connoissances. A mesure que vous en acquerrez, je vous dirai tout ce qui pourra vous être utile de sçavoir, mais jamais ce qui concerne les affaires des autres.
Emilie.
Et moi, Maman, dois-je vous dire les affaires des autres ?
La Mere.
Comme personne n’ira vous choisir à votre âge pour vous rien confier, vous pouvez tout me dire sans manquer à la prudence, & ce n’est qu’en me disant tout, que vous apprendrez ce qu’il faut dire & ce qu’il faut taire aux autres.
Emilie.
Mais si l’on me prioit de ne pas vous dire quelque chose, comment faire ?
La Mere.
Il faut ne pas recevoir de confidences jusqu’à ce que vous soyez en âge de discerner celles qui doivent être sacrées d’avec celles qu’il convient de me dire.
Emilie.
Mais est-ce que je peux empêcher de parler ?
La Mere.
Vous pouvez prévenir la confidence, & dire, si l’on vous demande le secret, je vous avertis qu’il ne faut pas me le dire, si vous ne voulez pas que Maman le sçache, parce que je ne lui cache rien.
Emilie.
On dira que je suis une indiscrette.
La Mere.
Au contraire, vous n’aurez pas promis le secret & vous n’aurez pas voulu l’entendre. On dira que vous êtes prudente & vraie.
Emilie.
C’est joli d’être prudente & vraie, n’est-ce pas, Maman ?
La Mere.
Oui, ce sont deux belles qualités. Mais je voudrois sçavoir pourquoi vous aviez tant de peine à me dire que je n’avois pas confiance en vous.
Emilie.
Maman, je ne sçais pas, je craignois que cela ne fût pas bien de vous dire cela.
La Mere.
Et quand cela auroit été mal, est-ce que je ne vous juge pas toujours par votre intention ?
Emilie.
Cela est vrai, Maman.
La Mere.
Vous voyez donc bien que c’est une fausse honte ; & une fausse honte a toutes sortes d’inconvénients.
Emilie.
Lesquels donc ?
La Mere.
Que vous seriez restée dans l’idée que j’exigeois de vous une confiance que je ne vous accordois pas.
Emilie.
Oui, & puis que je n’aurois pas appris quelque chose sur la curiosité & sur la discrétion que je suis bien aise de sçavoir. Mais, Maman, si vous vouliez pourtant me dire un secret d’affaire, je vous assure que je le garderai bien.
La Mere.
Un secret d’affaire ? Et vous êtes fort en état de comprendre ce que je pourrois vous dire, n’est-ce pas ?
Emilie.
Mais je crois qu’oui.
La Mere.
Allons, voyons.
Emilie.
Faut-il garder le secret ?
La Mere.
Non pas absolument, mais comme il n’est ni poli, ni prudent d’entretenir les autres de ses affaires, il est inutile d’en parler.
Emilie.
Oh ! je vous promets, Maman, que je n’en parlerai pas. Est-ce ce que vous disiez hier au soir avec mon Papa, quand vous m’avez dit de vous laisser causer tranquillement ?
La Mere.
Oui, vous ne m’interromprez pas.
Emilie.
Non, Maman, je vous le promets.
La Mere.
Votre Papa, l’année derniere, a fait afficher sa ferme, dont le bail étoit à renouveller. Il s’est présenté plusieurs Fermiers ; mais comme il a fallu faire des informations pour sçavoir s’ils étoient solvables, cela a donné au Fermier, dont le bail finissoit, le temps de faire des réflexions. Entendez-vous bien ?
Emilie.
Je ne comprens pas tous ces mots-là, mais je n’ai pas osé vous interrompre. Qu’est-ce que c’est qu’un Fermier ; & puis sol… sol ?… Comment avez-vous dit Maman ?
La Mere.
J’ai dit, mon Enfant, toutes choses qu’il vous est impossible de comprendre, mais ce que vous êtes fort en état de juger vous-même, parce que vous le voyez tous les jours, c’est qu’une mere seroit très-aise de donner sa confiance entiere à son enfant, & qu’elle n’attend pour cela que le temps.
Emilie.
Comment le temps ?
La Mere.
Oui, que le temps, que l’âge, que les instructions ayent mis son enfant en état de comprendre les différentes choses qu’elle voudroit lui confier. Elle attend que la prudence & la réflexion lui fassent juger de l’importance de ce qu’on lui confie. Enfin, elle voudroit la voir promptement formée ; mais il faut le temps à tout, & c’est pour en hâter le moment autant qu’il est possible, que je vous engage à profiter des leçons qu’on vous donne. C’est pour cela que nous causons ensemble. Eh bien, que concluez-vous de tout ce que je viens de vous dire ?
Emilie.
Je conclus, Maman, que lorsque vous me cachez quelque chose, c’est qu’il ne faut pas me le dire, & je n’aurai plus de curiosité pour sçavoir ce qui ne me regarde pas. Voilà ce que je conclus, & puis encore, que je vais m’appliquer tant que je pourrai, & que je profiterai des avis que vous voulez bien me donner.
La Mere.
Vous ne croirez donc plus qu’on manque de confiance en vous.
Emilie.
Non, Maman.
La Mere.
Cette défiance est affligeante pour les autres, & c’est un vilain défaut que la défiance ; mais il y a bien autre chose qu’il faut que vous ayez le courage de vous dire, parce que cela est vrai, & qu’il faut toujours se dire la vérité.
Emilie.
Quoi donc, Maman ?
La Mere.
C’est que vous n’avez encore aucune des qualités nécessaires pour que l’on ait confiance en vous ; ainsi vous n’êtes point en droit d’en exiger, ni de vous plaindre de ce que l’on en manque.
Emilie.
Et pourquoi donc, Maman, qu’est-ce qu’il faut faire pour les avoir ?
La Mere.
Il faut être plus grande que vous n’êtes, & cela ne dépend pas de vous. Vous avez les agréments & les inconvénients de votre âge. Il faut en grandissant, en prenant des années, perdre tous vos petits défauts & acquérir des vertus solides ; alors vous aurez droit à l’amitié & à la confiance.
Emilie.
Oui ; alors vous en aurez en moi, n’est-ce pas, Maman ?
La Mere.
Si vous sçavez m’en inspirer ; car la confiance est libre & ne peut s’exiger. Vous êtes convenue que je ne vous avois jamais dit d’en avoir en moi.
Emilie.
Non, Maman.
La Mere.
Qu’est-ce qui vous en a donné ?
Emilie.
Mais c’est que j’ai vu que je ferois bien.
La Mere.
Et comment avez-vous vu cela ?
Emilie.
Maman, j’ai eu l’honneur de vous le dire.
La Mere.
Oui, mais nous avons besoin de répéter souvent les mêmes choses ?
Emilie.
C’est que j’ai vu que vous me disiez toujours vrai, que vous ne répétiez jamais ce que je vous avois dit, & puis vous m’annoncez toujours d’avance ce qui m’arrivera.
La Mere.
La prévoyance, la vérité & le secret sont donc des vertus nécessaires pour inspirer la confiance ?
Emilie.
Je crois qu’oui.
La Mere.
Croyez-vous les avoir ?
Emilie.
Oh non, pas encore ; mais je veux les avoir absolument.
La Mere.
J’aime à vous voir cette émulation.
Emilie.
Maman, quand je les aurai, vous aurez confiance en moi, vous me l’avez dit, n’est-ce pas ?
La Mere.
Oui, je vous le promets. Est-ce là tout ce qui barbouilloit vos idées ?
Emilie.
Oh ! Maman, il y a bien autre chose ; mais c’est bien difficile à dire cela, je ne sçais par où m’y prendre.
La Mere.
Essayez toujours.
Emilie.
Maman, vous m’avez dit que si je restois ignorante, on n’auroit pas bonne opinion de moi.
La Mere.
Cela est vrai.
Emilie.
Voilà pourquoi je me suis dépêchée bien vîte, bien vîte, d’apprendre à lire & à écrire.
La Mere.
Ah, vous ne vous êtes pas dépêchée, si vîte, si vîte !
Emilie.
Mais un peu vîte, & puis je me dépêche à présent d’apprendre l’Histoire-Sainte, la Géographie, enfin tout.
La Mere.
Oui, vous en avez eu trois leçons… Eh bien, vous ne dites plus mot ?
Emilie.
Eh bien, Maman, c’est que je suis toute étonnée !
La Mere.
Et de quoi ?
Emilie.
Mais, Maman, vous avez toujours la bonté de m’encourager, & à présent il semble que vous ne soyez pas contente.
La Mere.
Pardonnez-moi ; mais vous commenciez à faire un si grand étalage de la vîtesse que vous avez mise à apprendre fort peu de chose, que j’ai voulu vous ramener à apprécier au juste votre mérite.
Emilie.
Mais enfin, Maman, je sçais bien lire & bien écrire.
La Mere.
Vous sçavez très-bien lire, j’en conviens, mais vous ne sçavez pas encore écrire ; vous commencez à bien former vos lettres, & il n’y a pas de quoi se vanter si fort.
Emilie.
Mais pourquoi donc, Maman ?
La Mere.
Si Mademoiselle Louise, ou quelques-unes de vos petites amies se vantoient d’avoir appris en très-peu de temps à bien mettre leurs gants, à se chausser & à se déchausser toutes seules, que penseriez-vous d’elles ?
Emilie.
Oh ! cela me feroit bien rire, par exemple ; car tout le monde sçait cela, je crois.
La Mere.
Eh bien, il n’y a pas plus de vanité à tirer de sçavoir lire & écrire, que de sçavoir se chausser & se déchausser toute seule ; il n’est pas plus permis d’ignorer l’un que l’autre, parce que cela est également nécessaire.
Emilie.
Mais d’apprendre à lire, c’est pourtant bien plus difficile.
La Mere.
J’en conviens ; mais c’est une peine que tout le monde a éprouvée, & que tout le monde a surmontée à son tour. Personne n’est encore mort à cette peine, ainsi l’on sçait que l’effort n’est pas grand.
Emilie.
J’ai pourtant bien travaillé pour sçavoir lire couramment.
La Mere.
Cela vous prouve que vous n’êtes pas un miracle de la nature comme vous aviez l’air de le croire ; car enfin vous ne sçavez rien de plus que ce que sçavent tous les enfants de votre âge… Et si vous n’étiez pas comme un petit hanneton…
Emilie.
Ah !… à propos, Maman, que je vous dise… ce n’est pas un hanneton ; mais j’ai pris hier un beau papillon. Oh, il étoit beau ! il avoit du jaune, du bleu, toutes sortes de couleurs. J’avois bien envie de le garder, mais je me suis souvenue de ce que vous m’avez dit… pas d’abord pourtant, c’est ma bonne qui me l’a rappellé.
La Mere.
Eh bien, qu’est-ce que vous en avez fait ?
Emilie.
Je me suis souvenue de cette mouche de l’autre jour, & j’ai dit, si l’on me tenoit comme cela en l’air par les cheveux, cela me feroit bien mal. Tenez, Maman, je me suis imaginé bien cela ; car je me suis tiré les cheveux, pour voir comme cela me feroit, & puis tout-de-suite j’ai été dans le jardin, j’ai posé le papillon sur une rose ; heureusement, je ne lui avois pas fait mal, car il s’est envolé tout-de-suite, & je suis revenue bien contente de lui avoir fait plaisir.
La Mere.
Venez, que je vous embrasse, Emilie, vous ne sçauriez croire le plaisir que vous me faites ! Exercez-vous toujours à faire du bien, & à vous trouver heureuse de celui que vous faites. C’est un moyen sûr de l’être toujours, & un moyen qu’il ne dépendra de personne de vous ôter. Je parie que vous étiez plus contente que vous ne l’êtes au milieu de tous vos amusements ordinaires ?
Emilie.
Oh ! cela est vrai, Maman ; tenez, je me sentois si aise… Il me sembloit que j’étois plus grande ! Pourquoi donc ?
La Mere.
C’est que quand vous faites du bien, vous vous élevez au-dessus de votre âge.
Emilie.
Comment cela, Maman ?
La Mere.
C’est qu’à votre âge, on n’a pas souvent le pouvoir d’en faire, mais revenons à ce que vous vouliez me dire.
Emilie.
Bon ! je ne sçais plus ce que c’est à présent. Qu’est-ce que je disois donc, Maman ?
La Mere.
Vous me parliez de la peine que vous avez eue à apprendre à lire & que vous avez à apprendre à écrire.
Emilie.
Oui, mais je voulois dire autre chose… Est-ce que je n’ai dit que cela ?
La Mere.
Il me semble que non. Vous avez commencé cependant comme si vous vouliez qu’on vous expliquât pourquoi ces premieres sciences, qui sont les éléments de toutes les autres, étoient si nécessaires à sçavoir.
Emilie.
Oh, non !… oui… je me souviens… voici ce que je n’entens pas. Vous m’avez toujours assuré, Maman, qu’on auroit mauvaise opinion de moi, si je ne sçavois rien ; & hier, vous sçavez bien, cette grande compagnie qui est venue, ces Messieurs, ces Dames…
La Mere.
Eh bien ?
Emilie.
Ils se sont moqués de cette Dame… J’ai oublié son nom… cette Dame, dont ils parloient toujours, qui est si sçavante, comment s’appelle-t-elle donc ?
La Mere.
Son nom n’y fait rien. Mais qu’est-ce qu’ils en disoient ?
Emilie.
Oh ! j’ai bien vu qu’ils se moquoient d’elle, & vous l’avez bien vu aussi, Maman, j’en suis sûre ; car vous avez ri & vous avez fait des signes à Papa. Pourquoi lui faisiez-vous des signes ?
La Mere.
C’étoit pour le prier de changer de conversation, parce que je n’aime point à entendre donner des ridicules à personne chez moi.
Emilie.
Monsieur le Comte disoit qu’il ne lui manquoit qu’un chapeau de Docteur, je crois, & qu’on ne pouvoit pas dire un mot, qu’elle ne répondît en grec ou en latin. Et puis ce gros Monsieur, qui avoit un habit verd & une si belle veste, a dit, qu’elle parle toujours de sa science, pendant qu’elle ne sçait pas seulement le prix d’un poulet ; & puis qu’elle feroit mieux d’apprendre à parler à sa fille, qui ne sçait pas lire.
La Mere.
Eh bien, qu’est-ce que vous en dites ?
Emilie.
Mais voilà ce qui brouille ma tête. Pourquoi se moquer de sa science, dès qu’il est honteux de ne rien sçavoir ?
La Mere.
Nous allons voir, c’est une chose à examiner. Je me rappelle qu’il y a une de vos compagnes, dont la société ne vous plaît pas beaucoup, c’est Mademoiselle Sophie, je crois.
Emilie.
Ah ! cela est vrai, elle m’ennuie.
La Mere.
Et pourquoi ?
Emilie.
Vous le sçavez bien, j’ai eu l’honneur de vous le dire.
La Mere.
Dites-le-moi encore, je ne m’en souviens pas bien.
Emilie.
Mais c’est qu’elle parle toujours d’elle, de ce qu’elle a appris, de ce qu’elle a dit, & quand on veut jouer ou parler d’autre chose, elle ne veut pas, elle prend de l’humeur, & elle se donne toujours pour exemple.
La Mere.
Et vous ne trouvez pas cela bien ?
Emilie.
Je ne sçais pas si cela est bien ou mal, mais cela m’ennuie.
La Mere.
N’est-ce pas que vous voudriez faire comme elle, & qu’elle ne vous en laisse pas le temps ?
Emilie.
Oh non, ma chere Maman !
La Mere.
Vous avez raison ; car cela est fort ridicule. Eh bien, vous ne devez plus être étonnée qu’on blâme cette Dame de parler de sa science, puisque vous trouvez le même ridicule insupportable dans vos compagnes.
Emilie.
Mais cependant il faut bien montrer aux autres ce que l’on sçait, sans quoi on passe pour une ignorante.
La Mere.
Point du tout ; cela s’arrange tout autrement, vous allez en convenir. Quand vous brodez, quand vous faites de la tapisserie, quand vous lisez, avez-vous besoin d’aller dire, Madame, je sçais lire, je sçais broder, je sçais faire de la tapisserie ? On sçait pourtant que vous n’ignorez pas ces différentes choses.
Emilie.
Je le crois bien, Maman ; on me les voit faire.
La Mere.
Eh bien ! à la maniere dont on écoute les différentes conversations, à la maniere dont on répond lorsqu’on nous adresse la parole, on juge très-aisément qu’une personne est instruite, ou qu’elle est ignorante. N’est-il pas vrai que si on vous parloit de l’histoire de France ou de l’histoire Romaine, vous ne sçauriez répondre, parce que vous ne sçauriez seulement pas de quoi l’on veut parler ?
Emilie.
Cela est sûr.
La Mere.
Et si l’on parloit devant vous de quelques points de Religion contenus dans votre Catéchisme, vous seriez tout d’un coup au fait de ce que l’on dit, & vous pourriez même répondre à propos. Vous voyez donc bien qu’on peut apprécier les connoissances que vous avez acquises sans que vous vous donniez la peine de dire, je sçais ceci, j’ignore cela.
Emilie.
Ah, ah, mais vraiment oui, cela est vrai !
La Mere.
Vous devez sentir par la même raison, que c’est une affectation ridicule d’aller se vanter de ce que l’on sçait.
Emilie.
Oui je sens cela. Mais si on ne parle pas devant moi des choses que je sçais, on croira que je suis ignorante.
La Mere.
C’est une des raisons qui doit vous engager à apprendre promptement ce que vous ne sçavez pas, pour être au fait de tout ce qu’on dit. Mais il y a encore une raison, qui rend ridicule cette affectation de se vanter de sa science.
Emilie.
Laquelle, Maman ?
La Mere.
Pourquoi apprenez-vous à travailler en broderie, en tapisserie, &c. ?
Emilie.
Mais c’est pour sçavoir m’occuper, je crois, & puis pour faire des ouvrages utiles pour moi.
La Mere.
Pourquoi apprenez-vous à coudre, à raccommoder vos mouchoirs, vos nippes, à faire vos ajustements ?
Emilie.
Maman, vous m’avez dit que c’étoit pour apprendre à me passer des autres.
La Mere.
C’est donc pour vous-même que vous apprenez à travailler, ce n’est pas pour les autres ?
Emilie.
Non sûrement, c’est pour moi, c’est pour mon avantage ; vous me l’avez dit, Maman, je m’en souviens bien.
La Mere.
Eh bien, mon Enfant ! c’est aussi pour soi, pour sçavoir s’occuper seule, & pour apprendre à se passer des autres, qu’il faut avoir des talents & cultiver les sciences.
Emilie.
Qu’est-ce que c’est que des talents & cultiver les sciences ?
La Mere.
La musique, le dessein, la danse, la peinture, &c. voilà ce qu’on appelle des talents.
Emilie.
Quoi, il faut sçavoir tout cela ?
La Mere.
Non, sur-tout si vous n’y avez pas de disposition naturelle ; mais il faut les connoître & apprendre à fond celui de ces talents pour lequel vous vous sentirez le plus de goût.
Emilie.
Oh ! je crois que ce sera le dessein. Et cultiver les sciences, qu’est-ce que c’est ?
La Mere.
C’est ce que vous appellez être sçavante, c’est sçavoir l’histoire & la lire souvent, c’est acquérir des connoissances en tout genre.
Emilie.
Mais on n’a donc jamais le temps de jouer ?
La Mere.
Quand vous appreniez à lire, vous ne pouviez pas concevoir que la lecture vous serviroit un jour d’amusement ?
Emilie.
Oh ! pour cela non ; car j’ai bien pleuré pour apprendre à lire, j’en suis bien honteuse à présent.
La Mere.
Et cependant dans les moments destinés à vos amusements, je vous vois souvent quitter votre poupée pour lire une Fable ou une Histoire.
Emilie.
Oui, j’aime beaucoup à lire ; cela m’amuse à présent.
La Mere.
Vous pouvez donc comprendre que quand je vous presse d’apprendre de nouvelles choses, ce sont de nouveaux amusements que je vous prépare.
Emilie.
Comment cela, Maman ?
La Mere.
Lorsque vous sçaurez la musique, la géographie, le dessein, vous passerez de l’une à l’autre de ces occupations, & vous vous en amuserez comme vous vous amusez actuellement de la lecture.
Emilie.
Oh, si je croyois cela !… Mais je le crois, Maman, puisque vous me le dites.
La Mere.
Il viendra un temps où votre poupée, votre lanterne magique, votre ménage ne vous amuseront plus. Il faut donc vous préparer dès-à-présent des ressources pour ce temps-là, & c’est ce que vous faites, lorsque vous étudiez.
Emilie.
Ah ! Maman, je m’en vais bien m’appliquer, afin de sçavoir le plus de choses que je pourrai. J’ai déja deux maîtres, Maman, si vous m’en donniez encore quelques-uns, deux ou trois.
La Mere.
Non ; il ne faut pas aller trop vîte ! Contentez-vous de bien faire ce qu’on exige de vous, & laissez-moi guider vos progrès.
Emilie.
Et avec cela je me passerai donc des autres ?
La Mere.
Vous n’aurez besoin que de vous-même & des vos talents pour vous trouver heureuse.
Emilie.
Mais pourquoi faut-il sçavoir se passer des autres ?
La Mere.
C’est qu’on est beaucoup plus souvent seul qu’avec les autres, & que si vous ne sçavez pas vous occuper & vous amuser seule, l’ennui vous gagnera. Quand on s’ennuie, on prend de l’humeur. Votre expérience vous a d’ailleurs appris que l’humeur n’arrive jamais que lorsque l’on est desœuvré.
Emilie.
Maman, voulez-vous que je demande de la lumiere, je ne vois plus clair.
La Mere.
Oui, sonnez !
Emilie.
Et puis nous verrons la lanterne magique, en attendant que mon maître vienne.

Emilie.
Maman, j’ai vu hier aux Thuileries quelque chose de bien extraordinaire.
La Mere.
Et qu’est-ce que c’étoit ?
Emilie.
C’étoit une petite Demoiselle, bien parée, qui n’étoit pas plus grande que moi, & qui regardoit toujours, toujours ses nœuds de manches.
La Mere.
Bon !
Emilie.
Elle ne regardoit pas seulement autre chose ; aussi tout le monde rioit & se moquoit d’elle. Elle ne le voyoit pas ; elle rioit aussi.
La Mere.
Comment ! elle ne sentoit pas qu’on se moquoit d’elle ?
Emilie.
C’est que je crois qu’elle est un peu bête.
La Mere.
Connoissez-vous cette petite Demoiselle ?
Emilie.
Non, Maman, je ne la connois pas, ni ma bonne non plus. Mais la bonne de Mademoiselle Louise a dit que c’étoit sûrement la fille de quelque cuisiniere, que sa maîtresse s’étoit divertie à parer, parce que si c’étoit une Demoiselle de condition, elle ne seroit pas si étonnée d’être bien mise & d’avoir des nœuds de manches.
La Mere.
Cela prouve au moins une bien petite tête, bien vuide, bien ignorante.
Emilie.
Oui, & bien bête de ne pas voir qu’on se moque d’elle. Mademoiselle Louise voit bien quand on se moque d’elle, mais elle ne s’en soucie pas ; c’est bien mal cela, Maman ?
La Mere.
C’est encore pis que de ne le pas voir.
Emilie.
Oui, cela prouve qu’elle n’a pas de sentiment.
La Mere.
Et vous, comment faites-vous quand on se moque de vous ?
Emilie.
Moi ?
La Mere.
Oui vous.
Emilie.
Je ne sçais pas.
La Mere.
Comment ! vous connoissez si bien les défauts de vos compagnes, & vous ne connoissez pas les vôtres ?
Emilie.
Mais, Maman… c’est que je les vois ; c’est visible cela.
La Mere.
Vous rappelez-vous la Fable de la besace ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
Eh bien, qu’est-ce qu’elle dit ?
Emilie.
N’est-ce pas celle où tous les animaux sont contents de leur figure ?
La Mere.
Oui, ils se trouvent tous parfaits & critiquent leurs camarades. Dites-moi les six derniers vers.
Emilie.
La Mere.
Avez-vous bien pensé au sens de ces vers, ma fille ?
Emilie.
Pas beaucoup, Maman ; mais j’y pense à présent.
La Mere.
Je me meurs de peur que ce ne soit votre histoire.
Emilie.
Non, Maman.
La Mere.
Regardez-y bien. Interrogez votre conscience ; je crois qu’il y a long-temps que vous ne lui avez rien dit. Voyez, vous avez très-bien remarqué qu’il étoit fort mal d’être insensible à l’improbation ?
Emilie.
L’improbation est le contraire de l’approbation, je crois ?
La Mere.
Oui, c’est le blâme, la critique. Eh bien ! voyez si vous n’avez aucun des défauts que vous voyez si bien dans les autres ?
Emilie.
C’est que mes défauts sont dans la besace qui est par derriere, vous sçavez bien, Maman ?
La Mere.
C’est pour cela qu’il faut interroger votre conscience ; il n’y a pas de besace cachée pour elle.
Emilie.
Eh bien, ce soir je lui demanderai. Maman, elle m’a parlé hier au moins.
La Mere.
Et qu’est-ce qu’elle vous a dit ?
Emilie.
Oh ! c’est après ma leçon d’écriture, vous sçavez bien ce qu’elle m’a dit, Maman ?
La Mere.
Je m’en doute ; elle vous a dit que si vous ne faisiez pas plus de progrès, c’étoit votre faute & manque d’application.
Emilie.
C’est vrai, Maman… ah !… à propos, j’ai lu hier une belle histoire dans ce Livre que vous m’avez prêté. Oh, elle est belle ! belle ! belle ! Sçavez-vous, Maman, qu’elle a fait pleurer mon frere ?
La Mere.
Et vous ?
Emilie.
Moi, je n’ai pas pleuré !
La Mere.
Est-ce que l’histoire ne vous a pas paru touchante ?
Emilie.
Ecoutez, Maman, je m’en vais vous la dire, vous me direz si j’ai mal fait de ne pas pleurer.
La Mere.
Sans sçavoir votre histoire, je vous dirai d’avance que vans avez bien fait de ne pas pleurer, dès qu’elle ne vous a pas assez touchée pour vous en donner envie, & votre frere a bien fait de pleurer dès qu’il étoit attendri.
Emilie.
Mais je n’entens pas cela, nous n’avons pas fait la même chose, & nous avons bien fait tous deux.
La Mere.
Oui, parce que vous avez suivi tous deux le mouvement de votre cœur. Le vôtre ne vous a rien dit ; il ne falloit pas le faire parler malgré lui. Le sien s’est attendri, il l’a écouté.
Emilie.
Maman, que je vous conte l’histoire que j’ai lue.
La Mere.
Me la conterez-vous d’une maniere bien claire ?
Emilie.
Oh ! oui, Maman, car je l’ai bien retenue.
La Mere.
Voyons ?
Emilie.
« Il y avoit deux vieux bons hommes qui étoient une fois sur les montagnes… les montagnes… » J’ai oublié le nom de la montagne, mais c’est égal.
La Mere.
Non pas, s’il vous plaît ; cela n’est point égal, à moins que vous ne me disiez au moins dans quel pays elle est.
Emilie.
Mais je ne le sçais pas, Maman.
La Mere.
Vous avez cependant lu le nom de la montagne, à ce que vous dites, & vous ne sçavez pas où elle est ?
Emilie.
Non, Maman !
La Mere.
Voilà ce que c’est que de ne pas connoître la géographie ; moi je suis bien aise de sçavoir dans quel pays étoient ces bons vieillards.
Emilie.
Eh bien, Maman… Ah ! je m’en souviens ; c’étoit au bord de la mer… Non, non, ils y alloient ; mais ils sont restés dans les Alpes, proche de la Savoie, je crois.
La Mere.
Ah ! vous me faites un grand plaisir de me le dire, parce qu’à présent je les vois d’ici.
Emilie.
Vous les voyez, Maman ?
La Mere.
Oui, parce que je sçais la géographie, & que voyant leur position, je me les représente bien mieux.
Emilie.
Et moi donc, Maman, puis-je voir où ils sont ? C’étoit tout ce que je desirois hier en lisant leur histoire.
La Mere.
Vous n’avez qu’à vous dépêcher d’apprendre la géographie, & vous connoîtrez bientôt le pays qu’ils habitoient.
Emilie.
Mais est-ce que je ne peux pas les voir aujourd’hui ?
La Mere.
Non, parce que vous avez des connoissances si superficielles en géographie que cela troubleroit vos idées. Il faut bien connoître son pays avant de parcourir ceux des autres. Voyons la suite de votre histoire !
Emilie.
Eh bien, Maman, ces deux vieillards étoient là. Ils s’étoient fait une petite maison, & ils avoient un lit, & puis des Livres, & puis ils prioient le bon Dieu, & puis…
La Mere.
Est-ce qu’il y avoit tous ces & puis là dans votre histoire ?
Emilie.
Mais non, Maman, mais c’est que je conte…
La Mere.
Je vous ai souvent conté des histoires, & je ne me rappelle pas d’avoir jamais orné mon discours de tant d’& puis.
Emilie.
Allons, je m’en vais bien dire. Il leur étoit arrivé bien des malheurs à ces deux Messieurs ; il y en avoit un qui étoit bien riche, bien riche, & puis l’autre ne l’étoit pas.
La Mere.
Je ne comprens rien à votre histoire. Qu’est-ce qu’ils faisoient sur cette montagne avec un lit, des Livres, puisque l’un d’eux étoit si riche ?
Emilie.
Mais non, Maman, c’est qu’il ne l’étoit plus, vous allez voir.
La Mere.
Ah ! c’est-à-dire, que vous avez commencé votre histoire par la fin. Il faut prévenir de ces choses-là, car ce n’est pas l’ordinaire.
Emilie.
Oh ! Maman, cela n’y fait rien.
La Mere.
Vous ne la contez pas apparemment pour être entendue.
Emilie.
Pardonnez-moi, Maman.
La Mere.
Mais si vous eussiez commencé à lire cette aventure par la fin, est-ce que vous auriez pu y rien comprendre ?
Emilie.
Non, pas trop. Mais je ne sçaurois dire autrement. Tenez, Maman, parlons d’autre chose.
La Mere.
Non pas, je vous prie d’achever comme vous pourrez, & puis je vous dirai comment il falloit la conter, afin de vous accoûtumer à mettre de l’ordre dans vos idées.
Emilie.
Si vous vouliez me le dire avant, ma chere Maman ?
La Mere.
Cela m’est impossible, je ne sçais pas votre histoire. Tâchez de vous en tirer, puisque vous avez entrepris de la conter. Donnez-vous la peine de penser avant de parler.
Emilie.
Je pense, Maman, & je ne peux pas dire autrement. Ce Monsieur, qui étoit bien riche a tout donné, parce que l’autre n’avoit rien. Il lui a dit, prenez tout : il a tout pris, il a tout payé, & sa femme est morte dans la prison en nourrissant son enfant… & puis…
La Mere.
La femme de qui ?
Emilie.
La femme de ce Monsieur qui n’avoit rien & qui étoit l’ami de celui-là qui étoit bien riche, & on l’avoit mis en prison aussi ; c’étoit son Boulanger, son Boucher & puis d’autres ; & puis ils n’ont plus rien eu ni l’un, ni l’autre, & voilà pourquoi ils sont sur la montagne, & ils sont heureux ; mais il y en a un qui est triste, c’est celui qui a perdu sa femme, & voilà tout. Ai-je bien fait de ne pas pleurer ?
La Mere.
Oh certainement ! vous ne pouviez pas pleurer, car vous n’y avez rien compris. Mais cet homme que ses créanciers avoient mis en prison, avoit-il été toujours pauvre, ou lui étoit-il arrivé quelque malheur ?
Emilie.
Je ne m’en souviens pas, je crois… Ah ! pardonnez-moi, c’est le feu qui avoit brûlé tout son bien la nuit, qui étoit dans son porte-feuille.
La Mere.
La nuit étoit dans son porte-feuille ?
Emilie.
Mais non, Maman, c’étoit son bien qui étoit dans son porte-feuille.
La Mere.
Moi, je comprens les choses comme on me les dit. Ainsi accoûtumez-vous à vous expliquer clairement. Point de paresse, s’il vous plaît. Et par quel hazard ces deux Messieurs étoient-ils amis ? Comment s’étoient-ils rencontrés ?
Emilie.
Mais ils ne s’étoient pas rencontrés, c’étoient deux freres.
La Mere.
Ah ! c’est une petite circonstance assez intéressante que vous oubliez là. L’amitié est si étroite entre freres qu’il est tout simple qu’ils partagent leur fortune entre eux. Ils seroient même très-coupables de ne le pas faire, car tout ce qui leur arrive doit leur être commun. Il falloit d’abord commencer votre récit par là ; ensuite dire l’événement qui avoit privé l’un des deux de sa fortune, tous les malheurs qui avoient suivi la perte de son bien, comment son frere en avoit réparé une partie autant qu’il étoit en son pouvoir, & vous auriez fini par leur établissement sur les montagnes des Alpes, vous auriez fait le tableau de la vie qu’ils y menoient, & l’on auroit compris quelque chose à votre histoire.
Emilie.
Eh bien, si vous voulez, Maman, je vais recommencer.
La Mere.
Oh non, pas pour aujourd’hui ; mais demain, pendant ma toilette, vous me la conterez. Tâchez d’ici là d’arranger vos idées d’une maniere un peu plus claire.
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
Et n’oubliez pas de dire un mot des raisons qui leur ont fait choisir cette habitation de préférence à une autre. Sont-ils partis de chez eux avec le projet d’y aller ?
Emilie.
Non, Maman. Il y a eu une tempête, parce qu’ils étoient embarqués… Ah ! tenez, je me souviens, ils demeuroient à Bruxelles, ils alloient en Italie, & ils sont obligés de rester là.
La Mere.
Ils ont pris un chemin bien singulier. Je ne vois pas trop comment ils ont fait pour aller par mer de Bruxelles sur les Alpes. Cela est impossible.
Emilie.
Oh, l’histoire est bien longue ; je n’ai pas tout retenu, & mon frere a dit qu’il la reliroit encore.
La Mere.
Je vous conseille d’en faire autant, si vous voulez la conter. Lisez-la jusqu’à ce que les événements soient si bien dans votre tête, que vous puissiez y mettre un peu plus d’ordre.
Emilie.
Oui, Maman… Mais est-ce que cela est vrai ?
La Mere.
Je n’y vois rien d’impossible, & à travers le pot-pourri que vous en avez fait, j’apperçois même qu’elle peut être fort intéressante, & qu’elle est une preuve de la force de l’amitié fraternelle.
Emilie.
Oh ! oui, ces deux freres s’aimoient bien… tenez, Maman, autant que j’aime mon frere.
La Mere.
Vous l’aimez donc beaucoup ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
Mais pourquoi donc vous disputez-vous toujours ?
Emilie.
Oh ! c’est pour jouer ; & puis il prend mes joujoux.
La Mere.
Vous n’êtes donc pas disposée à tout partager avec lui ?
Emilie.
Pardonnez-moi, Maman ; & mon argent aussi, & mon goûter aussi. Hier je l’ai partagé avec lui !
La Mere.
C’est très-bien fait ; mais il faut cependant changer le genre de vos amusements & ne plus vous disputer ainsi. Vous n’aimez pas à être contrariée, Emilie, & vous contrariez les autres ! Cela n’est pas juste. D’ailleurs cela est mal honnête, laissez ce ton à la petite Demoiselle aux nœuds de manches, & prenez celui de votre état & d’une fille bien née.
Emilie.
Maman, vous direz donc la même chose à mon frere ?
La Mere.
Je la lui dirois aussi, s’il se mettoit dans le cas de mériter cet avis ; mais rien n’est moins nécessaire avec lui, car il est très-complaisant.
Emilie.
Maman, je crois qu’on aime mieux mon frere que moi !
La Mere.
Qui croyez-vous qui aime mieux votre frere que vous ?
Emilie.
Mais tous ceux qui viennent ici. Depuis un mois qu’il est avec vous, on lui donne des louanges toute la journée, & à moi l’on ne dit mot.
La Mere.
Quelle peut être la raison de cette distinction ?
Emilie.
Je ne sçais pas, Maman, je voudrois bien la sçavoir.
La Mere.
Il faut la chercher, ma fille, & vous la trouverez.
Emilie.
Maman, aidez-moi à la trouver.
La Mere.
Je le veux bien ; mais commencez par me dire ce que vous imaginez, n’importe quoi.
Emilie.
Oh ! cela sera bientôt dit ; je pense qu’apparemment il est plus aimable que moi.
La Mere.
Oui, mais vous avez de quoi l’être autant que lui, si vous voulez.
Emilie.
Oui, Maman ? Et comment cela ?
La Mere.
C’est qu’il est doux ; c’est qu’il est complaisant ; c’est qu’il écoute quand on lui parle ; c’est qu’il profite des avis qu’on lui donne, & qu’il n’a point d’humeur.
Emilie.
Oui, c’est laid l’humeur, on ne plaît donc pas avec de l’humeur ?
La Mere.
Oh ! pour cela non.
Emilie.
Eh bien ! je n’en aurai plus ; car je veux plaire absolument, absolument.
La Mere.
Et comment vous y prendrez-vous pour n’avoir pas d’humeur ?
Emilie.
Quand elle voudra venir, je la renverrai.
La Mere.
Et vous croyez qu’elle s’en ira ?
Emilie.
Oui, sûrement Maman. Oh bon, je l’ai chassée souvent comme cela !
La Mere.
Oh que non, Emilie, ce n’est pas comme cela qu’il faut s’y prendre !
Emilie.
Et comment faut-il donc faire ?
La Mere.
Il faut sçavoir d’abord, qu’est-ce qui la fait venir ?
Emilie.
Oh ça, je n’en sçais rien ! Elle vient comme une folle à propos de bottes, au moment où j’y pense le moins.
La Mere.
Elle ne vient pourtant pas sans raison, & je le sçais bien ; c’est que vous craignez de vous donner de la peine. Vous êtes paresseuse naturellement.
Emilie.
Croyez-vous, Maman ?
La Mere.
Oui j’en suis sûre. Vous avez l’esprit paresseux, voyez vous-même.
Emilie.
Mais je vais pourtant toujours de bon cœur à l’étude.
La Mere.
Cela est vrai ! mais dès qu’il faut faire quelque effort, soit de mémoire, soit d’application, vous ne vous en sentez pas la force, & l’humeur vous gagne.
Emilie.
Mais quand je suis parvenue à la vaincre, j’apprens comme un petit ange ensuite.
La Mere.
Et quand vous jouez, & qu’il vous arrive la plus petite contrariété, vous aimez mieux laisser là vos jeux que de la surmonter ; vous êtes pourtant fâchée de ne pas jouer, & l’humeur vous gagne.
Emilie.
Cela est vrai, & cela m’humilie.
La Mere.
Vous avez raison d’en être honteuse ; car l’humeur est un aveu de notre foiblesse, & il est fâcheux & humiliant de s’avouer & de montrer aux autres qu’on est si foible.
Emilie.
Tout le monde voit donc cela ?
La Mere.
Oui, certainement. Rien ne s’apperçoit si vîte que l’humeur. Si vous voulez vous en corriger, il faut commencer par n’être plus paresseuse, & par vous soumettre aux contradictions ; alors vous acquerrez la force de n’avoir plus d’humeur. Sçavez-vous, Emilie, pourquoi vous êtes occupée toute la journée de rubans, de pompons, d’ajustements ?
Emilie.
Pourquoi, Maman ?
La Mere.
C’est que vous êtes paresseuse.
Emilie.
Je ne comprens pas cela.
La Mere.
C’est que vous êtes paresseuse & ignorante, & que pour penser à toutes ces fadaises, votre esprit, votre mémoire n’ont aucun effort à faire. Voilà pourquoi vous les préférez.
Emilie.
Mais, Maman, je parle souvent d’autre chose & j’écoute.
La Mere.
Oui, vous écoutez quand il est question de choses que vous connoissez ; acquérez donc promptement de nouvelles connoissances, si vous voulez vous amuser sans gêne & sans humeurs, des conversations que l’on tient quelquefois devant vous.
Emilie.
Oh ! je vais faire tout mon possible, Maman, je vous assure… Que ferons-nous aujourd’hui, Maman ?
La Mere.
Vous allez vous promener avec votre bonne & votre frere.
Emilie.
Et vous donc, Maman ?
La Mere.
Moi, je vais sortir, j’ai quelques affaires.
Emilie.
Rentrez-vous de bonne heure ?
La Mere.
Le plutôt que je pourrai.
Emilie.
Ah ! tant mieux, Maman ; car nous sommes bien contents, mon frere & moi, quand nous sommes avec vous.
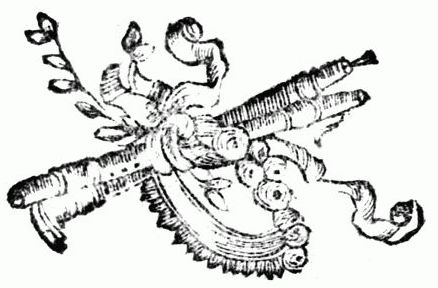

Emilie.
Maman, je viens de me promener aux Thuileries.
La Mere.
Vous y êtes-vous amusée, ma fille ?
Emilie.
Mon Dieu non, Maman, je vous assure.
La Mere.
Pourquoi donc ?
Emilie.
On m’a fait un fort vilain compliment.
La Mere.
Et qui cela ?
Emilie.
Une Dame & un Monsieur qui passoient.
La Mere.
Qu’est-ce donc qu’ils vous ont dit ?
Emilie.
Ils ont dit en passant que j’étois bien noire.
La Mere.
Et cela vous a empêché de vous amuser ?
Emilie.
Mais oui, Maman, j’ai été fâchée.
La Mere.
Cela n’en valoit pas la peine.
Emilie.
Est-ce que ce n’est pas vilain d’être noire ?
La Mere.
Quand on est blanche, c’est un agrément de plus ; quand on est noire, c’est un agrément de moins : voilà tout.
Emilie.
Mais quand on est noire, on est laide.
La Mere.
Et quand on est laide, on est donc bien malheureuse selon vous ?
Emilie.
Est-ce qu’on ne l’est pas ?
La Mere.
Je vous le demande. Vous sçavez bien que vous n’êtes pas jolie jusqu’à présent. Vous trouvez-vous bien à plaindre ?
Emilie.
Non, Maman.
La Mere.
Cela ne vous a jamais empêché de rire, de danser, de vous réjouir.
Emilie.
Oh ! pour cela non.
La Mere.
Eh bien, répondez vous-même à votre question, croyez-vous la beauté nécessaire au bonheur ?
Emilie.
Je vois bien que non. Mais, Maman, je n’étois pas si noire l’année passée, & je n’étois pas si laide.
La Mere.
Cela est vrai. C’est que vous avez été beaucoup au soleil & à la campagne au grand air… Ainsi vous voyez bien que vous seriez très à plaindre si vous faisiez dépendre votre bonheur de la beauté de votre teint.
Emilie.
Pourquoi, Maman ?
La Mere.
Puisqu’il est si aisé à gâter, vous courriez risque à tout moment d’être malheureuse.
Emilie.
Ah ! oui, vraiment. Je ne pourrois ni aller promener, ni rien faire. J’aime mieux être laide & me divertir.
La Mere.
Voilà pourquoi toutes les personnes raisonnables & sensées tâchent de se procurer des avantages moins fragiles, qui établissent le bonheur d’une maniere plus solide, & qui les dédommagent de la beauté qu’elles n’ont pas, ou qui se perd du moins avec les années.
Emilie.
Et comment faut-il faire, Maman ?
La Mere.
Je vous en ai indiqué déja plus d’un moyen.
Emilie.
Maman, ayez la bonté de me le dire encore.
La Mere.
Votre expérience ne vous a-t-elle encore rien appris là-dessus ?
Emilie.
Oui, quand je suis contente de moi d’abord, & puis quand j’ai pu faire plaisir à quelqu’un, oh ! je suis heureuse ! heureuse !
La Mere.
Eh bien, voilà un bonheur dont rien ne peut vous priver, dès que vous êtes assez bien née pour le sentir & pour le goûter. Faire plaisir aux autres, secourir un malheureux qui souffre, le consoler dans ses peines, y prendre part, cacher les fautes des autres, les excuser dans leurs foiblesses, oublier le mal & le méchant, parce que son idée trouble & dégoûte : en un mot, être juste envers les autres & envers vous-même.
Emilie.
Maman, je voudrois apprendre cela par cœur pour ne jamais l’oublier.
La Mere.
Quand vous serez un peu plus grande, Emilie, je vous donnerai un Livre à lire & même à apprendre par cœur, où vous trouverez presque tous ces principes réunis.
Emilie.
Ah, Maman, à présent, je vous en prie, je vous en prie, je vous demande en grace !
La Mere.
Il y a dans ce Livre des choses fort au-dessus de votre portée.
Emilie.
Mais, Maman, seulement un petit endroit à apprendre par cœur, je vous demande en grace, je vous promets que vous serez bien contente de moi. Tenez, je serai sage. Ah, ma bonne Maman !… Ah ! vous souriez ; c’est bon.
La Mere.
Eh bien, je vous en ferai un extrait au premier moment que j’aurai de libre, & je vous le donnerai.
Emilie.
Ah, Maman, que je vous remercie ! Que vous êtes bonne ! Sera-ce bientôt ?
La Mere.
Oui ; mais reprenons notre conversation.
Emilie.
Oui, Maman… Eh bien, tenez, je ne sçais plus moi, où nous en étions.
La Mere.
Tant pis ; car pour être heureuse, il ne faut pas avoir une tête de linotte.
Emilie.
Maman, je voulois vous demander… Qu’est-ce que c’est qu’un extrait ?
La Mere.
C’est de ne prendre d’un ouvrage que ce qui vous interesse en laissant tout le reste. Par exemple, dans celui dont je vous parle, je transcrirai tout ce qui a rapport aux principes que vous desirez graver dans votre tête & dans votre cœur, & je laisserai tout ce qui est étranger. Cela s’appelle extraire un ouvrage, faire un extrait.
Emilie.
J’entens… Eh bien, Maman, qu’est-ce que vous voulez bien me dire encore ?
La Mere.
Nous parlions des différents objets sur lesquels il faut fonder son bonheur.
Emilie.
Ah ! oui, j’ai bien retenu.
La Mere.
Retenez bien aussi qu’un des plus sûrs & des plus indépendants de tout événement, c’est le goût du travail & de l’occupation, parce qu’il nous rend indépendants des autres, comme je vous l’ai déja dit.
Emilie.
Oui ; c’est il y a aujourd’hui huit jours que nous avons dit cela.
La Mere.
L’occupation est une distraction sûre quand on a des peines & des contradictions. C’est une ressource contre l’ennui. La lecture, les talents, l’ouvrage, en un mot toutes les diverses occupations auxquelles peuvent se livrer les personnes de notre sexe, qui, comme vous, reçoivent une bonne éducation, sont une compagnie toujours prête, avec laquelle on ne craint pas de suites fâcheuses, ni de mauvais compliments, comme vous en a fait votre Dame des Thuileries.
Emilie.
Oh ! Maman, laissons cette Dame, je vous en prie, je suis fâchée…
La Mere.
De quoi ?
Emilie.
De m’être fâchée.
La Mere.
Eh bien, vous en tirerez du profit ; & les fautes qui tournent à profit sont moins fâcheuses que d’autres à votre âge. Mais comme vous dites, laissons cette conversation. Comme je suis contente de vous, il faut que je vous lise un Conte de Fée qui a assez de rapport à notre conversation.
Emilie.
Ah, ma chere Maman, que vous êtes bonne ! Est-il vrai ce Conte ?
La Mere.
Autant que peut l’être un Conte de Fée ; la morale n’en est point exagérée, elle est vraie, la fable ne l’est pas. Ecoutez-vous ?
Emilie.
Oui, Maman.
La Mere.
La Princesse Régentine, Souveraine de l’Isle Heureuse, avoit deux filles, qui toutes deux pouvoient se promettre de faire un jour des mariages avantageux. Elles étoient riches & de grande naissance. Régentine jouissoit d’une excellente réputation ; & l’on sçavoit qu’elle n’avoit rien épargné pour l’éducation de ses filles, & qu’elle ne les avoit jamais perdues de vue. Elles avoient toutes deux beaucoup d’esprit. L’aînée étoit belle comme un Ange, ce qui l’avoit fait nommer Céleste. Elle avoit un caractére vif & gai. La cadette, qu’on nommoit Reinette parce qu’elle étoit ronde comme une pomme, étoit laide, & avoit d’ailleurs tout autant d’agrément que sa sœur dans le caractére.
Régentine voyoit beaucoup de monde. Ses filles étoient toujours avec elle. Chacun se récrioit sur la beauté de Céleste ; tout le monde lui adressoit la parole, & personne ne disoit rien à Reinette. Quelquefois on rioit de ses reparties ; on disoit qu’elle avoit de l’esprit, mais que son aînée en avoit autant qu’elle, & que sa figure étoit si séduisante qu’on ne pouvoit pas s’empêcher de s’occuper d’elle de préférence…
Emilie.
Quel âge avoit-elle, Reinette ?
La Mere.
Elle avoit treize ans.
Emilie.
Et l’aînée ?
La Mere.
Elle en avoit près de quinze. Reinette se désoloit d’être ainsi délaissée ; elle en avoit même quelquefois de l’humeur. Sa mere, qui les jugeoit très-bien toutes deux, leur dit un jour : « Mes enfants, il y a long-temps que je vous examine l’une & l’autre en silence. J’étudie votre caractére. Vous êtes sœurs, vous ne devez rien avoir de caché l’une pour l’autre ; votre bonheur réciproque doit vous toucher également. Il ne peut rien arriver à l’une de vous que l’autre n’y prenne part. Malheur, plaisir, bonheur, en un mot l’amitié entre deux sœurs est si intime, que tout doit être commun. Je vais vous faire part de mes remarques ; d’ailleurs il est temps que je vous révéle un secret que je vous ai toujours tenu caché pour ne pas vous affliger. » Céleste & Reinette prierent leur mere de vouloir bien les en instruire. « Vous, ma fille, dit-elle à l’aînée, la nature vous a accordé une figure distinguée, & c’est un des moindres dons que le Ciel pouvoit vous faire. La beauté est souvent plus nuisible qu’utile au bonheur. D’ailleurs c’est un avantage passager ; quand vous aurez atteint l’âge de vingt ou vingt-cinq ans, chaque jour apportera une petite dégradation à votre beauté ; & si vous continuez à fonder sur elle votre bonheur, vous vous trouverez insensiblement fort à plaindre & sans ressource. Vous vous enyvrez journellement des hommages & des complaisances que vos charmes vous attirent. Vous y bornez votre existence. Vous vous accoûtumez peu-à-peu à penser que tout est fait dans le monde pour être soumis à vos volontés. Il arrive de-là que la plus legere contradiction est pour vous un malheur, & que vous trouvez injustes tous ceux qui ne vous admirent pas ; vous ne prévoyez pas, comme je l’ai dit souvent, que c’est dès la grande jeunesse & tout en jouissant de ses belles années, qu’il faut se prémunir contre les événements de la vie, & se préparer des ressources sûres contre l’adversité & les inconvénients d’un âge plus avancé. C’est dès-à-présent qu’il faut établir votre bonheur sur des fondements solides. Je vous ai dès l’enfance donné des principes qui me répondent de votre vertu & de votre honnêteté. Je vous ai donné des maîtres pour vous instruire & multiplier vos connoissances ; vous auriez pu en acquérir beaucoup, car vous avez de l’esprit ; mais vous négligez vos études, vous n’êtes occupée que de votre toilette & de vos ajustements. Vous avez beau faire ; ils ne vous dédommageront pas dans quelques années de votre beauté perdue. »
« L’exemple de votre sœur vous a donné la même tournure, Reinette. Vous vous affligez de n’être point jolie ; vous en avez de l’humeur, & vous passez des heures entieres devant votre miroir, pour voir si, à force de pompons, la beauté n’arrivera pas. Vous avez beau faire, mes enfans, je le répéte, Céleste ne sera pas toujours belle, & vous, Reinette, vous resterez comme vous êtes. Croyez-moi, au lieu de perdre votre temps dans des regrets inutiles, travaillez à vous dédommager de la beauté qui vous manque. Chacune de vous a été douée en naissant de divers avantages. Céleste a reçu la beauté, mais la Fée Prévoyante, qu’on oublia d’inviter à mes couches, n’a jamais voulu depuis se laisser fléchir en sa faveur, & a prononcé qu’elle ne verroit jamais plus loin que le bout de son nez sur tout ce qui concerne les événements de la vie. La Fée Prudente eut pitié de mes alarmes. Je ne puis, me dit-elle, m’opposer aux volontés de Prévoyante, qui est mon ancienne. J’ai vu dans le Livre des Destinées, qu’un sort heureux attend Céleste, mais elle n’en jouira que lorsqu’elle aura perdu sa beauté, & qu’elle aura pu faire naître une passion sans le secours de ses charmes.
« Vous voyez, ma fille, continua-t-elle, en adressant la parole à Céleste, que vous avez un grand intérêt à profiter de mes conseils, & que vous avez grand tort de n’être occupée que de votre beauté, qui sera toujours un obstacle à votre bonheur.
« La faute que j’avois faite en vous mettant au monde, me rendit attentive, lorsque votre sœur naquit. J’envoyai huit jours d’avance inviter Prévoyante & ma bonne amie Prudente ; ma marraine la Fée Lumineuse ne fut point oubliée : la Fée Beauté étoit absente & ne put pas venir ; mais elle m’envoya sa cousine issue de germaine, Laidronette. Elles vous reçurent, Reinette, & vous prirent l’une après l’autre entre leurs bras. Laidronette vous doua d’une physionomie spirituelle & vive. La Fée Lumineuse vous donna l’aptitude à tous les talents, & vous doua de fermeté & de courage. Prévoyante, qui est rancuniere, vous permit seulement d’être réfléchie, mais ne vous accorda la prévoyance que lorsque vos malheurs vous auroient éclairée. Et moi, s’écria promptement la Fée Prudente, je la doue du talent d’être heureuse au milieu de l’adversité. Lumineuse ajoûta, j’y consens, & pour multiplier son bonheur, je la doue d’une ame sensible & bienfaisante. Voilà, Reinette, le sort qui vous attend. Nous pressâmes en vain Prévoyante de s’expliquer sur les malheurs dont vous êtes menacée, elle s’est obstinée au silence. C’est à vous, mes filles, à profiter de ce que je viens de vous révéler ; vous, Céleste, en vous efforçant de plaire par votre caractére & par votre esprit, sans le secours de vos charmes ; vous, Reinette, en acquérant promptement des connoissances & des talents, pour vous en faire des ressources dont il paroît que vous aurez besoin. »
Emilie.
Est-ce que c’est déja tout, Maman ?
La Mere.
Oh ! que non.
Emilie.
Tant mieux, car cela m’amuse bien.
La Mere.
Ce discours fit peu d’impression sur Céleste. Une visite arriva, on la trouva belle comme un Ange ; elle oublia bientôt l’Oracle, & ne pensa qu’au plaisir de plaire & d’entendre louer sa beauté. Reinette fit quelques réflexions, fut touchée des alarmes de sa mere, résolut de s’appliquer davantage au dessein, à la musique, à la lecture ; mais elles étoient l’une & l’autre priées à un bal : l’heure de la toilette arriva, elles y coururent avec le même empressement & le même désouci, que si elles n’avoient rien appris de leur sort à venir.
Céleste trouva dans sa chambre un bel habit de bal de satin bleu & argent, dont chaque falbalas étoit attaché avec un diamant jaune. La Fée Prévoyante l’avoir envoyé, afin de la séduire & de lui faire oublier plus promptement les avis de sa mere. Ce présent produisit tout l’effet qu’elle en attendoit. Céleste ne se possédoit pas de joie. Elle courut montrer à Reinette son bel habit. Celle-cy, qui étoit encore un peu occupée de la conversation qu’elle venoit d’avoir, fut affligée pour sa sœur de l’yvresse où elle la voyoit. Elle alloit lui communiquer ses réflexions lorsque la fenêtre de son appartement s’ouvrit, & elles virent tout-à-coup entrer quatre pigeons, blancs comme la neige. Ils portoient une grande corbeille, qu’ils poserent aux pieds de Reinette ; elle s’ouvrit toute seule : les quatre pigeons déployerent un bel habit de satin couleur de Rose & argent, pareil à celui de Céleste, & relevé par des émeraudes. C’étoit encore un présent de Prévoyante qui prévoyoit tout. Les quatre pigeons, après s’être acquités de leur commission, s’en allerent par le même chemin, & la fenêtre se referma. Reinette fut bientôt aussi éblouie que sa sœur. Régentine, qui vit l’impression que les présents faisoient sur l’esprit de ses filles, fut un moment tentée de les leur ôter, mais la crainte d’attirer encore de plus grands malheurs sur elles, l’arrêta.
Dans cette perplexité, elle se retira dans son boudoir ; elle appella intérieurement Prudente à son secours, qui lui apparut tout-à-coup. « Vous avez raison, lui dit la Fée, d’être inquiette de l’effet que ces présents peuvent produire sur vos filles. Vous n’en connoissez pas encore tout le danger. Ils ont la vertu d’ôter à celles qui les portent la réflexion & la mémoire, & de ne les rendre sensibles qu’au plaisir de s’admirer. Je vous ai déja dit, que je ne pouvois rien changer à la destinée de Céleste, il faut qu’elle subisse son sort. Quant à Reinette, je viens de lui faire trouver sur sa toilette une parure de tête, qui la garantira du fort jetté sur son habit. Toutes les fois qu’elle se trouvera exposée à faire mauvais usage de ses réflexions, (car elle n’en feroit que de fausses) les roses qu’elle aura dans sa tête la piqueront si fort qu’elle en perdra de vue ce qui l’occupoit, & que, lasse de ce supplice, elle quittera d’elle-même sa parure. » Régentine remercia beaucoup la Fée. « Ce n’est pas tout, reprit-elle ; voici un miroir que je vous donne, qui a la vertu de faire voir les objets tels qu’ils sont. Aussi-tôt que vos filles commenceront à être lasses du bal, présentez leur ce miroir, & suivez exactement ce que, dans le premier mouvement de surprise, elles vous prieront de faire. » En finissant ces mots elle disparut.
Régentine plus tranquille, mit son miroir dans sa poche, & revint assister à la toilette de ses filles, qui étoient déja prêtes à partir. Reinette lui montra les roses & les pierreries qu’elle avoit trouvées sur sa toilette & dont elle s’étoit parée, & après maintes & maintes folies que la joie fit dire aux deux sœurs, elles partirent pour le bal.
Elles éblouirent toute l’assemblée. Céleste étoit si belle qu’on ne pouvoit pas soûtenir sa vue. Elle eut comme à l’ordinaire, la préférence sur sa sœur ; mais Reinette étoit si contente de sa parure, si gaie, si yvre, qu’elle ne s’en appercevoit pas, & qu’elle se croyoit aussi belle que Céleste, ce qui revenoit au même.
Le Prince Colibri pensa perdre la tête en voyant danser Céleste. Il forma dès cet instant le projet de la demander en mariage. Céleste reçut avec complaisance tous les hommages de cette brillante assemblée, & elle pensoit en elle-même qu’il n’y avoit pas de bonheur plus grand sur la terre que d’être belle, & d’avoir un habit de satin bleu & argent relevé de topases. La même réflexion venoit à Reinette sur son habit couleur de rose & argent relevé d’émeraudes ; car ces deux habits ayant reçu de la Fée Prévoyante le même pouvoir, la même idée vint en même temps aux deux sœurs. Reinette porta la main à la tête & jetta un cri qui fit retourner tout le monde ; chacun s’empressa de la secourir, mais elle ne pouvoit définir ce qu’elle avoit senti. Tout ce qu’on lui dit d’obligeant excita en elle un mouvement de sotte vanité, qui lui valut une seconde piquure plus forte encore que la premiere. Elle jetta un second cri. Elle dit alors qu’il lui avoit pris subitement une douleur insupportable à la tête, mais qu’elle avoit presque disparu. Elle remercia beaucoup ceux qui s’empressoient autour d’elle, & elle recommença la danse comme si de rien n’étoit. Ce ne fut pas pour long-temps. En passant devant une glace, les deux sœurs se contemplerent avec tant de satisfaction, qu’une troisieme piquure, plus longue & plus forte que les précédentes, faillit à la faire mal. Comme elle pensoit juste, tant que la piquure se faisoit sentir elle n’osa crier, de peur qu’à la fin on ne la prît pour folle. Elle chercha sa mere. Elle l’apperçut dans un coin de la sale. Elle lui vit les larmes aux yeux de la folie & de l’extravagance de ses filles. Son premier mouvement fut d’aller se jetter dans ses bras ; mais la piquure s’affoiblit, & elle cessa de la sentir en donnant la main à un Cavalier qui vint la prier à danser. Enfin le plaisir & la vanité l’enyvrerent tellement, & les piquures devinrent si fréquentes & si continues que l’une n’attendoit pas l’autre.
Ce fut alors qu’elle vint supplier sa mere de quitter promptement le bal. Heureusement pour elle, Céleste fit un faux pas en dansant, qui lui donna le même desir. Alors Régentine tira son miroir de sa poche, & leur dit : « Voyez vous-mêmes si vous n’avez pas perdu quelques pierreries. » Elles se regarderent toutes deux en même-temps. Céleste fit un éclat de rire, & Reinette fut si humiliée qu’elle se cacha de ses deux mains. « Maman, dit-elle, faites chercher par-tout ces vilains pigeons, qu’ils reprennent leur habit, je ne veux plus le voir. Et moi, dit Céleste, je vous prie, Maman, faites-moi peindre comme cela, pour que je ne sois plus tentée de m’habiller de même. J’ai l’air d’une folle. »
Emilie.
Mais qu’est-ce qu’elles avoient donc vu dans le miroir, Maman ?
La Mere.
Vous êtes bien pressée, Emilie, j’allois vous le dire. Eh bien ! dans ce miroir elles étoient si repetissées, elles paroissoient si petites, si petites, qu’un enfant qui vient de naître ne l’est pas davantage. Céleste n’apperçut dans sa tête que des hochets, des poupées, des polichinels & toutes sortes de jouets d’enfants, au lieu des fleurs qu’elle croyoit y avoir, & elle vit dans un coin de la sale la plûpart de ceux qui lui avoient prodigué tant d’éloges, la tourner en ridicule & lever les épaules de pitié en parlant d’elle.
Reinette vit toutes ses roses changées en épines. Son extrême parure lui parut faire un contraste ridicule avec sa figure qui n’étoit pas jolie, & elle entendit qu’on disoit quand elle partit, c’est dommage qu’avec de l’esprit on soit si ignorante & si frivole : Céleste & Reinette ne sçavent que sauter & rire comme des enfants. Régentine, qui a tant de mérite, est bien à plaindre d’avoir de tels hannetons à gouverner.
De retour chez elle, Régentine fit monter à cheval quatre de ses Pages pour chercher par-tout quatre pigeons blancs. Elle donna ordre aussi qu’on lui amenât le meilleur Peintre. En attendant, elle & ses filles se mirent au lit. Mais Céleste fut obligée de coucher toute habillée. Son habit resta collé sur son corps, quelqu’effort qu’on fît pour l’en débarrasser. Celui de Reinette tomba de lui-même dès qu’elle fut dans sa chambre. Il n’y eut que les fleurs qu’on ne put jamais détacher de sa coëffure. Ce qui lui fit faire des rêves couleur de rose.
A l’instant de son réveil, Régentine demanda si ses Pages étoient de retour. On lui dit qu’il y en avoit trois qui avoient parcouru en vain ses Etats, qu’ils n’avoient jamais pu trouver quatre pigeons blancs. Quant au Peintre, il y avoit une heure qu’il attendoit le réveil des Princesses. Régentine fit venir Céleste, & le Peintre commença aussi-tôt son portrait. A mesure que le tableau s’avançoit, l’habit de Céleste se détachoit de lui-même ; & le portrait achevé, elle se trouva vêtue de blanc, d’une toile très fine & sur laquelle se trouvoient peintes toutes sortes de mouches & de papillons.
Tandis qu’on peignoit Céleste, le quatrieme Page arriva tout essoufflé, & tout en nage. Il avoit parcouru, ainsi que ses camarades, tous les Etats de Régentine, & tout aussi inutilement qu’eux. Il s’en revenoit tristement, lorsqu’il apperçut au coin d’un bois une petite vieille qui donnoit à manger à quatre pigeons blancs. Il conduisit au grand galop son cheval vers elle. La vieille, le prenant pour un voleur, remit promptement ses pigeons dans un panier & s’enfonça dans le bois. Le Page y arriva presque en même temps qu’elle ; mais il ne comprit pas comment elle avoit pu faire, car le bois étoit si touffu qu’on ne pouvoit y pénétrer. Il tourna long-temps sans pouvoir trouver l’entrée ; il alloit renoncer à son entreprise lorsqu’il vit auprès de lui une jolie petite fille qui lui présenta un panier de chenevis. « Mon beau Seigneur, lui dit-elle, voulez-vous acheter mon reste ? J’ai là aussi de belles pommes ; croyez-moi, vous ferez bien de les acheter ; & puis vous ferez une bonne action, car j’ai ma mere bien malade, elle m’a donné tout cela à vendre, & je n’ai encore rien vendu d’aujourd’hui. » Le Page prit une de ses pommes, il mouroit de soif ; il la mangea avec avidité & la trouva délicieuse. Il lui vint en esprit, qu’en jettant du chenevis devant le bois, cela attireroit peut-être les pigeons, & enchanté de cette heureuse rencontre, il donna à la petite fille tout ce qu’il avoit d’argent dans sa poche, & elle s’en alla très-contente. Aussi-tôt le Page se mit à semer du chenevis le long des charmilles, & bientôt il entendit le roucoulement des pigeons. Il essaya d’entrer dans le bois ; mais cela lui fut impossible. Il jetta de nouveau du chenevis, & il vit paroître les quatre pigeons. La vieille suivoit le plus vîte qu’il lui étoit possible. Il voulut prendre ces pigeons qui alloient de branches en branches, mais ils lui échapoient toujours. Enfin, voyant que la vieille étoit hors d’haleine : « Remettez-moi vos quatre pigeons, lui dit-il, & je vous donnerai des pommes pour vous rafraîchir. — Ne perdez pas votre temps à en offrir, lui cria-t-elle, jettez-les contre la charmille jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus dans le panier. » Le page obéit à la vieille, & s’en trouva bien ; car la charmille prit feu & s’enflamma à mesure qu’il jettoit les pommes. La vieille rappella ses pigeons, qui vinrent se percher sur sa tête & sur ses épaules, & tout le bois fut consumé sans qu’il lui en coûtât un cheveu, ni une plume à ses pigeons. Le Page comprit alors qu’il avoit à faire à une Fée, & se prosterna devant elle. « Vous êtes courageux & constant, mon beau jeune homme, lui dit-elle, & vous en recevrez la récompense. Ramassez votre chenevis & mettez-le dans vos poches pour nourrir mes pigeons, & marchons ; car la Princesse Régentine nous attend avec impatience. » Il obéit sans hésiter, tant il étoit rempli de vénération pour elle.
Lorsque la vieille fut seule avec la Princesse, elle se fit connoître pour la Fée Prudente. « Aussi-tôt que je vous eus quittée hier, lui dit-elle, je courus m’emparer des pigeons de Prévoyante ; car ce ne sont qu’eux qui puissent débarrasser Reinette de son habit. Je m’étois auparavant munie de la permission de notre Souveraine, qui me donna une de ses filles d’honneur pour me secourir des piéges que me tendroit Prévoyante. En effet, dès que votre Page parut, je vis en même temps un faucon prêt à fondre sur les pigeons. Je connus qu’il étoit envoyé par mon ancienne, & je me retirai dans le bois. Aussi-tôt il s’éleva une charmille impénétrable. La fille d’honneur de la Souveraine vint à mon secours, en donnant au Page les moyens d’abbatre le bois enchanté, & me voilà ! Ne perdons point de temps, remettons l’habit dans la corbeille ! Dès que les pigeons seront envolés, Reinette sera débarrassée de sa coëffure qui étoit un préservatif contre le pouvoir de Prévoyante. »
Elles passerent ensemble dans l’appartement des jeunes Princesses. Elles trouverent le portrait achevé : mais Céleste n’en fut pas contente ; car il la représentoit telle qu’elle devoit être, quand elle auroit perdu sa beauté. Reinette faisoit de profondes réflexions sur tout ce qui lui étoit arrivé, & le Page jettoit du chenevis aux pigeons comme la vieille le lui avoit recommandé. Elle donna un coup de son bâton sur les deux habits, qui tomberent en poussiere & s’évaporerent en fumée. Alors elle congédia les pigeons dont elle n’avoit plus que faire. Ils partirent en jettant de longs sifflements & se transformerent en hiboux. La vieille dit au Page qu’il pouvoit faire l’usage qu’il voudroit de ce qui lui restoit de chenevis. Il mettoit déja la main dans sa poche pour le jetter par la fenêtre : mais il la retira pleine de diamants & de pierres précieuses de toutes couleurs. « C’est, lui dit la Fée, la récompense de votre bienfaisance & de votre zéle à exécuter les ordres de Régentine. Vous avez offert de partager vos pommes avec moi, tandis que vous mouriez de faim & de soif. Je vous donne de quoi faire la fortune de plus d’un cadet comme vous. — Grand merci, Madame la Fée, lui répondit le Page, je m’en vais porter cela à ma mere. »
« Souvenez-vous, Céleste, continua Prudente, de regarder ce tableau toutes les fois que vous voudrez vous en faire accroire. Et vous, Reinette, vous avez eu tout le temps de faire des réflexions sur votre oreiller, vous pouvez détacher vos roses & vos pierreries. — Ah ! ma marraine, s’écria Reinette, de grace, laissez-moi au moins une des roses pour m’avertir toutes les fois que je serai tentée d’oublier vos leçons. — Je ne le peux, mon enfant, répondit la Fée ; mais quand vous vous trouverez dans l’embarras, je vous en tirerai, si vous n’oubliez pas de m’appeller ; car je n’ai le pouvoir de secourir que ceux qui m’appellent avant de prendre un parti. » Reinette en donna sa parole, la Fée partit, & on lui souhaita un bon voyage.
Cependant le Prince Colibri…
Emilie.
Mais pourquoi s’appelloit-il Colibri, Maman ? Voilà un drolle de nom !
La Mere.
C’est que par le pouvoir d’une méchante Fée, il avoit été transformé pendant plusieurs années en un oiseau qui porte ce nom. Le Prince Colibri avoit été si frapé de la beauté de Céleste, qu’il retourna promptement chez le Prince Tout-Rond, son pere, pour obtenir la permission de la demander en mariage. On prépara une belle ambassade. Le Prince Tout-Rond n’aimoit cependant pas trop les cérémonies ; mais il sentit que dans cette occasion on ne pouvoit s’en dispenser, & il fit les choses de bonne grace. Son pays étoit limitrophe de celui de Régentine, & rien ne convenoit mieux aux intérêts des deux Cours que cette alliance. Aussi la demande fut-elle agréée, les préparatifs de la noce se firent promptement & avec la plus grande magnificence. Le pere de Colibri céda à son fils la souveraineté, & se réserva une seule Terre, où il se retira. Le mariage fut célébré, & Céleste partit avec le Prince son époux pour se rendre dans ses Etats, où elle fut reçue en Souveraine.
Reinette comprit à merveille qu’elle ne seroit pas si aisée à marier que sa sœur. Elle pensa donc sérieusement à se consoler de n’être pas jolie, & à se procurer d’autres avantages. Elle prit du goût pour l’occupation & l’étude. Elle avoit toujours appris avec assez de facilité, mais elle n’approfondissoit rien ; elle choisit la musique comme un genre d’étude qui lui parut préférable, & elle tenta de s’y perfectionner. De-là elle se fit un plan de lectures, les unes instructives, les autres amusantes, & insensiblement elle acquit un très-grand nombre de connoissances. Elle en retira plus d’un avantage, car indépendamment de son amusement journalier, l’instruction donna un nouvel agrément à son esprit, & bientôt elle fut plus recherchée & plus fêtée que ne l’avoit été sa sœur avec toute sa beauté.
Le fils cadet du Prince des Trois-Étoiles, qui étoit sans apanage, n’ayant rien à faire dans les Etats de son pere, voyageoit pour son plaisir. On l’appelloit Pacifique, parce qu’il terminoit tous les différends & toutes les querelles qui survenoient dans sa famille. Il vint à la Cour de Régentine pour y passer trois semaines, mais il fut si enchanté de la réception qu’on lui fit, qu’il y resta trois ans. Le Prince Colibri lui donna des fêtes. Céleste & lui saisissoient toutes les occasions de montrer leur magnificence, & ils étoient si accoûtumés à ce genre d’amusement que, quand on étoit par hazard cinq ou six jours sans inventer un nouveau spectacle, ils s’ennuyoient, ils baailloient, & finissoient par prendre de l’humeur & par gronder tout le monde. Comme on se lasse de tout, quand on en abuse, Céleste & Colibri ne trouverent bientôt plus rien de saillant dans les plaisirs qu’on leur offroit. L’Intendant des menus plaisirs du Prince fut menacé d’être chassé, s’il ne faisoit pas mieux. Il écrivit dans tous les pays, pour requérir les idées de toutes les gens célébres. On lui envoya des plans, des ouvrages & des sujets pour les exécuter. Le Prince & la Princesse trouverent tout cela très-beau, mais la fête n’étoit pas finie qu’ils baailloient comme auparavant. Enfin on eut recours aux Fées. Quelques-unes prétendirent que si Céleste & Colibri s’ennuyoient, c’étoit la faute de la vie oisive & désœuvrée qu’ils menoient. D’autres plus indulgentes se prêterent à les secourir & se firent fort de les faire mourir de rire ; mais le rire est un bien-être momentané, & ne rend pas heureux. Le Prince & la Princesse l’éprouverent. La Fée Fanfreluche, dont tous les revenus consistoient dans les contributions qu’elle tiroit des Marchandes de Modes & des Fabricants d’Etoffes, fit présent à Céleste de deux mois de son revenu pour effiloquer. Ce présent enchanta Céleste ; elle effiloqua du matin au soir pendant quelques jours ; mais cette occupation lui donna bientôt des vapeurs. Alors Fanfreluche ordonna un spectacle d’un nouveau genre. On l’établit dans une prairie en face du château, de sorte que Céleste pouvoit en jouir sans quitter sa chaise longue ; elle n’avoit que la peine de tourner la tête, ce qui lui coûtoit beaucoup, car à force de ne rien faire, elle étoit devenue extrêmement paresseuse. Cette fête devoit se passer la nuit. Par le pouvoir de la Fée la prairie fut tout-à-coup environnée d’une colonnade d’albâtre avec des feuillages en or & en pierreries, montant autour des pilastres ; il y avoit des amphithéatres dans toutes les travées où les Dames & les Seigneurs de la Cour étoient placés. Le peuple étoit derriere, & voyoit par le moyen de grandes & grosses lunettes où dix personnes pouvoient regarder à la fois pour la commodité du public. La Fée fit distribuer de belles tabatieres aux Dames & aux Seigneurs ; ensuite elle donna un signal, toutes les tabatieres s’ouvrirent à la fois, & il sortit de chacune une jolie petite paire de doigts bien potelés, qui saisissant chaque spectateur par le nez, les forçoit à lever la tête tous en même temps, & ils virent dans les airs le plus beau feu d’artifice dont on eût jamais ouï parler. Les doigts enchantés dirigeoient leur attention avec une dextérité surprenante, en leur faisant tourner le nez à propos. La Princesse & le Prince firent de grands éclats de rire, en voyant tous ces nez en l’air. Mais bientôt un spectacle plus flateur s’offrit à leurs yeux. Tous les spectateurs prirent subitement la figure de Céleste & de Colibri, & ils eurent la satisfaction de se voir par-tout où ils jettoient leurs regards, dans différents âges & dans toutes sortes d’attitudes. Céleste & Colibri penserent mourir de plaisir ; mais bientôt ils sentirent l’ennui d’eux-mêmes qui les gagnoit, & ils prierent instamment Fanfreluche de faire cesser le charme. Tout disparut, dès qu’ils eurent formé le desir. Il n’y eut que les doigts enchantés qui vinrent se ranger auprès de la Fée pour recevoir ses ordres. Elle les mit tous dans un mortier, les fit piler, & bientôt il en sortit un beau jeune homme que le Prince & la Princesse trouverent si aimable, qu’ils en firent leur favori, & ensuite leur premier Ministre. Les affaires en allerent beaucoup mieux, mais leur ennui accroissoit tous les jours davantage, leur santé se dérangea, & bientôt ils se trouverent excessivement malheureux.
Tandis que Céleste & Colibri faisoient de vains efforts pour trouver le bonheur hors d’eux-mêmes, le Prince Pacifique devint tous les jours plus épris du mérite de Reinette, & regrettoit d’être un cadet sans apanage & de n’avoir pas un thrône à lui offrir. « Que je serois heureux, disoit-il, d’avoir une femme si douce, si modeste, si raisonnable ! Elle est remplie de talents, & il ne lui échape jamais un mot qui puisse la faire soupçonner d’en avoir, & qui puisse humilier celles qui ne sont pas si habiles qu’elle. La pudeur & la décence, qui sont la plus belle parure des femmes, se remarquent dans toutes ses actions. Elle n’a de volonté que celle de sa mere ; elle n’aura de volonté que celle de son mari. Elle sçait s’occuper, elle trouve ses ressources en elle-même ; elle sera œconome. Elle est sensible, elle sera bienfaisante & généreuse. Ah, que n’ai-je un thrône à lui offrir ! » C’étoit là son refrain.
De son côté, Reinette n’étoit point insensible au mérite du Prince Pacifique, & regrettoit comme lui qu’il ne fût pas un parti sortable pour elle. Régentine s’apperçut de leur vœu mutuel, & en parla à sa fille. Reinette, qui n’avoit rien de caché pour sa mere, lui confia l’inclination qu’elle avoit prise pour le Prince. Régentine trouva un moyen de tout arranger ; c’étoit de donner à Pacifique sa fille & ses Etats, & de ne se conserver que la régence. Elle n’en eut pas plutôt formé le projet, qu’il fut exécuté. On envoya des Ambassadeurs au Prince des Trois-Etoiles, son pere, qui se hâta de donner son consentement ; & le jour de la noce suivit de près le retour des Ambassadeurs. Comme le Prince Pacifique & Reinette n’avoient pas un goût décidé pour les fêtes, on n’en donna pas d’extraordinaires, on se contenta de tenir grand appartement à la Cour de Régentine & de donner un bal paré. Ce bal rappella à la Princesse Reinette celui où elle avoit été deux ans auparavant. Ce souvenir la fit penser à la Fée Prudente, à qui elle avoit tant d’obligations. Elle rougit en réfléchissant qu’elle avoit négligé de la consulter sur son mariage, & courut à sa mere pour lui faire part de cette réflexion. Régentine la rassura du mieux qu’elle put, & se reprocha néanmoins intérieurement la précipitation avec laquelle elle avoit conclu le mariage de sa fille sans l’avis de ses protectrices. Elle eut beau se dire que sa tendresse pour Reinette & l’envie de lui faire promptement un sort heureux ne lui en avoient pas donné le loisir, elle ne pouvoit se dissimuler son tort. Elle quitta l’assemblée, & appella Prudente à haute voix. Prudente ne répondit pas. Enfin, à force de lui demander grace, elle parut. « Je ne peux plus rien pour vous, lui dit-elle ; vous avez négligé de m’appeller vous & votre fille, dans l’occasion la plus importante de sa vie ; il faut qu’elle en subisse la peine ; il faut que son expérience lui apprenne de quelle importance il est de ne rien faire sans moi. Et vous, Princesse, pour vous punir de n’avoir pas dirigé votre tendresse & vos démarches par mes avis, vous ne vous reveillerez que quand vos filles seront changées. » En disant ces mots, Prudente frapa Régentine de sa baguette, & elle s’endormit profondément.
Cependant Reinette inquiéte de ne point voir revenir sa mere, la fit chercher par-tout. On la trouva endormie dans son boudoir. On crut d’abord qu’elle s’étoit trouvée mal, mais on ne tarda pas à s’appercevoir qu’elle étoit enchantée. Alors tout le palais retentit des cris de Reinette. Chacun parla diversement de cet événement ; chacun en tira parti pour mettre à profit le moment où personne ne tenoit encore les rênes du gouvernement, & le Prince Pacifique travailla à se faire reconnoître Régent comme héritier de la souveraineté, en attendant qu’il plût aux Fées de réveiller sa belle-mere. « Doucement, lui dit sa femme, il faut appeller Prudente & Lumineuse à notre secours ; Prévoyante doit être aussi consultée pour sçavoir comment nous devons nous y prendre. — Je n’ai que faire de cette bande de Sorcieres, répondit Pacifique ; chez mon pere des Trois-Étoiles je me gouvernois tout seul ; je crois que vous me prenez pour mon beau-frere Colibri ? Je m’en vais assembler le conseil, & tout ira bien. — Vous ne sçavez pas, lui répondit affectueusement Reinette, à quoi vous vous exposez, cher Prince. » Alors elle lui révéla tous les secrets de famille & le sort dont elle étoit menacée. « Eh bien, lui répondit-il, assemblez-les, consultez-les, divertissez-vous bien. Si leur avis est bon, je le suivrai, car j’aime la paix ; s’il ne vaut rien, je suis votre serviteur, & je vais au Conseil. »
Reinette invita promptement Lumineuse, Prévoyante & Prudente. Elles arriverent. « Vous avez bien fait de nous appeller, lui dit tout bas la Fée Prudente. Quant à moi, mon avis vous est interdit ; mais ma présence vous garantira d’une partie des piéges que pourroient vous tendre mes anciennes. » Reinette leur exposa la situation où le Prince son époux & elle se trouvoient. Lumineuse aussi-tôt donna vingt projets, que Prévoyante détruisoit à mesure que sa compagne les exposoit. Reinette expliqua humblement ceux de son mari. Prévoyante se mit à sourire, & lui fit une longue énumération de tout ce qu’il ne falloit pas qu’il fît. Le Prince arriva, les écouta, se tenoit les côtes de rire, & partit pour ne suivre que son avis. Les trois Fées se retirerent en lui souhaitant bien du succès.
Pendant l’espace d’une année tout alloit assez bien ; mais un jour, en entrant dans l’appartement de Régentine, on la trouva disparue. Peu de jours avant, Reinette avoit mis au monde un Prince & une Princesse. Elle n’étoit pas encore éveillée, le Prince défendit qu’on lui annonçât cette nouvelle avant qu’on eût fait toutes les recherches possibles. Elles furent vaines. On ne put sçavoir ce que Régentine étoit devenue. Enfin il fallut bien en instruire ses filles. Elles furent dans un desespoir si violent qu’elles penserent en perdre la vie. Cet événement redoubla la mélancolie dans laquelle Céleste étoit depuis long-temps tombée. Colibri faisoit ce qu’il pouvoit pour la distraire, & n’y put réussir. « Vous êtes une singuliere femme, lui disoit-il quelquefois ; vous avez tout à souhait ; vous n’avez pas une fantaisie qui ne soit sur le champ satisfaite ; vous ne formez pas un desir, qui ne devienne une réalité ; je n’ai d’yeux que pour vous ; je fais vos volontés du matin au soir, & vous ne vous trouvez pas heureuse. Que vous faut-il donc ? — Je n’en sçais rien, répondit-elle ; mais je m’ennuie. »
Reinette fut aussi vivement touchée que Céleste de la perte de sa mere ; mais son caractére n’étant pas le même, la douleur produisit sur elle des effets différents. « Je suis mere aussi, se disoit-elle ; il faut que je me conserve pour élever mes enfants : mon mari est à la tête des Etats de ma mere ; il est surchargé d’affaires ; sans vouloir m’en mêler au-delà de ce qu’il jugera à propos, voyons si je ne peux pas lui être utile. Par exemple, visitons la veuve & l’orphelin, voyons si le pauvre dans sa chaumiere n’est point abandonné ! J’ai des peines, consolons ceux qui en ont plus que moi. Le soir, je rentrerai le cœur plein de joie du bien que j’aurai répandu autour de moi, & je me trouverai heureuse. Alors le Prince mon époux verra mon visage toujours serein & gai ; j’emploierai mes talents à le délasser des affaires, & il me verra chaque jour avec un nouveau plaisir. Je vois bien que je ne dois plus compter sur la protection des Fées. Rendons-nous heureuses par nous-mêmes & sans le secours des autres. »
Reinette mit à profit ses réflexions. Elle suivit son plan exactement. Elle eut bientôt sujet de s’en applaudir.
Le Prince Songecreux, dont les Etats n’étoient séparés de ceux de Régentine que par une petite riviere qui en bornoit les limites, trouva un jour en feuilletant dans ses archives, que son arriere-bisaïeul avoit été possesseur de l’apanage dont jouissoit Reinette. Il trouvoit bien la cession qui en avoit été faite en bonne forme ; mais il prétendoit qu’elle ne donnoit pas le droit à Régentine d’en disposer en faveur d’un gendre, & qu’il devoit lui revenir après elle, faute d’enfants mâles. Il dépêcha un Ambassadeur à Pacifique pour lui signifier ses prétentions. Pacifique ne laissa pas que d’en être alarmé. Il examina tous les titres de Régentine, & trouva qu’en effet elle avoit disposé en sa faveur un peu legerement de son héritage. Reinette lui représenta cependant que comme régent & comme gendre, il ne pouvoit se dispenser de défendre les droits de sa mere, & qu’il falloit promptement mettre tout le pays sous les armes & garnir les frontieres. L’avis du Conseil fut au contraire d’éluder la question, & de répondre qu’il seroit temps de l’examiner quand l’héritage seroit vacant. Régentine existoit ; elle pouvoit revenir d’un moment à l’autre ; enfin, ce n’étoit pas le moment d’écouter de telles prétentions, ni de les disputer. Cet avis pouvoit être le plus prudent, il plaisoit même assez à Pacifique ; mais la vanité de Reinette fut blessée qu’on osât mettre en question le pouvoir & les droits de sa mere. Les Ambassadeurs furent renvoyés & la guerre défensive résolue.
Emilie.
Sera-t-elle bientôt finie la guerre, Maman ; je ne l’aime pas, car je n’y entens rien.
La Mere.
Je m’en doute, aussi je veux vous en épargner les détails.
Emilie.
Mais Maman, pourquoi Reinette ne consulta-t-elle pas Prudente avant de faire la guerre ?
La Mere.
Vous avez raison ; elle auroit d’autant mieux fait, qu’il n’est pas sage de prendre un parti dans le premier mouvement du ressentiment. Enfin, elle négligea cette sage précaution, & tout fut en armes. Songecreux arriva en personne pour attaquer Pacifique dans ses Etats ; & comme vous n’aimez pas les détails, vous sçaurez seulement, qu’après s’être bien défendu, toujours battu & poussé de poste en poste, Pacifique fut fait prisonnier & ses troupes dispersées. Songecreux resta vainqueur, s’empara des Etats de Régentine par droit de conquête, & Reinette fut obligée de fuir chez sa sœur avec ses deux enfants, sans biens & sans moyen de racheter son mari. Sa désolation dans le premier instant fut extrême. Elle se repentit d’avoir déterminé son mari à faire la guerre ; mais il étoit trop tard ; elle sentit que de vains regrets ne remédient à rien. Elle avoit emporté avec elle toutes ses pierreries & ses diamants. Elle les vendit pour payer la rançon de son mari. Colibri & Céleste reçurent Pacifique, & lui offrirent, ainsi qu’ils avoient fait à Reinette, tout ce qui étoit en leur pouvoir. Pacifique reçut leurs offres avec reconnoissance, mais le malheur de se trouver à son âge frustré de belles espérances lui donna un profond chagrin. Sans état, sans revenu, chargé d’une femme & de deux enfants, cette situation l’affecta si vivement, qu’elle changea tout-à-fait son caractére. Il étoit sombre, inégal, inquiet, tout l’impatientoit & lui donnoit de l’humeur ; il grondoit sa femme, ses enfants : enfin, il devint insupportable. Reinette, peu accoûtumée aux mauvais traitements & bisarreries, gémissoit en secret d’un changement si funeste ; mais comme elle avoit un grand courage, elle n’opposa à ces mauvais traitements qu’une patience inaltérable, de la douceur & de la fermeté. Voyant combien elle étoit nécessaire à son mari & à ses enfants, elle fit taire jusqu’à sa douleur secrette, & pour y parvenir elle mit en usage toutes ses ressources ; elle passoit sans cesse d’une occupation à une autre ; elle n’étoit jamais un instant à rien faire, & elle parvint à se faire une maniere d’être agréable. Sa santé à la fin s’altéra, sans que son courage en fût ébranlé. On la voyoit toujours avec un visage serein & gai, & souvent elle parvenoit à tirer Pacifique de sa mélancolie.
« Qu’est-ce donc que les hommes, s’écrioit Colibri ! Ma femme possede tout ce que l’on imagine de plus nécessaire au bonheur ; elle meurt d’ennui & de chagrin ; elle est maussade & insipide. Ma belle-sœur est accablée de tous les revers possibles ; elle est gaie & heureuse, & sa conversation enchante ; on ne la quitte qu’à regret. J’ai épousé la plus belle femme de la terre ; sa figure se perd tous les jours par sa faute. Reinette étoit laide ; sa santé est foible & se détruit, & plus elle prend d’années, plus sa physionomie devient interessante. Ah ! je n’y comprens plus rien. »
Ces réflexions que faisoit Colibri, Céleste un beau matin les fit aussi. Elle comprit par l’exemple de sa sœur que son desœuvrement & l’yvresse où elle avoit été de sa belle figure, étoient la premiere cause de sa tristesse. Elle s’avoua que depuis qu’on ne lui disoit plus qu’elle étoit belle, on n’avoit plus rien à lui dire. Il lui vint dans l’esprit qu’apparemment il valoit mieux être aimable que d’être belle ; & elle forma la résolution de se retirer de l’apathie où elle vivoit depuis si long-temps. Elle demanda des Livres à sa sœur, & lui communiqua son projet. Reinette en fut enchantée & voulut l’aider dans sa reforme. Un événement qui fut le premier malheur réel que Céleste eût essuyé, acheva de la faire rentrer en elle-même ; car jusques-là elle avoit un peu confondu les contrariétés indispensables dans la vie, avec les malheurs. Le Prince Colibri fut tué à la chasse, d’un coup de fusil. Céleste fut au desespoir de la mort de son mari. Ce malheur touchoit de très-près Reinette & Pacifique, & par plus d’une raison. Quel alloit être leur asyle ? Céleste n’avoit point d’enfants & le pere de Colibri rentroit dans tous les droits dont il s’étoit dépouillé volontairement en mariant son fils. Reinette instruite par l’expérience & par le malheur, ne manqua pas cette fois d’appeller la Fée Prudente à son secours. Elle arriva. « Je suis contente, lui dit-elle, de la maniere dont vous vous êtes tirée de vos épreuves, & dont vous avez réparé vos fautes. Vos malheurs finiront bientôt. Il ne faut plus que perfectionner votre ouvrage, en rendant à votre sœur le service de la soûtenir dans le découragement qui s’emparera d’elle plus d’une fois avant d’embrasser une vie aussi utile & aussi occupée que la vôtre. — Et ma mere, s’écria Reinette ? Madame par pitié, donnez-m’en des nouvelles ; je ne cesse de la pleurer. — Votre mere existe, & vous la reverrez bientôt, répondit la Fée. — Et ses Etats… continua tristement Reinette ; elle les a perdus par ma faute ! — Ne veuillez point pénétrer dans l’avenir, reprit Prudente ; soyez plus circonspecte & espérez la récompense de votre mérite. — Et bien, je me tais, dit Reinette ; mais que devons-nous faire ma sœur & moi ? Quelle conduite devons-nous tenir ? — La plus simple est toujours la meilleure, répondit la Fée ; notifiez la mort du Prince à son pere, & attendez. Mais vous devez bannir toute crainte, je serai désormais toujours à vos côtés, & vous n’agirez plus qu’inspirée par moi. Je vous quitte pour vaquer à d’autres affaires ; mais je ne vous perdrai point de vue. Voici trois présents que je vous fais, servez-vous-en à propos. Quand vous vous trouverez embarrassée, vous casserez cette noisette, & vous suivrez la premiere pensée qui vous viendra dès qu’elle sera ouverte ; ensuite vous en remettrez les morceaux dans votre poche, ils se reprendront tout seuls, & à chaque nouvel embarras, vous la casserez de nouveau. Voici un flacon qui renferme une liqueur qui a la vertu de rendre la beauté, vous en ferez l’usage qu’il vous plaira. Ce Livre-cy est le plus précieux de mes dons, dit-elle, en tirant de sa poche un petit Livre bleu dont les feuillets étoient blancs. Vous êtes jeune encore, & il vous reste bien des choses à connoître. Ecrivez-y chaque jour vos réflexions, sur tout ce qui vous sera arrivé & sur ce que vous avez à faire le lendemain, mettez-le sous votre oreiller, en vous éveillant vous y trouverez mes réponses. Adieu, profitez & ne vous découragez pas. »
Reinette remercia beaucoup la Fée, mit ses présents dans sa poche, & courut chez sa sœur pour lui faire part des conseils de Prudente. Au moment d’entrer dans son appartement, elle pensa qu’elle n’avoit point demandé, si elle pouvoit lui parler de sa mere & des présents que la Fée lui avoit faits ; elle se trouva fort embarrassée, & elle cassa sa noisette. Elle y trouva un billet où il étoit écrit : De votre mere seulement. « C’est bon, dit-elle en elle-même ; ce sera un moyen pour hâter le changement de ma sœur. » Elle remit les morceaux de sa noisette dans sa poche. Elle lui annonça en effet que sa mere se réveilleroit aussi-tôt qu’elle se seroit corrigée des petits défauts contractés dans l’opulence & dans l’oisiveté, & elle parvint en même temps à calmer sa grande douleur, en lui montrant toujours le retour de sa mere attaché aux efforts qu’elle feroit sur elle-même.
On se hâta de faire part de la mort de Colibri à son pere. Ce bon vieillard s’étoit retiré dans une petite Terre, où il vivoit paisiblement avec quelques Gentilshommes de son voisinage. Il reçut cette nouvelle avec les démonstrations de la plus vive douleur. Celui qui avoit été chargé de la lui annoncer, lui dit, que Céleste attendoit ses ordres. Il rêva un moment, ensuite il dit : « Mon bien est bien à moi, j’en peux faire ce que je veux ; dites à Céleste, au Prince Pacifique & à Reinette de venir me voir, je leur ferai connoître mes intentions. » Plusieurs jours se passerent pendant lesquels Céleste, aidée des conseils de sa sœur, fit des progrès rapides ; mais la perte qu’elle avoit faite se représentoit toujours à elle avec amertume, & sa douleur détruisoit sensiblement sa figure. La premiere idée de Reinette fut de lui donner son flacon, mais se rappellant que sa beauté avoit été cause des défauts qui l’avoient rendue si malheureuse, elle remit à un autre temps à en faire usage.
Elles se préparerent avec le Prince Pacifique à aller rendre visite au Prince Tout-Rond. En arrivant chez lui, on leur dit que l’on doutoit qu’il pût les recevoir, parce que n’ayant pas de portrait du défunt, il étoit occupé à écrire dans le pays de Colibri, pour qu’on lui en envoyât un qui ressemblât à son fils quand il étoit sous cette forme, & il avoit défendu qu’on l’interrompît tant qu’il écriroit. Reinette demanda s’il étoit long-temps ordinairement dans son cabinet, on répondit qu’il n’étoit guere plus de vingt-quatre heures à écrire une Lettre. Pacifique, à qui cette visite repugnoit beaucoup, fut d’avis de s’en aller. Céleste & Reinette lui représenterent que le bon-homme pourroit en être blessé. Pacifique insista. Reinette passa dans un cabinet pour consulter sa noisette. Elle la cassa ; il en sortit un charmant Colibri. Reinette aussi-tôt rentra, & pria un Valet de chambre de présenter cet oiseau de sa part à son maître. Il n’hésita pas de lui obéir, bien sûr du plaisir qu’il alloit lui faire. Céleste & Pacifique ne comprenoient pas où Reinette avoit pris ce Colibri. Elle leur dit que c’étoit un présent que venoit de lui faire la Fée Prudente.
Le Prince & les deux Princesses furent bientôt admis en la présence du beau-pere de Céleste. Il combla Reinette de remerciments. « Vous m’avez rendu un grand service, lui dit-il, car je ne suis pas grand écrivain ; ce n’est pas que je n’aye écrit comme un autre ; mais, ma foi, il y a temps pour tout. » Après cette belle harangue, il embrassa sa belle-fille, & se mit en frais pour la consoler ; puis il passa avec Pacifique dans son cabinet : ils furent environ une heure ensemble pendant laquelle Céleste & Reinette ne laisserent pas que d’être fort en peine du motif de cette conversation. Enfin, elle finit. Ils revinrent. « J’ai voulu sçavoir, dit le bon-homme, ce que le Prince Pacifique avoit dans l’ame ; je suis content de lui, & comme je n’ai plus d’enfant, je l’adopte, & je le fais mon héritier. Dès aujourd’hui il peut entrer en jouissance de mes Etats ; je lui remets tous mes droits, tels que je les avois cédés à mon fils ; je ne me réserve que mon petit canton de terre. Mais j’y mets cependant la condition qu’il fera un sort convenable à la veuve du Prince Colibri, dit-il à Céleste. — Fixez-le vous-même, Madame, je m’en rapporte à vous, répondit Pacifique ; je n’ai aucun droit au bienfait que je reçois ; je serai trop content de ce qui me restera. — Prince, répondit Céleste, ce sera ma sœur qui me guidera sur la demande que j’aurai à vous faire… » Elle alloit continuer, mais un grand bruit qu’on entendit tout-à-coup l’interrompit. Une musique céleste se fit entendre, & l’on vit descendre du ciel un palais de crystal avec des portes de rubis & d’émeraudes. « Quel diable de train est-ce là, s’écria le Prince Tout-Rond ? Est-ce encore quelque Fée qui vient faire des siennes, elles ne me laisseront jamais en repos ? Mesdames, c’est à vous sans doute à qui elles en veulent, je vais m’enfermer dans mon cabinet avec mon charmant Colibri, & quand elles seront parties, vous n’avez qu’à me faire appeller ; il y a long-temps que je ne me mêle plus des affaires des Grands. — Je vous demande la permission de vous suivre, Prince, lui dit Pacifique, je ne suis guere plus curieux que vous de la conversation de ces Magiciennes. — A la bonne heure, reprit le vieillard, mais partons. »
Dès qu’ils furent sortis du salon, le palais, qui s’étoit placé dans la cour, s’ouvrit ; & les trois Fées, Lumineuse, Prévoyante & Prudente en sortirent. « Où sont les Princes, demanderent-elles ? » Les Princesses n’osoient répondre. « Point tant de façons », dit Prévoyante en frapant de sa baguette le cabinet où ils s’étoient retirés. La porte s’ouvrit. « Nous venons, dit la Fée, vous donner un bon avis, Prince. Nous approuvons fort le don que vous faites de vos Etats au Prince Pacifique, dit-elle au beau-pere de Céleste ; mais gardez-vous de le publier ; les succès de Songecreux pourroient l’engager à s’emparer aussi de vos Etats, s’il vous voyoit y renoncer. Il faut tenir vos dispositions secrettes. Il faut retourner prendre la place de votre fils. Pacifique gouvernera en effet ; mais il gouvernera en votre nom jusqu’à ce que vous n’ayez plus rien à redouter de Songecreux. — L’avis est bon, dit le vieillard, je n’en disconviens pas ; mais quand n’aurons-nous plus rien à redouter de Songecreux ? — Quand il plaira à Céleste, dit la Fée Lumineuse, voilà tout ce qu’il nous est permis de vous annoncer. — Moi, s’écria-t-elle, & comment cela dépend-il de moi ? — Oh qu’oui reprit Tout-Rond, attendez-vous qu’elles répondent à cela ? Allons, allons, il faut prendre son parti, & faire comme elles l’entendent. Mais, Mesdames, entre vous trois, ne pourriez-vous pas me rendre un service ?… — Il est rendu, se hâta de répondre la Fée Lumineuse, qui avoit pénétré la demande qu’il vouloit leur faire. — Oh parbleu ! Je vous défie, Madame Lumineuse, avec tout votre esprit, de deviner ce que je voulois dire. — Vous vouliez, lui dit-elle, nous demander de faire parler Colibri ; il répondra désormais à toutes les questions que vous lui ferez, toutes les fois que vous le tiendrez sur le doigt, & que vous le regarderez fixement ; mais il ne sera entendu que de vous, & il ne parlera jamais que vous ne l’interrogiez. — Bravo, répondit le bon-homme, c’est encore mieux que je ne demandois. Vivent les Fées ! C’est un plaisir d’avoir à faire à elles. Mais voyons cependant si vous ne m’attrapez pas. » Il prit le petit Colibri sur son doigt, & lui demanda quelque chose à l’oreille, puis le regarda fixement, ce qui fit venir les larmes aux yeux de Céleste. « Il parle comme un Oracle, s’écria-t-il ! Eh bien, Mesdames, vous dites donc… — Je dis, reprit Prudente, que vous perdez le temps en paroles inutiles. Partez, retournez dans vos Etats, abandonnez cette bicoque… — Bicoque vous-même, reprit Tout-Rond ; pourquoi injuriez-vous ma maison, Madame ? je la quitte avec peine, & puis je n’aime point à voyager. — Ne faut-il pas aussi vous en épargner la peine, reprit Prévoyante ? Allez vous coucher, & levez-vous demain de bonne heure, car vous aurez plus d’une affaire. — Je ne demande pas mieux, reprit-il encore, mais je suis en peine des Princesses & de Pacifique ; je n’ai d’appartement ici que pour moi, &… — Vous devenez modeste ou vilain, dit Prévoyante en l’interrompant ; où donne cette porte que voilà au fond de votre cabinet ? — Pardieu, dit-il, c’est ma garderobe, prétendez-vous les coucher là ? — Vous ne nous en imposez pas, reprit Prévoyante. » En disant cela, elle frapa la porte de sa baguette ; la porte s’ouvrit, & l’on vit un magnifique appartement destiné à Reinette & à son mari. De-là on passa dans un autre plus petit, & décoré suivant l’étiquette des veuves, ce qui désignoit que Céleste devoit l’occuper. « Vous avez très-bien fait d’y pourvoir, Mesdames, dit le bon-homme, en admirant les appartements ; tant que vous ne ferez que de ces tours-là, vous serez les bien venues. Si vous voulez aussi vous mêler du souper, je crois qu’il n’y aura pas grand mal, & alors je vous proposerai sans façon… — Et où est la sale à manger, demanda Prudente ? — La sale à manger, dit-il, partout où je me trouve quand j’ai faim. Ici par exemple ! » Aussi-tôt une table somptueusement servie descendit du plafond, & l’on se mit à table. Céleste paroissoit seule insensible à toutes ces merveilles. Elle regardoit les larmes aux yeux le petit Colibri que son beau-pere tenoit toujours sur son doigt. La Fée Lumineuse consulta ses compagnes pour sçavoir si elles ne tâcheroient pas par quelques charmes d’abréger le terme de ses regrets, & il fut résolu qu’on en donneroit le pouvoir à Reinette, dont Prudente guidoit toutes les actions.
Le souper fait, les Fées prirent congé de la compagnie, chacun se retira dans son appartement, se coucha, & le lendemain en se réveillant, ils se trouverent tous transportés dans le palais de Céleste. Tout rentra dans l’ordre ordinaire. Pacifique se mit à gouverner ; le bon vieillard causoit toute la journée avec son Colibri. Reinette reprit ses occupations, & Céleste fit tous ses efforts pour l’imiter. Elle consultoit toujours sa sœur ; celle-ci consultoit son Livre bleu & sa noisette, & tout alloit le mieux du monde. La paix & l’union regnoient entre eux. Céleste finit par se trouver heureuse. Tous les soirs on chantoit en chorus :
Une année se passa ainsi sans qu’il arrivât rien de remarquable. Un jour où ils étoient tous rassemblés, on leur annonça la visite de Songecreux. Cela les fit trembler. Il fallut pourtant bien le recevoir. La curiosité l’attiroit, & il ne le cacha pas. Il avoit tant entendu parler du bonheur de cette famille & du mérite de celle qu’il avoit dépouillée de son héritage, qu’il voulut en juger par lui-même. Il se fit accompagner par un de ses neveux, qui étoit un jeune Prince d’une beauté parfaite ; aussi on l’appelloit Phénix. La réception qu’on leur fit, fut assez froide. Le jeune Prince trouva Céleste fort au-dessous de la réputation de sa beauté, mais beaucoup plus aimable qu’on ne le lui avoit dit.
De retour chez son oncle, il ne parloit que de la Famille heureuse ; c’est le nom qu’on lui donnoit à vingt lieues à la ronde. « Mon oncle, disoit Phénix, avez-vous remarqué ces deux sœurs ? Et Céleste, quelle modestie dans ses regards ! — Ne m’interrompez pas, je songe… répondoit Songecreux. — Et à quoi songez-vous, mon oncle ? — A ce qui me plaît, mon neveu. » Songecreux fut trois mois entiers à songer tout seul à ce qui lui plaisoit sans jamais en faire part à personne. Pendant ce temps, Phénix alloit fréquemment faire sa cour aux Princesses ; il les trouvoit toujours occupées & toujours plus aimables. Il prit pour Céleste un goût si vif, qu’il vint un jour interrompre les rêveries de son oncle ; il se jetta à ses genoux, & lui avoua qu’il ne pouvoit plus vivre sans épouser Céleste. « Parbleu, lui répondit Songecreux, tu aurois bien dû me le dire plutôt : il y a trois mois que je songe comment je pourrois faire pour réparer le mal que j’ai fait à toute cette famille, sans leur avouer que j’ai eu tort, & je ne trouvois rien. Mais voilà l’arrangement tout fait : tu épouseras Céleste ; je te donne mes Etats, après moi s’entend, & je rens à Reinette & à Pacifique pour présent de noces ce que je leur ai pris. » Phénix fut dans un transport de joie difficile à rendre. « Je vous tiens quitte des remerciments, lui dit son oncle, allez-vous-en trouver votre céleste épouse, & laissez-moi, il faut que je me remette à songer. — Et pourquoi faire, mon oncle ? — Belle demande ! Et le contrat & la noce ? Laissez-moi songer, vous dis-je, & partez. » Phénix ne se le fit pas dire deux fois. Il s’adressa au Prince Pacifique, & lui dit les intentions de Songecreux, en le priant de lui être favorable auprès de Céleste. Reinette, qui vit dans cette proposition l’accomplissement de tout ce qu’avoit annoncé Prudente, pressa sa sœur d’accepter la main de Phénix. On consulta cependant son beau-pere, qui répondit : « Eh ! mais, qu’est-ce qu’on prétend donc que je devienne moi ? Est-ce que je resterai tout seul ici ? — Il ne tiendra qu’à vous, lui dit Reinette, de venir demeurer avec nous. — Parbleu, Princesse, vous n’en serez pas dédite ; à ce compte, je consens à tout. »
Dès que le mariage fut public, Songecreux vint lui-même chercher Reinette & Pacifique pour les remettre en possession de leurs biens, ce qui se fit avec la plus grande solemnité. Reinette ne fut pas plutôt dans son palais qu’elle courut avec Céleste à l’appartement de leur mere. Elles entrerent en tremblant dans le boudoir où elle s’étoit endormie, & dont elle avoit disparu. Reinette, plus vive que sa sœur, entra la premiere, & jetta un cri, en voyant sa mere qui se réveilla en sursaut au bruit qu’elle fit. On peut plus aisément se représenter que d’écrire les transports de joie des deux Princesses & de Régentine. Les Princes furent appellés. Le bruit du retour de Régentine se répandit bientôt, & la satisfaction devint générale. Régentine donna son consentement au mariage de Céleste. Elle apprit l’heureux changement qui s’étoit fait dans son caractére & dans sa façon de penser, & pensa en mourir de plaisir. Reinette fit présent à sa sœur de son flacon de beauté ; mais elle dédaigna d’en faire usage, bien sûre par son expérience que la beauté ne rendoit point heureuse.
Les Fées assisterent aux noces de Céleste, & l’on chanta un hymne en l’honneur de Prudente & de Prévoyante. Céleste convint, & promit de ne jamais oublier, que la beauté ne l’avoit jamais rendue heureuse, qu’elle avoit été au contraire un obstacle à son bonheur, & qu’elle n’avoit joui d’une satisfaction sans nuage que depuis qu’elle avoit contracté l’habitude de faire succéder sans cesse une occupation à une autre.
Depuis cet événement, ils ont tous vécu heureux. Les Fées fixerent les limites des Etats de Régentine, de Songecreux & du pere de Colibri ; ils furent entourés d’une riviere profonde. Ce pays est inaccessible à tous ceux qui ne sont pas aussi vertueux que ses habitants. Ce qui fait que depuis on l’a toujours appellé l’Isle heureuse.
La Mere.
Eh bien ! comment trouvez-vous cette histoire ?
Emilie.
Elle m’a fort amusée, Maman ; je voudrois bien ressembler à Reinette.
La Mere.
Vous sçavez ce qu’il faut pour cela ?
Emilie.
Oui, Maman, je la lirai encore, n’est-ce pas ?
La Mere.
Quand il vous plaira.
Emilie.
Il y a bien des choses que je vous prierai de m’expliquer.
La Mere.
Volontiers. Mais ce sera pour un autre jour.


Emilie.
Que ferons-nous aujourd’hui, Maman ?
La Mere.
Ce que vous voudrez. Voyez ce que vous voulez faire ; vous avez bien rempli vos devoirs, je vous laisse maîtresse de choisir vos occupations pour le reste de la journée.
Emilie.
Vous êtes bien bonne, ma chere Maman ! Eh bien, il faut si vous voulez… ou bien je voudrois… Oh non, non, tenez, Maman, causons, cela vaudra mieux.
La Mere.
Cela vaudra mieux que quoi ?…
Emilie.
Que tout ce qui me passoit par la tête. Mais, Maman, si vous voulez, puisque vous êtes contente de moi, j’aime mieux causer. Il y a près de huit jours au moins, Maman, que nous n’avons parlé ensemble.
La Mere.
Je croyois que nous causions ensemble tous les matins.
Emilie.
Ah ! oui, mais c’est à déjeûner ou en étudiant ; mais faire la conversation comme une Dame, il y a bien long-temps.
La Mere.
Cela est vrai. Eh bien, je vous écoute, avez-vous bien des choses à me dire ?
Emilie.
Oui, Maman, mais commencez.
La Mere.
Volontiers ! Par exemple, il me passe aussi une idée par la tête ; rendez moi un peu compte de tout ce qui vous est arrivé, & de la maniere dont vous avez passé votre temps depuis notre derniere conversation.
Emilie.
Ah ! voyons. Premierement, ma chere Maman… faut-il parler de mes devoirs ?
La Mere.
S’ils vous ont fait faire quelques réflexions nouvelles depuis que nous en avons parlé à la bonne heure.
Emilie.
Non. Ainsi je dirai seulement que Lundi dernier nous sommes sorties ensemble.
La Mere.
Et où avons-nous été, je ne m’en souviens pas trop ?
Emilie.
Comment, Maman, vous ne vous en souvenez pas ? je m’en souviens bien, moi ; nous avons été acheter de la soie pour faire de la tapisserie, & nous avons trouvé une Dame qui étoit si impertinente ; vous sçavez bien Maman, cette Dame qui étoit dans la boutique.
La Mere.
Ah ! oui vraiment, je me la rappelle ; mais j’avois oublié & la Dame & son impertinence.
Emilie.
Elle avoit pourtant grand tort.
La Mere.
C’est pour cela que j’ai été si pressée de l’oublier, d’autant qu’elle a été très-fâchée de l’impertinence qu’elle m’a faite.
Emilie.
Je le crois.
La Mere.
Vous avez donc senti qu’elle avoit eu tort.
Emilie.
Oui Maman !
La Mere.
Et en quoi ?
Emilie.
Mais parce qu’elle est entrée dans cette boutique comme une folle, qu’elle a voulu prendre votre chaise en vous faisant ranger, & sans seulement faire la révérence, comme si vous étiez une Femme de chambre.
La Mere.
Si j’avois été une Femme de chambre, elle n’auroit donc pas eu tort ?
Emilie.
Non Maman !
La Mere.
Vous vous trompez, Emilie. Sa Femme de chambre n’auroit pas eu le droit de lui résister comme moi ; mais la Dame auroit eu tout autant de tort.
Emilie.
Comment cela, Maman ?
La Mere.
En se conduisant comme elle l’a fait, elle étoit impertinente avec moi, elle auroit seulement été impolie avec une Femme de chambre ; & il ne faut être impolie avec personne. Voilà précisément en quoi consiste la faute que son étourderie lui a fait faire.
Emilie.
Voilà donc pourquoi, Maman, vous me dites toujours de faire la révérence à tout le monde.
La Mere.
Sans doute ; il faut s’accoûtumer de bonne heure à cette politesse générale, qui n’est jamais déplacée & qui n’a rien de faux.
Emilie.
Est-ce que la politesse est de la fausseté ?
La Mere.
Quand elle est exagérée, quand elle est outrée, elle en a l’air.
Emilie.
Qu’est-ce que c’est que la politesse, Maman ? Car c’est une de ces choses que j’entens à-peu-près & que je voudrois bien sçavoir tout-à-fait.
La Mere.
La politesse est une expression douce & volontaire des sentiments d’estime & de bienveillance que nous éprouvons. Elle se marque par le maintien, ou par les paroles. Elle est quelquefois aussi une simple marque d’égards.
Emilie.
C’est quand on fait la révérence à ceux devant qui on passe sans les connoître qu’elle est une marque d’égards, n’est-ce pas, Maman ?
La Mere.
Oui précisément. Celle-là est sans conséquence, & il vaut mieux la prodiguer que d’y manquer.
Emilie.
Et l’autre ?
La Mere.
Celle qui se marque par les propos affables, ou par ce qu’on appelle compliment d’usage, demande plus de distinction, pour ne pas passer les bornes de la droiture. Je vous les ferai faire à mesure que l’occasion s’en présentera.
Emilie.
Pourquoi pas à présent, ma chere Maman ?
La Mere.
C’est que les maximes générales sont presque toujours fausses ou sujettes à tant d’exceptions, qu’il vaut bien mieux attendre le moment où l’exemple se présentera.
Emilie.
Oui ? Eh bien, parlons d’autre chose, Maman, je suis bien aise d’être au monde !
La Mere.
Et pourquoi ?
Emilie.
C’est que c’est joli tout ce qu’on voit. Et puis, il y a des moments où je suis si heureuse ! si heureuse ! Hier, par exemple, cette Comédie où vous m’avez menée, cette petite Demoiselle qu’on avoit renvoyée ; elle étoit bien affligée, elle pleuroit ; mais aussi quand je l’ai vu revenir, cela m’a fait tant de plaisir !… Comment est-ce qu’elle s’appelle ?
La Mere.
Nanine.
Emilie.
Oui, Nanine ! Pourquoi donc est-ce qu’on l’avoit renvoyée ?
La Mere.
C’est qu’on avoit dit du mal d’elle à son maître, & il l’avoit cru.
Emilie.
Mais il avoit tort ! Pourquoi ne lui demandoit-il pas si cela étoit vrai ? Moi si j’avois été à la place de ce Monsieur, je lui aurois dit : Mademoiselle, on m’a dit… mais qu’est-ce qu’on lui avoit donc dit, je ne sçais plus ?
La Mere.
Son maître lui avoit donné de l’argent ; elle l’envoyoit en cachette à son pere, & l’on l’avoit accusée de l’avoir donné à un autre.
Emilie.
Eh bien ! je lui aurois demandé si cela étoit vrai.
La Mere.
Vous auriez mieux fait. Mais son maître étoit piqué de ce qu’elle avoit manqué de confiance en lui, & il n’écoutoit que son ressentiment.
Emilie.
Mais elle faisoit bien d’envoyer son argent à son pere ; on ne devoit pas la punir.
La Mere.
Certainement. Voyons un peu, quelles réflexions ferons-nous sur tout cela ?
Emilie.
Oh, je ne sçais pas, tout cela m’embrouille ! Aidez-moi, Maman, s’il vous plaît !
La Mere.
Il me semble que nous pouvons conclure qu’en général il y a un grand danger à ne pas donner sa confiance entiere à ceux qui veulent bien nous diriger & nous guider.
Emilie.
Oui, cela est vrai.
La Mere.
Que l’on est très-blamable de suivre son premier mouvement de colere ou de ressentiment, parce qu’on court le risque de faire des injustices comme le Comte d’Olban.
Emilie.
Cela est encore vrai. Ah ! est-ce qu’il s’appelle d’Olban, ce Monsieur ?
La Mere.
Oui. Et qu’enfin celui qui n’a rien à se reprocher peut se consoler comme Nanine des injustices qu’il essuie, parce que tôt ou tard la vérité se découvre, & qu’on rend justice à qui il appartient.
Emilie.
Oui… Maman, c’est bien commode, la vérité.
La Mere.
Oui, pour celui qui ne s’en écarte pas, il n’a qu’à se tenir tranquille. Et le mensonge, la calomnie, la fausseté sont en revanche bien incommodes & bien fatiguants pour ceux qui s’y laissent entraîner. Il faut qu’ils travaillent sans cesse à cacher leur duplicité, qu’ils craignent toujours d’être découverts ; qu’ils se tourmentent, & tout cela fort inutilement, car avec le temps ils le seront certainement.
Emilie.
Oh ! pour moi, je dirai toujours vrai, car je n’aime pas à être tourmentée. Tenez, Maman ; quand j’ai tort, je suis si mal à mon aise, & je serois bien pis si je mentois. Oh ! mon Dieu, je me cacherois comme cela avec mes deux mains sur mon visage ; je crois que je n’oserois plus jamais me montrer.
La Mere.
Vous avez raison ; car il y a des fautes qui ne s’oublient pas, & le mensonge est du nombre. Celui qui s’en est rendu coupable perd l’estime & la confiance des hommes, & l’on ne s’en releve jamais. C’est un vice bas & avilissant.
Emilie.
Mais à propos, Maman, vous sçavez bien ce que vous m’avez promis.
La Mere.
Quoi ?
Emilie.
L’extrait de ce Livre pour apprendre par cœur. Vous l’avez oublié, moi je m’en souviens bien.
La Mere.
Je ne l’ai point oublié, car je l’ai dans ma poche ; mais j’attendois que vous vous en souvinssiez.
Emilie.
Ah, ma chere Maman, que vous êtes bonne ! Allez-vous me le donner ?
La Mere.
Oui, je serai bien aise que nous le lisions ensemble. Le voici, lisez.
Emilie.
Voyons.
EXTRAIT des Principes moraux.
« Qu’il est doux d’exister, de penser, de sentir. J’existerai pour obéir à l’Auteur de la Nature. Je penserai pour connoître la vérité. Je sentirai pour aimer la vertu.
« Je ferai le bien, parce qu’il est agréable à faire. Je laisserai le mal, parce qu’il remplit le cœur d’horreur & d’amertume.
« J’ouvrirai le matin mon cœur à la joie de pouvoir faire le bien ; je me livrerai le soir au sommeil avec la satisfaction d’avoir vécu dans l’innocence. Je travaillerai le lendemain à faire le bien que je n’aurai pas fait la veille.
« Je jouirai de tous les biens de la vie sans orgueil & sans injustice. Je me passerai de tout ce que je n’ai point, sans humeur & sans murmure.
« O vérité, sois la lumiere de mon esprit ! O vertu, sois la seule nourriture de mon ame ! O bienveillance, amour, gratitude, amitié, soyez les plus douces occupations de ma vie !
« J’aimerai les hommes, parce qu’ils sont mes semblables. J’embellirai mon existence de celle des autres. J’étendrai ma bienveillance sur tout ce qui existe, afin que mon cœur soit toujours rempli de la douceur d’aimer & d’être utile.
« S’il est vrai que les hommes soient plus méchants qu’ils n’étoient, je ferai de l’indulgence & de la douceur mes compagnes ordinaires, afin de n’être pas malheureuse des vices & des défauts des autres.
« Je serai heureuse du bonheur d’autrui, parce que je le sçaurai dans l’aisance. Je plaindrai le malheureux que je ne puis secourir ; je partagerai ses peines, parce qu’il en sera d’autant soulagé. J’oublierai le méchant & ses actions, parce qu’il faudroit le haïr.
« Je ne vivrai que pour aimer ce qui est bon & aimable. Je fermerai mon cœur au poison de la haine & de l’envie, afin qu’il n’en soit pas corrompu. Je souffrirai les injustices des autres sans me plaindre, parce qu’ils sont assez punis d’être méchants.
« Je serai douce & sensible dans le bonheur, afin d’en être digne. Je serai patiente & courageuse dans le malheur, afin de le vaincre.
« Je ne murmurerai pas des événements de la vie, parce que je n’en connois ni la cause, ni le but. Je regarderai l’immensité de l’univers & ses abysmes, afin de me guérir de l’orgueil de me croire quelque chose. Je regarderai les soins de l’Auteur de la Nature pour la plus petite de ses créatures, afin de ne me point croire abandonnée.
« J’emploierai mon loisir à contempler l’ordre & la magnificence de ses ouvrages, afin d’avoir des sujets d’admirer & de me réjouir. Tous les êtres sont faits pour obéir à sa loi, & ils ne trouvent leur bonheur que dans leur obéissance. Je serai soumise à sa volonté, afin de remplir mon heureuse destinée.
« J’admirerai les travaux & les vertus de l’homme, son courage, son génie, & la sublimité de ses idées, & je serai aise d’être son semblable. O homme, qui t’es dégradé par la bassesse du vice & des mauvaises actions, que ton souvenir soit effacé de ma mémoire, afin que je ne rougisse pas de mon être !
« O espérance, remplis mon cœur de la certitude de passer ma vie dans l’innocence, afin que la paix de mon ame ne soit point altérée ! Que mon cœur n’éprouve jamais la lassitude de faire le bien ! Je regarderai la vie comme un bien passager que je rendrai sans regret, parce que je l’aurai fait valoir de mon mieux, & que j’en aurai joui pour le bonheur des autres & pour le mien. La vertu vaut mieux que la vie, parce qu’elle rend l’homme heureux, & qu’il ne faut vivre que pour le bonheur des autres & pour le sien.
« O toi, qui régles ma destinée, donne-moi beaucoup de devoirs à remplir, afin que mon cœur ait beaucoup de sujets de satisfaction ! Que plutôt je cesse de vivre que de faire un crime ! Que je ne sois jamais assez misérable pour causer le malheur d’un être vivant !
« La fausseté sera loin de mon cœur ! Le mensonge ne sera point dans ma bouche, parce que je gagnerai à me montrer telle que je suis… &c. »
La Mere.
Eh bien, comment trouvez-vous cela ?
Emilie.
Quoi ! c’est déja fini ? Mais il n’y a rien de nouveau là-dedans.
La Mere.
Comment ?
Emilie.
Mais je sçais tout cela, Maman. C’est ce que nous disons tous les jours.
La Mere.
Mais le dire ne signifie rien, si vous n’êtes pas convaincue de la vérité de ces principes.
Emilie.
Et comment ne le serois-je pas, Maman ? Est-ce que je ne l’éprouve pas ? Quand j’ai tort, je suis malheureuse ; quand je suis sage, je suis heureuse ; quand j’ai fait du bien à quelque chose, je suis enchantée. Quand je vois quelqu’un souffrir, cela me fait de la peine ; il semble que ce soit moi qui souffre.
La Mere.
Puissiez-vous toujours, mon Enfant, vous fortifier dans ces sentiments. Croyez-moi, apprenez cet extrait par cœur pour vous rappeller à tout instant les principes qui doivent diriger votre conduite.
Emilie.
Ah ! Maman, oui, je les apprendrai, je vous le promets ; mais, Maman, appellons cela les Eléments du bonheur, n’est-ce pas ?
La Mere.
Vous avez raison.
Emilie.
Nous les cherchions l’autre jour, les voilà tout trouvés ! Voulez-vous bien me permettre de les copier, je les sçaurai plus vîte.
La Mere.
Très-volontiers, les voilà. Allez les écrire.
Emilie.
J’y vais, Maman, & je ne quitterai pas que je n’aye tout fini.
FIN.