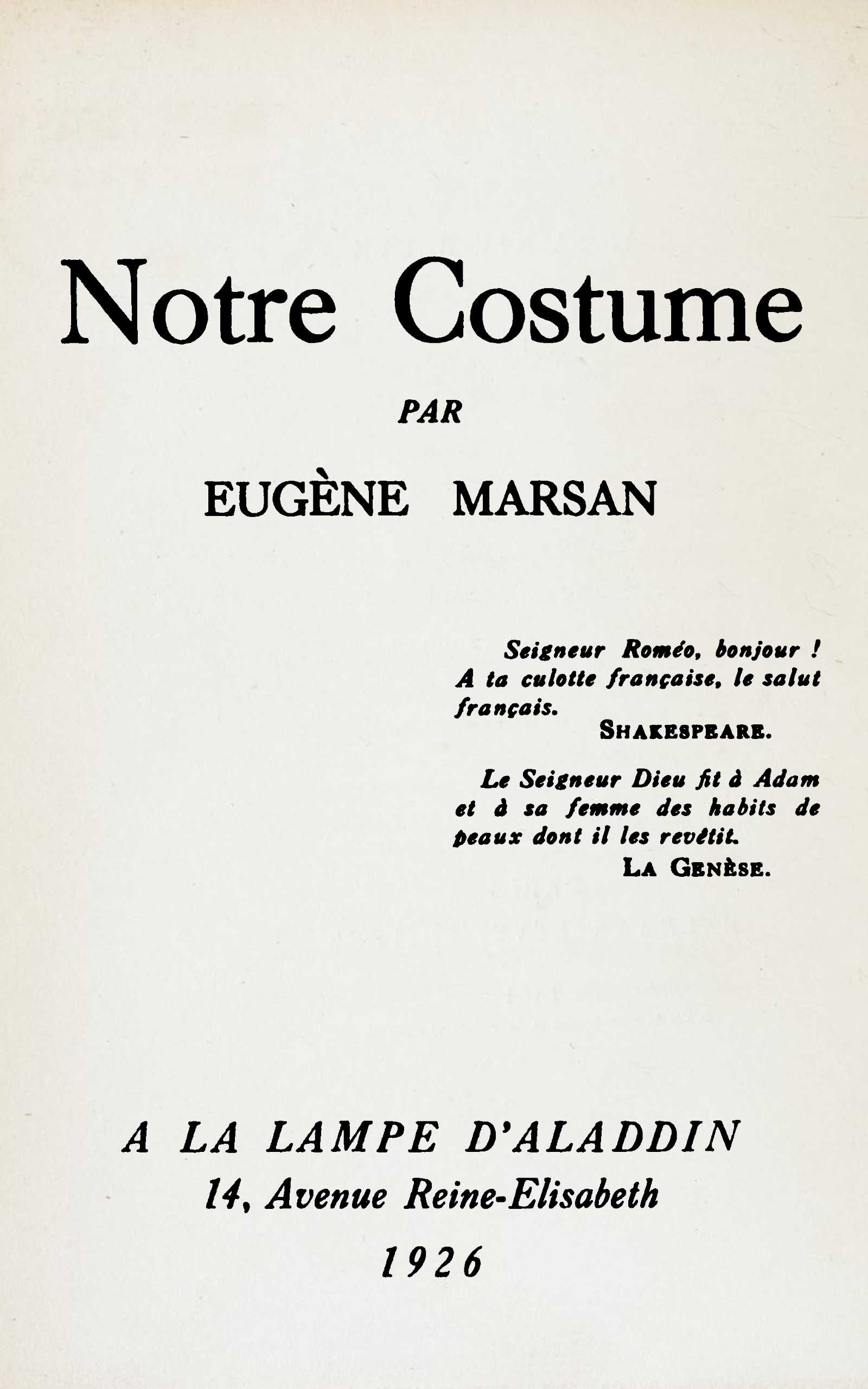
Title: Notre costume
Author: Eugène Marsan
Release date: November 28, 2025 [eBook #77362]
Language: French
Original publication: Liège: A la lampe d'Aladdin, 1926
Credits: Laurent Vogel (This book was produced from scanned images of public domain material from the Google Books project.)
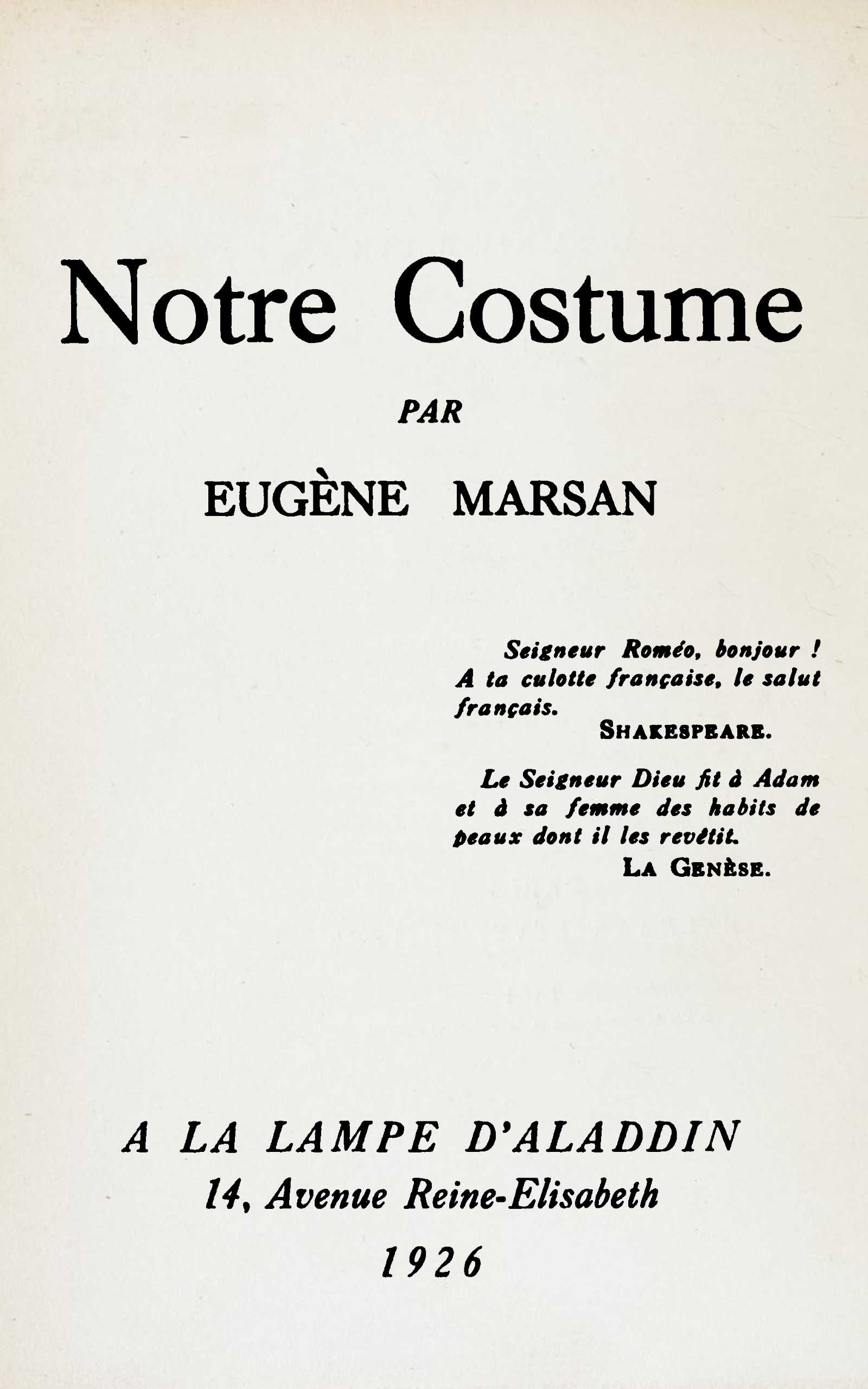
PAR
EUGÈNE MARSAN
Seigneur Roméo, bonjour ! A ta culotte française, le salut français.
Shakespeare.
Le Seigneur Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peaux dont il les revêtit.
La Genèse.
A LA LAMPE D’ALADDIN
14, Avenue Reine-Élisabeth
1926
DU MÊME AUTEUR :
A L’IMPRESSION :
Copyright 1926 by Eugène Marsan.
La moitié d’un gros livre a déjà été consacrée par le même auteur à peu près aux mêmes sujets. Mais on était loin de les avoir épuisés, et il n’y en a pas qui se renouvellent plus vite.
J’espère donc n’avoir jamais répété que par exception et à propos deux fois la même chose.
Il m’est arrivé, une fois seulement, je crois, de me contredire tout à fait. C’est à propos de l’habit, que je louais et que je condamne. On pèsera mes raisons dans les deux cas.
En outre, dans une matière d’habitude toute soumise à la réclame, il m’a plu d’introduire, par goût de la précision, la liberté dont dispose la critique des lettres et des arts.
E. M.
Les hommes n’estiment plus que leur costume doive être négligé.
Lorsqu’il n’y met pas une affectation odieuse, un homme élégant est à coup sûr mieux vu qu’un ours.
C’est notre temps qui a raison.
Nos aînés n’ont pas pensé comme nous. Ils ont eu d’autres idées. « Un homme, disaient-ils, n’a pas souci du costume, parce qu’un tel souci n’est point viril. » Ainsi, ils étaient en contradiction avec tout l’univers, en contradiction avec cette même nature qu’ils prétendaient diviniser.
Car, sur le globe, tous les mâles de toutes les espèces disposent d’un harnais plus magnifique que leur tendre moitié, et se battent pour elle, quelquefois à mort. Jusqu’aux infusoires dans leur goutte d’eau. En cet abrégé du monde, les mâles sont merveilleusement parés. Et ils dansent à l’heure de l’amour, jusqu’à ce que la belle fasse connaître son choix. Tel est l’ordre véritable des atomes.
L’homme est le seul animal qui s’habille (ici, je me répète exprès). Il n’avait pas encore découvert l’usage des métaux, il ne savait pas encore semer, il courait sur la trace des rennes, il n’était qu’un chasseur dépourvu, qu’il s’habillait déjà. Il est le seul être qui substitue de certaines règles conventionnelles, de certaines contraintes générales — les lois — à la simple rivalité des forces. Et il naît aussi nu qu’un dieu. Il est seul enfin à souffrir comme à jouir d’une idée tout à fait claire de la beauté. Le costume est un grand fait.
Autant qu’une nécessité, autant qu’une défense, il est parure, ornement, séduction.
Adam s’est habillé au sortir du paradis perdu. Il s’est habillé par vergogne et par besoin. Ensuite, pour plaire. Il y mit toujours un sentiment profond. Son âme et son corps. Rappelez-vous le mystérieux passage de la Genèse : « Alors le seigneur Dieu appela Adam et lui dit : Où êtes-vous ? Adam lui répondit : j’ai entendu votre voix dans le paradis, et j’ai eu peur parce que j’étais nu ; c’est pourquoi je me suis caché. » Et Dieu le vêtit. Dieu en personne. Dieu lui donna le premier vêtement, cousu en peaux de bêtes. Lisez le Livre. Le costume est un art, après tout, pareil à tous les autres, ayant la même fin, qui est de rendre le sort un peu moins désagréable. Les hommes du XIXe siècle ont été fous de le mépriser. Le dédain qu’ils ont gagné de leurs compagnes, j’en suis sûr, vient en grande partie de là. Elles tinrent les hommes pour des êtres grossiers. Elles les voyaient, jusqu’à des hommes d’État, se faire gloire d’un vêtement hideux et malpropre.
Aujourd’hui, nous nous tenons, lavons et habillons. S’il n’est permis qu’à un petit nombre d’atteindre un haut degré d’invention calme et de raffinement, tous les hommes ont heureusement pris le même dégoût d’un ignoble costume que d’un acte vil.
Ecco perchè… Voilà pourquoi, j’ose parler du costume plus complètement que personne l’osa jamais par écrit. Et nous n’en parlerons pas seulement dans l’abstrait, comme Barbey d’Aurevilly dans son Brummell. Nous entrerons dans le détail, nous ne perdrons pas de vue la pratique, nous pénétrerons des secrets.
Pour commencer, nous voudrions vous munir contre votre tailleur.
Oh ! d’armes purement défensives. Il faut que tu saches bien ce que tu veux. Le sachant, il faut que tu puisses l’exiger, c’est-à-dire t’exprimer en termes irréfutables. Or, j’en fais le pari, aujourd’hui, tu n’es plus tout à fait content de ton tailleur.
Les déceptions qu’il te donne, il est arrivé qu’elles te fissent choir dans un abîme. Tu te croyais malheureux, disgracié, tu remâchais ton infortune. Tu doutais de toi-même.
Console-toi. C’est le premier service que nous pourrons te rendre. Ou du moins on le souhaite. Même si ta forme n’est pas très harmonieuse, et si tu es déparé, tu dois parvenir à t’habiller très bien. Un bon tailleur ne se contente pas de coller les vêtements sur un corps. L’art est plus malin. Il doit remédier aux défauts qu’on te voit. Lui aussi, le tailleur, doit trouver un lieu géométrique de la vérité et du style.
Soyons justes. Il y a lieu d’invoquer plusieurs circonstances atténuantes au bénéfice du tailleur contemporain. Il est lui-même une victime. Il lui faut affronter des ouvriers difficiles, dont l’adresse n’a point crû avec les gains. Il lui faut supporter les changes. Et l’on ne travaille plus sous ses yeux. Il donne en ville. Ayant été traduites, tes recommandations ont été trahies. Finalement, tu n’essayes presque plus. C’est qu’à chaque essayage, contraint de revenir, l’ouvrier prélève, à cause du temps perdu, une grosse rançon.
Quoi qu’il en soit, tu risques d’être mal servi. Et regarde autour de toi. Regarde au théâtre, regarde les salons. Tout est plein de fausses coupes, de traditions altérées, d’insoutenables routines, d’impayables gaucheries, de plis imbéciles. Trop de fer, trop de coton, peu de vraie et simple coupe. Les Anglais eux-mêmes sont en décadence.
Il semble qu’on ne sache plus éviter un défaut qu’en donnant à pleine tête dans le défaut opposé. Aux bosses d’une manche trop large, on a substitué le boudin d’une manche trop étroite. A la raideur de l’épaulette rembourrée, cette ligne rompue, ce zig-zag. Au bâillement du col sur la nuque, son obliquité, qui te rend bossu. Au déséquilibre d’un veston qui relevait par devant cet autre désordre : il tombe, il pique du nez parce qu’il a trop court son dos. Trop court, sur les reins ; peut-être trop long sur les omoplates. Que la perfection est rare sur la planète ! Que ceux qui l’aiment sont malheureux !
Sans compter ces pantalons dont les rues sont pleines, qui — pour avoir pris garde de s’achever en tire-bouchon — se sont accrochés au-dessus de la cheville, et muent tant de messieurs poivre et sel en garçonnets sautillants.
Ai-je trop noirci mon tableau ? Je te le répète : regarde. Tes amis sont spirituels. Ils ont les plus élégantes manières qui soient, les plus naturelles (pour user d’un mot sur lequel il faudrait s’entendre). Ils sont comme toi : rarement habillés à leur gré… Laisse que viennent à ton secours l’étude et l’expérience. Et si tu en as plus que moi, souris, sois mon complice.
Qui voudra, sera libre de nous juger frivoles. Cette frivolité a plus de psychologie que son sérieux à œillères, comme celui des ânes. Elle n’empêche pas de sentir les grandeurs de l’esprit ni celles du cœur. Et ma frivolité, je l’avoue, partage le genre humain en deux classes.
D’une part, les honnêtes gens de la terre, depuis qu’il y en a, qui savent connaître et goûter la beauté, les beautés, le plaisir et la vie. Je les nomme les enfants de Ronsard.
Dans l’autre clan, figurent les jansénistes et les couacres (ou quakers), les iconoclastes, les hérétiques, les faces de carême.
Exprès. J’écris smoquin tout exprès, pour parler autant que possible français.
Un mot que le français n’a pas, dont il avait besoin et qu’il a pris en pays étranger, il faut pourtant l’adapter, l’acclimater, comme on ne manquait pas de faire dans les siècles vivaces. Dites-vous reading-coat ? En matière de costume surtout, à cause de la grande influence de Londres, la précaution doit être perpétuelle. Nous finirions par dire hat au lieu de chapeau, shoes, au lieu de souliers, suit au lieu de complet.
A l’Exposition des Arts décoratifs, entre les robes scintillantes, éblouissantes, et les robes strictes et nues — les dames étant vouées aux extrêmes — pour tant de complets qu’on admirait (ou non) à peine si vous distinguiez une redingote, une seule, et deux ou trois jaquettes.
Cela était raisonnable. C’était l’image de la réalité.
Le vêtement à taille est pour ainsi dire abandonné. Il nous semble archaïque, il vieillit son homme, il surprend nos yeux.
En dehors de l’église, pour habiller le père et le fiancé qui conduisent à l’autel une grande fille, en dehors du pesage d’Auteuil ou de Longchamp, où, dites-moi, découvrez-vous une redingote ? Celui qui en est paré, n’imagine pas qu’il pourrait s’en aller à pied dans les rues. Il a soin de ne laisser qu’au dernier moment la voiture qui le garde de l’indiscrétion des curieux.
La voici pourtant, cette rare redingote de nos jours. Cumberland y a pensé. Elle est à longs revers de soie unie, avec une courte jupe assez bombée, pareille à celle, quadragénaire mon ami, que tous les jours tu portais, lorsque tu avais l’âge des fleurs. Tu préférais que le revers fût à gros grains, et tu laissais le noir absolu aux vieux hommes, choisissant pour toi un joli gris, au lieu que celle-ci est d’un sombre, pointillé de blanc, qui ne te plaît qu’à moitié…
Tes premières visites aux amies de ta mère… Si tu avais pu prévoir que la machine ronde, toi dessus, irait à ce train du diable !
La jaquette est moins délaissée. Elle est pourtant dangereuse, Seigneur ! Un peu de ventre que vous ayez, elle l’étalera : c’est une devanture. Si vous étiez arrivés à cet âge du majestueux dont parle Brillat-Savarin, passe… Mais qui donc aujourd’hui se résigne à une majesté pareille ? On s’évertue. On se prive du boire et du manger. On s’enorgueillit à cinquante ans d’une taille restée mince et d’un petit air juvénile dû à cent moyens naturels, depuis la gymnastique et l’eau coulante jusqu’à la chute d’une vaine moustache.
On a pourtant voulu… Comment dire ? On a voulu galvaniser la jaquette. O’Rossen lui a enlevé sa trop grande mine cérémonieuse pour lui prêter une grâce estivale : un fil-à-fil gris de perle qui ferait encore bien aux Acacias jusqu’au Grand Prix, en admettant que cette date en soit toujours une. La forme en est aiguë, à l’hirondelle. Et Carette, au contraire, pour mieux nous amadouer, pour mieux nous tenter, l’abrège et l’arrondit. Il s’est même proposé de résoudre le problème du chapeau, qui est en pareil cas d’une difficulté invincible depuis l’éclipse du tube. Il a remis en avant cette coiffure de feutre plein et dur, tronquée, qui n’est pas plus haute, seulement plus carrée que le melon. Vous voyez comment je suis obligé de la décrire : comme un phénomène lacustre. On l’appela jadis un cronstadt, à cause du mirage russe.
Mais tout ce que l’on pourra essayer restera vain.
Nous assistons à une révolution du costume. Il y en a.
Il y en eut une à la fin du XVIIIe siècle, peut-être l’un des prodromes de la révolution politique. A la fin du XVIIIe siècle, nos pères ont quitté leur costume national pour le costume anglais, qui était le frac, père de l’habit moderne. Toute l’Europe nous avait suivis. Les institutions et les armes ont ce prestige. Nous suivions désormais l’Angleterre. Un Français de 1804, avec sa cravate et son col, sa petite redingote, ou ses deux pans de morue, ressemble plus à un Européen de 1870 qu’à un Français de l’Ancien Régime. Et vous, combien de fois par an mettez-vous votre habit ? En 1830, les galas comportaient encore un habit à la française, avec un petit bicorne à claque. Mais ceux qui s’obstinaient ainsi parurent peu à peu des originaux, des fossiles. Le frac a chassé l’ancien habit. Le smoquin va traquer le frac.
Vous vous souviendrez de ma prophétie.
Il est impossible que le costume du soir soit longtemps un déguisement insolite. Aux beaux temps du frac de soirée, le même frac était aussi pour le jour. Il différait à peine de couleur et de coupe. Dans une dizaine d’années, au plus, votre habit aura disparu. Il ne se maintiendra quelque temps que pour habiller les gens de service, s’il en reste. Toujours comme l’ancien habit à la française.
Vous le regretterez, dites-vous. Vous le regretterez. Il faisait un privilège. Il fallait savoir le porter.
Ah ! le détestable lieu commun ! Quel est le vêtement qu’il ne faille pas savoir porter ? Est-ce que tous les vestons se ressemblent ? Est-ce que tous les hommes en veston sont frères, et tous balourds, ou tous désinvoltes ? En vérité, non, il n’y aura pas lieu de pleurer l’habit. Seule l’habitude nous empêche de sentir son extravagance. Du point de vue de Sirius, ou du point de vue d’Orion, qui est bien meilleur, — puisqu’il sait joindre la sympathie à la lucidité, — du point de vue d’un artiste qui nous arriverait de la Chine, qui serait sans prévention, qui ne jugerait que par le goût, il est sûr qu’un veston, il est sûr qu’un smoquin est un objet plus aimable et moins fou. Vive le smoquin !
En attendant, il nous faut un habit, et s’il était d’une coupe mal venue, il blesserait notre amour-propre.
Entre les marteaux obliques qui avaient naguère toute la vogue et les marteaux à angle droit qu’on a voulu rétablir, cherche un biais, un milieu. Si tu as gardé le ventre ingénu de l’adolescence, tu peux prendre (avec bonheur) le petit gilet croisé à bord horizontal. Autrement, tu seras sage de demeurer fidèle au gilet à deux pointes en V renversé. Il élance. Dans les deux gilets, l’ouverture des revers dépend d’un caprice qui était à peu près annuel et dont les variations sont devenues plus rares. Les gilets tumultueux, aux pointes violentes et gonflés en jabot, sont à laisser aux hommes de certains métiers qui ont droit à la fantaisie. Je le dis sans dédain. Je pourrais le dire avec orgueil. Ils peuvent se permettre même de laisser le rigoureux gilet blanc. Un satin écossais, hein ? Quelle aubaine !
Un habit doit paraître comme peint sur le buste. Je dis : paraître. Le tailleur n’est jamais exempt de tricher en vue de la perfection. Le pantalon plus ou moins large, selon l’an ; et s’il dessinait sur le cou-de-pied un très léger soupçon de guêtre, il plairait aux connaisseurs. Trop court, qui découvre la chaussette à tous les pas, un pantalon est toujours fâcheux. Il faut se croire marqué des signes de la décrépitude pour revenir, dans les boutons, à l’étoffe, au lieu du divin coroso (le mot est vilain, je m’en excuse).
Quant au smoquin, tout ce que j’ai dit ou dirai du veston lui convient, puisque c’est un veston. Tout ce que je viens de dire du gilet et du pantalon de l’habit ne laisse pas non plus d’être exact pour le smoquin. La décadence de l’habit a déjà commencé à donner un gilet blanc au smoquin en certains cas. Il est bien de mettre aux revers, au col et aux manches une ganse minuscule. C’est une coquetterie qui a toujours ses fidèles. Par exemple, il ne faut pas que la ganse se prolonge sur le bord inférieur : elle le raidirait. Tant pour l’habit que pour le smoquin les revers sont le plus souvent d’une peau de soie qui n’est pas trop brillante. La soie mate à gros grains fait un heureux archaïsme. Tu méprises, tu hais, tu fuis un satin qui trop étincelle. J’ajoute que si tu n’as pas le cou trop court, l’encolure ne doit pas être trop basse. Que l’épaule et le cou ne fassent pas un angle droit. Aux pieds, le vernis nu. Foin des piqûres. Et ni la bottine, bien sûr, ni même l’escarpin. Des souliers.
C’est tout, je crois. Pour moi, quand un concile en déciderait, je n’accepterai jamais plus deux boutons au plastron de la chemise. Il n’en faut qu’un, et que ce soit une perle, et qu’elle soit assez grosse, — ou tout simplement de l’or.
Que dirais-tu d’une perle de nacre ?
Lorsque Lucien de Rubenpré eut essuyé à l’Opéra les mépris de Madame d’Espard et des lions, il comprit soudainement qu’il était mal habillé, que son gilet était de mauvais goût, et son habit d’une mode exagérée… Je cite Balzac. On a beau le décrier. Il savait ce qu’il disait.
Lucien avait acheté ce gilet et cet habit tout faits au Palais Royal. 1830 avait-il cette supériorité sur 1925 ? Un habit tout fait, qui n’avait pas le suffrage des grands connaisseurs, mais qui enfin allait…
Pour avoir tremblé de honte, Lucien décida de recourir à un tailleur magistral. Il va chez le plus célèbre, il court chez Staub. Lucien (c’est-à-dire Balzac) n’était pas homme à se payer d’à peu près. A sa première promenade sur la terrasse des Feuillants, au sortir de sa province, tout lui a été révélé comme dans un coup de foudre. Il a discerné le fin du fin. Avec « cette étonnante fidélité de la mémoire », dit Balzac, qui n’est pas moins nécessaire que le goût, il l’a retenu, il l’a gravé dans son esprit. Or, il nous est rapporté que, du premier coup, Staub habilla Lucien en maître.
Ce livre à la main, tu seras en état de concevoir un veston parfait.
Ne crois pas que le veston soit une découverte récente. Non plus, si vieille. Ton père a porté des vestons, et le père de ton père. Ton aïeul, non, ou c’est lui qui a commencé, vers le milieu du siècle dernier.
Ce fut d’abord pour voyager et pour le matin. La veste intérieure de l’ancien costume français raccourcie en gilet, l’abréviation de l’habit ou de la redingote finit par donner le veston. Lorsqu’on imagina de tailler les trois pièces dans la même étoffe, on eut les premiers complets. Sur le continent, on les appela d’abord des « tout de même ». Au moins dans les mots, il restait à la France quelque chose du prestige ancien.
Nous portons des vestons depuis le 1er janvier jusqu’à la Saint-Sylvestre. Nous courons trop, nous descendons trop vite les escaliers du chemin de fer souterrain, nous y sommes trop pressés ; nous avons à conduire notre petite voiture, ou nous pouvons toujours l’espérer : le chapeau haut de forme heurterait les plafonds, la jaquette se prendrait dans les portières. Nous nous ferions l’effet de chiens savants. Il nous déplaît aussi de trancher sur la foule par des moyens grossiers et apparents. Le très riche et puissant seigneur qui gît dans sa quarante Renault, et le commis qui fait l’amour aux petites clientes des Galeries Lafayette sont l’un et l’autre habillés d’un complet apparemment le même. Cela n’est pas mal. Brummell et Baudelaire eussent aimé une élégance idéalement réduite à la qualité pour ainsi dire imperceptible du tissu et à l’excellence de la coupe, cet arcane.
Carette, qui a toujours mis sa gloire dans les vêtements à taille, Carette avait à l’Exposition un joli costume de cheval d’un petit carreau bien net. La veste était à martingale, la botte d’un joli marron d’Inde (mais le chapeau d’un brun trop rose). De Cumberland, un petit complet à rayure fondue, entre le violet et le marron. De l’inégal Voisin, un magnifique complet couleur de pêche, à grand carreau violacé. Quel que soit leur mélange, un ton finit toujours par prévaloir, dans ces étoffes : gris la plupart du temps ; cette année, brun ou violâtre. Par fatigue de la rayure, vous rencontrerez plus d’un de ces carreaux étranges, associés ou entrecroisés en lames de parquets. Barclay inventa un curieux costume de plein air, avec la culotte droite et large, le tout — casquette comprise — à rayure horizontale, verdâtre et rougeâtre alternées. On ne s’est pas contenté de légères variantes, on a voulu innover. Harrisson a même un costume qui rompt entièrement avec l’ancienne neutralité. Imaginez un veston et une culotte droite, cette culotte dont il paraît absurde en France d’écrire le nom en anglais. Elle dessine un très léger carrelé sur un fond presque blanc. La veste est marquetée sur fond beige. L’une et l’autre d’un moelleux qui déjà tient chaud, à le contempler. Le manteau est brun, à grandes raies orange qui se recroisent. La chemise est décorée d’un médaillon ovale, à zones noires mêlées d’orange, le plus grand axe de l’ellipse étant horizontal. Chapeau gris brun…
Tous ces tailleurs français de l’Exposition ont fait merveille. Je vais jusqu’à dire qu’ils ont aujourd’hui raison contre les Anglais. Nous verrons de quelle manière. Il faut seulement qu’ils prennent garde à leurs manches. Monsieur, attention à ta manche ! Neuf fois sur dix, tu vas pécher par la manche.
Lorsque tu seras debout, tes deux manches vont être arquées comme les deux anses d’une cruche. Pour éviter les grimaces, il faudra que tu portes constamment les deux bras en équerre. Gare si tu les laisses retomber ! Or, si elles étaient plus droites, tu pourrais prendre sans dommage les deux positions. Le tailleur voudra peut-être te persuader que non, et qu’il faut absolument accepter cette servitude. Ne l’écoute pas. — Et regarde.
La laideur de ta manche tient, non seulement à la monstrueuse courbe qu’elle décrit, mais à l’ampleur idiote du coude. Quel coude ! Si le tailleur objecte que c’est une autre nécessité, sache que c’est une autre fable qu’il imagine et que peut-être il croit. Il dit que si tu plies ton bras l’étoffe va tirer, qu’elle aura trop de rides. Tu lui réponds qu’il est absurde d’éviter un défaut que l’on craint par un autre que l’on détermine.
Ton épaule, à présent. Vois-la de profil. Je parie qu’elle est trop large, de profil. Au lieu de dessiner au sommet un arc élégant d’un petit rayon, l’emmanchure s’élargit, elle s’écrase. Tu as la carrure d’un portefaix. Ou bien, si ton tailleur a appris à corriger ce vice, il est allé à l’autre extrême, il a tant pressé l’étoffe sur ton humérus que tu parais chétif, tu as l’air d’un bossu clandestin.
Regarde toujours. Il est raisonnable qu’une place soit ménagée aux longs muscles de ton bras. Pourtant, tu n’avais pas besoin de cette vaste poche, dont te voilà navré, à présent que je te l’ai montrée. C’est trop. Non plus, il ne t’en fallait pas tant pour pouvoir lever le bras, ni pour éviter, à la hauteur de l’aisselle, ces mille plis en patte d’oie que ton tailleur serait louable de vouloir empêcher, si ce n’était avec l’emphase des clounes, lorsqu’ils ouvrent un crâne à la hache pour guérir une migraine.
Il ne te reste plus qu’à vérifier le parallélisme rigoureux, à bras plié, du bord de ta manche avec le poignet de ta chemise. Les deux largeurs sont naturellement pareilles. La manche, qui dépasse un peu, ne flotte pas dans le vide. Cela va de soi, comme B-A, BA.
Et tu as une manche qui est égale, qui est aisée, qui tombe, ne visse pas, se comporte bien.
Lorsqu’il sera à bout d’objections particulières, il se peut, s’il a un tour d’esprit philosophique, que ton tailleur ait recours à un argument préjudiciel : « Monsieur : depuis tant de siècles que les tailleurs s’exercent, admettez-vous que l’expérience leur ait lentement enseigné les coupes qui conviennent, et qui peuvent à première vue dérouter les profanes ? » Sois content. Cela est d’un excellent esprit. Tu lui marqueras donc qu’il a raison, en principe. Cependant, ajouteras-tu, voyez les poètes. Il arrive qu’ils soient égarés tous ensemble par une erreur. En ce cas, tous les poèmes qu’ils produisent seront viciés, en dépit du savoir et du génie, jusqu’à ce qu’il vienne un homme qui rétablisse un art poétique sain. Tu fermeras la boucle en observant que les tailleurs ne sont pas exempts des pièges où tombent les poètes.
Il y en a trois, dans le moment, qui leur sont tendus. Nous allons les voir. Puis, nous passerons à une autre matière. La manche méritait qu’on en raisonnât avec soin.
Actuellement, notre ligne n’est point mal. Nous pourrons regarder plus tard nos portraits sans rire. Cette assez large épaule, légèrement tombante, cette taille dégagée sans mièvrerie, cette ampleur du torse, cette modération dans l’ouverture du gilet, dans la largeur du pantalon, la longueur de la veste, la hauteur du col. Proportions décentes, bel équilibre.
Ton pantalon va de la taille à la chaussure en six lignes d’un beau jet pur, dont quatre n’ont d’existence que dans nos yeux, les deux autres étant ces plis au fer qu’il faut savoir maintenir. Il est plus beau lorsqu’il tombe avec franchise sur le cou-de-pied et qu’il y touche, de telle manière que, trouvant ce point d’appui, l’étoffe puisse un peu bouger. Cela n’est pas facile. Encore un juste point à rencontrer. Il ne s’agit pas de cacher ta belle chaussure. Et ton veston a la bonne longueur ; c’est-à-dire que si tu mets la main dans la poche du pantalon, il retombe élégamment derrière ton bras. (Une bonne vérification que je t’enseigne). Tu es svelte. Tu as la hanche égyptienne (ou tu le voudrais).
Piège numéro 1, ou du gigolo. — Toutes les lignes sont anguleuses. L’épaule est en porte-manteau, le coude pointu, le bras long, mince comme un fil. La poche fuit au bout du bras, le dernier bouton presque au ras du bord inférieur. La taille est basse. Le pantalon en pain de sucre renversé. Gilet croisé sur un buste de lévrier. Dans le manteau, qu’entravent les derniers boutons, ces boutons sont à la hauteur des genoux. Mais ce piège, où beaucoup de jouvenceaux ont donné, — d’ailleurs sans grand dommage, car la jeunesse peut tout — n’est plus très dangereux. Il paraît écarté.
Piège numéro 2, ou boulevardier. — Il s’agit de nous ôter ce qui nous plaît, qui nous va, et qui est le reflet de nos pensées. Il s’agit de nous inspirer, à la place, l’amour des ramages et du voyant… Or, je ne nie pas que le carreau soit l’épreuve des maîtres, je ne dis pas qu’une couleur un peu vive ne soit louable, lorsqu’elle est bien trouvée et logée. J’accorde même qu’un jour, les sports, réagissant sur tout le costume masculin, l’éclaireront, l’exalteront. Je l’accorde et le désire. Pour le quart d’heure, nos trouvailles devraient chanter sur ce fond unique : la simplicité d’hommes qui ont à se mesurer avec un destin difficile.
Piège numéro 3, ou le Carnaval. — Imaginez d’abord… Imaginez un pantalon si large que son extrémité recouvre les deux tiers de la chaussure. Par l’excès de son ampleur, il doit en outre former sur notre derrière, puisque je suis contraint de le dire, un pli vertical bien marqué. Ce n’est pas tout. Je n’ai pas dit le plus affreux. Dans la fourche, il faudra qu’il dessine entre les jambes une sorte de poche arménienne ou turque, analogue à celle qu’inventa — nouvelle preuve de sa folie — cet animal de Jean-Jacques Rousseau. Vous riez à présent. Vous êtes tranquilles. Mais attendez. Avec ce pantalon fantastique, où le fondement devient pareil aux deux poings d’un enfant, imaginez une veste serrée, qui tombe droit, qui n’est pas trop longue, qui a ses manches assez étroites. Et soudain, vous vous récriez. Vous avez rencontré des jeunes gens accoutrés de la sorte, une énorme canne passée à leur bras. Chapeau sur l’œil. Vous aviez cru voir des déments. Il y en a dans les rues. Ceux-là pourtant étaient habillés « à la mode de demain ». A la mode que l’on essaye de lancer. Il paraît qu’elle nous vient d’Angleterre et d’Oxford.
Eh ! bien, non.
Non et non.
La bonne forme est trop bonne. Gardons-la. D’une manière générale, les Anglais, même les Anglais sages, veulent sortir du veston trop cambré par ce qu’on nomme le veston droit, un veston dont tous les pans verticaux sont rectilignes. Les Français, au contraire, ont retenu l’excellente idée du veston à taille, à la mode depuis 1904. Il mincit. Il a rappelé les arcs de notre corps, qui étaient oubliés. Qu’on en corrige l’excès et le maniérisme, on aura un chef-d’œuvre exemplaire. Non plus le caprice d’une saison : le choix au moins d’une décade, à quelques retouches près qu’on ne saurait prophétiser. Cette fois, Paris a raison contre Londres.
Le dos est droit, il tombe d’un seul jet. Ce sont les côtés qui marquent une très légère ondulation, parce que tu es un être humain ; tu n’es pas fait comme une idole cylindrique. La jupe sans godets, appliquée sur les hanches. La ligne de l’aisselle à la taille, très ample. Trois boutons, celui du milieu dans le creux de l’estomac. L’épaule est large, elle n’est pas trop haute, elle n’est pas épaisse. Le tout, aisé, souple, d’une bonne grâce fière. Le bord du pantalon est toujours retroussé : peut-être l’un des signes de la révolution précitée.
Un beau pantalon est obtenu par les ciseaux plus que par le fer. Pas tant de mollet, qui est un luxe 1830 aujourd’hui superflu. Un mollet trop fort se placera très bien dans la longueur.
Mis comme cela, tu paraîtras plus svelte, plus digne de la louange que Mme de Sévigné faisait des Français, lorsqu’elle les trouvait « les plus jolis du monde ».
Chacun son bien : cette fleur a été cueillie par Marcel Boulenger.
Dis donc : tâche que celles d’aujourd’hui aient de toi la même bonne opinion. De toi, de ton costume, de ta mine et de ton courage. Qu’elles te sachent prêt à te lever, à bondir sur tes deux pieds, bouclant ta ceinture, s’il faut un jour combattre pour les sauver de la barbarie, elles, et tout ce qui rend notre vie sur cette bulle un peu moins laide, un peu moins basse.
Il t’arrivera d’oublier, de laisser ton chapeau. Tu t’en iras la tête nue l’été, aux champs, quand le soir tombe. Dans la forêt, à toutes les heures. En ville, heu ?… Par exemple, oui, si tu demeures avenue Marceau et que tu ailles par une belle nuit au théâtre des Champs Élysées. Un petit coquetel en passant, chez Francis.
Les années volent. Il n’y a plus qu’un chapeau. Il est en feutre mou.
L’été, le canotier, je pense, ne sera plus jamais très plat : il faut qu’il tienne.
Et si le tube mérite un regret, en dépit de son extravagance, l’affreux melon s’en aille au diable !
On a rapetissé le tube, en attendant. On l’efface, tu le vois bien, on l’atténue. Comme le bicorne de gala en 1830.
C’est que le chapeau mou étant le seul qui convienne à nos mœurs, à notre vélocité, à notre carrure — voilà nos refrains — il se trouve qu’il est plus beau que les autres, plus naturel, plus varié. Quel que tu sois, tu dénicheras toujours celui qu’il te faut. Il faudrait que tu fusses vilain comme les sept péchés, ou mal avisé comme un prédicant de parc anglais.
Celui que l’on porte le plus est entre les deux tailles. Il a sa coiffe très légèrement conique. Les bords, ni grands ni petits, arrondis en général, et souvent baissés par devant. Tu peux adopter toute autre forme qui te plaira, pourvu qu’elle te siée. Ne va pas jusqu’à faire exprès de choisir (par chiqué-contre) un couvre-chef insolemment démodé.
Les fabricants ont tort de chercher des couleurs trop rares, un beige trop clair, quasi blanc, un fauve trop doré, un brun trop rouge, des tons trop rompus ou trop vifs. On raffine de la sorte sur un objet lorsque sa vogue diminue, pour émoustiller. La faveur du chapeau mou étant ce qu’elle est, il est oiseux de prévoir l’an 2.000. Tu alternes un marron qui est d’un café au lait où l’on n’aurait pas versé trop de crème avec un gris mêlé d’un peu de vert. Je ne renonce ni au gris ni au noir francs.
Quel que soit le renom de Locke et son étonnant mérite, tu ne te crois pas obligé d’avoir un chapeau anglais. Il y en a de très bons en France.
Certains initiés, qui avaient un peu trop de joue, savent comment ils ont pu corriger ce défaut. Commence par prendre un chapeau qui ait l’aile assez grande, et ne va pas le percher au sommet du crâne. Non plus, ne l’enfonce pas à t’en rabattre les oreilles. Exactement, que sa circonférence coïncide avec le plus grand cercle de la tête. C’est le principe du secret dont je parlais et que, ma foi, je lâche. Tu mourrais de curiosité. Supposé que ton visage, quand tu l’observes de face, ait plus de largeur d’une joue à l’autre qu’entre les deux tempes. Tu prélèveras un chapeau d’abord trop grand. Puis, tu demanderas qu’on en double le cuir, sur les deux côtés, d’un feutre qui augmente le volume apparent de la coiffe. Si l’on te fait tes chapeaux, comme je te le conseille, tu donnes les mêmes instructions. Avec le canotier de l’été, un système tubulaire… L’œuf de Christophe Colomb, comme tu vois.
Et passons à l’autre extrémité.
M. de C… est un seigneur que nous pouvons imiter.
Il n’a pas les neuf cent soixante-dix ans de Mathusalem. A la veille de la guerre, il était, il paraissait encore jeune. Il était difficile de lui donner son âge, qu’il déclare à présent, avec un reste de cette coquetterie à rebours, la plus aimable de toutes. Les dix ans qui viennent de passer, les plus rapides qui aient jamais fondu sur le monde, les plus romanesques, les plus tragiques, l’ont seuls un peu vieilli.
Mais il reste charmant. Il est merveilleusement poli, amène. Il sait les livres et les tableaux. Lorsqu’il parle d’une ville, il s’y promène ; d’une femme, il a l’air de savourer encore un doux souvenir. Lorsqu’il parle des chevaux, un maître. Et si vous voulez connaître sa propre grâce à cheval, il vous suffira de lire un des beaux romans qu’on lui doive. Car il écrit.
Dans son costume, l’obstination se trahit dans la chemise seulement. Il a la haine du col mou, de la chemise molle. Il y voit une invention du Diable. L’invention de cet être dont le Tintoret de San Rocco ignore s’il était femme ou archange. Partout ailleurs, la fidélité de M. de C… se confond avec la prudence des vrais élégants, qui se transmettent des formes choisies, avec un parfait dédain des vogues. Son veston n’a jamais été trop long ni trop court, son gilet ni trop ouvert ni trop fermé, ses pantalons ni trop larges ni trop étroits. Il est avide d’excellence. Le carreau, même étrange, de ses pantalons, ne l’a jamais fait prendre pour un Anglais.
Un jour que j’admirais sa belle chaussure, il fit d’abord aller son pied au bout de sa jambe croisée, par un mouvement à deux fins, dont l’une était involontaire. Il trahissait le plaisir de l’amour-propre flatté, et comme M. de C… en avait un peu de honte, son embarras fut caché par un air de désinvolture. En même temps il parla :
— Vous devez avoir une quarantaine d’années (je consentis), c’est-à-dire que vous avez vu naître et mourir un grand nombre de modes outrées, sur lesquelles se jetait à l’étourdie une foule sans discernement. Enfant, vous avez dû voir le pied des hommes prisonnier d’une sorte de longue boîte, qui les aurait mis à la torture sans l’excès de longueur de la pointe. Laquelle (j’acquiesçais), selon les années, s’achevait en aiguille ou s’épatait en bec de canard. Immédiatement après, nous vîmes se répandre la chaussure américaine, tordue, courte, obtuse, quasi orthopédique. La jeunesse s’y précipita. La délivrance ! Peut-être avez-vous pris part à cette émeute, enragé de nouveauté comme je vous connais. Les avocats de la chaussure américaine prétendaient qu’elle reproduisait la trace d’un pied mouillé. C’est elle qui a ouvert le règne de la chaussure toute faite. La vague absurde qui suivit éleva jusqu’aux nues la bottine à tige de drap, dont l’empeigne alla se réduisant chaque automne. La pointe était rondelette, le talon oblique et léger, la semelle trop fine : Un pavé inégal, on sautillait. Sa laideur était principalement dans ces lacets noués jusque sur les doigts. Il fallut la guerre pour accréditer une forme meilleure, qui est la seule bonne. Mais l’armistice était à peine signé que les fabricants revinrent aux lubies. On étira la chaussure, on revit ces pointes infernales d’il y a trente ans. Par surcroît, elles achevèrent une semelle dont la torsion était le dernier vestige de l’influence américaine. Et cet accouplement ayant mal réussi, nous voyons poindre une seconde fois la spatule, le bec de canard si disgracieux… Nous sommes pourtant un petit nombre d’Européens, des Anglais en tête, qui avons su demeurer insensibles à toutes ces variations, à ces chimères suspectes, à ces malencontreux engouements. Nous demeurons fidèles au pur type des vieux bottiers. A peu près le soulier du vendangeur assis de Goya.
— Oh ! monsieur, faudra-t-il renoncer ou se perdre ? Le bottier est plus lourd que le percepteur.
— En ce cas, remplaçons l’argent par le goût. L’incroyable progrès de la chaussure toute faite, voilà un événement dont les sociologues de l’avenir seront heureux de posséder la date. Il y a même, sur les boulevards, une boutique qui rivalise avec les meilleurs bottiers. Et ce qu’elle présente est cousu à la main. La bonne forme est modérée, elle est équilibrée dans toutes ses parties. Elle épouse sans affectation la forme réelle du pied, non sa forme mythique. Ni l’empeigne ne s’effondre ni elle ne grimpe à l’assaut. Le grand secret est dans la disposition des pentes, si l’on peut dire. Et il faut que la semelle à son extrémité adhère bien au sol. La pointe ressemble au bout d’une bonne cuiller, tout simplement, avec une petite différence que la cuiller ne connaît pas, entre les deux côtés de l’angle.
— Oh ! monsieur, dis-je encore, vous me pardonnerez d’insister. J’ai peine à admettre que vous ayez porté si longtemps une forme toujours la même. Cela est incroyable car cela est contraire à tout ce que l’on sait du cœur humain.
— Enfant que vous êtes… Pardonnez-moi à mon tour… Le détail changeait, la disposition des piqûres, la hauteur du talon, son inclinaison, l’épaisseur de la semelle, sa tranche, rayée ou non, et son rebord, plus ou moins large ; à la belle saison, la couleur du cuir. Si le drap m’a toujours déplu, nous avions la ressource de la tige en cuir fauve. Si le soulier de couleur champagne a toujours été une vilenie, nos souliers jaunes ont bellement varié du fauve clair au fauve pourpré. Pas de chevreau, jamais, à aucun prix. Sinon verni, pour le soir. Et s’il est vrai que je n’aie jamais accepté l’acajou, (il doit venir tout seul, à la longue, comme la patine d’un meuble), du moins je vous l’accorde. Le chocolat, non : Horrible !… Je vous livre tout. Lorsque j’étais jeune, on cirait encore à l’os. Le domestique empoignait un os de cerf et frottait. Alors le veau rivalisait avec les miroirs. Personne n’accepterait plus ce travail de galérien, mais servez-vous bien de vos crèmes, de vos étoffes, et sur l’embauchoir. Les meilleurs sont en bois. L’essentiel est qu’il en faut. On les glisse, à peine déchaussé, dans le cuir encore tiède.
M. de C… me déclara pour finir qu’il respectait la diversité des générations. Il approuva que mon soulier à grosse, piqûre eût le talon plus massif que le sien, et un peu débordant. Il approuva que ma semelle rejoignît le talon sans perdre aucune épaisseur sous l’arc du pied. Il alla jusqu’à reconnaître que parfois une pointe carrée, pourvu qu’elle fût large et bien conduite… Mais il condamna sans appel les souliers bas portés le jour en hiver, parce qu’ils sont contraires, prononça-t-il presque religieusement, à l’Ordre des saisons…
Lorsque parut dans l’Art vivant la première esquisse du petit portrait que voilà, et qui est en partie imaginaire, le modèle était désigné par l’initiale de son nom.
C’était, hélas ! M. de Comminges, qui fut enlevé trop tôt aux lettres et à l’amitié.
Il a écrit, en se jouant et sous divers masques, des œuvres charmantes ou poignantes, faites pour durer. L’admirable roman auquel je renvoyais tout à l’heure est intitulé la Zone dangereuse et signé Saint-Marcet. Les traités qu’il a consacrés à l’étude du cheval sont incomparables à tous les points de vue.
Il avait un fin visage, allongé, régulier, blondissant, avec la moustache de l’officier de cavalerie, qu’il avait gardée. L’un de ces visages qui paraissent impassibles, et l’observateur découvre en s’étonnant que la finesse, la sensibilité et l’ardeur s’y résolvent, qu’ils reçoivent les impressions de la vie comme un lac celles des cieux.
Il semble qu’elle ait paru au XVIIe siècle, introduite par les Croates au service de France. L’idée a été empruntée à la parure de ces Croates, ou Cravates, nation coquette, ou bien c’est à la fastueuse poitrine de leurs chevaux harnachés à l’orientale.
Les Français eurent besoin d’une cravate lorsque le justaucorps entr’ouvert montra le haut de la chemise, dont il fallut garnir et fixer le col.
Ces premières cravates, Voltaire croyait qu’elles furent toujours de dentelle. Il se trompait. Pour avoir regardé certains portraits, notamment l’un des portraits de Molière, nous savons qu’elles pouvaient être faites d’un ruban.
Et nouées de la même manière — mirabile dictu ! — exactement de la même manière que notre petit nœud du soir, notre excellent nœud carré.
Dans la fameuse salle d’armes de Gand, où l’on tirait déjà au XVIIe siècle, l’un des escrimeurs de ce temps-là, qu’on y admire en peinture, porte, couleur de pourpre, cette cravate pareille à la tienne.
C’est assez parler des origines. Elles amusent l’esprit, il n’en faut pas abuser. Au XIXe siècle, quand l’élégance masculine prit un nouveau caractère, qui effaçait l’éclat, la cravate demeura le dernier asile de la couleur. Mais il faut savoir choisir.
Il est un lieu commun, celui de la discrétion. Louable en soi, il est malheureusement d’une application difficile. Il ne suffit pas de s’abstenir. Le goût qui cherche refuge dans le gris avoue son impuissance. Il se démet. Le XIXe siècle a eu tort, qui donnait à ses tableaux, en les peignant, à ses mobiliers dans leur neuf, la patine ou la crasse ou la pâleur des années.
Un de mes amis s’avisa dernièrement de vouloir une cravate rouge. Il l’aurait choisie d’un rouge sombre. Il l’aurait nouée en forme de plastron.
Voilà trois ou quatre ans que des raffinés essayent de remettre en vogue le plastron. Et c’est inutile. La régate !… Nos contemporains n’en veulent pas démordre. Son empire est tel qu’elle y a perdu son nom particulier, comme les rois de France : son nom de régate que l’on ne sait plus. Elle semble devenue la cravate par excellence.
Mon ami voulait donc un plastron rouge, et parce que la boutique n’en avait point, le commis se donna un air de hauteur. Par un excès de générosité, ou par respect humain, mon ami ne voulut pas citer Baudelaire, qui porta, sous l’habit noir de son temps, une cravate sang de bœuf. Il rappela seulement qu’un plastron rouge était la cravate d’Huguenet dans Papa et celle de Jules Berry dans la Duchesse et le Garçon d’Étage. On lui répondit que c’était, par conséquent, une cravate de théâtre.
L’homme qui parlait ainsi tenait dans ses mains des cravates dont la rayure violente criait comme une pierre sous la scie. L’habitude l’empêchait de les entendre.
La morale de cette anecdote est qu’il faut distinguer la discrétion véritable de la discrétion conventionnelle, pour mépriser la seconde et rechercher passionnément l’autre. Un rouge peut être le plus discret du monde. Par un avantage inestimable, si votre chemise est blanche, ou si le rouge, ou si le gris, ou si un certain bleu y domine, votre cravate rouge ira presque avec tous vos complets. Au lieu que la cravate noire, si séduisante en principe, est en réalité d’un emploi tout à fait périlleux.
Il va sans dire que notre cravate est fonction aussi bien du linge que du costume. Mais attention. Il ne s’agit pas d’appareiller le tout avec une rigueur monotone. Soit une cravate à deux tons, et l’un de ces deux tons qui domine. Tu n’espères pas trouver la même chaussette. La rencontre d’ailleurs n’aurait pas grand intérêt. Il suffira que ta chaussette ait l’un des deux tons. Si elle est bigarrée, elle les présentera dans l’ordre inverse : celui qui domine la cravate décorera la chaussette. Ou réciproquement. Ayant une chemise à raies vives, tu as soin d’exclure les cravates de fond uni à dessins trop effacés. A plus forte raison les cravates qui contrediraient ces rayures. Tu as la principale couleur de ces raies, dans une nuance plus sombre, de la même gamme, ou tu as une combinaison — rayure, carreau — apparentée à la combinaison des raies.
Il est impossible d’en dire plus. Trop d’éléments sont en jeu. Il faut laisser intervenir, dans les cas particuliers, les décisions presque inanalysables du goût. Il en est ainsi dans l’amour ; tu n’aimes pas une théorie, tu aimes un être vivant.
Pour succéder aux combinaisons des rayures espacées sur un fond uni, des carreaux très compliqués ont vu le jour. Les éclaireurs de la mode l’avaient pressenti depuis longtemps. Heureux Picasso ! Heureux cubistes ! Leur influence est allée jusque-là ! L’écossais classique, que l’on essaya d’abord, n’a pas réussi, et c’est dommage. Une autre belle idée est de certaines fleurettes répandues sur un fond rare et dense. Mais ils tentent aussi des ramages extravagants, qui font pitié…
Comme on a tort de parler trop vite ! Même ces ramages peuvent être jolis, à l’occasion. Il suffit d’un pour nous ravir.
Du temps de Balzac, il y avait plus de cent manières, disait-on, de nouer une cravate. Mais ce texte m’a toujours trouvé sceptique. Il devait confondre le genre et le cas, le nœud proprement dit avec les innombrables dispositions des coques.
En tous cas, nous n’avons plus que trois formes, qui sont la régate, le nœud carré, le plastron.
Dans la plus lointaine contrée, la cravate à bague a disparu.
Tout le monde sait faire une régate. Tu ne saurais pas nouer une régate, tu en serais à l’acheter toute faite, enroulée à une âme en celluloïd, tu ne me lirais pas. La régate actuellement n’est pas creuse et soufflée. Elle n’est pas, non plus, étranglée entre le pouce et l’index. Elle est massive, assez petite, très régulière.
Il serait dommage que le nœud carré se perdît. L’opération se fait en quatre temps.
Le premier mouvement fait glisser un pan sur l’autre.
Dans le deuxième, tu replies l’un des deux côtés, tu dessines la coque inférieure.
Dans le troisième, tu dessineras le nœud : le pan supérieur est passé dans la boucle du pan inférieur (il faudrait une gravure).
Ici un abîme s’ouvre, qui sépare deux âges. Nos aînés achevaient le nœud en mettant dans la boucle le pan supérieur, qu’ils repliaient en coque à cet instant. Nous procédons d’une autre manière. Nous tirons tout à fait, nous dégageons ce pan supérieur. Et c’est pourquoi nous avons un quatrième mouvement.
Il consiste à rabattre le pan supérieur, à le couler.
Après quoi, ayant serré, bien serré, il ne reste plus qu’à marquer ton inflexion personnelle.
Marcel Boulenger, l’un des princes de sa génération, ou Maurice Wilmotte (gourmand fameux) veulent que les deux coques aient un air léger, quasi vaporeux.
Nous nous accordons en général à les vouloir pleines, quasi rigides. Mais les uns, comme Jean-Louis Vaudoyer ou Georges de Traz (François Fosca) les veulent rigoureusement horizontales. Et d’autres les penchent, les inclinent plus ou moins. Chacun de son côté, Louis Süe et mon meilleur ami (ou mon pire ennemi) ont fait plus : ils impriment à l’une des coques, une fois l’œuvre achevée, une torsion. Tout cela est difficile à exprimer. Voyez les personnages du Divan, dans le tableau de Klingsor.
La désuète lavallière est un cas particulier de nœud carré.
Autre cas particulier. Tu choisis une cravate très courte et tu la noues d’un seul trait, les deux pans élargis en ailes de papillon. Là, il n’y a point de coque. Trop régulier, l’objet serait nigaud : irrégulier, il est parfait. C’est ce que les jeunes gens préfèrent le soir avec le smoquin. Bernard Grasset, qui le porte dans la journée, lui donne un tour charmant.
Et parlons du plastron.
Pour faire un plastron, il faut une cravate à deux larges pans égaux.
Elle se noue en trois mouvements. Le premier est le même que pour le nœud carré. Dans le second, les deux pans sortent l’un à gauche, l’autre à droite du nœud. Par le troisième, les deux pans sont rabattus l’un après l’autre sur le nœud. Épingle.
Un raffinement que Barrès aimait beaucoup : l’on peut masquer tout l’ensemble par le pan qui est rabattu en dernier lieu. Ton plastron ne semble plus fait que d’une seule grosse coque d’un seul tenant.
Une cravate doit être fraîche comme une fleur. — Par conséquent :
1o Tu l’as payée un bon prix.
2o Tu la laisses reposer. Tu ne portes jamais la même deux jours de suite. — Tu n’aurais qu’une corde à la fin de la semaine.
3o Tu la fais quelquefois repasser. C’est le plus délicatement possible, sous un linge humide.
4o Tu es adroit. Tu ne recommences jamais.
5o Tu en fais don au premier signe de fatigue.
L’épingle est pour ainsi dire abolie. Le fixe-cravate tout à fait, à moins que, tu ne doives, pour une raison quelconque, courir en bras de chemise. Alors tu peux en user à la rigueur. Mais plutôt passe ta cravate dans ta chemise, — en ce cas-là seulement — entre les deux boutons. Ou n’aie point de cravate, mais une chemise exprès. Une épingle à sujet est impossible. Avec leur intolérance fanatique, les jeunes gens te mépriseraient. Ils n’admettent qu’une perle, ils n’admettent qu’un tout petit brillant, et préfèrent de s’en passer. L’épingle de nourrice en or a été bannie par l’épingle de même forme que nous portions naguère au col. Aujourd’hui que le col mou se passe d’épingle, tu pourrais repiquer dans le pan de ta régate cette belle nourrice tout unie, qui convient si parfaitement au siècle de l’auto.
Depuis quelques années, la simplicité est allée à pas de géants. Divine simplicité.
Maurice Martin du Gard a résolu le problème de l’épingle par une inspiration géniale. Il porte à sa régate une boule de métal précieux qu’il tient de son grand-père.
Commence par un exercice de l’esprit. Tu vas comparer deux hommes en léger appareil.
Ton contemporain a sa chemise molle assez étroite. Il a sa culotte de joueur de ballon. Sa chaussette est tendue. Elle est comme peinte sur la chair. S’il a évité la bigarrure, si la chemise et la culotte ont la même couleur, ou si tout est blanc, si la jarretelle est en harmonie avec le reste, et la chaussette avec la cravate, tu ne déconcerteras pas Psyché en te révélant. Voilà le point : il ne faut pas déplaire à Psyché. Tu sais, Psyché… Une curieuse, qui soit encore innocente. Tu es perdu si tu la fais rire.
Et l’autre ?
Il avait, il y a vingt ans, son torse enveloppé d’une vaste toile blanche partout bouillonnante, et empesée, raidie en manière de carcan. L’idée d’une cassure qui pouvait gâter son plastron lui était un supplice. Les deux jambes flottaient dans un falzar dont il fallait que les cordonnets, en les nouant sur la cheville, retinssent une chaussette rebelle. Allons ! ce n’était pas de jeu.
Les filles d’Ève ont peut-être cessé de railler les fils d’Adam. En tous cas, les fils d’Adam ont cessé, encore imberbes, de trembler devant les filles d’Ève. Ce curieux phénomène a certainement un grand nombre de causes. La révolution du costume masculin n’y doit pas être étrangère. Observe donc ce gosse avec sa bien-aimée, ou, comme il dit, sa chiquette, — de l’espagnol chica, petite : chiquita au diminutif. Elle joue l’assurée, mais il n’a pas peur. Tous deux se mesurent du coin de l’œil comme deux athlètes égaux entre les cordes. Oh ! Conseille-lui de n’être pas féroce. Qu’il soit gracieux et gentil. Finalement, n’oublie pas de le féliciter. Son calme. Sa tenue. Tout ce qu’il a de magistral dans son jeune cœur et dans son costume.
Tu refuseras une chemise trop longue. Un homme est ridicule lorsqu’il paraît entre les deux pans inégaux d’une immense bannière. C’est alors (je précise) que la pauvre Psyché s’étonne. Où donc est-il écrit, en quel livre, que ses beaux songes dussent avoir une telle fin ?
Tu refuseras une chemise trop large. On ne parvient pas à comprendre pourquoi les chemises toutes faites ont encore cette ampleur, comme si tout le monde était obèse.
Ta manche, non plus, n’a pas cette forme de jambon, nous sommes d’accord. Pareillement, tu as ôté toutes ces fronces qui foisonnaient depuis le XVIe siècle. Tu n’écouteras pas un chemisier borné. Il te dit que la chemise française, c’est-à-dire fermée, en a besoin. Mais ce n’est pas vrai, il se trompe. Une routine qu’il a.
La chemise molle a disparu avec l’habit. Et s’il la faut dure, qu’elle soit alors ouverte. Là, les Anglais ont raison. Avec le smoquin, j’approuve le petit nombre d’obstinés qui luttent contre la cuirasse. Il suffit bien que le col soit empesé. C’est une idée d’Iroquois de compter l’élégance à la gêne.
On a inventé une nouvelle chemise qui a sa manchette nouée autour du poignet par deux boutons. La coupe en est très difficile. Il faut demander à Charvet le modèle que porte Jacques Hébertot. Sacha Guitry, dans son intérieur, en a une autre, dont les poignets sont tels, légèrement évasés, qu’ils se passent de bouton. Ils sont fixés en haut, à leur base.
Nouvelle preuve que les poètes classiques avaient raison de distinguer deux vocabulaires : Psyché t’admire dans ta culotte en forme de trapèze. Dans ta culotte, non dans ton caleçon.
Les robes de chambre sont magnifiques, les pyjamas somptueux. Salut, princes et maharadjas ! L’homme qui est simple dans la rue, et se couvre chez lui de ces soyeuses splendeurs, n’est pas un bête.
Dans les chaussettes de jour, tout ce que tu voudras, pourvu que l’harmonie soit sauve, je te l’ai déjà dit. Tu devras tenir compte même du teint de ta peau. Tu n’es pas obligé, en grande toilette, au noir des croque-morts. Un vert bouteille. Un rouge sombre.
La fureur du moment, pour le linge, est aussi le carreau. Seelio, à l’Exposition, le donnait très fin. Seeligmann avait une chemise jaune à carreau violet, le chiffre sur la manche. Noir et gris dans le sens vertical, orangé dans le sens horizontal. Le quadrilatère de Hayem alliait le faste à la modération. David échappait à la double fatalité de la rayure ou du carreau par un arrangement de courbes légères, des arcs, sept ou huit à la fois.
Ces rayures qui persistent ont d’ailleurs été multipliées, enchevêtrées de manière à couvrir entièrement le fond. Puis, ce sont les carreaux que l’on violenta. On est allé jusqu’au losange. On est allé jusqu’au parallélépipède ombré. Attention !
Rien n’est plus joli qu’une chaussette imprévue. Tu ne diras pas le contraire. Tu es même capable d’agréer dans la chaussette, l’un de ces divertissements cubistes. Ils sont spirituels. La difficulté commence lorsqu’il s’agit d’appareiller tous ces divers carrelages. Sans compter celui du costume, qui ne sera plus l’antique et éternel pied de poule, ni les barbares et savoureux carrés anglais, mais, ton sur ton, une assez laborieuse marqueterie. Essayez de mettre tout cela ensemble ! Le carreau, décidément, doit rester une exception, une rencontre. Il ne peut devenir une habitude. Tu ne peux pas te nourrir de pikles !
Ton mouchoir est blanc à coup sûr, et assez vaste. L’été seulement, tu l’as pareil à ta chemise, lorsque celle-ci est d’un rose, d’un bleu, d’un jaune uni. Le mouchoir de soie, la pochette, non. Tu ne l’aimes guère. Il y a contradiction. En fil pur.
(En fil pur… Pour nous faire admettre dans le reste du linge un coton mieux travaillé qu’autrefois, on nous a parlé des révolutions russes, qui ont fabuleusement élevé le prix du fil. Mais on a bien su nous tenter au moyen de la soie, qui n’est pas donnée ! Si bien que nous ne cherchons plus à comprendre. On nous a dit aussi que le fil était froid dans nos climats, et que les tisseurs avaient appris à bien marier le fil et le coton, enfin qu’il ne s’agissait ni des cols ni des draps… Adieu donc ! beau fil d’antan, fil éclatant, beau fil de glace, orgueil des dimanches rustiques !)
Et ton col, à présent : la tête y repose, ta destinée en dépend.
Un col double mou doit tenir par sa propre vertu. Par la coupe, non par une épingle. Secret : qu’il ne paraisse jamais trop bas. Autre secret : l’angle des deux pointes sur le poitrail ne doit pas être trop aigu, ni ces pointes trop longues, — les grands ouvriers le dédaignent. Lorsqu’elles sont inégalement brisées par le contact avec la poitrine — à tête baissée — ou si l’une d’elles s’incurve, par hasard, comme une coquille convexe, tu as un chef d’œuvre.
Le col cassé a volontiers ses deux triangles qui vont chercher quasi l’oreille. Beaucoup le portent un peu bas. Tu l’aimes assez haut ; il est plus digne. Écoute encore un secret. Je t’en dis beaucoup. Sache éviter les trop grandes cassures trop ouvertes. Cela est de mauvais ton. Le triangle ouvert où ton menton repose étant un triangle isocèle, il vaut mieux que les cassures, de part et d’autre, soient deux triangles rectangles.
Je suis chinois, je suis tâtillon, je suis algébrique. Mais il le faut bien. Autrement, ce n’est que phrase vaine…
Le dernier secret d’une chemise irréprochable est dans l’encolure. Lorsqu’elle est trop décolletée, elle est affreuse. Il y a un homme, dans Paris, réputé pour son élégance, et qui l’ignore. Je pourrais le nommer. A quoi bon ? Je suis tout charité. Tu le vois bien, toi : qui me lis, mon frère, qui que tu sois. Te voilà peut-être un peu plus fort, moins démuni, devant cette Psyché qui a presque la même rigueur, la même inclémence que la nature.
Une canne est un jonc, un rotin, un bâton. Il faut le savoir : on sera gardé de certaines fantaisies outrées.
Une canne est une branche coupée.
Le règne unique, la tyrannie des cannes droites a pris fin.
Une canne droite, c’est-à-dire coiffée d’un pommeau ou se terminant par une mailloche, une canne droite peut embarrasser, lorsque les mains ont à faire. Une canne dont le bois s’arrondit en crosse est assurément plus commode. On l’accroche à son bras. Tu t’en vas d’un pied léger.
Mais quand la mode dessinera le mouvement inverse, lorsqu’elle tendra à repasser de la canne recourbée à la canne toute droite, nous ne manquerons pas non plus d’arguments pour justifier le nouveau point de vue. Allons, ne t’effraye pas. Où le sophisme aurait-il bonne grâce, sinon là ?
Aujourd’hui, contente-toi de doubler le nombre de tes cannes. Il faut en acquérir autant de courbes que tu en avais déjà de droites. Il n’est pas encore question de convertir ces dernières en objets de vitrine.
Le principe qui prévaut est le suivant. On prend une canne recourbée pour la ville, pour la promenade, et une canne droite, le soir.
A ne considérer que l’utile, il serait plus adroit de faire tout juste le contraire. Tu marches plus allègrement avec une bonne trique à la main, d’une seule venue, droite comme un I et redoutable comme la justice. Le soir, il te serait plus facile d’avoir une canne à suspendre à ton bras, pendant que tu assistes la dame qui descend de voiture, ou que l’on vous détrousse aux guichets d’un théâtre. Mais l’utilité n’est pas notre seule loi, par bonheur. La canne recourbée, le jour, qui nous paraît plus familière, et la canne droite, le soir, qui nous paraît plus cérémonieuse, s’accordent mieux avec l’état présent de notre sensibilité.
Je note vite une exception.
Supposé que tu marches… Tu ne passes pas, je suppose, les beaux mois de l’année dans l’indolence… Tu auras, si tu marches, les trois cannes à écorce, qui sont avec les rotins, les joncs et les bambous, les cannes par excellence. Elles nous rendent une pureté agreste. Le frêne, pâle comme les yeux de Minerve ; le noisetier doré ; le sombre et odorant merisier. Soit qu’il te plaise d’avoir au bout du bras une sorte de balancier, soit pour frapper de temps à autre une motte ou un caillou, ne vas-tu pas préférer que tes cannes à écorce soient droites ? Le frêne, pareil à une svelte massue ; le merisier, avec sa racine amusante : et le noisetier, donnant tout seul une belle mailloche.
Il n’y a pas plus belle petite canne d’été. Si tu as l’humeur guillerette, tu pourras y joindre quelque lisse et nerveux piment. Si tu as l’humeur étrange, quelque bambou de Madagascar, en tirant parti de sa racine fantastique.
Le printemps et l’été, tu laisseras tranquilles la sanglante amourette et l’ébène mouchetée (l’ébène unie, tu l’as rangée, elle n’est plus possible). Tu laisseras tranquille l’or, l’écaille, la corne des pommeaux. Ce faste est pour l’hiver. A suspendre à ton bras, tu auras un jonc, qui n’a besoin d’aucune parure. Tu en auras deux, pour jouir des deux tons, l’un couleur de miel, l’autre presque de pourpre. Tu alterneras selon l’heure, selon l’éclat du jour, selon la robe de ta belle. A tes joncs droits, une capsule, rien de plus.
J’avais oublié de dire que le frêne est particulièrement agréable au bord de la mer, surtout s’il y a de l’ombre dans le pays, s’il y a des bois. Le noisetier fait bien sur la route. Le merisier, c’est avec l’Automne.
Paie-toi (veinard) une canne en rhinocéros. En bélier, qui est aussi bien, il t’en coûtera une trentaine de louis. L’un et l’autre sont délicieux au clair de lune, ou dans le bleu des lampes et des arbres, sous les violons de la terrasse. Le rhinocéros vaut deux cents louis quand il est sans défaut. O les joncs innocents, les joncs virgiliens !
Si tu es curieux de poignées rares ou précieuses, je te signale les crosses en bois de cerf d’Antoine, les lézards et les galuchats du même, et ceux de Delpeuch, ceux de Degobert. Je ne sais plus où — mais à l’Exposition — j’ai vu certaine béquille parallélépipédique, en galuchat à filets d’ivoire. Belle d’ailleurs, mais redoutable.
Les clous d’or des sceptres d’Homère et les ciselures du Roi Soleil ont cette postérité.
Quant au parapluie, c’est bien simple.
Dis-moi si tu as envie de ressembler aux hommes que l’on voit, qui portent un parapluie ?
C’est un appareil dont l’Occident a voulu se passer durant des siècles. Il connut, il pratiqua quelquefois le parasol. Il omit ou dédaigna le parapluie.
Cette guerre terminée, que certains crurent témérairement la dernière de toutes, le petit toit d’étoffe, la petite pagode ambulante, parut un signe trop lâche et prosaïque. On a un chapeau (dont le vrai feutre nargue les cataractes). On a un manteau (qui braverait le Niagara). On n’a pas un parapluie.
Le tien, dans sa gaîne, était une mailloche en noisetier. Tu en avais un autre, d’une belle soie enroulée à un gros jonc massif. Tu en étais incroyablement vain. Allons, on te le permet quelquefois.
… Tu éternues à la première pluie du printemps. A tes souhaits ! Et que l’été qui vient soit beau. Il y a si longtemps.
Dans les beaux jours, tu liras les Stances de Moréas, et si le ciel était gris, pareillement.
Ce n’est pas toi, mon cher ami, même si tu as tiqué tout à l’heure devant cette expression, parce que tu n’as pas lu Molière.
La Petite Oie, c’était tout l’ornement, la décoration du costume : les canons de la jambe, le jabot, la dentelle des manchettes, les rubans de la veste… Notre costume n’en a pas.
La cravate… Peut-être les gants. La cravate et les gants sont les deux vestiges de la Petite Oie. Si tu as l’amour des couleurs vraies, la cravate est le seul point où tu pourras le satisfaire. Pour tes gants, tu les prends toujours larges, à ôter presque d’un seul coup. Il ne faut pas que tu en paraisses embarrassé, il ne faut pas qu’ils encombrent la vue de ton prochain. Veille à la rotondité du bout des doigts. Tannés, choisis-les un peu plus fauves, un peu plus rouges qu’on ne voudra te les donner, en prenant garde à la nuance de ta chaussure. Tu aimes aussi, pour alterner, ce renne sans égal.
Il est pourtant commode de ranger sous ce vocable de la Petite Oie, à défaut d’un autre nom, un certain nombre d’objets qui complètent notre semblant : la canne, le briquet, le porte-cigarettes, le portefeuille, la bague, l’épingle, la jarretelle, la ceinture, les bretelles (si tu en portes encore, comme je te le conseille, avec l’habit et le smoquin, et elles seront noires ou grises, avec des initiales assorties à la chaussette.)
La canne avait droit à tout un chapitre. Pour l’épingle, reviens au chapitre de la cravate.
Le portefeuille est un porte-billets. En le choisissant, tu dois penser à ton porte-cigarettes.
Avec ou sans pierre, la bague ne peut être qu’une chevalière. A moins que tu ne possèdes une merveille ancienne d’une autre sorte, mais sobre, ou que tu te sentes capable d’un miracle.
Point de mièvrerie dans le briquet. Le petit briquet à torche est bon. Le briquet de l’armée anglaise, meilleur ; et si tu peux l’avoir garni de galuchat…
Les pipes françaises valent bien la Dunhill, mais la Dunhill est un bijou d’un fini incomparable. On est obligé de l’avouer. Seulement toute armature métallique, quelle qu’elle soit, et même nettoyée chaque fois à l’alcool, rend la pipe plus forte.
Ta ceinture a deux centimètres de largeur. Elle est en daim sombre. Et va chez le sellier. Il t’en fera une bonne, dont il te montrera le cuir.
Ta jarretelle est d’un seul trait qui se referme sur lui-même comme un serpent.
Tu rencontreras des porte-cigarettes d’argent vastes comme une pelle, ou réduits à la taille d’une petite boîte. Ceux que j’aime sont en cuir : maroquin pour le soir, porc ou vache, — mais foin du crocodile, avec ses écailles galeuses. Hermès en fait deux entre lesquels il est exactement impossible d’opter. Ils sont royaux. Il n’est pas facile non plus de les dépeindre. L’un ressemble à un porte-monnaie plus ample. Il a un dessus qu’on rabat et qui passe sous une bande. Il ferme ainsi. L’autre, quand il s’ouvre, peut prendre la forme d’un chevalet, et on le pose. Le fauve ou le rouge de ces peaux est à crier d’admiration ou à tomber en rêverie.
Ton bagage excite les mêmes troubles moraux, ton porte-habit, ton nécessaire, ton « sac de chasse ». Tout cela, bien fauve, c’est le mieux. Dans le fourgon, une malle-armoire mais qui reste maniable. Si tu as une auto, la malle à valises superposées. Tu ne seras pas obligé de tout défaire à l’étape.
Tu as la tête bien coiffée. Pas d’artisterie. L’ordonnance est toujours aux cheveux rebroussés et serrés. Si tu as voulu garder ta raie, tu imprimes du moins à tes cheveux une direction générale de trois quarts, d’avant en arrière. Ton parfum est frais et vigoureux. Pierre de Trévières a marqué un jour que nous devions sentir le bois de teck, le miel, le tabac anglais, le cuir de Russie, et non plus les fleurs. Il a même donné dans un numéro de Monsieur — la formule de l’un de ces mâles parfums, au moyen du dimethylhydroquinone. Si tu l’essayais ?
Que la gymnastique, enfin, te garde fort, te garde mince… Sache vivre.
Et laisse-moi signer, ma foi, en toutes lettres. Puisqu’un Balzac, puisqu’un Stendhal, puisqu’un Bourget se sont plu à ces objets réputés frivoles, ni toi ni moi n’en serons déshonorés.
Cependant, lis encore mon épilogue.
Au XIXe siècle, grand fait nouveau, l’élégance est transformée en dandysme.
Les nouvelles formes du costume sont choisies beaucoup moins en vue d’embellir que dans l’intention d’étonner.
Pour la première fois — du moins en France, et du moins depuis la fin du XVIe siècle — une forme bizarre et même extravagante sera adoptée, à cause précisément de son extravagance. Insolente réplique, véritable et beau défi de l’esprit artiste à l’esprit bourgeois, et de l’esprit aristocratique persécuté à l’esprit de nivellement.
Le premier phénomène de caractère dandy est présenté en France par les Incroyables, qui donnent à leur cravates l’apparence d’un goître, à leur collet, l’enflure d’une bosse.
Le second phénomène dandy a pour auteur Napoléon. Cet empereur a inventé un costume — la redingote grise, le chapeau lunaire — qui n’a jamais été porté par personne.
Passent les années. Tout le monde s’évertue à qui paraîtra le plus singulier, dans le criant gilet, la tumultueuse cravate, ou le déconcertant chapeau. Mais il n’y a pas de trouvaille baroque qui ne soit à l’instant accueillie et reproduite. L’invention d’un fou, qui fut lapidée dans les rues de Londres, à savoir le tuyau de poële ou chapeau haut de forme, a régné tout un siècle sur l’Europe.
Celui qui, le premier, imagina de se tirer d’affaire par la simplicité, ce fut — après Brummell — le merveilleux Baudelaire. Puisqu’il était impossible de retrouver le faste de l’ancien costume, il se mit à raffiner sur l’habit noir. Lui aussi, dans sa jeunesse, il inventa un costume : il avait un étroit pantalon noir qui découvrait, sur le soulier éclatant, la blancheur du bas. Là-dessus, par une idée de son génie, une blouse de paysan. Oubliez que c’est une blouse : il n’y a pas de forme plus élégante. Et la tête nue, ce précurseur ! D’ailleurs propre de la tête aux pieds, fourbi comme une baïonnette.
Plus tard, seconde invention. Baudelaire adopte son froc, le célèbre froc, sorte de raglan ou de sac qu’il porta fidèlement, comme un uniforme.
Mais toi-même, est-ce que tu veux inventer ?
Tu penses d’abord que non, que tu n’as aucune obligation de cette espèce, que tu portes tout simplement le costume de ton époque. Même les peintres, ils ont tous renoncé à s’affubler. Tu les approuves. Rien n’était plus absurde au monde qu’un rapin. Toute son originalité consistait à garder les cheveux et le pantalon de 1850. Avec son linge dérobé, sa barbiche ou sa barbe, il était naïvement archaïque. Et il drapait ! Aujourd’hui, tout le monde se tient aux grands préceptes : que chacun doit paraître ressembler à tous (Balzac dixit), et que les convenances extérieures doivent être respectées (Baudelaire). L’accent et l’air de la personne se trahissent désormais par des riens : l’inflexion d’une cravate, le pli d’une mèche, l’imperceptible variation d’une coupe.
Voilà, nous y sommes. Ces riens sont d’un grand prix. Balzac complétait ainsi le précepte que je rappelais à l’instant : avoir l’air de ressembler à tout le monde ; ne ressembler en réalité à personne. Et ce détail, cette goutte d’eau, cette ombre par où l’homme fin se distingue de la tourbe, nos contemporains le cherchent à qui mieux mieux. Le chandail de Picasso et de Mac Orlan ; les admirables revers de Jean-Louis Vaudoyer ; les complets toujours clairs de Guy de Pourtalès ; le bleu constant de Jacques Boulenger ; le miraculeux faux-col de Jacques Blanche, aux deux pointes roulées, et son veston exemplaire, dont il garde exprès la manche assez large, et sa cravate de lord, à pois blancs. Hier, la mèche de Barrès…
Ou regarde Foujita, le plus hardi de tous.
Il ne s’est pas déguisé en Européen. Il n’a point voulu du linge dur. Il n’a pas essayé d’ouvrir une raie bien sotte dans la calotte de sa chevelure, ni de la rebrousser. Non ! Il a laissé ses cheveux sur le front, comme le roi de Rome dans le portrait de Lawrence, mais ce sont cheveux d’Asie, noirs comme l’encre, égaux comme les dents d’un peigne. Il ne voulait pas garder sous notre ciel la robe gênante de son pays. Encore moins prendre un veston trop sec. Émule de Baudelaire et de Napoléon, le seul moderne avec eux qui ait su trouver un costume nouveau, entièrement personnel et entièrement heureux, ce grand artiste a imaginé une sorte de blouse souple et croisée, peu flottante, dont la couleur est d’un beau bleu de papier buvard. Elle est serrée à la taille sur une chemise à grands carreaux vifs. Et le pantalon est relevé sur un soulier à semelle forte… La seule invention d’un tel costume méritait déjà la gloire.
| Exorde. — Aux Enfants de Ronsard | |
| L’abandon des vêtements à taille. — Combat du Smoquin et de l’Habit | |
| Les Complets. — Règne du Veston et sa forme | |
| La Chaussure et le Chapeau. — M. de Comminges | |
| La Cravate. — La choisir et la nouer | |
| Ta Chemise. — Ou prends garde à Psyché | |
| Les Cannes. — Et leur Façon | |
| Les Gants. — Et la Petite Oie | |
| Épilogue. — L’Inflexion personnelle |
Il a été tiré de cet ouvrage, le troisième de la collection “A LA LAMPE D’ALADDIN” 1 exemplaire unique sur vieux Japon portant le no 1. 20 exemplaires sur papier du Japon, numérotés 2 à 21. 40 exemplaires sur papier Madagascar, des papeteries Navarre, numérotés 22 à 61. 300 exemplaires sur papier vergé baroque thé, numérotés 62 à 361. Il a été tiré en outre, 35 exemplaires sur vergé baroque crème, numérotés en chiffres romains I à XXXV, réservés à M. Herbillon-Crombé, libraire à Bruxelles.
Exemplaire No
Achevé d’imprimer le 29 Juin 1926 sur les presses des Artisans Imprimeurs, sous la direction technique de F. Lefèvre, 23, rue de la Mare, à Paris (XXe), pour les Éditions de la Lampe d’Aladdin, P. J. Aelberts et M. Dethier, directeurs, 14, avenue Reine Élisabeth à Liège, Belgique.