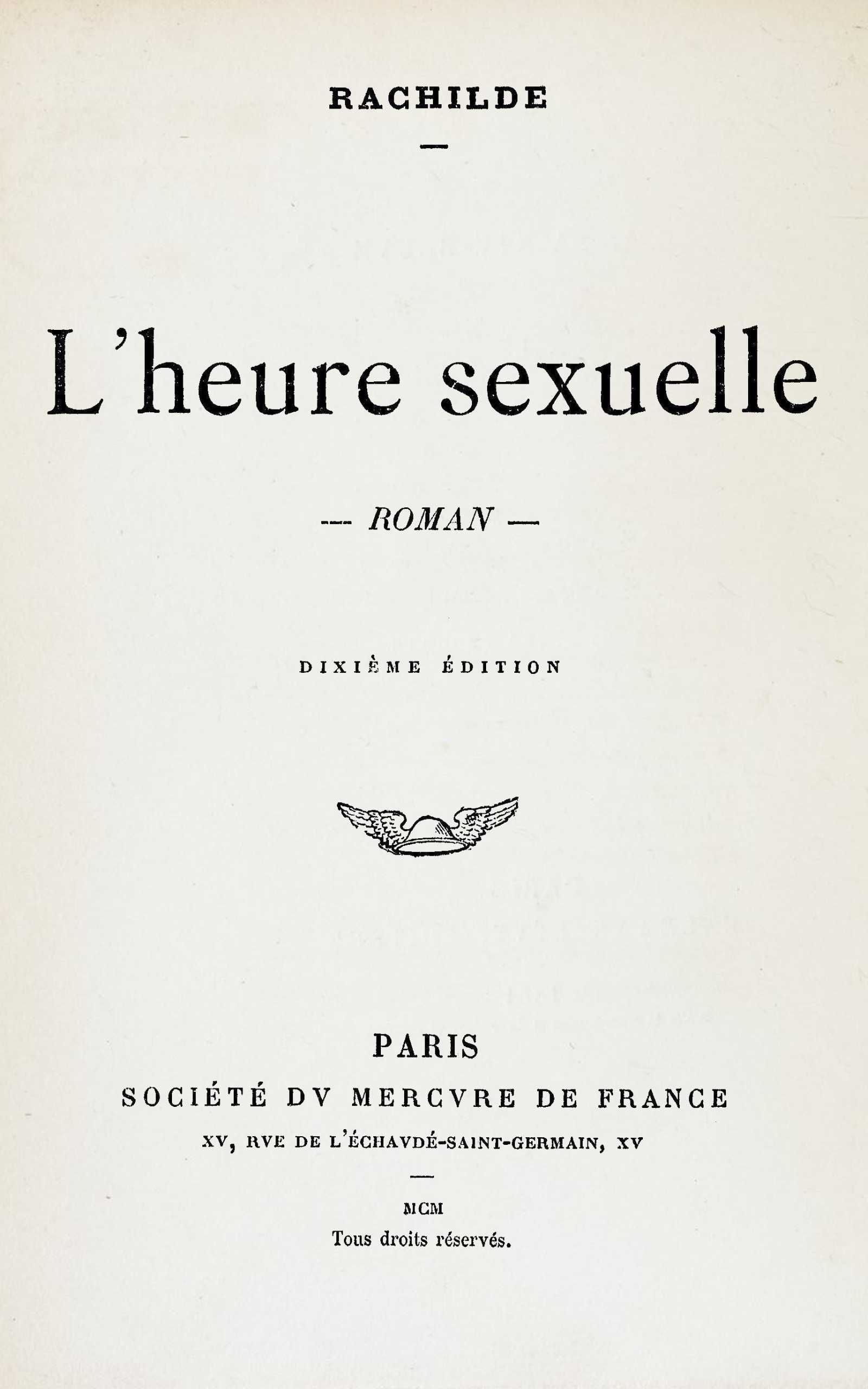
Title: L'heure sexuelle
roman
Author: Rachilde
Release date: November 27, 2025 [eBook #77358]
Language: French
Original publication: Paris: Mercure de France, 1900
Credits: Laurent Vogel (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))
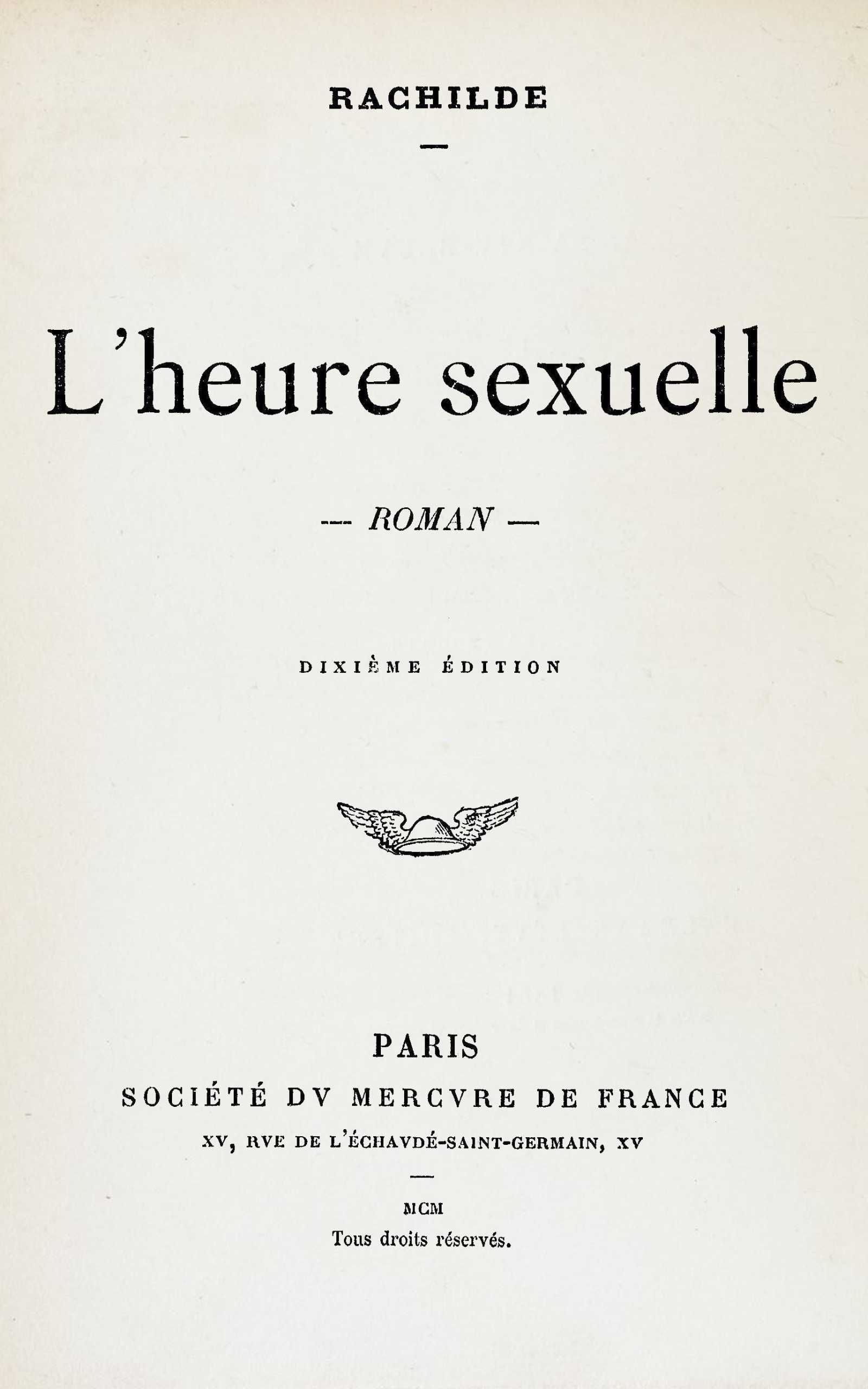
RACHILDE
— ROMAN —
DIXIÈME ÉDITION
PARIS
SOCIÉTÉ DV MERCVRE DE FRANCE
XV, RVE DE L’ÉCHAVDÉ-SAINT-GERMAIN, XV
MCM
Tous droits réservés.
DU MÊME AUTEUR :
| L’Animale (3e édition) | 1 vol. |
| La Princesse des Ténèbres (3e édition) | 1 vol. |
| Les Hors-Nature (5e édition) | 1 vol. |
| La Tour d’Amour (4e édition) | 1 vol. |
| La Jongleuse (5e édition) | 1 vol. |
| Contes et nouvelles, suivis du Théâtre | 1 vol. |
JUSTIFICATION DU TIRAGE :
Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays y compris la Suède, la Norvège et le Danemark.
Une heure sonne.
Une heure du matin.
Cette heure tombe sur moi, féroce et rouge comme une goutte de sang.
Je me lève. Je ne peux plus dormir. Quelque chose est mort ou quelque chose est né. Très épeuré, je regarde autour de mon lit. Quelque chose est né ou quelque chose est mort. Je veux repousser le rêve avec ma couverture, sortir de mes draps comme d’un linceul désormais inutile.
Je veux vivre.
Je veux vivre, c’est-à-dire prendre le rêve à la gorge.
Debout, mes pieds semblent glisser sur un métal chaud et leur réalité ne refroidit pas ce qu’elle touche. J’aperçois des objets fort connus qui me paraissent inconnus. Une flamme douce lèche l’or des cadres et la paume de mes mains. Un peu de vapeur fuse des glaces et j’ai les yeux pleins de larmes.
Je dois avoir trop travaillé ces temps-ci.
La saoulerie des phrases me monte à la tête. Je ne suis plus capable d’analyser des actes pour le seul plaisir de l’analyse, et les moindres gestes vont m’étonner, me pénétrer du surnaturel de l’existence, pourtant si banale.
Banale ? Ce n’est d’ailleurs vrai que pour les imbéciles.
Quand j’écris ou pense : banal, je vois, car il faut que je me représente les mots, que je leur donne des personnalités en dehors de toutes significations logiques, une banane, un fruit fade à saveur de marron pilé avec de la vanille. C’est nourrissant, écœurant, délicieux, indigeste, obscène de forme, et puis cela coûte cher.
La vie banale n’est pas à la portée de tout le monde.
Je vais essayer… Nous allons réagir. De l’absolu mort faire naître l’absolu vivant, et, seul, me comprenant, je me suffirai.
Me comprenant ?… Dès que je vis je ne comprends plus rien.
J’ai allumé une bougie, près de ma bibliothèque. Je m’habille. L’homme qui s’habille vers une heure du matin a l’air tragique. Mais je suis heureusement libre d’avoir cet air-là. Tout repose dans mon appartement, et tout demeure en ordre malgré que je passe. J’ai souvent remarqué cet ordre extrême autour de moi, murant, sous des masques de lignes symétriques, un redoutable désordre me guettant. J’ai besoin d’ordre comme le fou a besoin de douches et s’y soumet avec une grande répugnance sachant sa peine perdue. Mes livres sont rangés, pris et repris cependant tous les jours. Leurs dos, froids, ont l’hostilité de gens conviés à des cérémonies. La lueur de la bougie danse un pas souple et distribue l’auréole de l’un à l’autre. Le long de la vitre, qui les garde du monde en un frigorifique imité de la Morgue, il en est de verdis par le reflet de leur titre et ce sont les plus anciens, les reliés, les meilleurs, on ne sait… peut-être parce que reliés.
Dans un coin de la tenture de soie pourpre, une tête de Cléopâtre, un petit ivoire, tout à coup immense, surgit de la nuit en un recul de plusieurs lieues, me regarde et ouvre la bouche. Une bouche pleine de poussière.
On entend, dehors, des voitures. Celles qui ramènent, endormis, les gens qui ont dormi au théâtre. Le dernier souffle de la ville. Je vais donc sortir pour n’aller nulle part ? des cafés clos, des boulevards déserts. Un à un des becs de gaz qui s’éteignent. Et il faut que je sorte. Je n’échapperai pas à ma destinée.
J’ai au bout des doigts un frisson singulier que je connais bien. Mi-douloureux, mi-agréable, il me ferait briser des objets si je le laissais aller. Et je devine que ce frisson protège, à la rigueur, ce que je touche, l’enveloppe d’une caresse, j’ai le printemps sous les ongles. Quel quantième ? Vingt février. Précoce printemps. En cherchant la date, je lis les éphémérides : « Le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin. » C’est Voltaire, le seul grand homme, toujours disponible pour une ligne, qui m’envoie ce charitable avertissement.
Oh que les grands hommes ont tort de se mêler de nos misères quotidiennes ! Cela les diminue d’autant. Je sortirai. La morale de Voltaire me chasse.
De ma fenêtre, dominant les quais, j’ai vu, ce soir, le soleil, défaillant, vomir des flots de vin sur toute la ville, et j’ai l’Orient dans les veines. L’Orient ! L’Orient ! La chaleur, des palmes, du sable, un sable qui poudre les fleurs et les femmes. J’y suis allé, j’en suis revenu. J’ai rapporté de là-bas la vision constante d’une certaine affiche gigantesque et hurleuse de tons, illustrant la célébrité d’un dentifrice : une almée grossière, à l’écharpe tricolore, aux seins en pommes à cidre, montrant une double — que ne pouvait-elle être triple — rangée de dents trop blanches, larges comme des pierres tombales, entre lesquelles dents d’ogresse les gamins du pays avaient, selon l’usage occidental, introduit, à coup de charbon, de quoi fumer. Et devant cette affiche, les épaules brûlées par un soleil volontaire, meurtrier, une brute, j’ai rêvé de l’Orient… toujours plus lointain.
Je me tourne du côté de la petite Cléopâtre. Elle est toujours plus lointaine, mais si vraie, si vivante. Elle court. Elle descend des collines rouges, voici venir la femme, la reine des cruelles luxures. Elle porte la tête en arrière et ouvre toujours la bouche pour un cri qu’on n’entendra jamais. Dans ce reculement mystérieux des tentures ombrées par l’angle de la bibliothèque et des siècles, la petite reine arrive légère, presque chaste comme une enfant. Elle est pieds nus, court sans se blesser — elle sait choisir les endroits où écraser des bêtes mollement. — En courant, elle fait virer derrière elle le traditionnel parasol de plumes. Elle traverse des branches comme un oiseau et je perçois un bruit de jupe déchirée. (Ce n’est pas la sienne, c’est le parasol.) Elle a des yeux, des yeux ! Elle a des lèvres, des lèvres ! Je vois d’ici son sexe qui brille, humide, entre ses minces jambes, coureuses, frôleuses, comme le rubis d’un anneau entre les deux doigts d’une main s’écartant.
La reine est morte. Vive la reine ! Oui, accours et change, sous tes bonds, les paisibles ruisseaux en torrents furieux. Abaisse le front bovin des arbres pour que, te voyant, ils deviennent fous, s’excentrent. Broie des fleurs et des insectes afin de m’être plus odorante et plus venimeuse. Apporte-moi les deux clés pointues de tes seins pour les mettre en les deux tendres serrures de ma poitrine. Ouvre-moi le cœur. Ce ne sera pas difficile, j’ai tellement le cœur partout…
Si je fredonne le madrigal à la volupté, c’est que je vais faire des bêtises ; je suis en mal d’aventure, et, n’ayant rien encore bu, me voilà déjà gris. J’ignore ce qui peut m’arriver. M’arrivera-t-il même quelque chose ? Je pense que ce ne sera pas la reine en question. Cependant une étoile est sur moi. Ma vie d’amour a toujours été merveilleuse, car je l’ai voulue merveilleuse. J’ai senti tout à l’heure, durant mon sommeil, que mon astre me regardait. Il a coulé vers moi un rayon, et mes paupières conservent l’impression d’un bain de lait.
Je me dirige du côté de mon cabinet de toilette où des clartés pâles m’attirent. Des cristaux scintillent étrangement qui ne sont pas dans la lumière. Je suppose un flacon rempli d’essence et le respire ; il est vide et une odeur de menthe se répand. Je pars de là heureux après quelques coups de peigne, un soin des moustaches, un étirement satisfait de tout l’être.
Je me porte bien et cela m’étonne, de temps à autre. Je me porte si bien que je ne me sens pas vivre. A trente-trois ans, je n’ai point encore éprouvé la petite secousse effrayante qui vous rappelle le heurt final. Non, je ne me sens pas vivre. Je nage perpétuellement dans une eau tiède et mes mouvements sont sans effort. Mes pieds ont perdu le fond depuis longtemps. J’ai des douleurs morales excessives qui me donnent la juste mesure de mon indifférence physique : elle est absolue. Rien ne peut rendre mon épouvante de cet état. Aucun malade ne possède la souffrance aiguë que me procure la conscience de ma sécurité. Je n’ai pas la comparaison pour me rassurer. J’ai essayé des pinçons, des piqûres et des brûlures. Il m’a bien semblé que mon corps se moquait de moi. Il demeurait calme, ironiquement. J’ai rêvé d’avoir des maladies classables, peu graves, de ces petites maladies mondaines, menue monnaie de la mort : fièvre, bronchite, simple rhume, et je n’ai pas obtenu cette faveur d’être assez atteint pour entrevoir la destruction prochaine. La torture cérébrale qui s’érige de cette puissance à ne pas pouvoir souffrir comme tout le monde est terrible. Je suis inquiet de ma santé parce qu’elle est bonne. J’ai peur de tout et quelquefois je me jette dans n’importe quel danger pour me braver moi-même, me combattre à outrance. Cela m’humilie d’être oublié par la douleur, l’humaine et saine douleur physique qui expurge et déifie l’âme. J’ai rencontré des crétins qui m’ont dit, me serrant les poignets avec admiration :
— Mon cher, je vous félicite… mais attendons la vieillesse.
La vieillesse est une chose normale. Ses infirmités seront normales pour l’être privilégié qui n’a pas été entamé avant le temps. Je sais déjà que mes cheveux blanchiront et qu’ils ne tomberont pas. Mes dents resteront intactes jusqu’au soir où elles s’en iront sans violence comme elles sont venues. Je n’espère ni rhumatisme, ni goutte, ni affection cardiaque, ma famille me privant de ces hérédités fâcheuses. Ils sont solides mes parents. Ceux qui sont morts ont eu des trépas naturels, se sont éteints doucement, ou sont partis jeunes en dormant, sans savoir.
Et c’est pour ces causes que je suis doué de la nostalgie de la souffrance. J’aspire à souffrir nerveusement, à fleur de peau, de toutes les forces de ma belle santé physique. Je m’invente des maux imaginaires. J’abuse de ma pâleur pour me dire délicat ou faible de la poitrine, et mon éréthisme perpétuel me sert à simuler les plus compliquées des névroses. Des médecins m’ont prédit successivement l’ataxie, la paralysie, ou la folie. Je n’arrive à rien et… j’ai peur !
En dépassant le seuil de mon cabinet de toilette, un frisson me secoue. Le buste d’ivoire sort tout à fait des tentures, la petite Cléopâtre est éclairée brutalement par ma bougie. Elle brille. C’est un fanal bien mieux qu’une figure, et il est sinistre, ce fanal d’amour. C’est une gueule de bête blanche et pourrie. L’angle du front est prolongé par une ombre, l’ombre d’un clou. Pourquoi ce clou ? Les clous qui ne suspendent rien vous pénètrent dans le cerveau. Je réfléchis et me rappelle que mon domestique a eu l’idée de retenir le petit buste, très léger, par un fil parce qu’il avançait tout seul chaque fois qu’on fermait les portes. Je bénis le clou. Je n’aimerais pas en ce moment voir s’avancer les choses toutes seules.
Enfin, allons-nous-en ! Mon pardessus. Un cigare. Non. Je mords. Le frisson a fait le tour de ma vaillance. Je suis ému de m’en aller vers elle sans la connaître. Je tâte mes poches. J’ai de l’argent et c’est vulgaire, puis aussi ma clé : j’enferme ma volonté dehors, je la pousse aux abîmes. Je veux sortir, je veux ma liberté tout de suite. Je sors et me regarde marcher dans le noir des escaliers. Un étage file sous mes plantes comme un velours qui se déroule. Je foule des étoffes profondes et molles à l’infini. La vulgarité de ma fugue se dissout dans un désir de beauté, d’orgueil. J’ai la cervelle à trois mètres au-dessus de mon chapeau et elle m’évente à coups d’ailes, comme un oiseau blanc au milieu de la pleine nuit de mon chemin.
La rue.
Je ne sais toujours pas où je vais. Du brouillard. Une ouate. On dirait une fumée d’incendie. A travers ce brouillard se tendent les becs de gaz des maisons, grosses pipes d’hommes sages demeurant indifférents à mon passage d’exalté. Je transforme l’atmosphère et je nage de plus en plus dans une eau tiède battue longuement par les fouets du soleil. Voyons ! Un peu d’ordre. Ayons du sang-froid. Je consulte ma montre. Une heure trente-cinq. Je n’irai pas chez l’une de mes deux amies pour y faire des découvertes troublantes ou troubler simplement son sommeil, ce qui serait pire. Je connais la réponse de la servante de celle que j’ose préférer : « Monsieur ne veut pas qu’on l’attende aussi la nuit ! »
Oh ! la vie, la vie monstrueuse parce que calme ! J’aime et je crois être aimé. Seulement, la nuit, des portes sont fermées qui ne tombent pas naturellement sous les poings de mes désirs.
Je marche tout à coup sur une peau d’orange et un ébranlement nerveux me ramène à des réalités premières. De dessous mon orteil droit s’élance en fusée un nouveau frisson d’épeurement qui se tord le long des muscles de ma jambe, me coupe le jarret, me scie la rotule, étoile mes os d’un point électrique. Dans la cuisse le frisson meurt et, en expirant, souffle mon sexe comme j’ai, là-haut, soufflé ma bougie. Une seconde, mon cœur cesse de battre. Je fume sans goût et j’ai la bouche sèche. Je serre les dents. Il faut peu de chose pour me désorienter. Un moment, je prends les becs de gaz pour ce qu’ils sont et la rue pour ce qu’elle vaut, une vilaine rue, corridor de la mort de tout le monde.
Je marche plus vite. Mon cerveau remonte au-dessus de la fumée d’incendie. Est-ce que je vais aller loin comme cela ? C’est absurde. Je pense à un café pas luxueux, où on entend râcler des mandolines jusqu’à trois heures. Il y halte, de semaine en semaine, quelques camarades : Andrel, Massouard, Jules Hector, souvent leurs femmes. (D’ailleurs jamais les mêmes femmes.)
Ce que je cherche, c’est une détente de nerfs. D’abord cette peau d’orange… puis, une discussion sur des idées générales en face d’un monsieur rageur (tel Andrel) et des pieds chaussés finement, qui vous invitent à vous modérer, la maîtresse d’Andrel par exemple, une fille facile, l’air innocent, dont le vice vous dispense d’avoir des remords, au moins sous les tables de café.
J’aurais dû épouser la provinciale de ma mère.
Je songe à cela étant très loin du but, mais le mariage, un mariage de passion, aurait l’immense avantage de me préserver de la passion… de l’aventure. Or comme je détiens le pouvoir d’aimer qui je veux, réellement, sincèrement, rien ne devrait m’empêcher d’adorer une reine légitime.
Le brouillard prend des tons fauves. On se croirait dans une fourrure aux poils fluides et chatouilleurs.
Je marche sur un trottoir élastique. Il fait bon marcher. Le boulevard Saint-Germain est désert. Sa perspective s’enfonce au néant. Le gaz est auréolé des couleurs du prisme et a des aspects de feux follets. Il n’est plus en cage, il erre devant les vitres cherchant à rentrer, à les violer. Les maisons mornes se diluent et posent leurs derniers balcons sur des nuages. Un poudroiement de sable jaune vernit le pavé de bois. C’est l’heure des assassins. Je suis celui qui va tuer le rêve. Le vivre peut-être.
L’Orient ?… Il est en moi. Voici que je tourne dans le désert. Des palmes s’agitent, très haut, et les palmiers, en fût de colonnes lisses, ressemblent aux montants d’un vaste portique. (Ou ce sont les montants d’une porte cochère qui ressemblent à des palmiers…) On ne perçoit rien du bruit que font les larges pattes des autruches. Sur le seuil de la ville, morte depuis des siècles, des caravanes d’ombres se prosternent. Un violent parfum d’orange sature le vent tiède venu de l’oasis. Des femmes se cachent derrière une haie de cactus pour manger des fruits qu’elles ont volés aux hommes et elles dissimulent les pelures comme l’on déroberait des pièces jaunes. Elles rient.
Combien sont-elles de voleuses à la suite des caravanes d’ombres ?
Elles se moquent de moi. La plus effrontée m’appelle, me tire par la manche…
Je me réveille ahuri, je tombe de mon rêve et du haut du brouillard.
Il y a, en effet, une femme qui me tire par la manche.
Je m’arrête.
Elle aussi.
Il va falloir se dépêtrer, ce sera dur. Elle doit m’avoir entendu causer tout seul et me croit très ivre.
Droite, dans la ouate sale du brouillard, elle continue sa mélopée confidentielle. On jurerait qu’elle prie pour un agonisant. Elle ne rit plus et débite tous les psaumes. Les plus macabres fantaisies se joignent aux propositions les plus naïves. C’est le répertoire de deux heures du matin : celui des hommes saouls qui vont aux halles ou des vieux grands seigneurs perdus, après bal, devant leur propre hôtel.
J’ai tort de l’écouter puisque je le sais par cœur, mais le costume de cette fille me retient.
Son étroite robe de soie noire l’engaine drôlement, elle est maigre, la pauvre diablesse. Son corsage reluit de cabochons bizarres, aussi bizarres que ses propositions. Il est strié de métal et de strass comme une peau de serpent l’est d’écailles multicolores, pourtant unicolores. Elle a du jais, de l’acier, de l’or, des perles blanches, des perles vertes, des arabesques d’argent et des grains de corail… et tout est noir. Ce que l’on peut trouver au fond d’un tiroir de maniaque ou d’un nid de pie, elle l’a cousu, collé, imprimé sur sa poitrine plate. Ce sont des bijoux exaspérés. Ils ont l’insolence d’un défi. Ils sont énormes, fantastiquement faux, émaillés de soupirs et de larmes. Je rêve qu’il y a, parmi eux, des dents d’ours. Je suis certain d’y voir des prunelles d’enfant.
Je pense :
— La pierreuse aux pierres. Ce serait un titre de nouvelle.
Stupidement, j’ai posé ma main sur ce corsage. Je persiste à ne pas entendre ce qu’elle me dit, qui révolterait un soldat.
— Voyons, tais-toi, et laisse-moi examiner ta devanture, ma fille. Il y a de l’art de pécheresse là-dedans. Le miroir aux alouettes. Je parie que tu as fabriqué cela toi-même ? Un vrai travail de femme arabe. Mes compliments.
Elle se tait, anxieuse. Je lui représente une grosse alouette.
Je ne peux pas m’empêcher de sourire.
Au centre de la composition, un cœur de paillon bleuâtre ; autour du cœur, des flèches dorées, des broches, tous les menus articles de Paris que l’on vend sous les portes, des galons de jais, des galons de satin, une délicieuse broderie sur guipure ancienne, un croissant, des fleurs de soie, enfin, la rosace d’une cathédrale ! Et des petites lunules courent après des sequins, et des franges d’acier courent après des filigranes. La ceinture se noue sous un monstrueux fermoir de missel. Une boucle qui rougeoie de rubis et d’améthystes, cabochons si colossaux qu’on peut en deviner les défauts du verre.
L’étoffe du corsage est usée, déchirée, luisante, graisseuse à la façon d’un cuir. Cependant, le col, par hasard uni, s’échancre sur une peau blanche, probablement blafarde à cause des céruses.
Au feu de mon cigare le corsage se diamante et les reflets prismatiques de tous les joyaux de quatre sous percent la brume.
Dans la ouate écartée de ce brouillard sale, ce bijou honteux rayonne et me blesse.
Je veux me dégager, passer.
La fille me toise.
Du fard qui voile sa figure, comme du fond d’un abîme de chaux vive d’où monterait le cri d’un brûlé, hurlent ses yeux. Ses yeux, tout à coup magiques.
… Orient ! Orient ! Reine aux petits pieds nus. Toi, la toute-puissante et la toujours prostituée ! Cléopâtre adorable, dont, une fois morte, on a doré le sexe pour n’en plus faire qu’un emblème de lucre et d’horreur… Princesse exquise, souple fillette, couleuvre qui enlaça et fit choir le soudard Marc-Antoine… criminelle ingénue, épouse de son frère ou de son fils, on ne sait plus bien… mais si virile que toutes les galères ont fui au large de l’océan de tes prunelles… gerbe de roses brunes et blanches aux pétales de fer… je te salue.
— Chameau ! crie la fille me saisissant le bras.
Il est trop tard. Je ne peux plus m’éloigner.
La vie vient de se jeter à la gorge du rêve.
J’ai plongé dans les yeux de cette fille et je n’en remonte pas. L’Orient est là, dans l’eau noire et moirée de pestilences de ses yeux extraordinaires. Si j’étais ivre, au moins, je pourrais croire que je les invente, mais je ne suis ni gris ni fou… Cette fille me suggère Cléopâtre comme le petit buste de chez moi me réfléchirait cette fille si j’allais le regarder maintenant. J’ai rencontré sur la face de cette rôdeuse de carrefour les yeux sombres, les deux trous miraculeux d’où sont jaillies les sources de toutes les passions mauvaises, les sources pures qui ont empoisonné les veines de tous les hommes !…
— Chameau, dis-tu, mon enfant ? Soit ! (et je me mets à rire de bon cœur.) Tu as peut-être raison. Les caravanes d’ombres sont en marche… et la terre, encore chaude de leurs ordures répandues, fume comme un encensoir… Oui, c’est l’heure… je monte… Faites avancer le chameau de la reine !
Je l’ai suivie.
Selon sa promesse, c’était à deux pas. Une rue mal pavée dégorgeant des ruisseaux cyniques sur la bourgeoise propreté du boulevard. Elle a ouvert, dans un angle obscur de cette rue où miaulaient des chats tristes, une espèce de porte de cave avec une clé qui n’entrait pas bien. Une chandelle, — il y a donc encore des chandelles ? — achevait de pleurer son suif sur le mur, une chandelle collée d’un coup de pouce formidable. (Je ne pourrai jamais coller une chandelle comme cela le long d’un mur ! je reste stupéfait d’avoir vu ce simple tour de force et je n’ai pas osé demander qui…) Un escalier en échelle de meunier, du vieux bois s’effritant, m’a conduit dans sa chambre.
Là, je me suis senti ridicule.
Je n’aime pas les filles, ni celles de Bullier, quelquefois jeunes, ni celles de l’Américain, vieilles souvent et plus ruineuses que les célébrités de meilleures marques. J’ai le dégoût des technicités du métier, n’en ayant pas besoin. Mon adolescence s’est roulée en des jupes de femmes honnêtes où elle a pris l’appétit de la passion. J’ai connu des créatures si chastes que j’en suis devenu pervers à moi tout seul. N’ayant fait ni droit ni médecine, mais simplement beaucoup d’amour dans mes livres, j’ai toujours eu les mondaines et les actrices que j’ai désirées. Je ne crois pas aux voluptés savantes, je crois aux voluptés ressenties. J’ai toujours tant donné que l’on m’a toujours un peu rendu. J’ai rencontré quelques bonnes filles parmi le peuple des cabinets particuliers, mais on n’a risqué, ensemble, que des camaraderies.
Celle qui eut ma virginité d’homme, une fort proche parente, mit à ce geste de nobles gants… Pourtant, ce ne fut pas le geste de beauté. Je n’ai pas connu de femme ayant l’à-propos du geste. Elles arrivent ou trop tôt ou trop tard. Celle-là m’enseignait, en même temps, ma religion (je suis catholique) et ne m’a guéri… que de sa ferveur.
La fille au corsage rutilant allume une lampe. La chambre s’éclaire. Cette fois, une lumière discrète, un abat-jour de soie jaune. Les murs blanchis, et les meubles, en pitchpin, prennent des tons d’ivoire ancien.
De mon aventure, déshonorante à mon point de vue, et c’est assez, il ne peut surgir qu’un ennui, des fatigues, aussi le panache Montépin d’un revolver braqué, par l’écraseur de chandelle, sur le Monsieur possédant un collet de fourrure. J’ai l’envie traître de casser la lampe de cette vierge folle et de fuir. Je suis exactement dans l’état d’un personnage qui fait une visite de jour de l’an à la meilleure amie de sa mère et qui s’aperçoit qu’il a oublié la poche de bonbons. Il faut que j’en finisse ou je vais être odieux.
Elle s’est retournée, demeure immobile, silencieuse, dardant ses prunelles fixes. La lumière jaillit certainement du blanc ivoirin de ses yeux, et c’est ce rayon qui éclaire tout, le contraste de ce blanc avec ce noir intense. Elle va parler. Il faut que je l’empêche de parler. Ai-je, oui ou non, le droit de ne désirer que les yeux de cette fille ? Clore sa bouche, tout de suite…
Si ce que j’appellerais la force donjuanique existe, il faut que cette fille sache quel genre d’ivresse m’amène ici, et s’il est nécessaire de pousser le ridicule jusqu’au crime, je me sens capable de l’étrangler pour l’empêcher de parler. Je ne tiens pas essentiellement à ce que ce soit moi qui crève de l’aventure.
Dans quel singulier esprit j’envisage les choses ! Je ne suis plus maître de mes nerfs. Je tremble, je n’ai pas froid (il y a du feu). J’ai mis mes ongles dans mes paumes. Mon pardessus me gêne et je n’ose pas l’ôter. Si nous étions trois, je serais tranquille. J’ai envie de tuer. Cela dure une minute.
Elle vient à moi, sans parler, m’ôte mon pardessus, sans sourire.
Ah ! non ! Mille fois non, je ne veux pas de la reine Cléopâtre pour servante !
Et c’est moi qui parle. Qu’est-ce que je dis ? je n’en sais rien. Je me crois en face d’Andrel discutant la valeur du système, en amour.
Elle m’écoute avec une bienveillance insultante. Je lui semble de plus en plus ivre. Comme je la supplie de se taire, elle se tait, me regardant fixement, la tête droite. Son fameux corsage me donne des distractions. Y aurait-il vraiment des dents d’ours ? Et des coquillages ? On le jurerait ! Au centre de ce dessin de peau-rouge il y a le cœur, le petit cœur bleuâtre serti de flèches d’argent. Je passe doucement mon index dessus. Je suis comme quelqu’un qui pousse, avec précaution, un jeton sur un damier. Elle accompagne mon doigt et enlève une à une les agrafes. Le corsage tombe, la tente de peau-rouge se replie des deux côtés, et la sauvagesse apparaît.
J’ai, en dépit de mes raisonnements intérieurs, mis mon bras autour de sa taille. Elle est toute contre moi, la tête s’incline, ses paupières se baissent. Elle ne rit pas.
Je suis inquiet. Il m’est impossible, encore maintenant, de m’expliquer pourquoi. Je me rends compte que ce que je vois est naturel, mais je n’en suis pas bien sûr.
Elle est maigre, peut avoir vingt-trois ans, ou moins. Son épiderme est d’une finesse extrême, d’une transparence d’ivoire. Elle est blanche à la manière d’un objet chinois. Je voudrais d’autres comparaisons, je n’en réussirais aucune. Un objet chinois poli par des caresses effroyables. Les seins, très petits, un peu rentrés, ont un pli de satin qui baigne mes regards dans du lait. (Mon étoile coule-t-elle un nouveau rayon jusqu’à moi ?) La taille est mince, fuyante, une taille de gamine dressée pour sauter le ruisseau. On voit les côtes, un peu, sous la chair. Le bras est merveilleusement attaché, ferme, et l’épaule fuit comme une onde. Du creux de l’estomac au menton, c’est une enfant triste, anguleuse, souffrante et jolie. Du menton aux cheveux, c’est toute la royauté d’une vieille reine cruelle qui revient de l’exil. Le fard ne dissimule pas le ton d’ivoire mort du teint, le bistre ajouté des yeux ne leur ajoute pas d’ombre, et entre les dents aiguës brille comme du sang sa lèvre qu’elle ronge impatientée.
— … Il faut me laisser dire, vois-tu, car je suis le plus doux de tous les hommes. Je n’ai jamais pu avouer ces choses aux autres femmes qui abuseraient de ma faiblesse. Je me confie à toi que j’ignore. Je me suis gardé de tes… sœurs, ne leur donnant que le moins bon de ma personne. Je les aime toutes ici, en une qui a tes yeux. Elle est morte, j’ai mis des siècles à devenir fou et je n’exige pas que ma folie soit contagieuse. Je t’ai rencontrée… je suis heureux de t’avoir vue. Non, pas les petites cuisines… il y manquerait le piment, le seul piment de ma foi ou de la tienne. Nous ne pouvons pas nous aimer. On ne remonte pas les marches du trône quand on est descendu jusqu’où tu es ! je suis venu ici pour coucher avec tes yeux… Suppose un voyageur qui aurait la science de voir par tes prunelles noires la prostitution du monde entier. Oh ! tes yeux ! Ne baisse pas ainsi les paupières : on dirait des jupes qui tombent ! Tes yeux divins et sacrilèges, tes yeux qui sont grands comme des alcôves tendues de tout le velours des nuits de passion. Quelqu’un t’a-t-il dit que tu avais des yeux ? Quelqu’un t’a-t-il dit que tu étais la reine ? Mais, j’y pense : as-tu faim ?
Les yeux se rouvrent, immenses, effarés, colères, superbes. La bouche frémit.
— Tais-toi ! Tais-toi ! Un louis pour ne rien dire ! Tous les louis que tu voudras à la condition que tu ne prononceras plus un mot. J’en ai trop entendu, là-bas, sur le boulevard. Remets ce corsage. Il m’amuse ; ce dessin naïf imitant la cuirasse, sa cuirasse bossuée de gemmes précieuses et reproduisant les hiéroglyphes sacrés me fait plaisir à toucher. Tu ne sais pas ce que tu as sur la poitrine. Tu portes les décorations de l’Éros antique, de l’Éros égyptien au monstrueux phallus doré, à la gorge de bayadère. Et puis, regarde-moi encore de tout tes yeux. Je ne te ferai point de mal. Pour la première fois et, sans doute, la dernière, un homme t’aura respectée. C’est un genre de honte que je veux te faire boire jusqu’à t’en griser. Comprends-tu le français, étrange fille ?
Grâce à son habitude de la soumission, elle ne répond pas. Elle a compris : plus elle se taira et plus elle ensorcellera le client.
J’ai la sensation de tenir serrée contre moi une bête rare et féroce de qui je ne peux attendre que des morsures si elle ouvre la bouche. Serrée… et si loin que nous ne pouvons plus mesurer nos terreurs mutuelles.
Je m’amuse. Elle s’ennuie. Je l’empêche de parler. Elle m’empêche d’agir et de notre silence, quand je me tais à mon tour, monte tout le désespoir de ne pas nous entendre. C’est intolérable. Je la contemple éperdument, je la respire, je la bois, c’est moi qui finis par me griser pour de bon.
Oh ! le masque de Cléopâtre derrière lequel me guettent les véritables yeux de la véritable reine ! Ce nez droit, court, cette bouche sévère et dure, bouche royale qui ordonne ingénument sans savoir qu’on peut prier. Des générations d’hommes ont agonisé sur cette bouche sans en obtenir l’aveu du plaisir. Est-ce bien sur elle qu’on a coupé des têtes qui l’ont rougie de tout le sang du dernier spasme ? Et eut-elle jamais du plaisir cette bouche volontaire, frémissante de la seule passion de vaincre ou de tuer, douloureuse à force d’avoir sucé la vie et la douleur des créatures… et pure entre toutes parce qu’elle s’ignore. La voici, ma Cléopâtre d’ivoire, frêle et puissante de toute la force aveugle des morts, point dénaturée par les afflux de sève ou la tension des nerfs. Elle est l’unique, l’objet d’art splendide enfoui sous le fumier et plus rayonnant d’être immonde.
Je l’aime.
— Je t’aime, entends-tu ? je t’ordonne de me répondre, à présent.
Elle lève les yeux.
— Tout ça c’est du chiqué, murmure-t-elle un peu bâillante. Moi, j’ai sommeil. Il est trois heures du matin. Alors, quoi ? Fous le camp ou casque. J’en ai plein le dos de tes histoires. Tu es maboul.
Mais en disant ces mots, inouïs dans sa bouche de reine, ses yeux, ses yeux tristes ont proféré d’autres paroles. Un effort de l’esprit veillant sur elle a dénoué les liens mystérieux qui garrottent sa souveraineté. Ses yeux ont eu la mélancolie de l’exil et elle détourne la tête, la bouche mordue, révoltée à la fois contre elle et contre moi qui me suis permis de lui rappeler sa gloire. Je n’ai jamais éprouvé rien de pareil. Je devrais rire aux larmes, j’ai presque le désir de pleurer jusqu’au rire de la folie. Je tiens toujours ce corps souple qui se détourne et je n’ai jamais eu tant de joie à enlacer la taille de Mme Saint-Clair qui est une blonde, très élégante de forme, plus ample et plus moelleuse, ni à respirer les cheveux de la charmante Julia Noisey, une toison brune, frisée, toujours imprégnée de parfums excitants.
Les cheveux de cette fille sont noirs, fins, tordus et ramenés en un bandeau large, avançant sur le front : c’est le bandeau des impératrices et il sent seulement la poussière.
Elle ajoute, fatiguée :
— Je ressemble donc à quelqu’un de mort ? Tu en as une santé de vous raconter ça. Une ancienne ou ta légitime ? Non ! quel type ! Où est ton argent ?
— Tu ne ressembles à personne. Voici mon porte-monnaie et prends toi-même. Je regrette de ne pas posséder une pièce antique à ton effigie. Ce serait mieux. Glisser ta couronne dans tes bas… un rêve ! Puisque tu as sommeil, je vais me retirer. Adieu, chérie ! Tu es une chimère ; demain, en plein soleil, tu n’existeras plus et je ne te reconnaîtrai pas si je frôle tes jupes.
J’embrasse longuement ses paupières. Elles sont douces et agitées comme de petites souris. Elle s’est redressée, essayant de saisir, dans mon langage barbare, ce qui la concerne directement. Je suis certain que ce qu’elle va dire sera mon arrêt.
— Demain, mon vieux, il fera jour et toi tu pourras te fouiller… j’ai pas besoin de marcher avec les mabouls pour manger à ma faim.
— Je ne suis pas fou, chérie. Je te vois seulement telle que tu es. Si nous pouvions tous nous reconnaître en nous abordant, nous serions tous beaucoup plus heureux.
— Tu me vois comme l’ancienne ?
— Oui…
— Une femme chic ?
— La reine Cléopâtre.
— C’est crevant… je ressemble à Cléo, moi ?
— Non, tu n’as qu’un bandeau et elle en a deux… parce qu’elle est esclave.
— Si je te prends le demi-louis, est-ce que tu te fâcheras ?… Moi ça m’embête de faire un type qui ne veut pas que je marche. Est-ce que tu es de la police ?
— Prends le louis tout entier. Je ne me fâcherai point, mon pauvre amour. Nous nous parlons chacun du haut d’une montagne et c’est étonnant comme nos voix sont sourdes ; elles résonnent en nous-mêmes et reviennent nous frapper au cœur. Cela t’amuserait… de marcher ?
Elle me regarde fixement, toujours sans rire.
— Ça ne m’amuse pas du tout. Vaut mieux dormir… ce serait… que j’aime à payer en nature, t’as compris ?
— Admirablement. Tu es honnête.
Elle ricane. Un rire sinistre qui la rend encore plus belle et plus horrible.
— Et puis… je te ferais un joli cadeau… ça je t’en réponds…
Je suis terrifié à l’idée qu’elle va recommencer la litanie du boulevard, toutes les propositions de la Saint-Jean.
— Tais-toi, je t’en prie, et donne-moi tes lèvres… closes.
Elle est debout, dans la lueur sulfureuse de sa lampe, et elle a je ne sais quoi de furieusement méchant au fond des prunelles.
J’ai énervé la panthère et sa griffe royale va me marquer au front.
Tout d’un coup je songe que je suis idiot, non plus seulement ridicule, mais embêtant.
Que ce soit ma chimère ou une pauvre pierreuse, je n’ai pas le droit d’être dédaigneux.
Je suis sur la pente de toutes les sottises. Je n’ai pas le désir charnel de cette fille qui semble m’avoir enchanté, mais je vais être poli. Ce ne sera pas, je crois, très difficile.
Elle ricane toujours.
Je m’avance les bras tendus, les mains folles.
Elle cesse de rire, ses yeux brillent et, brusquement, elle me montre la porte :
— Non. Va-t’en… Pas toi… Va-t’en… je suis malade… et ce cadeau-là, je veux pas te le faire, imbécile !
Je vois toujours son bras levé, son poing crispé vers la porte et ses yeux de reine qui récompense ou qui se venge.
Oui, j’ai vu, cette nuit-là, le geste de beauté.
Depuis une semaine, je vis dans une étrange émotion.
Au lendemain de mon aventure — l’ai-je rêvée ? — je suis allé rendre visite à Mme Saint-Clair, mais selon l’usage, pour la prévenir que cette visite ne serait point cérémonieuse, je lui ai envoyé des roses.
Mathilde Saint-Clair aime les roses roses, les roses naturelles.
Julia Noisey, ma seconde amie, n’aime que les roses rouges, et il les lui faudrait pompons si on voulait assortir des fleurs à son caractère de singe gai ; elle préfère les roses spirituelles.
Quand j’envoie des roses roses à Thilde, je n’oublie pas Lia, et les deux bottes, vêtues d’un semblable papier innocent, vont répandre, par l’intermédiaire d’un même porteur, la même illusion de respectueuse tendresse en deux atmosphères très différentes.
Je ne trompe point ces deux femmes. D’abord, je ne fais jamais deux visites à la fois, ensuite, elles se connaissent et sont pleines de prévenances l’une pour l’autre. Elles ne se doutent pas de leur parenté dans mon cœur. Leur confier des détails sur nos intimités réciproques serait un manque d’éducation dont je suis incapable.
Mme Saint-Clair est une musicienne de grand talent. Elle est libre. Je vais chez elle tous les jeudis.
Julia Noisey est la femme d’un architecte, charmant garçon, assez bon causeur, que j’estime beaucoup. Elle vient chez moi quand la fantaisie lui en prend. Cette fantaisie l’amène, du reste, à tort et à travers, et risque, souvent, de se heurter à mes propres caprices. Nous renouons toujours. Je l’amuse. Elle m’amuse, nous nous quittons et nous nous retrouvons bons amis.
Je ne trompe pas ces deux femmes puisque je les aime autant l’une que l’autre et que je leur donne juste ce qu’elles me demandent.
A l’une, des roses naturelles, tout mon amour.
A l’autre des roses pompons… tout mon esprit.
Mais je crois que je n’ai pas assez d’amour et pas assez d’esprit, parce que, de ces deux trésors… il m’en reste encore un peu pour les voisines.
Sont-elles bien toutes deux dans mon cœur ?
Ou dans mon cerveau ?
Non, pas dans mon cerveau. La chimère est jalouse, elle, et je suis obligé, par métier, de conserver ma liberté cérébrale.
Elles sont donc dans mon cœur. Triste cœur ! Une chambre trop vaste aux trop nombreux escaliers de service qui communiquent trop avec le sous-sol.
Je garnis cette chambre de meubles bistournés, de divans profonds, de fleurs capiteuses (il y manque un lit où l’on puisse dormir du sommeil sans rêve), et quand tout est en ordre, amour, délice et orgue, c’est-à-dire dans le plus grand désordre voulu, je m’échappe par les portes dérobées. Je fuis Thilde pour Lia et Lia pour Thilde.
Si elles savaient bien, elles me plaindraient, car, grâce à leurs bontés, je ne suis pas heureux.
Je suis un pauvre homme.
Ce sont de pauvres femmes.
Je cherche toujours, dans les sous-sols, un bijou que j’ai perdu et qui leur appartient peut-être. Je cherche… Je vais apprendre à les aimer mieux le long des rêves qu’elles ne m’inspirent pas.
La vie banale ne va pas comme on veut.
Ce soir louche du vingt et un février, il y a huit jours, je suis entré dans le palais de mon fleuriste, boulevard Saint-Germain. Je lui ai commandé des roses roses pour Thilde et aussi des roses rouges pour Lia. (Je pense qu’on fera quelque échange, un soir d’encombrement, et j’ai la précaution de ne pas insinuer de notes explicatives. Leur adresse, ma carte, cela suffit. Mon fleuriste est intelligent, discret, il aiguille habilement ces trains de parfums.)
Les commandes inscrites, je suis demeuré, les yeux vagues, devant son étalage.
— Monsieur désire autre chose ?
— Oui.
Et je regarde des roses blanches, des roses froides, espèces de premières communiantes, mi-fermées dans un coin de verdure.
— Auriez-vous des roses plus blanches que celles-ci ?
— Oh ! Monsieur… plus blanches ? (Et il piétine, d’un doigt énorme et savant qui ne fane pas, les frêles pétales.) Ça c’est du Général Collot-Mayeux, c’est du blanc pur.
Cette idée d’appeler des roses blanches d’un nom de vieux fantassin me transporte d’indignation. Je lui réponds sèchement :
— Non. Pas assez pur… et si vous n’avez que celles-là…
— Il s’agit d’un envoi pour fiancée ?
— Je tiens à des roses blanches, qui soient d’un blanc plus intense, voilà tout.
Je sens que je dis des choses ridicules et je vais certainement faire une chose plus ridicule encore.
Des heures pour dénicher une douzaine de roses plus blanches qui le sont moins. Mais elles m’agréent : ce sont des fleurs couleur d’ivoire, elles ont des reflets verts comme, près des tempes, certaines jeunes filles mortes.
J’étais nerveux, maussade en les examinant, j’avais un mauvais frisson, le frisson de celui qui n’a pas dormi, la nuit précédente.
Avec mes roses d’ivoire je suis revenu chez moi, j’ai requis Joseph, mon domestique.
— Vous allez porter ces fleurs… Diable ! Attendez… je n’ai ni le nom ni le numéro… Vous êtes intelligent, Joseph ?… Écoutez-moi, dans l’angle de la rue Grégoire-de-Tours, une entrée basse, voûtée, la personne est seule sur le palier, je crois, c’est une dame, une brune, des cheveux très noirs en casque, un peu fardée, enfin, l’air d’une…
Le mot ne sort pas.
Joseph contemple la gerbe de roses dont la blancheur l’éblouit : tel un soufflet de main royale.
— Oui, Monsieur, je saisis, d’une grue ?
— J’ignore les… occupations de cette dame… et vous me feriez plaisir, Joseph, d’avoir l’air de les ignorer aussi.
J’ai le ton de quelqu’un qui va renvoyer son domestique.
Plongeon de Joseph.
Ce n’est pas un méchant garçon, mais il est jeune et se permet des clins d’yeux, de temps en temps, ayant servi trop de gens de lettres.
J’attends quarante-cinq minutes son retour en me traitant quarante-cinq fois de crétin.
Cette fille a voulu se débarrasser de moi. Se débarrasser de quelqu’un, ce n’est pas l’épargner.
D’ailleurs, elle a fait là un acte très en rapport avec son métier. Elle vend de l’amour de bonne ou de mauvaise qualité, selon la bonne ou mauvaise qualité du client. Elle a eu le respect de mon pardessus. Elle s’est dit : « Ce bonhomme est un Russe ! » Ces femmes-là sont patriotes.
J’essaye de plaisanter. Je suis de plus en plus nerveux.
Joseph me revient, un peu pincé, il rapporte les roses.
— Monsieur, la dame s’appelle : Mademoiselle Léonie tout court. Elle a déménagé vers midi pour aller dans un fichu endroit…
Joseph, avec mes entrées, fréquente tous les théâtres et il sait poser les temps.
— Quel fichu endroit, Joseph ?
— On l’a emballée pour Lourcine, Monsieur.
Je pousse un cri de joie, un véritable cri de joie, égoïste, inconscient, que je ne peux pas retenir.
— La brave fille ! C’était vrai. Joseph, vite, un fiacre et reprenez ces fleurs. Allez à l’hôpital. Tâchez, coûte que coûte, de pénétrer jusqu’à cette femme et de lui offrir mes roses. Tenez, joignez-y ma carte.
Je ne veux pas être en reste de générosité.
Joseph renonce à saisir… Je devine qu’il pense exactement ceci :
— Ce qu’on va se fiche de moi. Chienne de place !
Un égoïste d’un autre genre, Joseph.
Je suis en train de m’habiller pour aller dîner chez Thilde, quand Joseph écarte timidement la portière.
— La commission de Monsieur est faite, Mlle Léonie a le numéro dix-huit de la salle Cécile, si Monsieur tenait… J’ai pas pu la voir à cause des règlements, mais un interne a pris votre carte. Il connaissait votre nom et s’est chargé du bouquet… N’y a pas de réponse.
— Merci, Joseph.
La portière est retombée ; j’ai froid.
Il me semble que je viens de jeter mon anneau à la mer.
Chez Thilde.
Elle reçoit le jeudi. On fait naturellement beaucoup de musique. Avant la réception officielle, nous dînons en tête à tête et nous causons. Elle est en face de moi et me sourit. Sa bouche a une expression de bonheur, voluptueuse, très douce. C’est pour cette expression de bouche que j’ai désiré qu’elle fût mienne. Je me suis aperçu qu’elle la tendait à tout le monde en jouant du piano, et cela me l’a un peu gâtée dès l’aurore de notre union.
Je ne suis pas poète en littérature, mais je me réserve de l’être dans la vie où il semble que la poésie manque plus particulièrement. Je n’aime point qu’une femme artiste se donne artificiellement plus qu’il ne convient, car… elles ne font jamais rien avec mesure et cela n’est plus de l’art dès que cela cesse d’être composé avec méthode.
Thilde joue du piano en amour et elle fait l’amour au piano.
Il y a là des tas de nuances.
Ce soir, elle est vêtue d’un peignoir blanc, doublé de vieil or, ses cheveux sont mal rattachés (et pour cause), elle me bêche tout tendrement pour je ne sais plus quelle page sur la prostitution.
— Vous avez l’air de croire que c’est honorable de se vendre, vous, mon pauvre ami.
Je ne réplique pas. Elles disent toutes les mêmes sottises à ce sujet.
La salle à manger est jolie : des tapisseries claires. Il y a un nombre considérable d’objets en cristal. La porcelaine est blanche filetée d’or, en harmonie avec le peignoir, et des braises s’écroulent derrière le garde-étincelle en lançant partout l’acuité de leurs petits yeux rieurs.
Un chien minuscule, vivant, et qu’on supposerait de faïence, est assis entre nous, sur un tabouret de piano très exhaussé.
En arrivant ici, j’ai été fort empressé, fort amoureux, j’ai obtenu toutes les faveurs, même celles qu’on réserve pour le monstre Pleyel, c’est-à-dire l’expression de bouche, au moment précis choisi par moi ; je suis à présent moins gai, j’ai faim, et, quand je parle, mes mots se hérissent, à la dernière syllabe.
— Louis, vous avez vos nerfs ?
— Si vous y tenez… j’ai des nerfs parce que vous me dites des bêtises de femme d’esprit depuis une heure. Pourquoi me servez-vous de la copie comme ça ?
— Et… avant ?
— Avant, vous ne disiez rien… c’était plus drôle.
— Louis, vous vous oubliez… je ne suis pas une femme drôle, moi.
Cela est exact et elle peut ajouter qu’elle n’est pas non plus une femme tragique. C’est une bourgeoise manquée, elle a un amant comme elle aurait un mari et elle ne me trompe pas (ça, j’en suis sûr) parce qu’elle n’aurait pas davantage trompé son mari.
Elle est très belle, entre vingt-cinq et trente ans. Une chevelure châtain doré, abondante et ondulante. Des yeux couleur d’amande, de jolies dents.
(Elle a perdu deux molaires, mais elle croit que cela ne se voit pas. Je l’ai pourtant vu un jour qu’elle riait, la tête renversée sur le clavier de son piano. Il m’a semblé qu’il manquait deux touches à ce clavier… et je suis devenu grave.)
Elle cause agréablement, avant, pendant et après. C’est un tempérament voluptueux sans élan de passion. Elle aime l’homme comme elle aimerait une confiture spéciale, et se trouverait blâmable, petite fille, de s’en flanquer une indigestion.
Elle est complaisante autant qu’une femme du monde… un peu moins qu’une grande dame et elle n’a pas l’autorité du geste.
Allons ! Voilà que je pense encore à Cléopâtre… je suis décidément rêveur, ce soir.
Je jette ma serviette sur le petit chien qui jappe avec humeur. Je déteste ce toutou-là, seulement il paraît que c’est le seul chien qui ne hurle pas quand il écoute la sonate à la lune. Alors je le tolère par esprit d’ordre.
Nous devons passer au salon, il va venir des gens. Je me hâte de fumer des cigarettes qu’elle m’offre de ses doigts longs, un peu spatulés par l’abus de la sonate, mais très blancs, très harmonieux.
Elle ne fume pas et adore l’odeur du tabac, une anomalie.
— Thilde… pas tout de suite, hein ?
Elle me tend sa bouche, parce qu’elle va s’habiller pour les autres et que, comme elle y met beaucoup plus de soin que si c’était pour moi, elle me fourre en pénitence.
— Enfin, voyons, je prends ma robe mauve, ce soir, tu sais, celle au grand col médicis, il faut être raisonnable pour que je puisse l’attacher tranquille ! Tu es ennuyeux… là…
— Celle avec des cabochons dessus ?
— Oui… oh, pas des masses, une broderie d’améthystes… Tu ne vas pas faire le pantin ?…
Je suis sensé avoir l’horreur du cabochon, faux ou vrai, qui est la mode du jour depuis un siècle, des siècles.
— Pourquoi pas des dents d’ours… tiens, celles de ton piano ?
— Comme si j’étais la femme sauvage.
La bonne entre, et j’assiste à une conférence sur la façon dont il faut envelopper un certain fromage anglais qui doit s’abîmer si on ne le recouvre pas de papier d’argent dans le délai de vingt-quatre heures.
— Vous m’entendez bien, Marie, du papier d’argent, ou il coulera…
— Ce serait sinistre.
La bonne sortie :
— Loulou, tu es insupportable. Je te défends de te mêler du service avec tes railleries perpétuelles. D’abord, j’ai bien le droit d’aimer ce fromage, moi.
— Aimer le fromage… Vulgaire, pour une jolie femme.
— Et les cabochons ? Vulgaires aussi, hein ? Tu auras marché sur un grand critique, aujourd’hui, tu es rageur.
J’ai presque envie de lui répondre que j’ai marché sur l’aspic de Cléopâtre.
Elle s’en va.
Je la laisse partir pour jouer avec le chien. Cette femme ne me tient pas du tout aux moelles, surtout après. Je l’aime d’une façon ordinaire.
A la soirée, des gens quelconques : un professeur du Conservatoire, violon célèbre, sa femme, ses deux filles (cous de pigeons déplumés), puis, Andrel, Massouard, et Jules Hector, que j’ai introduits, successivement, pour pouvoir causer.
M. et Mme Noisey, que j’ai introduits aussi, doivent venir vers onze heures. Julia ne joue pas du piano, mais elle cultive un joli filet de voix, on dirait le murmure d’une fontaine de vinaigre.
Le salon est grand. Trois fenêtres voilées de stores vénitiens, un Pleyel énorme, le monstre. Des lampes en urne, une lyre d’or sur la cheminée, offerte par un ministre pour un morceau joué chez lui, des fleurs en paniers, en gerbes, les miennes dans un vase de Sèvres, et mes livres, très en vue, trop. Le portrait à l’huile d’un ténor connu au mur, grandeur naturelle, et de superbes photographies d’Otto dressant ses principaux rôles dans tous les coins. Tapis turcs, nombreux et moelleux.
Le premier arrivé, je m’installe par terre à feuilleter les albums, je m’ennuie.
Elle rentre, seconde arrivée, en costume mauve à traîne, chevelure plus relevée, bras nus. Elle n’a jamais pu se défendre d’être au concert chez elle. Il s’agit, du reste, de faire honneur à son piano.
Nous serons deux ainsi pendant près d’une heure, trois avec l’instrument qu’elle ira tapoter, caresser (il y aurait un mot plus juste mais… trivial).
J’ai rencontré Thilde dans un concert qu’elle donnait à son bénéfice. Je pris un billet bien par hasard, et après un dîner confortable, chez les Noisey, je vins vers dix heures ne sachant que faire de ma soirée, Julia ayant la migraine.
Une toute mignonne salle de spectacle, peu de monde et des ouvreuses polies. De ma stalle je contemple le monstre Pleyel. Une queue exubérante et des dents agressives découvertes. Je m’irrite malgré moi. La femme vient et le caresse… Une expression de bouche étonnante. Je suis jaloux, la trouve belle, cherche un confrère obséquieux pour me présenter.
Thilde était en satin blanc comme une épousée, elle avait pleuré (elle pleure facilement) parce qu’au moment de jouer son morceau de résistance on lui avait glissé la note de l’électricité. Ce coup de l’électricité, on le fait volontiers aux dramaturges amateurs et aux femmes sans protection dans ces petits théâtres. Thilde, rageuse, pétrissait son mouchoir. Elle saluait, répondait machinalement et songeait qu’elle n’aurait pas vingt-cinq francs pour payer cet acompte. Elle était vraiment fort désirable. Dans les coulisses, après l’ovation de rigueur, une crise, des explosions de larmes, et les injures de l’électricien. Comme je suis derrière un portant, j’entends tout, j’en profite lâchement. Je paie l’électricien d’abord et je console ensuite. Dans une loge, Thilde est étendue, le corsage déboutonné, les cheveux au diable, et l’ouvreuse lui bassine les tempes. C’est navrant, pas préparé. Je m’excuse, j’entre, je joue le morceau que je sais : prélude courtois, andante timide, arpège sur la chevalerie décidément disparue de nos mœurs, et final de chaleureuses preuves de dévouement.
— Oh ! Monsieur, je vous le rendrai dès demain… non… non… je ne souffrirai pas… pour qui me prenez-vous ?…
Elle est conquise, seulement, je suis plus amoureux que de coutume, je crois que c’est la bonne fois, le coup de foudre, et quand elle se remet à caresser le monstre, je fiche le camp n’importe où au lieu de songer à la ramener chez elle. J’ai de ces bizarreries de caractère. Le Pleyel me fait peur et l’expression de bouche de sa maîtresse aussi.
On s’écrit. Elle me rend mes vingt-cinq francs en me traitant de misérable qui l’a compromise. (Elle n’a pas eu encore le temps de rompre avec l’autre, le ténor.) Je retourne les vingt-cinq francs : gerbe de tubéreuses. Je me mets à ses genoux dans une lettre assez ridicule ou je fulmine contre la musique et parle de tuer le ténor. (Entre temps, dîner fin à la taverne du Panthéon avec Lia Noisey, pour prendre patience ; nous convenons tous les deux que cela n’est pas commode de se voir chez moi plus souvent à cause du mari.) Chez Thilde, reconcert. On me reçoit un jeudi soir. Je suis de très mauvaise humeur à cause du Pleyel. Il ne dit rien quand on ne l’excite pas, cet animal, il tient de la place quand on l’excite. Enfin Thilde accepte des joujoux, des bouquets de violettes passés dans des bagues, des partitions rares, une ceinture qu’elle a vue et que je déniche — ô télépathie. — Le ténor se liquide. Elle a des dettes et gagne plus d’argent que moi. Je paie les dettes, un jour de discussion sur l’amitié entre hommes et femmes, pour soutenir ma théorie, les armes à la main. Un autre jour, je la renverse sur son piano, avec la sensation de violer le Pleyel. Je suis très heureux. Je l’aime un mois, je m’imagine que je suis marié, je suis fidèle et puis…
Ce soir de soirée intime, je bâille.
Andrel, Massouard, et Jules Hector, là-bas, dans une embrasure, causent de leurs petites affaires avec la politesse prudente de gens qui ont l’habitude, bien littéraire, de gueuler ailleurs.
Ils s’ennuient.
On nous joue du Schumann et nous continuons à nous écouter discuter en dedans. Nous aimons la musique… mais ça nous assomme toujours d’en entendre, nous voudrions la lire.
Andrel se faufile vers le seuil.
Massouard décampe avec une ostentation de portefaix.
Hector s’en va, gentiment, à l’anglaise, toujours très correct.
Hélas, je ne peux pas partir, moi, je suis presque le maître de la maison.
Onze heures. Voici Julia, elle est seule. C’est inouï… Comment a-t-elle fait pour lâcher le mari ?
Je me lève sournoisement et j’arrange ma cravate devant une glace : notre signal. Elle mord son petit doigt, elle a compris.
Diable… mais ça va faire deux visites à la fois, alors !
Je sens que mes belles résolutions de pseudo-fidélité, ou pour l’une ou pour l’autre, se détraquent.
Julia Noisey est une petite poupée potelée, vive et rieuse, au moins dans le monde. Elle n’a pas de cervelle, pas de sentimentalité, pas de morale (la morale de la femme, c’est son amour, et elle n’aime rien). Elle est complètement folle, personne n’a l’air de s’en apercevoir. Son mari, un jeune homme, l’adore, la gâte et ne lui impose aucun enfant. Elle m’a fait l’honneur de m’accepter pour amant parce que j’avais écrit des choses sur les névroses. Elle s’est bien vite doutée que je n’étais pas plus vicieux qu’elle, autant seulement, et on s’est querellé tout de suite. Je suis persuadé qu’elle a un autre amant que j’ignore, mais dont je sens l’haleine dans ses cheveux quand je la respire, ce doit être un petit cousin quelconque, se servant de parfums violents pour imiter sa première maîtresse. Je suis sûr qu’elle en aura trente avec la même sérénité d’âme. L’amour ne l’amuse pas. Elle cherche un monsieur qui… (la plus élémentaire pudeur ne me permet point de m’expliquer ce qu’elle cherche), je ne suis pas ce monsieur. Je lui ai indiqué un vieux peintre, un ami de Massouard, dont c’est la spécialité. Il est complètement gaga. Elle n’ose pas y aller et en attendant me supporte…
Ce soir, elle est drôlette, ses jolis yeux de petite myope sont humides, ses courts cheveux frisés lui donnent l’allure d’un agneau qui serait enragé et elle dit des tas de bêtises grosses comme le monde, en faisant onduler sa jupe vraiment trop longue pour elle. C’est toujours un petit animal habillé dont le corps danse nu sous une robe.
Je n’écoute ni sa voix aigrelette, qui siffle sur certaine note en disant l’Adieu, ni les compliments de Thilde, indulgente parce qu’elle se sait la plus belle et qu’une poupée pareille doit me déplaire ; je songe à filer.
Thilde se croit le grand amour… oui, il y a le petit à côté. Julia est au fond persuadée que Thilde n’est pas mienne… J’ai inventé Thilde pour que nous puissions nous rencontrer sur un terrain neutre sans offusquer le mari. Je n’ai parlé de Mme Noisey à Thilde que le jour ou j’ai failli être surpris dans le salon de Lia.
Thilde dit de Lia : Cette petite peste de Mme Noisey. »
Lia dit de Thilde : « Cette grosse dinde de Mme Saint-Clair. »
Elles s’aiment beaucoup et se consultent pour leurs chapeaux.
… Enfin, minuit, je prends congé cérémonieusement et je vais attendre Julia à deux pas, dans un café.
Elle me rejoint.
— C’est tannant… j’ai perdu une demi-heure à lui dire du mal de ton dernier livre ! Ce qu’elle est empaumée de toi…
Moi, philosophe :
— Elle a tort. Où allons-nous ?
— Chez toi, cette idée (elle tire sa montre) et tu sais, rien qu’une minute, mon mari a la grippe.
Le mari qui a la grippe, ça fait sans doute partie du programme de ce genre de fille. Ce n’est pas un numéro intéressant.
Oh ! les roses roses, trop naturelles, les roses rouges, trop spirituelles, et les roses d’ivoire, les roses mortes…
Andrel boit de la chartreuse verte d’un air très recueilli et il ajoute :
— Vous savez, Rogès, je ne suis pas pour l’intrusion des femmes dans nos turnes. Dehors, c’est bien, ça va, on rigole et on les sème après. Dedans, c’est sacré, faut du calme. Moi, je ne peux plus travailler quand j’ai des jupes autour de mon bureau, et ce n’est pas pour ce que je les aime : elles m’embêtent.
Andrel ne s’exprime correctement que quand il écrit. Alors, il chantourne ses phrases, les bistourne à faire croire que son énorme crâne est toujours sur le point d’accoucher d’une petite marquise.
Andrel est un homme de quarante ans, rude, brun, un peu vulgaire d’aspect. Il s’habille comme un laquais de bonne maison.
Je m’allonge sur mon divan, et je contemple les ronds des deux lampes de ma cheminée, au plafond. Je suis las, j’ai des nerfs, dirait Thilde, et je n’ai pas envie de dormir, mais je bâille, cependant, malgré moi, me détournant d’eux.
Oui, je sais, je sais très bien… Andrel a chez lui une servante maîtresse et il appelle cela : les semer dehors après. Je le crois ! Elle lui fait de terribles scènes de jalousie. Il est de la meilleure foi du monde quand il prétend ne pas aimer la jupe autour de lui ; une servante, ce n’est pas la jupe, c’est tous les jupons sales.
Massouard bourre sa pipe avec des soins méticuleux.
Jules Hector ne cause plus depuis longtemps, mais je sais aussi à quoi il pense ; il songe aux Javanaises, une fois entrevues dans une exposition lointaine… tout son cœur est parti par là.
Massouard, qui n’a d’aventures qu’avec des modèles impeccables, au moins de formes, relève sa face de lion roux, tire une bouffée :
— On ne peut cependant rien ficher sans elles.
Et il ne dit pas ficher.
Andrel hausse les épaules.
— En sculpture ?… (Il ajoute, malicieusement :) Vous, Massouard, vous ne devriez pas dire ça, car ce n’est pas la nature qui vous inspire : vous faites si large !
Massouard grogne. Il est avéré que ce brave génie de sculpteur voit trop large.
Depuis qu’il travaille, il a pétri une série de bonnes femmes fabuleuses, hautes comme des clochers ; minces ou épaisses, elles ont toutes le visage perdu dans le ciel, des expressions de torture ou de joie qui ne sont nullement à la portée de notre œil. La dernière, commandée par l’État, n’a pas pu passer par l’antichambre de la salle de mairie où on voulait la mettre. Elle attend derrière un chantier de démolitions que les frontons s’élèvent en France.
Massouard n’a jamais su qu’il voyait trop grand. Son rêve l’aveugle. Il prétend que la proportion n’existe pas. On se met au point, c’est l’essentiel, selon lui, mais à quel point ? Faut-il regarder ses géantes du haut d’une tour, ou faut-il prendre du champ avec une bicyclette ?
C’est ce que nous ignorons.
Seulement nous l’aimons bien quand il tolère des réductions de ses statues. Nous saisissons des choses charmantes comme avec nos doigts, nous couchons mieux avec ses déesses ou ses humaines, et nous analysons, pieusement, à la loupe de nos sens, des lambeaux de son rêve, afin de le reconstituer sous nos plumes profanes, en très petit.
Jules Hector serre les lèvres.
Il hésite pour proférer le moindre mot. C’est un chaste, ou un vicieux, qui ne parle jamais de femme de peur d’en trop dire.
Je m’écrie, d’un ton solennel, parce que je suis le plus jeune :
— Non ! Non ! Rien fiche sans les femmes, rien fiche sans la passion.
Andrel rit.
— Oh ! vous, Rogès, vous avez le profil de César et vous en abusez… Ça vous fait bâcler vos livres comme des assauts.
— Je préfère parler d’elles… à écrire sur vous ou sur moi. Je continue ma poursuite du beau, et si je n’arrive pas, j’ai des sensations toujours…
Jules Hector vient à mon secours.
— L’objet d’art, dit-il, c’est certainement la femme en tout… seulement nous avons pour mission de la retrouver sous les ruines de Pompéi.
— Ça, oui, fait Massouard se tapant sur la cuisse, car elle est généralement bien perdue de lignes.
— Mais non ! Mais non, vous lui demandez d’être plus haute que nature, ricane Andrel.
Jules Hector se renverse et regarde le plafond, il attend je ne sais quoi, puis il reprend :
— Rogès n’a pas tort. Où je le blâme, c’est quand il s’extériorise de manière à perdre son véritable objet de vue. La passion, c’est notre force centrifuge, nous ne pouvons pas espérer gagner le ciel de l’art sans elle, mais elle n’est pas du tout inspirée par la femme, proprement ou salement dite, elle est en nous, rien qu’en nous, à l’état latent. La femme touche seulement au ressort qui doit faire jaillir la vision du beau selon notre vision du beau, qui est, pour chacun, une parcelle, une facette de l’Unique. Elle y touche quelquefois toute la vie sans que rien ne jaillisse d’autre… que ce que vous savez. Le hasard peut amener dans nos bras l’objet d’art tout créé, sous le rapport des lignes physiques ou sous le rapport des lignes morales, jamais complet, bien entendu… incomplet il est déjà si rare ! Nous sommes tellement bêtes que nous hésitons à nous l’approprier au seul nom de notre art, quand nous aurions déjà tant de raisons d’amour. Il y a les lois, nos usages à nous, plus sévères que nos lois, nos théories, nos systèmes tout cela complique énormément les choses. Il faudrait passer outre et nous mépriser, nous, d’abord, et les lois ensuite. Nous sommes tous d’une lâcheté sinistre et nous n’osons dépenser nos forces que pour des exploits ridicules, comme par exemple épouser une bourgeoise ! On a enfermé beaucoup de fous furieux qui avaient violé des enfants de huit ans et on ne sait pas si ceux-là n’avaient pas voulu, tout simplement, satisfaire à leur vision du beau, par conséquent failli devenir des géniaux au lieu de monomanes. On ne laisse pas le temps de cuver les crimes et on les laisse préméditer par les mille embarras de la vie moderne. Dans le pittoresque d’un crime passionnel, serait-il d’une attitude abjecte, révoltante, il y a une explosion de forces cérébrales qui peuvent ouvrir un lobe ignoré de son porteur, oui, une explosion de forces intellectuelles qui peuvent, le lendemain de la catastrophe, se ranger, se classer, retomber en pluie bienfaisante sur un champ de découverte. Tout, à ce sujet, est une affaire de petits hasards. Je suis persuadé qu’un homme n’est médiocre que parce qu’il n’a pas trouvé l’occasion d’être génial, surtout si le génie est considéré comme une guérison, non comme une maladie.
— Vous n’allez pas glorifier les assassins d’enfants, Hector, vous qui ne pouvez pas voir se débattre une mouche dans une tasse de thé sans déclarer que c’est de l’irrémédiable, murmure Andrel, formaliste à ses heures.
— Je ne glorifie personne, mais je plains l’assassin d’enfants à qui on coupe le cou, presque autant que la mouche qui crève dans sa tasse de thé. Il y a les mêmes proportions, croyez-moi… ou ne me croyez pas, ça n’a pas d’importance. La passion doit être seulement considérée comme force dynamique. Elle met en mouvement et n’a pas à conclure. Je la crois même sans objet réel. Ainsi Rogès se pense amoureux de quelques femmes parce qu’il cherche le genre d’objets qui convient à son tempérament d’artiste. Je veux admettre qu’il soit un artiste très sérieux, un jour, ce qui me semble difficile, car il finira par ne plus travailler sous prétexte qu’il manquera de matière ; il ne pourra cependant atteindre le genre de perfection dont il est capable, pas la perfection, mais un de ses modes, que s’il déniche l’objet d’art… l’objet de son art… L’assemblée saisit-elle, messieurs ?
Massouard et Andrel applaudissent, de leur banc ; moi, mis sur la sellette, je suis de mauvaise humeur.
— Permettez une objection à gauche, Hector ; les femmes, au contraire, m’empêchent de travailler.
— On ne le dirait guère, me répond son Excellence, ironique. Vous avez toujours l’air d’écrire sur leur peau tout exprès pour les chatouiller. C’est du bon travail cela, de l’excellent travail. Ça se vend dans certaines maisons sous un autre qualificatif. En librairie ça se colle sous des étiquettes fort honorables : Études de mœurs, profondes connaissances du cœur humain, psychologie, etc… etc… La vérité, je veux bien vous la lâcher, une fois pour toutes, parce que je vous aime à cause de votre franchise à être un nigaud ; vous ne considérez pas assez la passion comme force dynamique… vous cherchez beaucoup trop à conclure et vous ne lui laissez jamais le temps de devenir votre vrai tremplin, celui qui vous fera voir plus haut en vous aidant à exécuter les bonds désordonnés, toujours très ridicules aux yeux de la foule qui ne sait pas, toujours très utiles pour celui qui pressent.
Massouard, désolé de cette période :
— Pourquoi voulez-vous forcer ce garçon à sauter sur une corde raide ?
— Et quelle corde ? soupire Andrel en levant les épaules.
— Il a le choix des ficelles, murmure Hector mélancolique, et peut-être qu’il a trouvé la bonne. Je ne blâme pas son choix ; je blâmerai plus tôt le ratage de l’exercice que l’on veut faire. Je suis critique, je n’écris pas de livres, je n’oserais pas écrire un livre sur l’amour… cependant, après étude de toutes les philosophies, qui blanchissent surtout en vieillissant, je me demande si ce ne serait pas l’œuvre que je voudrais tenter… oui, un très gros livre à propos de l’amour.
L’idée que Jules Hector, le critique influent, sévère, mais juste, tenterait une histoire de l’amour depuis les temps les plus reculés jusqu’à notre lamentable époque, nous déride.
Il rit avec nous et boit un peu de chartreuse.
— Voyons, dit Massouard entêté comme une brute, vous sauteriez aussi ?… Vous qui poussez les gens à se casser les reins.
— Certes, mais beaucoup plus haut que les autres… et il ne faudrait pas que la société me mît des barrières, car je m’approprierais l’objet d’art, en supposant que je le découvre, par tous les moyens possibles, y compris le rapt, le viol et le mariage. Un objet d’art d’une réelle valeur, physique ou morale, plutôt physique, c’est un tremplin précieux, vous savez ! c’est le gage de beauté que les dieux nous accordent pour faire notre salut, remplir notre mission, gagner le pain de notre âme et toutes nos raisons d’exister… sans lui. Ah ! sans lui… (Jules Hector ajoute d’un ton sourd :) Bien fous les sages qui le laissent s’échapper de leurs mains… La société, surtout les lois morales que nous nous inventons en dehors de toutes les justices, enchaînent tellement nos poignets, quelquefois !
Nous nous regardons fixement, Jules Hector et moi, et nous n’écoutons plus les réflexions d’Andrel.
Je vois bien qu’il songe aux Javanaises…!
… Parce que je songe à Cléopâtre.
— … De nos jours la passion est sans objet, dit-il, me répondant sans que j’aie pu parler, ou tous les objets sont si loin. Pas en France. Non… plus en France.
Et il fume, les yeux clos.
A ce moment de discussion grave, on sonne à la porte du temple. Je tressaille parce que je n’attends personne. Il est minuit.
Le vendredi soir, j’ai toujours mes trois camarades, pas plus. Nous avons arrangé cela ensemble parce que nous nous sommes aperçu qu’on ne pouvait pas causer dès qu’on était six ou huit. Nous avons été cinq un moment, avec un arriviste plus jeune, mais cette petite bonne à tout faire du succès nous servait des cancans de journalistes et se servait de nos mots pour servir des journalistes. Nous l’avons prié de rendre son tablier. Nous ne sommes que quatre pouvant nous tolérer. Andrel fait un roman toutes les années bissextiles, un livre solide, ennuyeux, d’une écriture merveilleuse ; moi je bâcle un volume tous les ans, qui peut amuser les femmes, selon l’opinion d’Hector, mais dont le style laisse à désirer… même aux femmes. Nous nous complétons parce que nos défauts respectifs nous sautent aux yeux et que nous sommes heureux d’avoir mutuellement à nous pardonner quelque chose.
Massouard, le rustre, amuse Jules Hector, le systématique Hector, qui critique et invente des systèmes de naissance sans jamais avoir mis une seule œuvre debout. Habillé comme un Anglais soucieux de correction, Hector contemple avec une joie intense Massouard vêtu en maçon du dimanche et déchargeant sa pipe à petits coups secs sur l’épaule des statues les plus fragiles, plâtre, terre cuite, albâtre, marbre blanc, si bien que ses confrères, les sculpteurs mondains, en sont à ne pas oser lui montrer leur création.
Car celles de Massouard… qui pourrait les atteindre à l’épaule ?
Second coup de timbre.
Joseph doit dormir sur la banquette de l’antichambre ou est allé se coucher. Je suis angoissé parce que je pense immédiatement à Cléopâtre, je ne pense qu’à elle, puisque ce n’est pas elle qui peut venir. Elle a mon adresse, pourtant, avec ma carte.
Dans l’atmosphère bleutée du salon règne un calme et une sécurité qu’on ne devrait pas troubler… si ce n’est pas elle ! je vais voir. La portière retombe sur moi en même temps que ces mots d’Andrel :
— Ce Rogès, quel esclave de sa ficelle ! Je parie qu’on vient la tirer jusque chez lui. Ça, c’est un coup de sonnette de femme. Hélas !
Un tourbillon de soieries, de dentelles, la mollesse d’une fourrure et une odeur violente de chypre.
C’est Julia.
— Tu es folle ! sans prévenir… Et ton mari ?
— Non… J’ai une voiture en bas, j’arrive de chez les Devierne, de leur vendredi, j’y reste plus ou moins, c’est pas important. Mon mari travaille, suis venue au hasard de la fourchette… Tu travailles aussi, tant mieux, nous allons nous amuser… J’ai deux heures.
— Plus bas, malheureuse ! Il y a du monde… pas de femmes, des amis, un clan qui te connaît, que tu connais… Massouard et les autres… c’est impossible.
Je songe que ce qui est impossible c’est que je la renvoie. Elle aurait une attaque de nerfs.
Elle se tord, prend son parti, et entre dans le salon, tête haute :
— Bonjour, Messieurs. Comment, mon mari n’est pas là ? Je viens reprendre mon mari, en passant.
Cela s’est fait si rapidement que je n’ai pas eu le temps d’un geste, je bafouille, j’explique des choses inutiles, car tout le monde a compris, et mes trois amis se lèvent en s’entreregardant comme trois augures.
— Oui, Mme Noisey vient reprendre son mari… qui m’avait promis de venir, et il s’est excusé par télégramme comme vous savez, Messieurs. (Une gaffe !) Nous allons avoir le plaisir de lui voler sa femme quelques minutes pour le punir de ce lâchage.
Et mes yeux ajoutent, furibonds :
— Quelques minutes, tu m’entends, petite peste !
Ils savent que je mens.
Elle sait que je mens.
Nous savons tous que nous mentons.
Qui trompe-t-on ici ? je crois que c’est Noisey, mais je n’en suis pas bien sûr.
Le petit singe de Vénus est entré dans le temple.
Massouard cache sa pipe, comme un gosse mettrait sous sa blouse une poire volée.
Andrel rentre des manches douteuses.
Hector jette son cigare d’un mouvement d’impatience.
Je vais ouvrir une fenêtre pour chasser le nuage.
Du froid pénètre. On se tait.
Elle est très à son aise, détache son manteau, ôte ses gants. Elle est outrageusement décolletée, a une jupe de tulle pailletée sur satin rose, un corsage haut d’une phalange et un croissant de brillants éclaire ses cheveux. Je connais le croissant… il me semble qu’il brille moins. Ses yeux de myope sont humides, sa bouche se mouille, et elle rit.
Elle n’a jamais eu tant de mâles à la fois à faire embêter.
Nous songeons que chacun notre tour, ce serait plus drôle.
— Eh bien, quoi, Messieurs ? Vous ne fumez plus ? Offrez-moi, au contraire, une cigarette, j’adore ça, et puisque mon mari n’est pas là… je vais le remplacer. (Elle fume, je suis consterné.) Tiens, Monsieur Massouard ? heureuse de causer avec vous, je viens un peu pour cela. J’avais demandé à mon mari de vous prier pour un buste. Ne me faites pas cette lippe ! Vous fabriquez des bonnes femmes que je gobe. Je suis toute petite et ça m’irait de grandir comme votre Jeanne d’Arc, j’ai pas de lignes du tout et M. Louis Rogès prétend que j’ai l’air d’un singe en peluche… Si vous vouliez le faire mentir…
Jules Hector laissa tomber ceci, tranquille :
— Ce ne serait pas la première fois, Madame.
Massouard est ahuri. Il secoue sa crinière de lion roux.
— Mais, Madame, je ne travaille pas dans les mondaines, moi. De la ligne… on a toujours de la ligne, cependant, non, je ne vous vois pas en Jeanne d’Arc.
Et il a son gros rire de gros brasseur de glaise.
Andrel ajoute, conciliant :
— Peut-être en Esméralda… rien que pour la chèvre.
— Qu’est-ce que c’est que Esméralda ? demande Mme Noisey qui a lu tous les livres de Catulle mais n’est pas allée jusqu’à Victor Hugo, ayant entendu dire que c’était la même chose.
— C’est, fait Andrel très respectueux, une danseuse sacrée du temps d’Osiris.
Je suis sur les épines et j’offre du thé. Seulement il n’y a plus de thé, et les petits fours sont finis. Reste des liqueurs, beaucoup trop fortes ; si je lui fais boire de la chartreuse verte, elle va se répandre en mille folies, et, comme ce n’est pas une drôlesse, je serai obligé de me fâcher avec des gens que j’aime bien, pour cette drôlesse.
Elle jacasse, minaude, griffe, déclare le dernier livre d’Andrel, trop décadent. Elle a beau secouer sa jupe pailletée, nous sommes en bois. Ah ! Andrel a raison, une servante vaudrait mieux, elle servirait le thé, bourrerait les pipes, et, l’heure de la littérature venue, elle s’en irait se coucher, sur les pointes, pour ne pas faire de bruit.
Hector est le plus cruel. Il retourne contre elle tous ses mots et la frappe par derrière avec des manières de stylets italiens qu’elle sent, mais qu’elle ne peut pas voir. Massouard finit par la frapper, lui, de l’index, sur l’épaule, comme s’il débourrait ; Andrel propose des promenades à bicyclette… La soirée se gâche complètement.
Enfin ils s’en vont.
Massouard pour éviter le rendez-vous du buste.
Andrel pour fuir le rendez-vous de bicyclette qu’il a d’abord désiré. (Il redoute une scène de jalousie… pas de moi.)
Et Hector part le dernier en lui baisant la main, très gracieusement.
Seuls :
— Tu m’en veux, Loulou ?
— Je suis littéralement exaspéré, si tu tiens à le savoir. Ton mari a peut-être eu l’idée d’aller te chercher chez les Devierne, et le vois-tu ne t’y trouvant pas ? Tu es folle ou tu as envie de nous forcer à nous couper la gorge, dis ?
— Il y aurait de quoi, je t’assure ! Vous êtes aussi bêtes l’un que l’autre (elle tapote sa jupe).
J’éclate :
— Mais pourquoi viens-tu ?
— Tu n’es pas poli, mon cher… je viens (elle cherche), je viens pour te faire plaisir. (Elle m’embrasse :) J’ai deux pauvres heures, je te les apporte et tu grondes ?
Elle saute à mon cou. Elle se frotte à moi et se fait choir de la cendre de cigarette dans le dos, malgré tous mes efforts pour la maintenir à des distances respectueuses.
Voilà que je joue les Massouard, à présent. Je débourre sur l’épaule des statues. Mais celle-là est si petite.
J’ai passé la nuit précédente chez Thilde. Je suis très vanné. J’ai plein le dos de l’amour gentil comme elle a plein le dos des cendres de ma cigarette.
Tout de même je souffle un peu pour écarter ce voile gris.
Elle rit, chatouillée.
— Pourquoi que tu souffles ?
— Rien, des cendres. Dois-je te reconduire ou faut-il aller payer le fiacre ? Si ton cocher te lâche, nous serons jolis…
— Non. Me lâchera pas. Nous avons une petite heure… et je n’ôterai pas ma belle robe.
Je me demande quelle différence il peut y avoir entre Mlle Léonie, la pierreuse, et Mme Julia Noisey, femme d’un honnête architecte ?
Au moins Léonie ressemble à Cléopâtre, elle !
Subitement calme, je la dépose sur un fauteuil.
— Lia, je ne joue plus. Tu as dépassé la mesure.
— Hein ? Il y a de la mesure, maintenant ! Ah ! non, c’est idiot ! Risquer de se faire tuer pour un homme ! Tout planter là pour venir se jeter à son cou et l’entendre verbaliser comme un garde champêtre… Ça c’est trop fort ! Tes amis ? Est-ce que tu n’aurais pas dû les flanquer à la porte en mon honneur, espèce de grand mal élevé ! Tes amis ! Ils sont propres ! Massouard, c’est un palefrenier. Lui confier mon buste ? Je ne lui montrerais pas ma jambe, seulement. Mon mari en connaît de plus chouettes, des sculpteurs dans l’architecture ; et ton Andrel qui pond des livres comme des Bottin ! On ne peut même pas fourrer ça dans son lit pour s’endormir, tellement c’est gros. Ah ! Ne crie pas… tu m’as dit déjà qu’il faisait trop dense… sais pas ce que ça veut dire, mais je lui répéterai un jour, sois tranquille. Quant à Hector, je lui en passe parce qu’il est poli, seulement j’ai idée qu’il doit être symboliste ou… pédéraste, car il ne serait pas toujours habillé de noir et ganté de blanc comme une lettre de faire part !
Je suis étourdi, suffoqué, sans voix. Non, je n’ai pas envie de crier, j’ai envie de me sauver.
Elle me griffe.
— Symboliste ou pédéraste, Jules Hector ? Lia, taisez-vous, sacré tonnerre, ou je vais vous gifler !
Elle est debout, furieuse, ses cheveux courts semblent droits, ses sourcils sont en accent aigu, sa bouche est violette, elle a ses ongles en avant.
— Moi ! Essayez donc de me battre, moi que mon mari n’a jamais osé toucher ! Vous êtes déjà assez brutal, Dieu merci. C’est bon… je m’en vais… tant pis si mon mari est chez les Devierne, je lui dirai d’où je sors et tu auras du plomb dans la cervelle, puisqu’au fond tu as peur de ça !
Le malheur est que mon état de nerfs ne me permet pas de juger drôle une offense de singe.
J’ai levé la main et je la gifle, histoire de me différencier du mari.
Pas très fort, assez pour lui donner des couleurs.
Elle pleure, se roule sur le tapis et casse les barreaux d’une chaise volante.
Je suis très honteux et j’essaye de l’embrasser sans aller plus loin que de plates excuses.
Elle me rattrape, se tord, me mord. Il est clair qu’elle va finir par gagner la partie. J’en tremble…
En bas, sur le pavé, le bruit monotone d’un sabot de cheval qui se morfond dans la rue à marquer l’heure…
Je m’imagine entendre le mari, frappant ma porte d’un poing résigné.
Dans la débâcle des jupes pailletées, puis roses, puis blanches, puis encore très roses, je me perds, je m’attarde, j’ai l’odieuse sensation d’accomplir plus une corvée mondaine qu’une cérémonie amoureuse.
Elle est déjà toute consolée, daigne sourire, se relève en retapotant ses jupes.
— Voyons, Lia, c’est pas sérieux ? Voici deux fois que tu me joues ce tour. Tu manques absolument de générosité, épouvantable petite singesse ? Tu vas te sauver maintenant.
— Tiens ! C’est pour payer la gifle.
— Pardon ! Rends-moi ma monnaie alors.
Elle est d’aplomb, lisse, proprette, et à part un pli dans les bouffants de ses manches et un autre, sous les yeux, elle est fort digne.
— Non !… Je me trotte. A lundi le dîner chez moi, c’est convenu, hein !
Je ne risquerais pas un viol, en ce moment, pour toute la littérature. Le mieux est de l’accompagner jusqu’à sa voiture, en s’effilant les moustaches, et en l’appelant : chère Madame, c’est plus facile.
Pendant que nous descendons l’escalier, moi, tenant un bougeoir, elle ses jupes qu’elle retrousse afin d’éviter d’accrocher ses dentelles au bout des tringles, elle me débite des choses monstrueuses, dans le cou :
— Si tu étais bien raisonnable, bien gentil, ce serait toujours comme ça et nous serions bons amis tout plein. Tu comprends, j’ai peur des gosses, ce serait une histoire que mon mari ne me pardonnerait pas, lui qui fait tant attention… Et puis, me vois-tu sans taille, malade, neuf mois et plus ? Un médecin m’a prédit que j’en mourrais… mets-toi ça dans la tête… si tu m’aimes. Non, tout l’amour, c’est vraiment sale. Vous ne pouvez pas vous figurer ce que vous avez l’air bête… car nous avons le temps de vous regarder, tandis que vous autres, vous ne nous voyez même pas… Le reste, à la bonne heure… il faudrait seulement supprimer les gifles, je suis assez jolie pour qu’on prenne des gants.
Elle appelle ça des gants !
J’ai beau connaître la petite antienne par cœur, je suis secoué d’un fou rire. En a-t-elle un profond mépris de l’homme, et elle n’ajoute même pas la pudeur de l’oubli. Quand on songe que Thilde, de son côté, appelle toutes les bagatelles de la porte les choses sales.
A mon tour je me tords et nous nous quittons sur des éclats de rire qui s’étouffent dans nos baisers.
Mais je vais rompre. J’en ai assez.
Le petit singe est sorti du temple, heureusement.
Il fait gris, je crois qu’il pleut, j’entends venir, du sixième, les cris despotiques d’un enfant qui braille comme cela depuis une heure. Je ne peux plus écrire. Je suis navré.
Devant moi, monceau de papiers, livres ouverts, du vin Mariani dans une coupe illyrienne qui m’amuse toujours par ses reflets de vieux bijou byzantin, et, derrière moi, la caresse discrète d’un bon feu. Je suis aux meilleures loges pour voir la vie, ou ce que je crois être la vie, en littérature, et je ne peux pas achever les phrases, rien ne sort, c’est inutile de continuer, je perds mon temps.
Enfin, pourquoi cette maison, qui est d’ordinaire si tranquille, devient-elle, certains jours, inhabitable ? Les enfants hurlent, des chiens, qu’on n’a jamais rencontrés sur les paillassons, aboient lamentablement ; des bonnes font des réflexions d’une voix perçante et Joseph éprouve le besoin de bousculer des meubles, de l’autre côté.
Je me lève. En marchant je trouve cette idée que, peut-être, je m’aperçois des bruits de la maison surtout quand je n’ai pas envie de travailler.
L’enfant se tait.
Passe un camion.
Jadis, il y a trois ou quatre ans, je n’entendais jamais un camion passer dans ma rue. Vraiment, cette maison est inhabitable.
Autre réflexion logique : « Ah bien ! pour ce que tu écris… »
Si, seulement, une femme…
Je pense aux yeux de cette fille. Est-elle guérie ? Est-elle revenue ? Si elle avait jamais l’idée de me remercier de mes pauvres roses ?
Non, elle n’aura pas cette idée. Elle est d’un monde où on n’a pas ce genre d’occupation.
Je pense donc toujours aux yeux de cette fille ?
Coup de timbre.
— Pstt !… Joseph, j’y suis pour n’importe qui. Ouvrez vite.
Joseph, qui a reçu, le matin, l’ordre formel de défendre ma porte, va ouvrir en prenant un air pincé.
J’entends le bruit d’un parapluie qu’on dépose, un peu lourdement, dans la grande potiche.
Ce n’est pas une femme. Les femmes ne se séparent pas de leur parapluie. Elles vous les fourrent sous les coussins du canapé, les accrochent à un cadre, avec les pincettes, à gauche de la cheminée, dans tous les endroits impossibles, où elles les y oublient, le plus souvent, mais ne les posent pas dans l’antichambre parce que ce serait normal.
C’est un homme, un raseur.
Je me remets à écrire, très grave, dardant des prunelles profondes, des regards de personnage très absorbé par le problème social. Le raseur va saisir tout de suite, si c’est un Monsieur bien élevé, qu’il est en train de troubler l’éclosion d’un chef-d’œuvre… et j’écris, machinalement, la première phrase venue :
« Nous avons sur les yeux comme un voile de cendres. »
Ça n’a d’ailleurs aucun rapport avec le reste de la page.
— Est-ce que je ne vous dérange pas trop, Monsieur Rogès ?
Une voix douce, un peu tremblante, une voix de garçon embêté, fatigué, très affectueux.
Je lève la tête, subitement fou de terreur.
C’est Gaston Noisey, le mari de Julia.
Il n’est jamais venu chez moi.
Je dîne rarement chez lui, nous allons souvent au théâtre tous les trois, et nous échangeons les menues politesses d’usage entre gens du même monde qui s’estiment… de loin. Je lui épargne les trop longues intimités, les poignées de mains chaleureuses et les effusions, toujours désagréables à se rappeler quand on doit finir, un matin, par ne plus pouvoir se souffrir. Je l’ai prié, comme je le devais, de me rendre visite quand bon lui semblerait : des tableaux à voir, des livres, et un certain traité d’architecture indo-chinoise, mais je me suis arrangé de façon à ce que cela ne le tente point. Aux fumoirs des soirées où nous nous retrouvons une ou deux fois par mois, nous causons du ton détaché et plaisantin des gens qui n’ont plus rien à se dire.
Pour l’honneur de notre sexe, je ne peux pas supposer qu’un mari, jeune, assez intelligent, serait-il à mille lieues de toute littérature et de toute psychologie, ne puisse pas se douter, au seul parfum de la peau de sa femme, qu’elle le trompe.
Si Gaston Noisey, l’architecte d’humeur casanière, vient me faire une visite, c’est qu’il sait tout, comme au dernier acte.
Le fauve qui dort en moi se réveille dès que je me sens en présence d’un danger physique, c’est-à-dire j’ai d’abord très peur et mon second mouvement cherche une arme, parce que la bravoure est une résultante immédiate de la peur, pour les animaux, du moins.
Je recule, d’instinct, du côté d’une panoplie où se réunissent, en étoile d’acier, cinq lames de poignards qui ne peuvent servir à rien.
Il serait simple de frapper le premier.
J’ai à peine effleuré du dos la panoplie que je redeviens très civilisé : je vais à lui, les mains tendues :
— Comment allez-vous, Noisey ? je suis heureux de vous voir. Non, je n’ai justement pas envie de travailler, pas mieux à faire que de causer avec un homme d’esprit.
Il me serre la main.
Nous ne sommes pas tragiques du tout.
Il s’assied, souriant dans sa barbe, une jolie barbe. C’est un garçon de trente-deux ans, grand, un peu fluet, des yeux très bons, des gestes un peu indécis d’homme qui ne comprend pas très bien tout ce qui lui arrive, mais la résignation de qui sait, cependant, en accepter les conséquences. Règle générale, il y a tout à craindre d’un personnage résigné quand il est en face d’un impulsif de ma trempe : c’est toujours l’impulsif qui a le dessous.
— J’avais besoin d’aller aux Beaux-Arts aujourd’hui, murmure-t-il, et je n’ai pas voulu passer si près sans venir vous voir. Vous savez que je suis un peu hibou, votre monde littéraire me fait l’effet d’un épouvantail. J’ai bien hésité… puis nous avons tant de fois causé ensemble à cœur ouvert…
Est-ce que nous sommes dans un vaudeville ou dans une tragédie ? je ne comprends plus. Ou Lia lui a tout avoué en un transport de rage parce que je lui ai écrit (poste-restante, selon l’us) que j’en avais assez, ou il a pincé des lettres malgré nos précautions. Quant aux amis, personne, cela j’en réponds, n’a divulgué quoi que ce soit. Ils sont bien trop indifférents.
Bon Dieu ! j’ai chaud.
— Mon cher Noisey, je suis tout entier à votre disposition.
Et je souligne, d’un regard froid. Je crois que je suis seul à me donner des répliques. Il prend des cigarettes que je lui offre (justement celles que sa femme a l’habitude de fumer ici) et il s’installe, le buste un peu incliné, les yeux très humbles, avec une allure de chien battu qui serait risible en toute autre occasion. Sa main gauche déplace naïvement des petits objets sur le coin de ma table et sa main droite lustre le bord de son chapeau.
Je mets mon coude sur mon papier, mon menton dans ma paume et j’attends.
— Est-ce que vous travaillez comme ça tous les jours… du même train ?
Une interview ?
— Non, vraiment. Il y a des fois où je suis d’humeur massacrante. Ainsi, quand vous êtes entré, j’avais envie de tuer quelqu’un, ou de me jeter par la fenêtre, je suis très nerveux. Votre venue est une aubaine. Dans nos romans, il y a certaines situations qu’il faut savoir dénouer coûte que coûte. N’est-ce pas votre avis ?
Je raille. Je suis direct, j’ai une jolie ligne, je me regarde marcher avec plaisir… seulement, je réfléchis que, tout de même, c’est en hiver, qu’un duel avec un architecte ce n’est pas drôle, que je ne fais plus d’escrime depuis un mois, faisant trop de femmes, et que, dans les reins, une traître pointe de fatigue…
— Moi, j’ai aussi comme ça des jours où je ne suis pas rose.
Il fume, mélancolique.
— A propos : comment va Mme Noisey ? Voyez mon étourderie, j’oubliais de vous en demander des nouvelles. Mes excuses, cher Monsieur.
— Elle va bien, elle va très bien… sauf les nerfs… Une indisposition qui court, en ce moment, je crois. Je venais… Écoutez Monsieur Rogès, vous allez peut-être vous moquer de moi, je viens vous demander un conseil… oui… là… ne froncez pas les sourcils. Les bourgeois, comme vous dites, ça n’entend rien à la littérature et ça vous a une grande confiance dans les littérateurs, des savants, toujours. J’ai lu quelques-uns de vos livres et j’ai été très étonné de voir des choses sur la vie que j’ignorais. C’est bien bizarre comme tout est clair quand vous l’expliquez. On pense en les lisant : « Ça doit lui être arrivé, tout ça. » Au fond, il ne m’est pas arrivé tant d’histoires… je le regrette. Je vais risquer de vous demander un avis comme à un confesseur. Les bouquins… ça rend presque sacré et… ça tourne bien des pauvres petites têtes, aussi.
Quel jeu jouons-nous ? Il est impertinent, ce me semble, l’architecte.
Je réponds avec une impertinence plus marquée :
— Je ne suis pas un saint, je vous assure, Noisey, vous exagérez… par politesse. Débrouillons : quel conseil voulez-vous me demander ?
Il respire doucement, se caresse la barbe. C’est étonnant comme il est simple.
— Oh ! je vais vous paraître un peu ridicule ; mais c’est plus fort que moi, j’ai confiance en vous, parce que vous êtes très gentil, très bien élevé ; je vous ai entendu vous emballer tellement sur les questions d’amour, et prétendre qu’on n’a pas le droit de corrompre des innocents… alors… j’ai fini par me dire que ce serait encore vous qui sauriez me tirer d’embarras.
Va-t-il m’emprunter de l’argent ?
Le mot de Mlle Léonie me revient : « Tout ça, c’est du chiqué ! »
— De plus en plus à votre service, mon cher Monsieur.
J’émiette un bâton de cire à cacheter pour prendre patience. Le préambule est un peu long. Au théâtre ce serait d’un goût détestable.
— Monsieur Rogès, pourquoi espacez-vous vos visites depuis quelque temps ?
— Mais, mon cher Noisey, je suis tellement roulé par la vie des lettres. Une première, des romans, et des correspondances folles. Je vous ai déjà dit qu’il y avait des trous dans mon existence absolument comme dans la lune. Je m’éclipse, je m’enferme, et, au lieu de faire la noce, selon la jolie expression de Mme Noisey, je travaille sans même le souvenir de mes meilleurs amis.
— Êtes-vous bien sûr que vous n’avez pas d’autre raison… pour nous fuir ?
— Je vous jure…
Il hausse les épaules, ses bons yeux deviennent tristes.
— Allons ! Allons ! Ce n’est pas vous qui l’avoueriez. Je vais vous apprendre, moi, pourquoi vous nous fuyez, Rogès… car vous nous fuyez, maintenant… C’est parce que… parce que ma pauvre petite folle de femme s’éprend de vous et que cela vous agace… Ça y est-il ? Est-ce bien cela ?
Je suis tué.
Heureusement que je ne peux jamais pâlir étant déjà très pâle, de naissance, mais je dois lui faire une paire d’yeux fixes très réussis.
Un silence relativement mortel.
— Oui, Rogès, reprend Noisey de son ton amical, humblement. Je vous scandalise et je vais m’expliquer. Nous sommes seuls, vous avez le temps, et, je vous le répète, j’ai toute confiance en vous. (Il fume.) Écoutez-moi bien : j’ai épousé une petite pensionnaire, naïve, gamine, elle avait seize ans quand nous nous sommes mariés — et elle est, aujourd’hui, à vingt-quatre ans, aussi gamine que le jour de son mariage. Je sais qu’elle m’aime bien, je ne le mentionne pas par fatuité… non, elle me l’a prouvé maintes fois, mais elle est sentimentale en diable et c’est là le défaut de sa cuirasse. Je ne me dissimule pas que je ne suis pas toujours son rêve. Je suis positif, hélas, autant qu’un bon mari peut l’être, et je l’aime, de mon côté, sans rester dans les nuages. Elle a des idées de pensionnaire, de fleurs bleues, de fantômes et d’amour éternel qui sont absurdes, lui font trouver que la soupe c’est toujours de la soupe. Ah ! la femme est un ressort bien délicat, on a vite fait de tout fausser rien qu’en laissant sonner l’heure à sa pendule. Enfin, nous sommes entre hommes et je serai plus franc : j’ai le malheur d’avoir épousé une petite femme qui n’a pas de sens, et, par-dessus le marché, cette petite femme-là a eu le malheur de lire un livre de vous où vous parliez de deux amoureux qui voulaient rester purs. Ça lui a tourné, monté l’imagination, elle n’a pas du tout deviné que vous vouliez parler d’autre chose et ce n’est fichtre pas moi qui lui ai fourni des détails. J’ai fort bien suivi son raisonnement, son état d’âme, comme vous dites, les gens de lettres. On n’est pas très bête quand on aime beaucoup sa femme et on l’écoute causer, sans en avoir l’air. Elle a cru que l’amour pur, l’amour de tête selon votre expression, existait, et elle vous a supposé capable, à cause de votre allure de beau chevalier, de ce tour de force. Ne vous a-t-elle pas fait des tirades là-dessus devant moi, un soir, au dessert ? Ne niez pas. J’ai compris. Vous avez répondu par des plaisanteries, puis, à partir de ce soir-là, vous vous êtes espacé… car vous êtes un honnête garçon ; de plus, vous n’êtes pas libre. Ce n’est un mystère pour personne que Mme Mathilde Saint-Clair, la grande pianiste…
Je me lève brusquement.
— Permettez, cher Monsieur. Il faut laisser le nom de cette dame en repos. Il s’agit de votre femme, rien que de votre femme pour le moment. Vous avez découvert, ou cru découvrir que Mme Noisey était amoureuse de moi et vous venez me le reprocher, c’est trop naturel… Mais quel conseil voulez-vous me demander à présent ?
Je me promène de long en large pour me dégourdir les jambes. Il est évident que je me bats demain. C’est un nouveau système d’ironie. Il est très bien, ce Monsieur, j’admire sa ligne et s’il est aussi fort aux feintes de l’escrime… J’aurai du fer à retordre. Me voilà propre : je lâche la femme, je pense avoir la paix et le mari me tombe sur les bras…
Noisey ajoute d’un ton soumis.
— Je viens tout simplement vous prier d’écrire un livre pour expliquer à ma femme que les hommes ne sont pas anges (il rit). Vous cherchiez l’autre jour un sujet de roman. Eh ! En voici un qui se vendra ! J’ai déjà dit à Julia, qui faisait l’éloge de votre respect pour les dames, que l’amour de tête n’était possible qu’accompagné de l’autre, et, très certainement, vous couchez avec la belle Mathilde.
— Mon cher Noisey, vous vous moquez de moi ?
— Pas du tout. Je sens bien que vous n’aimez pas ma femme. Elle vous déplaît, je vous ai entendu raconter à M. Andrel que vous la trouviez laide et un peu folle ; seulement, elle, vous a dans la tête parce qu’elle cause de vous tout le temps. Si c’était plus grave, elle ne me ferait pas ses confidences. Elle m’a déjà dit vingt fois : « Va donc me le chercher, il m’amuse et je ne peux pas me passer de lui. » (Il ajoute, un peu sévèrement, du ton d’un bourgeois qui prend un artiste au collet :) Dame ! Vous faites le mal sans le savoir, vous autres. Ce serait justice de nous aider à le réparer. Vous pouvez bien écrire un livre naturel, pour changer.
Ils ont donc tous la monomanie de croire que leurs histoires naturelles sont intéressantes, ces sacrés bourgeois… et tous la monomanie de vous fournir un sujet ?
Je me plante à califourchon sur une chaise, la même dont Lia, en se roulant, a cassé deux barreaux, et je le contemple.
— Vous êtes prodigieux, mon ami Noisey.
Lui, modestement :
— J’aime beaucoup Julia, vous savez ; alors, je me suis dit que vous, qui êtes au fond un bon garçon, vous emballant si facilement, vous vous emballeriez là-dessus et que vous me tireriez du mauvais pas où vous m’aviez mis. (Sourire très malin.) Un livre un peu plus cochon que les autres, ce n’est pas une affaire pour vous. Ça la dégoûtera des amours pures, elle vous traitera de malpropre, car pour elle tous les hommes… positifs sont des sales, et je serai sauvé : elle vous prendra en grippe.
Je commence à dégringoler de mes sommets tragiques.
Je m’amuse.
— Voyons, Noisey, vous êtes jeune, pas plus bête que le voisin (au moins autant !) et votre femme vous aime… pourquoi redoutez-vous ce caprice… de tête de la part d’une personne honnête qui n’a pas de tempérament ?
— Tiens ! (Il s’anime.) Moi, je n’ai pas l’étourderie de Julia. Je veux bien admettre que cela débute par des blagues, mais ça finit par devenir sérieux quand ça intéresse le voisin. Si jamais elle en rencontre un qui se pique au jeu… Je n’ai pas envie d’être cocu plus tard, moi.
Est-ce que j’avais la berlue, tout à l’heure ?
Il est sûr de ne pas l’être encore, cela saute aux yeux, et je reconstitue la scène : elle aura été surprise pleurant après mon télégramme, nerveuse, noyée de vapeurs ; comme elle le mène par le bout du nez, elle lui aura fait avaler qu’elle avait un caprice de pure imagination pour moi, qui suis un chaste, tellement réservé…
— Dites-moi, Noisey, puisque vous me faites l’honneur de m’introduire dans vos secrets d’alcôve, pourquoi Mme Noisey n’a-t-elle pas de sens ? Est-ce qu’elle est malade ?
— Non. Elle se porte à ravir, seulement, il y a les fameuses migraines, elle est nerveuse, délicate, si petite… Un rien la froisse, et l’amour, ça lui semble toujours une corvée désagréable.
Je ne donnerais pas ma place pour un empire. D’ailleurs, il y a de ça dans son instantané, elle considère l’amour comme une chose fatigante, tellement fatigante que…
— Allons donc, moi qui la croyais très amoureuse de vous au contraire !
Soupir de Noisey, soupir sincère.
— Amoureuse de moi, oui, seulement à la condition que je reste tranquille. Et tenez, un exemple : nous sommes restés un an seuls, en tête à tête, à la campagne. Je ne l’ai jamais sentie me désirer de bon cœur. Nous étions bien seuls, aucun voisin pour lui parler de fariboles… Je suis fixé. Elle n’a pas de tempérament… C’est une pensionnaire. Quant à essayer, pour lui faire plaisir, du fameux amour de tête, de roucouler dans les étoiles ou d’évoquer des fantômes au clair de lune… Serviteur ! Je n’ai pas le temps.
Je me tords, intérieurement. Avec ma rage de courir à tous les paroxysmes, je m’exagère les ridicules de ce mari, et je ne vois pas le beau poème de sa douleur. Il est résigné. Oh ! ce n’est pas moi qui peux saisir tout de suite la grandeur du mot résignation, ce mot-là ne me représente qu’un homme regardant par le soupirail d’une cave. Résigné, mais bon gardien de son trésor ; il ne la quitte pas (sauf une heure ou deux !), l’étudie, l’écoute, la console et tente même, du fond de sa cave, des démarches un peu ridicules. Il est persuadé qu’il ne sera pas cocu s’il prend des précautions. Nous en sommes tous là, et, s’il vient trop tard, c’est la faute de cette sale petite bête qui a le vice des… pensionnaires.
— Mon bon Noisey, vous êtes digne d’un meilleur sort. Je vous avoue, en effet, que j’aime beaucoup Mme Saint-Clair et je n’ai nulle idée sur votre petite femme, j’ai horreur des trop petites femmes. Le livre un peu cochon. Hum ! Remède pire que le mal, cher ami ! Voulez-vous que je vous indique le véritable dénouement de la situation, moi ?
— Volontiers ! (Il sourit.) Si c’est dans mes cordes.
— Parbleu ! Faites-lui un enfant !
Je sens que je dis une rosserie. Le moyen de garder le juste milieu avec ces farceurs dont le mépris pour nous va jusqu’à nous demander d’amuser leurs femmes en des livres légers !
— J’y ai déjà songé, répond doucement l’architecte se tortillant la barbe, mais vous n’imaginez pas ce que Julia est dépensière. Elle aime la toilette. C’est tantôt une dentelle, tantôt un bijou, tantôt un meuble, et nous vivons difficilement malgré nos airs à l’aise. Ainsi, elle a la rage des diamants, maintenant, des vrais. Aujourd’hui on ne va guère acheter des diamants à sa femme avec douze mille francs de rente, sans espérance. Alors, voyez-vous, un enfant, une nourrice, d’autres fanfreluches pour le berceau… Non, mon cher, je ne peux pas.
Et il secoue la cendre de sa cigarette d’un doigt décisif.
— Dites donc ? j’ai aperçu, ces temps-ci, un croissant dans ses cheveux : des perles et des roses, au bas mot cinq cents francs. Mon petit Noisey, vous vous laissez attendrir ?
Je le dévisage, très tranquillement.
Je connais l’histoire du croissant, puisque c’est moi qui l’ai offert.
Il se tourne avec un bon geste paternel.
— Pauvre petite folle ! Un Lère-Cathelain. Elle a payé cela cinquante francs devant moi.
Je recule ma chaise. Comment, il a vu… Ah ! ça, c’est lui qui se paye ma tête depuis une heure ? J’ai acheté moi-même le croissant en question et je ne l’ai pas eu pour moins de cinq beaux billets bleus.
Je me promène dans une terrible agitation. Je sais bien qu’il a été convenu qu’elle prétendrait l’avoir acheté chez Lère-Cathelain et qu’elle se munirait d’un écrin portant cette marque… cependant le bijou est vrai, que diable, ou c’est le mari qui ment.
— Monsieur Noisey, une objection…
Je m’arrête, suffoqué.
— Quoi ? Il faut bien la laisser s’amuser avec le toc, puisque le toc l’amuse… c’est comme vos livres et les amours dans les étoiles, et quand ça ne me coûte pas plus cher !…
— Sacredieu, mon petit Noisey, ce bijou…
Je reste béant. Une idée ! Elle aura revendu mon croissant vrai pour en racheter un faux devant lui… et c’est le faux qu’elle porte… Je me rappelle que la dernière fois, il avait un tout autre aspect… cela m’a frappé… alors qu’aura-t-elle fait de la différence ?
Je suis au bout de toute ma patience, je m’y perds et j’ai la sensation d’être cocu à mon tour.
La conversation tombe. Noisey se lève. Il examine un bronze, regarde un tableau, feuillette le fameux traité d’architecture indo-chinoise. Il est un peu triste des confidences qu’il vient de me faire, point gêné.
Il sort en me demandant la permission de revenir de temps en temps, épancher son âme.
Me voici en passe de tromper la femme avec le mari.
Délicieux.
Il n’est pas plus tôt dehors que je suis saisi d’une rage. Oui, cet homme s’est fichu de moi et il faut que je m’aligne. Je ne peux pas tolérer qu’on se fiche de moi de cette odieuse façon.
Je m’empare fiévreusement d’un télégramme et j’écris :
« Cher Monsieur Noisey, en réfléchissant à notre bizarre conversation, il m’a semblé que vous n’étiez pas très fixé sur la valeur des croissants que l’on porte dans votre ménage… »
Je déchire.
Idiot, grossier, je deviens le bourgeois et lui sera le littérateur.
Autre télégramme :
« Cher ami,
« Entre nous, notre attitude manque de galbe et nous ferions mieux d’aller terminer nos explications sur un terrain plus… »
Ce qui manque de galbe, c’est de voler une femme à un homme pour vouloir ensuite coller de force un duel à cet homme beaucoup plus myope, décidément, que cette femme.
Je déchire.
Essayons d’une lettre pateline, genre Noisey.
« Voyons, cher Monsieur, de deux choses l’une : ou vous vous êtes moqué de moi et je ne puis le souffrir, ou je me suis moqué de vous et vous ne pouvez pas me souffrir, dès lors… »
Toujours le duel. Je n’en sors pas.
Je déchire encore.
Une heure, le front dans les mains.
Il y a l’histoire du croissant dont je ne sors pas non plus.
Et je revois les yeux vagues de Noisey, j’entends sa phrase pleine de conviction. « C’est une sentimentale. » La vicieuse que je connais, et qu’il ignore, laisse peut-être vraiment son cœur à la maison pour porter sa chair en ville, et le croissant vrai pour moi, faux pour lui, redevient faux pour moi, vrai pour lui.
Noisey ne comprend pas et il fait ce qu’il peut.
Moi, je ne comprends pas et j’écris des bêtises.
Julia ne comprend rien et doit nous tromper avec un troisième.
— Joseph… un fiacre ! Je vais dîner au boulevard. J’ai faim.
Nous avons tous sur les yeux comme un voile de cendres.
« … Sur le dos de l’éléphant blanc, la princesse est debout, sa main droite protégeant ses yeux longs, car le soleil incendie la plaine et fait rutiler le sable. Elle est vêtue d’une tunique blanche, roulée autour d’une de ses cuisses, laissant son sexe découvert. Elle a le buste nu, mais ses deux petits seins rigides sont coiffés de deux cloches d’or suspendues à son col par des chaînettes. Ses cheveux bouclés en grappes noires comme des grappes de raisin bleu, tombent sur ses oreilles, et un oiseau d’or paraît les couver sous ses deux ailes écaillées de gemmes curieuses. Le bec méchant de cet oiseau sacré, l’emblème d’une idole, fait plus méchant le profil de la princesse qui a l’air d’un garçon de quinze ans. Elle n’a pas de hanche et ses jambes pures s’étirent en fuseaux pâles. Elle n’a pas de ventre et l’on dirait que ses épaules fuient en deux lignes droites jusqu’à ses pieds étroits dont les orteils sont fleuris de scarabées peints. Elle est brune et blanche comme le fruit coupé des cocotiers. Elle semble toute petite, aussi très grande, quand elle se hausse pour y voir mieux. Des dessins violets terminent ses sourcils dont les extrémités, en flèches, vont rejoindre ses cheveux. Elle a un tatouage au-dessus de son sexe soigneusement épilé : il représente l’œuf du monde, un petit œuf plus ovale que les autres œufs, fendu de lignes rouges et couronné d’un serpent. Sur chaque joue de son visage, une étoile ; sur les deux moins rondes joues de ses fesses, deux croissants. De temps en temps, elle prend les cloches d’or voilant sa poitrine pour en faire des cymbales qu’elle heurte d’un léger coup harmonieux.
Accroupies près d’elle, les pieds retournés dans leurs paumes, ondulent, aux mouvements de navire de l’éléphant, deux filles complètement nues, deux esclaves. La première tient l’éventail de byssus, la seconde la boîte des fards et des parfums. Elles ont les paupières closes, ne s’intéressent à rien, attachées par une corde comme deux bêtes entravées.
Derrière la princesse, un enfant nègre, joli et de justes proportions, hausse le parasol de plumes. Il doit avoir dix ans. Il ne parle pas, ayant eu la langue coupée dès sa naissance, mais ses regards étincelants sont fiers. On le dit fou parce qu’il est le seul qui ose regarder la reine en face. Peut-être ne la voit-il plus, frappé du vertige de la peur.
Des Égyptiens armés, des prêtres mitrés se serrent contre lui, à l’ombre.
Un singe est assis au rebord de la corbeille de palmes qui contient Cléopâtre et sa cour, des tapis soyeux pendent, en houppes.
Le conducteur de l’éléphant, un eunuque drapé de laine jaune, chante une mélopée triste au son de laquelle marche, solennel et somptueux, cet énorme vaisseau blanc sur la mer houleuse des sables.
On marche ainsi depuis le matin et la chaleur se fait terrible.
Il n’y a que la reine qui ne souffre pas du soleil.
Elle ne souffre jamais de rien.
Les têtes bronzées des serviteurs et la peau zébrée de blessures des deux petites filles esclaves luisent comme toutes prêtes à se fondre sous les morsures de l’astre. Le sable pâlit de plus en plus, on ne peut pas le contempler, il entre dans les yeux en pointes de lances.
L’éléphant va toujours d’un pas égal, et, à chaque plissement de sa croupe, les corps se ploient dans la corbeille, le panache du parasol se penche.
On serait bien dans le palais, à manger des fruits, aux fraîcheurs des marbres humides.
Mais la jeune reine, que tourmentent des passions singulières, veut aller voir le champ de bataille.
Vers la tombée de la nuit, seulement, on arrive.
Déjà des choses abandonnées ont été rencontrées au sortir de l’oasis. On a découvert un guerrier mort, le front fracassé par un javelot. La reine s’est dressée un peu, ses narines au feston mince ont frémi et on a passé plus vite.
Maintenant, on est en plein carnage.
Des cadavres sont entassés avec des chevaux, des chars, des tours chues, des éléphants crevés par des flèches qui les hérissent et les font plus monstrueux.
Tout est horriblement calme.
Le sable a bu le sang et le soleil a mangé les yeux fixes qui ne purulent plus. Des armes brillent, très éclatantes, sous les rayons de la lune. Au loin, on entend hennir un cheval qui agonise… il se tait, brusquement.
La cour demeure silencieuse.
Il est bon qu’une jeune reine voie les résultats d’une guerre.
Tout à coup, dans le grand calme de cette nuit subitement tombée sur les morts et les choses perdues, un petit son de métal…
C’est Cléopâtre qui a pris les cloches d’or de ses seins et les heurte.
Les deux esclaves, à ce signal, se lèvent et offrent des parfums, car une senteur effroyable de chairs se décomposant est montée jusqu’à la princesse.
Un Chaldéen psalmodie des paroles lentes sur la gloire des guerriers braves, pendant que la reine, une de ses mains ouvertes à plat, l’autre, la droite, élevée, projetant ses poudres, se tient dans l’attitude des prêtresses assyriennes faisant l’offrande aux dieux.
— Je vais danser, dit-elle d’un accent clair.
Les prêtres ont formé aux danses sacrées la jeune fille. Elle sait aussi, la jeune femme, que sa cour est enivrée des contours purs de ses fines jambes en fuseau, et qu’au respect se mêle un rut bestial qu’on ne songe pas à lui cacher parce qu’il est un hommage.
Elle punirait de mort ceux qui ne se prosterneraient point quand elle danse, et elle épargnerait peut-être celui qui la violerait après la danse.
Personne n’ose encore.
On attend que son frère, son époux naturel ordonné par la loi, la déclare vraiment femme, reine ayant le droit de régner.
En attendant, elle a pour jouet d’amour ce seul petit esclave nègre, un enfant, forcé de ne pas dire qu’il est heureux trop tôt et qu’il en meurt…
Voici qu’elle danse.
Au milieu de la place libre laissée sur le dos de l’éléphant immobile, comme dans de la lumière, elle marche d’abord la tête inclinée, les bras arrondis en bras d’amphore blanche. Elle agite ses petites coupes d’or qui rendent un son aigûment sauvage.
Les esclaves, les grands Égyptiens préposés à sa garde, se sont assis en cercle autour du rayon qu’elle forme.
Ils ont tous les yeux fixes ou vides des morts qui jonchent le sol.
Ils sont sans autre âme que l’immense désir.
Et se corrompent, comme les morts, à la regarder vivre.
Elle saute deux fois, tourne sur elle-même, plus vite, oscille au vent de la pourriture comme une branche fleurie.
Elle respire au milieu d’eux et du champ funèbre comme en un jardin.
Elle se sent si belle !…
Ses yeux longs, mi-clos, ont des lueurs que jettent les yeux d’enfant avant de s’endormir.
Et elle heurte plus fort ses petites cloches, les secoue sur eux comme si elle voulait faire neiger ses petits seins.
Le jeune noir est debout, en face d’elle, il la regarde sans la voir, dans une extase triste…
Soudain, on entend, répondant aux tintements d’or des cymbales, un miaulement bizarre, un râle de joie éperdue ou un cri de colère.
La reine s’arrête.
Elle se penche en avant.
Puis en arrière.
— C’est un tigre, dit-elle, pas très émue.
En effet, il y a, couché sur un monceau de cadavres, un animal très grand, ou qui paraît grand parce qu’il s’allonge, qu’il a la coutume de ramper, et dont les yeux sont phosphorescents.
Il bâille, très énervé de voir ce qu’il voit.
Très étonné aussi.
Il a mangé. Il est repu pour la première fois depuis bien des jours, il a vraiment trouvé toute la nourriture de sa faim.
Il est joyeux. Il a pu achever beaucoup de mourants, finir leurs tortures.
Il allait dormir quand lui est apparue, au clair de lune, un autre animal, rampant et s’allongeant debout, une bête blanche qui bondit, saute et joue parmi les morts comme lui-même l’a osé faire, tout à l’heure.
Cela l’étonne et l’amuse.
Les animaux ne s’amusent pas souvent.
Pour qu’ils aient cette joie inutile, pas certaine, il faut qu’ils n’aient plus faim.
Parce qu’il n’a plus faim, le tigre est heureux de rencontrer une femme.
Les serviteurs de Cléopâtre ont préparé leurs arcs.
Des flèches sifflent.
Des prêtres ont peur.
La reine demeure debout, essayant de voir.
Mais le tigre, d’un bond plus rapide que leurs flèches, a sauté sur l’éléphant et s’attache à sa croupe de ses quatre griffes puissantes.
L’éléphant blanc plie sous ce poids, cependant léger, car le tigre est très jeune.
Il faut qu’il soit bien jeune pour attaquer des hommes, n’ayant plus faim.
Il fait, d’un coup de patte, verser la corbeille de palmes.
D’abord les petites esclaves tombent, sans un cri, déjà mortes, l’une avec la boîte des fards, l’autre avec l’éventail.
Puis un prêtre qui hurle.
Puis le singe qui se sauve derrière des chevaux amoncelés, en poussant des sifflements stridents de grosse flèche.
Un soldat lance encore un javelot qui n’atteint pas le tigre. Le soldat a eu peur d’atteindre la reine, toujours debout au centre de la corbeille.
Toujours debout parce que son petit nègre s’est précipité à ses pieds et lui a saisi les chevilles.
Cléopâtre regarde la bête merveilleuse dont la robe d’or se parsème de roses noires à la clarté pâle de la lune.
Et le tigre la regarde, ébloui, les oreilles couchées en arrière, les crocs saignants ; ses prunelles vertes, dans l’astre double de ses yeux, s’élargissent et se rétrécissent avec une expression de volupté féroce.
C’est un jeune mâle d’une très royale espèce.
Au fond du mystère de son animalité s’éveille comme une âme de dieu.
Car les animaux d’Égypte sont plus près des dieux que des hommes.
Cléopâtre n’a plus peur. Elle n’a d’ailleurs jamais rien redouté des bêtes.
Elle les aime toutes presque autant que son nègre.
Et elle pense qu’il dévorera ce nègre avant elle.
L’éléphant recule. Il lève sa trompe d’un mouvement de fureur et se bat les flancs en piétinant lourdement et en tournant sur lui-même.
Il saisit enfin le tigre et d’un seul effort, qui fait craquer toute sa peau, il arrache son ennemi, le lance dans le sable où celui-ci reste à hurler de douleur, une patte brisée, toute sa mâchoire en bouillie, vomissant ses dents broyées.
La cour se reforme autour de la reine.
On redresse la corbeille de palme et le petit nègre cherche le parasol de plumes.
Un Égyptien a le bras démis, les petites esclaves sont mortes, enchaînées l’une à l’autre, écrasées sous le même piétinement formidable.
On les laisse là et on appelle le singe qui ne veut pas revenir.
Cléopâtre ordonne qu’on enchaîne le tigre pour le traîner à la remorque de l’éléphant victorieux.
Et l’on revient, les hommes songeurs, la reine écoutant la toux rauque du prisonnier râlant sur sa chaîne, du prisonnier dont le long corps gracieux s’allonge le long du sable en traçant un sillon rouge.
Au palais, la reine rentre sans dire qu’on l’achève.
Des jours passent…
Et il guérit.
Il n’a plus de dents, sa patte de derrière racle un peu les marbres en marchant et il est devenu familier.
Superbe encore, gracieux, très digne souvent, quand il gronde, il joue avec la jeune reine dont il a l’humeur froidement cruelle.
Un matin, sur un signe, il étrangle le petit nègre dont les yeux tristes se meurent de langueur depuis longtemps.
Il l’étrangle de ses mâchoires édentées, mais rendues plus féroces par la jalousie.
Il ne peut pas y avoir deux favoris à jouer près de la même couche.
Dans les jardins, il ravage des fleurs et ne reçoit que le fouet, parce que, décidément, la jeune reine lui permet tout.
Des jours passent…
Le palais se remplit de gémissements. Du bas des larges pylônes aux galeries des étroites terrasses, des esclaves pleurent, le front dans des voiles, et des soldats se frappent la poitrine.
Le roi, le frère et l’époux naturel de Cléopâtre, au lieu de déclarer femme la jeune reine, sa sœur et son épouse naturelle, a résolu de la répudier.
Cléopâtre doit prendre le chemin de l’exil.
On ignore pourquoi.
On croit que ce maître veut régner seul.
Peut-être…
Le jeune prince est si grave que personne, ni les mages, ni les grands guerriers, n’ose l’aborder.
C’est un deuil universel, la reine étant l’objet le plus parfait du royaume.
Elle danse comme une prêtresse et elle est belle comme une courtisane.
On ne sait qu’une chose, c’est que le jeune prince, pour affirmer sa volonté de lui déplaire, a fait crucifier son tigre favori aux portes basses du palais.
Le tigre a mis toute une nuit pour mourir.
Et du haut de sa terrasse, elle a pu l’entendre hurler lamentablement.
Or, le jeune prince répudie Cléopâtre parce qu’un soir, en montant sur cette terrasse, il a vu ceci :
Sous le dais bleu sombre d’un ciel gemmé d’étoiles plus grosses que les opales sacrées, dans la pureté d’un air où l’on aurait entendu vibrer le chant de leurs sphères mystérieuses, la princesse, sa sœur et sa femme, se tordant, nue, entre les pattes d’un animal plus puissant qu’un homme… et plus heureux qu’un roi !
Mais Cléopâtre en exil aura l’empire du monde. Elle sait le charme qui enchaîne les fauves.
A sa cour de reine prostituée, il y aura toujours un tigre de race vraiment royale…
… Toute la littérature, tout le rêve, toutes les femmes, toutes les réalités, ne m’ont point empêché d’aller rue Grégoire-de-Tours.
Plus fort que moi.
Je voulais avoir de ses nouvelles.
J’y suis allé, oui, là.
Et puis, après ? Ai-je le droit de prendre des nouvelles de cette fille ?
Je pense que oui : j’ai l’âge de raison.
La concierge, une mégère, m’a dit, criant d’une voix qui sentait l’absinthe :
— Vous pouvez monter. Elle est revenue et elle est seule, de ce moment ici !
J’ai gravi, en plein jour, la misérable échelle de meunier, j’ai retrouvé, d’instinct, la porte… sa porte où une clé était dans la serrure.
Je suis entré, simplement.
Alors j’ai eu le vertige atroce d’affreuses murailles, j’ai vu cette chambre comme on verrait un cachot ruisselant de sang.
Il n’y avait plus les meubles en pitchpin d’il y a deux mois, il n’y avait plus la lampe voilée d’un abat-jour de soie couleur ivoire, plus de chaises, plus de bibelots, plus rien… A la fenêtre seulement, un rideau rouge tendu sur tringle, épais, hermétique, tamisant juste assez de lumière pour être abominable, un rideau rouge que le soleil d’avril faisait flamber et qui répandait un flot de lie par la chambre.
Les matelas étaient à même le sol, sans un tapis devant, et elle assise sur un vieux fauteuil canné, une antiquaille rigide comme un instrument de torture.
Elle ravaudait un bas, appuyant son pied nu sur l’extrémité de son traversin pour ne pas le poser par terre.
Je suis resté sans souffle comme un collégien.
Elle a tourné les yeux et j’ai vu se lever les astres noirs de mes désirs.
— Tiens, c’est vous, le maboul ? a-t-elle dit tranquillement.
— Oui, c’est moi, le fou, en effet. Je ne vous dérange pas ?
Elle a haussé les épaules et m’a montré son lit, d’un air froid.
— Asseyez-vous… ou couche-toi, comme tu voudras. Je suis guérie.
Elle avait une voix sourde qui me faisait très mal.
— Je suis venu pour vous demander de vos nouvelles uniquement… Et pour savoir si vous aviez besoin de moi.
— Quel béguin ! C’est pas sérieux, j’espère.
J’ai été surpris de sa logique. Elle comprend qu’elle me plaît surtout parce que je ne marche pas, selon sa canaille expression.
— Vous êtes guérie ? Ah ! tant mieux…
Je m’assieds près de son pied nu et je le regarde. Elle a un pied exquis, cambré, petit, souple, on passerait sa main dessous entre la plante et le plancher, sans en déranger le talon ni l’orteil. Il est d’un blanc d’ivoire vert, si mort. Ce n’est qu’un objet, pas une chose humaine.
— Guérie… Guérie… (a-t-elle fait comme se répondant à elle même). La seconde fois, je ne serai plus bonne pour le service, ni ni, fini Léonie. Ils m’ont enlevé le morceau avec des pinces. Brrr !… j’en ai ma claque de leur hospice.
Elle est toujours belle inexplicablement. C’est toujours Cléopâtre, et ses lèvres dures distillent toujours le venin de la cruauté. Elle ne rit pas, ne pleure pas, tout lui demeure indifférent.
— Vous n’avez pas la trouille, vous, de grimper mon escalier en plein jour. Quel type !
— Dites-moi, Léonie, vous êtes très malheureuse ici. Où sont donc vos meubles ?
— Les cochons de concierges ont tout vendu pendant que j’étais à la salade. Vous comprenez… je leur devais des tas… la chandelle, le vin, et un terme, puis, le foin, quoi !
Je suis ahuri.
— Qu’est-ce que c’est que la salade et qu’est-ce que c’est que le foin ?
Elle me regarde, méprisante.
— Ah ! c’est juste, vous n’êtes pas de la classe. Le foin, c’est la pièce par homme que je donne à cette… maquerelle.
Je deviens très inquiet. N’insistons pas pour la salade.
Je suis navré de mon ignorance du milieu, je ne cherche pas du tout une étude de mœurs, et j’ai la terreur qu’on me la serve malgré moi.
Je voudrais bien m’en aller, je ne sais pas comment.
— Heureusement que ça reprend, le turbin.
Je tressaille.
— Heureusement… dis-je en écho douloureux sans penser à ce que je dis.
— Voyons ! m’achète pas, hein, avec tes figures d’enterrement. J’enfile pas des perles, ici, et il faut que je mange. (Elle ajoute :) De vrai, j’ai pas faim. J’en ai trop vu là-bas… Tu sais, de quoi rendre son ventre à Dieu.
L’expression : rendre son ventre à Dieu est superbe, mais que nous voilà loin de mes roses blanches.
Il y a un grand silence entre nous.
Elle raccommode son bas noir en tirant très vite son aiguille ; la soie noire passe et repasse dans le petit trou blanc, sur son poing.
Elle est en jupe de laine sombre, avec un jersey rouge ouvert en rond au cou. On devine qu’elle a coupé le col parce qu’il était trop usé.
Elle a l’air en maillot de bain.
J’aime mieux ça que les cabochons. Et puis, c’est dans le ton furieux de la chambre, une chambre de tortures.
— Voulez-vous que je vous appelle autrement que Léonie, dites ? Vous n’avez pas un autre nom ?
— Je m’appelle Léonie Bochet sur les papiers, si vous voulez les voir…
Est-ce qu’elle continue à me croire de la police ?
— Eh bien, je vous appellerai Reine. Cela vous fâche-t-il ?
— Comme votre ancienne, hein ? Vous y tenez !
Je m’accoude sur le traversin, et je caresse son pied de belle morte d’un index prudent.
— L’ancienne s’appelait : Cléopâtre. Tu l’as oublié, déjà ? Et elle était couleur de roses blanches, de roses d’ivoire…
Il m’a semblé qu’un éveil se faisait en son impassible visage. Elle n’a pas souri, se contentant de retirer son pied.
— Ah ! oui, les roses !… C’est une infirmière qui me les a prises et on les a fichues à la chapelle. J’ai gardé votre carte. (Elle baisse la voix.) Il paraît que vous turbinez, vous, dans les journaux. Un interne me l’a dit.
Je suis ennuyé qu’elle me suppose journaliste. Pourquoi n’est-elle donc pas venue me trouver me sachant le Monsieur tapable ? Peut-être a-t-elle eu peur des distances. Elle est bête ou… peureuse ?
— Écoute, Reine, je ne travaille pas du tout dans les journaux et je ne suis pas du tout un Monsieur connu. (Je cherche à lui expliquer les choses et me voilà embarrassé en dernier point : nous avons l’air de personnages aux deux bouts d’un téléphone s’égosillant pour être plus clairs.) Reine… tiens… je vends de l’amour comme toi. Le mien est en papier, mais il est peut-être plus dangereux… selon certains maris.
Je ne sais pas ce qui m’arrive. Il faut que je pense tout haut devant elle, précisément parce qu’elle ne peut pas me comprendre.
Elle a un petit rire sec.
— Tu es maboul.
— Je te jure que non… j’essaye de me rapprocher de toi, puisque nous ne parlons pas la même langue.
— Bien possible. Veux-tu boire quelque chose : une menthe ou de la chartreuse ?
Je fais un geste de prière.
— Pas cela, dis, je bois tes yeux et ce poison me suffit, je t’assure.
— Espèce de dégoûté, mes verres sont propres. (Elle réfléchit.) Je les laverai devant toi, si tu veux. Je te dois une politesse.
J’ai envie de pleurer.
A trente-trois ans, c’est absurde. Comme c’est réel, ça me fait du bien de le constater, moi, le pauvre exilé de la vie, toujours dans le rêve et ne le distinguant plus de la réalité.
— Reine, puisque tu a besoin d’argent, pourquoi n’es-tu pas venue m’en demander… en sortant de l’hôpital ?
— Cette histoire ! Pour que tes larbins me foutent à la porte ! j’ai pas besoin de chambard… La police m’a à l’œil… (elle hésite) depuis que j’ai fait la fenêtre sans sa permission.
— La fenêtre sans permission ?
— Oui. Y en a qui sont en cartes, moi, (elle hésite encore) j’y étais pas. Maintenant, j’y suis. C’est plus la même chose. Il y a les heures pour le trottoir et les heures pour la fenêtre, faut pas se tromper. Je peux pas toujours me promener où je veux… rapport à un sergot de ville qui est mufle comme tout dans cette sale rue.
Sergot de ville est joli.
Je m’habitue un peu à ce langage singulier et lui découvre de la saveur.
— Ai-je le droit, malgré ton sergot de ville, de t’offrir autre chose que de la menthe ou de la chartreuse ? (Et je ris.) Tu n’es pas franche, Reine, tu n’es pas venue pour d’autres raisons ?…
Elle se tait, un instant, puis, brutalement :
— Tu m’embêtes ! Je te dis que tu es maboul !
— Ah ! sotte qui a peur que de mon côté, je cache un vilain jeu et que je veuille la chouriner comme un simple monomane !
Elle me regarde en dessous, les lèvres serrées, les prunelles sombres.
On sent que pèsent sur elle toutes les terreurs inconscientes qu’on entretient chez ces malheureuses : lois des concierges, de la police, toutes les tyrannies d’une société fière de sa pudeur et qui ne daigne que les tolérer.
Ou elle a souvenance de quelques tortures inouïes subies de bonne volonté en une de ses nuits louches de levages d’ivrognes.
Ils ne sont pas tous gris d’un rêve de poète, les ivrognes.
— Reine, est-ce que tu ne désirerais pas faire un autre métier ?
J’ai l’air du médecin qui propose l’Italie au poitrinaire pauvre.
— Moi ? je sais rien fiche… et je veux rien fiche. Je suis sur le tas… faut que j’y reste. (Elle ajoute farouche :) Je suis paresseuse, tu sais.
Il y a quelque chose de lourd sur les épaules de cette fille, de plus lourd… Elle a une raison pour se réserver ainsi devant un homme qu’elle pourrait si facilement exploiter.
Je redeviens nerveux
Je m’étends sur le lit pensant que je suis sur mon divan, chez moi, à rêver d’elle.
Je continue, impatienté :
— Enfin, combien te faudrait-il pour vivre en repos… le temps de te reposer de ta maladie.
— Me reposer ? Et coucher avec toi, hein ? J’ai idée que ce serait la même chose qu’avec les autres… ça ne serait pas plus reposant.
Elle a un rire sec, odieux.
— Mais je ne tiens pas du tout à coucher avec toi, ma fille.
— Alors ! (elle me toise) qu’est-ce que tu fais ici ?
— Si je te le dis, tu ne saisiras jamais les nuances… J’ai tout un arc-en-ciel dans l’âme à ton sujet. Des histoires de maboul ? Oui, je l’avoue parce que ce sera plus simple. D’ailleurs c’est peut-être vrai, je ne voudrais pas te causer la moindre terreur et je suis fort triste de ne trouver que la folie pour une explication honnête. Je crois que je t’aime, enfin, comme si tu étais une véritable femme.
Elle hausse les épaules.
— Fais pas ton daim !
Elle est laconique.
Drôle d’idylle.
— Reine, je voudrais aussi…
Une voix aigre nous interrompt. Celle de la concierge qui monte et qui crie, dans la serrure :
— Ninie, est-ce que ton type s’est barré ?
Je bondis.
D’elle, n’importe quelle locution vicieuse me semble pittoresque.
De cette mégère, je ne vais rien pouvoir entendre.
J’ouvre.
— Non, Madame, et je vous défends de déranger Mademoiselle quand je suis là. Vous allez vous taire.
Je lui glisse une pièce dont je ne regarde pas du tout le millésime et je la pousse vigoureusement dans l’escalier.
Elle s’effondre. On dirait du linge mouillé s’empilant.
Et je referme la porte.
— Dis donc, est-ce que tu vas faire de l’harmone chez moi à présent ? On peut vraiment nous déranger pour ce que tu me racontes…
Reine est debout, les bras croisés, les yeux en feu, elle a l’aspect sinistre.
En voilà une qui n’est pas de l’espèce qui sont bien gentilles et vous appellent Loulou. Mâtin ! J’ai la sensation qu’elle va me rendre la gifle que j’ai donné à Mme Julia Noisey.
Cela tourne mal.
Je la regarde bravement, mais je tremble.
— Tu as envie de me chasser parce que j’offense ta concierge, ma belle amie ? C’est d’un bon cœur. Seulement, je ne m’en irai pas, j’ai pas fini…
Elle va reprendre son bas noir, et rechausse son pied blanc avec un soin railleur, insultant.
— Écoute, j’aime tes yeux et je sens que je ne puis plus m’en passer. Combien veux-tu me les vendre ?
— Rien que mes yeux ?
Il y a entre nous une barrière, un mur que nous ne franchirons plus, ô Platon !
Je la condamne et je me condamne.
Je ne sais pourquoi je lui ai dit cette chose folle.
— Oui, je viendrai, je causerai, ou je ne parlerai pas, seulement, je les verrai, ils me regarderont et je te donnerai ce que tu me demanderas. Tu es d’ailleurs bien libre de ne pas accepter… si je te déplais tellement que je te fasse peur.
Je n’en ai nulle envie.
Et si elle me répondait que je lui déplais, il est certain que je sauterais dessus.
Elle doit me voir comme un Monsieur capable des pires fantaisies, une nouvelle espèce de plaie sociale qu’il lui faudra panser au nom de la grande tolérance humaine… et sans joie.
— Paie ou ne paie pas, fiche ton camp ou reste, ça m’est égal… Tu m’embêtes !
J’insiste, grelottant d’effroi et de colère.
— Je te déplais ?
— Non…
Elle a un petit rire, puis tourne la tête vers moi, les yeux fixes.
Elle prononce lentement :
— Tu veux m’aimer d’amitié, sans doute ? c’est du propre.
— Et pourquoi pas ? Qui m’empêche de chercher ton âme avec la mienne, au lieu de chercher autre chose… avec autre chose ? Laisse-toi faire sans comprendre, selon ton habitude. Ce n’est pas pour la purification des vierges folles que je travaille, chérie, va rassure-toi. Je ne suis pas un moraliste. Je suis un vicieux qui rêve de vices plus… absolus, voilà tout.
Je suis tout à fait fou et c’est elle qui a raison de sourire, apitoyée, mais ma fantaisie m’emporte si loin d’elle.
Je vois, derrière cette femme qui se chausse, des ténèbres, de la fumée, et un désert s’étendant tout rouge, s’empourprant de la buée sanglante d’une lune pareille à une tête coupée, une tête sortant de l’échancrure trop large d’un col d’une blancheur de chaux vive.
Est-ce la mort du soleil d’avril derrière le rideau rouge ?
Est-ce réellement des astres humains qui se heurtent dans un couchant funèbre, l’un éclipsant l’autre ?
Où suis-je bien saoul de la lie qui se répand à flots du haut de cette croisée condamnée par la police ?
Elle l’ouvrira tout à l’heure pour faire des signes mystérieux, et les passants monteront son échelle, une raide échelle de guillotine.
Ce qui est absolument vrai, c’est que nous sommes, cette fille et moi, en présence, comme les deux fantômes de deux forces de jadis…
… Aujourd’hui, perdues, ne se retrouvant même pas par le sens du toucher.
Il doit y avoir d’autres sens plus sensuels que celui du toucher.
Ah ! on ne s’échappe guère quand on porte en soi le souvenir de très anciens crimes !
Je suis heureux de savoir qu’elle m’est destinée avant que l’idée me soit venue de la contraindre.
Je l’aime un peu plus de toute son infamie, car la société me fournira des armes… si elle me résiste.
Me résister ? A propos de quoi ?
Je ne lui demande rien.
C’est justement cela qui lui fait peur.
— Reine ! Reine !…
Durant ce vertige, j’ai tourné autour de la chambre et me suis arrêté près de la cheminée.
Là, au coin, dans un petit cadre de paille, il y a une photographie, une mauvaise photographie faite à la foire de Neuilly ou en banlieue, par un jour de décembre. On voit une tête de soldat, un affreux voyou qui a dû mettre, avant son entrée au régiment, un képi plus regrettable.
Affreux ? Non. Jeune et très quelqu’un avec son masque diabolique, ses yeux sournois, sa bouche grimaçant en gueule de bête carnassière.
Le tigre !…
Le mâle de cette femme qui ressemble à Cléopâtre.
— Qui, ça ? ai-je dit en désignant le cadre.
— Mon frère. (Elle ajoute, plus bas :) Non, un cousin, un parent à moi.
— Tu ne sais plus si c’est ton frère ou ton cousin ? Drôle de parenté !
— Laisse-moi tranquille. Je te dis que tu m’embêtes, à la fin !
Très assorti, le couple. Un de plus, un de moins… celui-là doit lui en prendre au lieu de lui en donner.
Je rage. Celui-là, c’est celui qu’elle aime. J’en suis sûr.
Elle m’arrache la photographie et la remet sur la cheminée.
Son mouvement a été si violent qu’elle m’a griffé.
Et elle a une poigne, la sinistre demoiselle.
— Reine chérie, je n’ai pas du tout envie de me fâcher, parce que je constate que vous pouvez avoir un cœur.
Je ris un peu difficilement.
— J’ai pas de cœur. J’ai pas le temps, tu sais… Toi, tu es riche, tu n’as rien à faire ! mon bonhomme.
— Rien à faire ? J’ai à brûler ici tout l’encens que je ne peux pas brûler ailleurs… car elles ne m’ont pas fait peur, mes idoles, jusqu’à présent. Tu appelles cela ne rien faire, se sentir vivre ? Éther, morphine, haschisch, opium ou poison plus mortel, il faut que tu deviennes mon excentricité. J’en ai tellement assez de leur petit centre ! Je suis trop bien portant pour admettre les poisons lents en question ; je veux goûter à tes yeux parce qu’ils iront plus vite, comme deux morts qu’ils sont ! Il faut que je souffre, moi, pour être heureux. Et si je n’aime pas mon idole, je n’en n’aurai jamais peur… tu comprends. Reine… regarde-moi. Tu es sourde et je ne veux pas non plus que tu m’entendes… Il demeure convenu que je plaisante. Reine… Je t’adore.
Elle est devant la croisée rouge, les bras tombés, la tête si blanche qu’elle a la réverbération d’un astre.
Ses yeux font deux trous noirs au rideau. On dirait qu’ils percent la tête de part en part et que derrière, il y a le vide.
Ses yeux communiquent avec le néant.
Sa bouche est toujours dure, méprisante.
Elle a peut-être la crainte superstitieuse de l’amour.
L’amour est, pour elle, le dernier blasphème.
— Vous avez du toupet, oui, un fier toupet pour votre âge !
— Je suis très vieux, Reine, et il faut le piment des lointains mystères d’Égypte pour me rappeler ma jeunesse et ma force. Les filles qui boivent le sang des têtes coupées sur leur bouche ou celles qui jouent entre les pattes des tigres.
— Oh, bien, non ! Je ferais jamais ce travail-là, aujourd’hui. Avec des chiens, passe encore, mais des tigres… Vous pourriez me donner mille francs, je marcherais pas.
Je me mets à rire malgré moi, à cause du mot aujourd’hui.
Reconnaît-elle son ouvrage de jadis dans l’histoire du tigre ?
Elle est une pauvre petite dégénérée, ce n’est pas sa faute.
Après lui avoir pieusement baisé les yeux, je jette, sous le portrait du soldat, le louis qu’elle ne songe pas à me demander et je m’en vais.
Je ne reviendrai plus. Je me le jure en descendant son escalier comme ivre d’un affreux alcool qui me brûle l’estomac et me casse les jambes.
Je dois, en effet, être très vieux depuis une heure.
Si la belle Mathilde Saint-Clair ou la mignonne Julia Noisey me voyaient, elles auraient pitié de moi…
… Et je donnerais les deux corps de ces deux femmes honnêtes (très relativement) pour que le petit pied mort de Cléopâtre soit à moi par l’amour.
Non, je ne reviendrai plus parce que j’ai aperçu dans la chambre de Mlle Léonie la photographie d’un soldat.
Carnier, je trouve ce mot d’une superbe allure, et il ne me représente plus du tout le vulgaire sac en question. Il suffirait d’ajouter une lettre à ce mot pour lui rendre toute sa lugubre valeur.
Mais je n’aime pas la chasse, sport fatigant dont la brutalité n’est plus de notre époque…
Je suis allé, aujourd’hui jeudi, voir mon amie Thilde. J’étais un peu triste et j’avais besoin de douces consolations.
Dès mon entrée chez elle, j’ai bien compris qu’il se passait des choses. Ou elle avait pleuré ou elle avait trop ri.
— Bonjour, ma Thilde ! Vous avez les mains moites. Pourquoi ?
Nous nous sommes assis dans le grand canapé du salon sur lequel mon amie aime à prendre des poses Récamier en regardant son piano.
— Louis, m’a-t-elle déclaré fort grave, vous m’avez trompée.
Ce ne sont plus les maris qui savent tout, maintenant, ce sont nos maîtresses.
L’existence va devenir intolérable.
Je me suis levé vivement et j’ai arpenté le tapis de la lyre d’or du ministre, placée sur la cheminée, au portrait du ténor célèbre, mon prédécesseur, qui, grâce à sa célébrité, ne choque pas trop dans ce salon d’artiste.
Étonnant comme le froid de l’hiver pénètre sous les portières, aujourd’hui, jour de réel printemps.
Vent, pluie, grêle ; on entend des bêtes furieuses gratter aux vitres et cherchant à se précipiter malgré les rideaux de tulle…
Moi, je cherche une phrase et je reste court.
— Thilde…
Je la regarde. Elle est très belle. Toujours son expression de bouche si voluptueuse et comme inspirée. Ses yeux ont des halos d’ombre transparente. Par certains soirs clairs, la lune en a ainsi, sans motif. Ses cheveux sont défaits mollement. Elle porte un peignoir de velours très long, très ample et me paraît majestueuse. Ce n’est pas la reine (la reine, c’est toujours plus simple que cela), mais une belle matrone romaine prête à lever le pouce au-dessus du gladiateur.
Je ne l’ai jamais vue si bien.
— Thilde !…
Je viens m’agenouiller humblement à ses pieds et je baise le bord de sa robe avec une ferveur délicate. Je suis dramatique dès que je suis sincère, et quand je m’en aperçois je me blague, pour fouetter ma sincérité d’un peu d’esprit. En somme, je suis très bien, moi aussi ; je ne sais par cœur que mon métier d’amoureux, mais je le sais à fond. Je récite toutes les tirades et je donne toutes les répliques avec la même fougue, et comme j’ai le soin de me prendre à mes propres pièges, on doit croire chaque fois que je me casserai quelque chose dans la poitrine. J’ai, en ce moment, un mortel chagrin d’avoir froissé ma grande amie et je pense à l’autre, à la seule ! Il me semble que c’est à elle que je vais débiter mes tirades. Alors, mensonge ?…
Je ne dis plus rien.
Thilde me passe les doigts dans les cheveux et elle parle, reconquise déjà par mon humilité.
— Oui, vous m’avez trompée, Rogès. (Elle m’appelle par mon nom de famille quand elle désire établir des distances.) Je ne vous en veux pas, car je n’espérais guère vous garder si longtemps. En me donnant à vous, je devinais d’avance que je me donnais à un homme léger, très vicieux, — oh ! ne protestez pas ! — la femme avec laquelle vous m’avez trompée est une épouvantable vicieuse. Je connais cette femme, elle sort d’ici à l’instant, c’est Julia Noisey.
— La drôlesse ! Elle est venue vous dire ça ?
Je suis ahuri.
La sentimentale qui poursuit le cours de ses exploits sentimentaux !
Je regrette bien de ne pas avoir fait mon possible pour obtenir un duel du mari ; cela l’aurait calmée et je ne risquais pas plus de scandale.
Thilde a un sourire pénible.
— Une drôlesse, soit, mais cependant vous l’avez aimée ?
— Ah ! par exemple, non, Thilde ! je me révolte. Je ne l’ai jamais aimée. Elle est venue se jeter dans mes bras absolument comme elle a dû se jeter à votre tête cette après-midi. C’est une toquée. Elle m’a fait toutes les grimaces, toutes les singeries, et elle m’aurait pris de force, je crois, si…
C’est étonnant comme on nous prend de force souvent. J’ai calculé que durant certaine saison, et « l’heure complique la saison », dit le poète, tenez, au crépuscule, toutes les femmes, vieilles ou jeunes, belles ou laides, peuvent nous obtenir sans amour et, qui pis est, sans désir. Nous n’aurions qu’à tourner les yeux : elles s’arrangent de façon à ce que nous ne les tournions pas. Comme la nuit tombe, nous tombons avec elle. (L’essentiel serait d’allumer une lampe.)
C’est égal, cette Julia est une peste. Je ne lui pardonnerai jamais cette infamie.
Thilde a une voix navrée.
— Non, je n’ai pas cru que vous me seriez fidèle. Vos livres… votre effrayante littérature qui vous conduit aux pires études de mœurs…
Je l’arrête.
— Thilde, je vous en prie, laissons ma littérature. Je ne pense pas un mot de ce que j’écris, vous le savez bien.
J’ai dit cela d’un ton de merveilleuse conviction. Peut-être que c’est vrai, après tout.
— Allons donc ! j’ai toujours déploré votre facilité à conclure au vice…
— Je vous jure, Thilde, que je suis chaste. Si je pouvais vous avouer le fond de mon âme, vous découvririez que je suis capable de respecter…
— Oui, ce qui n’est pas respectable. Vous ne vous entendez bien qu’avec des monstres.
Je suis frappé de sa logique intuitive. En effet.
Je ne sais même pas aimer sincèrement cette charmante femme, un peu bourgeoise, cependant très digne du respect d’un véritable amour.
— Voyons, ma belle chérie, je m’entends bien avec vous par moment ? Daignez vous souvenir un peu de nos heures de tendresse, dites ?
Je suis assis sur un tabouret et j’ai mis ses pieds sur mes genoux parce que c’est plus commode.
Je m’aperçois que ses pieds sont chaussés de très vilaines pantoufles en drap et qu’elle a marché sur leur contrefort plié. La jambe est jolie, mais le pli du contrefort m’agace.
J’ai une nuance de sévérité pour ajouter :
— Vous n’êtes pas raisonnable, Thilde, de me reprocher une folie qui n’a rien à voir avec… les nôtres.
— Vous manquez de générosité, monsieur Rogès.
— Ma belle chérie, vous manquez aussi d’indulgence. Il y a des récréations qui ne vous plaisent pas, et j’ai su les retrancher de nos jeux particuliers, rien que pour vous être agréable.
Voilà au moins du respect sentant son homme du monde. On ne me traitera pas de voyou, selon l’usage. Je commence à redevenir très bien, très gentil. J’ai idée que notre explication va remettre les choses au point. Je prends, tout bas, la résolution de ne plus la trahir… avec cette indigne Julia. Les femmes de cette espèce sont enragées.
Pauvre Thilde ! Elle a de grosses larmes.
— Louis, quand je vous ai cédé (phrase un peu romanesque), je ne comptais pas sur vous… j’espérais, seulement… puisque nous étions librement unis, que vous me feriez part de vos décisions.
Elles sont absurdes ! Si on leur disait le quart… des décisions que nous prenons, ou mieux qui nous prennent, elles passeraient leur journée (surtout la nuit) à nous faire des scènes. Comme ce serait drôle et pour elles et pour nous ! Nous ne sommes décidés que lorsque tout est accompli. Nous ne savons jamais rien de la décision suivante. C’est plus prudent, l’impromptu épargne quelquefois de grosses gaffes.
— Voyons, ma Thilde, tu es trop solennelle… on dirait que tu vas cesser de tutoyer ton chien ! On n’a pas besoin d’arrêter les aiguilles des montres sur les choses de ce genre, ce n’est fichtre pas la peine, parce que, l’aiguille arrêtée, le temps coulerait tout de même, amenant des heures pareilles. Oui, là, j’ai couché avec Lia, et puis avec d’autres, naturellement, ceci pour te faire comprendre que toutes ces petites, qu’elles soient une ou douze, ce sont autant de zéros que nous ajoutons à l’unité pour la mettre en valeur (Bon ! Excellente image dont je me resservirai.) Ensuite, Thilde, je n’aime que toi et tu vas m’embrasser.
Conclusion bébête mais nature.
J’ai envie d’être nature aujourd’hui.
— Alors, Louis, pourquoi ne pas m’épouser, si vous voulez me traiter comme une pauvre femme légitime ?
Je fronce les sourcils.
Elle ne se doute pas du tout qu’un soir où elle m’avait exaspéré avec des caresses distribuées au monstre Pleyel, je lui aurais promis de l’épouser rien que pour avoir le droit de casser le piano.
Si je lui avais promis cela, je l’aurais tenu.
J’aurais certainement cassé le piano, puis je m’en serais mordu les doigts. Ce soir… non. Je suis lié, ailleurs, par un étrange lien infâme et merveilleux, qui ne me laisse plus que la liberté de la chair, la permission de minuit. A l’aube je rentrerai… fatigué, dégoûté, ennuyé, je reviendrai seul pour me retrouver avec mon double dont les yeux, deux trous, que semblent avoir creusés les miens à force de regarder dans le vide, me regarderont, m’aspireront à leur tour.
— Vous êtes au-dessus des femmes légitimes et je saurai toujours vous faire respecter… même par moi.
Du lyrisme. (Il n’est pas en or comme celui du ministre.)
— Vois-tu, Mathilde, je suis très malheureux. Je ne peux pas te dire tous mes chagrins, tu te moquerais de moi. J’ai besoin de m’étourdir, de brûler ma vie. Je suis un enfant malgré mon âge d’homme, et je suis tellement vieux. J’aime, je crois être aimant, puis, je n’aime plus, on ne m’aime plus. Je suis un gosse égaré sur le parvis d’un temple. Je cours après toutes les femmes qui entrent et sortent, murmurant des chapelets trop longs… Je cours, et ce n’est jamais ma mère, ce n’est jamais ma sœur, ce n’est jamais mon amie, celle-là est trop blonde, celle-là est trop brune, celle-là est trop petite… et des quêteuses passent me demandant pourquoi je pleure. (J’enrage de ne pas pouvoir tout expliquer, je suffoque, je pleure presque réellement.) Thilde ! je ne suis jamais plus sincère que quand je fais de la littérature et j’ai dit, tout à l’heure, que je ne pensais pas un mot de ce que j’écrivais… je ne me reconnais plus dans la sincérité de tous mes mensonges. Ah ! Tu es écrite, Thilde, comme les autres ! Je pleure parce que la vie vraie se fait mal et fait mal, mais je ne suis pas capable de la refaire. Je ne peux que lui draper, aux épaules, le peplum de ma fantaisie. Tu n’as pas l’air de comprendre, et Elle ne comprend pas non plus, moi aussi je ne comprends rien… (sanglot). Thilde, si tu me chasses, je vais tomber dans un abîme noir. Je vais tomber dans des yeux si grands qu’ils pourront refermer sur moi leurs paupières et que j’en mourrai. Ah ! Thilde, protège-moi ! Je ne suis plus digne que de tes caresses… et je fais serment de te les rendre, oui, toutes !…
— Serment d’ivrogne ! ajoute Thilde risquant d’être spirituelle.
Je ris à travers mes larmes d’homme nerveux.
— J’ai rien bu, Thilde, je t’assure… voilà près de trois heures que tu me tiens la coupe si haute…
Ouff ! Ça y est. Nous sommes au mieux. Elle m’embrasse. Cela va se terminer à mon entière satisfaction.
J’ai déjà remarqué que la littérature, peu productive au point de vue argent, nous fournissait des poses plastiques qui seraient bien ridicules sans le panache italien et l’épée en verrouil. On est mal habillé à notre époque, et le chapeau tuyau de poêle ne prédestine pas aux apothéoses. Une phrase vous revêt quelquefois de la couleur locale qui vous sied. De son fauteuil ou de votre tabouret, on gagne des batailles sensuelles fort importantes sans se déranger de sa ligne de correction moderne.
Je suis très partisan du balcon de Roméo ; pourtant, quand il pleut, — et il pleut toujours ce jour-là ! — c’est une fichue opération que de grimper. Moi, je grimpe assis dans l’ascenseur de mon cerveau.
Nous avons été très jeunes, Thilde et moi, ce jour d’explication orageuse. Nous avons oublié le dîner, et elle a prévenu sa bonne qu’elle ne recevrait personne pour cause de subite indisposition.
— Oui, ma fille, une migraine épouvantable, vous nous préparerez un souper vers minuit, un souper dînatoire. Monsieur non plus n’a pas faim…
Elle (le matin, rayon de soleil printanier et renouvelesque derrière des stores bleuâtres) : Quand reviens-tu, Loulou ?
Moi (du cabinet de toilette) : Je ne reviens pas, je t’emmène. Nous allons dîner à Saint-Cloud. Il fait beau.
Elle (réfléchissant) : Non, chéri, ce n’est pas possible, j’ai deux leçons aujourd’hui. La comtesse Fashi et M. Carle Duméril pour une répétition de musique de chambre.
Moi (soupirant) : Toujours le monstre Pleyel. Cet animal est bien assommant. Enfin…
Et je m’en vais seul.
Pourquoi suis-je revenu dans la journée, moi qui ne fais pas deux visites à la fois, au moins à la même ?
Ce sont de ces tours que vous joue Éros, le chasseur, quand il chasse ou vous chasse !
Je suis revenu tout naïvement pour proposer de dîner au restaurant parce que j’avais l’appétit d’huîtres entrevues chez un marchand, de mets bizarres et follement épicés, aussi de sauternes doux.
Je suis revenu avec la tendresse d’un mari préparant une seconde surprise, restauratrice puisque restaurant à la mode.
Je faisais déjà la carte en imagination (grossière littérature), et je sonne.
La servante, un peu effarée :
— Oh ! Monsieur !…
— Quoi ? La comtesse Fashi est encore là ?
— Non, c’est… (elle hésite), c’est Madame Noisey.
Ainsi, cette horreur de Julia est revenue (comme moi… nous sommes si vicieux !) pour torturer cette charmante créature… Toi, ma petite, je vais te régler ton compte, et je me décide brusquement.
— Annoncez-moi tout de suite.
— Pas possible, Madame ne veut pas qu’on la dérange. Elle me gronderait. J’ai entendu qu’elle pleurait dans le salon.
Je me jette comme un fou dans le salon où l’on pleure.
Je ne trouve pas ces dames.
Je pénètre dans la chambre à coucher.
Pièce obscure, violentes senteurs de Chypre et d’héliotrope mélangés. Je marche sur un corset, je m’embarrasse dans une jupe, je tombe presque sur le lit.
J’entends, là, des soupirs, des râles.
Je bondis vers l’un des boutons électriques de cette chambre où il y en a deux : près de la cheminée et au fond du lit.
A tâtons, je presse celui du fond, en face de moi.
Je fais la lumière…
… Julia Noisey se tord, complètement nue, dans les bras de Mathilde, non moins bien habillée !
Et cette chambre, si remplie de boutons électriques, ne contient ni fouet, ni cravache, ni canne.
Reste l’esprit.
Je n’en ai plus.
Reste l’injure.
J’en use et en abuse.
Je crie beaucoup. Je casse des choses. Je déchire des étoffes.
Elles sont toutes deux évanouies, selon la grande loi féminine qui ne permet pas à un Monsieur de demander des explications devant un flagrant délit.
Des explications ?… Ça ne me semble pas nécessaire, mais je suis féroce. J’en veux, moi.
Ça dépasse un peu ma littérature et ma psychologie, cette histoire.
Je me suis cru très malin.
Je ne peux plus faire le malin du tout.
Je constate et je ne comprends pas.
Je parle, je hurle, je frappe du poing dans des oreillers, et je crois qu’au hasard une claque résonne sur des rotondités plus fermes.
Je ne m’aperçois pas du tableau ravissant et bien vivant que forment la belle matrone romaine et la petite esclave grecque enlacées.
Très joli, d’accord, mais je me sens abominablement trahi par l’existence et j’entends qu’on m’explique pourquoi toutes les pudeurs, toutes les sentimentalités, puis tous les vices, tous les mensonges. On me bernait, chacune à son tour, et cette femme que je voulais épouser, et cette guenon à qui je voulais faire l’honneur de tuer son mari.
Tas de singes !
La vie, encore une fois, saisit le rêve à la gorge.
Moi, je rêve.
Mais, elles, me trompent par toutes les réalités bestiales.
— Sacré tonnerre ! Répondrez-vous, ou je vous étrangle ?
Lia ouvre un petit œil de chat inquiet. Elle se réfugie dans les bras de Thilde qui se recule, sans rien ouvrir du tout.
— Ah ! vous vous réveillez, maintenant ? Vous allez me permettre de vous rosser… car je vois qu’il n’y a pas d’autre leçon à vous offrir, mes petites bêtes.
Lia, qui se souvient d’une gifle déjà reçue, met ses bras en avant.
— De quoi, espèce de brutal, tu nous as trompées toutes les deux et tu n’as que ce que tu mérites, voilà !
— D’abord, toi, tu vas me faire le plaisir de m’accompagner chez ton imbécile de mari pour que je lui apprenne de quel genre de sentiment tu te chauffes. C’est honteux, tu dépraverais un couvent de carmélite… où aurait déjà passé un régiment de cuirassiers.
— Oui, murmure Thilde pleurante, s’enveloppant d’un drap parce qu’elle est la moins jeune, c’est vrai qu’elle est vicieuse et qu’elle m’a perdue… mais vous exagérez, Louis, comme toujours.
— Répète un peu que je t’ai perdue ! crie Lia lui griffant la gorge. Elle en a un toupet ! C’est une machination, Louis, elle a dû combiner ça exprès pour se venger de toi.
Et elle pleure.
Je suis très énervé.
Je ne peux pas corriger deux femmes qui pleurent, toutes nues.
Je commence à avoir envie de rire.
C’est ridicule ce qu’elles font.
Seulement je suis ridicule d’y attacher tant d’importance.
Elles ont, comme moi, des grands mots et des petits gestes.
Quand elles sont montées en ascenseur, elles redescendent à pied.
Tout ceci, c’est de la littérature fort ordinaire.
Il faudrait avoir du génie.
Et avoir du génie, c’est, généralement, se mettre à la hauteur de toutes les situations…
Pour comble de joie, voici venir la bonne qui gratte.
Heureusement qu’elle a le flair de gratter.
Je me précipite (au nom des mœurs) et j’ai, enfin, une idée, en poussant le verrou.
— Madame a la migraine, une migraine épouvantable ; nous ne recevons plus personne et vous nous préparerez, comme hier, un souper dînatoire… vers minuit.
Il m’est littéralement impossible de demeurer en frac et en gants clairs plus longtemps.
Elles finiraient par pouffer tout en séchant leurs larmes.
… Au cours de cette petite fête, Lia tient ce joli propos :
— D’abord, toi, je te défends les saletés.
Et Thilde ajoute, très digne :
— Si nous ne t’avions pas rencontré, mon cher, nous serions encore d’honnêtes femmes !
La prochaine fois j’amènerai des amis.
Deux perdrix de cette envolée dans le même carnier, c’est un peu lourd pour un seul chasseur.
Une journée d’étranges douceurs se terminant par un coup de couteau.
Je suis retourné rue Grégoire-de-Tours.
Parce que j’avais juré de n’y plus aller.
Des meubles neufs, des meubles vieux, un tapis d’orient et une pendule en zinc, un mélange de tous les luxes et de toutes les misères.
Surtout, au-dessus de tout, le fameux rideau de soie rouge.
C’est toujours le sang, la tuerie, qui domine.
Elle est venue vers moi de son pas souple et muet.
— Je suis contente de te voir pour te remercier, a-t-elle dit froidement.
— Alors, tu veux bien, Reine ?
— Non, je ne veux pas, c’est bête. On peut rencontrer des gens.
Elle me parle presque en français. Je suis si ému que je tremble.
— Des gens ?
— Des types qui te connaissent. Puis j’ai pas de toilette et je veux pas en faire. Je te plaque.
— Reine… la voiture est en bas. J’ai pris une voiture fermée. Nous irons gare d’Orléans et nous ne rencontrerons personne. Tu es folle ! Ou tu as peur que je te viole à la campagne, loin des sergots de ville. Toujours la pensée du monomane qui plante des épingles dans les seins, dis ?
Je ris et je me sens désespéré. Je comptais tellement sur cette partie de plaisir.
J’étais plein d’idées chastes.
Depuis ma dernière visite chez Mme Mathilde Saint-Clair, je suis plein d’idées chastes, je ne sais pas pourquoi.
— Reine, je te jure que tu n’as rien à craindre
A-t-on jamais songé à lui faire voir le ciel sans le lui faire payer de tout le paradis de son corps ?
Elle réfléchit une minute, le doigt sur sa bouche, l’œil très sombre.
— Sans blaguer, hein ! Ça gâterait tout Oui, là, je veux bien.
Nous sommes partis.
Dans le compartiment du train qui nous emporte, nous sommes seuls et elle risque cette singulière réflexion :
— Pourquoi qu’ils sont gris maintenant les wagons ?
Elle est assise en face de moi, vêtue d’un petit costume en laine noire. Son chapeau est en paille noire avec une aile noire et une voilette d’une nuance ambrée lui faisant le teint plus pâle et des yeux plus doux.
Malgré cette toilette simple, j’ai vu un homme, un rouleur de bagages, s’arrêter un instant comme flairant l’odeur de ses jupes !
— Reine, quel est ton pays ?
— Je crois que c’est l’Auvergne, mais je ne suis pas bien sûre. Je suis venue à Paris quand j’avais seize ans avec une… (Elle esquisse le mot d’un geste)… de Clermont. J’étais tellement saoule en montant en chemin de fer, que je ne me rappelle plus la couleur des compartiments. Je venais d’une maison et on m’a versée dans une autre maison ; puis, un cousin à moi, un parent, m’a retirée pour me mettre en chambre, dans mes meubles, et… voilà. (Elle reprend soucieuse :) Oui, je crois que c’est d’Auvergne, parce que j’ai été nourrie à la campagne chez une fille-mère en service, seulement, il y a eu des manigances rapport aux papiers. La police garde tout ça.
Elle se tait, les lèvres mordues.
J’ose lui demander, plus bas :
— Te rappelles-tu ton premier amant ?
Elle répond, l’œil un peu étonné :
— Non.
— Tu bois beaucoup, Reine, dans… ta profession, cela te fera mal.
— Je bois beaucoup, mais je ne me saoule jamais, il m’en faut trop. Maintenant, y a des types qui… (elle s’arrête).
Elle étire ses gants, s’arrange les ongles avec soin. Ses mouvements sont souples et brusques. Elle a des mains larges de paumes et longues de doigts, mais très fines du poignet. C’est une race inconnue à nos parisiennes de papier mâché, si croulantes au déballage, toujours prêtes à ramasser leurs formes comme avec une cuillère.
Elle a une petite bague en argent ornée d’une petite croix. Ce n’est ni un bijou faux, ni un bijou cher. Elle semble y tenir, car elle la retourne plusieurs fois pour que la croix soit bien droite au milieu de sa main.
— Reine, es-tu contente ?
— Moi, je ne suis jamais gaie.
— Je ne te veux pas gaie, au contraire. Sois belle et sois triste… tout à ton aise.
— Vous savez. Ça ne m’empêche pas de savoir faire rire le monde.
Cette phrase, si vulgaire lue en le sens où les gens vulgaires l’entendent, devient immense quand on songe à la lire en le sens du mot Monde, c’est-à-dire du globe entier.
Oui, elle est la dispensatrice des rires du Monde, et c’est pour cela qu’elle ne peut plus rire.
Oh ! comme je me crois bon, tendre et dévoué ! Comme je n’avais pas encore vu que le ciel était bleu, les arbres d’un vert léger, les toitures des villas bourgeoises ridicules au soleil !
J’apprends des vérités premières qui me font apprécier, à leur juste valeur, les derniers mensonges des civilisations.
Je suis heureux de constater un malheur irrémédiable.
J’ai toute l’eau du sadisme à la bouche.
Et je la crache, par la portière, sur une coquette maison qui passe en dessous.
— Reine, ta chambre te plaît ? Pourquoi ces affreux rideaux rouges ? N’aimerais-tu pas du damas jaune ?
— Non, merci, mes clients se trotteraient. Le jaune c’est pas l’usage. Puis quand ma garce de concierge ira vous faire casquer comme l’autre jour, faudra l’envoyer à la balançoire, vous avez eu tort de lui donner une pièce, vous savez, elle rappliquera souvent. Elle plumerait une tête chauve, celle-là.
— Elle a bien fait, ma chérie, mais ce n’est donc pas toi, l’auteur de cette petite lettre amusante ?
Et je lui passe ce billet écrit en style connu :
« Mon gros chat,
« J’ai besoin de cent balles pour avoir des nippes.
« A toi de cœur,
« Ninie. »
Dédaigneuse, elle déchire le billet et le jette par l’autre portière.
— Moi, j’écris jamais à personne et si j’écrivais je ne signerais pas Ninie… pour vous.
J’ai le cœur dilaté.
— Comment signerais-tu ?
Elle se tait.
Cela lui coûterait beaucoup de l’avouer, puisqu’elle est en exil.
— Sur les cent francs, elle a gardé sa moitié, ajoute-t-elle revenant à des pensées plus terre à terre.
— Et tu n’as pas réclamé ?
— Non. Je lui dois le foin (et elle rit, de son petit rire muet, en dedans), vous savez, le foin ?
— Tais-toi ! (J’essaye de réagir, en riant à mon tour, par une plaisanterie dans le ton de l’idylle.) Enfin, où il n’y a rien l’âne perd ses droits, ce me semble. Tiens ! Reine, cela m’ennuie de ne pas avoir un petit morceau de toi plié dans du papier… cette lettre…
Elle hausse les épaules.
— Pour ce que ça te servirait, mon pauvre garçon !
— Dis donc, tu ne me prends pas du tout pour un homme.
— Pas ma faute si vous êtes maboul.
— Il est nécessaire d’agir en rustre pour te paraître raisonnable. C’est drôle…
— Oh ! ça viendra. Vous finirez comme les autres… Mais vous voudriez bien m’acheter de l’amitié avant.
Cette idée bizarre de prononcer amitié pour amour !
Nous descendons sans regarder le nom de la gare.
Une allée de verdure ; la Seine, au bout.
Nous filons très vite. Elle a des mouvements prestes d’animal plus libre.
On entend chantonner des laveuses qui battent du linge au bord du fleuve.
Reine s’arrête, admire.
— En voilà des chemises ! Moi, j’en mets pas, c’est trop salissant.
L’eau du fleuve est lisse comme une plaque de métal et paraît s’enfoncer lourdement en faisant baisser les deux rives sous son poids.
Un chemin de halage, des arbres penchent, et de temps en temps, une péniche passe, chargée de pierres ou de tonneaux, sifflant, soufflant, l’air d’une sirène trop grasse.
J’ai mis mon bras autour des épaules de Reine pour qu’elle ne les hausse pas toutes les cinq minutes en ayant un regard ironique. Je m’appuie un peu. Elle n’a pas la sensation du fardeau et j’ai tout à coup très peur qu’elle soit plus forte que moi.
— Est-ce que je te fatigue ?
— Si tu veux que je te porte…
Je suis furieux, brusquement.
— Reine, tu es une sale bête, et je te défends de me toucher.
Elle se croise les bras sans une syllabe ; elle regarde l’eau et n’a pas entendu.
— Mon Dieu ! Reine, ma petite reine de douleurs ! J’étais fou. C’est moi qui salis tous les reflets, toutes les clartés, tout le ciel avec mes pensées obscures. Pardonne-moi, Reine chérie, ou flanque-moi des gifles, je le mérite. Et tant mieux si tu es la plus forte. Puisque tu marches volontairement courbée sous toute l’existence, c’est que tu en as reçu la mission. Tu dois expier des gloires farouches. Si je comprends pour toi, de quel droit vais-je t’accuser ? Ne me garde pas rancune, dis ?
Un petit frisson de sa bouche, ses yeux qui se ferment, mais elle se tait.
— Je voudrais bien t’avoir fait de la peine aussi… Reine !
Je boude.
Nous marchons un moment silencieux.
— Alors, vous écrivez des livres ? Faudra m’en prêter un. Je vous le rendrai.
Je remets mon bras sur ses épaules
— Tu lis donc quelquefois ?
— L’hiver… en attendant… (Elle hésite.) Pour ne pas avoir envie de bâiller toute la nuit. J’ai déjà lu les Trois mousquetaires, la Dame aux Camélias et (elle cherche) des chansons de Monsieur Frédéric de Musset.
Je suis un peu interdit.
Je ne lui prêterai pas de livres.
— Frédéric de Musset… Tu ne te trompes pas, bébé ?
— Non. C’était des vers, je me rappelle bien, un petit livre tout mince : L’Examen de Flora.
Ouff ! Je suis au bout de ce mignon calvaire intellectuel. Il y a là une croix. Arrêtons-nous. Je m’étends dans l’herbe, au bord de l’eau, et je cache mon visage dans mes bras.
Je suis honteux ; ce n’est pas à cause d’elle.
Reine est assise sur une grosse pierre. Elle s’amuse à lancer des petits morceaux de joncs qui font flèches.
Un grand silence.
Une torpeur peu à peu délicieuse et un rêve :
Cléopâtre sur la proue de sa trirème. Le petit nègre tient le parasol éclatant, des esclaves accroupies brûlent des parfums dont la nuée légère estompe leurs membres nus. Un homme, ivre du soleil et du vin qu’on lui fait boire, est couché aux pieds de la jeune reine et laisse pendre une de ses jambes dans l’eau. Cet homme est pâle. Il a l’air de mourir chaque fois que Cléopâtre se tourne vers lui. Elle se tourne vers lui, mais elle ne le regarde pas. Ses yeux ont la fixité des yeux d’idole et ne voient point. Je crois que cet homme est très malade. Il est couvert de cicatrices. Il a enlevé l’étoffe de pourpre qui le couvrait, posé une cuirasse d’or et des armes. Il ne lui reste, au cou, qu’une espèce de carcan de métal où étincellent des gemmes énormes. Ce n’est pas un esclave, car il a la peau blanche et soignée des patriciens qui vont aux étuves. Ce n’est pas non plus un simple soldat. Il serait déjà mort de toutes les blessures qu’il a reçues. Ni beau ni laid, il a le profil accusé des volontaires, le menton fendu et la bouche mince des voluptueux cruels. On devine son habitude de dompter ou des chevaux ou des hommes. Seulement, sous le charme, à son tour, d’un dompteur plus féroce que lui, le malheureux se laisse aller au fil de son plaisir.
La barque glisse et s’éloigne, emportant les esclaves qui brûlent des herbes odorantes, les mains levées.
Je suis réveillé par une phrase de Reine :
— Voilà des types nus avec une corde.
— Hein ! des hommes nus ?
Je bondis et la saisis à la taille pour la défendre contre les soldats de César.
Il s’agit seulement de hâleurs qui passent un bateau rempli de fumier. Reine les suit des yeux.
— Ça t’amuse donc bien les hommes nus ?
— Ceux-là sont solides, tu sais. (Elle baisse la tête, sournoisement.) Vous me prêterez un livre, n’est-ce pas ?
— Oui, et ça t’embêtera ferme, je t’en préviens.
— Vous racontez des histoires de femmes, d’amour… il y a celle de votre ancienne, hein ?
— Il y a tout excepté toi, ma chère. Marchons plus vite.
La vue de ces torses de hâleurs m’a un peu troublé. J’ai la tête lourde. Il me semble que j’ai bu quelque chose.
J’essaye de lui faire dire son histoire à elle.
Je m’aperçois qu’elle n’a pas de souvenirs, pas de mémoire. Tout est au présent.
Elle a été battue peut-être étant petite fille, battue ou trop aimée, elle ne sait plus très bien. Elle a vécu dans une usine et connu des métiers fatigants, ajoute ceci, d’un ton calme :
— Je pouvais pas suffire à ces garçons de la forge. Ils étaient sept après moi tous les soirs.
Je réponds, philosophiquement.
— En effet.
Silence. Crépuscule. Un oiseau chante.
— C’est doux comme du lait à boire, la campagne, murmure-t-elle de sa voix sourde, si dure.
J’entoure sa taille de mon bras et nous cherchons une auberge, pour dîner.
Un instant, sous des branches fleuries, des branches de pruniers qui sentent l’amande, elle tressaille :
— J’ai vu un crapaud, tiens, là. Il va sauter.
— Si tu levais la tête, tu ne verrais que des fleurs. Pourquoi marches-tu la tête basse ?
Elle lève le front, rencontre le mien, penché sur elle.
Nous nous regardons, éperdument effrayés l’un de l’autre, sans un geste.
— Eh bien, quoi ! fait-elle de son ton sourd, impatient. Quand nous resterions là toute la vie, à nous pourrir…
Quelle admirable précision de langage !
Aucune femme n’a si bien dit en un pareil moment.
— Reine as-tu pleuré quelquefois ?
— Je pleure jamais, pas la peine. Voyons… Viens-tu ?
— Embrasse-moi, dis ?
— Je sais pas embrasser. J’ai horreur de ça. C’est inutile.
— Tu n’embrasses pas tes amants… ou ton amant ?
— Ah bien ! Il vous en a une santé, lui ! (Elle éclate.) On ne perd pas son temps à ces bêtises… C’est bon pour les vieux.
— Reine, pour les vieux ? Qu’est-ce que tu racontes ?
— Mais oui… quand on est jeune, on est toujours plus pressé, et ce n’est pas pour traîner la chose dans ces bagatelles. Viens-tu ou je te lâche… à la fin !
Je tiens les poignets de Reine, mais je sens que c’est elle qui me lâchera si elle veut.
J’attire doucement son corps souple et elle rejette la tête en arrière comme quelqu’un qui a peur des soufflets.
Elle n’aime pas ça. C’est avouer qu’elle se garde pour un autre. Ou elle n’aime rien, et je voudrais bien savoir.
— Pas même un petit baiser honnête, Reine ?
Je fais la cour à cette prostituée, absolument.
Très forte, la reine d’Égypte ! Elle me maintient à distance de ses bras devenus rigides. Tout son corps souple est tendu en barre de fer qu’on ne tordra pas sans sa volonté.
Je ne lutte pas. Il est peut-être plus habile de ne jamais risquer le combat définitif.
J’en sortirai brisé certainement, sous tous les rapports.
Et puis, j’ai des idées chastes, aujourd’hui.
— Non, pas de bêtises, dit-elle d’une voix irritée. Si vous voulez que ce soit comme avec les autres, il n’y avait guère besoin de venir jusqu’ici… j’ai mon lit, là-bas. Fallait vous en servir !
— Oh ! Reine… taisez-vous !
Nous allons, de nouveau silencieux, jusqu’à l’auberge du bord de l’eau.
Des étoiles et des friselis dans les branches. Toute la suave odeur de l’amour monte de la terre parce que des bêtes inconnues, sous nos pieds qui les écrasent, sont accouplées.
Nous entrons. Il y a des tonnelles et on nous fait traverser un jardin…
Reine s’assied, ôte son chapeau, rectifie les lignes de son bandeau impérial.
— Que voulez-vous manger ?
— Je m’en fiche.
— Et boire ?
— Du cognac.
Aïe !… Soit. Ce sera peut-être plus drôle.
J’avais raison de penser que ce serait drôle de voir dîner la reine d’Égypte. Elle ne touche pas au pain, ni à l’eau, ni aux légumes. Elle mange avec une rapidité singulière, des gestes prompts et narquois d’animal qui se moque de vous. J’ignore ce qu’on nous sert, elle a l’air de fort peu s’en soucier, mais elle dévore des viandes qui ne sont pas cuites. Je suis au Jardin des plantes.
Elle ne redevient femme qu’en présence d’un saladier de fraises.
Petit gloussement de joie.
Toutes les fraises y passent, sauf deux, qu’elle m’octroie sur une feuille.
Elle verse le reste du cognac dans le saladier, en redemande.
— Vous voulez encore des fraises ?
— Non, du cognac. Il est beaucoup moins fort que celui de ma concierge. (Elle a une mine de vierge offensée.) tiens, goûte, il sent le muscat !
Je goûte, fais une grimace. Cela doit être de l’alcool à 96 degrés.
Elle réclame des chartreuses vertes pour étendre le goût du muscat.
Il faut lui rendre cette justice, c’est qu’elle est très calme et que son langage demeure aussi… châtié que de coutume.
Comme je ne bois pas ma chartreuse, elle me la vole en me disant :
— Ça te ferait mal.
Ça m’humilie et m’intéresse prodigieusement. Qu’est-ce qu’elle va devenir quand elle sera grise, car elle va se griser, c’est clair.
Je lui prends le pied sous la table.
Elle me regarde fixement, met la main sur son couteau.
— Finis, toi, ou je me fâche.
Ses yeux sont illuminés comme ceux d’une panthère à la chasse.
Je me lève, en m’éventant de ma serviette, parce que je suis un peu inquiet.
Si j’abandonne la partie tout de suite, je vais être ridicule, et si j’insiste, elle est capable de me piquer, du bout de ce couteau, rien que pour s’amuser, bien entendu.
« Le tremplin ». « La force dynamique de la passion ». Toutes les belles phrases de Jules Hector me hantent le cerveau, seulement je n’en suis pas plus fier. Durant cette saison chaude, l’heure complique les panthères, et ce petit dressage en liberté pourrait bien finir par un repas plus substantiel dont mon humble personnalité serait le plus bel ornement.
— Ma petite amie, je suis très doux, moi, je ne sais pas jouer du couteau, n’ayant jamais été souteneur de ma vie, ce que je regrette. Lâchez cela, ou vous allez m’éborgner.
Je veux saisir son poignet.
Elle me plante son couteau dans le bras.
Je suis tellement étonné que je n’éprouve aucune douleur.
Je la regarde. Elle est toute pâle.
Je regarde ma manchette. Elle est toute rouge et le sang ruisselle sur la nappe.
A présent cela me fait souffrir un peu, parce qu’elle vient de retirer le couteau.
— C’est bête, Reine, on va causer et s’extasier là-dessus… c’est très bête. Aidez-moi vite à nettoyer le sang. Nous ne sommes pas en Égypte ici.
Machinalement elle prend les serviettes, les mouille, et arrange des compresses.
— Vous pouvez me dénoncer, je ne me plaindrai pas !
Ce mot dénoncer est impayable dans sa bouche. De quoi suis-je complice, mon Dieu ?
— Tu es une sotte. Je n’aime pas plus les histoires de police que toi, et une jolie femme a toujours le droit de se… défendre.
— Je serais contente d’aller en prison.
Mon bras est enveloppé. Il me semble très lourd.
— Pourquoi serais-tu contente d’aller en prison, espèce de folle ?
Elle s’accoude, songeuse.
— Vois-tu, faut jamais me parler de couteau, ni de mon petit homme.
Je frissonne des pieds à la tête.
Il fait frais sous cette tonnelle sombre.
— Quel petit homme, dis ?
— Je ne suis pas grise. Je ne suis jamais grise. C’est le premier coup de surin que je fiche, et ça m’a produit un effet… j’aurais pas cru. Est-ce que ça t’a fait mal, à toi ?
— Non. Pas au bras, toujours. Ta dernière virginité ? Merci. On donne ce que l’on peut, ma fille. Il est donc en prison, le petit homme, et tu voudrais le rejoindre ?
— Oui. (Ses yeux longs se ferment langoureusement, elle s’étire, dans un bâillement sourd.) On l’a emballé parce qu’il a fait la même chose pour moi.
— Celui en soldat sur ta cheminée ?
— Tu es un malin… mais je ne suis pas grise. La fois du portrait, il était encore au régiment. Il en est sorti. Puis, on s’est battu devant ma porte, et il a éreinté un client. Nous avons été des tas pour témoigner. Maintenant, la police me surveille parce que j’ai dit que c’était moi qui lui faisais son truc.
Elle achève sa chartreuse et se mord les lèvres.
Ce que je sens bien, en ce moment, c’est que je rendrais volontiers le coup de couteau au petit homme.
Nous rentrons par un train bondé. Reine demeure muette, heureusement. Elle a sommeil. J’ai des élancements furieux dans le bras.
A Paris, impossible de trouver une pharmacie ouverte. Il est trop tard.
Je reconduis Reine chez elle.
Avant de disparaître sous le porche de son palais, la princesse se retourne, indifférente.
— Tu es un bon garçon, tu n’as pas gueulé. Bonsoir.
Je crois qu’elle m’estime. C’est toujours ça.
Et je m’en vais me coucher pour avoir la fièvre toute la nuit.
— … Sois belle et sois triste… mais ne frappe pas si fort une autre fois, dis ?
— Monsieur ! je ne peux pas empêcher cette dame d’entrer… puisqu’elle dit qu’elle est votre mère.
Sursaut.
Ma mère chez moi ? J’ai envie de passer par la fenêtre.
Je considère la carte que Joseph me présente, cérémonieusement.
Je lis en très petits caractères, timbrés d’une minuscule couronne :
Madame Marie-Louise-Antoinette de Rogès
née de la Paillerie
En comptant bien : une impératrice, une reine et une comtesse issue de marquise par-dessus le marché. Voilà beaucoup de grandes dames pour venir voir mourir un pauvre diable d’homme de lettres, lequel, d’ailleurs, se porte à merveille.
Joseph, qui n’a jamais vu ma mère, est sens dessus dessous et se confond en excuses : effet du petit carton timbré.
Moi qui, par hasard, connais cette dame, je m’allonge sur mon divan, et j’essaye de refaire le mort.
J’ai le bras en écharpe, comme à la suite d’un duel sérieux. (Le seul duel sérieux de ma vie !) Depuis quinze jours je me promène ainsi, parce qu’une fièvre de printemps a envenimé le joli coup de couteau de Cléopâtre. Peu s’en est fallu qu’il ne me joue le tour du fameux aspic. Je n’avais pas soigné cela. Un matin, cela s’est mis à me mordre. On a dû chercher un médecin et des fioles. Ce sont les fioles qui m’ont rendu malade. Des amis sont arrivés, compresse perfide ; Andrel a rédigé une note, Massouard a raconté un accident de voiture, et Jules Hector s’est réservé en des phrases hermétiques.
Maintenant le canard vole, vole… On parle d’un véritable combat singulier. Je suis tombé sur une vitre brisée poursuivi par un mari vengeur. J’ai reçu un coup de couteau japonais, histoire de jupes. On prétend même que, revenant du théâtre… Ça, c’est l’attaque de Joseph, l’attaque nocturne. Il y tient !
Hier, Noisey et sa femme sont venus poser des cartes. Mme Saint-Clair, oubliant nos griefs, écrit des lettres éplorées, et, bien entendu, la seule qui aurait dû venir, Cléopâtre, n’est pas venue. Elle dort entre les pattes d’un tigre probablement.
Je suis d’une humeur massacrante et j’en profite pour ne recevoir personne.
Mais Madame et Mère est entrée.
Ce n’est pas celle-là qu’on empêchera jamais d’entrer quelque part.
Elle pénètre de hautes allures, comme les chevaux de sang.
Et elle a sa robe couleur d’alezan brûlé.
Oh ! la famille !…
La comtesse de Rogès, mon honorable mère, est une femme de cinquante ans, très grande, très mince, qui marche sur des roues dissimulées. Sérieusement, je ne me rappelle pas lui avoir vu faire un pas humain. Elle avance ou elle recule, dirigée par le pouce de la providence ou de la fatalité, mais elle ne lève pas les jambes… Non ! elle n’a jamais levé les jambes.
Je lui fais une visite solennelle, chaque fois que le retour du premier janvier attendrit les foules. On échange des nouvelles de ses santés respectives, deux phrases aigres-douces sur l’immoralité des temps ou la bêtise de nos édiles qui dépavent les rues. On s’embrasse sur le front en prenant des précautions pour ne pas être contaminé, elle, par l’amour du vice, moi, par la haine de ce même produit de toutes nos civilisations, et on constate, périodiquement, que l’abîme se creuse de plus en plus, jusqu’à devenir insondable, selon son expression superfétatoire. Ma mère habite un hôtel assez coquet près de Passy. Elle y reçoit des gens très vagues qui ont, côté des dames, des panaches de corbillard, et, côté des hommes, des cannes à pommes de rampe. J’ai remarqué que, dans ces familles reçues chez elle membres à membres estimables et soigneusement épluchés, les enfants, garçons ou filles, naissaient tous à l’âge de quarante-cinq ans.
Ça m’a bouché un peu l’horizon de Passy.
J’ignore les occupations de ma mère. Je crois qu’elle joue aux revers de fortune. Elle perd des procès et fonde des ouvroirs. Elle soigne les aveugles qui sont aussi paralytiques et chasse, à coup de mouchoirs ourlés de deuil, les ferments de toutes les corruptions.
Les journaux parlent d’elle quand il y a une épidémie.
Ceci pour l’extérieur.
Intérieurement, elle prie Dieu de bénir ses haines.
Car elle a des haines formidables.
Elle en a deux principales qui suffiraient à chauffer les deux locomotives d’un express.
Elle abomine ma tante, Mme Chasel, et déteste mes livres.
Très réellement née de la Paillerie, elle a non moins réellement fait mourir mon père et son époux, le comte de Rogès, par l’abus de sa pudeur et des petits cierges brûlés à l’église en l’honneur de la conversion de ce brave homme, un peu porté, malgré lui, sur le tutu des danseuses.
Elle m’a pourvu d’un conseil judiciaire.
(Heureusement ! Car j’ai pu apprendre un plus noble métier que celui des armes.)
Et elle m’a fiancé, dans l’austère salon de son cœur, à une jeune provinciale pieuse.
Ce sont là des vétilles.
Je ne lui reproche que sa haine féroce contre ma pauvre tante.
Cette haine date du jour où j’eus l’idée originale d’enlever la charmante sœur de mon papa.
(Entendons-nous. Comme j’avais dix-sept ans et que je sortais du collège, la raison serait de supposer que c’est ma tante, alors âgée de quarante ans, qui m’enleva.)
Mais ceci n’autorise personne à la mésestimer. Au contraire…
Le souvenir de ce voyage en Italie m’est encore cher. Il fallait me récompenser de mes brillantes études, de ma sagesse, et je ne sache pas qu’on puisse mieux récompenser un garçon de dix-sept ans que par la folie.
Ma tante ! Bien bizarre créature. Une héroïne de la Fronde descendue de son cadre, extrêmement dévote, extrêmement sensible à toutes beautés profanes, violente, désordonnée, romantique, et pleine de petits soins pour sa toilette. Elle était tellement coquette qu’on ne s’en apercevait pas tout de suite, et elle aurait allumé un couvent de capucins rien qu’en tirant ses jarretières : un geste qu’elle avait d’attraper, sur sa robe, un pli, entre le genou et la ceinture, un petit geste irrésistible.
On la trouvait pleurant à chaudes larmes devant des crucifix, puis elle se retournait, brusquement, pour administrer des taloches à ses filles de chambre, ou à son neveu.
— Loulou ! je parie que tu viens de faire des cigarettes avec mon papier à frisure ?
(Un papier brun clair, imitant divinement le tabac, exquis de goût…)
— Non, ma tante.
— Tu mens !…
— Oui, ma tante.
Alors, vlan !… j’en recevais.
J’allais chez elle tous les dimanches pour perfectionner mon éducation religieuse. Elle me faisait m’agenouiller sur un pouf de damas bleu que je vois d’ici, un pouf orné d’une levrette héraldique arrondissant une patte en queue de cruche autour d’un blason naïf. Là, je disais, mains jointes et paupières baissées, de ferventes prières et je récitais les commandements de Dieu. Durant ces exercices, ma tante s’habillait, se frisait, tirait ses jarretières de son petit geste sournois. Elle n’était pas jolie, seulement douée d’un charme diabolique, avec une figure zigzagant en rictus passionnés, des yeux de braise, une chevelure miraculeuse. Elle possédait une fille très laide, un peu bossue, qu’elle destinait à une prise de voile et qui préféra épouser un juif. (Encore un scandale de famille ! Le sentiment de la dignité étant toujours très vif, chez nous, ma tante songe à la déshériter de la quotité disponible à cause de cette… mésalliance.)
Mon oncle mourut en jouant aux cartes, d’une congestion, après un bon dîner.
Cette fin subite impressionna et exalta terriblement la nerveuse dévote qui voulut m’apprendre à jeûner dès ma dixième année.
Nous passions des heures les genoux sur des planchers froids, sans collation, et au dessert du dîner, le soir, nous avions tous des crises de larmes ; nous nous embrassions entre parents et domestiques, parce que la moindre liqueur nous incendiait le cerveau, naturellement.
De la rigidité de ma mère, une sainte de bois, aux fantaisies espagnoles de ma tante, une sainte de carton, j’errais en des alternatives cruelles pour mes instincts de jeune mâle. Ma mère ne m’embrassait jamais, désirant ne pas développer ces mêmes instincts, et ma tante, après les gifles, me caressait vraiment trop.
Vers douze ans, l’internat me permit de fumer de vraies cigarettes en des coins moins parfumés que le cabinet de toilette de Mme Chasel, mais où je respirais plus… virilement, et je commençais à rendre les gifles à tous mes camarades.
Seulement, il y avait les vacances.
Oh ! les vacances.
Une petite propriété, en Poitou ; un parc, des arbres, des prairies, et des vaches rousses dont la vue me rendait fou de malice.
Je transformais le parc et la prairie en domaine de Gustave Aymard ; les vaches rousses étaient les indiens. Il y en avait une, la plus grosse, qui avait fini par savoir son rôle : dès qu’elle m’apercevait, elle imitait le cri de Bas-de-Cuir et saccageait des buissons.
Dans la maison, je demeurais plus calme. Je me contentais de déchirer les rideaux du salon ponceau pour me faire une étole et parodier la messe.
Ma tante grondait, pleurait, riait, me tirait les oreilles, tirait ses jarretières, me comblait de caresses ou de friandises.
Elle m’était nécessaire comme le fouet est utile à la toupie qui est en train de tourner mal.
Cette veuve, encore jeune, très surexcitée par les pratiques religieuses, un des meilleurs aphrodisiaques connus, me prenait souvent sur ses genoux et me racontait ses tourments :
— Loulou, est-ce que tu m’aimes ?
— Oui, ma tante !
(Baisers, caresses, et lissage de mon col marin sur mes épaules.)
— C’est que je n’ai que toi, pour me consoler. Ma fille ne m’aime pas. C’est une renfermée. Tu vois qu’elle ne m’a même pas écrit le jour de ma fête !
(Sa fille était aux Ursulines.)
— Pourquoi ne la fais-tu pas venir ici ? On s’amuserait mieux.
— Non… elle est trop grande. Et tu es déjà un garçon… Je parie que tu as encore fumé ?
— Oh ! Si on peut dire, ma tante ! Tiens, sens toi-même.
(Ma bouche sur la sienne.)
— Tu sens la fraise… c’est drôle. Non, tu n’as pas fumé.
— Là ! Tu es contente. Dis donc ? Est-ce que tu me donneras l’attirail de pêche pour aller à la rivière ?
— Jamais de la vie ! Tu n’aurais qu’à glisser sur le bord qui est argileux. Je te défends d’aller là.
— Tante, c’est embêtant, mais tu me défends toujours quelque chose !
— On ne dit pas embêtant. Ah ! Ils sont propres vos collèges. Tu nous rapportes des expressions !
— On ne peut pas dire : embêtant. Bien, je m’ennuie, là !
— Tu t’ennuies, chez moi ! Avec moi qui fais tes trente-six volontés ?
— … Pas fumer, toujours.
— Mais ça empeste mes tentures, et tu sauras, plus tard, qu’on ne fume jamais devant une femme.
— C’est donc pour ça que les Messieurs sont toujours dehors !
Et de bouder.
Elle me retraçait des tableaux affreux où la fumée causait les pires catastrophes et développaient des cancers sur la langue des gens.
Je tirais la mienne.
— Tiens ! j’ai fumé toute la matinée derrière toi. T’as rien vu, rien senti et regardes-y voir si j’ai un cancer !…
Ensuite, elle me parlait de notre sainte mère l’Église, de mes proches confessions, des enseignements, si poétiques, de saint Augustin, son auteur favori. (« Tout ce qui finit est trop court. »)
Ça durait des heures, et on se faisait des serments comme des amoureux.
— Tu épouseras ma fille et nous demeurerons ensemble toute la vie !
— Oui, mais ta fille est bossue, tante. Moi, ça m’emb… pardon, ça m’ennuie. On se moquerait de moi, au collège.
— Nigaud ! Tu auras quitté le collège ! Tiens… tu ne m’aimes pas.
Là-dessus, attendrissement, baisers prolongés, et mon jeune corps de félin exaspéré se tordait entre ses bras jusqu’à ce qu’il eût trouvé une certaine détente nerveuse que je m’imaginais être le début d’une effroyable maladie. (Au collège, ça se passait tellement d’une autre façon !)
Quand j’eus quinze ans, un matin qu’elle m’avait giflé trop fort, je lui sautai à la gorge et je la mordis cruellement en lui disant des vilains mots appris dans les endroits où j’allais fumer les cigarettes du collège. Ce fut une scène terrible. Elle me renvoya chez ma mère.
Je devins mélancolique.
J’eus des crises de larmes, moi aussi.
Puis une envie lâche de me faire prêtre.
Puis ma tante, sur le conseil funeste de ma mère dont j’entravais la vie mondaine, me rappela.
A partir de ce moment, tout se passa mieux. Il nous semblait que quelqu’un nous eût accordé la permission.
Vers dix-sept ans, après les brillantes études, le voyage en Italie. Tous les deux, ma tante et moi, nous nous mîmes en tête de ne plus revenir. Nous avions assez de la vie de famille. Nous restâmes un an absents, oubliant de donner de nos nouvelles, et je ne revins que parce que je n’avais plus d’argent. La porte maternelle se ferma devant mes supplications. On m’offrit, en échange de ces supplications, un conseil judiciaire. Et on m’interdit de me servir de mon nom… que je déshonorais. (J’ai pris un pseudonyme identique, ce qui a dérouté mes meilleurs amis.) Je suis un personnage incestueux… car je n’ai jamais pu faire comprendre à ma mère qu’enlever sa tante ce n’est pas un inceste.
Ma pauvre petite tante !… Je l’avais laissée dans un couvent de Naples, demandant la protection de Dieu et des saints, scandalisant tous les prêtres italiens, peu enclins à se scandaliser, par la crudité de ses confessions.
Je ne l’ai jamais revue.
Jamais nous ne nous sommes croisés, dans nos nouveaux chemins de perditions. Elle habite Paris, pourtant, mais… elle est revenue à de meilleurs sentiments.
Elle a vite vieilli.
Elle a maintenant soixante-cinq ans, je crois.
Ma mère l’a parquée dans sa haine froide, lui a fait clore son salon, perdre ses intimes ; elle a éloigné d’elle tous les hommes jeunes et bons pour lui fournir ses propres confesseurs, des vieillards ignorants de toutes les douleurs humaines et qui lui parlent des imaginaires douleurs de l’enfer. On l’a forcée à m’écrire des sottises.
Sa fille la fuit comme on doit fuir le mauvais exemple.
Son gendre ne la connaît même pas.
Elle n’embrassera jamais ses petits-enfants mâles.
Et encore moins ses petits-enfants femelles.
Oh ! le respect de la famille… c’est une belle chose !
Enfin, aujourd’hui, ma mère a pénétré pour la première fois chez moi depuis qu’elle m’a mis à la porte de chez elle.
Je suis hérissé de respect, ainsi que peut l’être un porc-épic de ses dards naturels.
Elle est là, devant ma bibliothèque, solennelle et flottante, s’emparant de toute l’atmosphère comme une bannière de procession.
Des yeux sévères, un nez pointu et des lèvres minces, en lame de yatagan.
Encore belle, toilette d’un goût sobre, pour seul bijou un Saint-Esprit pendu au col, agrémenté d’un onyx qui me regarde avec la prunelle d’un chat mystique.
Je ne suis pas très rassuré.
Il doit y avoir quelque histoire plus grave que mon duel.
— Alors, mon fils, vous pourriez mourir et votre mère n’en serait informée que par les journaux ?
Voix douce, timbre de cloche de chapelle, argentine, cristalline, mais elle se tient à quatre pour ne pas me foudroyer sous le doigt de Dieu qu’elle garde au fond de sa poche.
Je me lève péniblement, j’offre un fauteuil, je traîne la jambe et le bras.
— Une toute petite chute de bicyclette, ma chère maman. Ce n’est rien… en attendant celle dans le purgatoire. Je suis touché de votre démarche, devinant bien ce qu’elle a dû vous coûter d’hésitations.
Elle fait le tour du salon d’un regard noir.
Il y a, chez moi, des photographies plus que décolletées et quelques obscènes chinoiseries de jade, possédant de vagues ressemblances avec le doigt de Dieu.
— Oui, je suis désolé, mais il fallait me prévenir de votre visite. J’aurais mis l’appartement en état de vous recevoir. Joseph !
Joseph paraît et, sur un signe (comme il est stylé aujourd’hui), enlève les objets du culte profane.
Pendant cet enlèvement, ma mère contemple son Saint-Esprit.
— Vous faites de la bicyclette, vous ? dit-elle, rompant notre silence d’église.
— Depuis que vous avez vendu mes chevaux, ma chère maman.
Ce n’est pas vrai, je n’aime pas ce sport, seulement c’est pour la phrase.
Elle pince les lèvres, de sorte qu’elle n’a plus de bouche du tout.
Une femme qui n’aurait pas de bouche… l’idéal de la chasteté.
Je regrette bien de ne pas avoir connu ma mère lorsqu’elle était dans son vingtième printemps.
— La blessure de votre bras n’est pas sérieuse, je pense. (Regard oblique sur mon bras que je viens d’appuyer, sans y faire attention, contre un meuble). Je sais, du reste, de quoi il s’agit.
Ahurissement.
Ne perdons pas de terrain à nous étonner.
— Ah ? Vous savez que ce n’est pas une chute de bicyclette… mais vous avez le choix entre un duel mystérieux et une attaque nocturne, maman.
— Inutile de me rappeler vos mœurs, mon fils. Je les connais.
Je prends un air innocent comme tout, un air d’enfant martyr.
— Mes mœurs ! Je croyais, ma chère maman, que vous ne vous en occupiez plus depuis ma sortie du collège ?
— Moi, Monsieur, je ne fais pas d’esprit.
— C’est une lacune dans la famille, Madame.
— L’esprit, Monsieur, le tombeau du cœur…
(Chapitre XI des confessions du père François Nordelet, page 3, ligne 4.)
Elle reprend, souriante :
— Vous êtes content de votre dernier livre ?
(Un four ! Trop chaste. Un essai qui s’est mal vendu.)
— Enchanté ! Ça se vend comme du pain.
— Cela m’étonne ! Ce roman est presque plus propre que les autres. Le Figaro en a parlé.
(Je me demandais pourquoi celui-là ne se vendait pas ? Tout s’explique.)
Je répète, machinalement :
— Oui, comme du pain.
— Et ce n’est pas le pain de la prostitution, par hasard.
— Peuh ! Il y a des créatures, ma mère, qui en mangent de plus dur.
— Elles se vengent quelquefois, mon fils.
Je suis très inquiet.
— A propos, Louis, votre tante… Madame Chasel, se meurt.
Un bond.
— Ma tante se meurt et vous ne m’en dites rien ?
— Est-ce que vous me prévenez, vous, des accidents qui vous arrivent le long de vos courses nocturnes ? Voyons, mon cher enfant, pas de scènes. Vous pratiquez trop le théâtre pour que vos grands gestes m’émeuvent. La sincère douleur est toujours muette. Vous n’allez pas me dire que cette vieille femme vous tient encore… de très près ? Oui, Mme Chasel va rendre son âme à Dieu. Grâce à nous, elle est en passe de faire une fin édifiante. Elle n’a pas rompu, comme vous, avec tous les préjugés, toutes les traditions, elle s’est amendée, la solitude est une bonne conseillère, et du fond de sa retraite elle a pu juger de la levée du mauvais grain qu’elle avait semé en de certains cœurs ! Elle s’efforcera, j’en suis sûre, de réparer le mal selon tous ses moyens, avant de mourir. C’est, au moins, ce que m’affirme la digne femme que nous avons placée chez elle en qualité de gouvernante. En voilà une qui en a eu de la patience… depuis cinq ans !
Pauvre petite tante !
Et elle, donc !
— Dites-moi, mon fils, causons simplement : êtes-vous au courant des dispositions testamentaires de Mme Chasel ?
— Non, ma mère. Je sais qu’elle a une fille, cela me suffit.
— Il y a la quotité disponible, mon enfant, et elle est capable de nous en frustrer, après nous avoir fait les pires affronts.
Je commence à entrevoir quelque chose.
Nous frustrer de la quotité disponible est la plus admirable phrase de chicane que j’aie jamais entendue.
— Votre tante a cessé de vous écrire ?
— Moi, je lui écris tous les ans… le jour où j’ai l’honneur d’aller vous voir, ma mère.
— Touchante promiscuité, mon fils, de vos sentiments de famille… avec votre penchant incestueux.
Ça y est !
Pas de différence. Pas de trêve. Heure sensuelle. Heure du travail. Grande étreinte de la vie ou du rêve, c’est tout un.
Reste à devenir le héros d’un testament qui pourrait bien me faire aussi manger le pain dur de la prostitution.
Cette femme, je parle de ma mère, avec ces odeurs d’encens et sa voix blanche de trappistine : « Fils, il faut mourir ! » est la plus épouvantable des inventions catholiques : celle du remords.
Partant, celle de l’analyse et l’envie furieuse de retomber dans le péché jusqu’au cou.
— Si ma tante est très malade, je veux aller la voir.
— Vous ferez sagement, mon fils.
Hein ?
— Vous désirez que j’aille voir ma tante, moi ? Et c’est vous qui avez fait interdire sa porte ?
— Aujourd’hui, mon cher enfant, ce peut vous être fort utile… d’après ce que m’a raconté sa gouvernante.
Je regarde et je vois.
— Bien ma mère, j’irai.
Elle a senti à mon ton subitement changé que j’avais compris, trop compris.
Je ne suis pas riche. Je gagne ma vie en fantaisiste. Vis-à-vis d’elle, je n’ai jamais rien réclamé, parce que j’ai trouvé juste de payer, à la famille, en m’abstenant de toutes réclamations, toutes mes folies de jeunesse. J’ai calculé, calcul de fauve rongeant les os après le passage du chasseur qui a enlevé la viande, que ma famille, m’ayant donné l’initiation complète, elle avait le droit de me la faire payer plus cher que dans certaines maisons, moins nobles.
Grâce à ma tante, je sais et je suis libre.
Que pourrait-elle, pauvre femme, ajouter encore à mon éducation ?
— Ma chère maman, comptez sur moi, j’irai…
Nous croisons deux regards noirs d’orage.
Entre nous, il y a maintenant la quotité disponible.
Mais en quoi cela peut-il l’intéresser ?
Elle se lève pour prendre congé.
Sur le seuil, pendant que je m’efface :
— Il faut soigner votre blessure, mon fils. Les coups de couteau sont toujours très malsains, au printemps.
Un brouillard monte sur ma vue. Je ne vois plus distinctement. Colère ou honte, je tremble.
Un élancement nouveau dans ma blessure. Comment sait-elle ?… Inutile de nier.
— Comment savez-vous ?
— On sait toujours ce que l’on veut savoir. Et j’ajoute ceci pour votre gouverne, puisque vous roulez jusqu’à des aventures de ce genre : la fille qui vous a gratifié de ce coup de couteau est sous la surveillance de la police. Il est probable qu’on vous surveille aussi… en haut lieu. Prenez garde !
Je serre brusquement le bras de ma mère. Elle a un mouvement de révolte et d’horreur : non parce que je lui fais mal, mais parce que je la touche, affreuse mortification !
— Voulez-vous me dire tout de suite ce que vous désirez ? Ces manières, genre dernier empire, ne sont plus à la mode, je vous assure.
Ses yeux au ciel :
— Encore vos romans ? Je ne désire rien, Monsieur, que votre guérison. (Et sa voix conserve des notes de cristal de la chapelle des trappistines.) Votre guérison radicale du corps et de l’âme ! La préfecture est là. On peut s’en servir quand on a un enfant tellement dénaturé qu’il oublie de vous faire part de ses accidents de bicyclette. Les détails manquaient dans les journaux. J’ai envoyé un de mes amis, un vieil avocat fort estimable, en demander au parquet. Le dossier d’une nommée Léonie Bochet nous a édifiés sur votre conduite. D’ailleurs, vous êtes bien libre, n’est-ce pas, depuis votre âge de raison…
Il me semble qu’on fouille ma blessure avec des ongles pointus.
— Vous n’allez pas faire de mal à cette fille, je pense.
J’ai la tête en feu.
Ah ! pauvre tante ! La raillerie, l’intrépidité, la Fronde…
Je suis tout d’un coup un petit garçon frissonnant de fièvre. Mes yeux se brouillent de plus en plus. J’ai le vertige du surnaturel et suis tout prêt à croire que ma mère est douée de la puissance des archanges exterminateurs.
Libre, moi, oui. Mais Léonie ? Et je ne réfléchis pas qu’il faudrait ma propre plainte.
— Mon Dieu, maman, vous considérez cette personne comme un objet impur. Vous briseriez volontiers mes petites statuettes de jade et d’ivoire qui sont peu décentes, je l’avoue, et vous laisseriez tomber cette fille par terre, sans penser qu’elle a une âme, qu’elle est également un objet d’art précieux. Je vous en prie, faites bien attention à vos gestes, ne brisez rien… j’y tiens beaucoup.
Et j’ai trente-trois ans ! Je me battrais.
Elle me répond, pleine de mansuétude :
— Pouvez-vous supposer, mon cher enfant, que j’abandonnerai jamais mes droits de mère chrétienne ? Vous êtes en grand péril et je ne puis que prier de loin, mais nul au monde, pas même vous, ne peut m’empêcher de demeurer en prière pour votre âme, pendant que vous dormez. Une mère veille toujours.
(Chapitre XII des confessions du père François Nordelet, page 8, ligne 5.)
Elle sort.
Ma mère porte malheur, comme la religion et comme la vertu.
C’est elle qui m’a livré, enfant, à ma tante.
C’est elle qui va me précipiter dans une aventure folle.
Si on ose toucher à mon objet d’art, dieu, diable ou police, je lui offre un asile chez moi.
Je suis exaspéré et je vais m’abattre sur mon divan, les poings crispés, le front chaud.
Je ne suis donc plus maître de ma vie d’amour ?
Ai-je dérogé, par hasard ?
Et deux femmes se dressent aux deux bouts de ma route.
Elle, Cléopâtre, le beau vice doré, le sexe attirant…
Ma mère, la vertu maléfique, repoussante…
… Madame et Mère, née de la Paillerie.
La gouvernante, d’un humble accent, murmure :
— Non, elle ne passera pas la semaine, monsieur Louis, malgré la chaleur. Son catarrhe lui remonte et c’est la fin. Demain, on doit lui apporter le bon Dieu pour être plus sûr. Elle nous l’a demandé. Elle verra sa fille, son gendre… oh ! elle est devenue bien plus douce à soigner, la pauvre chère dame. Si vous pouviez, maintenant, obtenir qu’elle se raccommode avec Madame la comtesse, ce serait sa tranquillité pour l’autre monde, vous comprenez ?
Oui, je comprends, il s’agit de renouveler, en petit, la scène de l’inquisiteur menaçant de la torture qui ne sauvegarde pas l’argent pour la plus grande gloire de Dieu. Cette scène-là peut s’intituler : Quotité disponible.
Mon flair de fauve ne s’y trompe pas.
J’entre chez Mme Chasel pour la seconde fois depuis quinze ans.
Oh ! l’oubli lourd de ceux qui ont aimé des femmes et les laissent mourir loin, dans le manteau troué de leur vieillesse !
La chambre est sombre.
Je reconnais peu à peu les tentures de damas bleu pâle, et le pouf où la levrette arrondit sa patte, et le petit meuble de laque sur une console, un cadeau de moi, enfant. Je reconnais le tapis, si usé, les potiches en vieux Sèvres, la pendule, avec, dessus, deux amours de bronze couronnés de roses d’or.
Elle est couchée au fond d’un lit très vaste, sous un amoncellement de couvertures et d’oreillers.
Elle a toujours froid, me dit-on.
— C’est donc toi, Loulou ?
Oh ! cette voix cassée, trémolente, cette voix de femme perpétuellement effrayée par l’horreur de la nuit infernale qui se prépare pour elle.
Elle a un serre-tête de linge blanc, un bonnet d’hospice ; des cheveux gris tombent autour, en mèches luisantes d’une sueur de fièvre.
Son visage est tout réduit, comme en caoutchouc couturé, lacéré sous les stylets impitoyables des rides. Ses yeux, un peu bordés de rouge, noient leur prunelle derrière une taie comme deux têtes de nouveau-nés derrière une vitre sale. Elle a une camisole fort simple, en calicot dur, elle qui aimait les dentelles mousseuses.
Elle me tend la main, une chose déjà morte, craquante comme une feuille jaune, et en me tendant la main, sa camisole s’ouvre : je vois qu’elle a deux emplâtres sur la poitrine.
Non ! ce sont ses deux seins.
Non ! c’est impossible… Je veux, moi, que ce soient deux emplâtres.
— J’ai osé venir, ma tante, parce que l’on m’a dit que cela ne vous déplairait pas.
Elle rit, toussote, ses yeux roulant à droite et à gauche s’égarent dans un bon rêve d’honnêteté bourgeoise.
Elle a tout oublié.
Elle est devenue si vieille tout d’un coup.
Il n’y a pas eu de transition.
Elle est si loin de tout cela.
D’ailleurs, la femme de trente-neuf ans qui a quarante ans est une autre femme, et la femme de soixante-cinq ans n’a jamais eu même quarante ans.
Rien ne s’enchaîne normalement comme chez nous, les hommes.
Elles ne vieillissent pas.
Elles meurent d’époque en époque, se transforment.
On dirait que des génies malins les poursuivent pour leur donner, successivement, toutes les hontes et tous les espoirs.
Oh ! les pauvres saintes femmes ! Celles qui ont aimé.
(Celles que nous aimons ne sont jamais des saintes.)
J’ai poussé le pouf de damas bleu et me suis mis à genoux, comme jadis, sur la levrette à patte arrondie en queue de cruche, pour me rapprocher d’elle.
La gouvernante se retire discrètement.
— Ah ! on t’a dit, on t’a permis… C’est bien d’être venu, Loulou (elle se soulève péniblement et me regarde effarée). Voyons, toi, qui ne m’as pas examinée depuis longtemps ? Examine-moi bien… Est-ce que je suis si, si malade ? Réponds sans mentir, Loulou.
— Tante, tu es folle ! Toujours folle ! Tu as la mine heureuse de quelqu’un qui se dorlote, voilà tout ! Tolérez-vous qu’on vous embrasse ?
Elle semble chercher dans sa mémoire pourquoi cela ne serait pas tolérable. L’égoïste préoccupation de sa fin prochaine l’empêche d’avoir aucune lucidité d’esprit. Elle sent, vaguement, que j’étais un très mauvais sujet, un gamin mal élevé, (surtout par elle). Oui, elle y est, à présent : un neveu capable de tout, fabriquant des étoles avec les rideaux du salon ponceau.
— Mon Dieu, comme tu as grandi, Loulou, et engraissé. Tu as l’air d’un homme… raisonnable. Je t’ai laissé moutard. Dis donc, on met des jaquettes gris perle, maintenant, et à revers de soie ? Une mode que j’ai connue et qui revient. C’est singulier ! Moi, tu sais, je ne sais plus rien, on ne me visite guère… Les vieilles femmes ! (Elle toussote.) Tiens ! un bouquet de réséda ! C’est donc ma fête, aujourd’hui. Tu es gentil d’avoir eu cette attention… Voyons, quand je tousse, réponds-moi bien franchement, quel effet ça te produit ?
Elle tousse avec effort.
On dirait une poulie qui grince pour la première fois depuis des siècles.
— Tante, cela me produit l’effet d’une mauvaise plaisanterie de votre part. Vous voulez me faire peur ; seulement, ça ne prend plus…
Elle se met à rire.
— Jamais sérieux, ce garçon ! Quel drôle de garçon… Alors, ta mère a voulu te marier ?… On s’est encore disputé pour cette histoire, j’ai entendu raconter ces choses. On a le temps de comprendre quand on est seule… Pauvre Loulou ! J’ai lu toutes tes lettres… oui… oui… je n’ai jamais répondu. Une idée de mon confesseur. (Avec bonhomie :) Il faut bien leur en passer à ces bourreaux qui nous promettent le ciel. Toi, tu ne crois à rien, tu as tort. Enfin, je suis contente de te revoir. Tu es en santé, au moins, Loulou ?
— Peuh ! j’ai failli me casser un bras, le mois dernier.
— Comme c’est malin, ça. Tu grimpes donc toujours aux arbres ?
Elle a l’air d’avoir oublié précisément le temps écoulé entre ma sortie de l’école et mon retour d’Italie.
— Quelquefois, oui, ma tante.
Je tiens sa main, une chose atroce, sèche, grise, avec des espèces de mousses brunes entre les doigts et des ongles violets.
Je la baise doucement.
Elle esquisse le geste de me calotter.
— Ah ! non, petite tante, pas ça, dites ! J’ai des moustaches et vous allez me faire… beaucoup plus de mal.
Je suis terrorisé à cette pensée de recevoir des gifles de cette main, la même !
Elle rit, s’étire un peu, cligne de l’œil.
— Drôle de garçon ! J’ai été bien bête de me priver de tes visites, tu m’aurais fait rire quelquefois. Ça m’empêche de sentir mes douleurs, de te voir. Dis-moi ? je suis sûre que tu m’en veux, au fond ? (Elle devient mystérieuse.) Mais je dois réparer, oui j’ai promis de réparer et je n’ai qu’une parole, Loulou, c’est comme si le notaire y avait passé. Je ne pense pas m’en aller encore, Dieu merci, cependant, on a pris ses petites précautions de vieille bonne tante qui n’oublie pas que son seul enfant c’est toujours son neveu… Voyons, Loulou, qu’est-ce que tu regardes sur la table ? Tu ne m’écoutes pas.
— Si, ma tante.
Je regarde sur la table de son chevet, entre des fioles pharmaceutiques et des tasses de porcelaine commune, un petit chapelet en perles de Rome, ce que les dévotes appellent une dizaine, moitié bracelet, moitié joujou à prières ; il est là, souvenir diabolique des mille folies de deux amants, plus épris peut-être de voluptés que de véritable amour.
— Fais-moi le plaisir de m’écouter religieusement, Loulou !
La femme autoritaire qui reparaît.
Elle sort de son linceul, et la momie retrouve la parole sous les bandelettes de la dévotion.
— Voilà, j’ai fait un testament. On l’aurait bien trouvé après ma mort, mais je préfère te le dire tout de suite. Je ne t’ai pas oublié, pas plus que Marie-Louise. Ta mère a été bien dure pour moi, cependant, j’ai mon intérêt à lui laisser quelque chose. Ensuite, l’avenir n’est pas si brillant de ton côté (elle s’anime). Toi, tu écris des livres qui ne sont pas lisibles… Je n’y ai jamais rien compris… l’emballement des gens là-dessus, ça ne durera pas. Je te le dis comme je le pense. Toutes ces histoires d’amour, ça n’a jamais beaucoup de vogue. On s’en dégoûte. Les gens sont plus sérieux que ça.
— Oui, tante, ou ils le deviennent, je suis de votre avis.
— Et qu’est-ce que tu feras, quand on ne lira plus de romans ?
— Quand on ne lira plus de livres d’amour, tante, je n’aurai plus rien à faire ; la terre aura cessé de tourner.
— Mauvais garnement ! Si seulement je pouvais te montrer mon confesseur. Voyons, Loulou, pas de bêtises ! Va fermer la porte. Ma gouvernante écoute, j’en suis sûre. Là… baisse la portière. Non ! Pas comme ça ; détache le rideau de l’embrasse. Mais tu vas tout déchirer !… Tu es bien maladroit ! C’est étonnant comme un homme ça ne sait rien faire proprement. (Je reviens anxieux ; dans une minute, elle aura envie de me calotter.) Ah ! où est-ce que j’en étais ? Le testament ! C’est très drôle, je suis obligée de chercher mes mots comme avec la pince à sucre ! Enfin, j’y suis : Je te lègue (elle appuie sur les syllabes) cinquante mille francs, la moitié de ce que je voulais te donner, et les autres cinquante mille francs à ta mère, parce que le Juif plaidera, lui. Alors, comme je craignais tes étourderies habituelles… j’espère, hein ?… tu saisis bien… Je suis sûre, maintenant, que ta mère plaidera de son côté. Elle veut beaucoup savoir ce que je lui lègue… Tu pourras lui dire, de ma part, que je lui lègue… la permission de défendre tes intérêts. Elle qui aime tant la chicane !…
Je suis écœuré.
C’était bien cela.
— Petite tante, pourquoi voulez-vous me léguer des ors puisque vous savez que je gagne ma vie… exprès pour ne plus rien demander à personne…
— D’abord, je tiens à déshériter ma fille… parce qu’elle est plus riche que moi et qu’elle me déteste ; ensuite, mon gendre est un Juif qui ne mérite pas un sou… pas un sou ! Et puis… Loulou, tu es un grand enfant, tu es toqué ; seulement, quand tu te marieras, tu seras bien aise de mettre mes épingles dans ta corbeille de noces.
— Je ne veux pas me marier, ma tante.
— Allons donc ! Il faut toujours finir par là. Tiens, va me chercher le papier, là-bas, dans le petit meuble de laque, sur la console. La clé se trouve sous la pendule. Ne casse rien, je t’en prie. Tu es si brouillon.
Je trouve la clé. J’ouvre le petit meuble, je prends le papier, je l’apporte. Mais j’ai envie de casser quelque chose.
Et je ne peux pas m’empêcher de sourire en songeant à cet instinct des femmes d’amour qui font toujours passer leur amour avant leur devoir, même quand elles ont oublié.
— Qu’en dis-tu, Loulou ? C’est bien en règle !
— Pas à mes yeux, non.
— Ah ! tu sais, Loulou, j’entends être obéie. Heureusement que ta mère plaidera, et vous aurez la quotité disponible. (Elle toussote.) Oui !
Admirable logique de l’illogisme humain !
— Tante, ne vous tourmentez pas, vous êtes fatiguée. C’est convenu, nous plaiderons.
— Ta parole, hein ! Va remettre ce testament à sa place.
— Je vous donne ma parole, tante, que je remets cette enveloppe où je l’ai prise.
Et gravement, je glisse une de mes cartes dans cette enveloppe sacrée :
Louis Rogès
Homme de lettres.
Ma mère, son estimable belle-sœur, saura ma réponse. Et elle en éprouvera une certaine commotion nerveuse, elle qui n’a pas de nerfs.
— Petite tante, est-ce que vous aviez consulté un notaire ?
— Sans doute, mais il n’a pas voulu m’écouter. Aujourd’hui, tous les notaires sont juifs.
— Oui, ma tante. C’est bien bizarre. Ils ont l’esprit de famille, ces gens-là !
— Oh ! mon pauvre gamin, quels bourreaux, ces hommes de lois, ces confesseurs, ces religieux ! On n’a pas la paix du tout, les uns tirent par ci, les autres tirent par là, et il y a l’enfer, et il y a le code. Je suis joliment heureuse de t’avoir vu.
Je tressaille tout en tortillant le testament.
Elle est d’une telle candeur…
— Dis donc, Loulou, tu ne t’ennuies pas trop chez les vieilles femmes ?…
— Moi, ma tante, je m’amuse comme un dieu.
Je m’agenouille sur le pouf. Ce papier m’exaspère.
— Tante… tu es bonne… Pourquoi me giflais-tu si fort, jadis ?
Elle rit, toussote :
— Donne-moi mes pastilles, là, cette boîte rose ; je t’ai giflé parce que… tu en avais besoin, mauvais sujet. Tu ne faisais que des sottises.
— Nous sommes de vieilles gens, aujourd’hui, tous les deux. On peut se faire des confidences et se moquer de soi-même… demain, je me casserai peut-être le cou en grimpant à un arbre… Tante, pourquoi m’embrassiez-vous après m’avoir battu ?
Elle songe, cherche sur ses couvertures, en grattant du bout des ongles, un mot qui ne vient pas.
— Oui, je te battais et je t’embrassais… C’est parce que je regrettais de t’avoir battu si fort. Ah ! Loulou ! mon pauvre Loulou, je me souviens, et tu pleurais, et je pleurais… Les prêtres sont de terribles gens… les notaires aussi, Loulou ? Est-ce que tu as une pensée sur Dieu, toi ?
— Non, ma tante, parce que je lui préfère l’Autre.
— Quel autre ? Tu me fais peur !… Voyons, ne plaisante pas comme ça, c’est très sérieux, ce que je te demande, mon garçon !
— Le diable, l’amour, ma tante. Au moins, lui ne nous leurre pas, il nous fournit son enfer tout de suite, et gratis.
— L’amour ?…
Elle paraît dormir.
Dans le grand silence du lit et de la chambre, on entend seulement ses mains qui froissent de la soie.
— Loulou ? Est-ce que tu es encore là ?
— Oui, ma tante. Vous désirez que je m’en aille ?
— Une fantaisie… tu sais les malades ont des idées si bêtes ! Figure-toi que j’ai pris goût à l’odeur du tabac depuis que je tousse !… Eh bien ! tu ne vas pas rire, j’ai envie de sentir de la fumée. Oui, moi qui t’ai tant défendu les cigarettes, je voudrais te voir fumer chez moi… pour te bien prouver que je te pardonne toutes tes sales inventions de gamin.
Sentir de la fumée ?
Je la regarde tristement.
Elle rit, déjà retournée à son rêve de vieille que la peur de l’enfer talonne.
— Dame ! Si je dois brûler dans le purgatoire longtemps…
— Petite tante, vous êtes toujours frondeuse. Vous voulez toujours jouer aux choses défendues. Un homme ne doit pas fumer devant une femme comme il faut, vous le savez bien.
— Eh ! tu m’agaces. Je ne suis pas une femme… comme il faut. Je suis trop vieille. Obéis-moi, mauvais garçon du diable !
— J’obéis, ma tante, j’obéis.
Je cherche un cigare, des allumettes, en me penchant un peu en arrière de ses rideaux.
Le testament flambe, je suis débarrassé. Là, c’est fini… Un londrès de cinquante mille francs, ce n’est pas banal, et je mène encore la vie comme je veux. (D’autant mieux, qu’après chicane, ce cigare ne vaudrait peut-être plus rien du tout.)
Je me remets à genoux pour fumer.
Elle toussote, se calme, aspire doucement.
— Quel mauvais garçon, ce Loulou ! Tu reviendras, dis ? Tu es si drôle ! Oh ! tu n’as pas changé, toi ! Cette fumée… cette fumée… Ah ! chéri, chéri, je vois… Je me rappelle des choses… des choses que je ne peux pas dire… Dieu me pardonnera, j’ai tant souffert ! je suis si vieille, maintenant !… Ah ! cette fumée… Chéri ! cette fumée… ton corps si blanc et qui sentait la fraise. Ah ! Loulou !… c’est bon.
Et elle s’endort, paisible, en attendant le plus profond sommeil.
Pauvre femme qui a torturé, pauvre folle qu’on a torturée ? Est-ce bien là cette même bouche qui a râlé, sous la mienne, ce même mot, et ose, enfin, le répéter, mourante, sous le nez de Dieu ?
Elle est venue chez moi.
J’étais comme un collégien en vacances ; maintenant, je suis comme un très vieux Monsieur qu’on a brusquement lâché sur les trottoirs en lui disant d’affreuses choses.
Et il m’a fallu enterrer ma tante au lieu de courir chez tous les tapissiers pour y chercher des soieries jaunes.
Chienne d’existence !
Elle est venue. J’écrivais. Elle s’est plantée droite devant mon bureau.
— J’ai besoin de cent sous.
Je suis tombé à genoux, je me suis roulé, j’ai fait des culbutes, j’avais l’air d’un brave animal qui retrouve son maître (je ne dis pas : sa maîtresse).
— Oui, oui ! Cent sous ! C’est extravagant ! Pourquoi pas dix centimes ?
— Quel maboul.
Mais elle restait devant moi comme un autre animal point de la même espèce. Elle flairait le vent, les sourcils un peu froncés, car elle ne plaisante guère, elle, ou ses plaisanteries sont des coups de couteau.
— Je n’ai pas voulu t’envoyer ma maquerelle de concierge parce que…
— Oui, oui !… Je t’aime. Assieds-toi, ôte ta voilette. Tiens, ce coussin sous tes pieds… Tu as remis la robe de notre journée de campagne, c’est délicieux ! Voici du Porto et des biscuits… moi, je suis content pourvu que je boive tes yeux, tu sais ? Tu n’étais pas chez toi, dis, avant-hier ? Oh ! j’ai attendu dans cette loge de concierge une heure mortelle, en face d’une mégère qui me racontait des abominations…
Et j’ai vu descendre de sa chambre, par l’échelle de meunier, un homme, un type, selon son mot, encore tout remué du printemps de son corps.
J’ai vu cela et je suis à genoux devant elle, je lui baise les mains.
— Oui, j’avais du monde. Faut t’y habituer.
« Force dynamique, Tremplin et paroxysme de la passion » conseillés comme système d’art… J’en ai assez. Je ne veux plus qu’elle demeure là-bas. Je la veux près de moi, non pour la torturer à mon tour, mais pour qu’elle se repose tout enveloppée de l’effroi respectueux de mon amour.
Je ne sais plus du tout ce que je dis.
— Reine, pourquoi me demander de l’argent pièce à pièce comme un gosse qui va s’acheter des billes ? Laisse-moi te mettre une bonne fois à l’abri de ton infâme genre de misère. Est-ce que tu aimerais le métier, par hasard ?
— Ne me tourmente pas avec tes bêtises. Je veux rien savoir. Faut me laisser méchante, moi.
Elle trempe ses lèvres dans le Porto, fait une grimace et regarde le salon.
— C’est encore du muscat trop sucré ! Dis donc, chez toi, on dirait le b… de la rue… (Pas de réclame !) il est tendu aussi en soie rouge.
— Très flatteur ! Allons, Reine, un bon mouvement… viens habiter ici, et ce sera complet.
Je ris.
Elle rit, en dedans.
— Est-il maboul, ce garçon-là. (Elle cligne des yeux.) Ce serait pourtant le seul moyen pour me tirer de leurs pattes, en attendant mieux.
Je me croise les bras.
— Seulement, tu aurais peur de manquer sa sortie de prison ?
Elle a un geste de tête en arrière comme celle qui redoute toujours les soufflets.
— Ah, non, j’ai pas peur ! Quand il sortira, je m’en irai, voilà tout.
Je me remets à ses pieds, je tiens ses genoux que j’embrasse au travers de sa robe.
— Sérieusement, veux-tu demeurer ici ? Je serai ton frère, rien que ton frère. J’attendrai pour t’aimer… moins, que tu m’aimes… davantage. Je serai… ton amant de cœur, d’une race nouvelle d’amant de cœur. Pardieu, ne mâchons pas les termes et allons-y gaiement. Ton souteneur comme l’autre, qui donnera des coups de couteau à ceux qui t’embêteront… ou qui en recevra, cela me paraît plus certain. Reine, ma petite Cléopâtre bien aimée, tu essayeras sur moi les poisons tout à ton aise et tu dormiras la nuit. Ce que cela sera doux ! Nous aurons l’aplomb de nous fiche du monde qui se fichera de nous. L’idylle la plus monstrueuse que jamais démon ait pu rêver dans le cerveau d’un homme. Nous serons si chastes étant tellement corrompus déjà, que nous finirons par mourir un jour de nos fièvres. Un joli programme ! Est-ce que cette perspective ne te réjouit pas ? Voyons, Reine, il y a, touchant mon logis, deux chambres à louer qui ont une sortie particulière, un escalier de service… Je veux que tu puisses courir la nuit et me ramener des hommes si tu l’oses, mais je te déclare que si je m’en aperçois, je tire dessus… Je veux qu’on soit libre chez moi.
Je sens que je deviens positivement enragé.
Elle rit et hausse les épaules.
— Sois tranquille, mon petit homme, si je reste ici, ce sera pour dormir. J’en peux plus. (Et lasse elle s’appuie sur sa poitrine, ajoute d’une voix bâillante :) Du chiqué, tes histoires, ça finira mal, et ça fait tout de même plaisir quand ça vous passe dans l’oreille. Tu es bien maboul, mais tu es brave. J’aurais pas cru… Vois-tu, c’est crevant leurs petites visites, et ils m’en content, eux aussi, des histoires pour les mœurs. Dis donc, est-ce qu’un type comme toi peut avoir des raisons avec la police ?
J’éclate.
— Non, Reine, non ; je n’ai jamais ni volé ni assassiné personne, et je suis fort net sous le rapport des… mœurs. Je suis ce qu’on appelle un honnête homme. Un assez joli genre de canaille, je t’assure. Tu es donc, toi, une simple petite fille ? Ma parole, tu crois au loup-garou !
Et je l’embrasse, fraternellement, dans le cou, sous la toison noire de ses cheveux relevés.
Elle, d’un ton résigné.
— Déjà les saletés qui commencent ? Je dormirai pas mieux chez toi.
Cette fille a la conscience de l’absolu. Pourquoi ceci et pourquoi pas cela ? Pourquoi cela et pourquoi pas ceci ? Excellent tremplin. Nous allons devenir très gentils ; seulement, il y a le coup de couteau. Le donnerai-je, ou le recevrai-je ?
Je suis nerveux.
Elle se lève, remet sa voilette.
— Je leur laisserai tout mon bazard, hein ? J’arriverai comme je suis… c’est-à-dire sans liquette, j’en ai pas. Je suis forcée de leur écrire mon adresse, je t’ai prévenu.
— J’accepte toutes les responsabilités les yeux fermés… pour ne pas te voir sans liquette.
Et elle part.
… Le lendemain, j’enterre ma tante.
Cérémonie de famille (toujours vraiment funèbres, celles-là !)
Il pleut. Les seules larmes sincères, le ciel les déverse à flots. Ordinairement, je n’assiste pas à ces corvées mondaines, mais il pleut tellement que je ne peux pas voir partir cette vieille femme sans aller lui offrir mon bras.
Pauvre petite tante ! Il ne pleuvait point, en Italie, où nous avons mangé de ces fruits brûlants mûrissant près du Vésuve… et si remplis de cendres !
— Joseph, ma redingote, la dernière, celle cintrée… Joseph, vous serez plein de prévenances pour Mlle Léonie et vous la servirez comme moi-même.
— Oui, Monsieur. Ah ! vous allez en avoir des ennuis. Votre mère, pardon, Madame la comtesse…
— Il n’y a plus de comtesse, Joseph. Il y a la reine et saluez très bas ou je vous flanque dehors…
Maison mortuaire.
Réception froide. Poignées de mains rares et molles. Je fais scandale. Le plus terrible de tous : le scandale muet. Ma mère a un petit sourire protecteur qui me prouve qu’elle n’a pas encore ouvert le moindre testament ! On cherche. Je suis hermétique…
Des dames âgées, des messieurs graves : on n’est pas triste.
Toujours la réunion d’actionnaires qui déclarent quelqu’un en faillite.
Devant moi, les femmes se reculent en rangeant leurs jupes, les hommes, des commerçants ennemis-nés de ceux qui travaillent dans l’amour au mépris des sentiments de famille, affectent de ne pas me parler. Un seul me tend plus gracieusement la main et cause : le gendre juif. Une redingote plus cintrée encore que la mienne, beaucoup de chic. Il me parle avec un pli railleur de lèvres de mes œuvres. Il les a lues et il les admet. Ce Monsieur vend je ne sais quoi dans trois quartiers différents de Paris, et cela doit lui être joliment commode pour tromper sa femme, qui est bossue.
Elle est à côté de moi, petite tortue inquiète rentrant le col sous sa carapace de deuil. Un chignon noir superbe. Les bossues ont toujours de beaux cheveux. Là, sur la nuque, une petite place pâle, un trou de neige rafraîchissant, et pouvant, à la rigueur, mettre l’eau à la bouche.
Pauvre petite cousine ? A-t-elle eu son rêve d’amour, et l’a-t-elle réalisé ?
Déjà trois enfants. Une passive, une résignée, une excellente mère, dit-on. Je devine qu’elle a horreur de moi. Elle me fuit, se dissimule derrière des couronnes de perles gigantesques et ne m’a pas tendu la main.
Je comprends. Selon la légende, je suis le monstre incestueux, l’amant de sa mère, c’est-à-dire qu’au lieu de se dénommer ma cousine, elle pourrait aussi bien représenter ma fille, et son mari, mon gendre. Admirable complication.
Nous partons, Madame Mère est très digne. Elle s’enquiert tout le temps de la couronne des sœurs de la Passion.
Les sœurs de la Passion ! Une confrérie spéciale…
Notre sœur en la passion, ma pauvre petite tante, priez pour moi… et pour la fille Léonie !
A l’église.
Chaleur orageuse dégageant des odeurs de chien mouillé de tous les parapluies. Violent parfum catholique : un mélange de chaussures malpropres et d’encens.
Ma cousine me regarde désespérément, de loin.
Quand on songe qu’à Paris, où tout s’oublie, ma mère a trouvé le moyen d’entretenir cette… légende autour de la malheureuse vieille morte depuis quinze ans !
Les curés nasillent, se dépêchent ou s’attardent, avec le rythme d’une mélopée développant de la fatigue pour tout le monde.
La quête. Je regarde ma cousine.
Elle baisse les yeux sous son voile et j’aperçois la petite place de neige, entre la nuque et le col, qui devient rose.
Toi, ma petite, tu es sensuelle.
Je me rapproche et nous voici, messieurs et dames et la famille.
Bruits de cercle. « Un louis qui tombe. » « Ramassez. » Avec cette différence qu’aucun chasseur ne vient vous rendre la monnaie.
Des panaches ondoient et nous allons recevoir les gens à la porte, une figure de cotillon.
Ma cousine est tout près de moi. Elle tremble. Cela m’énerve. Je la pousse un peu du côté de son mari, sans le vouloir.
— Pardon, Madame.
Une réponse à voix inintelligible, presque un souffle.
— Je vous ai pardonné de tout mon cœur, Monsieur.
Les dévotes ont un art exquis pour vous parler à l’église sans que personne puisse entendre.
J’entends très bien. Celle-ci chasse de race.
Ma mère est impassible. Espérons qu’elle n’a rien saisi.
Elle est forcée, un moment, de s’appuyer sur mon bras, Madame Mère, et je crois que nous allons nous dévorer. Le contact du vice, tous les ferments de corruption… Horreur !
Elle appuie légèrement ses doigt noirs d’exorciste.
On dirait une fiancée qui n’ose…
Brutalement, je presse ce bras dans une inconsciente volonté de lui faire mal.
C’est trop de corvées pour un seul jour.
Nous passons.
Des réflexions, à la sortie : « C’est le neveu ? » « Oui, ma chère, il est bien. » « Quelle figure pâle ! Il a l’air d’un noceur. » « Ah ! Ah ! un de Rogès, ma chère, c’est toujours noceur. » On entoure le corbillard comme on entourerait une voiture de noce, en effet, et l’on parle trop haut.
Ma mère, cette fois-ci, a tout entendu.
Chose singulière, cela ne semble pas la faire s’évanouir, au contraire.
Ses yeux brillent. Elle pince moins la bouche. Ses narines se détendent un peu, lui festonnant un nez moins pointu. Elle pèse davantage sur mon bras, c’est une demi-seconde d’abandon, mais c’est réellement de l’abandon féminin.
J’ai envie de rire.
Est-ce qu’elle serait flattée d’avoir un fils noceur ?
Ou d’être, simplement, au bras d’un Monsieur bien ?
Pauvre petite tante ! Ne les écoute pas, dis ; je suis venu parce que je te pensais seule de ton espèce, ici, mais je m’aperçois qu’elles te ressemblent toutes… et Dieu m’est témoin qu’à l’heure sexuelle ou à l’heure de la mort, le mâle est toujours le roi.
Bonsoir. J’en ai assez.
Je te lâche, petite tante, pour courir après une fille, et je t’entends, souffle dernier de la dévote, au fond de ton cercueil :
— Va ! Va ! Tu seras toujours un mauvais garçon du diable !
— Oui, ma tante… et ce n’est pas absolument de ma faute.
Je rentre.
Ma journée gâchée.
Pas possible d’aller chercher des soieries jaunes, ni de louer les deux chambres séance tenante.
Impossible d’écrire. Je rêve.
Joseph, très anxieux, m’apporte des lampes.
— Monsieur voudrait-il recevoir ?
— Qui ?
— Quelqu’un de… sérieux.
Sans attendre une permission que je ne voulais pas lui donner, il s’efface devant un homme peut-être sérieux, mais très mal habillé.
Nous restons à nous examiner, les yeux hostiles.
Un bonhomme chauve, linge douteux, cravate voyante.
L’ancien prote ou correcteur dans la dèche ayant cinq petits enfants, une femme malade. Je cherche ma bourse.
— Monsieur de Rogès, n’est-ce pas ?
— Monsieur Rogès tout court, s’il vous plaît.
— Ah ! très bien ! Est-ce que l’on pourrait causer gentiment ? Non. Je n’ai besoin de rien. Je viens pour vous rendre un service, au contraire.
Je suis furieux. Il va me lire un manuscrit et m’apprendre à faire un roman.
— Trop heureux. Comment vous appelle-t-on ?
J’ai reçu, un soir, un Monsieur identique qui avait découvert la manière d’écrire deux sonnets différents à la fois et d’une seule main. C’était fort ingénieux.
Il désirait prendre un brevet. Il prit un petit bronze auquel j’avais la faiblesse de tenir, et disparut avec.
Joseph ne garde plus du tout ma porte, décidément.
— Je m’appelle Mathieu. Vous ne me connaissez pas ; moi, je suis charmé de faire votre connaissance. J’ai lu vos livres. Il m’ont rudement amusé, bien que je sois revenu des choses de la bagatelle. Des casse-tête chinois vos livres, entre nous ! Vous savez, sans doute, ce que vous voulez dire, hein, et vous aimez les petites femmes… ça se devine. (Rire gras.) Est-ce que je peux m’asseoir ?
— Non.
J’ai les poings serrés. Je me crois capable de le fourrer dehors sans aucun bronze.
Lui, très doucement.
— Voyons ! M. Rogès… tout court ! Ne vous gardez pas à carreaux. Je viens pour une histoire de petite femme, la fille Léonie.
Je hausse l’abat-jour d’une lampe.
Un de ses amants peut-être ?
Je me sens une pointe de feu sur les reins.
— Léonie ? Que lui arrive-t-il ou que voulez-vous ?
Il est perplexe et me regarde en dessous avec des yeux horriblement câlins.
— Parlerez-vous, à la fin, ou je vous mets dehors ! Je n’ai pas le temps, Monsieur.
— Vous êtes vif.
Il sort un petit portefeuille crasseux, me montre une carte de couleur.
C’est un agent des mœurs, et un vrai.
— Monsieur Rogès, je ne me flatte pas d’être un homme du monde, mais je suis tout sucre quand il convient d’arranger les choses. Je ne veux pas vous embêter, je suis ici pour vous être utile. (Il rit.) On n’empêche personne de s’amuser, dans notre arrondissement. Vous faites la noce et c’est de votre âge ; seulement, vous ignorez quelquefois avec qui, et quand on a une famille bien posée, ça peut créer des tas d’embarras. La fille Léonie est sous notre surveillance, Monsieur, est-ce que vous le saviez ?
Je ne reculerai pas d’une ligne. J’ai assez des familles bien posées.
— Oui, elle-même me l’a dit, cher Monsieur, mais cela ne me regarde pas.
— J’entends ! Parbleu, s’il fallait s’occuper de ces détails chaque fois qu’on se… promène… Cependant, quand on est cramponné par de pareils chameaux, il vaudrait mieux venir nous en toucher deux mots à la Sûreté. Monsieur Rogès, voulez-vous qu’on l’emballe ? Ça ne vous coûtera rien et ça nous fera plaisir. Pour ce qui est du côté de votre famille, je crois qu’elle en aurait de la satisfaction ! Ce n’est pas drôle pour une mère de savoir son fils dans ces draps-là et n’osant pas se plaindre.
Je n’ose pas lui répondre tout de suite, à cet homme bienveillant, parce que la colère m’étrangle.
J’ai besoin de sang-froid. Si je n’ai rien à craindre de mon côté, elle, ils peuvent me l’emballer, selon leur expression radicale.
Quand je suis en colère, je n’ai qu’un moyen de me calmer, c’est de casser n’importe quoi.
Je saisis un cornet de faïence, sur la cheminée, et je le brise en deux au coin du marbre.
L’autre me contemple, ahuri.
— Diable ! qu’est-ce qui vous prend donc ? j’ai dit une bêtise ?
— Je ne permets à personne de traiter Mlle Léonie de chameau, et si vous voulez que nous causions, il faut changer de langage immédiatement.
— Ah !…
Il recommence à m’examiner.
— Mlle Léonie doit venir demeurer chez moi, (j’appuie) chez moi, Monsieur. Ceci, pour lui éviter des rencontres fâcheuses. J’espère bien qu’on va nous laisser tranquilles.
— Fichtre ! vous aurez de l’agrément.
— Tout l’agrément qu’il me plaira d’avoir, soyez-en persuadé.
— Un collage, alors… Et vous comptez la garder longtemps ?
— Tout le temps qu’il lui plaira de rester !… Tenez, Monsieur, finissons-en. J’aime cette fille. C’est absurde, ridicule et j’en conviens volontiers, mais c’est réel. J’irai jusqu’où mon amour me poussera, n’ayant d’ailleurs rien sur la conscience que la charge de cet amour… oui… très lourde… Je suis seul responsable de mes actes et de ma folie. Ma famille me dégoûte profondément, surtout depuis ce matin. Je désire que ma famille cesse de s’intéresser à mes affaires, sinon…
— Vous brisez tout comme la porcelaine de la cheminée !
— Oui (et je souris). Préméditation dont vous pouvez faire part à vos chefs.
Le bonhomme prend un air tout triste, un air presque intelligent.
— Écoutez-moi, monsieur Rogès, vous allez vous fourvoyer. Je vois bien, maintenant, à quel point vous en êtes. C’est grave. Aimez-la… de loin. De si près, chez vous, c’est plus dangereux que vous ne le pensez. Elle a un amant sous les verroux, un voyou de la pire espèce, capable de vous faire chanter quand on le relâchera, et même… de vous tuer.
— Ou je le tuerai, Monsieur. Je suis de force à me défendre.
— Vous fabriquez de la littérature en ce moment, Monsieur Rogès.
— Du chiqué, n’est-ce pas, comme dit Léonie ? Peut-être, mais j’ai l’intention de vivre mon rêve, et la meilleure preuve, c’est que moi, je vous parle sans changer ma langue, dans le français qui me sert pour écrire, je n’en connais pas d’autre, Monsieur.
L’homme est un peu gêné. Il détourne les yeux. On lui a confié une mission trop délicate. Je ne suis pas un malfaiteur et je protège les filles… en ayant la réputation de ne pas bénéficier de leur travail.
Je lui représente une étrange espèce, il cherche la catégorie…
— Je comprends tous les langages, Monsieur, par métier, seulement je préfère croire que vous n’êtes pas capable…
— De vivre en dehors de la société si elle m’embête ?… Eh bien, vous avez tort, cher Monsieur… Voyons, expliquons-nous, de quoi suis-je menacé ?
Je lui offre un cigare.
Il refuse et feuillette son porte-cartes. Il tire des tas de petits papiers crasseux, huileux, colorés, tachés, et il me lit des choses stupides. J’apprends que j’ai porté des roses blanches à une fille syphilitique, et que la dite fille syphilitique est surveillée par la police pour avoir défendu chaleureusement son souteneur en pleine audience. (Bravo, la reine !) On l’accuse d’un tas de méfaits dont le plus sinistre est d’avoir ouvert sa fenêtre pour respirer à une heure où les filles ne doivent jamais respirer. Elle a dû prévenir pour qu’on lui permette de dépasser les fortifications en ma compagnie. On connaît mes pas et démarches, depuis les roses blanches jusqu’à ma station dans la loge de sa concierge. On mentionne, pour mémoire seulement, que j’ai deux autres maîtresses : la Saint-Clair, (ils sont polis) et une femme mariée : Mme X (ils sont trop polis).
— Concluons, je vous prie, cher Monsieur Mathieu ?
— Donc, Monsieur Rogès, nous devons venir, ou elle se présenter. Coup du dispensaire puisqu’elle est en carte. Analyse de ses correspondances si nous en voyons l’utilité. Interdiction de séjour dans les lieux publics où éclaterait le moindre scandale, et, sur un signe d’un client qu’elle aura simplement pincé au bras, nous la coffrons. Voilà le bilan.
— Vous voulez m’intimider ? C’est vous qui faites de la littérature.
— Monsieur Rogès, vous ne vous amuserez pas tranquille, je vous le promets.
— Qui vous dit que ce soit pour m’amuser que j’introduis Léonie chez moi ?
Silence.
L’agent hoche la tête.
— Et ses clients ? Croyez-vous qu’ils vont la lâcher ? Elle englue le monde, celle-là, parce qu’elle a l’air d’un gosse. Ils monteront chez vous ? Je vous préviens qu’elle est de taille à en abattre douze dans une nuit.
Il me passe un petit papier jaune.
Je lis, sur ce papier, que Cléopâtre a reçu, chez elle, pour des motifs qu’elle avoue en des termes d’une éloquence… épouvantable, sept personnes d’un sexe différent du sien, durant quelques heures de crépuscule.
Je commence à devenir fou.
Plus haut, j’ajoute, souriant :
— La prostitution est une belle chose, n’est-ce pas, cher Monsieur ?
Il accepte un cigare.
— Réfléchissez, Monsieur Rogès, il ne manque pas de grues sous le soleil, si vous aimez les grues… défiez-vous de ce collage, ou vous n’en sortirez pas propre… même avec vos livres et votre nom !
Je me lève brusquement, les poings en l’air.
— Assez ! Assez ! Je suis un homme, entendez-vous, et non pas un enfant. Je veux cette fille, ici, chez moi, et je l’aurai ici, chez moi ! Ce que j’en ferai, ça me regarde. Allez tous au diable ! C’est l’heure, pour moi, de devenir fou. Soit, je deviendrai fou. Je n’y puis rien, ni vous non plus. Est-ce que vous avez le droit d’introduire des sergents de ville dans mes songes, maintenant ? Ce serait grotesque de reculer devant tous vos fantoches et vos sabres de bois ! Il faut de la tranquillité pour concevoir l’amour ! Et vous empêcherez cette femme de m’aimer, peut-être, avec vos discours sur la police, la famille et les mœurs ! Elles sont propres, vos mœurs policières et familiales. Oui, parlons-en ! Je veux qu’elle m’aime. J’ai cette furieuse et humble fantaisie d’être aimé par Cléopâtre, que vous condamnez à vivre déguisée en putain moderne, j’ignore pourquoi. Moi aussi, j’essaye mes poisons sur ce vieux cœur, sans regarder ce trop jeune corps qui vous appartient et dont vous faites un instrument de torture… sur un très vieux cœur libre, datant de plus loin que votre république imbécile où personne n’est libre ! Ma mère, la religion, vous, la loi, je flanquerai tout dehors, et si des clients montent, je tirerai dessus, car ils n’ont pas le droit de monter, puisqu’elle est forcée de les recevoir. Vous comprenez bien ? J’emporterai cette fille en Amérique, si la France n’est plus le pays de l’amour. Ah ! mais, dites donc, elles sont dangereuses vos sociétés… ils ont raison !
L’agent tressaille.
— Monsieur Rogès, calmez-vous. Vous allez faire du socialisme !
Et il s’efforce de rire.
— Du socialisme ? (Je repars comme une locomotive.) Ah ! Non ! Je ne veux rien réorganiser du tout, moi ! Une société socialiste, ce serait encore plus sale, ils prostitueraient même le rêve pour le faire servir à quelque chose, les cochons ! Non ! Non ! Rien réorganiser du tout. La mort seule, et l’extinction de toute la race peut réorganiser. Quand le bon Dieu de la Bible, que vous avez l’air de prendre pour un homme estimable et un législateur adroit, veut nettoyer les mœurs de son peuple, il l’extermine et il fait bien !… Son tort est de laisser échapper quelques petits crétins qui se réaccouplent à la page suivante. Socialiste ? Il n’y a que votre bellâtre de Jésus-Christ qui soit socialiste et cherche à raccommoder un antique bateau avec du bois neuf ! Moi, je ne suis pas pour raccommoder aucun bateau. Je cherche l’amour. On m’embête, alors, je fais sauter ma maison… ou la vôtre.
— Ravachol ne pensait pas autrement, dit une voix sourde.
Il y a donc ici quelqu’un qui m’écoute ?
Je réponds, rêvant tout haut, projeté hors de moi :
— Hein ? Ravachol ? un type admirable, Monsieur. Le seul bandit dont on aurait pu faire un empereur dans des temps moins ternes ! Ravachol ? Mais c’est le deux décembre des pauvres ! C’est un de Morny avec la loyauté en plus et des régiments en moins, hélas ! Ravachol tuant un ermite dont la paillasse est pleine d’or comme celle d’un avare hypocrite, c’est la logique nous débarrassant d’un monomane et d’un malfaiteur, car on ne doit pas spéculer sur la pitié pour en faire des rentes !
— Ça va bien ! Ça va très bien ! reprend la voix sourde au fond de ma conscience. Et vous admettez aussi Ravachol dépouillant le cadavre d’une vieille dame, vous un artiste ?
— Oui, Monsieur, plus admirable encore ! Il s’est moqué utilement d’un préjugé ridicule entre tous : la mondanité de la mort. Il a voulu démontrer qu’il était nécessaire que ça finît là, dans la terre. Leurs vieilles dames ! Ils les enfouissent avec leurs diamants aux oreilles, leurs bagues aux doigts, et ils ne peut plus y avoir d’oreilles ni de doigts ! Après les avoir volées, de leur vivant, de tous les espoirs et de toutes les joies, par dignité sociale, ils les font voleuses à leur tour, des femmes pauvres, qui n’ont seulement jamais vu leurs bijoux, et qui attendent l’heure de la dernière toilette en grelottant aussi de tous les désirs inavoués. Il a eu ce courage d’aller dans une tombe de grande dame pour y déshabiller le mannequin social et il a bien fait, Monsieur… Je l’approuve surtout depuis que je suis revenu de l’enterrement de ma tante ! Je suis excédé par la comédie de l’existence devant la mort, et je me demande, vraiment, de quel droit la société toucherait à nos rêves. Si monstrueux soient-ils, je doute qu’ils soient plus monstrueux que son honneur !
— Boulevard Saint-Germain, lorsque la maison a sauté… vous auriez pu vous-même ?…
— Je ne regrette qu’une chose, c’est de ne pas m’y être trouvé avec toute ma famille !
Silence profond.
Je tourne autour de la chambre et je me heurte au policier qui sort.
— Tiens !… J’ai donc rêvé devant vous, cher Monsieur ? Vous avez dû passer un joyeux moment. Je ne rétracte rien, vous savez, ce n’est pas dans mes habitudes.
— Monsieur Rogès, je n’ai rien entendu, mais, voulez-vous un bon conseil : couchez avec cette fille le plus tôt possible, car je vois qu’elle n’est pas votre maîtresse. Nous allons vous laisser tranquille… juste le temps de vous en dégoûter.
Comment, il a deviné ça ? Il est très fort psychologue, ce bonhomme, je lui rends mon estime.
— C’est vrai. Elle n’est pas à moi. Je crois qu’elle ne peut pas m’aimer.
— Parbleu ! Il y a l’autre, la brute… si vous n’étiez pas tellement vif… je vous donnerais un détail de mensuration… l’autre, c’est beaucoup plus ce qu’il lui faut.
— Taisez-vous ! L’autre, c’est le tigre. Mais moi, je suis le rêve, et le rêve tuera le tigre. Je vaincrai…
— Hein !… vous êtes surtout capable de devenir anarchiste, ce qui serait propre pour un fils de famille ! Profitez de mon expérience, Monsieur le romancier ; vous êtes dans l’état d’amour qu’il faut pour commettre tous les crimes sans raison. Alors… couchez !
Et il s’éclipse.
… Fille de la douleur, anarchie ! anarchie !
— O ma Cléopâtre adorée, ma petite esclave, ma reine et ma sœur, surtout ma sœur, pourquoi m’avez-vous reçu en le palais de votre poitrine ? (Je ne dis pas de votre cœur, car, depuis longtemps, votre poitrine est vide ; il n’y réside plus qu’un distributeur automatique de coups sourds, de coups de couteau plongeant, soit en vous-même, soit en les autres.) Pourquoi m’avez-vous laissé aller jusqu’aux mignonnes portes de vos seins, toucher aux boutons luisants de ces portes, si vous n’aviez pas l’intention d’ouvrir, et si vous ne désiriez permettre que l’effraction ? Il me paraît bien inutile de vous violer, je ne vous apprendrais rien. Le viol est, en somme, le temps qu’un homme donne à une femme pour penser à un autre, et, j’aimerais mieux, ayant le choix, vous voir penser à moi durant qu’un autre vous violerait. Mais, pourquoi, sans me repousser brutalement, vous raidissez-vous toute, dans mes bras, avec une si muette dignité que je m’imagine, quelquefois, tenir bien plus un sceptre qu’une femme ? Si vous me haïssiez, vous ne seriez pas venue chez moi ! Et si vous m’aimiez, vous ne seriez pas tellement triste ! Pourquoi êtes-vous ici, mon Dieu ?… Cléopâtre, l’ancienne, s’est prostituée aux soldats-empereurs pour le plaisir de sentir, sous son pied nu, rouler la perle du monde. (Et aussi pour un plaisir plus direct, moins sous ses pieds !) Voilà que vous vous serez prostituée à moi pour simplement dormir… Je ne vous ai pas offert de fortune, je ne vous ai pas promis de bijou, pas même la perle du monde, et je ne vous aurai pas donné de plaisir. Alors, pourquoi vous livrez-vous entièrement, dans un sommeil sans rêves, ô ma coupe d’argent pâle où j’ai versé tout mon rêve, et que je n’ose pas boire, tellement j’ai peur de n’y plus trouver aucune ivresse !
Elle est là, étendue, comme morte, dans les coussins de faille jaune ; elle ne parle pas, respire à peine ; elle a l’air de dormir en s’enfonçant dans une autre chair, couleur d’orangé. Elle n’a qu’un peignoir de tulle noir, un transparent peignoir de fille ; et elle montre sa poitrine, tout son torse où se soulèvent ses petites côtes, un peu saillantes, glissant doucement sous les allées et venues de sa respiration lente. On dirait, ses petites côtes un peu saillantes, les plis onctueux d’une soie épaisse. On dirait qu’il n’y a rien entre le tulle du peignoir et la faille des coussins !…
— Chérie, tu n’es pas malade ? As-tu faim ? As-tu soif ? Veux-tu lire, puisque tu aimes tant à paresser sur des livres que tu ne lis pas ? Veux-tu des bonbons, des fleurs, des jouets… la lune ?
Ses cheveux noirs semblent ramener sur sa tête, en torsade funèbre, le deuil de sa robe, et le bandeau d’ombre, avançant sur son front, son bandeau royal, est plein de paillettes d’or. Elle a voulu de la poudre d’or…
Ce mauvais goût, parce qu’un soir de carnaval on lui en avait jeté, et qu’elle avait trouvé cela joli.
— Non, laisse-moi, j’ai sommeil.
Elle parle d’un ton bas qui fait mal tant il est résigné.
Elle étouffe, cette fille, pour ne pas pousser des cris injurieux.
Elle est chez moi depuis une semaine, et elle s’ennuie certainement.
A moins que dormir ne soit sa manière d’être heureuse.
Elle dort, elle s’éveille, boit, mange, et se rendort. Esclave, vraiment, car elle ne sort jamais, elle est servie par moi qui suis bien plus esclave qu’elle, puisque j’éprouve une volupté à contempler son sommeil. Tout lui est indifférent. Elle ne rit ni ne pleure, elle bâille un peu. Je suis en face d’un objet d’art, d’une statuette d’ivoire qu’un caprice m’a fait voiler d’une écharpe funéraire, et je me demande si ce n’est pas sur une tombe que je l’ai étendue pour mieux la regarder.
Je n’ai pas voulu qu’elle pût croire au paiement prochain de mon hospitalité et j’ai mis la discrétion d’un verrou à sa porte.
Son appartement, deux chambres, communique avec le mien et il a sa sortie particulière.
Mais elle n’en use pas. C’est une justice à lui rendre.
Elle se repose.
Ou elle attend…
Elle va quelquefois jusqu’à sa fenêtre guetter les passants, si rares, dans ma rue, derrière un store grillagé de rubans comme un moucharabieh.
Vieille habitude.
Elle marche pieds nus, crispant ses ongles sur un tapis où ils entrent comme des griffes nerveuses dans de la mousse, et elle fredonne de temps à autre un air sourd ressemblant au fredon d’une grosse abeille captive.
Elle ne se plaint pas… oui, elle est peut-être heureuse, après tout.
Au-dessus d’elle, j’ai fait voûter les plafonds avec les plis, en forme de tente, de la faille jaune. On dirait que le soleil égyptien meurt, sur nos murailles, en longs rayons s’évanouissant.
La chaleur est suffocante, dans cette étroite prison, car nous sommes en juillet et nous avons des raisons pour ne pas ouvrir nos fenêtres.
Profitant de la chaleur, la petite esclave d’orient erre nue sous sa robe de tulle, sans vouloir admettre l’usage de la chemise ; pas plus, du reste, qu’elle ne veut admettre le pain comme normal compagnon de la viande.
Elle mange toujours des biftecks absolument crus, et elle mêle du cognac à du Porto pour étendre la saveur d’un muscat imaginaire.
Elle erre nue, elle a raison, elle est bien faite, à la fois si frêle et si forte qu’elle évoque un peu la silhouette d’un garçon de quinze ans, une bizarre idole androgyne, jadis coupable d’avoir suscité des cultes pervers et, aujourd’hui, châtrée, épilée, maudite, enchantée… et enchantant ses adorateurs. Une forme de fantôme, un corps de reine momifié dont les alchimistes de notre époque ont, du bout de leurs pinces profanes, métallisé le sexe.
Pauvre petite esclave d’orient… qui regrette, sans doute, les vigoureux matelots nègres des bords du Nil !
Je ne suis nullement ému par le ridicule de ma… de notre situation. Je vais même avouer que je me trouve, de mon côté, très heureux, abominablement heureux. Don Juan agonise en la douleur de ne pas être aimé. Pour la première fois, il entrevoit l’impossible, et cela le rend fier d’une douleur jusqu’alors non ressentie, mais plus féconde en voluptés qu’aucune satisfaction d’amour-propre. Je dois arriver au point de paroxysme si vanté par Jules Hector. Je n’ai plus qu’à fermer les yeux et à frotter légèrement mes paupières pour obtenir tous les spasmes. Toucher le fond du désir par l’excessive possession est un tort ; il faut y aller par la seule puissance d’un refus perpétuel. Or la volonté physique est peu de chose vis-à-vis d’une fille qui, selon l’expression du policier, abattrait ses douze types en une seule nuit.
Que ce soit le tigre ou moi qu’elle aime, nous ne l’aurons jamais entièrement.
Il faut avoir le courage d’attendre.
Surtout quand ce courage est l’égoïsme du plaisir.
Elle est féroce.
Je serai plus féroce encore, et si elle s’en va, lasse d’espérer mieux, je garderai d’elle, la prostituée immonde, le souvenir exquis des roses blanches de sa peau.
Je vais souvent voir mes jeunes amies, Mme Saint-Clair, Mme Noisey, et, par un nouvel équilibre des lois sociales, c’est la bourgeoise artiste et la bourgeoise mariée qui font le métier des filles, tandis que la fille est en train d’oublier, ô sommeil sans rêve, qu’elle n’est plus tout à fait une vierge.
Ces dames sont tristes. Aujourd’hui, elles ont pleuré sur moi, qui me suis laissé aller à la dérive de leurs larmes, parce que j’ai des secrets pour elles et que cela se voit bien.
Elles sont touchantes et folles, surtout très voraces ; elles finiront par me rendre plus chaste que Mlle Léonie.
Mon Dieu, qu’on s’amuse bêtement dans la vie dès qu’on cesse de faire de la littérature !
Et mes amis, mes camarades, sont maussades parce que j’ai muré ma porte.
Andrel prétend que j’élève un singe.
Massouard grogne, regrettant la chartreuse verte.
Et Jules Hector se réserve en des opinions prudentes.
Cependant, je voudrais bien montrer mon objet d’art à ce dernier. Je n’ai pas peur de Jules Hector qui pense aux Javanaises.
En tous les cas, la police nous oublie, et je ne reçois pas la visite des clients.
Nous pouvons dormir tranquilles.
Nous dormons…
— Reine, qu’est-ce que tu as, ce soir ? tu es malade ?
— Mais non, j’ai sommeil.
— Toujours ?
Elle s’est levée, sur son coude, et me regarde fixement.
Sa bouche est rouge, luisante comme tous les piments ; elle a pris, sous le fard, le teint cuivré des véritables orientales qu’on dirait frottées d’or ou de safran. Ses yeux longs tiennent toute la largeur de sa face, comme des sangsues gonflées d’un poison noir, et son profil est si pur, cependant, si arrêté en relief de médaille, que je ne peux pas m’empêcher de l’admirer. Je suis ensorcelé par ce profil de vieille reine méchante… car elle a tantôt l’aspect d’une vieille reine, et tantôt la jeunesse, bien spéciale, d’une toute jeune fille sortie des marchés du Caire, déjà souillée furieusement par ses vendeurs.
— Oui, tu as l’air d’une médaille, ai-je pensé tout haut.
Elle a paru réfléchir répétant, en écho :
— L’air d’une médaille… toi aussi.
En passant son index, lentement, sur mon profil à moi.
C’est la première fois qu’elle me dit quelque chose.
Est-ce qu’elle se réveillerait, enfin ?
Je me mets à genoux et je la garde bien serrée contre moi pour que ses idées ne s’échappent plus.
Elle jette ses mots comme des cailloux inutiles dans une eau profonde, et cela me navre.
— Explique-toi, chérie ; où as-tu vu des médailles ?
— Donne de la chartreuse.
Elle boit la chartreuse verte de mes amis du vendredi, et elle en boit trois fois plus qu’eux trois réunis, mais elle cause moins.
Elle a trouvé un gobelet de vermeil sur une de mes étagères, et s’en sert pour que je ne juge pas des proportions.
Quand elle a fini, j’essuie ses lèvres, si elle daigne les tendre aux miennes, sauvage liqueur qui fermente en mon cerveau et me fait tituber dans les rues de Paris au sortir de mon orient mystérieux.
Je tomberai, un jour, consumé par ma passion pour cet étrange alcool, et personne ne saura pourquoi.
Morphine, éther, haschich ou opium, je verse tout sur la coupe de corail de ses lèvres mortes, et cela fait beaucoup de poisons en un seul.
Elle retombe dans les coussins et elle joue avec son pied. Elle est si souple qu’on peut la tenir toute ployée entre ses bras comme un morceau de satin, et elle prend, tout-à-coup, la rigidité et la froideur d’un morceau d’ivoire. Elle devient un objet chinois curieusement poli, comme un objet chinois qui sent le vétiver, la poussière, le musc, le santal, les roses blanches, les roses mortes, et elle ne se parfume point.
Elle sent aussi… la sève humaine que tous les hommes lui ont donnée pour s’en vernir affreusement, et elle en est plus brillante, plus objet d’art, plus morte.
— Oui, la médaille… (Elle s’étire, la bouche et le geste énervés.) Tu sais que je suis d’Auvergne ? C’est là que j’étais chez des parents nourriciers, dans la montagne, oui, une grande plaine sur une montagne.
— Voyons, Reine, tu dis des bêtises. Une plaine sur une montagne ? Elle est saoule, la petite Cléopâtre. Tu ferais mieux de m’embrasser.
Elle bâille.
— Ce que tu es collant, tout de même !
— Ah !… Explique la médaille ou embrasse-moi. Je te promets une parure de sequins très faux, en cuivre d’orient, si tu m’expliques.
Ses yeux s’allument.
— Tu as de la veine ! J’ai justement envie de ça depuis que j’ai vu le collier de la belle Féridjé de la foire aux pains d’épices…
Je pouffe.
— J’en étais sûr ! Quand il s’agit de poudre d’or ou de sequins faux, elle marche, la petite peau-rouge. On t’aura toujours pour des verroteries ou… un coup de couteau. Mais on ne reçoit guère que du toc, en échange. Embrasse-moi d’abord.
— Je ne sais pas embrasser… ça m’ennuie. Si tu savais ce que ça me rase.
— Oui, je connais l’histoire… tu es vierge.
Elle m’embrasse comme un oiseau méchant flanquerait son bec dans une écorce d’arbre.
Elle oublie le métier, complètement.
— Mieux que ça, dis ?
C’est l’enfouissement de tout mon être, cette fille, dans un marécage où des monstres me regardent expirer avec des yeux troubles.
— … Une plaine qui serait sur une montagne. Non. Je ne me trompe pas, mon petit homme, et je ne suis pas saoule, parce que je ne me saoule jamais. Une plaine qu’on appelait le plat… le plat… le plateau de Gergovie.
J’ignore ce qu’elle veut dire et j’ai un singulier frisson.
— Le plateau de Gergovie ? Tu as raison, c’est bien en Auvergne, ce pays-là, et si tu savais ton histoire de France…
— Voilà, je me rappelle pas très bien. J’étais gosse, tu comprends ? Je vois une chambre où des oignons séchaient au plafond. Je me cachais pour en voler, quand j’avais faim de ça… j’aime beaucoup les oignons crus. Dans cette chambre, il y avait une armoire à linge, et dans l’armoire, un tiroir plein de médailles, des espèces de sous tout rouillés. On ne voyait rien dessus… (Elle s’anime.) Mais il y avait une médaille très grosse, aussi grosse qu’un oignon coupé, une belle en argent, pas rouillée parce qu’on l’avait nettoyée avec du sable. Il faut te dire qu’on trouve de ces affaires-là en labourant dans mon pays. Oui, mon vieux, je t’assure…
— Et cette médaille en argent ?…
Je parle tout bas pour ne pas faire s’envoler son souvenir.
— Sur cette grande médaille en argent, il y avait une tête d’empereur. Pas Napoléon, l’autre, et c’est à l’autre que tu ressembles. Tiens, en touchant, j’ai tout-à-fait l’idée de la médaille…
— Le profil de César ! Vous me flattez, ma reine.
Seulement, au lieu de rire, j’ai peur.
Je suis tellement pris aux moelles par cette femme, que j’en deviens superstitieux. Je regarde, effaré, derrière moi, et je finis par croire qu’il plane des choses surnaturelles.
En réalité, elle est très grise, je pense.
Jamais elle ne m’aura parlé si longtemps sans émailler son discours d’une ou de plusieurs obscénités.
Je suis heureux.
— Dis donc, ce ne serait pas déjà trop mal de marcher sérieusement pour César.
Elle rêve.
— César… c’est un nom de chien.
Elle se rendort, boudeuse.
Je la regarde dormir et je n’ose remuer mon bras.
Toi, ce que tu te moques de mon empire !
Il faudrait…
Non, il faudrait le tigre, n’insistons pas.
Je suis le jouet de la reine, un bouffon d’une espèce bien rare ; celui qui n’exploite pas sa situation de bouffon.
Quand elle se réveillera, elle me demandera de lui raconter des histoires, à mon tour ; elle aime à m’entendre causer comme le serpent aime la musique. Elle n’y comprend rien ; seulement, cela l’étonne et la charme, la prédispose à de meilleurs sommeils.
Et nous ne pouvons pas sortir ensemble.
Nous ne pouvons pas aller à la campagne, comme tout le monde.
Nous ne pouvons pas ouvrir nos fenêtres pour jouir des vrais couchers de soleil.
La nature nous est interdite.
Nous demeurons enchaînés l’un à l’autre, comme deux bêtes.
— Je t’adore…
Sa tête est penchée, ses yeux sont clos, sa bouche respire à peine. Elle est très calme… c’est une heure unique dans sa vie… et là, au coin de sa bouche dure, impassible, si méprisante, il y a un petit frisson — oh ! presque rien — de l’eau qui se riderait sous le remous d’un très petit poisson rouge, sa langue, qu’elle laisse tout au bord de ses lèvres.
Ainsi les chattes s’assoupissant après avoir bu.
Elle boira tout le sang de mon cœur.
Elle dort vraiment. Elle est si lasse de mes tortures.
Que faut-il faire ? Cette fille ne me dira plus ce qu’elle rêve. Elle est retournée ailleurs. Je ne sais plus où elle est !
Aujourd’hui, Jules Hector est venu pour la voir. Il est entré dans mon bureau et m’a dit, causant bas comme dans une chambre de malade :
— Rogès, vous allez me faire le plaisir de prendre l’air. Vous êtes pâle, et vous avez la fièvre. C’est idiot.
— Non. Je crains qu’elle ne s’en aille durant mon absence. Je n’ose plus la quitter. Elle s’en ira ou… me ramènera des hommes.
Jules Hector sourit, imperceptiblement.
— Vous ne pouvez pas vous rendre compte…
— Si, je me rends très bien compte ; vous aimez. Enfin, voyons toujours l’idole. Elle en est peut-être digne. Je vous le souhaite.
Je suis allé chercher Reine. Elle lisait, les yeux fermés, en bâillant.
— Un de tes amis, le type ?
— Oui, un Monsieur grave. Sois gentille.
— Est-ce qu’il faut que je marche avec lui ?
Elle trouverait cela tout simple, je crois. Un de plus, un de moins…
Je l’ai ramenée dans sa robe transparente de déesse de l’illusion, ma petite idole en deuil, je l’ai priée seulement de ne point parler.
Elle avait, au cou, un collier d’ambre comme en ont les enfants en nourrice, et ses cheveux se dressaient sur sa tête, tordus selon l’actuelle mode ignoble des femmes des boulevards extérieurs, en un monstrueux phallus d’ébène. Elle ne veut pas abandonner cette coiffure, pas plus que le fameux peignoir transparent, et le bandeau royal subsiste, sous le phallus, comme une nuée ténébreuse d’orage d’où il sortirait plus sinistre.
Elle s’est présentée à Jules Hector, la taille droite, les seins dressés, crevant le tulle et ses yeux dardés de fureur. Elle a conscience d’une injure, mais ne sait pas bien quelle injure.
Hector l’a regardée, très respectueusement.
Puis il s’est tourné vers moi et d’une voix nette, cassante :
— Il faut épouser Madame.
Est-ce une ironie ou une pensée jaillie spontanément de son admiration ?
Elle n’a pas ri et n’a même pas daigné hausser les épaules, selon sa coutume.
— Tu peux t’en aller, chérie. Va dormir.
Elle est partie tout de suite, traînant ses voiles funèbres sans un mot.
— Mon pauvre Rogès, m’a dit Jules Hector, vous êtes fichu car… vous ne l’épouserez pas… cette fille n’est pas à vous, ne sera jamais entièrement à vous.
— Je sais. Je l’aime… trop.
— Vous êtes devant un mur. Espérons qu’il se passera quelque chose derrière ce mur.
Mes amies sont venues aussi la voir toutes les deux. Mais je ne les en avais pas priées.
Elles sont venues, puis sont reparties, scandalisées énormément.
Une idée folle en les voyant :
— Vous me dites que je ne vous aime plus. Si… je vous aime encore dans une troisième qu’il vous faut aimer autant que moi.
La Saint-Clair s’est formalisée la première :
— Nous ne pouvons consentir à cela, mon cher Louis, parce que nous ne sommes pas aussi dépravées que vous. Julia est mon amie, c’est vrai, mais je tolère ses exagérations sentimentales pour lui éviter de fâcheuses liaisons. Une troisième, dans notre alliance, ce serait du vice.
Et la seconde s’est écriée, blanche de colère :
— Le bruit court que tu élèves un singe ! Est-ce que tu nous prends pour des guenons, par hasard ?
Je leur ai montré mon singe.
Je n’ai pas fait venir Cléopâtre. Je les ai toutes deux introduites dans l’antre sacré.
Reine s’est éveillée, a mis la main sur ses yeux pour mieux regarder les jeunes femmes, subitement tremblantes.
— Ce sont mes amies, Reine, d’une façon ou d’une autre, je te les offre. Je suis certain qu’elles seront heureuses de t’apprendre l’amour.
Cléopâtre ne s’est point émue :
— Moi, j’aime pas les femmes, tu es maboul ! (Et en se tournant du côté du mur pour leur exhiber ce qu’elle a certainement de plus admirable, deux globes d’ivoire un peu plus gros et plus rond que les deux sphères de ses seins, elle a murmuré :) Oh ! là ! là ! Ces dindes !
Je n’ai pu retenir ces dames qui se sont sauvées en poussant des cris assez semblables aux gloussements des volatiles évoqués par la reine d’Égypte.
Je ne chercherai point à les retenir. Elles me vitrioleraient, car elles en ont vu suffisamment pour établir des comparaisons humiliantes.
Il est minuit. Je ne dors pas. Je suis dans mon lit comme le prisonnier qui attend un arrêt.
Elle est fâchée.
Elle n’a pas voulu de mes baisers, ce soir, avant de tirer son verrou. Elle a dû souffrir, peut-être cruellement.
Comme c’est une sorte de créature végétant au lieu de vivre, un animal qui serait une fleur (oh ! une fleur très vénéneuse), elle ne peut pas se plaindre, elle ne sait pas se plaindre.
Elle est la mystérieuse idole portant, brodé sur ses voiles, l’emblème de l’Éros captif, le phallus enchaîné à la terre Isis. Elle est l’abominable charmeuse qui ne peut se soustraire elle-même au charme maudit, et il faut qu’on la désenchante.
Puis-je la désenchanter ?
Pauvre Don Juan sans force, presque sans croyance. Je n’ai plus ma belle confiance de jadis. Je ne suis plus César, et j’ai perdu la bataille.
J’ai voulu trop aimer, je me suis grisé de mon amour, et mes pas sont incertains. Je touche à une précoce vieillesse. J’ai souffert, j’ai heurté la mort. Il n’y a rien de plus anéantissant que cette pensée qu’on ne plaît pas, et je me découvre tous les défauts physiques, je crois que je suis laid, vieux ou usé, maussade, railleur. Elle déteste mes plaisanteries.
Comment est le tigre, lui ?
Il est, simplement.
Moi, je ne suis pas.
J’ai cessé d’être le jour où, devant cette fille, la réalité, j’ai choisi le rêve.
J’ai désiré cette épreuve, je suis récompensé de ma patience, puisque je me dégage peu à peu du lien charnel ; mais je suis puni parce qu’elle s’éloigne de plus en plus de ma chair.
Ah ! si j’avais su !… Comme j’aurais joyeusement partagé la misère et les hontes de son sexe.
Je n’ai pas eu le courage d’aimer, d’abord.
On ne peut plus aimer après.
Une heure existe, durant quelle heure il ne faut pas contrarier les destins.
… J’entends du bruit, un petit bruit de robe frôlante. Mon Dieu, c’est elle ! Et je me dresse du fond de mon lit, pauvre Lazare qui ressuscite ; j’écoute.
Non, plus rien.
Pourtant si… on écarte une draperie et voilà une lumière qui pâlit le plancher, sa lampe.
— Reine !
J’ouvre les bras. Elle entre de son pas souple, muet, elle a mis le costume de notre belle journée de campagne. Elle a dépouillé sa livrée d’esclave orientale, sa robe transparente lui permettant les poses cyniques et les phrases qui font frémir. Elle est en jeune femme d’occident, toute simple, toute enfantine, ses yeux sont plus doux et ses lèvres moins rouges.
Elle va me dire :
— En effet. Pourquoi n’épouserais-tu pas ta sœur, la reine, toi mon frère, le roi ? Il faut sauver la maudite en la gardant éternellement sur ton cœur.
Ce serait fou. Cependant, l’honneur est une beauté généralement déchue… comme elle.
— Reine ! Reine ! Il y a quelque chose ?
Elle s’assied sur le bord de mon lit, en tenant haut sa lampe.
— Il n’y a rien. Je m’en vais.
Et le pauvre Lazare ressuscité par sa présence bénie, se sent mourir encore de sa présence maudite.
C’est le coup de couteau final.
— Pourquoi t’en vas-tu ? Que t’ai-je fait, Reine ? Tu m’en veux de l’ami et des femmes ? J’ai eu tort de te montrer aux gens, mais tu es si belle. Ma petite Reine, tu ne vas pas t’en aller, ce serait un crime.
— Non, je ne t’en veux pas pour le type et pour les femmes. Tu es… maboul. Pas ta faute. (Elle caresse doucement ma poitrine, et je ne l’ai jamais sentie si douce. Mon Dieu, comme elle me fait mal !) Je suis obligée de partir. Voyons, du courage, mon petit homme. L’autre est sorti de prison. Tu comprends bien ?
Je retombe, le front caché dans mon oreiller.
Oui, je comprends bien. J’avais déjà très bien compris plusieurs fois. Je ne voulais pas le croire. J’espérais toujours… le vaincre.
— Oh ! Reine, est-ce que tu reviendras ? Au moins, ne m’abandonne pas complètement.
Elle me regarde, ses yeux sont fixes, de nouveau, très durs. On dirait qu’elle ne me voit plus du tout.
— Pauvre petit homme, ça me fait tant de peine… tant de peine.
On ne sait pas si elle parle de lui ou de moi.
— As-tu besoin d’argent, dis ?
— J’en ai bien de trop… et il y a le turbin.
— Reine… tais-toi… Je te supplie de te taire.
Je pleure.
Je n’ose plus ni la retenir, ni la chasser, ni la toucher.
Je n’ai pas de volonté devant elle.
Elle me caresse toujours la poitrine, puis se recule ; je sens ses yeux fixes brûler mon pauvre cœur, mis à nu.
Elle s’en va !
Je relève la tête, horrifié.
Sur le seuil, elle s’arrête, s’appuie contre la porte ; j’entends comme un petit bruit d’aile, sa jupe qui frôle… Elle est partie.
Je ne dois pas la retenir, elle reviendra. Elle reviendra parce qu’elle a hésité, là, sur le seuil de ma chambre. Je l’ai bien vu, dans cette ombre… ses yeux n’étaient plus si durs… à moins que le reflet de sa lampe… oui… peut-être, seulement, le reflet…
Elle n’est pas revenue.
Et je suis resté seul, essayant de faire un peu d’art pour me guérir d’elle, un peu d’art avec toute ma douleur.
O nuits d’orient !… nuits d’orient !…
I. |
— FAITES AVANCER LE CHAMEAU DE LA REINE ! | |
II. |
— LE GESTE DE BEAUTÉ | |
III. |
— LES ROSES ROSES, LES ROSES ROUGES, LES ROSES D’IVOIRE | |
IV. |
— LE PETIT SINGE DE VÉNUS CHEZ LES AUGURES | |
V. |
— NOUS AVONS SUR LES YEUX COMME UN VOILE DE CENDRES | |
VI. |
— A LA COUR DE CLÉOPÂTRE, IL ÉTAIT UN TIGRE ROYAL… | |
VII. |
— DANS LA CHAMBRE DE MADEMOISELLE LÉONIE SE TROUVE LA PHOTOGRAPHIE D’UN SOLDAT | |
VIII. |
— OÙ ÉROS MET DEUX PERDRIX DANS LE MÊME CARNIER | |
IX. |
— « SOIS BELLE ET SOIS TRISTE »… MAIS NE FRAPPE PAS SI FORT | |
X. |
— MADAME ET MÈRE | |
XI. |
— SOUS LE NEZ DE DIEU | |
XII. |
— FILLE DE LA DOULEUR, ANARCHIE, ANARCHIE ! | |
XIII. |
— NUITS D’ORIENT |
Poitiers. — Imp. Blais et Roy, 7, rue Victor-Hugo, 7.