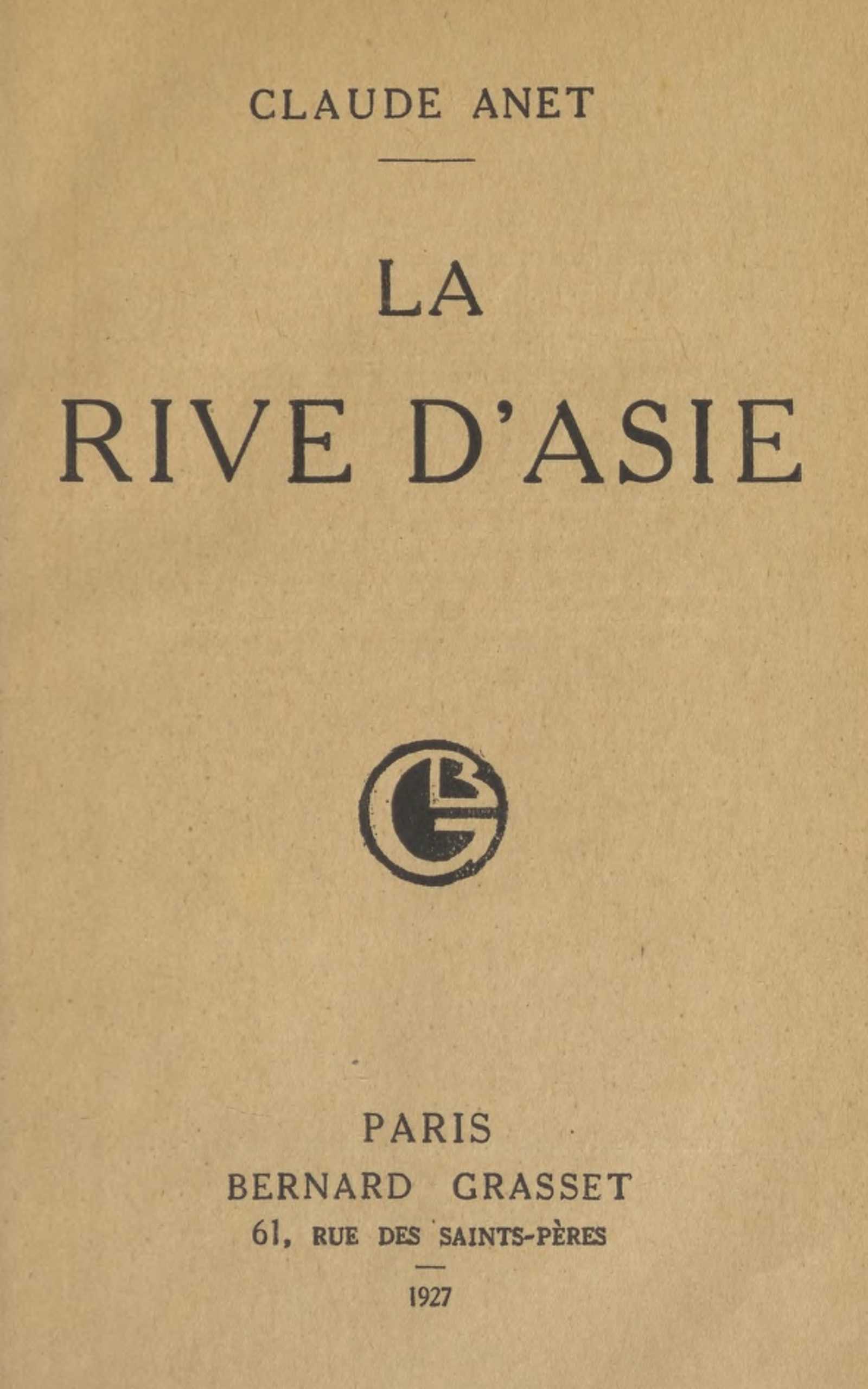
Title: La rive d'Asie
Author: Claude Anet
Release date: November 24, 2025 [eBook #77330]
Language: French
Original publication: Paris: Bernard Grasset, 1927
Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Polona digital library)
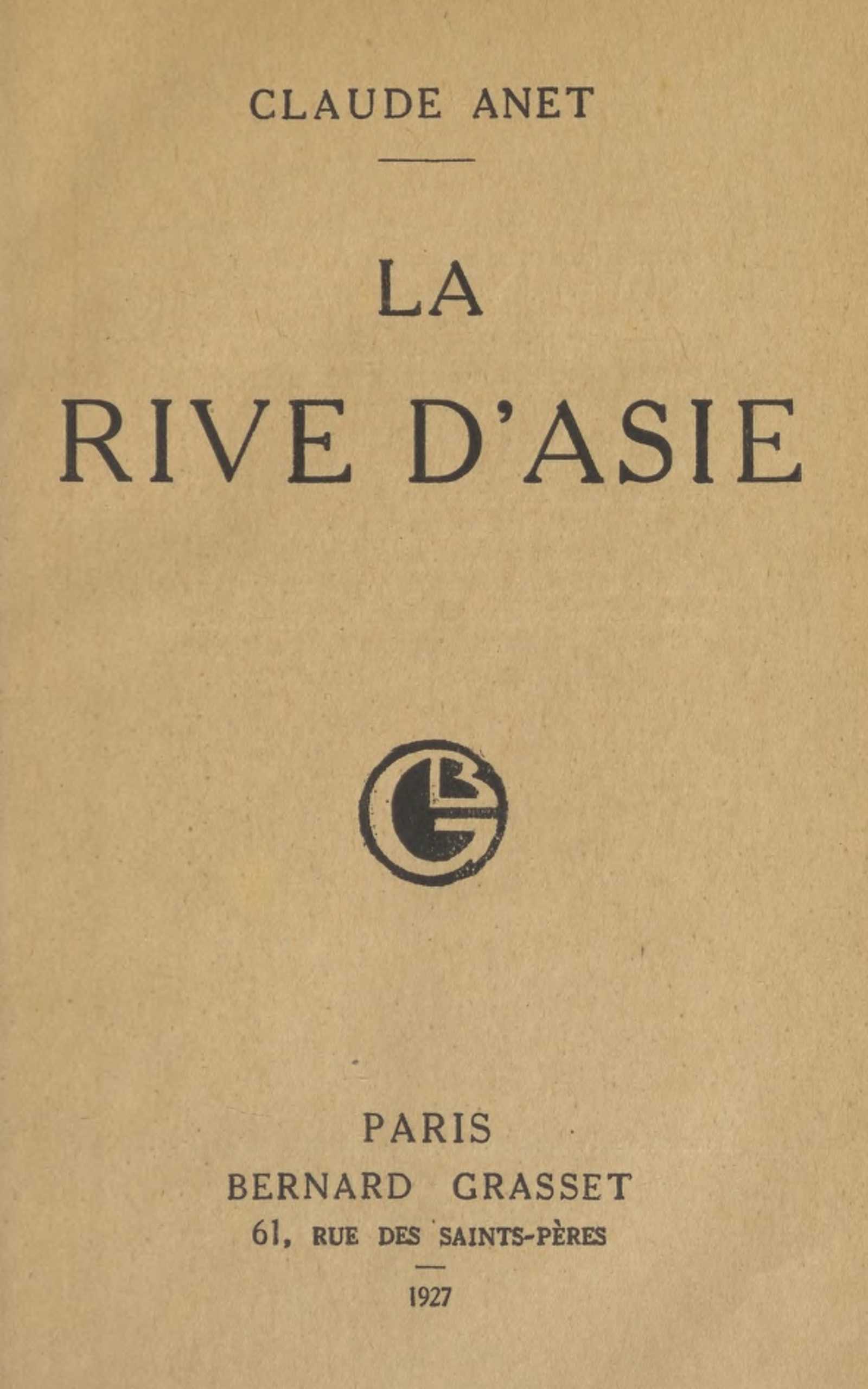
CLAUDE ANET
PARIS
BERNARD GRASSET
61, RUE DES SAINTS-PÈRES
1927
DU MÊME AUTEUR
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CET OUVRAGE : DIX-NEUF EXEMPLAIRES SUR MONTVAL (CANSON ET MONTGOLFIER), NUMÉROTÉS MONTVAL 1 A 15 ET I A IV ; DIX-NEUF EXEMPLAIRES SUR ANNAM DE RIVES, NUMÉROTÉS ANNAM 1 A 15 ET I A IV ; VINGT-SIX EXEMPLAIRES SUR VÉLIN D’ARCHES, NUMÉROTÉS ARCHES 1 A 20 ET I A VI ; SEIZE EXEMPLAIRES SUR OR TURNER, NUMÉROTÉS OR TURNER 1 A 12 ET I A IV ; CENT DIX EXEMPLAIRES SUR VÉLIN PUR FIL LAFUMA, NUMÉROTÉS VÉLIN PUR FIL 1 A 100 ET I A X ; SEPT EXEMPLAIRES SUR RONSARD GRIS LOUIS MULLER, NUMÉROTÉS RONSARD 1 A 5 ET I ET II.
TOUS LES EXEMPLAIRES CI-DESSUS
SONT RÉIMPOSÉS IN-4o TELLIÈRE
ET ENFIN NEUF CENT DIX EXEMPLAIRES SUR ALFA SATINÉ FRANÇAIS, FORMAT IN-SEIZE DOUBLE COURONNE, CONSTITUANT PROPREMENT ET AUTHENTIQUEMENT LA PREMIÈRE ÉDITION, NUMÉROTÉS ALFA 1 A 880 ET I A XXX.
Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
Copyright by Claude Anet, 1927
… J’ai été un adolescent précoce et timide. A l’heure où je goûtais les Géorgiques et où Virgile, avant Lucrèce, donnait une forme antique aux émotions confuses qu’éveillait en moi le spectacle de la nature, je sentis les premières fièvres d’un sang tumultueux. Je ne courais pas après une jeune paysanne, mais je poursuivais Galatée sous les saules. Elle fuyait et me laissait déçu. Plus heureux lorsque je rêvais, je serrais une nymphe dans mes bras et mêlais mes membres maladroits aux siens. J’étais élevé à la campagne, sans camarades. Le moindre lycéen aurait pris en pitié mon inexpérience. Sain et fort jusqu’à l’excès, je courais, je nageais, je montais à cheval ; je me fatiguais sans parvenir à calmer l’ardeur qui me dévorait.
Ma mère vivait fort à l’écart dans sa propriété. Elle voyait le plus souvent des amies de son âge qui ne faisaient guère attention à moi, ni moi à elles. Parfois arrivait de Paris une femme jeune, élégante, parée. Que de désirs elle éveillait en ce grand garçon qui restait immobile et muet, assis dans un coin ! Elle causait avec ma mère, et cependant, à distance, je prenais possession d’elle. Alors je la déshabillais sans crainte, je l’étendais nue sur un divan, nos vies se confondaient.
Mais quand, à son départ, je l’accompagnais jusqu’à sa voiture, je ne savais que dire. La robe dont elle était vêtue l’isolait comme une armure magique que l’on ne peut toucher sans tomber foudroyé. Comment imaginer que je pourrais la lui enlever ? Comment croire que cette dame convenable et mondaine, amie de ma mère, je la verrais en chemise et en pantalon, que j’entourerais sa taille de mon bras, que ma main inexperte s’approcherait d’un sein délicatement fleuri ? Elle m’adressait la parole. Gêné même dans mes regards, je me détournais n’osant répondre. J’avais quatorze ans…
Je me souviens avec terreur de cette époque où la sève montait en moi si violemment que j’en étais ébranlé. Je luttais, j’essayais de me dominer sans y réussir et ce combat contre nature me laissait irritable, abattu, dégoûté de tout.
Ma mère, si attentive aux moindres variations de ma santé, ne se doutait pas de la crise que je traversais. Elle se faisait mille soucis ; un coup de froid, une courbature, au plus léger malaise, elle demandait le médecin. Qu’était une migraine ou un rhume comparé à la tempête qui me secouait ?
Il aurait fallu qu’une femme me prît par la main. Aucune ne s’occupa de ce garçon poussé trop tôt, gauche d’allure, à la voix changeante.
Avec les jeunes filles, je ne ressentais pas le même trouble. Auprès d’elles, j’étais libre, empressé, ardent à plaire. La sensualité si pesante à mes heures de solitude ne m’accablait plus lorsque j’étais en leur compagnie. Pourtant nous échangions des caresses charmantes ; c’étaient des serrements de mains, un bras passé sous un autre, parfois des baisers dérobés, mais surtout mille paroles tendres, une sympathie entière, un mouvement vif de cœur à cœur. Je garde un souvenir délicieux de ces heures innocentes, fraîcheur d’un bain pur qui calme de lourdes fièvres.
Les jeunes filles, je les voyais surtout dans la belle saison, car nous habitions un pays assez âpre en hiver, mais où l’été amenait des visiteurs. Les maisons du voisinage s’ouvraient, c’était soudain un bruit bien inattendu de fête.
Ma mère, malgré son goût pour l’isolement, avait conservé ses relations, moins pour elle que pour moi.
Je préparais la première partie de mon baccalauréat quand nous apprîmes que la propriété la plus voisine de la nôtre, inhabitée depuis longtemps, avait été achetée par des étrangers. Les étrangers, c’étaient pour nous des gens d’une autre province. Ceux-ci venaient du Midi et s’appelaient Maure. Je leur rêvai tout aussitôt une ascendance sarrasine. Grand émoi dans le pays, car on gardait chez nous une méfiance un peu paysanne envers les inconnus. Qu’étaient ces Maure ? Les verrait-on ? On sut bientôt que M. Maure était avocat et qu’il ne passerait jamais beaucoup de temps aux Ormeaux qu’il avait acquis. L’été venu, il y installa sa femme et ses enfants, et repartit.
Peu de temps après, Mme Maure fit une visite à ma mère. Nous étions à causer devant la maison sous les lauriers-roses et les orangers, lorsque Mme Maure et sa fille aînée parurent.
Mme Maure était une femme d’une quarantaine d’années, assez forte, assez commune, mais bonne et simple. Telle je la jugeais au premier jour, telle elle fut lorsque je la connus davantage. Comme on voit, elle ne trompait pas son monde et se livrait tout de suite.
Derrière elle, sa fille… Par quel miracle apercevons-nous au premier coup d’œil jeté sur un être dont la vie va se mêler, ne serait-ce qu’un instant, à la nôtre, tout ce à quoi nous donnons du prix ?
Au moment même où Mlle Maure descendit la première des marches qui mènent du salon à la terrasse, je savais déjà qu’elle était dans sa taille moyenne parfaitement proportionnée, que les membres s’attachaient souples au corps, que les pieds étaient étroits, les mains allongées, les poignets fins, la tête petite, les dents éblouissantes, et les yeux noirs riants et les plus doux du monde.
Henriette Maure avait seize ans, — mon âge, — jeune fille déjà, alors que je restais encore un adolescent mal dégrossi. Elle était aimable et bonne, pareille en cela à sa mère ; en elle, rien que de naturel et de simple, même sa coquetterie qui paraissait involontaire et qui l’était, sans doute. Il semblerait qu’à vivre dans l’intimité de cette charmante fille, — car nous fûmes intimes dès le premier jour, — j’aurais dû m’éprendre d’elle et que des sentiments si forts et longtemps sans objet allaient enfin trouver à qui s’offrir. Mais non, Henriette n’était pour moi qu’une amie, la plus tendre des amies, et dans mes rêves, ce n’est pas elle qui apparaissait.
La propriété des Maure jouxtait la nôtre ; d’une maison à l’autre, à peine dix minutes. Le sentier qui y conduisait longeait d’abord un champ, puis traversait un petit bois de chênes où coulait le ruisseau qui séparait nos terres. Je franchissais le pont, j’étais chez nos voisins. La maison était ancienne et sans prétention. Aux heures chaudes, Mme Maure se réfugiait sous les tilleuls de la cour. Elle me gardait un instant, s’informant de la santé de ma mère, des gens du pays. Puis elle me disait :
— Je vous ai assez retenu, Philippe, allez vers la jeunesse. Elle est là-bas.
Là-bas, c’était un bosquet où les bouleaux au tronc blanc mariaient la grâce flexible de leurs branches aux masses lourdes des sapins. J’y retrouvais Henriette, avec quelques cousines ou amies qui passaient l’été chez les Maure. Et des jeunes gens étaient là. De quoi parlions-nous ? de ce qui occupe les pensées des adolescents. Nos propos étaient parfois d’une singulière hardiesse, mais comme pour la pure Iphigénie « l’innocence habitait dans nos cœurs ». C’était une cour d’amour platonique et sans expérience. Des couples se formaient. Un de nos voisins, un garçon de dix-neuf ans, au visage pâle, boutonneux et âpre, qui préparait à Paris l’école polytechnique était épris d’Henriette qui se moquait de lui.
Je ne la quittais guère. Elle m’avait élu son ami. Et de l’ami, elle faisait un confident, me contraignant à un rôle que, certes, je n’aurais pas choisi. Mais, par une singulière contradiction, je paraissais me plaire dans le caractère qu’elle me prêtait. J’affectais d’être supérieur aux faiblesses du cœur ; je feignais de croire que l’amitié est au-dessus de l’amour, d’essence plus rare, et qu’entre deux êtres tels que nous, seule elle peut porter d’abondantes moissons. Ainsi je me trompais moi-même.
Cependant une admiration si vive avait quelque peine à se concilier avec l’amitié, et si j’avais été plus clairvoyant j’aurais compris que c’était de bien autre chose qu’il s’agissait. Je lui faisais mille compliments de tout ce que j’aimais en elle, je lui prenais les mains… Et je n’avais pas envie de la serrer contre moi et de poser mes lèvres sur sa bouche souriante !
Bien mieux, de son consentement, avec son appui et sa complicité, je courtisais une de ses cousines, ravissante fille aux cheveux d’or, au teint plus délicat que la fleur du pêcher. Gertrude était timide et rêveuse, Henriette prompte et hardie. Lorsque nous étions tous trois ensemble, Henriette parlait pour sa cousine et ne cessait de la taquiner à mon sujet, la menaçant de me dire ce que Gertrude n’osait m’avouer elle-même. Gertrude rougissait et levait sur Henriette des beaux yeux suppliants.
Une fois, à la fin du jour, nous étions assis sur la mousse au pied d’un sapin, Henriette m’assura que les cheveux dénoués de sa cousine étaient admirables.
— Que ne la voyez-vous, disait-elle, lorsqu’elle s’agenouille pour sa prière, le soir, en chemise de nuit !
— Mais, Henriette…, soupirait Gertrude.
— Ses cheveux tombent alors jusque sur ses jambes. Elle est baignée de lumière. Il faut que Philippe les voie, ajouta-t-elle, il le faut… et, d’un geste rapide, elle enleva les deux épingles qui soutenaient les épaisses torsades de cheveux.
Ils s’écroulèrent. Malgré les protestations de Gertrude, Henriette voulut me les faire toucher. J’y plongeai mes deux mains. Je sentis leurs mille caresses subtiles à fleur de peau.
Gertrude maintenant restait immobile, comme engourdie.
— Mais, Philippe, embrassez-la, dit Henriette, je ne vous regarde pas.
Je me penchai vers la jeune fille, cherchant sa bouche. Elle détourna la tête et mes lèvres ne rencontrèrent que sa joue rougissante.
Telle était l’atmosphère dans laquelle nous vivions.
L’automne arriva trop vite. Une à une les maisons du voisinage se fermèrent et les Maure annoncèrent leur départ. Gertrude et sa mère les devançaient de quelques jours. Henriette, feignant de s’attendrir sur le malheur de notre séparation, nous ménagea une dernière entrevue. C’était dans une partie du bois assez écartée où nous aimions à nous réfugier. J’y trouvai Gertrude seule, hésitante, voulant fuir. Je la retins, je la rassurai, je lui demandai si elle m’oublierait vite, s’il y avait pour moi une place dans son cœur, et quel souvenir elle garderait des heures que nous avions passées ensemble.
Par un dédoublement curieux, je m’aperçus, en ce moment où d’autres préoccupations semblaient devoir m’absorber, que ma voix prenait pour prononcer ces mots une douceur persuasive et touchante que je ne lui connaissais pas, une qualité musicale qui m’émut moi-même. Et je parlais autant pour me plaire que pour gagner Gertrude.
Celle-ci ne fut pas insensible à l’accent de la mélodie que je lui murmurais et je vis bientôt l’effet produit, moins par mes paroles que par le ton sur lequel elles étaient dites. Elle me serra les mains, ses yeux s’emplirent de larmes, elle pencha la tête sur mon épaule.
Je couvris de baisers sa figure humide de pleurs. Je trouvai du charme à ces baisers, mais, faut-il l’avouer ? ces caresses échangées m’émurent à peine. Ma curiosité y était plus intéressée que mes sens. Et mon cœur restait de glace…
Deux jours plus tard, j’allai chercher Henriette pour une dernière promenade. Elle partait le lendemain. Par un besoin de secrète harmonie, nous choisîmes non pas les bois où souvent avaient retenti les éclats de rire de notre bande folle, mais une plaine morne que dominait une colline et qui avait été longtemps un marécage. Aujourd’hui des fossés la traversant en drainaient les eaux. Elle était nue et triste, quelques touffes de ronces épineuses seules y poussaient. Le ciel gris, bas, plein des brumes de l’automne, s’appuyait sur le fin clocher d’une église au sommet du coteau. Dans les champs, on brûlait les feuilles et les tiges des pommes de terre. Les fumées traînaient et ne s’élevaient qu’avec peine. Longtemps nous marchâmes sans parler. Enfin Henriette rompit le silence.
— Dire que je regretterai même cette pauvre plaine lorsque je serai à la ville. Je vous envie de rester ici.
Je ne répondis pas. Je venais de comprendre que rien dans ce pays qui m’était cher n’aurait plus de charme pour moi du jour où Henriette l’aurait quitté. La surprise de ce sentiment nouveau, la pensée de l’isolement où le départ d’Henriette me laisserait, me serrèrent le cœur au point que je fus obligé de m’arrêter.
Elle s’arrêta aussi et me regarda. Que lut-elle dans mes yeux ? Il me parut qu’elle pâlissait. Elle se mordit la lèvre, puis, avec un mouvement d’épaule que je ne sus comment interpréter, elle dit :
— Il faut rentrer.
Le lendemain elle partit, me laissant désespéré et fou de joie. J’aimais !
L’ivresse d’un premier amour suffit à remplir une âme moins enflammée que ne l’était la mienne. Le monde transformé s’éclaira d’une lumière inconnue ; je sentis s’agiter en moi la force qui anime la nature ; je fus enfin une parcelle vivante de l’antique et toujours jeune univers. Mes livres participèrent de cet enchantement. Je les avais lus avec les yeux de l’esprit ; ma sensibilité cette fois-ci s’émut. Les romans me racontèrent mon histoire ; les livres de science eux-mêmes me parlaient un langage que je comprenais pour la première fois. C’est alors que mon professeur me mit entre les mains l’Origine des espèces, de Darwin, et je n’oublie pas l’émotion que j’en éprouvai. Je crus voir s’ouvrir les portes longtemps fermées du temple. Les secrets m’étaient révélés de la vie qui palpite, identique, en tous les êtres. Et, au même moment, je découvrais que l’amour seul vaut de vivre et qu’il serait désormais mon maître. Mais sa tyrannie, sous laquelle tant d’âmes faibles succombent, ne m’effrayait pas. Elle me donnait, au contraire, un désir plus fort d’agir, je voulais maintenant exceller en mille choses ; j’entendais dominer. Je me jetai dans l’étude, non pas tant par le goût d’apprendre et de m’enrichir ainsi que pour me prouver à moi-même ma puissance. Au collège où je venais d’entrer, j’obtins cet hiver-là de mémorables succès. Mon professeur s’étonnait de mon ardeur et me prédisait un succès certain au baccalauréat qui, à la fin de l’année, terminerait mes études secondaires.
Mais Henriette ?… Chose étrange, j’étais exalté à ce point que je ne souffrais pas de son absence. Ne lui devais-je pas la magique transformation que j’avais subie ? Sans doute, je désirais la revoir ; je lui parlais comme si elle avait été présente ; son souvenir ennoblissait chaque heure de ma vie. Mais je me créais de si merveilleux bonheurs qu’à la lettre je n’avais pas le temps de pleurer sur notre séparation. L’image que je me formais de mon amie était à ce point parfaite que peut-être l’Henriette réelle, si elle m’était apparue, n’aurait pas rempli exactement la place et le rôle que je réservais à l’Henriette de mes rêves.
Nous nous écrivions. Mais comment traduire mes sentiments dans des lettres qui pouvaient être lues par d’autres ? Comment lui écrire ce que je ne lui avais pas dit lorsqu’elle était près de moi ? Ses lettres étaient, il faut l’avouer, décevantes, tant ce qu’elles exprimaient était éloigné du langage que je lui prêtais à distance.
Par ailleurs, je ne souffrais plus autant du malaise mystérieux et redoutable qui m’avait si cruellement accablé depuis deux ans, la fraîcheur de mon amour avait fait disparaître les fièvres malignes de la puberté.
L’hiver, le printemps passèrent ; je ne comptais pas les jours qui me séparaient d’Henriette, je vivais avec elle sous la lampe près du poêle, dans les champs durcis par le froid ou sous les vertes frondaisons. L’été me la ramènerait.
Vers le début de juin ma mère tomba malade ; elle fut longtemps retenue à la chambre. Elle y était encore quand je partis pour passer mes examens à l’université voisine. Lorsque j’en revins, elle sortait de convalescence et les médecins l’envoyaient aux eaux. Elle était trop faible pour que je pusse songer à l’y laisser aller seule.
Elle pensait que la nouvelle de ce déplacement me serait agréable et qu’il me plairait de quitter, presque pour la première fois, nos campagnes.
Mais je ne songeais qu’à Henriette. Ses yeux riants ne rencontreraient pas les miens lorsqu’elle arriverait dans le pays ! Je lui envoyai une lettre désolée, la plus explicite de toutes celles que je lui avais écrites. J’annonçais mon retour au mois d’août, je la suppliai de ne pas m’en vouloir…
Aux eaux, des habitudes nouvelles me furent une distraction. Pourtant je ne voulais pas me l’avouer. Lorsque j’étais avec ma mère, je ne cessais de regretter le confort, le calme délicieux de notre demeure, de me plaindre de l’impossibilité d’être seuls dans le va-et-vient du grand hôtel où nous habitions. Cependant je trouvais un charme singulier à ce coudoiement de tant de personnes inconnues, à ces rapides coups d’œil échangés avec des étrangers, à la vie en commun qui mêlait nos plaisirs et nos occupations, aux repas au restaurant, à la danse, le soir. J’avais déclaré vouloir vivre en sauvage. Je n’étais pas à X… depuis quarante-huit heures que je jouais au lawn-tennis, que j’étais de toutes les parties, que je dansais chaque nuit. Je faisais tout avec fièvre comme si j’eusse voulu m’étourdir et oublier. Quoi ?
Je remarquai dès le premier jour une jeune femme qui mangeait à une table voisine de la nôtre. Ses yeux étaient sombres et elle semblait désireuse d’en voiler l’éclat en tenant ses paupières à moitié baissées. Elle me parut avoir environ trente ans. Ma mère lui en donna plus généreusement quarante. Dans son visage pâle d’un ovale allongé ses lèvres plus rouges que celles des femmes que nous avions l’habitude de voir attiraient mes regards. J’eus la curiosité de savoir son nom. Elle s’appelait la comtesse de Francheret. J’avais lu ce nom dans les journaux mondains de Paris. A X…, Mme de Francheret n’appartenait à aucune des coteries où se groupaient les baigneurs. Ses manières, sa distinction, la solitude où elle vivait, le prestige aussi de sa classe sociale, voilà des motifs d’intérêt pour un jeune provincial jamais sorti de chez lui. Je me mis donc à l’observer, peut-être trop directement. Voulut-elle me faire sentir que je manquais aux convenances ? Deux ou trois fois, elle me fixa d’une façon pénétrante. Vers cinq heures, elle s’asseyait près de la cour de tennis où nous jouions. Les spectateurs étaient nombreux qui suivaient nos parties. Elle se tenait à l’écart. Pourtant il était rare, lorsque je levais les yeux sur elle, que je ne surprisse pas les siens.
Quelques jours passèrent ainsi. J’aurais voulu l’approcher, lui parler, mais je ne savais comment m’y prendre. Elle vint heureusement à mon secours.
Une fin d’après-midi, comme je descendais du tennis pour aller à la douche, je dépassai Mme de Francheret. Elle se tourna à demi vers moi et m’adressa la parole de la façon la plus simple, comme si nous nous connaissions depuis longtemps.
— Vous avez chaud, me dit-elle.
Tout en marchant nous continuâmes à causer. La nouveauté de la situation eût pu m’être gênante. Mais, par bonheur, je ne pensai pas à moi.
Sa voix avait une certaine gravité qui me plut.
Les jours suivants nous nous rencontrâmes encore. Elle paraissait écouter sans ennui ce que je racontais de moi-même, de notre vie provinciale, de mes plans incertains et magnifiques. Elle parlait peu, mais ses paroles, lorsqu’on y réfléchissait, prenaient un sens plus profond que celui qu’elles présentaient tout d’abord. Elle ne causait ni de littérature, ni d’art, mais elle semblait connaître les gens et les choses mieux qu’il n’est accoutumé. Enfin son regard, dont elle était ménagère, ajoutait du poids à ses paroles.
— Que vous êtes jeune ! disait-elle souvent.
Nous ne nous voyions jamais que dans les jardins et, le soir, au salon, où elle s’installait avec ma mère.
Un jour, après déjeuner, je me rendis pour la première fois chez elle. Elle était légèrement souffrante et m’avait fait demander un livre. Elle occupait, sur la cour d’entrée célèbre par ses arbres centenaires, un appartement composé d’un salon minuscule et d’une chambre. Je la trouvai couchée sur une chaise longue, vêtue d’un blanc peignoir de dentelles. Les ormeaux jetaient leur ombre entre les persiennes à moitié closes ; on entendait le bruit confus des conversations à quelques pieds au-dessous de nous.
— Asseyez-vous là, me dit-elle, montrant un fauteuil tout proche.
Une fois assis, moi, qui étais à l’ordinaire si bavard, je n’eus rien à dire, je n’avais aucune idée, aucune volonté. Le silence ne me pesait pas. Un parfum de je ne sais quoi flottait dans l’air. Je regardai Mme de Francheret. Elle rêvait, un bras relevé sur le dossier de la chaise longue. Je voyais les chairs pleines et ambrées par où le bras s’attache à la poitrine qui se soulevait lentement à chaque respiration. Sa bouche s’entr’ouvrait comme pour un sourire. J’oubliai que je me trouvais à côté de la comtesse de Francheret. C’était une femme qui était là près de moi. Et nous étions seuls.
Sans plus y réfléchir, je pris sa main et j’eus la hardiesse de la porter à mes lèvres. Elle me laissa faire.
— Que vous êtes jeune ! dit-elle encore. C’est délicieux !
Elle m’attira vers elle ; je sentis l’odeur de sa tiède gorge, et ses deux bras se nouèrent autour de mon cou.
Quand je sortis de sa chambre, une heure plus tard, j’étais un homme.
La joie que j’aurais pu prendre dans les bras de Mme de Francheret avait été gâtée par la peur de lui paraître novice. Un adolescent craint le ridicule. N’eût-il pas été plus simple de lui dire : « Je ne sais rien, je me remets entre vos mains ; soyez vraiment ma maîtresse. » Mais on ne gagne la simplicité que par des chemins longs et difficiles. Je pensais : « Elle s’est aperçue, sans doute, de mon inexpérience. Demain, elle se moquera de moi ; elle ne voudra plus me voir. Et moi-même, comment la regarderai-je ? »
Mais, en même temps, j’étais gonflé de joie. Je connaissais enfin la réalité de ce monde féminin dont le mystère m’avait longtemps troublé. Ma première impression, celle qui ne devait point s’évanouir, je la traduisis par ces mots de la Bible : « L’œuvre de chair. » J’avais participé à une œuvre de chair, cela et rien de plus. Pour un garçon qui avait vécu dans les livres et dans de romanesques enchantements, la nouveauté était grande. Je sentais aussi que l’incomplète joie de cette première rencontre serait transformée bientôt en un bonheur plus complet, qu’il y avait un point de perfection à atteindre, et j’étais bien décidé à y arriver au plus vite.
Pas un instant, je n’eus l’idée que j’avais commis une infidélité envers Henriette. Henriette vivait sur un plan différent. Elle habitait le palais que mon imagination lui avait bâti. Mme de Francheret m’avait invité dans une demeure plus terrestre. Je ne songeai même pas à me demander si j’aimais mon initiatrice. Aimer, c’était penser tendrement à une personne, chercher à la voir, lui parler, deviner les moindres nuances de ses sentiments, s’émouvoir à son seul souvenir. Un regard d’elle, c’était assez pour être heureux ; se sentir maître de son âme, y régner sans partage, la félicité suprême.
Pour Mme de Francheret, présente ou absente, je ne ressentais aucune de ces émotions. Lorsque je pensais à elle, des images précises se levaient devant mes yeux, et quelles images ! Je sentais sa chair contre ma chair et le désir m’agitait de renouveler ces obscures et violentes sensations.
Désormais je passai mes après-midi dans l’appartement de Mme de Francheret. Je ne montais au tennis, un peu las, qu’à la fin de la journée. J’eus bientôt perdu la gêne des premiers jours. Déjà je me croyais naïvement un maître…
La seule ombre à mon bonheur, où la chercher ? Dans la facilité avec laquelle je l’avais acquis. J’étais assez sot pour ne pas estimer à son prix une victoire qui ne m’avait rien coûté. « Je suis l’amant, me disais-je, de cette femme charmante et qui appartient à la meilleure société, mais sans doute a-t-elle l’habitude de satisfaire ses moindres caprices. J’étais là ; elle m’a pris. Moi absent, un autre l’eût possédée. »
La manière d’être de Mme de Francheret n’était pas faite pour me donner une trop haute idée de moi-même. Nous étions toujours dans des rapports simples. Personne ne prenait moins de plaisir à jouer la comédie. Elle n’affecta aucun remords, aucune crainte ; elle ne se crut pas obligée de chercher des excuses à ce que d’autres appellent leur faute ; elle n’essaya pas de me faire croire qu’elle avait cédé à un sentiment irrésistible. Avec une aisance parfaite (seule, pensais-je, une grande dame — Balzac ! — a cette inimitable liberté), elle m’invita à des jeux que j’ignorais et m’en apprit la douceur. Une semaine ne se passa pas sans que je lui avouasse que j’étais arrivé neuf dans ses bras.
Elle sourit.
— Croyez-vous que j’aie pu l’ignorer ? dit-elle.
Elle m’apprit bien d’autres choses encore, et surtout le prix du secret. Hors de sa chambre, elle me traitait comme un étranger, et je m’émerveillais de ce changement à ses yeux si naturel… Il n’y avait alors, entre nous, aucune familiarité, pas un mot équivoque, pas un regard trop appuyé. Je la voyais au restaurant, ou au salon, le soir, causant avec ma mère, à son aise, libre, distante, et je ne pouvais m’imaginer que cette même femme je l’avais eue quelques heures auparavant nue entre mes bras, que je connaissais les parties les plus secrètes de son corps. Et je l’en admirai davantage.
Nous vécûmes ainsi pendant deux semaines. Puis il fallut nous quitter. Le dernier jour où je fus chez elle, je lui dis :
— Comment pourrai-je me passer de vous ?
— Bien mieux que vous ne le croyez, me répondit-elle. Ce que je vous ai donné, d’autres vous l’offriront. Elles y mettront plus de façons sans doute et moins de franchise. J’ai été la première, vous ne m’oublierez pas. Peut-être nous reverrons-nous à Paris puisque vos études vous y appellent. Les choses ne seront pas là-bas ce qu’elles ont été ici. Il est des folies délicieuses qu’on doit se refuser. Vous étiez en vacances, moi aussi. Maintenant la vie régulière reprend. Au moment de partir, vous donnerai-je un conseil ? La différence de nos âges me le permet. Défendez-vous en amour des choses vulgaires qui ont vite fait de gâter les jeunes gens. Vous vous plairez toujours dans la société des femmes. Ne croyez pas, comme quelques-uns, qu’il faille être sincère avec elles. Sachez leur mentir, ne serait-ce que pour les amuser. La plupart demandent à être trompées ; il est bon d’y mettre quelques manières. Voilà mon conseil. Et en voici un second. Ne croyez pas à l’irréparable. Il y a, cher ami, fort peu de choses irréparables…
Elle ne m’en avait jamais tant dit. Ainsi me fit-elle participer à sa sagesse humaine au moment où nous nous séparions. Je quittai les eaux avec un beau sujet de méditations et les souvenirs tout proches d’un passé déjà plein de volupté.
J’eus le loisir d’y penser plus longuement que je ne l’aurais voulu. Au lieu de rentrer, nous allâmes passer quinze jours sur une plage dans le sud de la Bretagne. Les médecins avaient ordonné ce repos à ma mère avant le retour au foyer.
J’en fus moins affligé qu’on ne le croirait. J’étais encore tout étonné de mon aventure et, malgré mon désir de revoir celle que j’aimais toujours, j’éprouvais le besoin de mettre un intervalle entre le moment où j’avais quitté Mme de Francheret et celui où je retrouverais Henriette. On se plaît à raconter dans les romans qu’une fois séparé d’une femme que l’on a aimée charnellement on découvre, peu à peu, qu’on lui est attaché par d’autres liens aussi. Rien de semblable ne m’arriva. J’aimais Henriette, et Mme de Francheret m’avait attaqué là où Henriette n’avait jamais régné. Je savais un gré infini à Mme de Francheret de m’avoir révélé la nature et l’agrément des rapports entre l’homme et la femme. Je n’oubliais pas les heures passées près d’elle, mais, par un phénomène bizarre, elle m’incitait à penser à Henriette et à voir celle-ci sous un jour nouveau. Grâce à Mme de Francheret, mon amour pour Henriette quitta les sphères éthérées où il se mouvait et prit une forme sensuelle. C’était Henriette et non Mme de Francheret que je tenais dans mes bras pendant mes rêves. C’était le corps frais et juvénile de mon amie que je pressais à l’heure où le désir suscitait devant moi des images voluptueuses.
Je n’ai gardé de ces semaines aucun autre souvenir. Les gens qui m’entouraient étaient-ils vivants ? Ils allaient et venaient comme des ombres. Je faisais de longues promenades sur la digue à l’heure où le soleil couchant borde de nacre le sable humide. Des enfants jouaient, des jeunes femmes passaient vêtues de robes claires. Je ne les voyais pas, je ne voyais bercée au jeu des vagues molles dont les crêtes d’argent s’irisaient dans les vapeurs du crépuscule, qu’Henriette, et quelle Henriette ! non pas la fille que j’avais connue près de sa mère sous les ombrages de nos campagnes, mais une Vénus adolescente endormie au bord des flots.
Nous nous écrivions. Que dire par lettre à une déesse ? Je ne savais trouver le ton. J’étais grandiloquent et confus. En échange, je recevais quelques cartes postales, assez insignifiantes, à la vérité. Henriette paraissait de triste humeur. Pourtant sa maison était pleine d’amis. Le cercle joyeux de l’an dernier s’était reformé. Seul j’y manquais !
Au début de septembre enfin, nous rentrâmes. A mesure que l’heure approchait où je devais revoir Henriette je m’inquiétais. Je brûlais de devancer les jours, de courir à elle, de me jeter à ses genoux et, au même temps, une douloureuse appréhension me serrait le cœur. Je craignais de cette rencontre je ne sais quel choc, quelle blessure insupportable. J’aurais voulu retarder une minute attendue avec tant de fièvre.
Nous arrivâmes un matin. A la fin de l’après-midi je me rendis chez Mme Maure. De loin, je la vis sous les tilleuls près de la vieille maison. Rien n’avait changé depuis un an. Henriette devait être à quelques pas de là. L’émotion de la sentir si voisine me fit chanceler. Je m’arrêtai, j’étais essoufflé moins par la rapidité de ma course que par la violence des sentiments qui se heurtaient en moi. Je compris pour la première fois et d’un seul coup — ainsi, la nuit, un éclair illumine les prés et les champs, et montre au voyageur le chemin dont il s’est écarté — que le roman magnifique que j’avais vécu depuis l’automne passé s’était déroulé dans mon imagination, que je l’avais créé à moi seul, qu’Henriette en ignorait encore le premier mot… Un instant, je pensai à retourner sur mes pas, à différer une entrevue si hasardeuse. Mais j’eus honte à l’idée de reculer. Je me repris et avançai vers Mme Maure.
Elle me fit l’accueil le plus aimable. Après s’être informée longuement de la santé de ma mère, elle me dit :
— Comme vous avez grandi, Philippe ! Vous voilà un homme, maintenant. Et cette pointe de moustache ! Qu’allez-vous faire ?
Je parlai de mes projets assez incertains. J’irais à Paris pour continuer mes études à la Sorbonne sans doute et à l’école de droit, mais je ne désirais être ni professeur, ni avocat et ne savais ce que serait ma carrière… Cependant, je pensais à Henriette absente, alternativement avec terreur et avec joie. Où était-elle ?
Une demi-heure passa. J’entendis un bruit dans l’allée.
C’était Henriette et Gertrude, accompagnées par le polytechnicien de l’an dernier.
Henriette me parut grandie ; elle restait mince, un peu maigre, mais le corsage de sa robe se gonflait légèrement et ses hanches se dessinaient plus pleines. Son visage n’avait pas changé, son teint hâlé par l’été faisait paraître les dents plus blanches et je retrouvai, dans les yeux riants et doux, le feu que j’aimais. Auprès d’elle, magnifique contraste, Gertrude était éblouissante de fraîcheur blonde. Toutes deux vêtues de clair, elles venaient enlacées et joyeuses. Le printemps de ma vie s’avançait au-devant de moi.
Gertrude rougit, mais l’accueil que me fit Henriette ne trahit aucune gêne. Elle ne me cacha pas le plaisir qu’elle avait à me revoir et me gronda gentiment de mon retard. Elle me demanda qui j’avais rencontré aux eaux et à la mer. Rien de plus amical et de plus naturel que cette conversation, mais elle était si éloignée de celles que j’avais tenues avec la même Henriette pendant mes promenades solitaires que j’en restai glacé. Je m’efforçai de découvrir dans ses propos un mot à double entente destiné à moi seul. Je ne le trouvai pas. Pourtant il me parut qu’à deux ou trois reprises elle me regardait avec un peu d’étonnement. Sur elle-même elle ne dit rien.
Charles-Henri (le polytechnicien) se chargea de m’apprendre quels avaient été les amusements de la saison. Rappelant des incidents que j’ignorais, il fit rire les filles en les évoquant et s’arrangea de façon que je me sentisse un étranger parmi eux. Cela me déplut.
Lorsque je partis, Henriette et Gertrude décidèrent de m’accompagner. Mais Charles-Henri ne les laissa pas seules et, quand nous nous séparâmes à la lisière du petit bois de chênes, je n’avais pu échanger une phrase avec Henriette sans témoins.
Je ne fus pas plus heureux les jours qui suivirent. Je vis mon amie, mais entourée de sa cousine, de Charles-Henri, d’allants et de venants. Elle était le centre lumineux de notre cercle. Charles-Henri violemment épris ne la quittait point. Je ne fus pas longtemps avant de comprendre qu’il montait la garde auprès d’elle et qu’il ferait l’impossible pour m’empêcher de la joindre. Gertrude, sans dessein, j’imagine, le secondait. Elle semblait ne vivre que par Henriette, toujours à ses côtés, le bras autour de la taille. Si elle était séparée de sa cousine, ses yeux restaient attachés sur Henriette. Vis-à-vis de moi, elle observait une certaine réserve ; elle s’effarouchait vite et lorsqu’en plaisantant je voulus reprendre les propos de l’an passé, elle eut un mouvement de retraite.
Malgré Charles-Henri, malgré Gertrude, je ne désespérais pas d’arriver à Henriette, mais, à ma grande surprise, je constatai que c’était chez elle que je trouverais l’obstacle le plus difficile. Elle apportait une attention toujours égale à ne pas rester seule ; et si, profitant d’un incident heureux, je réussissais à écarter ses deux gardiens, elle ne me laissait pas choisir le thème de la conversation et, d’un mot, la ramenait à des banalités. Après une semaine ou deux de tentatives infructueuses, j’étais exaspéré.
Tour à tour, j’imaginais ou qu’Henriette avait deviné que j’avais fait mon école d’homme, qu’elle soupçonnait un danger à se lier avec moi et qu’elle cherchait à m’éviter, ou, plus simplement, que je lui étais devenu indifférent.
Suivant que j’adoptais l’un ou l’autre de ces partis, je décidais ou de m’imposer à elle ou de la fuir. Je déclarais alors que je ne la reverrais plus, que j’avais été victime de mon imagination, que je me trouvais en face d’une fille incapable d’éprouver les grands sentiments que je lui avais prêtés. Cette farouche résolution ne durait que l’espace d’un matin. Il n’y eut pas de jour où je ne décidasse de rompre ; il n’y en eut pas un qui ne me vît près d’Henriette.
Et cependant le temps coulait, bientôt viendrait octobre et le départ. J’eus l’idée, empruntée sans doute à mes lectures, d’éveiller sa jalousie. Je fis la cour à Gertrude ; j’y déployai beaucoup d’application et, au bout de quelque temps, Gertrude parut y être sensible. Mais sa cousine veillait et comme un jour, moitié plaisantant, moitié sérieux, j’adressais à Gertrude des propos tendres et lui baisais la main, Henriette intervint assez brusquement disant que les jeux permis naguère ne l’étaient plus aujourd’hui.
Je fus surpris du ton vif sur lequel elle parla et qui était bien éloigné de celui que nous employions. Rentré chez moi et en y réfléchissant, il me parut que cette nouvelle attitude d’Henriette avait quelque chose de flatteur pour mon amour-propre.
Le lendemain, je la trouvai de méchante humeur. Je cessai de flirter avec Gertrude. Mais Henriette ne s’apaisa pas. « Peut-elle sérieusement m’en vouloir, me demandais-je, de ce qui n’est qu’un jeu ? » Mais elle ne me laissa pas lui poser la question.
Je devins irritable. Elle me contredisait pour un rien. Nous échangions des phrases aigres. Les jours qui fuyaient ajoutaient à mon énervement. Une fois, sur un mot un peu plus piquant, elle eut soudain les yeux pleins de larmes. Troublé à cette vue, je me précipitai vers elle. Nous étions seuls, mais à une douzaine de pas sa mère brodait sous les tilleuls. Henriette me repoussa vivement et, sans me donner le temps de m’excuser, rentra dans la maison.
Pendant quarante-huit heures, je ne la vis point. Lorsque nous nous retrouvâmes, elle ne paraissait pas se souvenir de cette scène pénible.
La première semaine d’octobre commença. Les Maure partaient le 10. Le temps était d’une admirable douceur et la lune dans son second quartier permettait de prolonger encore les soirées en plein air. Un jour, une amie à nous s’invita à dîner. Ma mère envoya un mot à Mme Maure pour lui demander de venir avec sa fille et sa nièce. Le soir, je fus surpris de voir arriver Mme Maure et Henriette seules. Gertrude un peu souffrante s’était couchée. « Enfin, pensai-je, j’aurai l’explication attendue depuis si longtemps. » Mais, après dîner, Henriette refusa de quitter le salon pour s’asseoir avec moi sur la terrasse. A la demande de ma mère, elle fit de la musique, puis resta près des dames et je fus obligé de l’y rejoindre.
J’étouffais de fureur. En moi-même, j’avais déjà rompu avec Henriette, je ne reverrais de ma vie cette fille insensible. Qu’elle parte et sans retard ! Cependant je m’absorbais dans un silence farouche.
Vers dix heures, nos visiteurs se levèrent. L’amie de ma mère offrit à Mme Maure et à sa fille de les ramener en voiture. Mme Maure, fatiguée, accepta. Mais le vieux coupé, très étroit, n’avait que deux places et Henriette, par politesse, se crut obligée de dire :
— Nous allons vous gêner beaucoup, madame.
Alors, par une décision subite, je m’avançai, pris la main d’Henriette dans l’obscurité et, la lui serrant fortement pour empêcher toute résistance, je dis à Mme Maure :
— Je raccompagnerai Henriette. Nous serons là presque aussitôt que vous.
Henriette, stupéfiée par la pression de ma main, hésita avant de parler. Déjà Mme Maure de la voiture me jetait :
— Si cela ne vous ennuie pas de la ramener, il sera excellent pour elle de marcher un peu. Elle est si paresseuse.
La voiture partit nous laissant seuls sur les marches du perron.
Tout de suite, le long de l’allée qui menait au bois, nous fûmes dans l’ombre fraîche du soir.
Nous ne parlions pas, nous allions côte à côte sans nous toucher. Le silence, à se prolonger, pesa comme une menace. Pour rien au monde, je ne l’aurais rompu. J’étais plein de colère ; je me souvenais de l’étrange manière d’être d’Henriette depuis ma rentrée ; elle m’avait froissé ; elle me devait des excuses… Je marchais la tête droite, les yeux fixés devant moi.
Henriette fut la première à ne pouvoir supporter l’hostilité silencieuse qui était entre nous. A un détour du chemin — nous avions déjà franchi la moitié de la distance qui séparait nos deux maisons — elle se tourna pour m’interroger du regard. Je vis à la clarté de la lune ses yeux inquiets. Bouleversé par la supplication muette que j’y lus, je glissai mon bras sous le sien. Le contact de ma main sur sa chair suffit à opérer un prodige. L’irritation qui nous avait dressés l’un contre l’autre fondit comme neige d’avril au soleil ; des rapports naturels, confiants, heureux s’établirent sans que nous eussions échangé une parole. Je sentis qu’Henriette gagnée m’appartenait. Nous arrivions au bois de chênes. Je la conduisis jusqu’au banc où cent fois nous nous étions reposés au cours de nos promenades. Elle me suivit sans opposer de résistance. Je m’assis près d’elle, je la pris dans mes bras, — la nuit était complice — je me penchai sur son visage pâle, je vis ses yeux m’implorer, et sous la pression de mes lèvres sa bouche s’entr’ouvrit.
Nous eûmes une semaine entière pour épuiser notre bonheur. Henriette, transformée, montra la bravoure d’une femme. Elle n’essaya pas de dissimuler ses sentiments. Nous étions ensemble à chaque heure. Je la voyais le matin, l’après-midi, même le soir. Elle inventait mille ruses pour se débarrasser de Charles-Henri. Quant à Gertrude, elle en fit sa complice, et cela sans hésitation, sans se demander si sa cousine en souffrirait, sans se soucier d’être jugée par elle. Elles sortaient à deux ; dès qu’elles m’avaient retrouvé, Henriette s’éloignait avec moi, la priant de nous attendre. Parfois elle l’appelait en riant : Brangaine. Un jour, devant Gertrude, elle risqua une caresse hardie. Celle-ci rougit, puis pâlit, mais se tut.
Nous vivions ainsi comme en dehors du temps. La date approchait qui l’emmènerait, elle, à Marseille, moi, à Paris. Nos jours étaient comptés, nous ne les comptions pas. Nous ne parlions ni de la séparation, ni des moyens de nous retrouver. Jamais il n’y eut gens plus acharnés à se satisfaire du présent. Pas une minute, Henriette n’eut l’idée qu’elle goûtait d’un fruit défendu. Elle m’aimait. Cherche-t-on des excuses à l’amour ? A ses yeux, il n’était pas besoin de se justifier.
La séparation vint. Je vis Henriette disparaître en voiture au détour du chemin, ne cachant pas ses larmes.
Je restai seul une semaine encore. Je ne sentais pas mon isolement. Le prix de mon bonheur était-il diminué parce que je l’avais perdu ? j’étais déjà enclin, sans que je pusse en analyser les motifs avec précision, à considérer toutes choses par rapport au développement de mon individualité. Plus tard, quand mes lectures s’étendirent, je me trouvai d’illustres frères dans la littérature européenne. A ce moment, ce sentiment en moi ne devait rien à l’imitation, j’aurai bientôt à en fournir une preuve.
Ainsi la séparation me fut adoucie par la joie orgueilleuse de constater que j’étais capable d’éprouver une grande passion et aussi de la faire naître chez autrui. Je n’eus, du reste, pas la plus légère fatuité à voir que j’avais triomphé d’Henriette ; je n’en avais pas ressenti non plus à éprouver que Mme de Francheret avait du goût pour moi. Une obscure, mais juste idée de la fatalité qui nous mène m’empêcha toujours de m’attribuer à mérite ce dont je n’étais redevable qu’à un sort heureux.
Six mois après, j’appris par une lettre de ma mère qu’Henriette se mariait avec un riche industriel de Marseille, gaillard à tout poil, grand coureur de filles et de cabarets, six pieds de haut, le verbe fort.
Je ne lus pas cette lettre sans un serrement de cœur. Henriette dans les bras d’un rustre ! La vilaine image !
Je m’efforçai, à l’exemple des stoïciens dont les doctrines alors m’enchantaient, de raisonner, pour l’amortir, sur le coup reçu. « Je me suis trompé moi-même, me disais-je. Voilà une expérience salutaire à ton début dans la vie. Ne mets pas à l’avenir les femmes sur un plan trop élevé. Elles ne sont jamais qu’à mi-hauteur et plus près de la terre que du ciel. »
Mais cette leçon de sagesse avait un arrière-goût d’amertume qui fut longtemps à s’effacer.
J’étais alors un étudiant mal débrouillé dans les rues étroites de Paris. Ma jeunesse me paraissait médiocre. Pourtant que n’en attendais-je pas ? Je croyais arriver à la période la plus heureuse de mon âge. Après l’existence mesquine d’une petite ville de province, je serais entraîné par la vie tumultueuse, riche et multiple de Paris. Je n’aurais qu’à me laisser porter par le courant.
Il me fallut déchanter. Je n’ai de ces années que des souvenirs confus, souvent pénibles. En guerre avec moi-même, incertain de la voie que je suivrais, je cherchais avidement des vérités qui fussent miennes. J’avais de la fierté ; je n’aurais avoué à personne — me l’avouais-je à moi-même ? — mon désarroi. Au lieu de crier au secours je prenais un air détaché, un ton distant, je paraissais indifférent et supérieur. J’étais haïssable, sans doute, mais comment demander à un jeune homme passionné, qui ne sait ce qu’il est, en qui combattent mille désirs contraires, d’être simple et naturel, alors qu’il ne s’est pas encore trouvé.
Peut-être la cause véritable de ce malaise est-elle dans la jeunesse même, âge difficile dont chacun connaît à des degrés divers les heurts et les cahots. Nous les oublions. La mémoire assoiffée d’idéal — le bon vieux temps ! — a bientôt fait de transformer la lumière grise ou orageuse qui baigne nos jeunes années en une aube éblouissante. On a comparé la jeunesse au printemps, non sans raison, car elle en connaît les ciels brouillés, les giboulées où neige, pluie et soleil se mêlent, les brusques morsures du froid, les gelées meurtrières d’une nuit d’avril, et aussi les caresses, presque insupportables tant elles sont subites, de l’atmosphère, la vie qui repart sur un rythme trop rapide, le complot universel de la nature qui vous entraîne dans son branle frénétique. Il faut être fort déjà pour supporter ces contrastes et ces véhémences. Si l’on se tue, c’est entre dix-huit et vingt-deux ans.
Dans un état si trouble, aimer était hors de question. Le souvenir de l’expérience faite avec Henriette était toujours vivant. Je ne voulais pas m’avouer la déception ressentie. Pourtant je regardais les femmes d’un œil un peu méprisant ; je plaignais leur fragilité. Je les recherchais, mais même entre leurs bras je ne m’abandonnais point. J’allais ainsi, comme tout jeune homme, de liaison en liaison, ne me prenant à personne. Si j’eus des bonnes fortunes, je ne sus pas en profiter. J’appris par expérience une chose banale, c’est que l’homme peut pratiquer l’amour indéfiniment sans ressentir l’amour. J’avais des maîtresses, je ne les aimais pas. J’avais des amies, encore des jeunes filles, je ne les possédais point. On me croyait hardi, j’étais timide ; on m’enviait, je me faisais pitié. Je voulais paraître, à vingt-deux ans, maître de moi. Maître de quoi ? de pas grand chose.
Les femmes à portée de ma main me semblaient — peut-être avais-je là des trésors qu’aveugle je ne voyais pas ? — indignes d’attention. La conquête de la plus belle princesse du monde, du cœur le plus haut, de l’âme la plus pure, tels étaient mes rêves d’alors. J’étais sec et sans illusion dans le présent, chimérique pour l’avenir. Mais ce désir ardent en mon jeune cœur a eu de lointaines et merveilleuses conséquences et le mot de Gœthe est vrai que je me répétais souvent : « Ce que tu as désiré avec force au temps de ta jeunesse, tu l’auras en abondance dans ton âge mûr. »
Pourtant, si médiocre que je fusse, on m’accueillait avec faveur dans quelques maisons. Je me déplaisais, mais des femmes et des filles se plaisaient à ma compagnie. Un plus avisé en eût tiré des avantages. Je ne m’en souciais point. Emporté par mes rêveries, je n’abaissais pas mes regards vers le sol. Je pensais à la grande passion que je rencontrerais un jour. Pouvais-je imaginer qu’elle eût une origine obscure et qu’elle trouvât peu à peu vie et force dans les éléments, de médiocre prix à mes yeux, dont j’étais entouré ? Elle m’apparaîtrait éblouissante, casquée d’argent, armée de pied en cap, comme Minerve à l’heure de sa naissance. Il ne me fallait rien de moins qu’un miracle.
En l’attendant, je me distrayais de mon mieux. Je disais en plaisantant : je pelote avant partie.
Je n’étais que contradiction et système. Au vrai, je n’aimais déjà que les jeunes filles, je les ai toujours aimées. Mais je ne savais ce qui m’attirait vers elles. Il m’a fallu la leçon d’une tragique expérience pour voir clair en moi. Je n’ai compris que plus tard pourquoi, seules, elles pouvaient me rendre heureux. Pour l’instant je vivais dans les sophismes et l’erreur. Je pensais que par une lente évolution elles seraient un jour capables d’aimer et dignes d’être aimées, mais il ne me venait pas à l’esprit de hâter leur transformation. Je leur donnais rendez-vous dix ans plus tard lorsqu’elles pénétreraient dans le monde de la passion où elles n’étaient que postulantes. Avec un pédantisme incroyable, j’avais fixé l’âge de l’amour entre vingt-cinq et trente-cinq ans. Avant, inexpérience ; après, ressorts déjà usés ! Ainsi, peu sûr de moi, j’échafaudais d’absurdes théories et leur accordais de la valeur.
Une des maisons agréables où je fréquentais alors était celle de Mme Saint-Aignan. Son mari, mort depuis quelques années, avait travaillé près du baron de Hirsch aux chemins de fer orientaux. En Turquie, elle s’était fait des relations internationales et voyait une société mêlée. Ce sont les plus agréables. Elle avait à peine passé la quarantaine. Sa fille Isabelle, née à Constantinople, venait d’avoir quinze ans. Elles étaient toutes deux belles, toutes deux charmantes, mais en dehors de l’âge où j’enfermais si sottement l’amour. Plus libre d’esprit, j’eusse fait la cour à la mère enjouée ou à la fille grave, et peut-être eussé-je réussi. Isabelle, avec ses yeux étroits et longs, son front petit, un visage ovale, ressemblait à une Vierge byzantine. Où avait-elle pris ses traits ? Pas à sa mère, à coup sûr, blonde, bien en chair, aux yeux bleus. Et la photographie de M. Saint-Aignan le montrait normand des pieds à la tête. Il y avait là un de ces phénomènes si complexes de l’influence du milieu qui, parfois, s’exerce de façon surprenante sur une femme jeune, jolie, courtisée et sensible. Quoi qu’il en soit, Isabelle Saint-Aignan paraissait parmi nous d’une autre race. Je me pris d’amitié pour elle, mais la traitais plus en enfant qu’en jeune fille.
J’aimais à la faire parler de Constantinople qu’elle avait quitté à six ans. L’Orient m’attirait. Tout jeune, je ne supportais pas les plats récits de Mme de Ségur, née Rostopchine, mais avec une belle histoire orientale on faisait de moi ce qu’on voulait. Si on discutait chez Isabelle de la vie turque, elle était la seule à n’avoir pas d’opinion. Elle gardait pour elle le trésor des souvenirs précieux qu’elle avait rapportés de là-bas ; mais j’avais gagné sa confiance et bientôt elle me fit partager ses impressions de naguère, fraîches et vives dans sa mémoire.
Elle me racontait la vie indolente du Bosphore, les promenades en caïque, les rencontres sur l’eau, l’appel d’une guitare au fond d’un jardin qu’envahit le crépuscule, le calme des mosquées nues. Plus que tout l’intéressait l’existence dans les harems où sa mère quelquefois l’avait menée en visite chez des dames turques. Un monde de serviteurs s’empressait autour de ces femmes recluses par goût plus que par contrainte, servantes noires ou blanches, vieux hommes ridés à la voix enfantine, pleins de politesse. C’était un endroit enchanté, loin de l’agitation et des orages… Isabelle me disait aussi les barques et les paquebots qui montent et descendent sans cesse le Bosphore.
— Nous habitions une maison au ras de l’eau avec un jardin plein de fleurs. Parfois, une goélette passait dans la nuit tout proche la côte. Je ne voyais pas le remorqueur, mais j’entendais une respiration haletante et j’imaginais que c’était celle du génie qui la tirait. Elle glissait ainsi mystérieusement, voiles pliées, à quelques pieds du lit où, enfant, je cherchais le sommeil. Elle m’emportait dans des contrées plus belles d’être lointaines.
Cette fille sauvageonne, à peine grandie, ne venait pas à vous ; il fallait la chercher. L’ombre lui plaisait mieux que la lumière. Mais sa mère avait eu des succès et n’entendait pas renoncer au rôle de femme brillante. Pour moi, je préférais la fille défendue à la mère permise.
Je les rencontrais souvent. Mme Saint-Aignan me regardait avec sympathie. Je n’étais pas très observateur à ce moment-là, pourtant il me parut qu’Isabelle voyait sans plaisir les avances, oh ! bien innocentes, que me faisait sa mère. Un jour, elle sortit un peu brusquement du salon où Mme Saint-Aignan me taquinait sur une comédienne connue dont elle me croyait l’amant. La porte claqua derrière Isabelle.
— Qu’a donc cette petite ? demanda Mme Saint-Aignan.
L’été nous sépara. Les séparations avaient toujours pour moi quelque chose de définitif. Je n’aimais pas assez mes amis d’un jour ou d’une saison pour me souvenir d’eux longtemps. Je ne voulais pas me fixer. J’avais soif de changement. A la rentrée d’automne, je fus entraîné dans des cercles nouveaux.
Ma mère avec qui j’étais dans une grande intimité ne comprenait rien à mon genre de vie. Elle venait à Paris un mois en hiver et nous passions mes vacances ensemble. Elle regardait les choses de l’amour avec sérieux et se méfiait de ceux qui n’y voient qu’un amusement sans conséquence. C’étaient des gens « à qui on ne pouvait se fier », des personnes « qui finiraient mal ». Elle ne les admettait pas volontiers auprès d’elle, comme si l’atmosphère dans laquelle ils se mouvaient lui eût été irrespirable. Et voilà que son fils, le fils qu’elle chérissait et dont elle était fière, ce fils intelligent et réfléchi dont on lui faisait des compliments, qui avait mené à bien des études difficiles, ce fils affectueux, tendre et raisonnable en toutes choses, ce fils avait, de son aveu même, une façon d’être incroyablement légère avec les femmes. Il les recherchait, les prenait et ne les gardait pas. Il en parlait comme de charmantes petites bêtes à qui on distribue alternativement caresses et claques.
Comment ne pas en concevoir de l’inquiétude ? Elle se rassurait en pensant qu’il n’y avait là qu’une crise peu durable. Je m’éprendrais d’une jeune fille dont je ferais ma femme. J’aurais des enfants qu’elle, grand’mère, bercerait sur ses genoux. Mais, pleine de sagesse, voyant que le moment n’en était pas venu, elle gardait le silence.
Cependant je sortais, j’allais dans le monde, dans tous les mondes. Où que je me trouvasse, une seule idée m’occupait : « Y rencontrerai-je la femme que je pourrais aimer ? » Les gens que je connaissais n’avaient rien à m’offrir. A peine échangeais-je avec eux quelques reparties polies et indifférentes. J’étais tout à la chasse, à la chasse de l’inconnue. Le plus souvent un coup d’œil me fixait. Je haussais les épaules.
Mais, parfois, j’apercevais à distance une femme d’une silhouette ravissante. Le cœur battant, je l’étudiais avec plus de soin qu’un médecin n’examine un malade, avec plus de sérieux qu’un avare ne compte son argent. « Elle est grande, me disais-je, elle a la taille ronde et flexible, les épaules larges, le dos plat, les jambes longues. Le cou est élevé, les yeux grands, le visage délicat et plein à la fois, le menton bien dessiné, les lèvres sont fermes, les dents nettes et régulières. Il y a en elle quelque chose de grave qui va jusqu’à l’âme. Ce n’est pas un animal que je veux aimer, mais un être tendre et passionné qui saura pleurer sur mon cœur. » Je m’avançais, presque tremblant. Soudain je m’arrêtais… Qu’avais-je vu ? Les ailes des narines un peu trop remontées. Je reculais, furieux.
Je voulais plaire, je voulais être aimé, et peut-être, j’y réussissais. Mais je jouais « au jeu dangereux » avec le seul désir de gagner la partie. Mon bonheur était dans la lutte et la victoire, non dans la possession.
J’approchais pourtant sans le savoir de la fin de cette période de sécheresse et mon cœur dont je n’avais connu qu’il existait qu’à l’époque déjà lointaine où j’aimais Henriette se réveilla d’un long sommeil. Je le croyais mort avant qu’il eût vécu. Je pensais que, comme tant d’autres, comme presque tous les autres, je n’étais pas fait pour aimer et que l’élan inoubliable de mon adolescence marquerait et l’aurore et le crépuscule de ma sentimentalité. Mais, en secret, avec patience et dissimulation, le sort m’avait préparé péniblement pendant les années arides de ma jeunesse pour un autre destin.
J’imagine un croyant qui a gardé une âme d’enfant pure et naïve. Voici les ténèbres et le silence du Vendredi saint. Il étouffe d’angoisse ; il est seul, sans secours, sans espérance sur la terre qu’emplit l’ombre. Si ces heures se prolongent, il mourra, lui aussi. Le samedi de Pâques, il est debout à l’aube, et regarde monter le soleil dans le ciel. Lorsque le soleil passe le zénith, une vibrante nouvelle traverse les airs. Je veux qu’il en ait désespéré jusqu’au moment de l’entendre. Peut-être cette année-ci Christ est-il définitivement mort, peut-être ne reviendra-t-il jamais. Mais non, le battement solennel d’une cloche lui annonce qu’une fois encore le miracle s’est produit. « Dig, ding, don ! » Christ est ressuscité ! « Dig, ding, don ! » Est-il assez de cloches pour le crier à travers les campagnes et sur les toits pressés des villes ? « Dig, ding, don ! » La lumière est rendue au monde ! Il pleure, mais c’est de joie. « Je suis sauvé ! » dit-il.
A la première palpitation de mon cœur de jeune homme, je me dressai, comme ivre, tenant à peine debout. « Hors du tombeau ! m’écriai-je. Et moi aussi, je vivrai ! »
On voit que je n’avais pas fréquenté impunément les romantiques. Mais je n’avais que vingt-cinq ans et, si éloigné que je sois à l’ordinaire de la prosopopée, un peu de grandiloquence m’était permise en cette occasion.
Revenons au ton simple de ce récit.
Ce n’est pas au hasard que Christ est ressuscité au printemps. Un dieu ne peut renaître qu’avec la verdure. Et c’est en cette même saison trouble et passionnée que je rencontrai Mme de Sées.
A la fin d’une après-midi d’avril, je descendais le boulevard Saint-Germain à la hauteur de la rue des Saints-Pères. Devant moi une femme marchait, ni grande ni petite, mais de si harmonieuses proportions que je la remarquai. Je m’amusais à chercher qui elle pouvait être. La mise simple et correcte disait pourtant, par quelques détails bien importants aux yeux d’un parisien, la province. Des souliers assez forts et mieux faits pour fouler un sentier au long d’un champ de luzerne que l’asphalte d’un trottoir de Paris chaussaient un joli pied. La jupe était un peu trop ample. Le chapeau ne venait pas de la rue de la Paix. Néanmoins le tout était de bon goût et porté avec une distinction indéniable. Je me décrivis à moi-même le visage qui m’était caché. Il devait être jeune, le nez un rien court, presque retroussé, les yeux vifs et spirituels. Et j’eus soudain envie de faire la connaissance de ce nez-là et de voir au-dessus de quelle bouche il se trouvait.
A ce moment, le hasard me vint en aide. Une lettre glissa de la main de l’inconnue et tomba doucement. Je la ramassai, hâtai le pas et abordai la jeune femme en lui tendant ce qu’elle avait perdu.
Étonnée, elle s’arrêta, me regarda, et aussitôt je compris l’absurdité de mes imaginations. La femme qui m’était révélée avait un visage de statue antique, un nez droit, une bouche petite et arquée. Mais cela, je le vis à peine, car ce que j’aperçus tout de suite, et seulement, et que je n’oublierai jamais, ce fut deux grands yeux couleur de pervenche, des yeux pensifs, mélancoliques, qui disaient l’existence d’une âme soigneusement gardée contre les bassesses du monde, des yeux tels qu’on aurait pu les rencontrer au fond d’un couvent, dans une demeure toute baignée de spiritualité, mais qu’on ne s’attendait guère à voir en plein boulevard de Paris dans le tapage des automobiles et des tramways. Le choc qu’ils me donnèrent fut si fort que j’en restai stupide. Le chapeau à la main, incapable de dire un mot, je rendis la lettre à sa propriétaire. J’entendis un « merci, monsieur » prononcé par une voix grave, et déjà je me sauvais dans la plus grande confusion, plein de colère contre moi-même. Il me fallut quelques minutes pour me remettre et je crois bien que je ne repris mes esprits qu’à la hauteur de la rue du Bac. Je me demandai alors avec effroi quelle impression j’avais dû produire. Par ma sottise j’avais laissé perdre l’occasion de faire la connaissance d’une femme qui ne ressemblait à aucune autre.
Je n’oubliais pas les yeux de pervenche ; je les revoyais aux moments les plus inattendus. Parfois, ils me regardaient alors que j’allais m’endormir ; parfois, ils brillaient devant moi quand j’étais dans les bras d’une femme. Cela prit le caractère d’une obsession, tant et tant que je me décidai à faire tous mes efforts pour retrouver la passante dont le souvenir me troublait à ce point. Je me lierais avec elle, elle serait ma maîtresse, car j’étais assuré de jouir d’un bonheur sans pareil auprès de celle qui possédait des yeux si beaux. Me voici donc à arpenter le boulevard Saint-Germain vers la fin du jour ; mon inconnue devait habiter ce quartier puisqu’elle venait jeter ses lettres à la poste qui se trouve presqu’en face de la rue Saint-Guillaume.
Je ne suis pas patient mais je goûtais bien du plaisir au poste d’affût que j’avais choisi. Quel chasseur a connu les émotions que j’éprouvais alors ! Dans ces heures d’attente, mon imagination trouvait à chaque minute à s’occuper le plus agréablement du monde. On se représente celle que l’on aime (oui, déjà !) arrivant vers vous. On l’aborde, elle s’effare ; on a un mot qui, à la fois, la rassure et la touche. Voilà un pas de fait et quel pas décisif ! Enivré de ce premier succès, on devient spirituel (comment ne pas l’être dans un moment pareil !) ; elle sourit, elle est perdue… Ainsi, je m’amusais sur le trottoir du boulevard Saint-Germain, attentif cependant aux mille circonstances de la vie multiple qui m’entourait, causant avec la marchande de fleurs arrêtée derrière sa petite voiture (ah ! puisse l’inconnue me voir — elle me reconnaîtra — au moment où j’achète ce bouquet de violettes !). Les journaux du soir paraissaient. J’apprenais en plein air la victoire de Myrmidon dans le Grand steeple, la chute du ministère prussien, la baisse du Rio-tinto, l’arrivée prochaine de S. M. Édouard VII, et ces nouvelles à cette heure me semblaient toutes sur le même plan et sans intérêt.
Et voici qu’un beau jour, j’aperçus venant à moi la femme aux yeux de pervenche. Je la reconnus aussitôt bien qu’elle ne portât ni la robe ni les souliers un peu lourds de notre première rencontre. A côté d’elle marchait un homme de taille moyenne, sans élégance, le teint coloré, les cheveux fades, l’air bonasse et vide. Il avait une serviette noire sous le bras. Personne (sauf moi) n’aurait cherché à savoir son âge, tant il était insignifiant. Je le mis au hasard entre trente et quarante ans. A la façon tranquille dont il parlait ou se taisait, c’était le mari, il n’y avait pas à en douter.
Je fus presque déçu à le trouver tel. Comment les yeux de pervenche avaient-ils pu se poser sur un homme si peu attrayant ? Mais déjà mon imagination fournissait à la femme que j’aimais mille excuses valables : mariage forcé, convenances de famille, ne pas attrister un père ou une mère âgés qu’un refus tuerait et qui veulent voir avant de mourir leur fille unique (et sans argent) en mains sûres. Et je me représentais la scène où cette Iphigénie avait été sacrifiée, ses larmes à l’autel. Comme elle me paraissait plus grande maintenant !
Cependant je suivais à distance le couple si mal assorti. Il prit la rue des Saints-Pères, la remonta, traversa la rue de Sèvres, enfila celle du Cherche-Midi et finalement disparut sous la porte cochère d’une vieille maison. Au fond d’une vaste cour, deux petits hôtels anciens s’élevaient. Je vis l’homme tirer une clef de sa poche. J’en savais assez.
Je ne m’adressai pas au concierge un louis à la main. D’abord mon caractère est tel que je ne puis supporter un refus et cela m’a causé mille embarras. Ensuite parce que, si enflammé que je fusse, j’étais plein de prudence et de ruse (je n’avais pas lu en vain les Chroniques italiennes de Stendhal). Et, certain déjà que j’étais de revenir dans cette maison en qualité de visiteur et d’invité, je ne voulais pas nous compromettre, elle et moi — comme cet « elle et moi » me plaisait ! — aux yeux de son concierge.
Je rentrai donc, ouvris un annuaire mondain et en moins d’une minute j’y trouvai la notice suivante : « M. Charles de Sées, conseiller référendaire à la Cour des comptes et Madame, née de Clairville, 45, rue du Cherche-Midi. » Tout cela sentait sa Normandie à plein nez.
Les Sées ne devaient pas être très répandus, car il me fallut une quinzaine de jours pour récolter quelques renseignements sur eux.
J’appris qu’ils fréquentaient une bonne compagnie provinciale. On continue ainsi, dans certains coins retirés du faubourg Saint-Germain, une existence assez semblable à celle que l’on mène à Angoulême ou à Bayeux. Des ressources limitées, un certain goût de sagesse aussi, des habitudes anciennes de réserve et presque de timidité, empêchent de se mêler à la société brillante de Paris à laquelle on appartient, mais une fois l’an on se montre pourtant au bal célèbre que donne la veille du Grand Prix, en son bel hôtel de la rue Saint-Dominique, la marquise de la Charité-Plessis, votre cousine. Une partie de l’année se passe dans ce qu’on a conservé de terres ; on y pratique la plus stricte économie. A Paris, on se lie peu ; on se méfie des figures nouvelles ; on reste entre soi, on reçoit rarement, avec une grande simplicité, et la conversation roule plutôt sur les nouvelles de sa province que sur les derniers scandales du monde parisien.
Tous ces détails que me donna un camarade m’enchantèrent. Je me persuadai qu’en vertu d’une harmonie préétablie, Mme de Sées avait été créée pour être aimée par moi. En elle, aucune dissipation, aucune frivolité. L’amour qu’elle n’avait jamais connu serait le drame de sa vie. Elle y apporterait la ferveur d’âme, si rare à Paris, mais qui anime encore des existences provinciales plus recluses. J’étais un homme maintenant, je pouvais affronter les orages de la passion.
Me voici donc pénétrant lentement dans un monde nouveau et assez fermé. Mon ami me guidait. J’allai à des matinées dansantes où je ne connaissais personne ; j’entendis de la médiocre musique de chambre. Je bus du mauvais thé chez de vieilles dames qui avaient des terres entre Caen et Lisieux. J’acceptais ces corvées d’une humeur excellente. La poursuite et ses imprévus m’amusaient. Jamais je ne m’étais donné tant de mal pour la conquête d’une femme.
Ma patience fut enfin récompensée. Je me trouvai un soir vers sept heures en face de Mme de Sées dans le plus désuet des salons de la rive gauche. Elle était assise près d’une fenêtre ouverte sur un étroit et calme jardin. Une branche de lilas montait jusqu’à elle, lui offrant ses fleurs. Des oiseaux se pourchassaient dans les arbres que traversaient les derniers rayons du soleil. Où étions-nous ? Pas à Paris, bien sûr.
Je savais ce que je voulais dire à Mme de Sées. J’y avais pensé cent fois ; ses réponses même je les avais prévues, et mes répliques triomphantes. Elle leva sur moi ses beaux yeux pervenche… et je ne retrouvai pas un mot de ce que j’avais préparé. Mais peut-être mon embarras me servit-il mieux auprès d’elle que ne l’eût fait un excès d’assurance. Toujours est-il que, quand nous nous quittâmes, j’avais la permission d’aller la voir la semaine suivante.
Un mois plus tard, à force d’ingéniosité et de désir de plaire, j’étais devenu intime dans la maison. Je parlais à M. de Sées de la carrière diplomatique qui serait la mienne ; j’étais pour lui un jeune homme distingué et d’avenir.
Avec Mme de Sées, où en étais-je ? Je gagnais lentement du terrain, mais l’instinct, mon seul guide, m’avertissait qu’il ne fallait rien brusquer et qu’une parole imprudente pouvait me perdre.
Du reste, pourquoi me hâter ? J’avais un délicieux plaisir à voir presque quotidiennement Mme de Sées et à faire peu à peu sa connaissance plus approfondie. En elle aucune dissimulation, aucune feinte, aucun désir non plus de jouer un personnage, de s’adapter au ton et aux manières à la mode dans telle ou telle société. Elle restait elle-même sans effort, franche, saine, modérée, avec un caractère à ne prendre au sérieux que les choses morales et un penchant marqué pour la vie spirituelle. Pieuse, d’une piété agissante, mais qui ne s’affichait point, elle pensait à Dieu chaque jour, mais n’en parlait pas à chaque heure. Elle était aussi naturellement bonne qu’elle était belle, c’est-à-dire avec simplicité, sans chercher à en tirer avantage et sans en concevoir de l’orgueil. Un peu de gravité dans l’esprit ne l’empêchait pas d’être gaie et son rire, s’il était rare, en acquérait plus de prix.
Elle avait épousé toute jeune Charles de Sées de douze ans plus âgé qu’elle. Les familles étaient anciennement liées et le mariage arrangé depuis longtemps. Le ménage eut une seule fille, Geneviève, que je ne voyais guère à Paris.
Les Sées avaient un cercle assez restreint de relations et il n’était pas facile d’y être admis. J’eus bientôt une alliée en Mme de Sées qui avait pris du goût pour moi. Il ne s’agissait dans son esprit que d’amitié, cela va de soi, mais enfin je lui plaisais, elle aimait à me voir. Elle me trouvait très « gentil » et me le disait. Mais je n’étais pas un bon catholique, je n’étais même plus catholique du tout. Ah ! cela, c’était affreux ! Un garçon bien élevé, fils d’une mère pieuse, et qui n’allait pas à l’église ! Se perdre ! et donner un mauvais exemple !
— Je serai votre catéchumène, disais-je.
Sur ce point, on ne plaisantait pas. Mme de Sées parlait sérieusement de ces choses sérieuses. Et cependant ses beaux yeux pervenche s’attachaient sur les miens pour mieux me convaincre. Je ne voulais pas laisser tomber une aussi agréable discussion et faisais quelques objections de doctrine. Elle les réfutait sans peine, car peut-être n’en voyait-elle pas la portée. Puis, elle m’enveloppait d’un regard plein de bonté et disait :
— Votre heure viendra, je n’ai pas d’inquiétude à votre sujet.
Savait-elle pourquoi j’étais près d’elle ? Sans doute. Est-il une femme si pure, si droite soit-elle, qui s’y trompe ? Mais elle ne voyait pas le danger et goûtait le plaisir, à ses yeux innocent, de m’avoir pour ami. Je ne l’entraînerais pas dans des sentiers dangereux, c’est elle qui me ramènerait dans le droit chemin. Elle eût été bien étonnée si je lui avais dit que l’amitié n’était pas possible entre une femme comme elle et un homme comme moi. Mais, je ne le lui disais pas. Le temps n’était pas venu de l’éclairer sur les mouvements secrets de son cœur.
Je prolongeais ainsi ce moment plein de charme. Notre intimité grandissante m’apportait chaque jour des joies nouvelles. Je m’interrogeais, ravi. Était-ce bien l’amour que je ressentais ? — Oui, je ne pouvais m’y tromper. C’en étaient les premières et irrésistibles atteintes. Je notais les symptômes qui confirmaient mon infaillible diagnostic : une fièvre légère colorait les rêveries auxquelles je m’abandonnais. Parfois mon cœur battait plus vite ; parfois j’oubliais Mme de Sées pendant quelques instants ; lorsque ma pensée revenait à elle, c’était avec la force d’un torrent qui déborde ses digues. Je la pressais sur ma poitrine, je la couvrais de baisers, je voyais ses yeux, ses yeux inoubliables, se noyer de bonheur.
J’étais si sûr de l’aimer, j’étais si sûr qu’elle serait un jour à moi, que je rompis avec ma maîtresse, — rompre n’est pas le mot juste, on ne rompt que des liens, il n’y en avait pas ici, des habitudes agréables, rien de plus — et je commençai à connaître ce dangereux état de chasteté si propre à enflammer l’imagination. J’eus enfin des visions voluptueuses comme saint Antoine dans son désert.
Je ne laissai rien paraître à Mme de Sées de l’ardeur qui était en moi. Nous avions de longues conversations dont pas une phrase, pas un sous-entendu ne pouvait l’alarmer. Qui nous eût écoutés sans nous regarder nous eût pris pour les meilleurs amis du monde. Charles de Sées entrait-il dans la chambre où nous nous trouvions, pas le moindre embarras ; nous continuions notre propos sur le même ton sans être obligés d’y changer un mot. Quelquefois la gaîté nous prenait, une gaîté quasi-enfantine. Ah ! nos bons rires d’alors, nos bons rires de camarades !
Eh bien, au même temps, cette camarade si chère, cet être pur et droit qui se livrait naïvement, je déployais une ruse diabolique pour le faire tomber dans mes bras. All’s fair in love and war, dit un proverbe anglais. Cet attentat froidement combiné m’apparaissait — ô magie de la passion ! — comme la chose la plus glorieuse du monde, car l’amour est une guerre, plus perfide et traîtresse qu’aucune autre, cruelle comme toutes les guerres, et que l’on mène sans pitié contre qui ? non contre un ennemi prévenu, armé et fortifié, mais contre une aimable femme chez qui l’on dîne, avec qui l’on vit sur le pied de paix, que l’on comble d’égards et de prévenances. Je paraissais un ami loyal, et cependant je ne cessais de dresser des plans, de tendre des pièges, de chercher une tactique qui, poursuivie avec une patiente et implacable rigueur, amènerait la bonne, et pieuse, et chaste Madeleine de Sées, nue dans mon lit.
L’été vint, il ne nous sépara pas. Les Sées partirent pour la propriété des parents de Madeleine entre Bayeux et la mer. Je découvris, aussitôt, que des amis m’appelaient à Arromanches voisin. Ma mère, un peu fatiguée, ne voulut pas me rejoindre sur une plage normande et froide. Elle m’attendrait, la seconde quinzaine d’août, à la maison. J’eus un instant de remords en pensant que je la privais, déjà âgée, de nos vacances en commun. C’était la première fois que je lui faussais compagnie. Mais j’étais emporté dans une autre direction ; je suivis Mme de Sées.
Pas un jour qui ne nous réunît, au bord de la mer couleur d’ardoise sur laquelle fuyaient les voiles blanches des bateaux de Port-en-Bessin, ou sur les falaises dans les hautes herbes qu’inclinait le vent, ou chez ses parents en pleine campagne. Elle aimait à marcher ; nous faisions souvent à pied par les chemins bordés de haies la lieue qui sépare Orville d’Arromanches.
Il y avait près de trois mois que je connaissais Mme de Sées et tour à tour je m’émerveillais des progrès de notre intimité et me lamentais des lenteurs et des atermoiements que subissait mon amour.
J’avais pourtant franchi une difficile étape : je ne cachais plus mes sentiments. Un soir, avant de quitter Paris, une occasion s’était offerte dont j’avais profité. Mme de Sées, qui ne savait pas encore que je la retrouverais à Arromanches, montrait un peu de tristesse à l’idée de la séparation. Dans la pièce même où son mari et des amis jouaient au bridge, je me mis à parler de l’amour sur un ton mi-plaisant, mi-sérieux. Je disais qu’on ne sait comment il vient aux gens, et parfois d’une façon si soudaine qu’on n’a, à la lettre, pas le temps de faire « ouf ! »
— Comme vous avez de l’expérience ! interrompit Mme de Sées.
— Il suffit d’une fois, repris-je, pour devenir très savant. Si cela vous amuse, je vous raconterai comment cela m’est arrivé. J’ai suivi un jour une femme dans la rue — (Je note ici que nous n’avions jamais causé de cette première rencontre. J’entendais choisir mon heure. Surprise lorsque je lui avais remis la lettre boulevard Saint-Germain, Mme de Sées ne m’avait même pas regardé. Souvent, plus tard, je la taquinai à ce sujet car elle croyait maintenant m’avoir reconnu aussitôt que je lui avais été présenté. Ces grandes discussions finissaient par des baisers). — Et je m’amusais à imaginer quelle pouvait être sa figure. Tout à coup, désireux de voir si la réalité répondait à mes imaginations, sous un prétexte quelconque, je l’abordai. Je découvris alors un jeune visage si beau et des yeux — ils avaient vraiment la couleur des vôtres ! — si touchants que je perdis contenance. Je ne sus que dire et m’enfuis. Voilà comment l’amour me prit en pleine rue dans le tapage des automobiles et des tramways.
Mais Mme de Sées sans vouloir s’arrêter à cette dernière phrase fit un retour en arrière et me demanda :
— Sous quel prétexte abordez-vous les femmes dans la rue, mauvais garçon que vous êtes ?
— Et le hasard, dis-je, le comptez-vous pour rien ? Les femmes n’ont-elles pas un mouchoir, un sac, un paquet quelconque qui peut tomber ? N’arrive-t-il pas qu’on va mettre son courrier à la boîte et qu’une lettre vous glisse de la main devant le bureau de poste ?
Mme de Sées n’était pas assez maîtresse d’elle-même pour cacher sa surprise. Elle resta immobile, les yeux fixés sur moi, sa jolie bouche bée, attendant ce que j’allais dire.
Mais je n’eus garde d’ajouter un mot. Je tournai court, me levai et pris congé d’elle, lui laissant matière à penser pour le reste de la soirée, et plus sans doute.
Les jours suivants, j’évitai toute allusion à ce que j’avais dit. Mais le temps aidant, j’y revins. N’y aurait-il pas eu hypocrisie chez Mme de Sées à feindre d’ignorer mes sentiments et duplicité de ma part à prétendre les tenir secrets ? Pour faire l’aveu de mon amour, je trouvais habile de professer la pureté, que rien ne saurait souiller, de Mme de Sées. Elle pouvait m’écouter sans risques, hélas !
A l’aide de ces sophismes ingénieux, nous eûmes bientôt pour thème presque unique de nos conversations ce qui, au début de notre liaison, semblait devoir rester toujours caché. Quelle est la femme qui soit insensible à la grandeur de l’amour qu’elle inspire ? Elle voit son image transportée dans un pays merveilleux qu’elle n’a jamais habité et où, croit-elle, jamais elle ne pénétrera. Elle le visite ainsi, en pensée seulement et, imagine-t-elle, impunément. On lui offre un concert délicieux qui peu à peu gagne l’âme, puis le cœur.
Il va de soi qu’au début mes discours étaient, en effet, tels que la femme la plus honnête eût pu les entendre. Mais bientôt des propos plus profanes s’y glissèrent ; on entrevit sous le voile qui les recouvrait encore l’ardeur de sentiments tout terrestres. Mais cela par une pente si douce, si insensible que l’on n’aurait su à quel moment intervenir pour m’arrêter.
Je m’étonnais de mon adresse à un début dans cette carrière difficile. Mais, adolescent encore, n’avais-je pas découvert déjà, quand j’étais épris d’Henriette, que l’amour est une exaltation de l’être et qu’au lieu de m’abaisser, il m’élevait au-dessus de moi-même. Je trouvais alors, comme un grand capitaine à l’heure critique, l’ingéniosité nécessaire, l’audace, un coup d’œil plus sûr.
Que de surprise pourtant à voir se confondre en moi des états que je croyais contradictoires ! J’aimais à la folie et je calculais avec froideur ; je paraissais être dans les nuages et cependant, pour tout ce qui pouvait me servir, j’agissais de la façon la plus précise, la plus efficace. Je multipliais les attaques qui me donneraient un cœur qu’il fallait conquérir d’abord. Il est des femmes pour qui un geste mis en sa place vaut les plus belles déclarations. Mme de Sées n’était pas de celles-là ; je ne la gagnerais que par le sentiment.
Transporté de bonheur à la voir faiblir peu à peu, je ne perdais pas mon sang-froid. Je surprenais un regard qui se posait tendrement sur moi, un sourire heureux. Elle avait des moments de gaîté et d’éclat qui étonnaient jusqu’à son mari, homme doué de peu d’esprit d’observation. A d’autres jours, renfermée en elle-même, elle paraissait éloignée de cent lieues. Je notais avec soin ces passages subits de la joie à la tristesse ; je savais que l’une et l’autre la rapprochaient également du but où nous nous rencontrerions.
Il y eut entre nous une scène assez étrange et qui éclaira soudain la route où nous étions engagés. Quand Mme de Sées venait en voiture à Arromanches, elle amenait sa fille Geneviève qui avait alors cinq ans. A Paris, je la voyais à peine ; elle me regardait d’un œil méfiant. En vacances, je m’efforçai de la gagner et j’y réussis vite, bien qu’elle conservât toujours envers moi un rien de coquetterie féminine. Les jeux sur le sable, les bains en commun, firent de nous de grands amis. Mme de Sées semblait contente de me voir avec sa fille. Dans les longues heures que nous passions sur la plage, l’enfant ne cessait d’aller d’elle à moi et de moi à elle, et je me plaisais à imaginer qu’elle était chargée de porter des messages muets de l’un à l’autre.
Un jour, courant après elle, je la pris et l’enlevai de terre.
— Gagné, m’écriai-je, je t’embrasse !
— Non, non, dit l’enfant riant et se débattant, je ne veux pas.
Je l’embrassai pourtant sur ses bonnes joues fermes qui avaient le goût du sel marin. Elle m’échappa et s’enfuit vers sa mère qui la serra contre elle et la couvrit de baisers. Il me parut que Mme de Sées y mettait comme de l’emportement et la pensée me vint tout à coup qu’elle cherchait sur le visage de sa fille la trace encore fraîche de mes lèvres.
J’accompagnai Mme de Sées jusqu’à Orville, mais, tout au long du trajet nous restâmes silencieux.
Cette scène équivoque et passionnée, je ne l’oubliai pas et je crus sentir qu’elle vivait aussi dans la mémoire de Mme de Sées. Dès ce jour, nos rapports changèrent. Nous ne nous regardions plus de la même façon ; nous étions comme les complices d’une même faute. Mme de Sées d’un caractère si égal pourtant avait sans raison des moments d’impatience. Parfois, elle me brusquait ; repentante aussitôt, elle venait à moi avec tant de douceur et de soumission que le cœur soudain me fondait de tendresse. Nous éprouvions le besoin d’être plus près l’un de l’autre, d’établir entre nous un contact physique, si innocent fût-il. Madeleine — c’est à partir de ce moment que je l’appelai ainsi, lorsque nous étions seuls — laissait un instant sa main dans la mienne. J’y appuyai plus longuement mes lèvres en la quittant. Elle me frôlait, quand elle passait près de moi, par inadvertance, sans doute ; mais, à travers la robe, je sentais sa hanche effleurer ma hanche, et je frémissais.
Il y eut une soirée chez des voisins. Nous y allâmes. J’avais dansé déjà avec Madeleine, mais cette fois-ci j’imaginais la prendre dans mes bras pour la première fois et j’eus le courage de le lui dire. Elle s’arrêta, je la vis chanceler. Je la conduisis près d’une fenêtre ouverte sur l’ombre.
— Philippe, dit-elle, ne continuez pas… Je vous aime comme une sœur aime son frère. Rien n’est plus beau au monde. J’ai tant d’amitié pour vous, plus peut-être qu’il n’est permis, mais de l’amitié seulement… Je ne puis vous écouter !
Elle divaguait ainsi, et moi, penché sur elle, touché jusqu’aux larmes par l’accent de ses paroles, je l’assurais que je serais toujours tel qu’elle désirait que je fusse.
J’étais sincère. Et je l’étais aussi deux jours plus tard dans une situation bien différente où j’agis contrairement à ce que je venais de promettre. Mais que sont les paroles entre deux êtres qui s’aiment ? Malgré leurs serments de sagesse, leurs corps continuent à se désirer et veulent s’unir.
Le lendemain Madeleine ne descendit pas à Arromanches. Je lui en voulus. L’après-midi, je montai jusqu’à Orville. Je n’y rencontrai que Charles de Sées revenant de la pêche. Sa femme un peu souffrante garderait la chambre. Le jour suivant, je trouvai Madeleine sur la terrasse devant la maison avec sa mère et sa fille. Elle me parut fatiguée ; ses yeux étaient plus beaux d’être légèrement cernés. La conversation à trois fut languissante. Au coucher du soleil, Mme de Clairville déclara que craignant la fraîcheur et la rosée elle rentrait avec la petite Geneviève. Nous restâmes seuls en un pesant tête-à-tête. Des domestiques passaient autour de nous. On entendit la voix de M. de Sées qui, de la chambre où il travaillait à un rapport pour la Cour des comptes, demandait à sa femme comment elle se portait.
J’étais silencieux, mais prolongeai volontairement mon silence, car je savais que Madeleine ne pouvait le supporter et, momentanément, pour des raisons obscures mais puissantes, je la considérais comme une ennemie et voulais la faire souffrir. Tel est l’impitoyable va-et-vient de l’amour entre la tendresse et la cruauté. Seuls ceux qui ne l’ont pas connu imaginent des amants élégiaques qui ne soupirent que de bonheur. La vie de ceux qui aiment est, au contraire, sans cesse heurtée, la joie et la douleur s’y mêlent étrangement, le désir de plaire et la volonté de blesser se succèdent en une minute, et le visage véritable de l’amour, si on l’entrevoit sous le masque qu’il porte, ce pauvre visage, tout éclairé d’un ravissement surhumain, est sillonné par les rides profondes qu’y creusent chaque jour l’inquiétude, la jalousie et le souci.
Un mot de Madeleine tout à coup m’apaisa.
— Voulez-vous faire quelques pas avant le dîner ? dit-elle, en me regardant avec douceur.
Elle se leva et je la suivis. J’étais heureux maintenant. Le monde m’appartenait. Il me semblait qu’après avoir perdu Madeleine, je venais de la regagner pour toujours. Pourtant que s’était-il passé ? Rien, un regard qui m’était cher s’était posé sur moi. Il n’en faut pas davantage.
Nous prîmes une allée qui menait à un bouquet de hêtres. Lorsque nous y arrivâmes, la lumière sous les arbres était déjà plus rare. Le tronc d’un bouleau apparaissait clair au milieu du taillis.
— Les nymphes ont habité jadis ce bois, dis-je. Elles le hantent encore à l’heure où tout est calme et parfois y dansent à la clarté des étoiles. Restons ici et peut-être les verrons-nous surgir dans le crépuscule qui s’obscurcit. Mais il ne faut pas parler.
Nous nous assîmes au bord du chemin. A quelque distance, les lumières s’allumaient dans la maison. Des brouillards légers flottaient sur les prairies ; on entendait au loin le meuglement d’une vache qui voulait rentrer à l’étable.
Le beau visage de Madeleine peu à peu se noyait d’ombre. Elle portait une robe de mousseline blanche si légère que, clignant des yeux, je m’imaginais qu’elle était vêtue d’une de ces brumes qui se levaient lentement de la terre humide. Je me plaisais ainsi à m’halluciner et l’hallucination à laquelle je me prêtais devint si forte que j’oubliai bientôt où je me trouvais, dans quel parc de quelle demeure, et qui j’étais, et qui était la femme assise près de moi dans sa robe tissée des vapeurs du soir. Changé en un jeune satyre, je guettais l’arrivée de la nymphe que je désirais. Cette nymphe, soudain, je la découvris à côté de moi presque immatérielle. Rêvais-je ?… Je tendis vers elle une main hésitante ; je la touchai — elle avait un corps vraiment ! elle n’était pas un fantôme créé par mon imagination ! — et dans un mouvement irrésistible, je m’en emparai. A la seconde où Madeleine fut dans mes bras, je revins à la réalité. C’était bien son cou délicat que je couvrais de baisers entrecoupés par ces seuls mots :
— Je t’aime ! je t’aime !
La surprise du choc, sa violence, l’empêchèrent d’abord de se défendre. Puis, gagnée par la douceur des caresses inattendues, un instant elle s’oublia et mes lèvres s’unirent aux siennes. Mais, aussitôt, elle s’arracha à mon étreinte.
— Qu’avez-vous fait, Philippe ? dit-elle sans colère, mais sur un ton qui me glaça.
J’étais à ses pieds, la suppliant de me pardonner.
— Il n’y a que moi de coupable, continua-t-elle. Vous êtes libre, je ne le suis pas. Maintenant tout est fini.
Le sens de ces mots terribles « tout est fini », je ne le compris que les jours suivants. Je ne devais plus voir Madeleine seule. La présence de sa fille ne lui paraissant pas suffisante, elle faisait en sorte que son mari ou sa mère fussent en tiers avec nous. Elle descendit moins souvent à Arromanches.
Quelques jours passés ainsi suffirent à me faire perdre la raison. Loin d’elle, j’accusais Madeleine tour à tour de froideur et de coquetterie. Si elle m’avait aimé, elle aurait pardonné le mouvement de folie auquel j’avais cédé. A qui donc allait l’amour que je ressentais enfin dans sa grandeur ? à une femme incapable d’en comprendre la beauté et qui n’était faite que pour de médiocres bonheurs bourgeois. Eh bien, qu’elle vécût entre son mari, personnage ridicule en somme, et sa fille ! Ma place n’était pas près d’elle ! A d’autres moments, je pensais qu’elle s’était amusée de moi. Elle avait voulu entendre, pour s’en moquer sans doute, le langage de la passion. Maintenant qu’elle avait eu les accords désirés, elle arrêtait un concert qui ne l’intéressait plus. Détestable jeu ! Je méditais mille projets contraires : il faudrait bien qu’elle me reçût seul ; je lui dirais alors ce que j’avais sur le cœur. Non, mieux, je partais sans la revoir… Ou bien, je prenais une maîtresse éclatante avec qui je m’affichais sous ses yeux… Et, d’autres fois, je ne pensais qu’à la gagner encore à force de tendresse et de soumission. Vivre dans son ombre, ne la quitter jamais, je ne demandais rien de plus.
J’allais ainsi d’une idée absurde à l’autre lorsqu’une lettre arriva qui mit fin à mes hésitations.
Une vieille amie de la famille m’écrivait que la santé de ma mère lui causait quelques inquiétudes. Elle me conseillait de ne pas tarder à rentrer ; ma présence redonnerait, sans doute, des forces à la malade. Le ton de cette lettre trop volontairement rassurant m’inquiéta, au contraire de ce qu’en attendait ma correspondante. Je lus entre les lignes plus qu’elle ne voulait en cacher peut-être. Je vis ma mère perdue et décidai de la rejoindre sans un jour de délai.
J’avais un train du soir à Bayeux ; j’envoyai mes valises à la gare par l’omnibus de l’hôtel, car j’avais résolu de passer à Orville et de m’y rendre à pied.
J’aime tant la marche et le plein air qu’il est bien peu de chagrins qui ne soient adoucis par leur influence salutaire. Au milieu de ma course, déjà, j’étais plus rassuré : ma mère avait une santé parfaite ; elle pouvait être souffrante, elle n’était pas malade ; je la garderais de longues années encore. Tranquille de ce côté, je me tournai vers Madeleine. Je le fis avec un rare sang-froid ; j’examinai notre situation de la façon la plus détachée, comme s’il se fût agi de quelqu’un d’autre. J’avais douté de Madeleine et, lorsque le doute s’insinue dans un cœur passionné, il y fait des ravages. Il m’apparut que ce départ inopiné me fournissait le moyen d’avoir une certitude et que, grâce à lui, je pourrais forcer Madeleine à ne me rien cacher. Il fallait agir brusquement et observer avec une lucide attention l’effet de mes paroles.
La pluie me tenait compagnie sur le chemin, et j’y prenais plaisir. A Orville, je trouvai Madeleine au salon. Elle était debout près d’un secrétaire à deux corps, occupée à chercher quelque papier dans un tiroir. Sans se déranger de sa besogne, elle me reçut aimablement comme à son ordinaire. Mais moi, m’étant placé entre elle et la fenêtre de façon à la voir en plein jour, je lui dis en appuyant sur les mots et du ton le plus indifférent qui se pût :
— Je viens vous dire adieu ; je quitte Arromanches ce soir et n’y reviendrai pas.
Elle chancela sous le coup ; ses yeux inquiets m’interrogèrent pour savoir si je voulais la mettre à l’épreuve et si, une fois de plus, je jouais un jeu cruel. Mais je m’endurcis ; je n’en avais pas fini avec ma victime. Le souvenir était encore vivant de tant d’heures déchirées vécues dans la solitude, de mes doutes, de mes tourments et je continuai :
— Soyez heureuse, je ne troublerai plus la tranquillité qui vous est chère.
A voir sa pâleur, son désarroi, son regard surtout, ce regard désespéré de quelqu’un qui se noie et qui cherche si personne n’est là pour le sauver, je mesurai enfin la place que je tenais dans sa vie. Je l’emplissais tout entière et Madeleine, incapable à cette heure de dissimuler, montrait à nu son cœur qui ne battait que pour moi. Elle restait là, presque inconsciente, ne me voyant pas. Pourtant elle dit encore :
— Partir !…
J’étouffais de pitié. D’un mot je la secourus :
— Ma mère est malade…
A peine avais-je parlé que Madeleine, oubliant sa souffrance pour ne penser qu’à la mienne, vint à moi :
— Comme je vous plains ! mon pauvre Philippe.
Elle me prit une main et la garda dans les siennes maternelles. J’étais faible et sans courage. Je désirais être consolé. Et au même temps je frémissais de désir à sentir si proche le corps de Madeleine… Je me repris et d’une voix qui tremblait un peu, je dis seulement :
— Ah ! que j’ai de la peine à vous quitter !
Et je m’enfuis.
Ma mère s’était arrangée de son mieux pour me recevoir.
Au premier coup d’œil je compris qu’on ne m’avait pas alarmé en vain ; sa bonne et pâle figure était ravagée par les souffrances d’un mal invisible ; et dans le regard doucement attaché sur moi, je lisais une interrogation : « Qu’est-ce qu’il pensait de sa vieille maman, ce grand garçon qui arrivait là presqu’à l’improviste ? »
Le grand garçon fit du mieux qu’il put et s’écria avec courage :
— Quand on a une mine comme ça, on n’effraie pas les gens !
Et deux gros baisers sonnèrent sur des joues amaigries.
Commença une vie dont l’amère monotonie était faite de douleur pour ma pauvre maman, d’inquiétude pour moi, et de mensonge de moi à elle. Je la savais perdue, une tumeur qui ne pardonne pas la minait plus profondément chaque jour. Cependant, nous faisions, avec une gaîté feinte, mille projets. Une fois la crise passée (ce n’était qu’une crise), nous partions vers la fin de l’automne pour le midi ; le soleil rendrait vite des forces à la convalescente. Il faudrait acheter une petite maison sur la côte provençale ; à l’âge de ma mère, les brouillards de l’hiver et la froidure de nos campagnes ne lui valaient rien. Ainsi parlions-nous. Mais ses yeux démentaient les paroles et je croyais entendre ces mots qui ne pouvaient être prononcés :
— Je sais bien que tu me trompes, mon cher garçon, mais je te suis reconnaissante de tes mensonges.
La présence continuelle d’un être qui est torturé dans sa chair ne vous laisse point de paix et vous met le cœur à vif. On voudrait s’endurcir contre l’inévitable ; par moment, on songe même à fuir, puisque nous savons que la mort est nécessaire et que nous y sommes tous condamnés. Pendant ces longues heures de veille, je me souvenais d’une boutade que j’avais dite un jour : « Être garde-malade, c’est une profession et ce n’est pas la mienne. Je n’aime point le spectacle de la souffrance, tonique pour ceux à qui de rudes contrastes sont nécessaires ; je n’ai pas besoin pour trouver du plaisir à ma vie de regarder le malheur des autres. »
Mais il s’agissait de ma mère dont la douleur usait l’un après l’autre les liens qui l’attachaient à ce monde ; c’était elle, si choyée toujours, si entourée, qui allait entreprendre le voyage que chacun fait seul et dont personne ne revient. Comment la quitter à ce moment ? Impuissant à la secourir, j’adoucissais pourtant sa grande misère ; je lui donnais le reste de bonheur qu’elle pouvait goûter encore : avoir son fils à son chevet avant de fermer les yeux pour s’assoupir, le retrouver là quand elle les rouvrait un peu plus tard.
Les jours passaient lentement.
Je recevais une lettre quotidienne de Madeleine. Ce cœur généreux ne supportait pas que j’eusse de la peine loin d’elle. Il fallait que, même à distance, elle me soutînt. Elle trouvait là l’occasion permise de me montrer la place que je tenais dans ses pensées et je sentais bien, malgré la réserve voulue, qu’elles m’appartenaient toutes. Madeleine y mettait, sans le savoir certes, une tendresse infinie. C’étaient des caresses lointaines d’âme à âme, mais, suivant les heures, je les transposais sur un plan plus terrestre. Elle avait quitté Orville « où elle laissait tant de souvenirs chers » ; octobre la ramènerait à Paris « où elle m’avait connu ». J’étais présent partout. Il fallait que notre séparation, disait-elle aussi, nous fût une occasion de méditer sur la voie dangereuse que nous avions prise. Les desseins de Dieu étaient visibles ici, Il voulait nous sauver. A l’avenir, nous devrions nous abstenir de la moindre allusion à des sentiments défendus. Et cependant ce lui était une occasion d’en parler encore. Je voyais qu’elle se surveillait en m’écrivant ; elle s’efforçait de me donner l’idée que le calme s’était fait en elle, mais, parfois, un tournant de phrase, un mot, montraient que le feu brûlait sous la cendre où elle cherchait à l’ensevelir. Et comment me cacher sa tristesse ?
Dans mes lettres qu’elle n’était pas seule à lire, sans doute, je ne lui parlais que de ma mère et des heures affreuses que je passais loin d’elle (j’allais jusqu’à cette équivoque !). A certains jours où la vie que je menais avait raison de mes nerfs, je me désespérais du silence auquel j’étais contraint. Elle croirait que je l’oubliais (les hommes sont inconstants, était un de ses thèmes favoris ; elle contrastait l’amour éternel de Dieu aux amours changeantes de ses créatures), et peu à peu s’éloignerait de moi. A cette pensée, je frémissais de fureur impuissante. Et voilà qu’un matin où je traversais une de ces crises, le courrier m’apprit que M. de Sées avait été envoyé à Bordeaux pour une inspection. Sans réfléchir un instant, j’écrivis à Madeleine une lettre passionnée où je lui disais avec une netteté effrayante que, quoi qu’elle pensât, quoi qu’elle fît, je l’aimerais toujours et qu’il n’était ni en son pouvoir ni au mien de détruire le sentiment qui nous unissait.
Cette lettre resta sans réponse. Mais le ton de Madeleine devint plus triste encore. Je me désolais. Que faire ? Je ne pouvais plus écrire maintenant en cachette ; j’aurais voulu lui demander pardon, l’assurer que je serais au retour tel qu’elle le désirait. Je me rongeais de souci.
Et cependant, à côté de moi, un grand drame muet se hâtait lentement vers sa fin dans la douleur et dans l’angoisse. Sous l’étreinte de la souffrance ma mère faiblissait. Elle prenait des stupéfiants qu’elle supportait mal. Elle avait de longues heures de somnolence. Lorsqu’elle se réveillait, elle me parlait avec clarté de ses affaires qu’elle avait mises en bon ordre ; elle me donnait d’utiles conseils. Quelle que fût sa faiblesse, je répondais toujours qu’il serait temps de causer de cela plus tard, que rien ne pressait. J’étais accablé par l’obligation de mentir jusqu’au bout et de sourire alors que le cœur me manquait.
Elle mourut dans mes bras après une longue agonie. Je la menai au cimetière où reposaient les miens. J’étais sans forces, je me sentais seul au monde ; j’avais besoin de la tendresse de Madeleine. Je partis pour Paris le lendemain de l’enterrement.
J’avais écrit à mon amie un mot sur une feuille volante jointe à la lettre que tous pouvaient lire, la suppliant de venir l’après-midi chez moi. Dans l’état où j’étais, elle comprendrait que je ne pouvais la voir en présence d’indifférents.
Des lettres m’attendaient sur mon bureau de la rue de Commailles ; il n’y en avait point de Madeleine. Je m’engourdis, les pieds au feu, dans mon cabinet de travail. Les livres me regardaient comme un étranger et n’avaient rien à me dire. Plus tard, passant devant une glace, j’aperçus mon visage. Je ne l’avais pas vu depuis longtemps, on peut se raser chaque matin devant un miroir et ne pas se connaître. Tout à coup je m’apparus et m’étonnai : j’avais une expression qui m’était étrangère. J’approchai, les yeux étaient creusés, le teint brouillé, des rides plus profondes se marquaient au front. Comment Madeleine me trouverait-elle ? Je haussai les épaules. Cela n’avait aucune importance, rien n’avait de l’importance. J’occupai le reste de la matinée à mettre mes papiers en ordre. Je répondis à des lettres d’affaires. Je faisais tout machinalement, le cerveau vide.
Après déjeuner, je m’étendis sur le divan et pris un journal. Il me tomba des mains, je dormis d’un sommeil lourd.
Un coup de timbre me réveilla en sursaut. Je courus à l’antichambre. Personne ; j’avais rêvé. Il était trois heures. Madeleine ne viendrait pas.
Pourquoi viendrait-elle, après tout ? Elle restait avec Dieu qui emplissait ses pensées. Qu’avait-elle besoin de moi ? Qu’étais-je pour ce regard qui se perdait dans l’éternité divine ? Un accident insignifiant, négligeable. Je réfléchissais ainsi, le front appuyé à la fenêtre, regardant les arbres dénudés du jardin appartenant à l’hôtel Carafa. Ma pensée se détachait peu à peu du monde où j’avais vécu. Faut-il donc se torturer pour la possession d’une femme ? N’est-il pas des pays où l’on ignore les passions stériles qui nous déchirent ? Déjà je faisais le projet de quitter l’Europe, ses brouillards, ses pluies, son agitation. L’Asie, colosse immobile, de loin me souriait. Des songes à l’ombre des platanes où passent parfois des femmes voilées, une volupté sans fièvre, une vie sans combat, rempliraient les jours monotones et toujours nouveaux de mon bonheur. L’image de ma petite amie Isabelle m’apparut. Avait-elle encore ce visage étroit sous les cheveux dorés ? Elle me plaisait naguère. Le seul nom de Constantinople prononcé par elle m’avait emmené jusque sur la rive d’Asie. Qu’était-elle devenue ? Par quelle fatalité ne pouvais-je rester attaché à ceux près de qui j’étais heureux ?
Quatre coups sonnèrent à la chapelle des Pères de la mission. Je laissai Isabelle et le Bosphore, je rentrai en Europe pour mettre une bûche dans la cheminée.
J’étais surpris de me trouver si calme. J’en compris la raison : je n’attendais rien. Seule l’incertitude est anxieuse. Or une suite de raisonnements glacés avaient mis le doute en fuite.
Si Madeleine m’aimait, m’étais-je dit, qui aurait pu la retenir ? Mais, en mon absence la religion, travailleuse infatigable, me l’avait enlevée. Elle ne me verrait plus. Elle était pieuse, elle était sage, elle avait raison de ne pas venir. Quoi de pire que de mettre face à face une femme indifférente et un homme qui ne l’est pas. Et, même si elle était ma maîtresse, quel avenir devant nous ? Elle n’abandonnerait ni sa fille ni son mari, car elle était bonne mère et, d’autre part, les liens du mariage étaient, à ses yeux, sacrés. Il fallait donc accepter l’inévitable.
Cela m’était d’autant plus facile que dans l’état d’apathie où je me trouvais, rien ne pouvait réveiller la souffrance en moi. Je partirais. Le temps de régler les affaires de la succession de ma mère — cinq ou six semaines — et je demanderais un poste en Orient.
Je me parlais ainsi pour me cacher ma misère. Cependant les heures passaient. Par une décision soudaine, je résolus de faire avant dîner quelques courses urgentes et m’habillai en hâte. Madeleine ? Que m’était Madeleine ? Qu’étais-je pour elle ?
Le timbre de l’antichambre retentit : « C’est elle ! » pensai-je, mais je ne bougeai pas… La porte de mon cabinet s’ouvrit et Madeleine entra.
Sans doute était-elle venue poussée par la seule bonté de son cœur, du moins le croyait-elle, car elle était incapable de chercher à se duper. Elle accomplissait ainsi, magnifiquement, une des sept œuvres de la Miséricorde : aegros visitare. N’étais-je pas un malade ? N’avais-je pas besoin d’elle ? Et voilà qu’au moment où elle franchit le seuil, un sentiment qu’elle voulait oublier, ou qu’elle croyait mort, se réveilla soudain. Elle s’arrêta et rougit, ne comprenant plus pourquoi elle était là.
Mais ses yeux rencontrèrent mon visage, le parcoururent, cherchant les miens et n’osant s’y fixer. A lire sur ma figure pâlie le cycle de douleurs que j’avais traversé, elle s’émut. Elle hésita un instant. Nous n’étions plus, l’un en face de l’autre, que deux malheureux longtemps séparés et qui, toutes barrières tombées, se retrouvent. La pitié fit ce que l’amour n’aurait osé accomplir. Madeleine ne dit rien ; elle vint à moi et, simplement, m’attira vers elle… La tête enfouie sur sa poitrine, je pleurai comme un enfant.
— Mon petit, mon petit, disait-elle, comme il a de la peine !
Ces mots si tendres, loin d’arrêter mes larmes, les firent couler avec plus de force encore. Je trouvais à les répandre une singulière volupté. Par cette voie s’en allait le chagrin accumulé durant tant de jours d’angoisse. Je n’essayai pas de me reprendre ; je ne m’excusai pas de la faiblesse que je montrais. Rien n’était plus naturel, rien n’était plus délicieux que de pleurer dans les bras de Madeleine, sur son cœur pitoyable.
Secouée par mes sanglots jusqu’au fond d’elle-même, elle me caressait et me parlait à la fois. Le doux murmure de sa voix à lui seul était un baume. Que disait-elle ? Tout et rien. C’était le sublime balbutiement des femmes qui deviennent mères pour bercer le chagrin des hommes.
Sous ce flot tiède de mots sans suite, je ne sentais plus ma souffrance. Serrés l’un contre l’autre, nous nous étions assis sur le divan. La nuit était venue dans la chambre et nous enveloppait. Je ne pleurais plus ; je restais, apaisé maintenant, dans l’asile que m’offrait Madeleine. Son sang battait tout près du mien, la chaleur de son corps me pénétrait. Je l’avais dans mon étreinte, à demi couchée sous moi. Une blouse légère séparait seule ma bouche de son sein et mes lèvres avides qui le pressaient crurent le sentir frémir.
Madeleine s’était tue. Son silence en faisait-il ma complice ? Savait-elle que j’allais la prendre ? M’attendait-elle ? Ou bien n’était-elle plus, brisée par tant d’émotions, qu’une femme lasse, incapable de se battre ? Je ne raisonnai pas davantage, je n’étais que désir qui brûle. Mes lèvres remontèrent du sein jusqu’à l’épaule dont elles suivirent le contour et, soudain, elles rencontrèrent la chair fraîche du cou derrière l’oreille. A ce contact, Madeleine tressaillit. Elle s’efforçait de m’écarter. Elle me suppliait :
— Que faites-vous ?… Laissez-moi !
— Ne dis rien, je t’en prie, murmurai-je passionnément. Je t’aime, je ne sais que cela.
Déjà ma bouche trouvait la sienne. Elle s’abandonna.
Si j’avais cru que la possession de Madeleine mettrait fin à la période troublée que nous venions de traverser et que nous connaîtrions maintenant une ère enchantée où nos cœurs et nos sens goûteraient une égale satisfaction, je me serais trompé. Commença une vie déchirée et tragique. Madeleine était mariée.
Avant qu’elle fût ma maîtresse, la présence de M. de Sées n’était qu’une gêne ; elle était aujourd’hui une souffrance. Je ne me préoccupais guère jusqu’alors de la vie que menaient les femmes assez aimables pour me recevoir dans leur intimité. Se prêtaient-elles à d’autres qu’à moi ? Cela était vraisemblable, mais sans intérêt. Cette question se posait au sujet de Madeleine. Il y avait là quelque chose que je n’osais regarder en face, mais que je ne pouvais éviter. Je ne supportais pas l’idée que la chair de Madeleine, que les parties les plus secrètes de son corps, que tout ce que j’avais gagné au prix de tant de luttes et de douleurs servissent de plein droit au plaisir de son mari, qu’il n’eût qu’à y porter la main pour en jouir. Il y avait de quoi se casser la tête contre les murs et je chassais, furieux, ces visions empoisonnées. Elles revenaient… Finalement je voulus savoir de Madeleine elle-même quels étaient les rapports entre elle et son mari. Le malheur est qu’en ces matières on n’ose pas laisser voir sa misère. On est torturé, la honte vous étouffe et l’on prend un ton indifférent, de simple curiosité, on a la force de sourire, alors qu’on retient des cris de rage.
Madeleine devina-t-elle la peine que j’endurais ? Elle n’en montra rien. Elle agit, inconsciemment peut-être, avec une merveilleuse adresse et trouva pour me rassurer les mots les plus propres, les plus efficaces. Elle transposa le débat du terrain de la chair à celui des sentiments, mais toujours d’une façon indirecte, objective en quelque sorte, comme s’il s’agissait de choses quasi-historiques, dont on ne se souvient presque pas, et non de la plus brûlante, de la plus actuelle des questions. Il ressortait de ces conversations sans suite, dans lesquelles je prenais ici et là un bout de phrase qui touchait à ma préoccupation présente, qu’elle n’avait jamais eu pour M. de Sées qu’une affectueuse estime, qu’ils étaient déjà de vieux mariés, — la seule idée que Charles de Sées l’avait prise jeune fille était déplaisante à l’extrême, mais, dans la presse et le conflit où j’étais avec, devant moi, tant de soucis plus urgents, je l’écartai. Madeleine risqua même une fois que Charles était de santé délicate, à d’autres jours (ah ! cela ne m’intéressait pas !) que leurs habitudes étaient bien différentes. Il avait besoin de peu de repos ; elle sommeillait depuis longtemps lorsqu’il entrait dans la chambre. Le matin (je ne demandais rien), le matin, il se levait de bonne heure et courait à ses dossiers. Tels furent les multiples renseignements que j’obtins d’elle, sans en avoir l’air, à diverses reprises, et dont elle composa, pour endormir ma jalousie, un narcotique. On en arrivait à se demander quand un ménage ainsi réglé avait eu l’occasion de faire un enfant.
Mais j’étais jeune, je voulais à toute force être heureux, je ne demandais qu’à laisser l’habile infirmière panser sans paraître y toucher ma blessure secrète.
Du reste, d’autres sujets non moins immédiats me réclamaient. Je croyais Madeleine à moi, mais non, rien n’était acquis, tout restait disputé, et, combattant à côté de Madeleine, je rencontrai un nouvel adversaire, et de taille ! Dieu. Je sentais sa présence invisible dans les batailles que je livrais pour garder un bien que j’avais conquis et qui pourtant ne m’appartenait pas. Parfois, Il l’emportait et Madeleine, en larmes, m’échappait pendant un jour ou deux. D’autres fois j’arrachais la victoire à mon divin antagoniste. Madeleine, cédant au désir qui la poussait, ne résistait plus. Elle se donnait alors avec une sorte de fureur sauvage ; une femme se révélait inconnue d’elle-même. Elle oubliait sa religion, son Dieu, ses devoirs. Ce n’était pas elle qui se serait écriée, comme Mme de Krüdner dans les bras de son amant : « O Dieu, je te demande pardon de l’excès de mon bonheur ! » Ivre de volupté, elle me faisait gémir sous la morsure de ses baisers. Ces brefs et dionysiaques emportements étaient suivis d’une longue repentance. Madeleine semblait se réveiller d’un profond sommeil ; hagarde, elle me voyait et ne me connaissait point. Elle quittait le lit où je m’assoupissais accablé de fatigue et, prête en un clin d’œil, elle sortait sans que j’eusse le temps de la retenir, ses seuls mots sur le seuil étant : « Il faut que je parte ! »
Lorsque je la retrouvais, elle était calme et distante. Si je me permettais une allusion à notre dernier rendez-vous, elle ne m’entendait pas, comme si j’usais d’un langage qui lui était étranger. A la voir ainsi, je finissais par croire que j’avais été le jouet d’un rêve.
Mais, le plus souvent, les choses se passaient d’autre sorte. Madeleine me suppliait de l’épargner. Écrasée par le remords, elle était humble et pressante : « Regarde ce que je suis, disait-elle, et prends pitié de moi. Je dois me battre, et contre toi ! Mais tu sens bien que c’est impossible, mon aimé. Où trouverais-je la force de te faire de la peine ? Je suis faible, viens-moi donc en aide… Nous ne pouvons vivre dans le péché. Ce ne sont pas des raisons humaines que je t’oppose. Tu les vaincrais trop facilement, mais il y a Dieu ! Tu peux Lui céder sans honte puisqu’Il me réclame. »
Elle était si sincère dans son remords, si touchante dans ses larmes que je me laissais émouvoir. Nous prenions alors les plus sages résolutions. Les rendez-vous rue de Commailles étaient interdits. Malgré la saison, nous nous rencontrions en plein air et courions les quartiers éloignés. Les tours de Notre-Dame nous virent penchés, couple fervent, au-dessus de Paris. Le cèdre du Liban nous offrit au Jardin des plantes la protection de ses branches pendant une averse. Le Luxembourg trop voisin où jouait la petite Geneviève nous était défendu, mais un jour, comme elle gardait la chambre à cause d’un rhume, nous nous y rendîmes. La température était clémente, nous nous assîmes au soleil devant l’Orangerie, dans l’endroit que l’on appelle la Petite Provence. Nous n’avions causé en nous promenant que de sujets étrangers à notre amour. Madeleine était rassurée, presque heureuse. Nous étions amis, enfin ! Que désirer de plus ? Elle imaginait, peut-être, que cette accalmie serait durable et que, sans aucun sacrifice de notre part, elle me garderait près d’elle comme un frère très cher. Ses beaux yeux me regardaient avec confiance. Elle ne doutait pas de moi. A la voir caresser complaisamment ces chimères, j’eus un mouvement d’humeur que je réprimai vite. Nous restâmes silencieux. Des bambins couraient autour de nous ; des nourrices promenaient leurs bébés endormis. Mes yeux allaient d’eux à Madeleine, et tout à coup une idée me vint que je ne pus chasser. Au même moment, Madeleine me voyant soucieux me demanda à quoi je pensais.
Je réfléchis encore une minute, puis je lui dis en la fixant :
— Madeleine, je voudrais avoir un enfant de toi.
Elle tressaillit ; son visage changea aussitôt d’expression. J’y lus de l’inquiétude et peut-être aussi un autre sentiment qu’elle ne s’avouait pas, de l’orgueil. Mais, l’inquiétude l’emporta. Elle voulut m’arrêter. Je ne lui en laissai pas le loisir et continuai :
— Oui, j’aimerais te confier un germe précieux que tu garderais longtemps dans ton ventre si doux, que tu nourrirais de ton sang, que tu mettrais au jour, et qui serait toi, et qui serait moi. Il me semble que le destin qui nous a réunis trouvera sa fin nécessaire lorsque d’un si grand amour naîtra un enfant beau et fier pour nous perpétuer.
Madeleine me regarda comme si elle voulait aller jusqu’au fond de mes pensées. En un instant, sa tranquillité avait disparu. Était-ce une nouvelle épreuve que je tentais ? Allais-je l’assaillir à l’improviste alors qu’elle était sans défense ? Elle comprit qu’une fois de plus elle s’était trompée. Cela la rassura sur ma sincérité, mais son trouble s’en accrut. Cet appel si humain toucha en elle un point douloureux qu’elle m’avait tenu secret. Ses yeux s’emplirent de larmes qu’elle n’essayait pas de me cacher et qui tombaient une à une lentement sur son col de fourrure où elles disparaissaient. Ce fut sa seule réponse.
Ma sortie intempestive dont je n’avais pas calculé les effets eut le triste résultat d’ajouter un sujet nouveau de chagrin à ceux qui affligeaient déjà Madeleine. Dans son esprit que la lutte soutenue depuis le jour de notre rencontre avait rendu craintif, l’idée s’implanta qu’elle ne pouvait me rendre heureux, qu’elle ne me donnerait pas les joies si naturelles (et qui m’étaient nécessaires, elle venait de l’apprendre) de la paternité. Elle se crut un obstacle au développement normal de ma vie.
Ainsi, aux redoutables devoirs dont elle était comptable envers Dieu et envers elle-même, se joignaient des devoirs non moins impérieux envers moi. C’était trop pour un cœur tendre. Elle gravissait un calvaire, se déchirant aux ronces du chemin, les yeux fixés sur le sommet où Dieu l’appelait, terrifiée à l’idée que si elle regardait en arrière elle verrait l’amant dont elle essayait de se détacher. Elle touchait enfin au terme de sa course, n’en pouvant plus de fatigue et de souffrance ; elle faisait un faux-pas ; d’un seul coup, elle roulait jusqu’au bas de la pente qu’elle avait eu tant de peine à monter, et cette chute l’amenait à nouveau, amoureuse meurtrie et sanglotante, dans mes bras.
C’étaient alors quelques jours de plaisirs passionnés. Elle venait à moi matin et après-midi et, le soir encore, nous étions ensemble chez elle ou chez des amis. La rue de Commailles l’attirait irrésistiblement. Parfois, elle m’avertissait que de nombreuses courses et visites la retiendraient l’après-midi entière. Mais, voilà qu’avant trois heures, elle se trouvait, surprise, à ma porte où ses pieds, en dépit d’elle-même, ses pieds joyeux et libres l’avaient conduite. Mi-indignée, mi-riante, elle s’étonnait de son aventure.
— Tu ne m’attendais pas, disait-elle (elle me tutoyait alors), et pourtant tu n’étais pas sorti.
— Je t’attends toujours, répondais-je.
— Ah ! monstre que j’aime, comme tu me connais !
Et c’étaient des baisers éperdus.
Ou bien elle disait :
— Et si j’avais trouvé une femme ici ! Peut-être bien que tu me trompes après tout. Avec les hommes, sait-on jamais ? Je ne suis pas une maîtresse bien gaie ni bien savante dans l’art de plaire. Mais telle que je suis, je te veux tout entier, je ne te partage pas.
Elle me serrait contre elle à m’étouffer.
Puis l’excès de la passion la ramenait face à elle-même. Elle regardait son péché avec horreur, elle courait à l’église. Elle y puisait des forces fraîches pour recommencer la lutte contre elle et contre moi.
L’hiver passa ainsi dans la fièvre. J’ai toujours aimé à me sentir d’aplomb, les pieds bien calés sur le sol. Mais, cette fois-ci, j’avais perdu l’équilibre. J’allais à droite, à gauche, au gré du vent. Lorsque j’avais le loisir de réfléchir, je me demandais : « Qu’est-ce que ce mélange de coups et de baisers ? Est-ce là ce qu’on appelle l’amour ? Est-ce là ce que j’ai tant désiré ? Qu’on se batte avant la possession, je le comprends. Mais, après, cela n’a plus de sens. Où sont les beati possidentes ?… Pourquoi, diable, me suis-je épris d’une femme mariée ? Elle est tout de même à son mari, si rarement que ce soit. Quelle saleté ! Et je le supporte ! Elle est pieuse, en outre ! Belle complication ! Il est évident que la religion n’a pas à s’occuper de notre bonheur terrestre puisque, pour elle, nous ne sommes ici-bas qu’en transit vers l’éternité.
Mais que me restait-il à moi qui ne croyais plus à des récompenses ou à des punitions supra-terrestres ? Au nom de doctrines que je ne partageais pas, j’étais privé du seul bien qui m’importât.
Dans ma colère, je m’en prenais, cela va de soi, à Madeleine. Je ne lui faisais pas de reproches, je n’éclatais pas en cris et en récriminations. Cela n’était pas dans ma manière. J’étais sec, froid, sarcastique, haïssable. Je l’attaquais dans sa foi, je discutais avec elle apparemment de la façon la plus objective, comme pour l’amour de la seule vérité mais au fond poussé par un désir mal contenu de lui porter un coup douloureux, de me venger de ce qu’elle me faisait souffrir.
Madeleine redoutait ces attaques insidieuses. Mais elle était assez femme pour savoir d’où venait la violence secrète qui m’animait. Elle me plaignait et redoublait de douceur. Il faut reconnaître, du reste, que dans cette lutte sourde je ne gagnais pas un pouce de terrain. Madeleine croyait comme elle respirait. Je ne la troublais donc en aucune manière dans le domaine qui était à elle. Jamais elle n’était embarrassée pour me répondre. Mes arguments ne la touchaient point. Les siens n’arrivaient pas jusqu’à moi. Nous nous battions sur des plans différents et arrivions à ce résultat paradoxal de nous blesser sans nous atteindre. Le dogme à ses yeux se suffisait. Je me souvenais d’un curé entendu à l’heure du catéchisme, alors que je visitais une des plus vieilles églises gothiques de l’Ile-de-France : « Mes enfants, disait-il, le mystère de la Sainte-Trinité est un mystère, par conséquent je ne puis vous l’expliquer. Acceptez-le donc tel qu’il est. » Ce raisonnement qui se rapproche de celui de Hegel : « Il faut comprendre l’incompréhensible comme tel », m’avait paru définitif. C’était celui de Madeleine. Elle passait ainsi d’un pied léger par-dessus les difficultés où achoppent les pauvres rationalistes.
Mais, bientôt lassé d’un absurde combat, j’abandonnais ces discussions. Je me reprochais mes efforts pour détruire les croyances de Madeleine, besogne assez basse et indigne de moi. Par un brusque revirement, je lui laissais voir que je ne restais pas insensible à l’admirable construction qu’avait élevée l’Église, forte maison, en vérité, dont les murs ont soutenu plus d’un assaut sans faiblir.
Madeleine me regardait, osant à peine en croire ses oreilles. Quoi, je n’étais pas l’ennemi de l’Église que je lui avais paru ! Son cœur se dilatait de joie. Elle me prenait la main et, d’un ton assuré, disait :
— Philippe, il y aura une place pour vous dans cette maison. Je l’ai demandé à Dieu ; il me l’a promis.
Tant que duraient ces périodes de détente, je ressentais une grande pitié pour Madeleine. Qu’avais-je fait d’elle ? Jusqu’au jour de notre rencontre, elle n’avait navigué que sur de calmes rivières, se laissant aller paresseusement au fil d’une eau connue, dans un pays monotone il est vrai, entre des rives un peu plates, mais ombragées et agréables. Et voici que je l’entraînais en pleine mer ; le vent sifflait autour d’elle, la foudre tombait, les vagues furieuses menaçaient de l’engloutir. Elle n’avait qu’un refuge en ce péril extrême : elle priait.
Je la prenais par la main, je lui parlais tendrement ; je feignais de me laisser convaincre ; peut-être même et pour quelques instants, je partageais ses vues chimériques sur une amitié possible.
Ces accalmies étaient brèves, car j’étais homme, et jeune, et j’aimais. J’exigeais autre chose, nous recommencions à nous battre.
Le printemps était venu. A mesure que nous approchions de Pâques, Madeleine montrait plus d’inquiétude. Comment arriverait-elle à la grande fête religieuse de l’année ? Comment recevoir la sainte communion ? Déjà Noël lui avait causé de vives angoisses. Il avait fallu se mettre bien avec Dieu, comme elle disait. Une brouille passagère entre nous avait rendu cette réconciliation plus facile. Pendant les quelques jours où elle fuyait la rue de Commailles, elle avait couru chez son confesseur. Le remords la consumait ; elle reçut l’absolution. Mais, cette fois-ci, irait-elle dire au même prêtre qu’elle était retombée dans son péché, qu’elle y vivait depuis trois mois ? Une âpre lutte se livrait en elle. Je le voyais à l’altération de son humeur, au trouble de son regard, à la fièvre qui colorait son beau visage. Elle n’était pas femme à ruser avec le devoir, à trouver un subterfuge ingénieux pour franchir cette passe difficile et comme, toute à la violence du sentiment présent, elle avait la mémoire et l’imagination courtes, elle pensait que sa décision serait sans appel et commanderait l’avenir. La rupture nécessaire la désespérait. Elle oubliait que cent fois elle m’avait quitté et que cent fois elle était retombée dans mes bras. Bientôt les cloches de Pâques sonneraient ! Elle s’affola.
Un jour que nous goûtions ensemble, elle me demanda de l’accompagner avant dîner sur la rive droite. Bien qu’elle fût fatiguée, elle voulut marcher. Nous descendîmes jusqu’à la Seine et traversâmes la cour du Carrousel. Je pensais qu’elle me menait aux magasins du Louvre et qu’il n’y avait, en effet, rien de plus important que de se parer pour me plaire. Mais elle prit la rue Saint-Honoré et la rue Croix-des-Petits-Champs. Je commençais à comprendre. Quelques minutes plus tard, nous entrions à Notre-Dame-des-Victoires. L’obscurité de la nef était traversée par une zone lumineuse qui venait de cent cierges allumés à droite devant l’autel de la Vierge. Madeleine trouva avec peine deux chaises libres et me fit signe de m’asseoir près d’elle. Elle resta longtemps à prier, la tête enfouie dans les mains. Elle était très légèrement parfumée et ce parfum chargé pour moi de tant de souvenirs se mariait maintenant à l’odeur voluptueuse de l’encens. Je me baignais dans ces effluves délicieux, inconscient du lieu où j’étais et du temps qui coulait. Je regardais le corps agenouillé de ma maîtresse. Je suivais la ligne souple qui va des épaules aux genoux ; elle s’infléchissait à la taille, s’épanouissait aux hanches pleines et j’imaginais sous l’étoffe sombre qui la couvrait une chair dont pas un pouce n’avait échappé à mes baisers.
Madeleine se releva enfin, se signa, et nous sortîmes. Je vis alors seulement qu’elle avait pleuré.
Il faisait nuit déjà. Je lui offris de prendre une voiture pour la ramener chez elle, mais elle refusa. Je passai mon bras sous le sien, elle se dégagea doucement. Elle était absorbée et je ne voulus pas la distraire de ses méditations. Aussi arrivâmes-nous rue du Cherche-Midi sans avoir échangé un mot. Au moment de me quitter, elle dit :
— J’ai quelque chose à vous demander, Philippe, mais je ne puis parler dans la rue.
Ces mots si simples, elle les prononça comme une personne qui revient de loin, qui n’est pas à la conversation et dont la voix inattendue fait tressaillir ceux qui l’entendent.
— Venez rue de Commailles, répondis-je. Où serons-nous plus tranquilles ? Où pourrez-vous mieux vous expliquer ?
J’employais d’habitude le « tu » qu’elle, au contraire, s’efforçait maintenant d’éviter. Surpris, j’avais dit involontairement « vous ». Elle s’alarma. Étais-je fâché ? C’est avec timidité qu’elle continua :
— Je me suis promis de ne plus venir rue de Commailles.
— Alors renonce à ce que tu as à me demander, fis-je assez sèchement.
— C’est impossible, Philippe, mais soyez bon, je ne peux pas vous voir en colère. Eh bien, je viendrai demain puisqu’il le faut.
Elle partit sans rien ajouter. Souvent déjà, d’importantes résolutions m’avaient été annoncées de cette manière. Suivant l’état de mes nerfs, ou je m’inquiétais sans mesure, ou je restais indifférent. Le ton de Madeleine était peut-être aujourd’hui plus grave. Mais je n’étais pas d’humeur à me tracasser et je ne m’en préoccupai pas davantage.
Pour la première fois depuis la mort de ma mère, je sortais ce soir-là. J’avais accepté de dîner dans une maison agréable où les hommes étaient riches, et les femmes jolies. En y allant, mon état d’esprit était celui d’un collégien qui fait l’école buissonnière. J’échappais pendant quelques heures à l’atmosphère orageuse que j’avais respirée ces mois derniers. Je me trouvai à table à côté d’une femme que je ne connaissais que de réputation. Elle avait eu des aventures éclatantes dont elle s’était tirée à son honneur. Elle était de celles à qui le meilleur monde auquel elles appartiennent passe tout, alors qu’il se montre d’une sévérité inexplicable pour d’autres qui en ont fait beaucoup moins. Elle parlait d’une façon nette et charmante, sans l’ombre d’hypocrisie, mais avec une certaine élégance qui lui permettait de tout dire. Elle me plut. Personne ne faisait moins penser à l’amour, mais n’éveillait plus vivement le désir. Le dîner, le vin de champagne, les fleurs, les cristaux, la belle argenterie, les femmes décolletées dont pas une qui n’eût un amant, le ton libre de la conversation, l’impression de vivre dans un milieu où le mot devoir aurait détonné, mais où celui de plaisir rendait un son plein, j’étais loin de Madeleine. Appartenaient-ils à la même ville et à la même civilisation le luxueux hôtel du faubourg Saint-Honoré où je dînais et l’église obscure, bourdonnante de prières, où ma maîtresse en larmes avait demandé à Dieu de la séparer de moi ? Le contraste était grand, je le goûtai. Ma belle voisine m’amusa ; je ne l’ennuyai point. Lorsque nous nous quittâmes, il allait sans dire, mais nous l’avions dit tout de même, que nous nous reverrions.
Rue de Commailles, je retrouvai Madeleine. Mon appartement était rempli d’elle ; je ne pouvais lui échapper : « Qu’a-t-elle à me dire que je ne sache déjà ? » pensai-je et je haussai les épaules. Pourtant je me souvins de l’accent de sa voix ; il me poursuivit jusque dans mon sommeil.
Le lendemain après-midi Madeleine arriva craintive, fatiguée. Je l’accueillis avec douceur, la rassurai et, bientôt elle aborda, non sans beaucoup de détours, non sans m’avoir posé mille questions sur mon dîner de la veille, le sujet qui l’amenait.
Elle m’expliqua une fois de plus qu’elle ne pouvait être à moi. Ses raisons, je les connaissais depuis longtemps. Mais, par le choix des mots, par leur simplicité, par l’accent douloureux qui pénétrait son discours, elle m’émut. Je ne ressentais ni rancune ni colère. Qui m’était plus cher au monde ? Elle possédait mon cœur. Les heures les plus belles de nos vies s’étaient confondues. Je tenais sa main dans les miennes et l’écoutais avec une telle sympathie que sa tâche en était rendue plus facile. Elle montrait beaucoup de courage ; elle n’en manquait pas pour elle. Mais, lorsqu’elle en vint à parler de moi, sa voix se mit à trembler. Elle eut pourtant la force de me dire qu’elle ne pouvait faire mon bonheur : il n’y avait aucune issue à notre liaison, je perdais mes meilleures années, je m’en rendais compte certainement ; elle-même finissait par se prendre en dégoût à voir l’inutilité de ses remords, pourtant sincères, et la faiblesse qui la faisait retomber dans le péché. Il lui fallait donc implorer mon aide ; une solution lui était apparue, si claire, si évidente qu’il n’y avait pas à la discuter.
Elle s’arrêta et il y eut un long silence. Rien de plus pitoyable à ce moment que Madeleine, la tête penchée, les mains tremblantes. Elle me regarda et ses yeux s’emplirent de larmes. Je n’en pus supporter la vue.
— Madeleine, dis-je plaisantant, car il fallait enlever à cette scène la pointe de sa douleur, si tu pleures, rien au monde ne m’empêchera de t’embrasser. Tu vois de quoi je te menace !
Je ne réussis pas à faire sourire ma pauvre amie. Elle hésita, balbutia et finalement j’appris que je devais prendre une maîtresse.
D’abord je ne fus sensible, je l’avoue, qu’à ce que cette proposition pouvait avoir de comique. Mais je fus bien vite ramené à d’autres sentiments. Madeleine sanglotait sur mon épaule. Une fois de plus j’opposai la grandeur de son amour et la médiocrité du mien. Elle, fière et jalouse comme je la connaissais, en arriver là ! J’eus honte de moi, je tombai à ses pieds et je lui dis avec une passion qui emportait tout, que je n’abandonnerais jamais une femme d’un si grand cœur, que je l’aimerais toujours, et que je préférais souffrir par elle que d’être heureux auprès d’une autre.
Elle me mit la main sur la bouche pour m’arrêter ; je couvris sa main de baisers. Elle se leva, se défit de moi et, avant que j’eusse pu me redresser, elle se sauvait en courant.
J’ai parlé du déséquilibre où je me trouvais alors. J’en puis fournir une preuve nouvelle. Au lieu de laisser tomber dans l’oubli l’étrange conseil de Madeleine et de n’y prêter pas plus d’attention qu’à mille paroles dites au cours de scènes non moins émouvantes, je me mis à y penser dès la porte close. Il m’apparut comme l’unique moyen de sauver Madeleine de la situation désespérée où elle se débattait. C’était un beau thème à mettre sous forme dialoguée. Au cours d’une soirée solitaire, mon esprit s’enfiévra ; je me montai à un diapason aigu et composai bientôt un pathétique drame à deux personnages, donnant les répliques avec une force incroyable pour l’un et l’autre protagoniste. La conclusion de cette scène fut que je devais me sacrifier pour le salut de ma victime (Madeleine !). J’allais si loin dans l’absurde que je finis par m’attendrir sur mon sort pitoyable. Au théâtre on ne s’embarrasse pas de la vérité des caractères. On exploite une situation sans s’occuper de la vraisemblance. Ainsi fis-je de bonne foi ce soir-là.
Au matin, je me réveillai plus calme. Je n’étais pas disposé à dramatiser, je ressentais un peu de courbature. J’examinai de sang-froid les arguments enflammés de la veille. Je ne pensais pas à Madeleine, mais à moi. J’étais las de nos discussions qui renaissaient de leurs cendres. J’avais voulu connaître les orages de la passion ; ils avaient fondu sur ma tête. Maintenant la tranquillité me paraissait le plus précieux des biens. Une maîtresse aimable et libre, les plaisirs modérés de la chair, et surtout la paix du cœur, même au prix de l’indifférence, voilà quel était l’objet de mes vœux matinaux.
Et soudain passa devant mes yeux l’image de Mme V…, ma belle voisine de table du faubourg Saint-Honoré. Je revis son sourire, ses dents si blanches. Savait-elle seulement que nous entrions dans la semaine sainte ?
Pourquoi n’avais-je pas cherché à la joindre plus tôt ? Je résolus de réparer sans retard cet oubli.
Je lui téléphonai (Madeleine n’avait pas le téléphone).
— Me voir ?… Mais certainement. Elle était hors de Paris pour la journée. Le lendemain nous pourrions sortir ensemble.
Le lendemain nous vit, en effet, au bois de Boulogne. Promeneurs matinaux, nous suivions les allées égayées par les toilettes printanières des femmes et par leurs chapeaux fleuris. Tout en saluant maintes personnes nous causions à bâtons rompus, mais, dans ce désordre apparent, nos propos avaient une suite et allaient à un certain but. Mme V… n’ignorait pas pourquoi j’étais près d’elle et j’imaginais que, si elle avait accepté de sortir avec moi, elle ne me voulait pas de mal. Elle se trouvait, par hasard, libre. Nos accords furent vite conclus et ne laissaient place à aucune équivoque. Nous avions du goût l’un pour l’autre, cela et rien de plus ; nous partions le cœur léger à la recherche du plaisir, en amis pleins d’expérience et de sagesse qui, se trouvant de sexe différent, n’ont pas de raison de se refuser les joies si naturelles et si saines de la chair. Nous passerions ensemble quelques heures par semaine, et, sans nous engager davantage, restions maîtres du reste de notre temps. Tout cela n’avait pas été dit expressément, mais était entendu avec autant de précision que si nous l’avions fait rédiger par notaire sur papier timbré.
Quarante-huit heures plus tard, Mme V… dînait chez moi. Bien que nous fussions seuls et pour cause, cette femme charmante me fit la surprise d’arriver en toilette de soirée, comme si elle allait au bal après dîner. Lorsqu’elle entra, parée, éblouissante, endiamantée, chassant, telle l’aurore, les nuées de la nuit, l’atmosphère un peu sombre de mon appartement s’éclaira.
Plus tard, pendant que nous prenions le café, elle s’assit sur le divan et moi à côté d’elle. Pourquoi faut-il qu’alors l’image de Madeleine m’apparût ? A cette même place, j’avais caché ma tête sur son épaule en un jour inoubliable ; je la vis dans mon étreinte, je vis ses beaux yeux pleins d’effroi et de désir, j’entendis sa voix suppliante, tout cela si nettement que je m’arrêtai au milieu d’une phrase.
Mme V… me regarda, étonnée. Déjà je m’étais repris. C’était elle seule maintenant que je serrais dans mes bras.
Des relations si bien réglées avaient peu à redouter du hasard. Jamais programme ne fut plus exactement rempli que celui que nous avions fixé. Mme V… venait chez moi deux ou trois fois la semaine, et le plus souvent pour dîner, mais parfois, vers onze heures seulement, sortant d’une réception, décolletée, perles et diamants. Elle excellait à créer ainsi l’illusion qu’elle s’était parée pour me plaire. Riant, je l’appelais : « Dîner de gala. » Et vraiment toute notre liaison prit ainsi un air de fête. Elle en avait l’éclat, la gaîté brillante et peut-être aussi l’artificialité. C’était un à fleur de peau parfaitement réussi. Nous représentions assez bien les personnages de ces gravures libertines du XVIIIe siècle qui, en diverses postures, se livrent aux plaisirs de l’amour, mais qui restent soigneusement frisés et poudrés. En réalité, il n’y avait dans nos rapports aucun désordre et, par là, il leur manquait un élément humain. Madeleine faisait vibrer d’autres cordes et plus profondes.
La religion était venue à son secours. A Pâques, elle avait repris dans la communion des fidèles la place que rien ne devait lui faire perdre. Elle y trouvait les forces nécessaires pour supporter son sacrifice.
Je la voyais tous les jours, chez elle ou dehors. La rue de Commailles était interdite. Nous n’abordions pas certains sujets. Aucune allusion à l’étrange conseil qu’elle m’avait donné. Me supposait-elle une vie secrète ? Je redoutais qu’elle en parlât. Entière dans ses sentiments, il devait lui paraître impossible que, renonçant à elle, j’eusse cherché au sortir de ses bras une autre maîtresse. Mais elle était si lasse de la lutte soutenue que cette idée ne se présentait même pas à son esprit.
Je jouissais ainsi d’une tranquillité momentanée. Faut-il user son temps à prévoir l’avenir ? Le présent me paraissait agréable. N’était-il pas excellent d’avoir à la fois Madeleine comme maîtresse de cœur et Mme V… comme maîtresse de lit ? N’étaient-elles pas toutes deux parfaites dans des rôles qui leur convenaient si bien ? Je souhaitais qu’elles n’eussent jamais la tentation d’en sortir. Je me sentais une âme de classique, je n’étais pas pour le mélange des genres.
Tels furent les débuts d’une vie à trois dont j’étais le centre. Je la goûtais seul dans sa plénitude puisque les deux autres personnages s’ignoraient. J’étais redevenu un homme libre. Rien ne m’enchaînait à Mme V… Elle savait n’avoir aucun droit sur les heures de mon existence que je ne passais point avec elle. Elle ne me posait pas une question indiscrète. Le mot jalousie était entre nous vide de sens. Peut-être voyait-elle à l’occasion un ami ancien ou récent. Le jour où cette pensée me vint, je sursautai. Accepterais-je un partage ? Je constatai aussitôt que je n’en serais pas autrement choqué. Ainsi nous n’avions pas dévié de la ligne que nous nous étions tracée. J’en fus charmé car le cœur va souvent se fourrer où il n’a que faire.
Madeleine ? Elle s’était refusée à moi et, me suppliant de prendre une maîtresse, m’avait jeté dans les bras de Mme V… Pourtant je lui cachais ma liaison. A certaines heures, je me reprochais mon silence, mais craignant qu’elle me sût peu de gré de lui avoir obéi, je désirais prolonger le calme dont nous jouissions et lui épargner une peine nouvelle. Elle était, pour l’instant, heureuse à sa manière. La vague de piété qui l’avait portée à travers ses Pâques la soutenait encore. Elle croyait avoir gagné un abri sûr ; elle respirait largement comme quelqu’un qui vient d’échapper à un grand péril.
Pas une minute, je n’eus l’intention de rompre avec elle. Des liens solidement forgés par la joie et par la souffrance nous unissaient. Ils m’avaient blessé naguère, mais je n’en sentais plus le poids. Pour une période de temps très brève, tout me parut facile. Je me refusais à voir ce que la vie que je menais avait d’anormal et de presque monstrueux. Je me félicitais d’avoir trouvé la solution du problème le plus ardu, celui de l’amour. Il se résolvait par une équation à deux inconnues. Chercher le bonheur dans une seule femme, quelle folie ! et quel danger ! Comment une femme, si parfaite qu’on l’imagine, satisferait-elle aux multiples et contradictoires besoins de l’homme ? Elles n’étaient pas trop de deux pour cette tâche et j’étais assuré de pouvoir donner à chacune la part qui lui revenait.
Je m’enorgueillissais ainsi de ma découverte lorsque, vers le milieu de mai, j’entendis quelques petits grincements dans la marche d’une machine que je croyais fort bien réglée. Madeleine commença à m’inquiéter. Les rapports établis entre nous étant ceux qu’elle avait voulus, elle jugea d’abord devoir en être contente. Ignorait-elle donc qu’il y avait en elle une autre femme et que cette femme, tôt ou tard, demanderait, elle aussi, à être heureuse ? Si Madeleine s’en était aperçue, elle ne l’aurait jamais avoué, car elle était fière. Mais je pense qu’elle ne se rendait pas un compte exact de ce qui se passait en son cœur. Parfois elle était triste, parfois elle montrait de l’humeur ; je la surpris un jour les yeux encore humides de larmes. Elle allégua ses nerfs malades, le climat de Paris ; la campagne lui était nécessaire. Au vrai, elle avait soif de mes caresses.
Elle se croyait si sûre d’elle-même qu’à deux reprises, sous un prétexte quelconque — elle faisait des courses dans le quartier, ou bien sortant du Bon marché elle avait été surprise par une averse — elle arriva rue de Commailles. J’étais à la maison et seul, par hasard. Lorsqu’elle entra, je tressaillis. Il était sept heures. J’attendais Mme V… d’un moment à l’autre.
Je ne pus cacher un peu de nervosité. Madeleine le remarqua. Qu’imagina-t-elle ? Je ne sais, mais elle perdit de son assurance. J’avais déjà recouvré mon sang-froid. Je l’accueillis comme si rien n’était plus naturel que sa visite. Je lui pris la main, je la gardai, je lui parlai tendrement. Cependant j’éprouvais un trouble voluptueux à voir la femme que j’avais aimée, que j’aimais encore, dans le secret de mon appartement. Elle me quitta bientôt. Je l’accompagnai à la porte, je passai mon bras autour de sa taille, mais comme eût pu le faire un frère à sa sœur.
Je pensai à elle deux ou trois fois pendant le dîner en face de Mme V…, et même un peu plus tard.
Moins d’une semaine après, Madeleine réapparut. Mme V… avait déjeuné chez moi ce même jour. Il devenait périlleux de les recevoir toutes deux rue de Commailles. Je donnai à goûter à Madeleine. Je préparai le thé moi-même sans permettre à ma vieille bonne de nous déranger. Madeleine me suivait des yeux. Je plaisantais avec elle, j’étais tendre. Elle avait l’illusion qu’elle se mêlait de nouveau à ma vie, elle était heureuse.
Elle évita de s’asseoir sur le divan et choisit une petite bergère basse qu’avait élue quelques heures plus tôt Mme V… Le hasard qui rapprochait ainsi dans le temps et dans l’espace mes deux amies me fit sentir combien Madeleine m’était la plus chère. Je pris un coussin et m’assis près d’elle. Comme nous causions, mon attention fut attirée par son pied, chaussé d’un soulier découvert sur un bas de soie qui laissait voir la chair. L’envie me vint de poser ma main sur ce pied. J’y résistai, mais l’envie revint, plus forte d’avoir été contrariée, et me harcela. Il me semblait que je m’affirmerais ainsi toujours maître de Madeleine qui était mienne, après tout, et à qui j’avais accordé seulement de brèves vacances. Ce que je ferais d’elle, je n’en savais rien encore, mais je montrerais par là que mes droits n’étaient pas prescrits. Ce raisonnement était d’une rigueur telle que j’y cédai aussitôt. Sans cesser de parler, j’avançai la main et la mis sur le pied de Madeleine.
Ce geste inattendu la surprit, mais, chose curieuse, elle ne retira pas son pied, elle ne me demanda pas d’enlever ma main, elle fit comme si rien ne s’était passé. Elle croyait peut-être que nous nous étions rencontrés involontairement, qu’emporté par la chaleur de la discussion je ne m’en étais pas aperçu, qu’une remarque donnerait de l’importance à ma méprise, que le moindre mot nous placerait l’un et l’autre dans une fausse situation et que, sans paraître prendre garde à cet incident, il était préférable d’attendre en feignant l’indifférence que je retirasse ma main.
Le contact établi entre Madeleine et moi se prolongea ainsi bien plus que je ne l’avais prévu. Chez des gens qui se sont aimés et qui se fuient, le moindre rappel de la chair se fait entendre fortement. Le sang de Madeleine battait au bout de mes doigts. Un désir impérieux me prit de la posséder. Un instant j’hésitai, me demandant si elle partageait mon désir. Peut-être ses sens plus lents n’étaient-ils pas encore éveillés. Peut-être acceptait-elle comme dénué de signification ce qui était devenu pour moi la plus raffinée des caresses. Peu importe, ma main allait remonter le long de sa jambe lorsque, d’un mouvement brusque, elle retira son pied.
Je la regardai. Pâle, les yeux fixés sur moi, elle voulait parler et n’y arrivait pas. Elle froissait dans sa main un petit mouchoir de soie bleue. Je le reconnus ; il appartenait à Mme V… Madeleine l’examinait, en respirait le parfum comme s’il allait lui apporter des renseignements sur celle qui l’avait laissé là… Puis elle le jeta vivement loin d’elle, disant :
— Quel dégoût !
Elle se leva, fit quelques pas vers la porte. Si je l’avais laissée sortir, elle serait partie sans pouvoir placer un mot, bien qu’elle brûlât de m’accabler de son mépris et de sa colère. Elle s’arrêta donc, espérant que je lui fournirais l’occasion de parler. J’étais très jeune, je perdis la tête ; la vue de sa douleur m’émut ; je ne supportais pas l’idée qu’elle s’en allât ainsi, peut-être pour toujours. Égarée, que lui arriverait-il ? elle se ferait écraser ;… la rue du Bac menait à la Seine,… je ne la reverrais jamais !… Je courus à elle et la retins.
Elle se défendit, j’insistai et l’entraînai jusqu’au milieu de la chambre. Alors elle éclata, j’entendis les reproches les plus violents, les plus amers dont une femme hors d’elle-même peut vous accabler en telle occasion. Était-ce Madeleine qui parlait ? Hélas ! la fureur ramène nos amoureuses à une commune mesure dans l’absurde et dans l’incohérence. Ce qui lui tenait le plus à cœur était que je recevais cette « créature » dans l’appartement où elle, Madeleine, était venue, où elle venait encore. J’étais donc sans vergogne, comme tous les hommes. Et moi, à qui elle avait tout sacrifié, pour qui elle avait failli perdre son âme, je lui donnais pour remplaçante une fille ! Seule, une fille avait un mouchoir de soie si violemment parfumé !… Elle retourna au mot remplaçante. Était-ce une remplaçante ? Ne l’avais-je peut-être pas eue avant elle, Madeleine ? en même temps qu’elle, Madeleine ?… Arrivée à ce point de son discours et se représentant de si noires trahisons, elle fondit en larmes et devint pareille à une pauvre petite fille malheureuse, secouée par la douleur et qui ne demande qu’à être consolée.
Je m’y employai de mon mieux, mais je ne pus user du remède le plus approprié, c’est-à-dire la prendre dans mes bras, car, lorsque je l’essayai, elle frissonna et s’écarta. J’en fus réduit à la raisonner, à lui dire avec douceur un mélange de choses tendres et sensées, à l’assurer par mille serments que je n’avais jamais aimé qu’elle, qu’elle tiendrait dans ma vie une place unique, que je ne m’étais résolu à « cela » (impossible de risquer le mot maîtresse) que parce qu’elle m’en avait supplié et que, comme elle, je ne voyais pas d’autre moyen de salut, que j’étais prêt à y renoncer sur le champ pour peu qu’elle me le demandât, que cela ne me coûterait rien, que je quitterais Paris si elle le voulait. Je réussis à la calmer. Elle m’écouta, elle me crut et, lorsqu’elle partit, la blessure qui la faisait souffrir encore n’était plus empoisonnée.
Je restai étourdi par la violence de cette scène. A la réflexion, je pensai qu’il était inévitable que Madeleine apprît un jour l’existence d’une Mme V… ou X… Elle avait chancelé sous le choc. Elle reprendrait son équilibre et finirait par accepter une situation qu’elle avait elle-même créée.
Mais moi, continuerais-je à m’en satisfaire ? De cette journée dramatique, un souvenir effaçait presque tous les autres, celui du désir impétueux qui m’avait poussé vers Madeleine. Sans l’incident du mouchoir, je la prenais de gré ou de force. J’avais rêvé effusions du cœur, commerce tendre des âmes. J’étais loin de compte. Que faire maintenant ? Dans mon trouble, je multipliai les rendez-vous avec Mme V…, espérant y trouver l’apaisement. Mes sens ne prirent pas le change. Je ne cessai de désirer Madeleine.
Pendant près d’une semaine, je ne la vis pas. Elle n’était pas rue du Cherche-Midi quand je m’y présentai, ou bien, souffrante, elle ne pouvait me recevoir. Je m’inquiétai ; je supposai le pire. A mon tour, je devins nerveux, agité ; je dormais mal.
Lorsque je la rencontrai enfin, elle était, en apparence tout au moins, calme et résignée. Mais elle s’alarma de la mine que j’avais. Étais-je malade ? Il fallait me soigner, et sans retard. Connaissant son grand cœur, je me gardai de la rassurer. Elle me gronda tendrement, elle ne pensait plus qu’à moi. Finalement elle me fit part, devant son mari, d’un beau projet qu’elle avait conçu.
Sa fille se remettait à peine d’une bronchite. Les Sées passeraient Pentecôte prochaine à Orville, ils m’invitaient à les accompagner. Charles me ramènerait à Paris le mardi ; elle ne rentrerait qu’après le dimanche de la Trinité. La chère créature se promettait de ces courtes vacances mille félicités innocentes, promenades matinales le long des prés couverts de rosée, goûter dans les fermes, ô le bon lait tout frais tiré ! soleil sur la plage pour me rendre des couleurs. Je pensai qu’elle était heureuse aussi à l’idée de m’éloigner de la rue de Commailles. J’acceptai sans me faire prier.
Nous arrivâmes à Orville au milieu de l’après-midi. Bientôt, la petite Geneviève s’endormit sur les genoux de sa grand’mère ; Charles de Sées causait agriculture avec M. de Clairville ; la pipe à la bouche, ils allèrent jusqu’à la ferme.
Madeleine montrait un visage apaisé. Elle me souriait et je ne lisais dans ses yeux que bonté, que douceur. M’avoir à elle seule, loin de Paris, du matin au soir, était-il un bonheur plus grand ? Elle se sentait en pleine sécurité, et c’est sans arrière-pensée qu’elle accepta d’aller avec moi à la rencontre de son père et de son mari.
Nous traversions des prés fraîchement coupés ; une fine odeur de thym et de menthe se mêlait à celle de l’herbe qui avait séché toute la journée au soleil. La beauté de la lumière, le changement si complet de décor nous avaient comme enlevés à nous-mêmes, nous oubliions nos chagrins récents, nous n’étions plus que deux êtres jeunes et aimants qui se promènent au crépuscule dans la campagne. Nous causions de je ne sais quoi ; les mots que nous disions avaient, certes, moins de sens que le murmure de la brise qui se levait. Avec la nuit elle soufflait de la mer dont elle nous apportait la fraîcheur. Les arbres s’éveillaient de leur tiède sommeil diurne et agitaient lentement leurs branches. A cette heure autrefois les peupliers en bordure de notre parc chuchotaient de toutes leurs feuilles dorées par les derniers rayons du couchant et je me répétais alors ces vers magnifiques :
Je regardai Madeleine ; l’air jouait avec l’écharpe légère qui couvrait sa poitrine. Ces vers me revinrent à la mémoire ; je les lui récitai. La juste cadence des mots, leur musique l’émurent, et aussi, sans doute, ma voix et l’accent que j’y mis.
M. de Clairville et Charles de Sées n’étaient pas à la ferme. Nous rentrâmes, rêvant plus que parlant, indifférents au chemin que nous suivions. Les ombres des arbres s’allongeaient sur la prairie. Le hasard, — ou quelque attraction secrète — conduisit nos pas. Ils nous menèrent au bouquet de hêtres où nous nous étions assis l’an dernier en un jour pareil à celui-ci. A peine y étions-nous entrés, un flot de souvenirs nous assaillit avec une telle violence que nous nous arrêtâmes. Les yeux baissés, je me laissai emporter vers un passé si récent et pourtant si loin de nous déjà. D’un cœur douloureux, je refis les étapes trop vite parcourues : la plage où elle cherchait la trace de mes baisers sur les joues de sa fille, l’heure enfin où, sous ces mêmes branches, mes lèvres avaient bu à sa bouche, nos luttes, puis la séparation. Ah ! je m’étais trompé en croyant que je pourrais si facilement me priver d’elle. Et maintenant elle était morte pour moi ; une force supérieure me l’avait ravie ; je ne la verrais plus défaillante de plaisir entre mes bras. Je restais accablé sous de telles pensées.
Appuyée à un arbre, Madeleine était immobile, pâle, perdue en elle-même. Sentant le poids de mon regard, elle leva la tête. Je ne pouvais parler. Deux mots pourtant vinrent expirer sur mes lèvres :
— Jamais plus !
Ils arrivèrent jusqu’à elle et y réveillèrent des résonnances profondes et fortes, car elle frissonna. Je compris qu’elle souffrait comme moi à évoquer les mêmes images. Je m’approchai, tremblant d’émotion.
— Laissez-moi, Philippe, dit-elle d’un ton pitoyable, je ne suis pas si forte que vous le croyez.
Après le dîner, Madeleine allégua la fatigue du voyage et monta chez elle. Je me couchai de bonne heure, mais les mots qu’elle avait dits chassaient le sommeil. Elle était dans un lit voisin, réveillée elle aussi, tendue vers moi de tout son être en révolte ; puis elle se levait et s’agenouillait pour prier longuement comme à Notre-Dame-des-Victoires. Je revis l’église sombre, je respirai l’odeur d’un parfum profane mêlée à celle de l’encens. Je m’endormis enfin, il faisait clair déjà.
Je ne la retrouvais qu’à midi. Nous nous asseyions à peine à déjeuner qu’on apporta un télégramme. Un oncle de Charles de Sées avec lequel il était peu lié venait de mourir dans une propriété près de Laigle. Il ne laissait pas d’enfants et l’on demandait son neveu pour les formalités légales. M. de Sées ne reviendrait que le lundi matin. Je décidai aussitôt de rentrer à Paris. Mais les parents de Madeleine et Charles lui-même protestèrent. Pourquoi les priver de ma présence à cause du bref voyage de M. de Sées ? Ils ne l’entendaient pas ainsi. Je leur avais promis trois jours ; ils ne me tenaient pas quitte à moins. Je remarquai que Madeleine se bornait à appuyer très faiblement les objurgations des siens. Je me laissai pourtant convaincre. L’après-midi j’accompagnai Charles jusqu’à Bayeux. Craignant de rester seul avec Madeleine, je flânai dans la vieille ville et devant la tapisserie de Guillaume le Conquérant. Je regagnai Orville à pied.
Une irritation sourde m’empêchait de sentir ma lassitude. Madeleine semblait plus morte que vive. Elle fuyait mon regard, mais, comme je me détournais d’elle, je vis qu’elle me suivait des yeux. Elle ne prit aucune part à la conversation pendant le repas. Par une saute d’humeur que je ne m’expliquai point, je fus assez brillant et amusai les Clairville. Mais dans tout ce que je disais de général, il y avait une pointe secrète qui ne pouvait être sentie que par Madeleine, et sentie à la façon d’un aiguillon qui blesse. Je payai cette dépense de moi-même par un grand abattement après le dîner. La soirée, heureusement, fut brève, on se couche tôt à la campagne. Nous fûmes laissés un instant en tête à tête. Madeleine me dit avec timidité :
— Vous avez l’air fatigué, Philippe.
— Cela n’a pas d’importance, répondis-je en haussant les épaules.
J’étais de nouveau, sans savoir pourquoi, à bout de nerfs et continuai sèchement :
— Vous auriez mieux fait de me laisser partir.
— Je vous demande pardon, dit-elle humblement, d’une voix si faible que je l’entendis à peine.
Mme de Clairville rentrait. Peu après, nous nous séparions.
Je redoutais la solitude de ma chambre, et non sans raison. Dès que j’y fus enfermé, une tempête se déchaîna en moi. La volonté de Madeleine, et sa volonté seule, créait une situation absurde. Quoi, nous étions tous deux dans cette maison, libres pour une fois, et nous ne passions pas la nuit ensemble. Au lieu des rendez-vous hâtifs de Paris où l’on a à peine le temps de se déshabiller, où l’on se prend montre en main, elle pouvait s’endormir et se réveiller sous mes baisers, me prodiguer les siens, sentir même dans son sommeil mon corps contre son corps, et elle ne venait pas ! Bel amour, en vérité, que la religion maîtrisait si facilement !…
Et si j’allais la surprendre ? Elle serait à ma merci. Pour descendre chez elle, un escalier de bois… Il craquerait. Ses parents, vieilles gens au sommeil léger, se réveilleraient… Un scandale !
J’étais hors de moi de désir et de fureur. Je poussais les volets, j’avais besoin d’air pur. Le vent s’était levé et emplissait l’ombre de son souffle puissant. J’entendais le froissement des branches agitées dans le bois voisin et le cri d’amour mélancolique et flûté d’un crapaud au bord d’une mare. Le calme de la campagne nocturne m’apaisa.
Je fermai les volets et me préparai à me coucher. Il était près de minuit. Refoulant les images et les idées qui m’avaient obsédé, il fallait dormir… Un craquement du parquet devant ma chambre me rendit la fièvre. Ah ! ah ! Madeleine venait enfin ! Je savais bien que rien ne la retiendrait ! Il était, parbleu, impossible qu’elle ne vînt pas… D’un bond, je fus à la porte et l’ouvris… L’obscurité, rien…, j’attendis encore. Me serais-je trompé sur Madeleine ? Étais-je assez fou pour croire qu’elle m’aimait au point de risquer quelque chose pour moi ?… Je rentrai dans la chambre et m’allongeai sur le fauteuil. Ce dernier sursaut d’espérance si vite déçue m’avait brisé. Je restais sans force. Dans l’engourdissement qui me gagnait, j’entendis un grincement de gond, ah ! si léger que d’abord on pouvait s’y méprendre. Mais non, il se prolongeait, il emplissait la maison. Une porte s’ouvrait !… Je courus à la mienne et, debout, frémissant, je me mis à écouter comme seul un amant attendant sa maîtresse sait écouter. Je ne vivais plus que par les oreilles… Et d’abord le silence, un siècle de silence, les années s’accumulaient sur moi… puis, soudain, comme au commandement d’un chef d’orchestre invisible, le bruit d’une marche d’escalier qui gémit sous la pression d’un pied, car il n’y a pas d’erreur possible, une feuille de parquet qui joue sous l’influence de la température ne rend pas le même son qu’une marche d’escalier sur laquelle un pied, même avec mille précautions, même déchaussé, se pose. Ce bruit me parut vibrer si fort que je vis du coup maîtres et domestiques alarmés se précipiter hors de leurs chambres en criant : « Au voleur !… » Rien, une nouvelle onde de silence interminable ; j’étais un vieillard !… je retombai dans mon fauteuil… Un craquement, tout proche, me rendit la jeunesse. Mais il m’était impossible de bouger ; je n’entendais plus maintenant que le battement précipité de mon cœur.
Et voilà que ma porte s’ouvrit. Surgie de l’ombre, Madeleine apparut, en peignoir, les cheveux dénoués, les pieds nus. Elle tremblait un peu, son visage avait une gravité qui me frappa. Elle vint à moi, mit ses bras autour de mon cou et, penchant la tête sur mon épaule, elle dit :
— Je mourais loin de toi !
Je me réveillai en sursaut. Quelle heure était-il ?… Madeleine dormait, à moitié couchée sur moi, la bouche près de la mienne, comme si le sommeil l’avait surprise au milieu d’un baiser. Dans la demi-obscurité, je voyais l’arc de ses lèvres un peu gonflées. Il faisait à peine jour. A travers les rideaux, de la clarté filtrait. Je me levai doucement et, ne voulant pas frotter une allumette pour allumer la lampe, j’allai à la fenêtre et entr’ouvris les volets.
Des brumes traînaient sur les prairies qu’argentait la rosée ; le vent était tombé ; le soleil devait être au ras de l’horizon, mais caché par une ondulation du terrain ; tout était paix et calme dans la campagne silencieuse. Je regardai la pendule, elle marquait quatre heures.
Je me retournai vers le lit. La chemise de Madeleine avait glissé, laissant l’épaule et le sein gauche nus. Qu’elle était belle ainsi et digne d’être aimée ! L’amour l’avait portée jusqu’à ma chambre. J’oubliai nos âpres combats, j’oubliai ma jalousie, un passé empoisonné. Elle m’appartenait tout entière ; purifiée au feu de la passion, elle n’avait jamais été la femme d’un autre, elle n’appartiendrait jamais qu’à moi. Je ne pensais qu’à la douceur de nos étreintes, qu’à jouir d’elle encore ; la nuit n’était pas finie ; j’avais soif de ses baisers. Je me penchai sur son sein et y posai ma bouche. Elle dormait si profondément qu’elle ne sentit pas mes caresses. Je la pris dans mes bras.
— Mon amour, dis-je, c’est moi !
Engourdie, les yeux clos, flottant entre la veille et le sommeil, elle m’enlaça, et ses lèvres, ah ! certes, elles n’étaient pas réveillées ! balbutièrent un mot jailli de l’inconscient d’elle-même, d’habitudes empreintes en sa chair par sept années de vie conjugale, un mot qui me glaça :
— Charles !
Je me relevai brusquement et la repoussai. Elle retomba sur l’oreiller, et, innocente de ce qu’elle avait dit, continua à dormir. Je restai immobile, les yeux fixes. D’un mot que je ne pouvais même pas lui reprocher, elle m’éloignait de cent lieues. Pour se défaire de moi, elle avait accumulé les arguments les plus touchants ; ses supplications et ses larmes étaient demeurées sans effet ; je l’avais poursuivie, je l’avais eue. Elle avait appelé Dieu à son secours. Il n’était pas nécessaire d’aller si haut et de se donner tant de mal. Une arme plus efficace était sous sa main, mais interdite. Au moment du plus grand péril, Madeleine instinctivement s’en emparait et, sans le vouloir, me portait un coup mortel. Un seul nom suffit pour me rappeler qu’elle était à un autre et que ma possession d’elle ne serait jamais que précaire et partagée. Pour l’oublier, je m’étais grisé de sophismes, j’avais interprété à ma guise le peu que je savais des rapports existant entre elle et son mari. Elle ne l’aimait pas, elle ne l’avait jamais aimé ! Eh ! qu’importe ! C’était lui — Charles ! — qui l’avait faite femme. Elle n’avait connu, ou subi, que ses caresses et lorsque, plus qu’à moitié endormie, elle sentait une bouche sur son sein, c’était le nom de son mari qui lui montait aux lèvres.
Je me répétais machinalement : « Impossible ! impossible ! » Aucune explication ne devait avoir lieu. Sur quel ton parler à Madeleine maintenant ? que lui dire ? Il n’y avait qu’à fuir sans attendre un jour. Cette idée devint si forte que je me levai et commençai à m’habiller. Allais-je vraiment sortir de cette maison à la minute ? Je m’arrêtai. Sans plus réfléchir, je m’assis sur le bord du lit où Madeleine n’avait pas bougé.
Un rayon de soleil presque horizontal franchit la fenêtre.
J’étais las, indifférent, à peine curieux de ce qui se passerait. Quel démon avait jeté ce nom dans la nuit ? Tout arrivait en vertu de forces obscures qui échappaient à notre contrôle. Elles me chassaient d’Orville ; je n’opposais aucune résistance, je ne me plaignais pas, je partais.
Ce qui me restait de sentiment, je le dépensai au profit de Madeleine. J’avais le cœur serré en songeant à elle. Que penserait-elle de mon départ dont je lui cacherais la cause ?… Puis je me détachai du présent et notre situation m’apparut comme si, des années s’étant écoulées, j’en raisonnais à distance. Qu’attendre de plus d’un amour condamné à la mort ? Il était brusquement tranché par le couperet de la guillotine, mais il avait porté tous ses fruits. Madeleine rentrerait dans le devoir. Elle vivrait entre son mari, sa fille et son Dieu, des jours un peu gris, un peu ternes, où passerait parfois, tel un éclair qui déchire la nue, le souvenir éblouissant de son péché.
Ce n’était pas le temps de m’attendrir sur moi-même. Je me raidis, j’étais décidé à ne pas souffrir. Je n’avais rien à reprocher à Madeleine. J’étais seul responsable. Mon tort avait été de lui demander un bonheur qu’elle ne pouvait me donner. Puisque j’étais exclusif et jaloux, qu’avais-je à faire d’une femme mariée ? Si douloureuse que fût l’épreuve, il fallait en charger mes seules épaules et ne pas gémir sous le faix.
Je tâchais ainsi — mais y réussissais-je ? — de m’endurcir, lorsqu’un soupir presque enfantin me rappela à l’humanité. Madeleine se réveillait dans un désordre charmant, rejetait en arrière ses cheveux défaits, remontait la chemise qui, glissant, l’avait laissée demi-nue, rentrait sous le drap une jambe qui sortait du lit. Souriante et un peu honteuse, elle se redressa.
— Philippe, dit-elle.
Je la vis heureuse, confiante, parée des grâces de l’amour et pourtant avec un rien de confusion dans son regard qui cherchait le mien. Chassant mes soucis amers, je me penchai vers elle. Elle me prit dans ses bras et, soudain détendu à la tiédeur de son sein, je sentis mes yeux se gonfler de larmes. Une d’elles glissa le long de ma joue et tomba sur l’épaule de Madeleine. Elle pensa, sans doute, qu’après tant d’épreuves j’étais ému jusqu’à pleurer de joie. Fière de mon amour, elle me caressait.
— Comme tu m’aimes ! dit-elle. Je t’aime aussi.
Nous restions accolés, presque fondus de tendresse. Pourtant je la tenais pour la dernière fois serrée sur mon cœur et cette pensée déchirante me la rendait plus chère encore, m’attachait plus étroitement à elle, car en ce moment le bonheur et la misère se mêlaient en moi de telle façon que je n’en pouvais discerner les fils inextricablement noués. Je la couvrais de baisers dont je ne savais si c’était ceux que l’on échange, un mouchoir à la main, quand on se dit adieu, ou ceux que la passion prodigue à une maîtresse adorée.
Le bruit d’un volet claquant contre le mur mit fin à nos transports.
Madeleine sursauta.
— Quelle heure est-il ? demanda-t-elle.
L’horloge du village répondit en sonnant six coups.
Nous nous retrouvâmes à la messe de dix heures. Madeleine ne leva pas les yeux sur moi. Après le déjeuner où le malaise entre nous était si visible que M. et Mme de Clairville eux-mêmes le perçurent, je proposai par politesse, et certain d’être refusé, une promenade à pied. Je passai mon après-midi à arpenter les falaises d’Arromanches à Port-en-Bessin. Orville m’était devenu insupportable. Je ne pensais qu’à fuir avant que M. de Sées rentrât. Je regagnai la maison tard dans l’après-midi, recru de chagrin et de fatigue. Je vis Madeleine seule un instant et j’eus soin de lui montrer un visage rasséréné, sinon heureux. Je lui dis que je jugeais préférable de m’en aller le lendemain matin. Pour d’autres raisons que les miennes, elle m’approuva et se chargea d’expliquer mon départ à ses parents et à son mari.
Le lundi de bonne heure, comme le char-à-bancs qui m’emmenait à Bayeux sortait de la cour, Madeleine apparut à sa fenêtre. Elle agitait une écharpe en signe d’adieu. Elle essayait de sourire. Aurait-elle pu retenir ses larmes si elle avait su que je la quittais pour toujours ?
A Paris, je me rendis au ministère des affaires étrangères où je faisais depuis trois ans un stage. Un poste était vacant à Constantinople. Je l’obtins. Mes affaires personnelles furent rapidement réglées.
Madeleine prolongeait, du reste, son séjour à Orville. Je lui écrivis pour lui dire ma décision. Je n’eus pas de peine à mettre dans les mots que je lui adressai de l’émotion et de la tendresse. Il me suffit de laisser parler mon cœur encore plein d’elle.
Avant qu’elle rentrât à Paris, je prenais le train pour Marseille, porte de l’Orient.
Cependant que je réglais ainsi le cours extérieur de ma vie, je restais en moi-même blessé et douloureux. A Paris pendant les trois semaines qui suivirent la fatale nuit d’Orville, je me tâtais anxieusement pour circonscrire l’étendue de ma plaie. Je procédais avec des précautions inouïes comme un malade qui sait que, s’il fait tel geste, il réveillera un mal aigu, mais qui dort. Jusqu’à tel point, je ne souffrais pas. J’explorais la région neutre où je pouvais me mouvoir sans risques. L’ayant reconnue, je décidai de ne point sortir de cette zone indolore : « De quoi s’agit-il, en somme ? me disais-je. De ne pas penser à Madeleine ? N’est-ce pas une question de volonté ? Ne puis-je l’exercer efficacement ? Si Madeleine se présente à mon esprit, chassons-la, quel que soit l’aspect sous lequel elle apparaisse, quelles que soient les ruses qu’elle imagine pour me demander audience. En ce moment, elle n’est pas mon amie ; elle ne reviendra près de moi que pour me tourmenter ; avec elle il n’est point de repos. »
Il fallait donc ne pas me perdre dans les rêveries sentimentales où se plaisent — et s’empoisonnent — les amants malheureux. Je déployais une énergie incroyable à fuir Madeleine. Où qu’elle se montrât, je lui tournai le dos, je ne la saluai plus, je la traitai en ennemie. Tous les moyens m’étaient bons pour me distraire. Je fis de la culture physique, des muscles se gonflèrent sur mes bras et sur mon torse. Hélas ! lorsque j’étais à demi nu, les haltères à la main, c’est elle qui, silencieuse, me regardait. Je m’occupai de mes affaires, je dressai des comptes, je vécus parmi les chiffres. Le total des additions donnait immuablement Madeleine.
Exaspéré de la vanité de mes efforts, j’adoptai audacieusement un parti opposé. Je me contraignis à ne penser à rien autre et à la voir seulement comme la femme de son mari. Je croyais pouvoir me détacher d’elle par l’évoquer en des postures dégoûtantes. « Le jaloux… est obligé à joindre en son esprit l’image de la femme qu’il aime aux parties honteuses et aux excréments d’un autre… » dit Spinoza.
Je me mis ainsi à la torture, mais je ne me dépris point de Madeleine. Pourtant dans les crises les pires de ma passion, j’eus la force de résister aux montées subites de désir qui me poussaient à la rejoindre à Orville où elle était toujours. Quelque chose s’était brisé à jamais ; cela au moins je le voyais clairement.
Au moment de partir j’étais au comble du désespoir. Je n’attendais plus ma guérison que d’un changement complet de décor et d’habitudes. Y avait-il encore pour moi un baume en Arabie ?
Il ne me fut pas nécessaire d’aller si loin. A peine le pied sur le bateau, je sentis que commençait une existence nouvelle. Tout me plaisait, l’agitation du port, le bruit des camions retentissants, les sifflets, la lumière éblouissante, la légèreté de l’air, sa transparence, l’azur des flots et du ciel, et même la chaleur d’un midi méridional tempérée par la brise marine. Mille petits drapeaux préparés pour le 14 juillet claquaient au vent. Je m’étonnais d’avoir pu vivre jusqu’ici sous les cieux gris du nord ; en les quittant, je laissais derrière moi, bagage inutile, les années passées, leurs tristesses, leurs soucis. Ce beau bateau qui filait vers le Levant emportait un être ardent et fier que rien, désormais, ne pourrait humilier.
C’est avec une véritable ivresse qu’accoudé au bastingage, je regardais les maisons serrées de Marseille, ses monuments, ses jardins fuir à l’horizon. Déjà le bateau cherchait son équilibre sur la houle régulière qui venait du large ; de petites vagues écumeuses couraient le long de ses flancs noirs. Des souvenirs classiques hantaient mon esprit. Entendrai-je chanter les sirènes ? Ah ! j’étais décidé à ne pas me couler de la cire dans les oreilles, à ne pas me faire attacher au mât du navire.
A cet instant une voix féminine, pleine et riche, prononça mon nom à quelques pas. Je me retournai vivement.
Une jeune fille était là, grande, mince, le teint ambré, l’expression grave et douce à la fois. Qui était-ce ? Aussitôt, je trouvai. L’ovale du visage, les yeux étroits, les longs sourcils arqués :
« Isabelle ! m’écriai-je. Et pourtant combien changée d’elle-même ! »
C’était, en effet, Mlle Saint-Aignan, que je n’avais pas revue depuis deux ans au moins. Je lui tendis la main et, d’un mouvement rapide, joyeux, irréfléchi, je passai mon bras gauche autour de sa taille comme si j’avais peur qu’elle ne m’échappât. Ce geste inattendu pour elle le fut pour moi plus encore. Lorsque je l’avais quittée, elle était une enfant fermée et sauvage. Comment pouvais-je reconnaître, dans la jeune fille qu’elle était devenue, une amie ? Comment savais-je tout de suite, sans un mot échangé, que les liens anciens, plus solides que je ne le croyais, loin de se rompre avaient pris de la force pendant l’absence ? Et ce ne fut pas la seule chose que j’appris en un espace de temps si bref. Je m’aperçus que la solitude où j’avais vécu récemment, à laquelle je m’étais condamné, que je croyais bonne et salutaire, me faisait horreur, que je n’étais pas destiné à être malheureux et à nourrir des pensées sombres. Un coup d’œil suffit à dissiper les nuées tristes dont je m’entourais. Le soleil n’emplissait-il pas le ciel ? N’avais-je pas près de moi une fille souriante ? Tout cela en une seconde. On assure que l’homme qui va mourir voit en aussi peu de temps la longue suite des jours qu’il a vécus défiler devant ses yeux. Je ne voulais pas mourir, mais peut-être dans un regard vis-je toute ma vie à venir…
Cependant mon bras gauche restait autour de la taille d’Isabelle. L’absence de préméditation, l’ingénuité, pouvaient seules excuser ce geste. Elle le comprit, elle se dégagea non pas brusquement, mais avec lenteur. Ainsi à la minute où nous nous retrouvions, nous nous montrions capables d’agir dans des circonstances délicates, et sans nous être concertés, en parfaite harmonie. Il y eut un instant de silence, puis commença une vive conversation à bâtons rompus. Que d’événements, petits et grands, durant une si longue séparation ! A nous entendre, à voir l’intérêt que nous prenions à nos bavardages, il semblait que nous eussions à nous en raconter pour toute la traversée. Cependant je ne cessais d’examiner Isabelle, et avec quel sérieux ! C’était à croire que je n’avais jamais vu une jeune fille. Combien me plaisait l’éclat répandu sur ce visage, sa pureté, sa fraîcheur rayonnante ! Et je faisais peu à peu une merveilleuse découverte : cet éclat, cette fraîcheur, cette pureté ne pouvaient émaner que d’une jeune fille, ils lui appartenaient en propre, ils étaient comme la fleur de son corps intact. Je sentais que seul a du prix ce qui n’a été touché par personne et que le plus rare, le plus beau présent qu’une femme puisse offrir à un homme est sa virginité. Le souvenir me traversa, à la façon d’un coup de poignard, de la nuit où, évoquée par deux lèvres innocentes mais impures, l’ombre de mon prédécesseur m’avait arraché aux baisers de la femme que j’aimais.
Mme Saint-Aignan et sa fille allaient passer le reste de l’été et l’automne à Constantinople où les appelaient le soin de leurs affaires et leur plaisir. Mme Saint-Aignan qui supportait mal la mer ne sortait pas de sa couchette.
Isabelle fut à moi seul. Nous ne nous quittions point. L’aube nous trouvait sur le pont que les matelots lavaient à grande eau et les nuits étaient si douces que nous ne nous décidions pas à regagner nos cabines. Nous longeâmes la Sicile ; puis la mer Ionienne agitée nous berça. Le lendemain, au petit jour, nous étions ensemble pour voir surgir des nuées du levant et des flots gris la masse rocheuse du cap Matapan. Isabelle, dont la culture était peu livresque et en avait à mes yeux plus de charme, ne partageait que par sympathie l’émotion qu’éveillait en moi l’idée de débarquer en Grèce.
Lorsque nous fûmes devant Athènes, elle me dit :
— Constantinople est plus beau !
Nous passâmes l’après-midi sur l’acropole. Une lumière ambrée et légère baignait les marbres des temples, les pierres écroulées à leur pied et, au loin, les pentes violettes du Lycabète. Isabelle préféra l’Érechthéion au Parthénon. Dressée le long d’une colonne, le corps plein, la tête petite aux cheveux ondulés, ne figurait-elle pas une vivante cariatide ? Les Niké du petit musée l’arrêtèrent :
— Elles ont des bras ronds, gros, bien en chair. Ce sont de fortes filles de la campagne. Mais ce sourire me trouble. Elles n’ont pas l’âme paysanne.
A Smyrne, premier contact avec l’Orient, Isabelle eut la coquetterie de paraître voilée presqu’à la façon d’une dame turque. Lorsqu’elle arriva sur le pont où je l’attendais, je surpris un peu d’inquiétude dans son regard. La trouvais-je à mon goût ? Voilà la seule question qui la préoccupât. Ainsi s’arrangeait-elle pour me faire comprendre, sans oser me le dire, qu’elle désirait me plaire.
Dans l’ombre poussiéreuse du bazar, des marchands accroupis au seuil de leur boutique nous offraient des colliers d’ambre, des étoffes lamées, des tapis. Une odeur d’épices emplissait l’allée couverte. Par une porte donnant sur la campagne, des chameaux mélancoliques, roux et désabusés, montrèrent leur cou pelé et leurs longues dents jaunes.
Des plaisirs variés et purs, un beau décor changeant, la présence continue d’Isabelle, je souhaitais que ce voyage n’eût pas de fin. Aucun retour offensif du passé ; j’étais guéri. Si je pensais à Madeleine, c’était sans amertume. Déjà cet amour participait à la grandeur et à la sérénité des choses mortes. Je ne disais plus : « Si… » Il était un tout auquel je ne pouvais rien ajouter, dont il ne fallait rien supprimer. Mes souffrances m’avaient accouché de mon être véritable. Elles étaient les étapes douloureuses, mais nécessaires, de mon développement. Grâce à elles, je n’ignorais plus où chercher le bonheur. Celui que je goûtais aujourd’hui auprès d’Isabelle, ne le devais-je pas aux pleurs versés dans les bras de Madeleine ?
Nous vivions sur ce bateau avec une simplicité et un naturel qu’on aurait peine à imaginer. Toute idée de ruse, d’artifice, de dissimulation était aussi éloignée de l’esprit d’Isabelle que du mien. Pourquoi aurait-elle cherché à jouer un personnage puisqu’à l’instant où elle m’était apparue elle m’avait séduit en étant elle-même ? Pourquoi aurais-je dressé des plans pour conquérir un cœur qui ne se défendait pas ? Notre entente, nous n’éprouvions aucun besoin de l’exprimer par des mots, nous en jouissions comme du ciel et de l’air. Nous ne parlions pas de l’avenir, nous ne faisions pas de projets. Nous ne pensions qu’à nous connaître plus complètement. Il semblait que la tâche fût infinie à voir l’ardeur que nous y apportions. Et pourtant ce que nous avions à apprendre ainsi était secondaire, car la seule chose qui importât, nous la savions depuis longtemps déjà sans nous la dire. Elle nous avait été révélée à la minute où nous nous étions retrouvés. Rien n’était capable d’altérer la certitude que nous avions gagnée alors. Nous savions que nous serions l’un à l’autre…
Parfois nous causions sérieusement, de Constantinople et de la vie qu’y menaient, non les Européens mais les Turcs. Dans son langage où les choses graves et les choses légères s’entremêlaient d’une façon charmante, Isabelle me disait qu’elle trouvait honorable pour une femme de ne connaître et de n’aimer qu’un homme : « Je n’en demande pas davantage », ajoutait-elle en souriant. Elle parlait un peu le turc et me donnait des leçons avec une application incroyable, comme s’il était vraiment utile pour ma carrière que je l’apprisse.
Puis soudain, nous redevenions des enfants. Ce n’étaient que jeux, devinettes, énigmes, rébus, marelle, courses à cloche-pied, shuffle board. Isabelle était adroite. En un exercice, je triomphais, car j’étais seul compétiteur. Je me laissais descendre en tournant, les jambes relevées à angle droit, le long d’une de ces colonnettes minces, en cuivre, qui soutenaient le pont supérieur. J’arrivais ainsi, tel un clown, assis à terre après m’être dévidé autour de la colonnette. L’admiration, l’envie et le rire se disputaient Isabelle ébahie. Le rire l’emportait.
On conçoit que lorsque Mme Saint-Aignan nous rejoignit à l’entrée de la mer de Marmara ces folies ne furent plus de mise.
Du reste nous touchions au terme du voyage. Vers la fin de l’après-midi, nous nous penchâmes, Isabelle et moi, à l’avant du bateau pour voir le ciel s’embrumer à l’orient. Des poussières grises étaient suspendues au-dessus de la ville qu’elles nous cachaient. Au crépuscule, elles se dorèrent dans les rayons du soleil. Une coupole, puis d’autres se montrèrent et les pointes blanches effilées des minarets montant comme un cri vers le ciel. Une double ville immense, désordonnée, apparut sur des collines entre lesquelles coulait un fleuve aux flots bleus. Mille fenêtres s’illuminèrent aux feux du couchant. Les noirs cyprès des cimetières fusaient au milieu des maisons basses ; des terrasses surplombaient la Corne d’Or ; des palais, des jardins descendaient jusqu’au bord de l’eau. Le Bosphore était couvert de paquebots et de barques, le vent enflait les voiles, déchirait les panaches de fumée et nous les apportait avec les appels rauques des sirènes. Je sentis frémir dans la mienne qui la tenait enfermée la main d’Isabelle. Nous étions à Constantinople.
Six semaines plus tard — il n’y avait pas trois mois que j’avais quitté Orville — notre mariage fut célébré à la chapelle de l’ambassade de France.
Un homme aime une femme et l’attire à lui. Préparée au bonheur, elle sait où elle va. Mais Isabelle ignorante !… Riche de cent expériences, à quoi me servaient-elles ? J’avais en face de moi une fille chaste et vierge ! J’étais son mari depuis quelques heures, j’allais être son amant. Ma rencontre déjà ancienne avec Henriette ne m’avait rien appris. Cédant tous deux à une poussée violente de l’instinct, Henriette avait été heureuse en même temps que blessée.
La nuit… Un couple pour la première fois enlacé, un corps qui tremble et qu’on veut épargner, cette ardeur de l’homme qu’il faut contenir, les mots tendres qui rassurent, les promesses, tout un balbutiement fervent et mystérieux, puis le silence, un silence brusquement rompu !… Ah ! je n’oublierai jamais Isabelle meurtrie, confuse et fière, se pressant contre moi, ses joues humides de larmes, les baisers timides et maladroits qu’elle me prodiguait. Je la gardai dans mes bras, j’effleurais doucement cette chair sans histoire où aucun souvenir ne s’éveillait sous ma main caressante. Isabelle était ma femme. Je baignais dans la joie, une joie complexe et grave. J’apprenais enfin pourquoi la nature a mis sur les jeunes filles un sceau. Elles donnent ainsi l’absolu à un homme qui, comme moi, ne doit être que le premier, l’unique. Si non, incertitude, déchirement. Isabelle dans le lit nuptial m’avait montré la voie qui mène à la vie bienheureuse. Ce que je pressentais depuis la nuit d’Orville trouvait ici sa confirmation. Je me penchai vers elle, je baisai son front pur. Vaincue par la fatigue, elle dormait, la tête sur ma poitrine. Son souffle frais et régulier s’accordait aux mouvements de mon cœur et, le long du mien, son corps s’allongeait désormais sans crainte.
Nous habitions sur la rive d’Asie.
Nous avions trouvé, entre Tchoubouklou et Béikos, une maison turque isolée au bord du Bosphore dans une position charmante. Mme Saint-Aignan et ses amis avaient crié à la folie. Mais comment résister au désir de quitter l’Europe ? Isabelle y tenait plus que moi encore. Vivre en Asie, fût-ce à un mille de Thérapia, était si tentant que nous n’hésitâmes point. Nous ignorions les conséquences lointaines d’une décision en apparence anodine.
Notre maison était construite en bois au ras de l’eau ; une seule grande salle tenait tout le rez-de-chaussée du côté du Bosphore. Sur le jardin, divisé en deux et clos de hauts murs, plusieurs pièces complétaient ce que nous appelions le sélamlik. Au premier étage, l’appartement des femmes, une série de petites chambres, regardait la côte d’Europe par ses fenêtres artistement grillagées de bois. On ne pénétrait dans le harem qu’avec difficulté. Il fallait franchir cinq portes dont la seconde se fermait automatiquement quand on ouvrait la première, et ainsi de suite. Ces précautions enchantaient Isabelle.
— Tu vois, lui dis-je, que je pourrai t’enfermer maintenant.
— Ah ! répondit-elle, crois-tu qu’une fois derrière ces portes, j’aurai jamais envie de m’échapper ?
Le harem avait son jardin et, dans le jardin, un pavillon pour les servantes. Nous étions riches, en outre, d’un hamman et de communs où se trouvaient la cuisine et le logement des serviteurs.
Nous résolûmes de conserver ces sages divisions et de régler autant que possible notre vie à la turque. Mais nous étions frileux et installâmes partout de grands poêles de faïence russes achetés à un de mes collègues qui rentrait à Saint-Pétersbourg.
Nous avions l’ambition de ne pas introduire des meubles européens dans notre yali, au moins dans la pièce du rez-de-chaussée où nous nous tenions. Cela restreignait singulièrement notre choix et nous dûmes nous borner à mettre le long des murs des divans chargés de coussins, et, près des divans, les petites tables basses, rondes ou octogonales, incrustées de nacre, d’écaille, ou d’ivoire, sur lesquelles les Turcs posent leur tasse de café ou leur cigarette.
Pour cette pièce, nous voulions des tapis anciens, seul et rare luxe de l’Orient. Ces recherches nous firent courir Stamboul. Bientôt tous les marchands et courtiers du vieux bazar et de Péra nous connurent. C’étaient avec eux des conciliabules sans fin, des rendez-vous mystérieux, des visites faites à des maisons perdues dans des quartiers lointains. Nous prenions à cette chasse aux tapis un vif plaisir, nous ne nous pressions pas d’acheter, la poursuite en elle-même avait son prix. Chemin faisant, nous trouvions un beau morceau de velours oriental, une soie brochée, une toile persane peinte à la cire où brillaient des poussières de mica. Un arbre touffu y était représenté ; à son pied, deux lions s’affrontaient et des oiseaux jouaient au milieu de ses mille fleurs blanches. Chaque matin, dès notre réveil, deux ou trois barques attendaient devant notre maison. C’étaient des courtiers qui nous apportaient quelques merveilles découvertes par eux, un tapis yordès « sur lequel le sultan Mahomet II lui-même avait prié », un ispahan miraculeusement conservé pour nous au fond d’un palais, et dont la fraîcheur faisait dire au marchand : « Il est comme une jeune fille ! », un velours à personnages datant de Chah Abbas. Le yordès avait été refait hier au bazar, l’ispahan n’avait pas un brin de laine qui fût ancien, le velours n’était guère plus âgé que moi. Mais les histoires de ces hommes ingénieux nous amusaient autant que celles des mille et une nuits. Certains d’entre eux étaient si fins que, voyant le plaisir qu’Isabelle avait à parler turc, ils affectaient de ne pas savoir le français. Nous les écoutions en déjeunant dans la salle presque vide. Dès le printemps les fenêtres étaient ouvertes et l’air frais qui venait du Bosphore caressait nos pieds nus.
L’hiver fut consacré aux soins de notre installation. L’été revenu, nous connaissions déjà chaque place, chaque rue, chaque monument de Stamboul, du château des sept tours au fond mystérieux d’Eyoub, des terrasses si belles du vieux sérail aux ruines du palais de Constantin. Les mosquées nous accueillaient, discrets visiteurs ; dans tous les quartiers des échoppes s’ouvraient où nous étions traités en amis.
Avant la nuit, nous remontions le Bosphore en caïque, suivant les plis et les replis de la rive d’Asie. Nous nous arrêtions à un village qui paraissait tout entier construit sous le platane trois fois centenaire qui l’abritait. Un proverbe dit : « Où le Turc a passé, l’herbe ne pousse plus. » Ce proverbe doit avoir une origine arménienne ; je n’avais vu nulle part au monde de tels arbres. Un petit café était là, où l’eau chauffait sur des braises. Le cafedgi, vieil homme à la longue barbe blanche, nous recevait en souverains étrangers débarqués chez lui, souverain comme nous. Nous ne rentrions que lorsque mille lumières s’allumaient autour de Thérapia. Du fond de notre obscurité asiatique, nous jouissions du feu d’artifice que l’on nous offrait.
Notre vie s’arrangeait sans peine. J’allais à l’ambassade le matin par le bateau qui touche à Galata vers onze heures. Souvent Isabelle venait m’y chercher en caïque et nous déjeunions dans quelque restaurant turc de Stamboul. Ou bien elle arrivait au milieu de l’après-midi et nous regagnions Tchoubouklou par le chemin des écoliers.
Au début, nos rapports avec les Européens se réglèrent simplement, nous étions de jeunes mariés ; on nous laissa tranquilles. Nous arrangions notre maison ; on ne vint pas nous voir. Nous eûmes ainsi huit ou dix mois de répit où nous prîmes la délicieuse habitude d’être deux et de nous suffire. Isabelle se nichait dans son bonheur et n’en voulait pas bouger. Elle regardait la rive d’Europe, admirable spectacle, et se félicitait chaque jour de n’y point habiter. Sa seule crainte était que je trouvasse monotones les jours que nous passions ensemble.
— Ne t’ennuieras-tu pas ici ? disait-elle, je ne suis qu’une petite fille, et ignorante. Saurai-je te garder ?
De tels propos emplissaient mon cœur de joie. Tout en Isabelle me plaisait ; je ne me lassais pas d’être heureux par elle, gaie ou sérieuse, bavarde ou taciturne, aimante et tendre toujours, et mienne absolument.
A Tchoubouklou, elle s’habillait d’étoffes claires et éclatantes à la façon des dames turques de jadis. Elle glissait ses pieds nus qu’elle avait fort beaux dans des babouches. Et déjà lorsqu’il fallait mettre une robe à l’européenne, des bas et se chausser pour sortir, elle soupirait :
— Tu ne m’aimeras pas ainsi, n’as-tu pas épousé une orientale ? Qu’attends-tu pour m’enfermer derrière les cinq portes du harem ?
Elle découvrit au vieux bazar une robe d’honneur boukhare ancienne, d’une ampleur incomparable, un khalat merveilleux en tapisserie au petit point où sur un fond grenat s’enlevaient des bouquets de vives fleurs. Elle m’acheta aussi des sandales persanes, des guivets en fines cordelettes tressées. J’endossai le khalat qui est le plus confortable vêtement d’intérieur et chaussai les guivets. Nous nous harmonisions ainsi avec la décoration de la grande pièce où nous habitions. Parfois des touristes passaient devant nos fenêtres en canot à pétrole et nous regardaient curieusement.
— Ils nous prennent pour des Turcs, disait Isabelle enchantée. Mais ils ignorent, ces nigauds, que si j’étais turque, je ne me laisserais pas voir.
Sans sortir de chez elle, mais grâce à des relations — les relations, c’étaient de vieilles femmes voilées qui entraient assez mystérieusement par l’arrière du jardin — elle avait trouvé un cuisinier turc qu’on appela, comme il convient, hadji-bachi. Ce hadji-bachi, complété d’un ou deux garçons de cuisine, m’établit par raison démonstrative la vérité d’une phrase que m’avait dite à Paris un pacha bien connu.
— Il n’y a que deux cuisines mères, la française et la turque.
Le hadji-bachi avait cent et une manières, toutes excellentes, de préparer les légumes et le riz, les œufs, la volaille, le poisson, l’agneau, et, un mois durant, se piquait de ne pas nous faire manger deux fois le même plat.
Lorsque j’étais absent, Isabelle s’occupait avec ses servantes dont le nombre n’était pas exactement fixé. La première femme de chambre répondait au nom de Souzidil, la seconde était Nilfer, les autres restaient pour moi anonymes. Un jour, c’était une couturière qui dormait à la maison, parce qu’il était trop difficile de rentrer chaque soir à Constantinople. Elle finissait par loger chez nous. Peut-on se passer d’une couturière ? Et la couturière pouvait-elle travailler sans une apprentie ?
Deux rameurs étaient attachés au service du caïque, qui aidaient aussi à leurs moments perdus le jardinier. Un arménien, Agop, servait de valet de chambre et de maître d’hôtel et se faisait seconder par un de ses petits compatriotes, Onyk. Toutes les femmes habitaient soit les pièces de derrière au premier étage, soit un pavillon élevé dans le jardin dépendant du harem.
Je donne ces détails bien qu’ils puissent paraître de peu d’intérêt, mais, comme on le verra par la suite, ils ont leur importance et doivent trouver leur place ici. Cependant le mécanisme d’une vie si différente de celle que j’avais connue m’amusait et j’y pénétrais sans effort. J’avais été élevé en province par la plus sage des mères ; à la maison, où tout était calculé et ordonné avec une minutieuse prévoyance, nous avions trois domestiques qui faisaient en quelque sorte partie de la famille et, le jeudi, une ouvrière pour la journée. Mais je prenais les habitudes de l’Orient ou, mieux, je m’y laissais aller mollement. Et déjà, il me semblait difficile de recommencer un jour l’existence étroite que l’on mène en Europe. J’aimais d’être entouré de nombreux serviteurs, de voir passer à l’arrière-plan dans l’ombre du harem des figures féminines dont je ne savais rien, sinon qu’elles étaient à mes ordres.
Mais, en face de nous, l’autre rive nous appelait. A la belle saison, les villas et les hôtels de Thérapia s’étaient remplis. Nous avions des amis et des relations qui nous réclamaient ; en outre, des visites obligées, toujours remises, à faire. Mes collègues, leurs femmes, me plaisantaient sur notre lune de miel indéfiniment prolongée. Je voyais que bientôt nous ne pourrions plus suivre le cours voluptueux et paisible de nos heures asiatiques.
Il fallut consacrer quelques fins d’après-midi à des devoirs de politesse. Isabelle en souffrit plus que moi qui avais conservé par mon service à l’ambassade un contact avec les Européens. Une fois chez les gens, elle montrait toute la bonne grâce possible, bien qu’elle fût timide. Mais lorsqu’elle en sortait, c’était un soupir de soulagement. Notre installation excitait la curiosité. Nous vivions à la turque, paraît-il. Avions-nous des esclaves ? Nous nous étions meublés de la façon la plus originale.
On demandait à Isabelle quand on la trouvait à la maison. Elle éludait. — Ne prendrait-elle pas un jour ? — Plus tard, répondait-elle. La seule idée d’avoir « un jour » dans notre yali était absurde.
Et voici qu’un matin nous reçûmes de l’ambassadeur d’Autriche-Hongrie qui était de nouveau à Péra une invitation à dîner. Un refus était difficile, quasi-impossible. Mais que de problèmes se posaient à la pauvre Isabelle ! Le temps pouvait se gâter. Il ne fallait pas songer à se rendre à Constantinople en caïque et à rentrer la nuit. Alors coucher à Péra ! Drame !
Nous avions déjà discuté l’achat d’un canot à pétrole. Isabelle y était opposée ; elle aimait flâner sur l’eau. Court-on le Bosphore à toute allure dans l’odeur de l’essence ? Mais un canot me serait utile pour aller à Constantinople en hiver quand le service des bateaux à vapeur est diminué. L’invitation à l’ambassade d’Autriche, qui serait suivie d’autres, sans doute, nous obligea à prendre un parti. Un canot nous conduirait à Galata et nous regagnerions facilement la rive asiatique. Peu de jours après, le petit port de notre yali abritait un canot. Isabelle le regardait d’un œil hostile. Elle n’en aurait jamais aucun plaisir. Pourtant il me permettait de rester plus tard chez nous le matin et me ramenait plus tôt auprès d’elle l’après-midi. Je m’accoutumai vite, je l’avoue, à ce bateau si rapide qui me transportait en un clin d’œil, comme le tapis d’un magicien, de Tchoubouklou à Thérapia ou à Constantinople. Et nous voici, au bout d’un an de mariage, munis, chacun, de notre bateau !
A mainte reprise pendant l’hiver, Isabelle prétexta une indisposition et ne m’accompagna pas à des dîners diplomatiques. Rien ne lui paraissait plus insipide qu’une réunion mondaine ; elle prenait les choses au sérieux et ne savait pas s’adapter au ton frivole qui est de mise dans un salon. Elle était belle ; les hommes l’entouraient et lui faisaient la cour. Elle le supportait mal. Parfois elle en riait avec moi, parfois elle s’irritait.
— Qu’est-ce que cette société européenne ? me disait-elle. Les femmes, celles du moins qui sont assez jeunes pour en trouver, ont des amants. Les maris ne l’ignorent pas, ferment les yeux, et cherchent une maîtresse à leur goût. Les femmes s’exhibent à moitié nues. Une Turque appartient à son mari et ne montre son visage à personne. Je connais l’une et l’autre vie, je préfère la turque.
Mais ma femme, jeune et sage, si elle allait peu sur la rive d’Europe ne me retenait pas en Asie. Elle savait quels sont les devoirs, les habitudes et les plaisirs d’un homme. Ceux d’une femme étaient selon elle si différents qu’elle ne voyait ni l’avantage, ni la possibilité, de les mêler. Elle m’était reconnaissante de me charger seul des corvées qui sont généralement communes aux deux sexes. Quand je revenais vers minuit, elle me fêtait, me demandait mille détails. M’étais-je diverti, m’étais-je ennuyé ? Avais-je une jolie voisine à table ? Elle n’acceptait le monde que raconté par moi. Elle ne montrait aucune jalousie ; elle n’en ressentait point. Elle me voyait heureux près d’elle ; j’étais tendre, je me plaisais en sa compagnie dans ce beau yali qui n’était qu’à nous. Si j’étais obligé de me mettre en habit de soirée pour sortir, elle disait que j’étais beaucoup plus beau vêtu de mon khalat boukhare, et que les guivets persans sont une chaussure plus agréable que les souliers vernis.
A la maison, les heures lui paraissaient brèves. Même lorsque le mauvais temps avec l’hiver s’établit, que les vents froids descendaient de la mer Noire poussant parfois des tourbillons de neige devant eux, que le Bosphore se hérissait de vagues courtes et dures, Isabelle, condamnée à passer chez elle des journées entières, ne s’ennuyait pas. A quoi s’occupait-elle quand je vaquais à mon service ? Je ne saurais vraiment le dire. Elle rêvait ou réfléchissait beaucoup sur les mêmes questions, opposant la dignité de la vie turque à la légèreté et à l’inconsistance de la nôtre. Parfois, un écho de ces longues méditations m’arrivait par un mot qui sonnait juste et allait loin.
Elle s’était liée avec quelques grandes dames égyptiennes ou turques qui ne sortaient qu’accompagnées et voilées. Elle s’intéressait à tout ce qui touchait à leur mode d’existence ; elle m’en parlait souvent. Ces dames parfois se plaignaient d’être recluses. Isabelle en était surprise, car elle les jugeait dignes d’envie. Elle les recevait dans notre yali ; pas un homme ne paraissait.
Un jour, en hiver, revenant de Constantinople, je trouvai Isabelle causant en turc avec une petite fille accroupie au pied du lit, à la figure maigre et pâle, l’air sauvage, les yeux noirs farouches. Cette enfant se leva à mon entrée — elle était plus grande que je ne croyais — s’inclina, me saisit la main et la porta à ses lèvres. Puis, elle recula et resta immobile, attendant les ordres d’Isabelle.
— Qu’est-ce que cette fille ? demandai-je.
— C’est une petite Circassienne qui est née dans un harem, dit ma femme. Sa mère est morte. Je l’ai trouvée chez une amie, elle m’a plu. On m’a offert de la prendre ici. On sait qui nous sommes, que nous avons une maison et que, près de moi, elle mènera une vie convenable. Elle n’a que douze ans, mais on me dit beaucoup de bien d’elle. Je saurai l’occuper. Elle ne nous gênera guère et je la garderai, à moins que tu ne t’y opposes.
Je me mis à rire.
— Ces choses-là sont de ton domaine, dis-je, et non du mien. Comment s’appelle cette sauvageonne ?
— Djémila, répondit Isabelle. C’est un joli nom.
Elle sut, en effet, « occuper » l’enfant Djémila. Elle lui apprit le français et en fit une poupée. Elle s’amusait à la parer, à lui tailler des robes et des pantalons bouffants. Elle l’emmenait dans son caïque, mais, à l’été déjà, elle ne la laissait plus sortir le visage découvert.
Nos amis européens qui avaient cru à un caprice d’Isabelle, à un désir passager de jouer à la vie turque, qui n’y voyaient peut-être que le prétexte inventé par une jeune femme, et amoureuse, pour n’être pas dérangée au début de son mariage, finirent par comprendre qu’ils s’étaient trompés. Isabelle était de plus en plus rare à Constantinople. Quand, par hasard, elle y venait, on la taquinait gentiment sur sa « turquerie ». Elle souriait et ne répondait pas. Elle était si manifestement heureuse, elle se montrait si certaine de l’excellence de son choix, que les plaisanteries cessaient bientôt. Tous s’accordaient à dire qu’elle était charmante et que j’étais un mari privilégié. Méritais-je un si rare bonheur ?
Isabelle, à l’automne, ne put se refuser à entr’ouvrir sa maison de Tchoubouklou. Elle invita à un goûter les personnes avec qui nous étions en relation.
Lorsque, rentrant de l’ambassade, j’arrivai à notre yali devant lequel étaient amarrés de nombreux canots et caïques, et que je pénétrai dans la grande pièce du rez-de-chaussée, je fus surpris de voir Isabelle n’être entourée que de femmes. Aucun de mes collègues, aucun des jeunes gens des banques n’était présent. Toutes ces dames s’extasiaient sur le goût qui avait présidé à notre installation. Quelques-unes remarquèrent que notre intérieur ne ressemblait pas à celui des princesses turques qu’elles visitaient. Chez celles-ci, on trouvait des mobiliers de mauvais style européen, surchargés de dorures. D’autres déclarèrent, avec un sourire, que les divans étaient bas et mieux faits pour y être couché qu’assis. Les cinq portes du harem les enchantèrent. On en parla longtemps. Je cherchai vainement le maître d’hôtel, Agop, et son second, Onyk ; ils avaient disparu. Mais toutes les femmes d’Isabelle s’empressaient à servir des sorbets, de la chira qui est un cidre de raisin léger, de l’aïran, ou petit lait glacé, des glaces, des sirops, des confitures, des pâtisseries, des bonbons, des noisettes pilées et des fruits magnifiques. La petite Djémila, que je n’apercevais presque jamais et qui me parut singulièrement embellie, en pantalon d’étoffe lamée et en boléro brodé, ne quittait pas sa maîtresse.
On fut unanime à déclarer que la réception était un « succès » et la plus originale de la saison.
Après le départ de nos hôtes, je dis à Isabelle qu’il était curieux qu’aucun homme ne fût venu.
— Je n’en ai pas invité, me répondit-elle. Toi seul as le droit d’entrer dans mes appartements. Ne trouves-tu pas cela mieux ainsi ? continua-t-elle en passant les bras autour de mon cou et en m’offrant ses lèvres. Le peu que j’ai t’appartient tout entier.
Quelques jours plus tard, nous célébrâmes le second anniversaire de notre mariage. Les femmes nous apportèrent des fleurs au matin ; le hadji-bachi se surpassa pour le dîner. Le soir, Agop tira un petit feu d’artifice devant la maison. Le yali était en joie. Je donnai à Isabelle une parure ancienne en grosses améthystes qu’un juif m’avait trouvée dans un harem. Elle la porta aussitôt. Cette fête à deux la charmait plus que tout au monde. Le rêve qu’elle avait caressé depuis son enfance s’était réalisé.
Tandis qu’elle se préparait pour la nuit, je sortis prendre l’air sur la terrasse. Après une journée encore chaude, la brise plus fraîche se levait à peine. En face de moi la rive d’Europe étincelait de mille feux dont les reflets se mêlaient dans les eaux calmes du Bosphore à ceux des étoiles.
La date où nous étions, et l’heure, prêtaient à la méditation. Un passé proche et pourtant lointain me sollicitait ; je mesurai le chemin parcouru en peu d’années. Madeleine y arrêta mes yeux. Comme je l’avais aimée, avec quel déchirement ! Mais comment n’avais-je pas vu tout de suite qu’un tel amour était condamné à une prompte mort ? Comment avais-je été assez fou pour croire qu’une femme qui ne m’appartenait point pouvait me rendre heureux ?
Isabelle avait écarté de moi jusqu’au souvenir de cette époque troublée. Sa jeunesse, son corps intact, sa santé morale m’avaient guéri de mes fièvres anciennes. En laissant derrière moi l’Europe, j’avais quitté la région des orages. De la rive où ma femme m’avait conduit je regardais au loin les hommes s’agiter dans des passions sans honneur et sans sécurité. Quelle sagesse innée en Isabelle ! Enfant déjà, quelques-uns de ses mots m’avaient surpris par leur justesse ; elle mettait l’homme et la femme à la place qu’ils doivent occuper. Depuis notre mariage, Isabelle s’était peu à peu emparée, avec une industrie merveilleuse, de tout ce qui, appartenant à une civilisation différente, pouvait servir à consolider notre union.
Comment imaginer notre existence au bord de la Seine ? Comment n’y pas perdre ce qu’il y avait de précieux entre nous ? Les restaurants, les théâtres, les bals, Isabelle entourée de jeunes femmes vaines, obligée de les imiter au moins dans leurs toilettes, une existence brillante et vide ! Des hommes l’auraient entourée. Je n’eusse pas supporté qu’on essayât de la séduire.
Au sein de notre retraite asiatique, aucune dissipation à redouter. Tout nous ramenait à nous-mêmes. Isabelle ne vivait que pour moi. Le moindre prétexte, maintenant, lui était bon pour refuser les invitations de l’autre côté de l’eau. Elle n’agissait pas ainsi par esprit de devoir, mais dans un mouvement joyeux de l’âme et, si elle se retirait du monde, c’était pour jouir plus voluptueusement du grand amour qu’elle avait au cœur.
Au début, peut-être avais-je ressenti à sortir avec elle un puéril orgueil de propriétaire. Ces bouffées légères de vanité s’étaient vite évanouies. Aucune pensée mesquine ne pouvait se développer dans l’atmosphère créée par Isabelle…
Et soudain une question surgit, interrompant le cours serein de mes méditations : « Quelle sera la fin de tout cela ? »
Le ciel me parut s’obscurcir, un vent froid souffla de la mer Noire ; je frissonnai à la seule idée de prévoir un terme à mon bonheur. Je me retournai ; tout était calme dans notre yali endormi. Il y avait encore de la lumière chez ma femme. Aucun mal ne me viendrait d’elle. Elle ne changerait pas. Mais moi ? Jusqu’ici j’avais été porté de l’une à l’autre au gré de mes passions. Mon caractère se modifierait-il ? Resterai-je épris jusqu’à la mort d’une même femme ? Accepterai-je un établissement qui durerait autant que nous ? Isabelle bâtissait pour toujours. Elle coupait un à un les liens qui nous attachaient au passé. Jamais elle ne reviendrait en Europe !… De nouveau, j’eus peur.
Mais je n’étais pas d’humeur à me tourmenter. Le contact de l’Asie déjà m’amenait à la sagesse. J’écartai doucement l’importune question. Nous étions heureux dans le présent. Il fallait en remercier le Clément, le Miséricordieux. Il pourvoirait à l’avenir.
Cet été-là — y avait-il trois ou quatre ans que j’étais marié ? — fut très brillant à Constantinople. Quelques yachts ancrèrent devant la Corne d’or. Nous eûmes la visite d’un parlementaire français, littérateur et membre de l’Académie. On donna en son honneur des fêtes. Je ne pouvais me dispenser d’assister à des dîners officiels.
Lassé par la persistance de ses refus, on commençait à ne plus inviter Isabelle. Elle en était ravie. Elle goûtait chaque jour davantage son existence recluse. Maintenant elle ne se tenait presque pas au rez-de-chaussée, trop exposé à la curiosité des passants. Elle habitait les chambres du premier étage. De celles qui donnaient sur la campagne, la vue s’étendait au loin et, les jours clairs, jusqu’à la masse élevée de l’Olympe de Bithynie. C’est là qu’elle m’attendait à la fin de l’après-midi lorsque je revenais de mon service.
Souvent des collègues à moi profitaient de mon canot pour regagner Thérapia. Je les y posais avant de rentrer, ou bien ils me ramenaient à Tchoubouklou et je les faisais conduire jusque chez eux. Voyant qu’ils ne dérangeaient personne, ils pénétraient parfois dans la grande pièce vide où Agop, expert en toutes choses de son métier, apportait des boissons internationales.
Un jour je rapatriai ainsi un secrétaire américain récemment arrivé à Constantinople avec sa femme. Celle-ci était une Irlandaise d’une éblouissante couleur. Elle regretta de ne pas faire la connaissance d’Isabelle, « légèrement souffrante », mais le yali lui plut. Cette salle nue dont tout le luxe était sur les murs et le parquet lui parut quelque chose d’« horriblement bien ». Il fallait y donner un bal avec fête vénitienne. Elle allait de-ci de-là, dansant presque, parlant toujours. Je m’amusais à la regarder. Elle avait une petite tête d’oiseau, mais le plumage était ravissant. Des cheveux bois d’acajou, un teint qui obligeait à croire que, dès son enfance, elle avait été uniquement nourrie de lait et de pétales de roses et que, depuis cette peu lointaine époque, un dieu, jaloux de préserver l’éclat d’une telle fraîcheur avait étendu sur elle, où qu’elle allât, une couche de brumes légères pareilles à celles qui flottent au-dessus de son île natale, un œil grand, lumineux et doré, une bouche si petite qu’on n’imaginait pas qu’elle pût servir à autre chose qu’à respirer et qu’on était tout étonné de la voir absorber en trois gorgées un cocktail. Cette Irlandaise parfumée avait pour prénom Diane, qu’elle prononçait à l’anglaise Daiana.
Je racontai cette visite à Isabelle et la fis rire en lui décrivant la Daiana aux cocktails, ses projets de bal et de fête vénitienne. Isabelle me demanda beaucoup de détails ; il fallut même décrire la toilette de l’étrangère, ce à quoi j’étais, comme la plupart des hommes, malhabile. Isabelle ne voulait pas se mêler au monde, mais les échos que je lui en apportais l’intéressaient encore ; elle apprenait ainsi ce qui retenait mon attention.
J’aimais la vie nocturne du Bosphore. La magnificence du paysage, la douceur de la température, la beauté des nuits orientales ne cessaient de m’enchanter.
J’avais plus d’une façon d’en jouir.
Un soir nous étions en caïque, ma femme et moi ; nous nous laissions mollement bercer entre les deux rives, les musiques de Thérapia venaient mourir jusqu’à nous. De grands bateaux filant vers le nord et l’orient nous frôlaient. Ils allaient aux ports russes ou turcs de la mer Noire et les noms que je prononçais à voix haute, Poti qui est aux bords du Phase, Batoum, Inéboli, Trébizonde, faisaient lever devant nous un essaim de rêves voyageurs. Je restais à demi couché, Isabelle serrée contre moi, et, comme tente à notre embarcation, le sombre velours du ciel piqué d’étoiles. Alors, au milieu de la nuit tiède, dans l’odeur de ce jeune corps qui m’appartenait, je récitais des vers qui avaient poussé et mûri sur la vieille terre d’Asie, les quatrains où Khayyam chante, pour nous le rendre plus précieux, la précarité de notre bonheur :
O Khayyam, si tu es assis près d’une adolescente sans rides, sois heureux !
Isabelle ne parlait pas, mais la pression de sa main montrait que chaque mot des vers admirables du poète avait pour elle un sens et la touchait. J’étais heureux !
Et je ne l’étais pas moins peut-être, le lendemain, par un soir aussi beau. Les terrasses illuminées d’un jardin de la côte d’Europe, les femmes décolletées, les tziganes, du vin, cette atmosphère de fête dont on se lasse à la respirer continûment, mais à laquelle j’étais fort sensible quand je sortais de mon yali asiatique, une société aimable et mêlée, des gens accourus de toutes parts, avides d’épuiser les plaisirs de ces lieux avant de les quitter demain, la fièvre latente de l’Orient qui accélère le pouls, voilà ce que je trouvais en quittant Isabelle. Si obscur que je fusse, j’excitais la curiosité. Ne vivais-je pas à la turque ? Les uns disaient que j’étais jaloux de ma femme au point de l’enfermer dans un harem. D’autres ajoutaient qu’elle n’y était pas seule. Aussi me regardait-on plus que je ne le méritais.
Daiana était là. On nous voyait beaucoup ensemble. Elle montrait des épaules blanches comme neige, elle était souple, légère. J’avais envie de jouer avec elle comme avec un jeune chat — elle en laissait voir la langue fine et rose, — de la rouler, de la caresser et finalement de la prendre sur mes genoux. Nous dansions ; j’aimais le parfum qui venait d’elle et je le lui disais. Parfois elle levait les yeux sur moi, ses yeux pleins d’une fausse innocence. Un jour, nous étions assis à l’écart, elle me dit d’un air ingénu, baissant les paupières, exagérant un peu son accent :
— Voulez-vous de moi dans votre harem ?
Elle s’arrêta un instant avant le mot harem.
Le coup était direct.
— Cette cage n’est pas faite pour un bel oiseau comme vous, répondis-je en plaisantant. La rive d’Europe vous convient mieux.
Tels étaient nos propos pertinents et hardis. Nos silences avaient aussi leur valeur. Qui m’aurait retenu ? Je sentais en moi l’ardeur à réussir qui m’avait possédé si souvent. Du reste, aucune crainte ! Je savais que, même poussé très loin, ce jeu ne ruinerait pas l’édifice élevé là-bas sur l’autre rive. La belle Irlandaise était mariée ! Merveilleux antidote, non contre le plaisir, mais contre l’amour.
Lorsqu’au milieu de la nuit, je regagnais notre yali et que le canot fendait les eaux noires du Bosphore, j’offrais ma tête nue au vent pour qu’il enlevât l’odeur persistante d’un parfum qui me hantait et, songeant à celle qui m’attendait dans une chambre close, frémissant à l’idée de retrouver un corps pur et des joies non adultérées, mon seul mot à l’homme de la barre était : « Plus vite ! »
Je goûtais ces contrastes. Cependant l’été se passait dans la dissipation. J’appartenais à l’Asie, mais l’Europe essayait de me reprendre. Elle usait, comme on voit, d’artifices pleins de charme. J’en sentais l’agrément ; j’en niais la force. Aussi je ne me défendais pas. Isabelle devina-t-elle le danger qui nous menaçait ? Elle ne me posait presque plus de questions sur mes soirées européennes. Pensait-elle que, l’aimant comme je l’aimais, je ne prendrais pas une maîtresse ? Jugeait-elle au contraire qu’en ma qualité d’homme j’avais droit au plaisir ? Mais qu’était le plaisir à ses yeux ? Où étaient ses limites ? Elle ne le connaissait que confondu avec l’amour. Savait-elle qu’il n’en est pas ainsi pour l’homme ?
Au lieu de vivre dans la paix que, sagement, elle me laissait, au lieu de bénéficier d’un doute qui m’était favorable, je fus pris d’inquiétude. Bientôt le mutisme d’Isabelle me pesa ; j’eusse préféré ses reproches. Son regard triste semblait fuir le mien. Que se passait-il derrière ce front fermé ? Je n’admettais pas que ce qui m’était un simple plaisir, plaisir auquel je renoncerais sans peine, fût une cause de souffrance pour Isabelle.
Un jour enfin, n’en pouvant plus d’incertitude, je parlai. On ne pénétrait pas chez Isabelle de plain-pied. Elle fuyait les confidences intempestives. Je lui fis sentir combien je m’affligeais de la voir préoccupée. Avait-elle des soucis ? Jugeait-elle que j’allais trop souvent le soir sur la rive d’Europe ? S’il en était ainsi, je resterais près d’elle sans lui sacrifier quoi que ce fût. Elle m’assura n’avoir aucune cause de tristesse. Elle était heureuse et ne demandait rien. Elle m’était reconnaissante de consentir à m’enfermer dans une maison isolée, avec une femme recluse à qui le monde faisait horreur. Il était donc naturel que j’allasse chercher au dehors les distractions qu’elle me refusait ici. Elle me dit ces choses si touchantes sur un ton de parfaite simplicité. Isabelle avait l’âme noble. On s’en apercevait en des moments comme celui-ci où les mots étaient chargés de plus de sens qu’ils ne paraissaient en contenir.
Je fus ému, mais sourdement irrité aussi. Je cherchais des choses contradictoires : j’usais de la liberté qui m’était nécessaire et agréable, mais je supportais mal qu’Isabelle en pâtît. Je lui en voulus de la douleur qu’elle me cachait et je m’armai contre elle des mots si généreux qu’elle venait de prononcer. Mais aurais-je toléré son indifférence ?
Et je revenais toujours à la même interrogation : que savait-elle au juste de mes amusements à Thérapia ? Elle avait parlé de « distractions ». Jusqu’où allaient les distractions permises ? Elle ne comptait plus d’amies européennes. Elle ne fréquentait guère que quelques dames turques de haut rang. Elle était ainsi, croyais-je, à l’abri des commérages de la colonie étrangère. Pouvais-je supposer — ce que j’appris beaucoup plus tard — que ma liaison, ou ce qu’on pensait être ma liaison, avec la belle Daiana occupait la société de Constantinople ? Je me suis toujours fort peu intéressé à la vie secrète des gens. Comment imaginer que la mienne excitât tant de curiosité ? Partout on parlait de nous ! Ce qu’on en disait — invention, calomnie, vérité — est trop dénué d’intérêt pour que je le rapporte ici. Ces histoires étaient racontées au fond des harems et l’écho en parvint jusqu’à Isabelle.
Elle eut la force de me le cacher. Elle me témoigna une égale tendresse. Si je ne m’étais senti coupable envers elle, aurais-je noté un changement dans son humeur ?
L’automne touchait à son terme. La saison de Thérapia perdait de son éclat. J’allais à l’ambassade. Mais Constantinople est une grande ville ; on y passe inaperçu. Du reste, je ne m’y attardais pas. Je ne quittais plus Isabelle après dîner. Nous passions à deux des soirées charmantes et un peu mélancoliques.
Pendant cette période troublée où tant de choses étaient mises en question, Isabelle n’envisagea pas un instant la possibilité de changer son genre d’existence. Nous avions une maison. Ce fait, en apparence secondaire, était important aux yeux de ma femme. Elle voyait là quelque chose de durable, de définitif, de presque sacré qui nous dictait des habitudes, des devoirs, et, bientôt, nous imposerait des traditions. Nous n’étions pas des nomades, comme les Européens du Bosphore. Tout était changeant dans leur vie, tout tendait à se fixer dans la nôtre. Chaque jour lui apportait une confirmation de l’excellence du choix qu’elle avait fait en venant habiter la rive d’Asie. Les seuls mots durs qu’elle se permit étaient à l’adresse des femmes qui se donnent facilement, montrant ainsi le peu de prix qu’elles mettent à leur personne. Mais elle n’accusait jamais les hommes ; la faute et la honte restaient aux femmes. Ainsi quoi qu’il arrivât, elle s’attachait davantage à notre yali de Tchoubouklou.
— Je finirai mes jours ici, dit-elle une fois.
Ces mots avaient quelque chose de pathétique sur les lèvres d’une femme si jeune. Et comment ne pas remarquer qu’elle disait « je » et pas « nous » ?
Bouleversé à de tels accents, je la pris dans mes bras ; je l’assurai que je ne l’abandonnerais jamais et qu’elle avait fondé notre bonheur sur un roc inébranlable.
Vers ce temps mon chef eut à m’envoyer passer une quinzaine à Paris pour affaires de service. Ma femme parut indifférente à cette nouvelle. Pourtant nous ne nous étions pas séparés une nuit. Mais, pleine de sens et de raison, elle jugeait bonne mon absence de Constantinople en ce moment ; je retrouverais ainsi, pensait-elle, l’équilibre. Il ne fut pas question pour elle de quitter Tchoubouklou. Elle avait pris racine en terre d’Asie. L’Orient-express m’emmena donc seul. Le malheur fut que, sans nous être concertés, l’Irlandaise et son Américain de mari qui avait un congé de six mois partissent, par le même train vingt-quatre heures plus tard. Cette coïncidence ne pouvait manquer d’être exploitée. On raconta que Daiana voyageait avec moi, sans son mari, et qu’elle occupait, ô cynisme, le coupé voisin du mien.
Isabelle ne m’avait pas accompagné à la gare, sinon elle aurait vu elle-même la créance qu’il convenait d’accorder à ces bruits. Mais elle redoutait la cohue de la gare, et d’y afficher sa tristesse. Elle me fit ses adieux à Tchoubouklou. Ces nouvelles données comme certaines arrivèrent à notre yali. Isabelle fut atterrée. Jusqu’ici elle avait choisi de vivre dans le doute : je m’amusais sur la rive d’Europe, je dansais avec l’Irlandaise, on nous voyait ensemble. Comment empêcher les langues de se déchaîner ? Mais cela prouvait-il que je la rencontrasse en secret ? Notre voyage à deux ne permettait plus, hélas ! d’interprétation favorable. Il fallait accepter l’idée que Daiana était une maîtresse. Le plaisir qu’Isabelle était prête à m’accorder allait donc jusque-là ! Elle avait souvent tourné autour de cette idée sans oser la regarder en pleine lumière. Maintenant rien ne restait dans l’ombre. Il y avait de quoi s’étonner ! il y avait de quoi souffrir ! Pendant l’été, Isabelle m’avait trouvé, à chaque fois que je revenais de Thérapia, joyeux et tendre. Avais-je cessé de l’aimer ? Non, certes. Dans l’atmosphère de notre yali, j’étais tel qu’elle m’avait toujours connu. Que ne donnerait-elle pour m’avoir encore ? Mais j’étais parti, j’avais quitté Constantinople ! Sous d’autres cieux, je l’oublierais ! Une aventurière, experte à séduire les hommes et à se les attacher, m’avait enlevé !
Cependant elle recevait de moi de longues et affectueuses lettres. Elle ne se rassurait pas et imaginait que je voulais adoucir sa peine. Mais ces lettres étaient écrites sous les yeux d’une rivale ! Est-il pire tourment ? Elle passa près de deux semaines angoissées.
Je revins ! avec un peu de retard dû aux lenteurs des bureaux. Elle ne m’attendait plus. Toute à la joie de me revoir, elle ne fut pas maîtresse d’elle-même. Ses larmes m’apprirent qu’elle avait cru me perdre.
Je la consolai sur mon cœur. Mais elle se reprit vite. J’apprenais à connaître l’admirable caractère de ma femme. Elle n’admettait pas d’être plainte. Un grand orgueil la soutenait et la poussait à prendre la responsabilité de notre bonheur. N’était-ce pas elle qui m’avait entraîné loin du commerce des hommes ? Elle avait à prouver que nous devions être heureux, elle et moi, plus que si nous avions mené la vie banale qui eût été la nôtre en Europe. Elle n’entendait pas s’avouer vaincue. Dans l’inquiétude où elle était, elle cherchait les causes de son échec. Et d’abord elle se reprocha d’avoir suivi trop uniquement ses goûts et de n’avoir pas pensé aux miens. Lorsqu’au début de notre mariage, je sortais sans elle, elle craignait, non de me laisser seul au milieu d’une société brillante, mais de me déplaire en ne m’y accompagnant pas. Pourtant elle restait à la maison. Elle fit un pas de plus. Elle comprit qu’eût-elle été avec moi, elle n’aurait pu me protéger contre certains assauts et qu’il y a dans l’homme le meilleur (j’étais tel à ses yeux) un élément inconnu, un démon qui, à certains moments imprévisibles, se réveille et ne s’arrête, pour se satisfaire, à rien. Quelle menace ! Et comment l’écarter ?
Elle était soucieuse, taciturne, mais se refusait à me communiquer ses pensées. Si j’en avais connu le cours douloureux, je l’aurais vite rassurée en lui disant que pas une minute je n’avais eu l’idée de la quitter pour suivre la belle et triviale Irlandaise. A mon insu un lent travail de réflexion s’opérait en elle et l’amenait à me regarder sous un jour nouveau. « Ce démon vivant dans ma chair, comment le détruire ? et si cela n’était pas en son pouvoir, comment le domestiquer ? » Voilà le thème de ses méditations. Il fallut quelques mois pour que j’en découvrisse l’aboutissant et je vis alors seulement jusqu’où l’amour et l’audace, mêlés à la crainte de me perdre, avaient conduit la solitaire Isabelle.
Un des soirs de cet hiver, comme je rentrais chez moi et qu’avant de rejoindre Isabelle, je m’occupais un instant au rez-de-chaussée, j’entendis venant du fond de l’appartement le son grêle d’une guitare. Ce n’était pas la première fois qu’un des serviteurs se divertissait ainsi au jardin ou dans le pavillon de la cuisine. Mais il me parut qu’une main plus savante m’envoyait aujourd’hui des accords et des modulations que je ne connaissais pas.
Je me mis à la recherche du musicien et arrivai à une petite chambre éloignée. J’y trouvai le maître d’hôtel Agop, qui ne me savait pas de retour, assis sur un divan et, à ses pieds, un homme vêtu de noir, coiffé de la kola persane. Il y avait peu de lumière et je ne distinguai de lui qu’une figure assez ronde, trouée par la petite vérole. Il tenait une guitare double. A mon entrée, il s’arrêta, se leva et resta immobile, les mains croisées sur le ventre. Agop m’expliqua aussitôt que mirza Ali était un lettré persan de grand mérite. Il l’avait rencontré naguère à Téhéran. Mirza Ali se rendait en Europe pour examiner dans les bibliothèques les manuscrits de son pays ; il n’était pas sans ressources, et en chemin séjournait à Constantinople.
Le mirza parlait français. Les yeux baissés, tortillant ses doigts un peu gros, il me fit un compliment avec tant de finesse naturelle et acquise, jointe de la façon la plus raffinée à une réserve et à une grâce respectueuses, que je fus pris pour lui d’une sympathie soudaine et résolus de ne pas le laisser quitter de sitôt notre yali. Nous causâmes des poètes persans que je lisais en traduction. Il corrigea sur-le-champ la version que je donnais de quelques vers et les fit apparaître dans une beauté nouvelle.
Enchanté de mon mirza, je l’invitai à loger chez moi, où il habitait, je l’appris plus tard, depuis une semaine.
En dînant, je racontai ma découverte à Isabelle. Tout ce qui venait de l’Asie, tout ce qui pouvait m’attacher à l’Asie, lui semblait excellent. Elle voulut voir le mirza et, le repas terminé, elle descendit. Mirza Ali s’exprimait avec un peu de difficulté. On pensait d’abord qu’il n’arriverait pas où il voulait aller, mais finalement il trouvait un chemin inattendu et charmant qui le menait au but. Il évoqua ainsi par petites touches en apparence insignifiantes et même parfois triviales la Perse fleurie, cultivée et rare des poètes.
La journée n’était pas achevée que j’avais décidé d’apprendre le persan sous la direction du mirza. Isabelle approuvait.
Je puis rester longtemps oisif, mais si j’entreprends une chose je m’y jette avec passion. Me voilà donc plongeant en compagnie du mirza dans l’étude du persan. Si l’écriture arabe en est difficile pour un Européen, la langue elle-même est d’une grande simplicité et ne présente pas plus de complications grammaticales que l’anglaise.
Au bout de quelques semaines, je commençai à lire des vers d’Omar Khayyam. Alléguant la mauvaise saison et une avarie au moteur du canot, je n’acceptais pas d’invitations à Péra. Dès le dîner fini je descendais au rez-de-chaussée où mirza Ali m’attendait. Belles et tranquilles soirées à la lueur de la lampe, que nous prolongions jusqu’au milieu de la nuit. Du fond des vergers de l’Irak, une voix persuasive m’appelait. Ah ! je ne pensais point à l’Europe alors ! Un rythme nouveau menait mes travaux et mes jours.
Quand j’étais fatigué, mirza Ali prenait sa guitare persane à double caisse dont les cinq cordes étaient accordées au quart de ton et, après des préludes interminables, avançait tout à coup d’une main sûre dans un thème simple qu’il couvrait aussitôt de mille modulations, le perdait, le retrouvait, faisant s’épanouir devant mes yeux les arabesques hardies, folles et précises, des tapis anciens d’Ispahan. Puis c’étaient de longs silences où nous partions pour des rêveries lointaines et souvent, lorsque j’en sortais, mirza Ali avait disparu emportant son tar.
Un jour, c’était le 21 mars — je me souviens que le temps était mauvais et que la pluie battait les vitres — il m’expliqua, une fois le travail terminé, qu’à cette date où le printemps apparaît les Persans célèbrent l’an nouveau, le nôrouz.
— On s’en va alors dans un jardin près de la ville avec un ami, on récite des vers et l’on joue du tar.
A l’image de ces félicités il se tut. Puis prenant sa guitare, il improvisa sur le thème du printemps, la vie renaissait sous ses doigts habiles, je sentais la sève universelle couler dans mes veines. Cela dura longtemps… Quand je revins à moi, j’étais seul…
L’esprit encore troublé, je poursuivis machinalement des pensées qui avaient une forme sonore et un rythme. Un bruit de pas léger me fit tressaillir. Était-ce le printemps qui faisait ainsi magiquement son apparition à la date fixée ?
Je levai la tête. Une fille était là enveloppée du tcharchaf noir dont les femmes se couvrent pour circuler hors de la partie de la maison qui leur est réservée. Voyant que j’étais seul, elle le laissa tomber et je reconnus à ses grands yeux bruns Djémila, la suivante, presque l’amie d’Isabelle. Il y avait des mois que je ne l’avais aperçue. Parfois elle accompagnait sa maîtresse en caïque, mais, silencieuse, restait entourée de voiles. Aujourd’hui je découvrais soudain qu’elle n’était plus une enfant, mais une de ces adolescentes au visage de lune, une de ces idoles adorées des poètes que je lisais, une fille belle, enfin, faite pour l’amour. Ma maison, mystérieuse comme toutes les maisons d’Orient, recelait un trésor, et je ne le savais pas !
Un instant, je sentis le feu doux de ses yeux sur les miens, puis elle baissa les paupières et, approchant encore, me tendit une timbale en argent qu’elle m’apportait.
— O bey effendi, dit-elle, la khanoum a préparé ce verre de chira qu’elle vous envoie.
Elle parlait un français pur, mais d’une voix dont les sonorités chantantes n’étaient pas de notre pays.
— Comme te voilà grandie, Djémila ! dis-je. Où donc te caches-tu que je ne te vois jamais !
— Je suis toujours avec la khanoum quand elle est seule, répondit-elle avec un peu d’orgueil.
Il y eut un silence. Mon esprit flottait, ne s’attachait à rien. Soudain, sans qu’aucune cause apparente eût motivé cette question, je demandai :
— Sais-tu que le printemps commence aujourd’hui ?
— Je le sais, bey effendi, dit-elle en souriant.
Elle s’inclina et sortit, chargée de mes remerciements à l’adresse de la khanoum. Derrière elle, un parfum de musc traînait.
Un moment je rêvai, puis sautai sur mes pieds et courus à la fenêtre que j’ouvris. Changement subit de décor : il ne pleuvait plus ; quelques nuages filaient vers le sud dans un ciel qu’éclairait une lune d’or à son second quartier. De petites vagues clapotaient sur l’appontement du yali. Un oiseau de nuit en chasse passa. L’air était froid, mais n’avait pas l’aigreur de l’hiver. Je respirai à pleine poitrine : « C’est le printemps, me dis-je, c’est le printemps qui arrive ! »
Une heure plus tard, je fis compliment à Isabelle de Djémila.
— Elle est charmante, ajoutai-je. Ne songes-tu pas à la marier ?
— Je me passerais difficilement d’elle, répondit ma femme. Et puis voudrait-elle quitter notre maison ?
Les soirs succédèrent aux soirs et, lorsque je travaillais, Djémila entrait portant une boisson. Parfois mirza Ali était encore là ; le plus souvent elle semblait attendre qu’il fût parti. Sa visite prenait alors les allures d’un rendez-vous. Pourtant il ne s’y passait rien ; je me bornais à admirer celle qui venait à moi dans la nuit.
Isabelle l’habillait d’une façon ravissante et fantasque. Un jour Djémila se montrait pareille à l’échanson aux lèvres de rubis d’une miniature persane. Deux boucles de cheveux passant sous le turban encadraient son frais et beau visage ; elle portait de grandes culottes larges serrées au cou de pied qu’elle avait fin ; une chemisette de tulle pailleté d’argent enfermait un torse juvénile. Ou bien, elle était vêtue comme une bayadère hindoue, de pantalons étroits, recouverts d’une ample robe de mousseline transparente des Indes où passaient des fils d’or. Des rangs de pierres de couleur lui encadraient les bras, le cou, et descendaient en bruissant jusqu’aux seins.
Longtemps, je ne causai pas avec elle. Je goûtais le plaisir de la voir aller et venir dans la pièce à demi éclairée et de regarder ses pieds nus, délicats fouler mes tapis anciens. Pour qu’elle ne s’en allât pas tout de suite, je lui demandais de me rendre quelque menu service, de m’apporter un livre qui était hors de la portée de ma main, ou une boîte d’allumettes. Accroupie sur les talons, elle me donnait l’objet réclamé. J’admirais la souplesse animale de ce jeune corps, la courbure de la croupe, le cintrage des reins tendus.
Mirza Ali maintenant ne partait pas. Il ne montrait pourtant d’aucune manière qu’il s’intéressât à la visiteuse. Il restait agenouillé, la guitare à la main. Il ne tournait même pas la tête lorsqu’elle venait. Je m’étonnais de ce qui paraissait être une faute de tact chez un homme si fin, si sensible. Il grattait distraitement des accords sur le tar, en manière de prélude. Djémila, curieuse, écoutait. Mais le mirza n’en finissait pas de préluder et elle nous quittait, comme si ses ordres étaient, du moins l’imaginai-je, de ne pas tarder auprès de moi. Peu à peu je m’habituai à la présence de mirza Ali et n’y prêtai plus attention.
Une fois, manquant de cigarettes, je demandai à Djémila de m’en chercher une boîte. Elle en trouva dans la pièce voisine, alluma une cigarette, puis me la tendit. Cette façon de faire se pratique en Orient, mais elle n’était pas d’usage chez nous. J’eus un léger battement de cœur en portant à ma bouche la cigarette qui m’apportait, tiède encore, le parfum des lèvres de cette belle fille.
Chaque soir, je l’attendais impatiemment. Je tirais ma montre. Je faisais quelques pas vers la porte… Elle arrivait ! Je prenais de ses mains le verre de chira…
Maintenant tout me retenait dans notre yali, Isabelle semblable à elle-même, mon travail avec le mirza, cette lente promenade à travers les jardins fleuris de la pensée persane, la musique d’Asie qui pénétrait de jour en jour plus profondément en moi, et enfin l’apparition dans la nuit de l’idole à la taille de cyprès. Que demander encore ? Que pouvait m’offrir la rive d’Europe ?
Ne voyais-je pas que je m’attachais insensiblement à la petite Djémila ? Je l’avais regardée d’abord avec curiosité et admiration, un peu comme une figure détachée d’une miniature persane. Elle avait la noblesse inimitable de port, le visage fier, candide et voluptueux des adolescentes qu’ont représentées les peintres de jadis ? Mais bientôt un désir impérieux m’envahit : je ne songeais qu’à jouir d’elle, comme un homme d’une fille intacte et qui le tente. Cela, et rien de plus. Je ne perdais pas, ici au moins, mon temps à des rêveries sentimentales. J’avais fait mes écoles…
Et pourtant je m’inquiétai. Je commençais à me connaître, je savais non pas ma faiblesse, mais la force avec laquelle un désir nouveau s’empare de moi et combien il m’est difficile d’y résister. Mais Isabelle ? mais toute ma vie harmonieuse dans ce yali ? Risquerai-je de la détruire pour la satisfaction d’un caprice ? J’étais un homme ; je devais peser les conséquences de mes actes. Sans doute, je me permettais beaucoup, mais à distance, loin de ma femme. Une passade sur la rive d’Europe était sans importance. Tout restait dans le vague. Étais-je, n’étais-je pas l’amant de l’Irlandaise ? Nulle certitude. — Avoir une maîtresse dans la maison même où vivait Isabelle à qui j’étais attaché par mille liens que je ne songeais pas à rompre, la chose était grave. Comment le lui cacher ? Bientôt épiés, nous serions à la merci de l’indiscrétion ou de la jalousie d’une servante. Isabelle pourrait nous surprendre… Mais le conflit éternel du drame classique entre le devoir et la passion se présentait devant mes yeux à travers la fumée d’une cigarette de tabac turc. Et puis, le plaisir remplaçait la passion. Et ce ciel d’un bleu d’outre-mer au-dessus de nos têtes ! et les beaux nuages dorés qui venaient du sud ! et la douceur de vivre sur ces rives ! L’atmosphère ne prêtait pas au tragique.
Ce qui restait en moi de l’homme ancien eut encore la force de discuter un jour avec Isabelle la question Djémila. Je lui dis assez sérieusement qu’il fallait marier cette fille, qu’elle était jolie, qu’il était inhumain de l’enfermer chez nous et que je me chargeais de lui assurer une petite dot.
Isabelle me parut attentive au ton de mes paroles ; ses yeux étaient attachés sur les miens ; elle me prit la main et la garda. Mais elle répondit :
— Djémila a du cœur et nous aime. Je l’aime aussi. Ne nous séparons point d’elle aujourd’hui. Plus tard…
Elle ne conclut pas. Ces mots me touchèrent et, pour un instant, donnèrent de la force aux scrupules qui m’avaient fait intervenir auprès d’elle. Et pourtant avec quelle joie — ô contradictions d’un cœur sincère ! — les entendis-je ! Djémila ne partirait pas. Pour apaiser ma conscience, j’insistai. Que risquais-je ? je savais maintenant que la décision d’Isabelle était irrévocable.
Je continuai donc à recevoir la visite nocturne de Djémila. Parfois nous causions. Sa voix d’une extrême douceur vibrait presque plaintivement sur les terminaisons en or, en our et en ar. Le français parlé par elle devenait la plus musicale des langues. Je pensais aux Persans qui gardent un rossignol en cage. Nous échangions à peu près autant d’idées que j’en eusse échangé avec un oiseau. Mais que cette conversation, par ce qu’elle contenait d’inexprimé, par le but inavoué qu’elle visait, me paraissait intéressante !
— Quel âge as-tu ? lui demandai-je un jour.
— Quinze ans, bey effendi.
— Une enfant ! conclus-je machinalement.
Rien dans l’aspect de Djémila ne justifiait ce mot. Elle était maigre, il est vrai, mais, les hanches et les seins développés comme il convient, et pas plus. Les vers d’un poète né à Constantinople étaient sur mes lèvres quand je la regardais et me troublaient :
Le feu sombre de ses yeux si bien dessinés m’évoquait la Témimé de Firdousi dont le jeune cœur est déchiré d’amour pour Rustem. Pourquoi ma femme m’envoyait-elle la nuit cette belle adolescente ? Je rêvai un instant. Puis je dis :
— Il est tard pour toi, ma petite, va te coucher.
Un soir, je la retiendrais. Que serait cette Orientale devant le désir d’un Européen ? Tel était maintenant le sujet de mes méditations que rythmait le tar sous les mains expertes de mirza Ali. Bien qu’elle eût vécu dans un harem où l’homme est le maître, l’instinct féminin est constant. Elle était vierge, elle se défendrait pour se faire désirer avec plus d’ardeur. Puis elle cèderait.
Et après ?
Quoi qu’il arrivât, je ne me séparerais pas d’Isabelle. Je ne pourrais me priver de sa tendresse et de son amour fervent. Je l’avais prise jeune fille. Comment rester insensible à son charme, à cette pureté d’âme et de corps qui se conservait miraculeusement à l’abri des hauts murs de notre yali ? Les nuages avaient passé sans laisser d’ombre sur son cœur. Nous partagions le même lit ; le matin, à peine éveillée, son corps se rapprochait du mien et ses premiers mots étaient : « Ma vie ! »
Quand nous étions ensemble, sa seule présence gagnait sa cause. Je descendais au rez-de-chaussée, elle était désarmée. Djémila emportait la victoire avant que d’ouvrir la porte.
Mirza Ali s’accroupissait à terre loin de la lampe. Il commençait à gratter le tar ; c’étaient des cadences subtiles, des phrases qui semblaient monotones, mais, pleines d’une vie ardente, secrète et passionnée, avaient vite fait de m’emmener dans un pays où, vides de sens, les mots « fidélité », « foi conjugale », ne se présentaient même pas à l’esprit.
Vers onze heures, Djémila arrivait. Si légère qu’elle fût, j’entendais son pas sur les marches de l’escalier. (J’avais écouté naguère le bruit d’un pas sur un escalier !) Elle venait à moi, la Sulamite, porteuse d’un philtre. Elle disait les mots attendus :
— O bey effendi, j’apporte un verre de chira que la khanoum vous a préparé.
Ali effleurait d’une main distraite, mais savante, les cordes tendues, parfois silencieux, parfois chantant d’une voix sourde qui s’élevait pour s’apaiser aussitôt et n’être plus qu’un murmure. Voyait-il nos regards ? Devinait-il ce qui se passerait entre nous ? Pensait-il que la musique était pour l’instant nécessaire à ces rendez-vous nocturnes ? Je ne sais. Mais soir après soir, — nous étions maintenant à la fin d’avril — je trouvais le mirza près d’une fenêtre ouverte sur le Bosphore, accordant avec soin et nonchalance son instrument.
Nous étudiions quelques vers d’un poète. Mirza Ali m’en expliquait le sens caché et les correspondances lointaines. Il se perdait ainsi, et moi avec lui, dans la mysticité. La difficulté qu’il avait à parler le français — pour les sujets simples nous commencions à causer en persan — ajoutait au mystère du texte celui de l’interprétation. Il semblait en savoir plus qu’il ne pouvait exprimer, avoir les clefs d’un paradis où je ne pénétrais que par sa grâce. J’imaginais aussi qu’une longue familiarité avec la pensée asiatique lui permettait de lire dans les êtres des choses dont ils ne soupçonnaient pas encore l’existence. A suivre les méandres de sa conversation, mon esprit commençait à flotter, bientôt il s’élevait jusqu’à un point d’où je contemplais la terre sous un angle nouveau. Jamais homme ne fut plus adroit à vous détacher de vous-même. Il accomplissait par des moyens différents et qui lui étaient propres l’œuvre subtile de l’opium. Une fois obtenu le résultat désiré, il prenait la double guitare et l’essaim des notes s’éveillait sous ses doigts en apparence malhabiles. Elles semblaient s’envoler au hasard, sans ordre, sans intention, mais peu à peu se groupaient, formaient des phrases qui bondissaient en avant, se mêlaient les unes aux autres et, revenant sur elles-mêmes, tissaient autour de moi une trame harmonieuse et solide dont les fils m’enlaçaient, ne me laissant ni le goût, ni la possibilité de fuir.
Paraissait alors Djémila. Elle ne me ramenait pas à une réalité banale. Elle entrait sans effort dans le cercle magique où le mirza m’avait conduit. Elle appartenait à un monde enchanté, bien loin de celui où j’avais vécu, de celui où je vivais quelques heures plus tôt. Tout n’y était que volupté raffinée pour l’esprit et pour les sens. Mirza Ali continuait en sourdine, se taisait enfin. Mais une corde résonnait dans le silence, puis une autre, et la guitare, comme d’elle-même, commentait à sa manière la situation créée par l’arrivée de Djémila. Un soir, le mirza m’avait raconté l’admirable scène de l’histoire de Sohrab au Livre des Rois, où Témimé, la fille du roi de Sémengan, visite la nuit le héros Rustem tandis qu’il dort. Il s’accompagnait alors sur un rythme que je ne connaissais pas… Et voilà qu’aujourd’hui, au moment où Djémila entrait, parmi les arabesques compliquées issues de la guitare, deux accords sonnaient sur le rythme inoubliable, deux accords aussitôt disparus, qui suscitaient devant mes yeux Témimé au cœur brûlant, Témimé se glissant auprès de Rustem. Je la voyais dans les bras du héros. Était-ce Témimé ? Était-ce Djémila ? Était-ce Rustem ? Était-ce moi ?
Par de tels sortilèges, le mirza enfoui sous son aba, petite masse écroulée presque invisible dans l’ombre, nous enchaînait l’un à l’autre. Où étais-je alors ? L’Europe oubliée, j’habitais au cœur de l’Asie ; je succombais à ses enchantements.
Telles furent, ce printemps-là, nos soirées sur le Bosphore. Nous ne nous hâtions pas vers le dénouement d’une situation qui se développait d’elle-même, en dehors de notre volonté. J’imaginais assez curieusement que mirza Ali en savait autant que nous, plus peut-être… Mais sa présence deviendrait vite une gêne. Ne le sentait-il pas ? Pourtant j’inclinais à croire que je n’aurais pas à le renvoyer et qu’il nous laisserait lorsqu’il le jugerait nécessaire.
Un soir, je dis insolitement à Djémila en lui montrant une place à côté de moi :
— Assieds-toi, petite.
Au lieu de s’asseoir sur le divan, elle s’agenouilla à mes pieds.
Mirza Ali s’arrêta de gratter la guitare. Il arrivait qu’il s’interrompît pour suivre silencieusement sa rêverie. Aussi, sans y faire attention, je regardai Djémila immobile et son cou flexible que j’aurais pu caresser. Le hasard voulut que mes yeux fussent tournés vers la porte et j’aperçus le mirza qui, sans que je l’eusse entendu, en avait gagné le seuil et l’allait franchir.
— Tu t’en vas ? dis-je surpris.
— Khasté hastam, khan (je suis fatigué, seigneur), répondit-il en persan, puis il disparut.
Déjà Djémila était debout. La façon un peu inquiète dont elle dressa la tête la fit semblable à une biche effrayée. « Le plus ravissant animal… » pensai-je.
Elle s’inclinait, les doigts sur le front. Me quitter ?… Je tendis la main et saisis la sienne. Ce geste inattendu — jamais je ne l’avais touchée — lui fit perdre l’équilibre. Et, comme je ne la lâchais pas, elle s’abattit à moitié sur le divan, à moitié sur moi. Elle ne put retenir un frais éclat de rire. Mes lèvres l’arrêtèrent sur sa bouche. Elle ne résista pas. Je ne rencontrai à la prendre que le seul obstacle élevé par la nature entre elle et l’homme.
La flamme baissait dans la lampe lorsque je me levai. Djémila, heureuse et lasse, restait à moitié défaite, le bras gauche, long et délié, passé derrière la tête. L’épaule un peu maigre était encore d’une enfant. Ses yeux se posaient librement sur les miens, sans gêne et sans effronterie, sans honte inopportune, sans rien non plus qui pût laisser entendre que nous étions complices d’une faute. Nous avions agi selon la nature et selon les coutumes de sa race. En se donnant, elle n’avait pas trahi sa maîtresse par les ordres de qui elle descendait près de moi. Sa mission était de me plaire. Elle y avait réussi.
Comme je la regardais, elle se redressa, rajusta ses vêtements.
— Il est minuit, dit-elle, il faut que je remonte.
Elle s’approcha, me sourit, sa main me caressa légèrement.
Le lendemain matin, comme je causais avec ma femme, je crus la voir — peut-être m’abusai-je — un peu triste. L’image de Djémila m’apparut. Sous l’aiguillon du remords je me reprochai de laisser Isabelle seule trop souvent et lui demandai de venir me chercher à Constantinople dans l’après-midi. Elle sembla étonnée d’abord de ma proposition, mais tout de suite charmée, et l’accepta. A l’heure dite, je la trouvai au ponton de Galata. Pour la première fois, elle était voilée à la turque ; jusqu’alors elle se contentait de se cacher à demi le visage. Cet arrangement me plut. Le temps était clair. Nous décidâmes d’aller aux îles des Princes. Le canot filait sur une mer d’azur à peine ridée par le vent.
A Prinkipo, l’envie nous prit de monter au couvent de Saint-Georges qui est au sommet de l’île. On y accède par des sentiers rocailleux. Nous louâmes des ânes et nous voilà le long des chemins bordés de lentisques et de térébinthes. Nous étions gais et riions de toutes choses comme des écoliers. Dans ce couvent, il y a une fontaine au pouvoir miraculeux. Les gens du pays, même les Turcs, y viennent en pélerinage et, faisant un vœu, mettent sur la face verticale de la pierre qui la surplombe une pièce de monnaie. Si la pièce reste collée au roc, le vœu est exaucé.
Avec un grand sérieux, Isabelle tira une pièce de son sac et l’appliqua sur la pierre. La pièce ne tomba pas.
— Qu’as-tu demandé ? lui dis-je.
Le visage de ma femme s’éclaira.
— Sois assuré que je ne veux que ton bonheur, répondit-elle, et ses beaux yeux me fixèrent un peu plus d’un instant.
Nous rentrâmes à Tchoubouklou à la clarté de la lune. Je soupai avec Isabelle et, comme la nuit était avancée déjà, je ne descendis pas travailler.
Mais la soirée suivante me ramena Ali, sa guitare, ses chants et, vers onze heures, l’échanson Djémila. Le mirza — il semblait que tout fût réglé de façon immuable — pinça les cordes pour la dernière fois (l’accord de Témimé !) et disparut.
Djémila restait debout attendant mon désir.
Seul, plus tard, avant de rejoindre Isabelle, je m’attardai dans la pièce silencieuse. L’air était lourd des effluves d’un magnolia épanoui près de la maison. Et soudain, du fond obscur du passé, des mots montèrent en moi : « Une volupté sans fièvre. » La terre asiatique tenait ses promesses. L’amour, le plaisir, il n’y avait ici rien de bas… Et cette fille neuve…
ACHEVÉ D’IMPRIMER LE
21 AVRIL 1927 PAR
L’IMPRIMERIE FLOCH,
A MAYENNE (FRANCE).