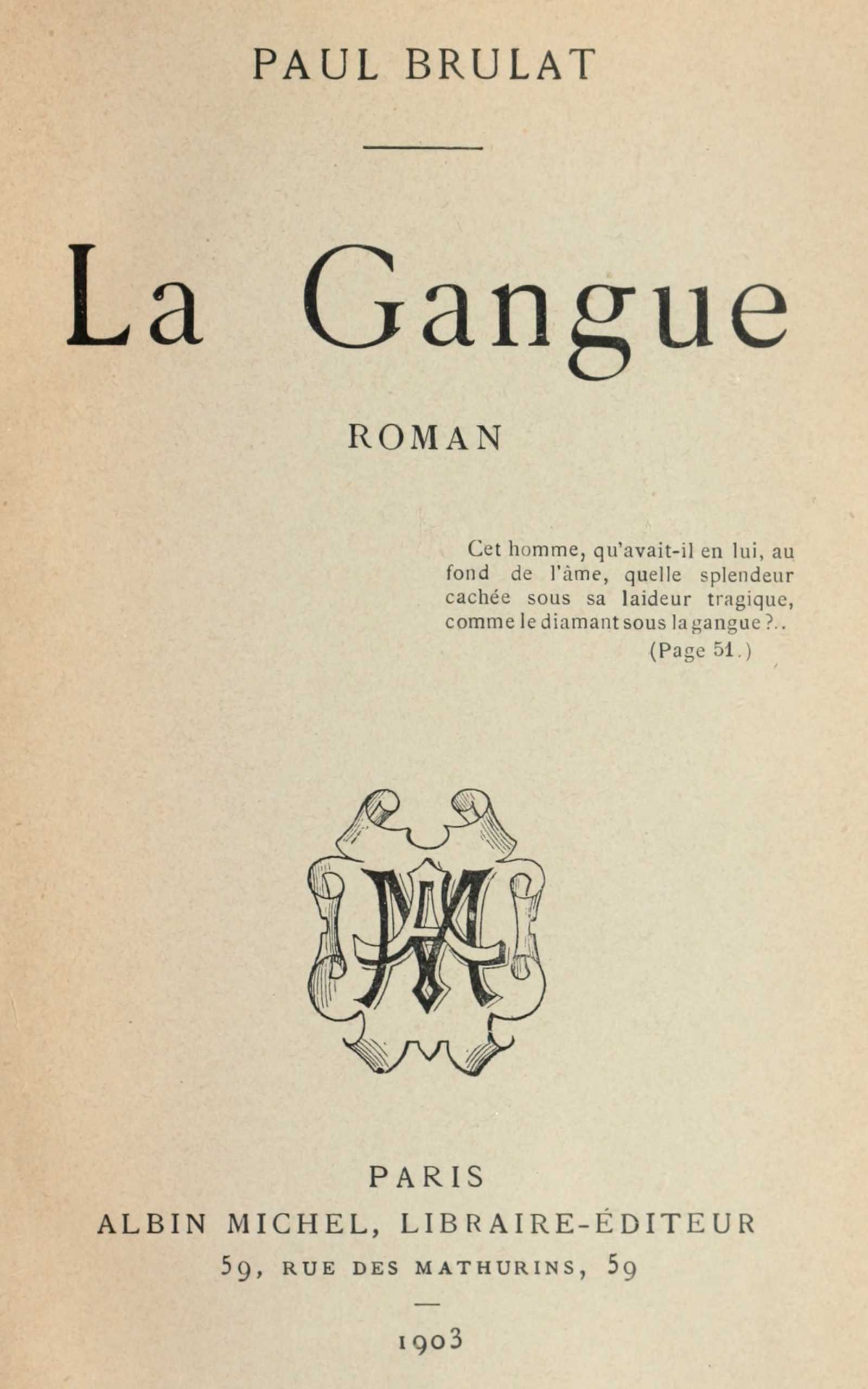
Title: La gangue
roman
Author: Paul Brulat
Release date: November 22, 2025 [eBook #77289]
Language: French
Original publication: Paris: Albin Michel, 1903
Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive/Canadian Libraries)
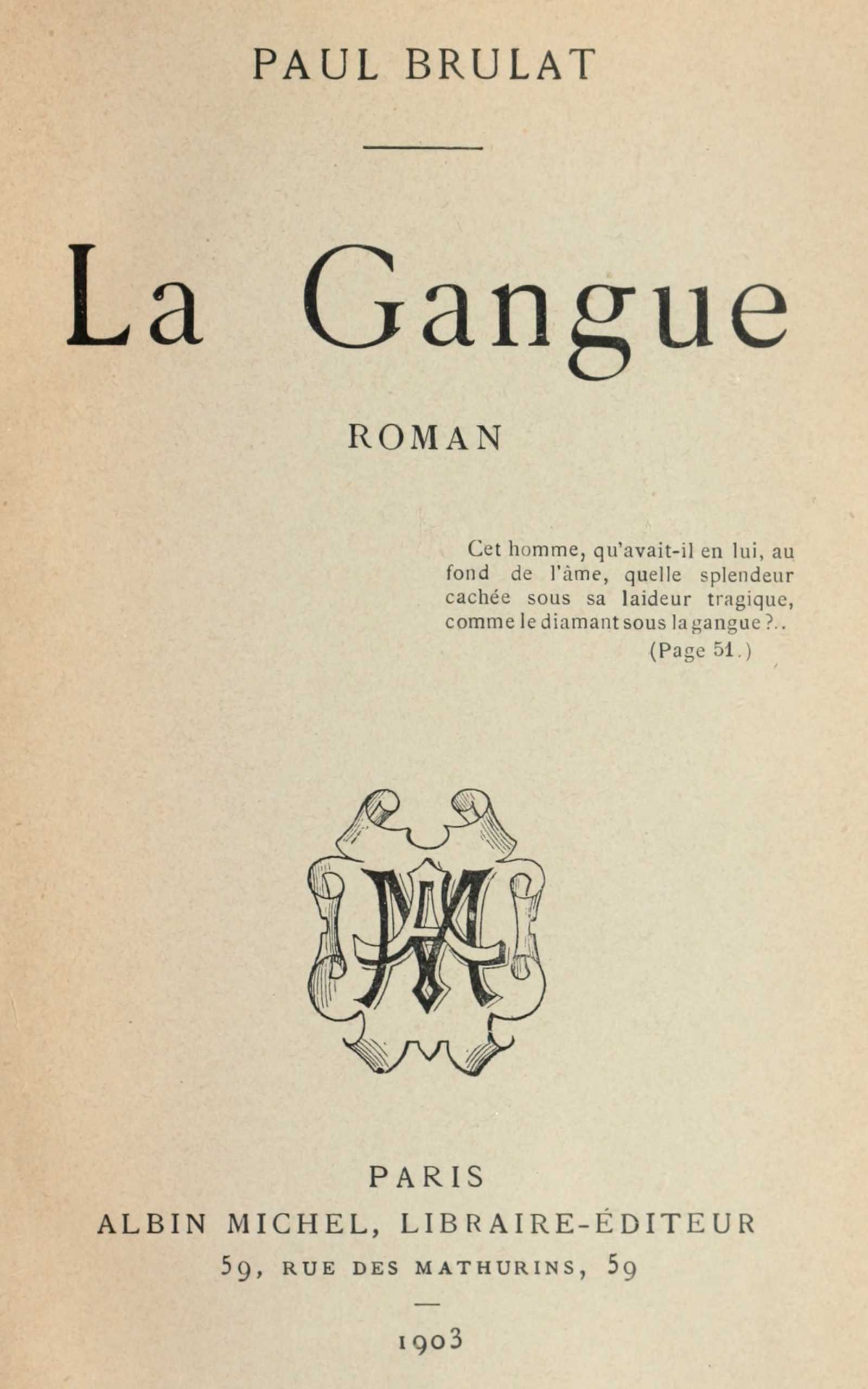
PAUL BRULAT
ROMAN
Cet homme, qu’avait-il en lui, au fond de l’âme, quelle splendeur cachée sous sa laideur tragique, comme le diamant sous la gangue ?…
(Page 51.)
PARIS
ALBIN MICHEL, LIBRAIRE-ÉDITEUR
59, RUE DES MATHURINS, 59
1903
OUVRAGES DU MÊME AUTEUR
Romans | |
| L’Ame Errante (Bibliothèque-Charpentier) | 1 vol. |
| La Rédemption (Bibliothèque-Charpentier) | 1 — |
| L’Ennemie (Bibliothèque-Charpentier) | 1 — |
| Le Reporter (Perrin, éditeur) | 1 vol. |
| La Faiseuse de Gloire (Dujarric, éditeur) | 1 — |
| Le Nouveau Candide (Dujarric, éditeur) | 1 — |
Contes et Nouvelles | |
| Sous la Fenêtre (Simonis Empis, éditeur) | 1 vol. |
| Méryem (Borel, éditeur) | 1 — |
Polémique | |
| Violence et Raison (Stock, éditeur) | 1 vol. |
ÉMILE COLIN, IMPRIMERIE DE LAGNY (S.-&-M.)
LA GANGUE
Il y a quelques années, vers les derniers jours d’octobre, je m’arrêtai dans une des villes d’eaux les plus fréquentées de France… Je ne sais plus pour quelle raison, peut-être pour satisfaire la vaine curiosité de revoir dans une mélancolie d’automne, avec ses grands parcs muets et déserts, cette ville que j’avais connue, deux mois auparavant, pimpante, parée, orgueilleuse de ses cinquante mille hôtes, dans toute la coquetterie de sa belle saison et la magnificence d’un soleil d’août qui emplissait l’atmosphère de griserie.
C’est un sentiment d’une poésie douce et amollissante que la mélancolie, cette reconnaissance du cœur pour tout ce que le passé y a laissé de souvenirs discrets ou délicats. L’âme s’y abandonne volontiers et la recherche aussi parfois, quand elle désire réveiller sans brusquerie une sensibilité paresseuse.
Mais, dès mon arrivée, ce fut un spectacle de désolation qui me frappa. Les avenues, naguère éclatantes de vie, de lumière et de toutes les musiques des Tziganes, s’allongeaient maintenant, silencieuses et mornes, comme accablées par la fatigue des lendemains de fête, sous un ciel grisâtre, d’où tombaient sans cesse, par milliers, avec l’hésitation des oiseaux blessés, des feuilles éperdues que le vent, çà et là, balayait parmi des tourbillons de poussière. Entre les hauts platanes, énormes et déjà presque dépouillés, erraient, promenant leur lente veulerie, quelques rares baigneurs, les retardataires de la saison, figures molles et jaunes, où suintait cet ennui résigné des désœuvrés de province.
Sur le parc, un hôtel restait encore ouvert. J’y entrai pour déjeuner, décidé à repartir par le premier train, tant me pénétrait cette tristesse de ville abandonnée. Je pris place à la table d’hôte, où siégeaient déjà une dizaine de bourgeois, incolores et graves, dont un commis voyageur bellâtre, rasé de près.
Tous ces gens-là, même le commis voyageur, ne disaient mot, paraissaient glacés. Les dames touchaient à peine aux plats. Il y avait une gêne évidente, une répugnance que je cherchais à m’expliquer, quand, soudain, mon regard s’arrêta sur mon voisin de droite, qui s’était, avec intention sans doute, placé un peu à l’écart, à l’extrémité de la table, laissant ainsi plus d’espace entre nous qu’entre les autres convives.
C’était un être d’une laideur atroce, stupéfiante, telle qu’à première vue, j’en éprouvai un frisson d’effroi.
La face, sans nez, sans barbe, sans sourcils, présentait une chose informe, déconcertante, un amas de chairs torturées, ravagées, labourées, une sorte d’épouvantable plaie cicatrisée.
Cependant, sur cette chose funèbre, rayonnaient, comme une aurore qui se dégage des ténèbres, deux grands yeux splendides, splendides par leur lumière et plus encore par la qualité et par la profondeur de leur expression. Car on eût dit qu’ils exprimaient tout le drame des passions silencieuses, des désirs qu’on n’avoue pas, des ardeurs réprimées, des tendresses inassouvies, tout le tourment d’une âme véhémente et ignorée, toute la douleur d’être et d’avoir été, en même temps qu’une acceptation définitive de la fatalité, une tristesse si vaste et pourtant si douce qu’elle en atténuait l’horreur de cette face tragique.
Il baissait la tête, s’effaçait le plus qu’il pouvait, conscient de la répulsion qu’il inspirait, et mangeait sans bruit, vite, comme s’il avait eu hâte d’en finir, d’échapper à une ambiance hostile, au malaise intolérable dont sa présence était cause et qu’on sentait chez tous, bien que personne ne parût prendre garde à lui.
Pour moi, après le premier moment de stupeur, je commençai à me troubler devant cet homme, devant cette existence, comme devant quelque chose d’inconnu et de mystérieux.
D’abord, quel âge pouvait-il avoir ?… En vérité, il semblait impossible de mettre un âge quelconque sur ce visage creusé de larges sillons et qui n’avait plus rien d’humain, où tous les traits avaient été comme emportés par le soc d’une charrue, où les lèvres mêmes ne dessinaient plus qu’une barre d’ombre violacée. Seuls, les cheveux blonds, très fins, et l’intensité du regard permettaient de supposer que c’était un homme encore jeune, de trente à quarante ans peut-être.
J’observai ses mains, car rien ne révèle autant un homme que les mains. Un instant, ces mains me hantèrent. Elles étaient belles, soignées et délicates, comme ces mains de femme, aux jointures frêles, aux longs doigts minces, qui indiquent une distinction de race et où l’on rêve de poser ses lèvres… Je constatai aussi que la mise était correcte, irréprochable, sinon élégante et recherchée.
Je me sentais agité d’un sentiment complexe, confus, indéfinissable, où il y avait à la fois de l’effroi, de la curiosité, presque de la sympathie. Dans cette face sinistre, je ne voyais plus que les yeux, si beaux de tout le désespoir qu’ils exprimaient et qui semblaient demander grâce, s’excuser d’un malheur prodigieux, permanent, irréparable, le malheur d’être laid, d’être horrible.
L’épouvante dont j’avais frémi tout d’abord faisait place insensiblement à la pitié. J’osais maintenant regarder ce monstre, ou plutôt je ne voyais plus que l’âme qui s’y cachait, c’est-à-dire tout le drame, toute la souffrance contenus dans cette violente iniquité de la nature, dans cette atroce ironie du destin qui, sous ce masque affreux, faisait saigner le cœur d’un homme.
Brusquement, avant que le repas fût achevé, il se leva et disparut, sans bruit, à la dérobée.
Ce fut, parmi les convives, comme un soulagement instantané. Des poitrines se dégonflèrent, le silence aussitôt fut rompu, des voix glapirent dans un concert de plaintes et de récriminations.
— Il était temps ! soupira une dame toute suffoquée… Je n’en ai pas déjeuné, ça m’a coupé l’appétit.
— C’est comme moi, dit une autre, je n’ai pas touché à un plat.
— C’est trop fort, s’exclama un bourgeois furieux, qu’on permette à ce monstre de s’asseoir à la table d’hôte ! S’il doit rester ici, je quitte l’hôtel, je m’en vais dès ce soir.
— C’est à faire frémir, déclara le commis voyageur… Supposez qu’une femme dans une position intéressante voie ça…
— J’en suis toute bouleversée, fit une voix douce et fraîche, et j’ai peur d’en rêver, cette nuit… Oh ! je suis bien de votre avis, monsieur, il devrait être défendu à cet homme-là de paraître en société. On devrait l’enfermer.
C’était une jolie femme qui parlait ainsi, si jolie et si blonde que je ne fus point choqué de ces dures paroles, car tel est l’empire de la beauté que nous pardonnons à la nature, quand elle pousse l’ironie jusqu’à parer d’un masque charmant l’injustice, la cruauté ou la sottise.
— Mon Dieu ! reprit une matrone tétonneuse et empesée, se peut-il qu’il existe des laideurs pareilles ?… Ce n’est pas sa faute, le malheureux est à plaindre, mais enfin…
— Moi, à sa place, je n’hésiterais pas, je me tuerais, déclara héroïquement un bourgeois énorme et diabétique dont la face poupine, écarlate et luisante, semblait suer du sucre.
Un monsieur solennel, inspirant le respect par ces profondeurs et ces sévérités d’expression qui caractérisent souvent la physionomie d’un imbécile, s’éleva à des considérations sociales :
— Dans l’antiquité, dit-il, les Spartiates, plus sages que nous, et plus humains, détruisaient, dès leur naissance, les enfants difformes, mal venus. Aussi n’avaient-ils que de beaux hommes, de superbes guerriers, tandis que, dans nos sociétés modernes, on rencontre partout des rachitiques, des scrofuleux, des infirmes qui ne trouvent plus de place dans nos hôpitaux encombrés et qui deviennent des non-valeurs sociales, des misérables condamnés à toujours souffrir, sans que la charité publique puisse les secourir…
— Sans doute, interrompit carrément le commis-voyageur, mais en attendant, je vais tancer d’importance la patronne.
— Rassurez-vous, monsieur, intervint tout à coup celle-ci… Vous ne le verrez plus, il quitte l’hôtel aujourd’hui même… Je suis désolée, ajouta-t-elle, mais vous comprenez, il nous est difficile de refuser quelqu’un qui paye comme tout le monde.
— Et il a bien aussi le droit de vivre, observai-je.
Ce fut un silence stupéfait, où il y avait un peu de dignité froissée, quelque chose d’analogue à ce sentiment de révolte qui redresse les imbéciles, quand on leur raconte que l’homme descend du singe. Il semblait que tous ces bourgeois se sentaient outragés dans leur humanité, humiliés qu’un tel monstre fût un homme comme eux, leur égal selon les lois, leur frère selon leur religion.
— Non, ce n’est pas un homme, protesta quelqu’un, c’est une erreur, une aberration de la nature.
Je n’étais pas d’humeur à discuter. J’allai faire un tour dans le parc, en attendant mon train… Le ciel s’était découvert. Un soleil d’automne, filtrant à travers les branches, s’épandait çà et là en nappes pâles sur le sol jonché de feuilles mortes.
Derrière un bosquet, j’entendis de jeunes rires. Je m’approchai.
C’était une maman, une blonde maman de vingt ans à peine, dont toute la jeunesse épanouie exhalait une grâce adorable, et qui courait après un bébé, pas plus haut qu’une botte. — Je t’attrape ! criait-elle, je t’attrape !… Près de là, sur un banc, un homme, jeune aussi, suivait des yeux la partie de cache-cache avec un sourire de tendresse et de bonté qui disait la joie sereine d’un amour exempt d’inquiétude. A un moment, le bébé vint se blottir sur ses genoux ; il lui passa la main dans les cheveux, d’un geste lent et délicat, tandis que son regard ravi se tournait vers la jeune femme, essoufflée et charmante. Il émanait de ces trois êtres une atmosphère de douceur réchauffante, ce je ne sais quoi de divin qu’emportent continuellement avec eux et que répandent à l’entour ceux qui aiment…
J’allais pourtant me retirer, sentant ma présence indiscrète, lorsque, en levant les yeux, je fus saisi d’apercevoir à quelque distance, dissimulée parmi des arbres, la face horrible de mon voisin de table d’hôte.
Que faisait-il là ?… Il demeurait immobile, effacé, sans un souffle, comme s’il avait craint d’être découvert, de déranger ce bonheur entrevu ainsi que dans un songe merveilleux et dont le spectacle semblait le retenir, le subjuguer, l’emplir d’une émotion étrange, extraordinaire, car tel était en ce moment l’éclat de son regard qu’on l’eût dit surnaturel. Un ravissement l’illuminait comme d’une aurore intérieure. Quelles pensées l’obsédaient, à cette heure ? Peut-être ces choses qu’il voyait, qu’il devinait, l’amour, la jeunesse, la grâce, réveillaient-elles en lui des sentiments longtemps refoulés, des désirs éperdus, des chimères évanouies, un idéal lointain. Peut-être était-il possédé de quelque rêve éblouissant, d’une illusion prodigieuse, aussi troublante qu’une hallucination. Peut-être éprouvait-il une volupté infinie à s’imaginer, un instant, le bonheur qu’il aurait eu, s’il avait été cet homme, jeune et beau, qui caressait cet enfant, qui souriait à cette femme charmante et d’un sourire qui révélait tant de douceur, de tendresse et tant de clarté intérieure.
Soudain, la jeune femme jeta un cri terrifié :
— Oh ! quelle horreur !
En même temps, elle eut un geste, comme pour repousser une vision d’épouvante, et détourna la tête.
Son mari s’approcha avec sollicitude.
— Qu’est-ce donc, ma chérie ? demanda-t-il.
— Là ! fit-elle… cet homme… Oh ! c’est affreux ! je n’ose pas regarder !
Il chercha un instant des yeux. Puis, brusquement, son visage devint dur, s’empourpra de colère.
— Attends, je vais le chasser.
Il s’avança, menaçant… Mais la vision d’épouvante s’était enfuie.
— Il n’est plus là, dit-il… Allons, remets-toi.
Elle restait pâle, tremblante. Le bébé se pendait à ses jupes, en bégayant :
— Maman, j’ai peur… j’ai peur…
— Ne crains rien, mon chéri, dit-elle enfin, il est parti, il ne reviendra pas…
— Si tu es sage, ajouta le père.
Je m’éloignai… Il y avait environ, de là, dix minutes de marche pour se rendre à la gare, située tout au bout d’une longue avenue qui s’ouvrait sur le parc. Chemin faisant, je pensais à ce malheureux, j’y pensais malgré moi. C’était une obsession pénible, presque suffocante. J’étais hanté de ce visage monstrueux, de ce regard de détresse, si troublant par tout ce qu’il disait et plus encore par tout ce qu’il ne pouvait pas dire, par tout ce qu’il contenait enfin d’insondable et d’incommensurable. Pour la première fois, je réfléchissais profondément à cette odieuse et stupide contradiction de la nature qui avait fait cette laideur inhumaine avec un cœur humain. Et je m’étonnais aussi de n’avoir pas vu dans ces yeux-là des lueurs farouches de haine et de révolte. Il me semblait que ce maudit, sans cesse repoussé, objet d’effroi et de dégoût, victime d’une iniquité désespérante, aurait dû haïr tout ce qui était jeune et beau, tout ce qui exhalait l’amour, la fraîcheur, la joie de vivre, lui qui n’avait jamais été aimé, lui qui n’avait jamais été heureux et qui ne pouvait l’être.
Comme je m’engageais dans l’avenue, je le vis, de nouveau :
Il était debout, contre un arbre… Oh ! ces yeux !… C’était un spectacle dont le souvenir m’émeut encore… De grosses larmes emplissaient maintenant leurs prunelles fixes, à demi sanglantes, sans vouloir couler. Aucun pli de sa face, cependant, ne bougeait ; il restait calme, grave. Quelque chose indiquait que ces larmes étaient rares, comme les larmes de ceux qui sont accoutumés à souffrir… Elles s’arrêtèrent longtemps, puis finirent par se détacher des paupières et roulèrent, silencieuses, lentes, dans le lacis de rides qui labouraient les joues, tandis que le visage gardait toujours son étrange impassibilité.
Sans doute ne m’aperçut-il pas, car il était comme un homme qui se croit seul, qui ne se sent pas observé… Mais un bruit de feuilles mortes craquant sous des pas le fit tressaillir ; il se remit en marche, vers la gare, en suivant un sentier parallèle à l’avenue.
Il prit, comme moi, un billet de première pour Paris. Cela et d’autres indices me laissaient supposer qu’il était riche, ou du moins dans l’aisance. D’ailleurs, on ne concevait pas qu’il eût pu vivre pauvre ; intolérable eût été la misère s’associant à une telle disgrâce physique.
Cependant, malgré la fortune qu’il paraissait avoir, je cherchais en vain quelle illusion, quelle raison d’être attachait ce malheureux à la vie. Ce n’était pas l’amour, ce n’était pas non plus l’espoir en une justice des hommes, puisque les hommes ne sont justes qu’envers ceux qu’ils aiment… Qu’était-ce donc alors ?
Une ardente curiosité m’incitait à faire sa connaissance, à pénétrer dans le secret de cette âme, dans le drame de cette existence. Je montai dans le même compartiment, je pris place en face de lui.
Nous n’étions pas seuls. Dans les coins opposés, deux voyageurs sommeillaient sous la lueur molle d’une veilleuse, luttant avec les reflets pâles du jour qui commençait à baisser. Notre train s’ébranla, puis s’enfonça dans les campagnes désolées déjà par les premiers souffles de l’hiver.
Une heure presque entière s’écoula… Je ne trouvais pas la phrase banale par quoi débute un entretien. Je ne sais quelle émotion m’obstruait la gorge. Visiblement, d’ailleurs, il n’était pas disposé à causer ; il ne semblait préoccupé que de me cacher son visage, de se soustraire aux investigations de ma pensée. Tantôt, la tête penchée à la portière du wagon, il regardait défiler les paysages, s’effondrer et se reconstituer tour à tour les horizons ; tantôt, il baissait les paupières et se prenait le front dans les mains. Mais je sentais qu’il ne dormait pas ; son esprit poursuivait quelque longue méditation… Un moment, il rouvrit les yeux, nos regards se rencontrèrent. Je dis enfin :
— Pardon, monsieur, la fumée vous dérange-t-elle ?
Il fit signe que non. Je repris aussitôt :
— C’est long, ces voyages, quand on ne dort pas en chemin de fer… On est tout de même content de rentrer à Paris. Et quelle triste ville nous venons de quitter !… J’avoue que pour rien au monde je n’aurais consenti à y rester vingt-quatre heures de plus… Sans doute y étiez-vous de passage comme moi, par pure fantaisie… Voulez-vous me permettre de vous offrir un cigare ?
— Merci, dit-il, je ne fume pas.
— Vous rentrez aussi à Paris ?
— Oui.
— Vous habitez Paris ?
— Oui.
Décidément, il ne voulait pas causer, il n’était pas liant. Peut-être se défiait-il ou pressentait-il chez moi une curiosité qui le froissait, qu’il se refusait à satisfaire, par dignité, par cette sorte de pudeur qu’ont les âmes fières de ne point s’étaler à nu. Je craignais d’être importun en insistant davantage. Pourtant, une heure après environ, je parvins encore, péniblement, à lui arracher quelques lambeaux de phrases, d’ailleurs insignifiants, et qui ne m’apprirent rien de son passé, de ses sentiments, de tout ce que pouvait contenir cette vie que jamais sans doute n’avait épanouie une joie, une espérance, un sourire, ni même peut-être l’aumône presque insultante de la pitié.
Plus je l’observais cependant, plus je me persuadais qu’il n’était pas né ainsi, que seul un accident pouvait l’avoir défiguré si effroyablement, car, sur cet amas de chairs torturées, il y avait comme les ravages d’un incendie.
La seule chose qui me frappa, ce fut le son de sa voix, une voix harmonieuse, joliment timbrée, un peu chevrotante et qui avait quelque chose de la plainte d’un enfant abandonné. Et c’était une stupéfaction que cette voix douce, caressante, qui sortait de ce monstre.
Le silence s’était fait. Le train roulait à roues fébriles, précipitant sa course dans la nuit, avec des souffles et des sifflets de hâte.
Je m’endormis… Lui, sans doute, ne dormit pas, car chaque fois que je me réveillais, je revoyais ses grands yeux ouverts, profonds et pensifs, si impressionnants que j’en pouvais à peine supporter l’éclat, l’éloquence trop forte, quand par hasard ils rencontraient les miens.
Le lendemain, à l’aube, nous arrivâmes à Paris.
Je ne me trompais pas, c’était lui… Plusieurs mois s’étaient écoulés depuis notre première rencontre, et je ne l’avais plus revu… Oui, c’était bien lui. D’instant à autre, sa laideur formidable m’apparaissait violemment dans l’éclat traître d’un réverbère… Il allait et venait, d’un air agité, avec des mouvements fiévreux, un frémissement de tout l’être, quelque chose d’impatient, d’impérieux, de douloureux, comme l’exaltation suprême d’une volonté, d’une exigence qui s’exaspère, d’une passion torturante et inassouvie.
Il devait être dix heures du soir. C’était une nuit sans lune, une nuit ardente et sombre de juillet, où traînaient des senteurs fortes, des souffles tièdes et délicieux, comme une haleine de femme désirée. Le soleil, toute la journée, avait brûlé la terre. Maintenant, il faisait bon de vivre, de respirer la paix qui descendait des étoiles. Des promeneurs passaient, d’une allure quiète, engourdie par la béatitude universelle de ce soir d’été.
Il y avait là un square encore ouvert. Sur les bancs des allées, des couples enlacés causaient à voix très basses, cependant qu’à l’entour, le long du boulevard, des ombres quêteuses rampaient vers le passant solitaire.
Il était toujours là… Que voulait-il, que cherchait-il, qui l’agitait ainsi ? Peut-être un besoin de tendresse, une passion trop longtemps contenue… et pourquoi pas une de celles-là, puisque les autres se refusaient à lui ?… N’était-il pas un homme, après tout ? Et n’étaient-elles pas des femmes aussi, peut-être moins injustes, plus pitoyables que bien d’autres, ces naufragées de l’amour et de la vie ?… Celles-là, peut-être, ne le repousseraient pas.
Pourtant, il me semblait qu’il hésitait. Son ombre tragique s’attachait à ces ombres. De la terrasse d’un café, où je m’étais assis, j’observais son irrésolution, je le sentais oppressé d’une angoisse, paralysé tout à coup par une appréhension, une timidité douloureuse, frissonnante, invincible… Immobile, raidi, la poitrine haletante, il regardait avec une fixité étrange ces ombres fascinantes qui s’allongeaient vers lui, qui l’attiraient et qui le troublaient… Parfois, il avançait… Un rire insultant le repoussait dans un coin de ténèbres. Il y demeurait un moment, puis, de nouveau, s’approchait, craintif, avec un tremblement. Autour de lui, les ombres s’amassaient, brusquement réduites, recroquevillées en un tas d’images informes. Un grand silence tombait… Soudain, un murmure s’éleva, des voix glapirent, aigres, sinistres, épouvantées et colères :
— Malheur ! le v’là encore !… As-tu fini de rôder ?… Dis, qu’est-ce que tu veux ?… Allons, parle…
D’autres, des rues avoisinantes, accouraient au bruit. Les fusées de rire éclataient parmi les injures :
— Oh ! ce monstre !… Qu’est-ce qu’il vient faire ici ?… Va donc ! eh ! feignant ! Va-t’en, horreur ! Faudrait être bien fauchée pour vouloir de toi… Va-t’en, ou je vas appeler au secours !
Il s’éloigna, sans répondre, éperdu sous cette tempête d’outrages, pourchassé par le coup de gosier ignoble de ces filles. Il allait, d’un pas rapide, longeant les murs, évitant l’éclat des réverbères, cherchant la nuit, pour y cacher sa honte, sa laideur humiliée, haïe et bafouée. Enfin, sa silhouette s’effaça, au tournant d’une ruelle.
Je songeai un moment à cette destinée noire, assez commune cependant, puisque les difformités et les laideurs abondent sur la terre, et que tant d’êtres humains auraient sans doute un lamentable calvaire sentimental à nous conter, si l’amour-propre n’interdisait certains aveux, ne condamnait au silence les exclus de l’amour… Il y a plus de malheur encore qu’on ne suppose dans l’humanité, car nous ne reconnaissons que les maux qui se dévoilent et qui nous touchent de près.
J’avais donc, de nouveau, oublié mon personnage, lorsqu’une autre rencontre que le hasard fit, quelques années après, au printemps, dans un coin des environs de Paris, me causa une profonde surprise et fut longtemps pour moi l’objet d’une énigme.
C’était sur la jolie route qui va de Robinson à Fontenay-aux-Roses. Il était accompagné d’une femme, qui s’appuyait sur son bras. Tous deux allaient lentement, penchés l’un vers l’autre, comme fatigués par une promenade déjà longue. Je marchais derrière eux, gardant une distance discrète.
A un moment, la femme se retourna, comme pour mesurer du regard le chemin parcouru.
Elle n’était plus jeune, elle paraissait avancer vers la quarantaine, mais d’une beauté encore récente, finissant à peine, atteinte moins par l’âge que par la vie, et d’où sa physionomie prenait un charme attirant, qui n’était plus la beauté, n’en avait plus l’éclat, mais qui en gardait le reflet, une douceur de crépuscule, la mélancolie des choses qui s’effacent…
Une parente, sans doute, une sœur, peut-être une amie.
D’ailleurs, je n’étais pas bien sûr que ce fût lui… Pourtant, c’était son allure, sa démarche, et c’étaient ses yeux, ces yeux splendides, inoubliables, — car il s’était aussi retourné deux ou trois fois — et, ces yeux, j’avais pu les voir, en reconnaître le regard intense et troublant.
Le reste du visage se dissimulait sous un cache-nez, une sorte de bandage, qui ne laissait à découvert que le front.
Cela encore me faisait douter que ce fût lui, car pourquoi, maintenant, cette pudeur tardive, et là, sur cette route presque déserte, où il ne risquait d’être aperçu que de rares passants, alors qu’autrefois, il ne craignait point d’étaler en public, et jusqu’à une table d’hôte, sa tragique laideur ? Voulait-il, à cette heure, épargner l’amour-propre de la généreuse femme qui s’affichait avec lui ? Était-ce une coquetterie, si l’on peut nommer ainsi ce désir de ne point déplaire qui nous fait cacher nos plaies, nos souffrances, désir si naturel aux malheureux qui ont encore du courage dans leur découragement même, et qui parfois met un sourire héroïque aux lèvres du désespéré ?
Je m’étonnais plus encore de la façon dont elle se penchait vers lui, de l’attention pieuse qu’elle semblait prêter à sa voix, dont le murmure arrivait, par instants, jusqu’à mon oreille, ainsi qu’un rêve parlé.
La curiosité qui me poussait à les suivre m’avait un peu détourné de mon chemin… Quel mystère était là ? Je voulais savoir. J’avais alors, comme aujourd’hui, bien que la mode littéraire, dit-on, en soit passée, l’inquiétude des problèmes psychologiques. Et je me trouvais là en présence d’un cas vraiment extraordinaire, prodigieux.
Que cette femme, séduisante malgré son âge, et belle de cette beauté éprouvée, plus touchante que le rayonnement de la jeunesse, qu’impriment parfois la maturité et les rigueurs de la vie, fût la maîtresse de cet homme, cela paraissait inconcevable, cela confondait l’esprit ou laissait croire qu’il existe dans le cœur humain, comme dans l’univers, ce que Spencer appelle « le domaine de l’inconnaissable ».
Quiconque, en effet, sait la vie ne croit pas à l’amour inspiré par la seule grandeur morale ou la supériorité de l’intelligence. L’amour n’est ni le fils ni le frère de la vertu, « il est le premier né des Dieux, dit Anatole France, il est né bien avant la justice et bien avant la charité. »
Alors, je ne comprenais pas, j’étais déconcerté : comment cette femme pouvait-elle aimer ce monstre, mettre un baiser d’amante sur ce visage affreux ? Quel lien, quelle illusion inouïe, quelle force ignorée dans l’immense sphère des passions et des aberrations humaines, unissait ces deux êtres ? Quelle héroïque et sublime pitié, ou quel inimaginable démon de perversité ?
Non, cela ne se pouvait, ce n’était pas lui, ou elle était une sœur qui le consolait, une sœur admirable, dont le dévouement, pour ce frère malheureux, se soulevait au spectacle de tout ce malheur, de toute cette injustice, de tout le désespoir qui s’encavait dans cette pauvre âme humaine, sous le masque infâme qui la calomniait.
Ils avaient quitté la route et semblaient errer à la recherche de quelque coin solitaire, d’un abri de bonheur, ignoré du destin.
Ils errèrent longtemps… Le soleil descendait sur les cimes des grands arbres, estompant l’horizon d’une teinte violette. Tous les bruits de la nature, jusqu’aux meuglements des bœufs, regagnant leur étable, s’harmonisaient, plus vagues, plus lointains, comme ouatés par les vapeurs du soir.
Ils s’assirent au bord d’un étang, où nageaient des cygnes… Je les voyais encore, malgré le crépuscule… Il avait enlevé le bandage qui lui cachait la face… Oui, c’était lui… et c’était aussi une flamme amoureuse qui illuminait ses prunelles comme une clarté céleste, comme un rayon du ciel tombé dans l’enfer de cette vie. Il en était transfiguré au point que sa laideur ne m’apparaissait plus.
Ils avaient cessé de causer ; leurs regards seuls se parlaient, mais ses regards, à elle, étaient tout autres. En vérité, jamais des yeux humains ne m’avaient semblé exprimer tant de sentiments à la fois : de la pitié, du sacrifice, de la tristesse, et quelque chose de plus encore, quelque chose comme une reconnaissance infinie, éternelle, que le langage impuissant renonçait à traduire.
Ils furent, un moment, sans voix, en face l’un de l’autre. Je demeurais rêveur, sans comprendre. La nuit s’avançait lentement. C’était l’heure bénie où tout s’apaise, où les violences mêmes se changent en quiétude. Pas une feuille ne bougeait. Dans les champs voisins, des paysans rassemblaient leurs instruments de culture. Le crépuscule avait un parfum d’héliotrope…
Elle lui avait pris les mains et les pressait sur ses lèvres, éperdument.
Je croyais rêver, être ailleurs que sur la terre, dans l’irréel, un conte de fées…
Qu’avait donc accompli cet homme pour mériter un tel transport de gratitude ? Pourquoi lui baisait-elle les mains ?…
J’étais ému, mon imagination s’égarait, battait le champ des hypothèses, s’élançait dans des conjectures bizarres, romanesques, sans rencontrer le vraisemblable.
Les ténèbres envahissaient la campagne, apportant avec elles le silence et le mystère.
Peu à peu, tout s’effaça, tout s’éteignit, et, bientôt, dans la nuit tout à fait tombée, je ne distinguai plus qu’une lamentation intermittente et confuse, comme un bruit lointain apporté par la brise.
A deux ans de là environ, me trouvant en visite dans un salon, où j’allais d’ailleurs rarement, mon attention se fixa sur une personne que je ne connaissais pas, que je croyais voir pour la première fois, et dont le visage cependant éveillait en moi une sympathie soudaine, cette attirance qu’on ne saurait expliquer, parce que les causes en sont peut-être dans les profondeurs inconscientes de notre être, dans une association d’idées ou d’images dont nous ne nous rendons pas compte, ou que nous ne parvenons pas à saisir.
Elle avait un maintien réservé, mais une aisance naturelle, une distinction sans artifice qui annonçaient une femme du monde ou qui plutôt avait renoncé à l’être, car sa physionomie me frappait par cette intensité de caractère qui reflète une âme obsédée d’un sentiment exclusif et qui ne veut pas en être distraite.
Son âge ? Qu’importait… Elle était de ces femmes dont la vraie jeunesse commence à la maturité, au plein épanouissement de leur nature, et qui inspirent alors les plus grandes passions. Sa beauté, toute de vie, toute d’expression, semblait indépendante des traits, et les rides mêmes ne la déparaient point.
Elle ne prenait part à la conversation que par de légers hochements de tête ; mais le pli de ses lèvres, où il y avait à la fois de l’amertume, de la sensualité, de la souffrance, de la révolte, disait plus qu’elle n’aurait voulu dire ; et cette bouche avait un silence plus émouvant que tous les cris de la voix humaine.
Non, ce visage ne m’était pas étranger ; il soulevait au fond de mon être une émotion, il me rappelait quelque chose de vague, de lointain, comme ces rêves dont il ne reste plus, au réveil, qu’une impression fugitive.
Je fus, un moment, songeur, fouillant le passé, cherchant à fixer un souvenir… Où donc avais-je vu cette femme ? En quel temps, en quelle circonstance ? A quel événement heureux ou agréable de mon existence son image s’associait-elle ?… Une confusion de crépuscule s’abattait en ma pensée. Je ne me rappelais rien.
Je prolongeais ma visite, pour l’observer plus attentivement. Sans doute ne se souvenait-elle pas non plus, car elle n’avait manifesté aucune surprise, quand je lui avais été présenté. Elle se nommait madame Derive. Ce nom ne m’apprenait rien non plus.
La conversation s’attardait aux banalités courantes, aux insignifiances voulues.
— Et vous, chère amie, dit enfin la maîtresse de la maison, madame Gallian, en se tournant à demi vers madame Derive — que devenez-vous ? On ne vous voit pas souvent… Êtes-vous moins souffrante ?
— Oui, depuis quelque temps, répondit-elle, mais, cet hiver, j’ai gardé la chambre deux mois, et je ne cesse de redouter une nouvelle crise.
— Vous avez, je crois, une maladie de cœur.
— Les médecins le disent.
— Et que vous conseillent-ils ?
— D’éviter les secousses, les fatigues, les émotions.
— Cela heureusement vous est facile, dans votre situation… Mais quelles sont vos distractions ? Cette solitude ne vous pèse-t-elle pas un peu ?
— Non, mon mal m’occupe. Et j’ai des livres, j’adore la lecture.
— Vous êtes une sage, je vous admire… Qui donc me parlait de vous, ces jours-ci ?… Ah ! oui, on me disait que vous aviez vendu votre jolie villa de Fontenay-aux-Roses.
Ce fut comme un éclair qui dissipa le néant où sombraient mes souvenirs… Tout à coup, je revis la scène dont j’avais été témoin, deux ans auparavant, sur la route de Robinson à Fontenay… Je revis ce couple stupéfiant, ce monstre au bras de cette femme, belle encore, et qui, maintenant, était là, devant moi… J’entendis cette plainte, confuse et douce, s’élevant, comme un bruit lointain, dans la nuit noire tombée sur la campagne ; et l’énigme impénétrable, déconcertante, s’imposa, de nouveau, à mon esprit.
— Il est vrai, dit-elle, j’ai vendu ma villa, et j’ai aussi déménagé. J’habite aujourd’hui rue Condorcet.
— Alors, vous voilà voisine de notre bon docteur, remarqua madame Gallian en me désignant ; et je m’autorise à vous le recommander, au cas où vous auriez besoin de soins immédiats.
— Je souhaite, madame, que cela n’arrive jamais, répliquai-je.
— Dites : n’arrive plus, monsieur, répondit madame Derive, car cela s’est déjà produit plusieurs fois dans la nuit. Et le médecin qui me soigne habituellement ne loge plus près de chez moi. C’est, d’ailleurs, un vieillard, et je n’oserais pas le faire appeler à une heure aussi tardive.
— S’il en est ainsi, madame, je suis votre serviteur, déclarai-je.
— Je vous remercie, dit-elle.
Sa voix même était émouvante ; elle me rappelait ce trait, que conte Michelet, d’un homme que des familiers peu délicats plaisantaient sur la laideur de sa maîtresse, s’étonnant qu’il pût aimer une personne si disgraciée. « L’avez-vous jamais entendue parler ? » leur répondit-il. Et il n’évoquait que le timbre de la voix, dont le charme, l’harmonie délicieuse avaient suffi à conquérir son cœur… C’est que la voix est comme le son de l’âme ; elle nous aide à comprendre des sentiments qui valent mieux que les paroles, celles-ci étant incapables, le plus souvent, de traduire ce qu’il y a en nous d’intime, de profond, de meilleur, tant de choses imprécises, irréelles, qui demeurent à jamais ignorées, silencieuses en nous-mêmes et font de chacun un pauvre être muré dans un éternel isolement.
Un nouveau visiteur entra ; je me retirai, très intrigué, avec un désir, une impatience plus aiguë de pénétrer cette énigme… Je me souvenais qu’elle lui avait embrassé les mains… Pourquoi ? Qu’était-elle à cet homme ? Tout ce que j’avais vu, tout ce que je savais d’elle me paraissait inexplicable.
J’attendis quelques instants, un peu à l’écart, les yeux fixés sur la porte, d’où elle ne pouvait tarder à sortir. Elle parut bientôt, en effet, promena autour d’elle un long regard, puis s’engagea dans la rue de Douai. C’était mon chemin, car nous habitions le même quartier, la même rue. J’ignorais seulement le numéro de sa maison, qu’elle avait, volontairement peut-être, négligé d’indiquer.
Il faisait une chaleur lourde de juin ; l’atmosphère frémissait sous le ciel limpide… Elle allait d’un pas lent, un peu las, qui révélait de la faiblesse, non de la défaillance. Visiblement, au contraire, elle mettait à se redresser une énergie qui ajoutait à sa grâce naturelle de la hauteur et de la fierté. Elle avait cette allure hautaine qui impose, commande le respect, décourage les plus audacieux. Auprès d’elle, la cohue parisienne m’apparaissait comme une foule de pantins agités, disloqués, fébriles, tourbillonnant dans le vide. Elle passait au travers, droite, tranquille, avec la majesté dédaigneuse d’une statue qu’on eût promenée par la ville. Son maintien contrastait singulièrement avec l’exaltation, la violence de sentiments que j’avais pressenties en elle et que trahissait seule sa bouche, si extraordinaire d’expression. Était-ce cette exaltation même qui, à force de retenue, lui donnait cet air glacial, intimidant, presque méprisant ? Peut-être…
« Mais une telle nature, pensais-je, ne peut être qu’aux extrémités du bien ou du mal ; rien de médiocre, de banal, de vulgaire n’est en elle. Quelle aberration criminelle tourmente cette âme ou quelle passion sublime l’embrase ? »
Tout, en sa personne, me semblait étrange, jusqu’au sourire qui s’arrêtait parfois sur ses lèvres, jusqu’à sa voix, jusqu’à sa démarche.
Par moments, j’étais tenté de m’approcher d’elle et de lui murmurer tout bas à l’oreille, en passant, ces trois mots magiques, qui peut-être feraient frémir d’épouvante bien des humains, surprendre sur des faces tout à coup blêmies le crime ou le remords que chacun porte en soi — ces trois mots inattendus et terribles :
— Je sais tout.
Peut-être aussi l’énigme n’existait-elle que dans mon imagination et n’y avait-il là qu’une histoire toute simple, toute naturelle, la chose que j’avais d’abord supposée, une affection très pitoyable et très touchante de frère et de sœur aînée.
A vrai dire, c’était moins la curiosité qui me possédait qu’une espérance, l’espérance de découvrir une âme supérieure, presque divine à force d’être humaine, répandant de la bonté et de la charité à profusion sur les misères de ce monde, et consolant un peu de cette humanité si impitoyable pour elle-même et qui, sans cesse, de ses propres mains, se déchire, se meurtrit, entretient ses plaies saignantes.
Nous arrivâmes rue Condorcet. Je la vis rentrer chez elle… J’habitais presque en face.
A Paris, la vie de quartier, qui fait à la fois le charme et le désagrément des villes de province, n’existe pas. Les voisins s’ignorent ou affectent de s’ignorer. C’est le désert d’hommes dont parlait Jean-Jacques, à une époque où la capitale ne comptait encore que six cent mille âmes.
Pendant un mois, je cherchai vainement une occasion, un prétexte pour entrer en relations avec Madame Derive. Sans doute sortait-elle rarement, car je ne la rencontrai qu’une fois. Je la saluai ; elle me rendit mon salut, en inclinant légèrement la tête. Les renseignements que je recueillis sur elle étaient vagues. On ne lui connaissait pas de famille ; elle vivait avec une vieille servante qui demeurait impénétrable.
Son passé n’était pas moins ignoré. Était-elle veuve, divorcée, vieille fille ? Personne ne le savait : elle était nouvelle dans le quartier et semblait mettre un grand soin à cacher sa vie. D’ailleurs, sauf moi, nul ne paraissait s’inquiéter d’elle. Puis je n’osais pas questionner ; je ne sais quelle voix intérieure me disait qu’il fallait respecter le mystère dont s’enveloppait cette existence, ou attendre qu’un hasard me le révélât.
Des semaines encore s’écoulèrent. Son appartement occupait un troisième étage. Quelquefois, dans ces nuits étouffantes du mois d’août, je m’attardais, sur mon balcon, à contempler sa fenêtre éclairée, où passait, par instants, une ombre indécise et discrète. Cette fenêtre s’éteignait souvent à une heure avancée. Même, il m’arriva de la voir pâlir avec les premières lueurs de l’aurore. Sa clarté paisible et douce faisait lever mes rêves. Il me semblait qu’elle veillait sur le sommeil des choses, sur toute la rue silencieuse et déserte, comme une conscience pieuse, dans la vaste obscurité des maisons environnantes, dont les façades sévères avaient, avec les volets clos, toutes les portes barricadées, je ne sais quel air de méfiance et d’hostilité.
Cela est étrange que tant de pensées et tant d’humanité nous viennent de cette petite lueur qui, la nuit, dore la vitre d’une fenêtre, quand notre attention s’y arrête. L’imagination prend un vol éperdu ; on voudrait savoir ce qui se passe derrière cette vitre, quel cerveau y fermente dans les tourments de l’insomnie, quelle angoisse y veille, quel drame de la vie, de l’amour ou de la mort peut-être s’y consomme. Tandis qu’à l’entour, tout repose, on sent que, là, s’agitent une âme, des passions, quelque chose qui ne saurait être banal comme les habitudes du jour, les occupations quotidiennes dont se compose l’uniformité de notre existence, et il suffit alors de cette petite lueur aux vitres d’une croisée, dans l’inconnu troublant des ténèbres, pour réveiller en nous ce sentiment de fraternité universelle qui fait tressaillir au spectacle ou au pressentiment d’un drame, d’une souffrance.
C’est ce sentiment-là peut-être qui refleurit surtout chez ceux qui n’ont plus de famille, oui, c’est cela qui me retenait si longtemps anxieux et songeur, et pourtant pénétré d’une émotion très douce, devant cette fenêtre éclairée.
Que faisait-elle ?… Je pensais qu’elle était malade et que, ne pouvant dormir, elle laissait brûler sa lampe jusqu’à l’aube, cherchant dans des lectures un soulagement à ses longues insomnies.
Une nuit, je vis entrer quelqu’un dans la maison qu’habitait madame Derive.
Il était environ une heure du matin.
Une coïncidence singulière me frappa : presque aussitôt après, le temps de gravir trois étages, la clarté de la fenêtre s’éteignit.
Trois jours après, puis toutes les nuits suivantes, vers la même heure, le même homme entra.
Chaque fois, l’étrange coïncidence se renouvelait.
Cette partie de la rue Condorcet est mal éclairée… Était-ce bien le même individu ? Du moins, je le croyais, car il ne m’était possible de le reconnaître qu’à sa démarche, à la façon furtive dont il se glissait dans l’ombre, le long des murs, la tête enfoncée dans le collet relevé de son pardessus. Ses pas s’entendaient à peine, comme étouffés, dans le silence de cette rue tranquille, toujours déserte à ces heures tardives… Même, je n’aurais su dire si c’était un jeune homme ou un vieillard.
Parfois, la porte tardait à s’ouvrir. Je devinais alors son impatience frémissante, son anxiété, à des mouvements réflexes, aux regards inquiets qu’il semblait promener à l’entour, au tressaillement de tout son être, quand, par hasard, résonnait le pas d’un passant. Visiblement, il hésitait à sonner de nouveau, et ne s’y décidait qu’après une attente fiévreuse d’une minute ou deux, longue comme des heures.
Il ressortait toujours avant l’aube qui, en cette saison, commençait à blanchir le ciel vers quatre heures du matin.
Ce n’était donc pas un locataire… Un malfaiteur ? Non plus ; il ne fût pas revenu toutes les nuits… Évidemment, c’était quelqu’un qui voulait ne pas être reconnu, qui craignait de compromettre une femme, sa maîtresse sans doute.
Pourtant, quelle imprudence ! Il suffisait que le concierge de la maison se réveillât, le surprît au passage et lui demandât son nom. Et pourquoi courir ce risque, alors qu’à Paris tant de refuges sûrs s’offrent aux baisers défendus ? Je ne m’expliquais pas l’inutile témérité de cet homme, à moins qu’il ne cédât à cet attrait du danger qui ravive la passion, ou à quelqu’un de ces mobiles mystérieux que la raison ne saisit pas, parce qu’ils naissent, comme le dit Pascal, de cette autre raison bien autrement profonde, qui est celle du cœur.
Depuis cinq semaines, chaque nuit, à la même heure, il entrait ainsi dans cette maison et en sortait avant le lever du jour.
Une nuit, il s’arrêta devant la porte et ne sonna pas.
La fenêtre de madame Derive avait les volets clos ; aucune lumière ne filtrait à travers.
L’homme s’écarta, leva la tête, regarda longuement.
La nuit se faisait grave, une nuit sombre où la plainte du vent, par instants, s’élevait comme l’écho de détresses invisibles.
Je le vis s’éloigner lentement, avec hésitation, en se retournant presque à chaque pas, puis revenir, et, de nouveau, contempler cette croisée qui s’effaçait dans les ténèbres.
Il semblait qu’il ne pouvait s’arracher de là. Vingt minutes au moins s’écoulèrent. La rue vide s’allongeait, éclairée, à de longues distances, par trois réverbères dont les reflets tremblaient sur le pavé humide.
Plusieurs fois, il parut se décider à partir, puis revint, comme ramené par une force irrésistible. Enfin, son ombre en détresse s’échoua au coin d’une impasse voisine.
Soudain, un coup de timbre, chez moi, retentit… J’allai ouvrir. Une voix chevrotante de femme me jeta ces mots :
— Docteur, venez vite… madame Derive est très mal.
Pendant ce court trajet de mon domicile à celui de madame Derive, j’interrogeai la servante qui était venue me prévenir.
A ses réponses, je compris que le cas était grave, peut-être désespéré.
J’étais saisi d’une émotion que je n’avais jamais ressentie en pareille circonstance, car le médecin ne voit et ne doit voir dans un malade qu’un sujet… J’allai là avec l’appréhension d’un malheur, d’une catastrophe qui aurait menacé un être dont la vie eût été intimement liée à la mienne… C’était même un sentiment à la fois plus vague et plus profond, difficile à définir, quelque chose comme la crainte de voir disparaître, s’éteindre en moi tout à coup une espérance, une illusion bienfaisante, la grande douceur que j’éprouvais, chaque nuit, à contempler cette clarté charitable qui veillait pieusement sur la rue endormie, faisait lever mes rêves et qui désormais peut-être ne brillerait plus.
Précédé de la servante, je pénétrai, presque en tremblant, dans la chambre de madame Derive.
Couchée dans un grand lit, à demi soulevée sur son oreiller, elle tourna faiblement la tête vers la porte, et eut la force de sourire en me voyant paraître.
C’est une chose touchante que ce souci de la bienséance qui demeure chez la grande dame, en dépit de tout, et qui résiste à la douleur jusqu’à parer d’un sourire aimable le masque même de l’agonie.
Ma première impression, cependant, fut mauvaise : la respiration de la malade était forte et pénible ; de légères gouttes de sueur perlaient sur les tempes creuses, et, dans les yeux cernés d’une auréole bleuâtre, un presque surnaturel éclat contrastait avec la pâleur cireuse du visage. La bouche surtout, entr’ouverte et crispée, et dont les lèvres sans couleur ne dessinaient plus qu’une barre d’ombre, avait une indicible expression de souffrance.
Je prononçai quelques paroles, auxquelles elle ne répondit pas. Ses regards seuls me parlaient, m’imploraient, me disaient qu’elle voulait vivre encore.
Je m’approchai, je tâtai le pouls : la fièvre était brûlante. J’auscultai le cœur, ce cœur plein d’une humanité impénétrable, trop grande peut-être pour qu’il pût la contenir toute, sans en mourir : il battait violemment, comme si l’âme qu’il enfermait avait fait des bonds pour se dégager… J’acquis la conviction qu’elle était perdue.
Le devoir, pour un médecin, étant d’espérer contre l’espérance même, de lutter jusqu’au dernier instant, je rédigeai à la hâte une ordonnance, et j’envoyai la servante chez le pharmacien le plus proche.
Je restai seul auprès de la malade. Je questionnai :
— Avez-vous de la famille, des parents, quelqu’un que vous désireriez faire prévenir ?
Elle eut un lent signe de tête qui signifiait : non. D’un autre geste, elle me fit entendre qu’elle étouffait, qu’elle voulait de l’air. J’écartai les doubles rideaux de la fenêtre et j’ouvris les persiennes. En même temps, je plongeai un regard dans la rue… Quoi, il était encore là, ce mystérieux personnage qui, chaque nuit, pénétrait dans cette maison ! Même, attiré par la clarté, il s’avança jusque sous la croisée et demeura là, immobile, comme quelqu’un qui attend, qui écoute, qui s’inquiète. L’obscurité qui l’enveloppait m’empêchait de distinguer son visage. D’ailleurs, selon son habitude, et bien que la nuit fût chaude, il enfonçait la tête dans le col relevé de son manteau. Cependant, il me sembla apercevoir dans les ténèbres ses yeux chargés d’angoisse… Enfin, que voulait-il ?
Déjà, plusieurs fois, un soupçon m’avait effleuré. Maintenant, une certitude se faisait en moi… Non, il n’était plus possible d’en douter : c’était madame Derive qu’il venait voir ainsi, chaque nuit ; elle était la maîtresse de cet homme, et c’était pour elle qu’il restait là, frémissant, les yeux obstinément fixés sur cette fenêtre… Il m’avait vu ; que devait-il croire ou supposer ? Quelles pensées enfiévraient son cerveau ? Pressentait-il un malheur, et, sachant qu’elle n’était pas seule, n’osait-il monter, par crainte de la compromettre ? Son anxiété devait être horrible… Quel drame inouï était là ?
Et nul doute aussi que cet homme ne fût celui au bras de qui je l’avais vue, elle, cette femme aux allures de grande dame et rayonnante encore de beauté, sur la route de Robinson à Fontenay-aux-Roses… Elle était donc l’amante de cet être misérable, si effroyablement défiguré, qui faisait fuir d’horreur les vendeuses d’amour mêmes !
Cela seul demeurait incompréhensible, trop beau, trop grand pour être cru. La pitié elle-même, cette pitié sublime dont la pente douce glisse quelquefois jusqu’à l’amour, pouvait-elle avoir fait ce miracle ?
Mais tout le reste, à cette heure, devenait évident : cette fenêtre éclairée, toutes les nuits, c’était le signe dont ils étaient convenus, le signe qui lui disait : je suis seule, viens, je te désire !
Et je m’expliquais aussi, maintenant, cette témérité, en apparence aussi folle qu’inutile. Il ne pouvait, en effet, la rejoindre que la nuit. La pudeur, le souci d’épargner, de ne pas soumettre à une trop cruelle épreuve l’amour-propre de la femme qui se donnait à lui, lui interdisaient d’afficher, auprès d’elle, pendant le jour, son épouvantante laideur.
Et, cette nuit, il était venu, et, pour la première fois, il avait trouvé les volets clos… Pourquoi ? Que se passait-il ?… Il était toujours là, transi dans les ténèbres et les affres du doute.
La malade avait baissé les paupières ; une pâleur plus grande s’épandait sur son visage.
Allait-elle mourir, sans qu’il la vît une dernière fois ? Allait-elle emporter dans la tombe le secret de son cœur ? Et, s’il était vrai que son amour fût né d’une pitié sublime, serait-elle alors à jamais perdue, cette haute leçon de charité qu’elle donnait à l’amour, à l’injustice des passions humaines qui ne pardonnent pas à la laideur ni à l’infirmité ? Enfin, cette espérance qu’elle eût laissée à tous ceux et à toutes celles qui ne furent jamais aimés, serait-elle aussi enfouie dans la terre ?
Mais cet homme lui-même, qu’avait-il en lui, au fond de l’âme, pour avoir conquis le cœur de cette femme ? Quelle splendeur se cachait sous cette laideur tragique, comme le diamant sous la gangue ?
Je me rapprochai de la fenêtre. Ma surprise fut extrême de constater qu’il avait disparu. J’interrogeai la rue aussi loin que mes regards pouvaient porter dans la nuit… Non, il n’était plus là. Où était-il ? Son angoisse régnait encore à l’entour ; il me semblait qu’il ne pouvait être loin…
Soudain, trois coups heurtèrent la porte… La malade rouvrit les yeux, se redressa avec effort sur sa couche, et je vis ses prunelles s’emplir tout à coup de grosses larmes.
Un grand silence tomba ; trois nouveaux coups se firent entendre.
— Faut-il ouvrir ? demandai-je.
Elle parut, un instant, en proie à une indécision douloureuse, puis recouvra la voix pour dire :
— Non, n’ouvrez pas… C’est sans doute un voisin qui vient prendre de mes nouvelles… Je ne veux recevoir personne.
Sa tête retomba mollement sur l’oreiller. Un moment après, la bonne entra, rapportant l’ordonnance.
Maintenant, il faisait grand jour.
Madame Derive avait atteint à la sérénité définitive. Son visage apaisé et grave, avec les ombres denses qui s’amassaient sous les arcades sourcilières, exprimait cette impassible beauté des choses qui ont cessé d’être, mais qui vivent encore par tout ce qu’elles évoquent.
Dans le calme absolu que la mort avait fait autour d’elle, j’éprouvais, en songeant au mystère de cette existence, un peu de cet étonnement et de cette tristesse qui nous saisissent devant les ruines silencieuses de quelque antique cité, où se ruèrent les passions humaines. L’âme n’est-elle pas aussi une cité où s’agitent des foules, des passions, toute une époque, et qui laisse des ruines mélancoliques, sur lesquelles s’accroupit l’inexorable et l’éternel oubli ?
Quelques personnes, des voisines et des connaissances, prévenues de l’événement, arrivèrent.
J’allais me retirer, quand mon attention fut frappée par une photographie encadrée et placée en évidence sur un petit meuble du salon : c’était une très belle figure de jeune garçon, où rayonnaient des yeux admirables, dont l’expression ne m’était pas étrangère. Ces yeux, je les connaissais, je les avais vus ; déjà, leur regard m’avait pénétré jusqu’à l’âme.
Une bizarre association d’images se fit en moi, tout à coup : je me rappelais l’impression que m’avait causée ce monstre que j’avais rencontré, la première fois, à une table d’hôte, dans une ville d’eaux — tandis qu’en même temps, me revenait à la mémoire une étrange aventure, dont j’avais été témoin, autrefois, et qui, en apparence, n’avait aucun rapport avec ces choses.
J’étais alors étudiant ; j’habitais le quartier Latin. Un jour, je retrouvai un ancien camarade que j’avais perdu de vue, depuis des années. Le changement qui s’était fait en lui me stupéfia… Quoi, c’était ce Jacques Varnier, jadis si gai, si robuste, ce gars au geste brutal, aux allures grossières, qui emplissait les brasseries de son rire gras, de son exubérance méridionale, de sa verve sonore ! Je n’en revenais pas. C’était, maintenant, un pâle jeune homme, dont le corps aminci avait pris une élégance ; les manières, une certaine grâce ; la voix, de la discrétion et de la douceur.
— Sais-tu, me dit-il, que j’ai été bien malheureux ?
Je le poussai aux confidences. Alors, il me conta son histoire : la trahison d’une femme qu’il aimait… Presque tous les hommes ont éprouvé cela. Il en est qui s’en consolent ; lui ne s’était pas consolé. Et, depuis deux ans qu’elle l’avait quitté, parce qu’il était pauvre et parce qu’elle était belle, depuis deux ans, sans relâche, il la cherchait à travers Paris, il allait à sa découverte, fouillant les cafés et les restaurants de nuit, les lieux de débauche, avec, à toute heure, la vision torturante des souillures qu’elle devait subir, de la bave que les colimaçons laissaient sur la rose dont il adorait le parfum évaporé, et qu’il avait cueillie, lui, toute fraîche, à peine éclose, baignée de rosée, un matin de printemps… Elle avait alors tout juste dix-sept ans.
Elle était plus nécessaire à sa vie que l’air, la lumière et le pain quotidien. La nuit précédente encore, il l’avait cherchée jusqu’à l’aube, toujours en vain ; et ses yeux, ses pauvres yeux, qui n’avaient plus de larmes, disaient la détresse de son âme et cette lâcheté de l’amour qui n’est peut-être que l’héroïsme de la fidélité.
Le voyant si las, je l’invitai à s’asseoir dans un coin du café.
Il y avait quelques minutes que nous étions là, quand, soudain, je m’aperçus qu’il pâlissait.
Une fille, assez jolie, venait d’entrer, au milieu d’un groupe d’étudiants en goguette.
— C’est celle-là, n’est-ce pas, fis-je avec une nuance de conviction.
Je vis qu’il hésitait à la reconnaître ; son front se plissait douloureusement, tandis que des frémissements lui couraient sur les joues.
— Oh ! murmura-t-il enfin, c’est une ressemblance extraordinaire… Oui, je crois que c’est elle… Pourtant, je n’en suis pas sûr, et je m’étonne qu’elle soit tombée si bas.
Il l’observa un instant, puis répéta :
— La ressemblance est prodigieuse… Ce sont ses gestes, c’est sa voix, c’est son rire, et c’est surtout sa physionomie… Du reste, tu vas pouvoir en juger par toi-même, j’ai sa photographie.
Ses mains fiévreuses fouillèrent ses poches.
— Ah ! dit-il, je l’ai laissée chez moi, mais j’habite à deux pas, je vais la chercher ; il faut que tu compares.
Il se retira, puis, un moment après, reparut, tremblant d’émotion.
— Excuse-moi, je te quitte, me dit-il… La première personne que j’ai rencontrée, en sortant d’ici, c’est elle, elle-même, ma maîtresse… nous avons causé… Elle est en bas, elle m’attend… Adieu.
— Eh bien, et l’autre ? questionnai-je en désignant la fille en qui, l’instant d’avant, il avait cru reconnaître l’infidèle.
Il la regarda, de nouveau, avec attention, et un étonnement profond se peignit sur sa figure.
— C’est étrange, fit-il… Je m’étais trompé… Non, elle ne lui ressemble pas du tout… Je ne m’explique pas cette singulière méprise.
Et, m’ayant serré la main, il alla rejoindre l’autre, la vraie, la chère infidèle enfin retrouvée et reconquise.
C’était là, simplement, sans doute, un phénomène d’obsession. A force de porter en nous, continuellement, la même image, il arrive que nous la retrouvons partout et jusque dans l’objet le plus différent, car le monde extérieur n’est, selon le mot de Schopenhauer, qu’un phénomène cérébral, ou un état d’âme, comme disent les psychologues de nos jours.
Alors, revenant sur moi-même, je me demandai si je n’étais pas dupe d’une obsession semblable, en contemplant le portrait de ce jeune garçon si beau et dans les yeux de qui il me semblait voir revivre et rayonner, plus jeune et plus heureuse, toute l’âme de ce monstre qui portait l’auréole d’un amour mystérieux.
En même temps, j’imaginais que cet homme avait été autrefois ce jeune garçon si beau, qu’un accident l’avait défiguré, et qu’elle l’avait connu, qu’elle l’avait aimé, avant cette catastrophe, et si profondément que son amour en avait gardé un idéal indestructible, plus fort que le malheur, plus lumineux que l’évidence. Et peut-être, prise de la même obsession, avait-elle continué à voir cet homme tel qu’il avait été, à retrouver jusqu’en sa laideur effrayante la définitive image qu’un premier amour, grandi depuis par la pitié, avait gravé dans son cœur.
Il était toujours là, sur le trottoir en face, juste devant la porte de ma maison. Il avait le visage découvert et sa laideur m’apparut vraiment si horrible qu’un instant je me repris à douter de l’évidence, à me demander si je n’avais pas cru voir l’impossible, si mon imagination enfin ne s’était pas complue dans un roman invraisemblable, une de ces illusions consolantes qui, de temps en temps, naissent, comme des roses, du fumier de la vie.
Pourtant, il continuait à fixer les yeux sur la fenêtre du troisième étage… Savait-il, à cette heure, ou ne savait-il pas ?… Non, il ne devait pas savoir, car son regard plein d’anxiété se détournait parfois de sa contemplation obstinée, pour interroger les gens qui sortaient de la maison. Il y avait à l’entour un va-et-vient inusité, indiquant qu’il se passait là, derrière ces murs impénétrables, ces volets clos, un de ces événements qui troublent, pendant quelques heures, la monotonie quotidienne des existences.
J’hésitais à traverser la chaussée pour rentrer chez moi, craignant d’être le premier qu’il oserait aborder, pour le questionner.
Justement, en ce moment même, son regard s’attachait à moi, m’enveloppait de son angoisse, me barrait la rue… Bien sûr, c’était à moi qu’il voulait parler, de moi qu’il attendait la fatale nouvelle… Après tout, pourquoi me dérober ? Ne valait-il pas mieux qu’il sût tout de suite ?… Je me décidai à passer.
Comme j’allais franchir le seuil de la porte, il m’arrêta :
— Pardon, monsieur, pourriez-vous me donner un renseignement, je vous prie ?
— Lequel ?
— Que se passe-t-il donc là ?
D’un geste, il désigna la maison dont je sortais. Sa voix ne trahissait aucune émotion.
— C’est une dame qui est morte, cette nuit, répondis-je.
— Savez-vous son nom ?
— Oui, elle se nomme madame Derive.
— Je vous remercie, monsieur, dit-il en me saluant.
Ce fut tout. Il avait reçu le coup sans faiblir, sans un tressaillement, comme une nouvelle indifférente, qui ne le touchait pas. J’aperçus cependant, en baissant les yeux, une de ses mains qui tremblait, avant qu’il eût le temps de la dissimuler.
Le lendemain, une vingtaine de personnes, dont j’étais, suivaient le char funèbre qui, par le boulevard de Clichy, se dirigeait vers le cimetière Montmartre.
Et lui ?… Il n’était pas dans le cortège. Où était-il ?… En me retournant, je le découvris enfin… Il marchait derrière nous, à quelque distance, un peu à droite, tout à fait à l’écart, comme un simple passant confondu parmi les lents promeneurs qui, par ce bel après-midi d’été, envahissaient le boulevard. Sa démarche était ferme, tranquille en apparence ; ses yeux n’avaient pas une larme. Sa pâleur seulement était si extraordinaire que tous les traits du visage s’en trouvaient effacés et que même sa laideur effrayante n’apparaissait plus.
Autour de moi, cependant, on causait de la défunte.
— Savez-vous qu’elle laisse vingt mille francs de rente ?
— Oui, au bas mot.
— Et pas d’héritier ?
— Si, un seul, ce jeune homme qui conduit le deuil : un cousin qu’elle ne voyait plus, paraît-il…
— Et qui ne doit pas être fâché de cela.
— Pensez donc, une fortune qui vous tombe ainsi, au moment où l’on s’y attend le moins !
— Ah oui ! une fière chance !
— Comment se fait-il qu’elle ne se soit pas remariée ? Ce ne sont pas les partis avantageux qui ont dû lui manquer !
— Non, certes ! Elle a eu les plus beaux, les plus séduisants… Jusqu’à ces derniers temps, il s’en est présenté… Elle était encore belle, toujours riche et pas très âgée : quarante ans à peine.
— Et elle a préféré rester veuve ?
— Oui.
— Elle ne s’en est jamais expliquée ?
— Pas à ma connaissance. Elle était la discrétion même, pour elle et pour les autres. D’ailleurs, elle vivait très retirée, ne recevait plus personne.
— Après tout, elle a peut-être bien fait… Le mariage, voyez-vous !…
L’autre baissa la voix pour dire :
— N’importe, moi je me méfie des gens qui causent si peu… Il y a quelque chose là-dessous.
— Avez-vous remarqué sa bouche et le drôle d’air qu’elle avait quelquefois… Oh ! pour moi ?…
— Savez-vous qu’elle a fait beaucoup parler d’elle, en un temps ?
— Ah !
— Oui, elle avait une réputation de mondaine, d’élégante et de coquette… On lui donnait des amants… Mais on dit tant de choses, le monde est si méchant, ma chère !…
— C’est bien vrai, aucune honnête femme aujourd’hui n’est à l’abri des médisances… Il faut en prendre son parti.
— Pourtant, on affirme que M. Derive allait demander le divorce, quand il est mort, subitement, d’une attaque.
— Il l’avait épousée par amour ?…
— Et sans dot, pour sa beauté… Il était riche, elle n’avait rien. Sa famille avait été ruinée, complètement ruinée… presque la misère… Les mariages d’inclination, les mésalliances, voilà comment ça tourne, bien souvent, ma chère.
— Il faudrait savoir aussi de quel côté étaient les torts, peut-être du mari…
— Sans doute… Enfin, une fois veuve, elle a changé tout à fait, une vraie métamorphose, une femme retirée, ayant renoncé à tout, de mœurs sévères… une vie cachée, mystérieuse…
Les deux commères qui parlaient ainsi se regardèrent, comme si elles avaient eu, en même temps, une pensée que les convenances, aussi bien que la circonstance, obligeaient de taire.
— Après tout, dit l’une, elle était libre, c’était son droit… Personne, d’ailleurs, n’en a jamais rien su.
— Excepté sans doute la vieille servante qui vivait avec elle.
— Oh ! celle-là, un tombeau ! Peut-être aussi ne savait-elle rien elle-même… A Paris, c’est si facile de se cacher !
— Enfin, paix à son âme !
On approchait ; il se fit un silence, ce recueillement que l’on sent aux environs d’un cimetière, comme si les morts communiquaient aux vivants et aux choses elles-mêmes un peu de leur sérénité.
Je me retournai pour voir s’il nous suivait encore… Non, il ne nous suivait plus, il nous avait devancés et s’était arrêté à l’entrée du cimetière… Il laissa passer le convoi devant lui, immobile, la tête découverte, toujours très pâle, et les yeux fixes, profonds comme un désespoir muet.
Quelques personnes du cortège le remarquèrent.
— Avez-vous vu ce monstre ?… Quelle abomination !
— Oh ! c’est atroce ! Ne m’en parlez pas… J’ai détourné tout de suite la tête… On ne devrait pas laisser ça sur la voie publique.
Puis, comme pour cacher cette vision d’épouvante, elle ajouta :
— La superbe couronne ! Savez-vous qui l’a envoyée ?
— Non.
De nouveau, les deux femmes échangèrent un regard, et se turent. Ce respect de la mort, où il entre un peu de crainte et qui fait se replier les consciences, arrêta les insinuations malicieuses.
A part cette belle couronne, qui ne portait aucune épigraphe, il y avait peu de fleurs sur le char funèbre. Il semblait que madame Derive n’avait pas laissé beaucoup de regrets, ce qui s’expliquait, d’ailleurs, par sa vie retirée. Peut-être aussi un grand nombre de ses anciennes relations s’étaient-elles abstenues d’assister à ses obsèques, parce qu’elles étaient civiles. A notre époque, où la foi, dit-on, s’en va, on ne saurait croire combien le sentiment religieux, en présence de la mort, se réveille, profond, dans presque toutes les âmes. Ce n’est pas en vain que des siècles d’hérédité chrétienne pèsent sur notre vieux monde, et l’enterrement civil, surtout d’une femme, apparaît encore de nos jours comme une sorte de bravade qui choque, qui offense et que beaucoup de gens, tolérants en d’autres circonstances, n’excusent pas… Et, pourtant ce Dieu des chrétiens, qui pardonna à la Madeleine repentante, avait-il été plus grand que cette femme, riche et belle, qui avait pardonné à la laideur ?
Quand la bière fut descendue au fond du caveau, l’assistance se dispersa.
Alors, je vis s’avancer le malheureux qui, seul, portait et cachait dans son âme le deuil de cette amante magnanime.
Il promena autour de lui, comme pour s’assurer qu’il était bien seul, un regard inquiet et farouche, semblable à celui des bêtes qui cherchent la solitude, quand elles se sentent mortellement blessées.
Je m’étais dissimulé dans un angle d’où je pouvais l’observer, sans qu’il m’aperçût.
D’abord, il s’engagea dans une longue allée, l’artère principale du cimetière. Il semblait qu’il ne trouvait plus, qu’il cherchait à s’orienter… De toutes parts, les tombes se serraient, se mêlaient, les unes abandonnées, les autres toutes fraîches, religieusement entretenues et couvertes de fleurs. Au loin, s’étendaient une multitude de croix si rapprochées les unes des autres qu’on les eût dit liées entre elles, comme si la grande ville, orgueilleuse et superbe, se fût montrée tellement avare de sa terre pour ceux qui avaient été l’animation de ses rues et le peuple de sa grandeur.
Il cherchait encore… Le jour, cependant, commençait à baisser. Des cyprès immobiles tombait une infinie tristesse… Il allait de tombe en tombe, s’arrêtant devant des épitaphes sans doute effacées par le temps et qu’il avait peine à déchiffrer. Deux fois, il revint sur ses pas, puis s’égara dans les allées transversales… Enfin, quand il eut découvert le caveau où reposait madame Derive, il demeura là, les yeux perdus dans une fixité contemplative et la tête penchée vers la terre comme pour écouter le silence de la mort, qui faisait s’amasser peu à peu des larmes sous ses paupières et du désespoir dans son cœur.
Les vapeurs du soir estompaient les arbres d’une teinte violette et transparente. Quelque chose de mélancolique et de doux émanait de la terre, de cette réconciliation fraternelle des êtres dont on poursuit vainement le rêve pendant la vie et qui ne se réalise qu’après elle.
Une voix lointaine, tout à coup, s’éleva dans l’espace :
— On ferme ! on ferme !
Il semblait n’avoir pas entendu. Il s’était tourné à demi, je ne voyais plus son visage, mais ses mains, ses bras, tous ses membres, maintenant, tremblaient comme des branches sous l’orage. Je devinai qu’il sanglotait…
— On ferme ! répéta la voix.
Son corps oscilla ainsi qu’un arbre qu’on arrache du sol et dont les racines résistent encore. Le crépuscule envahissait le cimetière, apportant des linceuls dans son ombre. Une exigence de paix descendait du ciel, que parcouraient de légers nuages roses, au seuil pourpré de l’occident.
Pour la troisième fois, la voix cria, plus rapprochée :
— On ferme ! on ferme !
La silhouette d’un gardien s’avança vers lui. Alors, il se redressa, parut se ressaisir. Ses prunelles à demi sanglantes promenèrent à l’entour, sur ce vaste champ de la mort, sur le néant de ce qui avait vécu, pensé et souffert, un adieu éternel, l’adieu définitif, puis, lentement, sans détourner la tête, il s’éloigna.
C’est ce même soir, peu d’instants après la scène dont j’avais été témoin, que je fis connaissance avec cet homme. Il semblait avoir repris déjà, par un suprême effort de volonté, entière possession de lui-même.
Je l’abordai simplement ; il me reconnut, et nos mains se serrèrent. Savait-il que j’étais au courant de tout ? Il me parut du moins qu’il s’en doutait, par la façon dont sa main pressa la mienne.
Je lui appris que j’avais assisté, comme médecin, aux derniers moments de madame Derive ; mais, à ma grande surprise, il ne me posa, à ce sujet, aucune question. Peut-être préférait-il, par respect, pour la mémoire de la morte, que l’aveu des relations qui avaient existé entre elle et lui ne sortît pas de sa bouche, en présence d’un étranger.
Pour transporter la conversation sur un champ où il fût plus à l’aise, je lui rappelai notre première rencontre dans une ville d’eaux et la nuit que nous avions passée ensemble en chemin de fer, en face l’un de l’autre.
— Oui, je me souviens, dit-il.
Et il n’ajouta rien. Je sentais toutefois que ma présence ne lui était pas déplaisante, sans doute parce que j’étais celui qui avait recueilli les dernières paroles et le dernier soupir de madame Derive. Cela, entre nous, créait une sympathie, presque une parenté sentimentale.
A vrai dire, de ma part, il n’y avait guère que de la curiosité. Je dois même confesser que j’éprouvais une certaine gêne, une sorte de fausse honte peu généreuse à m’afficher à ses côtés. Je craignais de rencontrer quelque connaissance, et, tout en causant, je l’entraînais dans les rues désertes qui avoisinent le cimetière de Montmartre.
J’essayais vainement de le faire parler. Je pressentais en lui une de ces natures profondes qui ne se livrent pas, chez lesquelles les souffrances de la vie, l’expérience des hommes, de leur légèreté, de leur égoïsme, de leur incompréhension ont creusé un gouffre où toutes les pensées et tous les sentiments demeurent enfouis. Je pensais aussi qu’il attendait de me mieux connaître, d’avoir pénétré les raisons véritables de ma sympathie, pour s’ouvrir à moi. L’ostracisme qui le frappait, la répulsion qu’il inspirait ne justifiaient que trop sa méfiance.
Son silence m’impressionnait, exerçait sur moi un prestige, une autorité qui, à la longue, me pesaient. Il est des silences qui ne disent rien, qui ne découvrent que le vide ; le sien dévoilait, au contraire, des profondeurs insondables et des hauteurs inaccessibles. J’avais, en sa présence, cette sensation, cette peur de notre frêle molécule humaine, qui nous saisit devant ces monts dont les sommets dépassent les nues.
Il se nommait René Grandon ; il habitait un hôtel qui lui appartenait, avenue Frochot. C’est à peu près tout ce que j’appris de lui, au cours de notre premier entretien.
Au moment de nous séparer, il m’invita à aller le voir, et je sentis encore à sa poignée de main qu’un lien existait désormais entre nous.
A dater de ce soir-là, nos relations se resserrèrent… Il arrive que des années, toute une vie de fréquentation quotidienne, et même de cohabitation, ne suffisent pas à rapprocher deux êtres, à dissiper l’inconnu qui demeure entre eux et qui en fait des étrangers l’un pour l’autre. Au contraire, une heure de causerie, c’est assez quelquefois pour faire jaillir la clarté qui révèle deux natures l’une à l’autre et les soude à jamais.
C’est ce qui se produisit, dès notre seconde entrevue. Pourtant, cette fois encore, il ne me parla pas de lui-même, ni de madame Derive. De neuf heures du soir à deux heures du matin, nous abordâmes tous les sujets, excepté celui-là. Je fus étonné de la multitude de ses connaissances, de l’originalité de ses vues, de l’élévation de sa pensée. Ses manières étaient simples et distinguées, sa voix avait un charme si prenant, son regard tant d’expression, son esprit tant de force et d’éclat que sa laideur même en devenait resplendissante. Je finissais par me familiariser avec ce visage, il cessait de me paraître horrible ; même, par moments, lorsqu’il s’animait, il me semblait beau, d’une beauté tragique et en quelque sorte surhumaine.
Je le revis deux jours après, puis deux fois par semaine. Nos entretiens se prolongeaient fort avant dans la nuit. Il n’y avait aucune amertume dans son langage ; à peine devinait-on un peu de mépris dans l’indulgence qu’il témoignait pour l’espèce humaine.
D’ailleurs, il continuait à ne pas prononcer le nom de madame Derive… Peut-être en est-il des grandes douleurs comme de la véritable pauvreté, qui ne demande jamais l’aumône… On eût dit que, tout en parlant, il se taisait et que la plainte incessante de son âme dominait le murmure de sa voix. Si émouvante que fût sa parole, son silence, qui était plein d’elle, me semblait plus émouvant encore. Je n’osais pas l’interroger ; j’éprouvais vis-à-vis de lui une discrétion respectueuse, comme devant un pauvre qui cache sa misère.
Il y avait trois mois que nous nous connaissions, lorsque, un soir, dans le salon où il me recevait habituellement, un joli salon meublé avec un goût exquis — il aimait à s’entourer d’objets d’art — mon regard tomba sur cette même photographie que j’avais remarquée chez madame Derive, la nuit où j’avais été appelé, trop tard ! auprès d’elle… C’était ce portrait de jeune garçon si beau et dont les yeux avaient tout à coup soulevé en moi l’émotion d’un souvenir. Ce soir-là, il me sembla que ces yeux me parlaient plus familièrement encore… Je me retournai vers René Grandon…
— Cette photographie date de loin, me dit-il… J’avais alors dix ans… C’était, ajouta-t-il, peu de jours avant l’accident qui m’a défiguré…, une brûlure !
— Ah ! fis-je.
— Oui, une affreuse brûlure, reprit-il, qui a laissé sur ma figure — vous le voyez — les ravages d’un incendie… J’ai failli en mourir… J’en ai plus souffert encore moralement… Je fus sauvé par le dévouement d’une vieille servante, qui m’avait vu naître… C’est d’un triste service que mon cœur lui garde la reconnaissance !… Si j’étais mort à cet âge, je n’aurais laissé que des regrets, je n’aurais connu qu’une enfance heureuse, les sourires et les caresses d’une famille qui m’adorait, quand j’étais petit et quand j’étais beau… Mais ce serait une trop longue histoire à vous conter, toute mon histoire, et il vaut mieux tourner le dos aux ombres que les malheurs du passé projettent autour de nous, et regarder vers l’avenir où rayonne toujours une espérance.
— Mais le passé, répondis-je, a aussi ses souvenirs délicieux, ses illusions et sa poésie, dans lesquels il ne faut pas trop, il est vrai, laisser s’engourdir son âme, mais qu’il est doux quelquefois d’évoquer.
— C’est donc ma vie que vous voudriez connaître ?
— Ne suis-je pas maintenant votre ami ?
Je vis une humidité dans ses prunelles ; il baissa les paupières comme pour retenir une larme qui s’apprêtait à couler, et, en même temps, sa main fine esquissa un geste vague qui semblait signifier : A quoi bon !
— Je vous en prie ? insistai-je.
— A quoi bon ! répéta-t-il à haute voix, — mon histoire ne touche à aucun grand événement.
— Les événements, répliquai-je, ne valent que par la sensibilité qui les éprouve, et l’histoire du plus humble individu n’est pas moins intéressante que celle d’un peuple.
Je sentis qu’il allait parler, je gardai le silence.
Son regard erra, un instant, comme perdu dans les distances incommensurables du passé, puis, d’une voix, d’abord un peu éteinte et qui veut se ménager, pour se soutenir longtemps, il commença…
Un des premiers souvenirs de mon enfance, ou, du moins, un des plus vivaces, et qui me fit entrevoir tout à coup la réalité des choses — car jusqu’alors j’avais été berné par l’hypocrisie bourgeoise — ce fut une conversation à demi-mots qui s’engagea, un jour, au sein de ma famille, pendant un déjeuner. Nous étions tous à table : mon père, ma mère, mes deux sœurs, Henriette et Suzanne, dont j’étais le cadet.
On causait des Delbray, nos voisins, avec qui nous étions en relations très intimes, depuis de longues années. J’en avais toujours entendu parler avec de grands éloges, même avec vénération. M. Delbray était deux ou trois fois millionnaire : une des plus grosses fortunes industrielles de Brive ; M. Delbray portait un ruban rouge à la boutonnière ; M. Delbray enfin avait une influence électorale. — C’est une grande intelligence, affirmait mon père.
A la maison, on faisait des frais pour recevoir les Delbray, on sortait toute l’argenterie, on allumait toutes les bougies. Aussi, ma surprise fut-elle grande, ce jour-là, quand ma mère me dit :
— Tu entends, mon chéri, tu ne joueras plus avec Lucette Delbray.
J’étais un enfant docile, je n’avais pas l’habitude de répliquer. Pourtant, je ne pus m’empêcher, cette fois, de questionner :
— Pourquoi, maman, ne dois-je plus jouer avec Lucette ?
— Parce que… répondit ma mère. Tu n’as pas besoin de comprendre, tu comprendras plus tard… Tu sais, René, tu n’as jamais désobéi… Je ne te dis pas de lui tourner le dos, à ta petite amie…
— Non, il ne faut pas se brouiller, interrompit mon père, il est inutile de se faire des ennemis ; on ne sait jamais ce qui peut arriver.
— Mais chacun à son rang, déclara ma mère. Les Delbray ne sont plus aujourd’hui de notre société… Alors, écoute bien ce que je vais te dire, mon amour : Quand Lucette viendra te trouver, tu peux lui dire bonjour, je ne te le défends pas… Puis, tu t’en iras. Tu as d’autres amis pour t’amuser : les neveux du préfet, les petits Glavaux, par exemple.
— Lucette ne m’a rien fait, maman… Lucette a toujours été gentille avec moi, protestai-je.
— Je ne te dis pas le contraire, mon chéri, mais nous ne devons plus fréquenter les Delbray.
Je me tus, j’avais une grosse envie de pleurer… Je l’aimais tant, ma petite Lucette, je ne voulais jouer qu’avec elle… Elle avait de beaux yeux clairs qui me souriaient toujours, et des manières de petite dame, presque de petite mère, quand nous étions ensemble, car j’avais un an de moins qu’elle, et elle en profitait pour me traiter en bébé, me donner de sages conseils, me gronder tendrement — et surtout pour me raconter toutes les belles histoires qu’elle savait, qu’elle avait lues ou qu’elle inventait. Je préférais celles qu’elle inventait, et, à vrai dire, je n’aimais les histoires que quand c’était Lucette qui me les racontait. Même, souvent, au lieu de l’écouter, je regardais ses longs cheveux fins comme de la soie et qui bouclaient naturellement ; et il m’arrivait aussi de me mirer dans ses prunelles.
Il y eut un silence, puis ma mère reprit :
— C’est extraordinaire, cette débâcle survenue si vite… Qui aurait cru cela ? Ils semblaient si tranquilles, si certains de l’avenir.
— J’avais pourtant prévenu Delbray, dit mon père… Aussi, avoir engagé toute sa fortune dans cette affaire ?
— Elle paraissait sûre, souviens-toi, mon ami ; tu le disais toi-même…
— En affaires, il n’y a jamais rien de sûr, répliqua mon père… Moi, j’ai bien su me retirer à temps. Delbray, lui, a voulu s’entêter, et il a fait la culbute.
— Alors, c’est la faillite ?
— Oui.
— Il leur reste encore des espérances ?
— Oh ! un oncle, le fameux oncle à héritage, qui ne meurt jamais, et en attendant…
Mes parents avaient des visages sévères. Je ne comprenais pas grand’chose à tout cela. Je remarquai seulement que mon père, qui jusqu’alors, quand on parlait de nos voisins, disait toujours monsieur Delbray, d’un ton plein de respect, ne l’appelait plus maintenant que Delbray tout court. Faillite, ruine, ces mots n’avaient encore pour moi qu’un sens vague… Je continuais à penser à ma petite Lucette, et des larmes, que je ne pouvais plus retenir, coulaient sur mes joues, sur mes mains, sur mon pain et jusque dans mon assiette… C’était mon premier gros chagrin… On m’avait toujours tant gâté ! bien plus même qu’Henriette et Suzanne, mes deux sœurs. C’était moi le Chérubin, le Benjamin, continuellement entouré de sourires, de caresses et de tendresse. Je régnais dans la maison.
— Allons, René, console-toi, me dit ma mère. On te conduira au cirque, cet après-midi.
De la tête, je fis signe que je ne voulais pas.
— Comment, tu ne veux pas aller au cirque, toi qui aimes tant le cirque ! Voyons, René, réfléchis bien.
— Je veux aller voir Lucette, répondis-je en avalant mes larmes.
Pour la première fois, maman me jeta un regard sévère.
— Tu n’iras pas, dit-elle.
— Si, maman.
— René, va dans ta chambre, tu n’auras pas de dessert.
Dans ma chambre, mes larmes séchèrent. J’éprouvai tout à coup une émotion, un grand bonheur en pensant que Lucette m’avait embrassé, la dernière fois que nous nous étions quittés. Et il me sembla que je la voyais autrement, qu’elle n’était plus une petite fille, que j’avais changé aussi et que nous avions soudain grandi tous deux.
J’écartai les rideaux de ma fenêtre, je restai le front collé à la vitre. La rue était étroite. Les Delbray habitaient en face. Quelquefois, nous nous faisions des signes par la croisée ; des conversations même s’engageaient, qu’interrompait le bruit des voitures ou la plainte criarde d’un orgue de barbarie.
J’attendis longtemps, ce jour-là. Lucette parut enfin, et je ne sais pourquoi je me retirai avant qu’elle m’eût aperçu. Ce n’était pas, je crois, la peur de désobéir, c’était autre chose que je ne m’expliquais pas et qui me faisait craindre autant que désirer sa présence… C’est peut-être que l’amour, qui naquit bien avant la justice, naît aussi bien avant la raison et bien avant la conscience.
Quelques jours s’écoulèrent… Brive est la petite ville de province où l’ennui suinte aux murs, où il semble que tout soit économisé, jusqu’au mouvement, au bruit et à la lumière. La ruine des Delbray était l’événement dont s’entretenait toute la société. Ma famille, restée debout dans le désastre financier qui avait emporté plusieurs fortunes du pays, semblait avoir gagné en considération et en prestige. Nous recevions plus de monde qu’autrefois, et j’ai gardé le souvenir pénible de ces déjeuners accablants qui, commencés à midi, ne s’achevaient guère avant quatre heures du soir.
Mon père avait fait fortune dans les céréales, et nous étions considérés comme faisant partie de la société. En province, la profession de commerçant n’exclut de la société que jusqu’au jour où l’on s’est enrichi. A Paris, on s’incline encore devant les talents officiels ; à Brive, l’argent seul a droit au respect.
L’unique distraction de la ville était la musique militaire qui jouait deux fois par semaine, le jeudi et le dimanche, sur la place d’armes.
C’était là que notre bonne nous conduisait, mes sœurs et moi, quand le temps était beau.
Un dimanche, j’y rencontrai Lucette, avec sa mère. Elles étaient assises à l’écart, hors de la foule, et personne n’allait leur parler. Madame Delbray, qui passait naguère pour la femme la plus élégante de la ville, qui donnait le ton et lançait la mode, était vêtue de noir, très simplement. Lucette avait l’air tout triste. Nous nous regardâmes longtemps. Ce fut elle enfin qui m’aborda.
— René, dit-elle, tu es fâché ?
— Non, Lucette, je ne suis pas fâché.
— Alors, pourquoi ne viens-tu plus jouer avec moi ?
Je rougis jusqu’au blanc des yeux. Je ne savais que répondre ; maman avait oublié de me faire la leçon. Puis, je n’aurais pas pu mentir. Je finis par dire la vérité.
— C’est pour ne pas désobéir à maman, Lucette.
— Ta maman t’a donc défendu de jouer avec moi ?
— Oui.
— Pourquoi ?
— Je ne sais pas… Mais elle ne m’a pas défendu de te dire bonjour, m’empressai-je d’ajouter.
— Adieu, René.
Je baissai les yeux. Bien qu’enfant, je souffrais comme un homme qui vient de commettre une lâcheté.
A partir de ce jour, mon caractère changea ; je devins taciturne, presque sauvage. Tous les jeux, et les enfants de mon âge, surtout les petits Glavaux, les neveux du préfet, dont on me recommandait la fréquentation, m’ennuyaient. Je préférais être seul.
— Qu’as-tu donc, René, à quoi penses-tu ? me demandait ma mère.
Je ne voulais pas dire à quoi je pensais ; on aurait ri de moi.
— Serais-tu malade ?
— Non, maman.
— Alors, parle, qu’est-ce que tu as ?
— Je n’ai rien.
— C’est l’âge ingrat, concluait mon père.
Cependant, j’étais toujours le gâté de la famille. Choyé par mes parents, par mes sœurs et par les domestiques même, j’entendais partout chuchoter autour de moi : Oh ! le bel enfant ! — Cela flattait la vanité de ma mère. Il n’était rien qu’on ne fît pour me donner de la joie. A toutes les fêtes, j’étais comblé de cadeaux. Les jours de visite, je subissais les embrassades de ces dames… Pourtant, les gens ne me semblaient plus bons comme autrefois, ni la vie si heureuse. J’avais comme l’intuition de toute l’hypocrisie et de tout le mensonge dont se compose la trompeuse aménité des convenances sociales.
Mes sœurs auraient pu être jalouses. On les habillait avec moins de coquetterie, on les grondait souvent, même à tort. A moi, on me passait tous les caprices. La préférence dont j’étais l’objet s’apercevait en toutes choses. Même, on m’admirait, on s’extasiait sur la précocité de mon intelligence, et c’était sur moi que mes parents déclaraient fonder leurs plus grandes espérances. Comme les enfants gâtés, je n’avais point de timidité, et quelques réparties amusantes avaient suffi pour faire concevoir de moi une grande opinion.
Sous prétexte que j’étais délicat, on ne voulait pas me mettre au collège, tandis qu’Henriette et Suzanne allaient en pension. J’avais un professeur à domicile. Je travaillais peu, je bâclais mes devoirs, et l’on n’en estimait pas moins que je faisais de grands progrès. — Cet enfant a une telle facilité ! déclarait mon père. — Mon professeur, un pauvre homme que ces leçons aidaient à vivre, n’avait garde d’y contredire.
On se préoccupait déjà de mon avenir. C’était même le sujet des causeries intimes, le soir, sous la lampe. Il était arrêté que, si j’avais du goût pour les mathématiques, on me pousserait à Polytechnique.
Je m’amusais parfois à dessiner des bonshommes. Mes parents s’en inquiétaient… Non, pas artiste ! Mon père avait une mauvaise opinion des artistes, des bohèmes, des rapins, des crève-la-faim, à l’entendre, tandis que dans l’armée, dans l’administration, c’était la vie assurée, la considération, le ruban rouge.
— Pourtant, disait ma mère, s’il devenait plus tard un Carolus Duran ou un Bouguereau ?
— Oui, mais tout le monde n’a pas le génie de Carolus Duran ou de Bouguereau, répondait mon père.
Il n’était plus question des Delbray. Je n’osais plus prononcer le nom de Lucette… Ils habitaient maintenant, dans le quartier le plus éloigné du centre de la ville, une maison d’humble apparence et qui sentait l’indigence. L’hôtel qu’ils avaient occupé en face de chez nous était resté vide ; il s’en exhalait une mélancolie de ruine, qui m’était douce pourtant et dont j’aimais à me pénétrer.
On ne me permettait pas encore de sortir seul. Quand j’allais en promenade, accompagné de ma mère ou d’une bonne, j’espérais rencontrer Lucette, mes yeux la cherchaient partout. Une seule fois, en l’espace de trois mois, il me sembla l’apercevoir, au tournant d’une rue, et je pressai le pas pour la rejoindre, la voir de plus près.
— René, ne va pas si vite, me dit ma mère, je ne peux plus te suivre.
Un matin, je me réveillai au moment où l’aube commençait à poindre. Tout le monde dormait. Je me levai, je m’habillai sans bruit, sans réveiller personne ; j’ouvris la porte, je sortis.
J’allai droit à la maison des Delbray… Il était à peine sept heures. Tout était fermé. J’attendis… J’attendis longtemps… C’était un dimanche. La cloche d’une église voisine emplissait l’air de ses lamentations pacifiques… Je crois bien que je restai là près de deux heures à écouter le son de cette cloche et à regarder cette maison. J’avais oublié de mettre mon petit manteau, j’étais glacé… il pleuvait un peu… Enfin, je vis sortir Lucette et sa mère. Elles passèrent près de moi, sans me voir ; elles allaient à la messe… Je marchais derrière elles en murmurant : Lucette… Lucette…
Madame Delbray se retourna.
— Que fais-tu là, René ? dit-elle… Tu sais bien que tes parents t’ont défendu… Ils ne savent peut-être pas que tu es ici, tu vas te faire gronder.
Je restai interdit. Lucette ne disait rien non plus.
— Va, mon petit, reprit madame Delbray, je sais bien que ce n’est pas ta faute. Toi, tu as un bon cœur… Lucette, embrasse ton petit ami.
J’embrassai Lucette plusieurs fois.
— Allons, c’est assez, mes enfants, dit madame Delbray… Va, mon petit René, rentre vite chez toi ; tu as l’air tout gelé… Pourvu que l’on ne te gronde pas trop !
A mon retour, je trouvai ma famille et tout notre quartier en grand émoi. Depuis sept heures du matin, on me cherchait. La police avait été prévenue de ma disparition. Mon père et les domestiques de la maison s’étaient élancés dans toutes les directions, à travers la ville et jusqu’aux environs.
Pendant huit jours, on ne cessa de m’interroger.
— René, où as-tu été ?… Nous voulons le savoir… Malheureux enfant ! s’écriait mon père.
Je refusai de répondre. Punitions, promesses, supplications, rien n’y fit. Je fus mis quarante-huit heures au pain sec, et les larmes même de ma mère ne purent me fléchir. Je ne m’explique pas encore aujourd’hui cet entêtement bizarre, ce silence inexorable, qui laissa supposer que j’avais commis quelque chose de très grave. On avait pris soin de fermer à double tour, chaque soir, avant le coucher, toutes les portes de la maison et d’en cacher les clefs, afin qu’il ne me prît pas la fantaisie de renouveler mon escapade.
Je tombai dans une mélancolie profonde, extraordinaire pour mon âge, et qui finit par inquiéter mes parents. J’éprouvais vis-à-vis d’eux un sentiment qui touchait presque à l’aversion. Leurs sévérités m’étaient moins pénibles que leurs tendresses. Toute mon affection se reporta sur notre vieille bonne Noémie qui m’avait vu naître et qui nous était si dévouée.
— Il y a quinze ans que nous l’avons, et nous l’aimons beaucoup, disait ma mère avec un air d’adorable bonté. Aussi nous la garderons, tant qu’elle pourra faire convenablement son service.
Moi, j’étais toujours auprès de ma vieille Noémie, et il me semblait qu’elle seule me comprenait et m’aimait vraiment. Elle seule aussi quelquefois me parlait de Lucette ; elle baissait la voix pour me dire :
— René, j’ai rencontré aujourd’hui ta petite amie ; elle te dit bien le bonjour.
C’était assez pour faire lever mes rêves… Oh ! les doux rêves que j’avais alors, et de quelle joie pure ils m’inondaient le cœur ! Puis, à ces songes délicieux, succédaient de longues tristesses. C’était Noémie qui me consolait, parce qu’elle devinait la cause de mon chagrin.
— René, que fais-tu donc encore à la cuisine ? grondait ma mère… Ce n’est pas ta place, et tu empêches Noémie de faire son ouvrage.
A la fin, mes parents s’émurent sérieusement de mon état. Un médecin leur conseilla de me faire voyager pendant les grandes vacances. Il fut décidé que nous irions en Suisse.
La veille de notre départ, j’écrivis à Lucette une longue lettre que je ne parvins pas à mettre à la poste… Oh ! ces lettres d’amour, où l’homme et l’enfant parlent le même langage, que de naïveté elles découvrent au fond du cœur humain !
Nous arrivâmes à Genève… Mais ma pensée, mes souvenirs, toute la poésie qui m’engourdissait l’âme, étaient restés là-bas, dans cette triste ville de Brive, où vivait Lucette. Mon corps seul avait voyagé. Les glaciers des Alpes ne me disaient rien, ni le Rhône, ni le lac Léman. Encore, si Lucette avait vu tout cela, ces montagnes, ce lac, ce fleuve ! Mais Lucette n’avait jamais été en Suisse, et le Rhône ne passait même pas à Brive !
— Admire ! s’écriait mon père… C’était bien la peine de t’emmener en Suisse et de dépenser tant d’argent pour toi !
Les choses du dehors, en effet, m’impressionnaient peu ; je trouvais en moi-même la source de toutes mes émotions. Aux heures de rêverie, je sentais frémir en moi des aspirations étranges, des ardeurs romanesques, un besoin d’aimer qui me mettait le cœur sur les lèvres et qui m’eût fait embrasser les arbres mêmes de tendresse.
Ma famille, au contraire, tombait continuellement en extase devant les spectacles de la nature. C’était là un genre, une mode. Toute la journée, j’entendais ces mots : « Magnifique ! Superbe ! Splendide ! » Leur enthousiasme ne tarissait pas.
Ce voyage en Suisse n’eut d’autre effet que d’aggraver ma mélancolie. Au retour, ce fut un allègement soudain. Je me penchais en avant comme pour accélérer l’élan de l’express qui nous ramenait à Brive. Chaque minute qui m’en rapprochait, augmentait mon allégresse. J’étais bien décidé à revoir Lucette dès mon arrivée ; je gravais dans ma mémoire toutes les choses que j’avais à lui dire… Il me semblait que j’allais parler longtemps, longtemps, longtemps… Je suffoquais sous une abondance de sentiments et de pensées.
Dès la gare, je m’enfuis, j’arrivai chez les Delbray, haletant, essoufflé d’avoir couru tout le long du chemin. Ce fut Lucette qui m’ouvrit la porte… Elle avait alors dix ans. En me voyant, elle devint rouge comme une pomme d’amour.
— Maman, cria-t-elle, c’est René.
— Eh bien, fais-le entrer, répondit, de la pièce voisine, la voix de madame Delbray.
Ils étaient encore à table. J’apparus, les yeux baissés, si ému que mes mains en tremblaient et qu’il me fut impossible même de souhaiter le bonsoir.
— Lucie, dit madame Delbray, donne une chaise à René.
Je m’assis tout au bord de la chaise, sans oser lever les yeux.
— Tes parents t’ont donc permis de venir nous voir ? reprit madame Delbray.
De la tête, je fis signe que non.
— Alors, pourquoi viens-tu ? demanda monsieur Delbray.
Je gardai le silence.
— Il vient sans doute pour voir Lucette, dit madame Delbray… N’est-ce pas, René, tu viens voir ta petite amie Lucette ?… Oui, il a dit oui.
On me posa plusieurs questions auxquelles je répondis par oui ou par non, sans pouvoir dire autre chose. Je faisais des efforts suprêmes pour ne pas pleurer. Je vis que les yeux de madame Delbray s’emplissaient aussi de larmes.
— Pauvre enfant ! murmura-t-elle, si tout le monde avait ton bon cœur !… Va, je n’ai pas le courage de te renvoyer. Reste un moment avec Lucette… Approche ta chaise, tu vas prendre un peu de dessert avec nous.
La salle à manger était toute petite. Cela sentait la gêne, presque la pauvreté, cette pauvreté plus lamentable qui succède à la splendeur. M. Delbray, en peu de temps, avait beaucoup vieilli. Il ne portait plus le ruban de la légion d’honneur. Depuis qu’il avait été déclaré en faillite, le désert s’était fait autour de cette maison. Je me rappelais avec quel empressement, autrefois, quel air de vanité triomphante, toute la société de la ville accourait chez les Delbray… Maintenant, il me semblait que j’étais presque de leur famille ; je mangeais mon dessert comme un pauvre qui hésite à satisfaire tout son appétit. Lucette me regardait… Comme elle avait grandi ! Ce n’était pas encore une jeune fille, mais c’était déjà une vraie petite femme qui s’occupait du ménage avec une grâce adorable, car les Delbray n’avaient plus de domestique… Je me sentais heureux et malheureux à la fois : j’aurais voulu ne plus partir, demeurer là toujours, toute ma vie. Mille pensées se troublaient dans ma tête, et je continuais à répondre par oui et par non aux questions qu’on me posait. Je crois même que j’oubliai de dire que je revenais de Suisse, en droite ligne, et que je n’avais pas encore dîné.
— René, me dit enfin madame Delbray, je voudrais bien te garder plus longtemps, mais tes parents, qui ne te savent pas ici, doivent s’inquiéter… Va, rentre vite chez toi, mon petit. Tu reviendras…
Lucette m’accompagna jusqu’à la porte. Je pleurais à chaudes larmes.
— Pourquoi pleures-tu, René ?
— Parce qu’il me semble que je ne te reverrai plus de bien longtemps, Lucette.
— Puisque maman t’a dit de revenir, répondit-elle en baissant la voix.
— Je ne sais pas si je pourrai, Lucette… Je suis bien malheureux, Lucette… Je ne pense qu’à toi !
Ces derniers mots la firent s’envoler comme par enchantement… Un instant après, je me vis seul dans la rue. Je séchai mes larmes avant de rentrer à la maison ; je ne voulais pas qu’on s’aperçût que j’avais pleuré.
Mon pressentiment se réalisa. Des mois s’écoulèrent, sans qu’il me fût possible de retourner chez les Delbray, tant j’étais surveillé.
Pourtant, je ne cachai plus à mes parents que j’aimais Lucette. On prenait le parti d’en rire ; mes sœurs se moquaient de moi… C’était, dans la famille, un sujet de gaieté.
Un jour, à table, il fut question d’un jeune homme riche du pays qui avait épousé une fille sans dot. Mes parents ne trouvaient aucune excuse, ni même aucune circonstance atténuante à cet acte.
— Quelle folie ! déclarait ma mère.
— Quelle aberration ! s’écriait mon père.
A Brive, comme en bien des endroits de province, le prodigue, ou même celui qui n’augmente pas son avoir, devient l’objet du mépris public. L’homme qui se ruine est considéré à l’égal d’un malfaiteur. Même, à vrai dire, on pardonnerait plutôt à ce dernier.
— Quand on pense, dit ma mère, que ce garçon-là aurait très bien pu épouser une des filles Glavaux, qui lui aurait apporté trois cent mille francs, sans compter les espérances.
— C’est la faute des parents, déclara mon père. Voilà ce que c’est que d’élever les enfants dans de mauvais principes. On récolte toujours ce qu’on a semé.
— Eh bien, moi, dis-je alors naïvement, je ne me marierai qu’avec Lucette.
— Cet enfant devient fou, ma parole ! répliqua mon père.
Et, tout à coup, il s’emporta, indigné, rouge de colère :
— Quoi ! s’écria-t-il, j’aurais travaillé toute ma vie, j’aurais fait des économies, des sacrifices, je me serais saigné à toutes les veines, pour laisser une fortune aux miens, et je la verrais gaspillée par un gamin pareil !… Non, je n’ose même pas y penser… Cela me fait bondir !
— Voyons, mon ami, calme-toi, dit ma mère… Il changera. A cet âge, est-ce qu’on sait ce qu’on dit !
— Si, maman, je sais ce que je dis, répliquai-je avec une tranquille insolence.
Ce fut la seconde fois qu’on me renvoya de table… Oh ! les tristes jours qui suivirent ! Jamais je ne m’étais senti si triste, et tout en moi s’écroulait soudain, au pressentiment de la vie réelle qui me crachait à la face sa dérisoire disproportion avec mes chimères idéales.
Je passais des heures entières dans ma chambre, immobile, regardant, à travers les carreaux de ma fenêtre, les lents nuages qui défilaient dans le ciel, en écoutant un orgue de barbarie qui exhalait son harmonie lamentable, comme une impuissance découragée, dans le bruit sourd et continu de la pluie.
Dans les conversations de mes parents, tout me choquait, tout me blessait, tout me révoltait. Je me sentais mal à l’aise, égaré au milieu de ma famille comme en un pays de barbares. Je n’avais plus rien à leur dire, je restais muet pendant les repas ; tout demeurait en moi silencieux, étouffé… Et l’on me trouvait sage, on me citait en exemple à mes sœurs ; j’étais toujours le gâté de la maison.
Je ne pensais qu’à Lucette. Son image me poursuivait partout, obsédante et douce, comme une conscience intime, dirigeant toutes mes rêveries, toutes mes émotions… Peut-être vous étonnez-vous de ces sentiments précoces, car je n’avais encore que dix ans. C’est que l’amour n’a pas d’âge et que l’enfant, l’homme mûr, le vieillard lui-même, quand ils aiment, se ressemblent, ont le même cœur, les mêmes candeurs et les mêmes désespoirs.
Quelquefois, ma bonne Noémie me conduisait en promenade hors de la ville, jusqu’à une colline d’où la vue embrassait Brive et toute la campagne environnante. Je m’abandonnais alors avec volupté au vagabondage de mon imagination.
Une infinie douceur me venait des champs où traînaient des parfums de thym et d’herbes sauvages. J’éprouvais un charme imprévu dans la contemplation de la nature ; et les mêmes spectacles, qui jadis avaient passé devant mes yeux sans pouvoir me distraire de mon ennui, soulevaient maintenant au fond de mon âme des ravissements, des extases, de vagues exaltations. Un rien, la brise du soir, le bruissement des feuilles, la fumée d’une cabane s’élevant dans la cime des arbres, la cloche d’une église résonnant au loin, suffisaient à entretenir ma rêverie. J’aimais surtout le crépuscule, à l’heure où des bandes de passereaux défilaient au-dessus de ma tête, cherchant un dernier asile. Il y avait alors dans la nature je ne sais quoi de calme et de très doux qui me pénétrait d’une paix délicieuse. Je gravissais un coteau, j’allais m’asseoir sur un rocher pour voir la nuit s’avancer sur la campagne ou la pâleur éblouissante du soleil qui descendait à l’horizon.
— Il se fait tard, rentrons, disait Noémie.
— Encore, encore, suppliais-je.
Un jour que nous étions partis plus tôt que d’habitude pour regagner notre logis, j’entraînai Noémie vers la demeure des Delbray, sous prétexte de prolonger un peu notre promenade.
Hélas ! que l’homme dépend de peu ! A quoi tient sa destinée ! Que le hasard joue un grand rôle dans la vie de chacun !… Le moindre geste, une parole, le fait le plus insignifiant en apparence, comme de passer, un jour, par telle rue plutôt que par telle autre, c’est assez quelquefois pour entraîner des conséquences incalculables, pour changer le cours d’une existence, pour décider enfin de notre bonheur ou de notre malheur !
Oui, ce jour-là, si nous étions partis un quart d’heure plus tard, si nous avions suivi notre chemin habituel, si ma bonne Noémie n’eût pas cédé à mon caprice, vous ne me verriez pas aujourd’hui horriblement défiguré… Mais pourquoi discuter de ces choses ? Peut-être y a-t-il une fatalité, une prédestination inéluctable, dans ces sortes d’étranges coïncidences que nous attribuons au hasard. Peut-être, dans l’effrayant inconnu qui nous enveloppe, tout est-il dirigé vers des fins qui nous échappent, et chaque être est-il marqué, dès sa naissance, pour le rôle qui lui est dévolu dans cet éternel drame dont se compose l’histoire de l’humanité !
Comme nous approchions de la maison des Delbray, nous remarquâmes des lueurs rouges, puis une fumée noire, épaisse, que le vent chassait vers nous en gros tourbillons, et qui couvrait le ciel d’une nuée sinistre.
— Il y a le feu quelque part, et pas bien loin d’ici, dit ma bonne Noémie.
Une rumeur confuse s’élevait des rues avoisinantes. De tous côtés, des gens accouraient. La curiosité nous fit aussi presser le pas.
Surtout, me dit Noémie, tu ne me quitteras pas. Un malheur est si vite arrivé !… Donne-moi la main.
Oui, je me souviens encore de tous ces détails… Brusquement au détour d’une rue, un spectacle terrifiant, tout près de nous !… La maison des Delbray jetait des flammes par toutes les croisées… Une foule stationnait. J’entendis, d’abord, dire autour de moi que tout le monde était sauvé.
— Non, affirma quelqu’un… La fille des Delbray est restée dans la maison… On la cherche…
Oh ! je ne m’enorgueillis pas de ce que j’ai fait… L’héroïsme irréfléchi est condamnable et sot. Mon excuse est que, si j’avais déjà le cœur d’un homme, j’avais encore le cerveau d’un enfant. J’ai agi comme un fou, inutilement d’ailleurs, car Lucette était hors de danger… Je ne sais quelle force irrésistible m’a poussé ; je me suis élancé, je suis allé au feu… J’entends encore les cris épouvantés de Noémie et la foule qui clamait : arrêtez-le, arrêtez-le !… J’entrai dans l’incendie… Un brouillard de fumée, traversé par des flammes, m’enveloppait. J’appelai d’une voix forte : Lucette, Lucette ! un formidable fracas me répondit… Et je ne me souviens plus de rien. La fatalité voulut que je fusse sauvé. On me ramena évanoui… Quand je repris connaissance, j’étais chez moi, dans mon lit, torturé d’atroces souffrances, la face ravagée d’horribles brûlures.
Les premiers jours, ce furent, autour de moi, des larmes, des sanglots, du désespoir et le défilé de toutes nos connaissances qui mêlaient leurs lamentations à celles de ma famille.
Noémie, nuit et jour, était à mon chevet… Oh ! le doux visage de bonté et d’amour qui se penchait vers moi, qui m’aidait à souffrir ! Il y avait, dans ses yeux tristes, de la charité, du dévouement et du remords… Car elle s’accusait. A l’entendre, c’était sa faute, elle était responsable de ce malheur : elle n’aurait pas dû, disait-elle, me quitter ni me conduire là… Et moi qui ne pouvais parler, qui ne pouvais la défendre !…
Il avait été question, un moment, de la renvoyer. Elle avait supplié pour rester, pour se constituer ma garde-malade, pour me sauver la vie, offrant même de renoncer à ses gages… Et il y avait quinze ans qu’elle était dans la maison ! Ah ! Pauvre Noémie !
Quelquefois, elle me tenait dans ses bras, elle me berçait comme un enfant qu’on console et qu’on endort. Sa voix douce psalmodiait une chanson de son pays, toujours la même, monotone et vague, tandis que son visage baigné de larmes souriait à l’affreuse plaie qui couvrait toute ma figure et sur laquelle ses lèvres ne trouvaient plus de place pour se poser. Alors, c’était mes mains qu’elle embrassait en pleurant. « Tu as de jolies mains, me disait-elle, des mains de petite fille… Et tu auras toujours tes beaux yeux. »
Rien ne lassait sa pitié. C’était une vieille fille : je me dorlotais dans toute la maternité que la nature avait mise en elle et dont la destinée lui avait refusé les douleurs et les joies. Elle fut plus de huit jours à me veiller, sans vouloir prendre le moindre repos. Non, elle n’était pas fatiguée, elle n’avait pas sommeil. Pourtant, elle était vieille, et je n’étais pas un malade commode, car la souffrance m’arrachait des plaintes continuelles.
On m’avait cru perdu. Je devais vivre et rester défiguré !
Ah ! je n’y pensais pas encore à l’avenir qui me guettait, à ce malheur effroyable d’une âme créée pour l’amour et cachée sous une gangue horrible. Je souffrais trop et j’étais trop petit. Peut-être aussi y avait-il inconsciemment au fond de moi, de mon ignorance, cette illusion naïve qu’il suffisait, pour être aimé, de sentir noblement… Une seule question, pour l’instant me préoccupait : Que pensait Lucette de mon héroïque déclaration d’amour ? Le lui avait-on dit seulement et connaissait-elle mon état ?
J’interrogeai un jour Noémie à ce sujet. « Mais oui, mais oui, répondit-elle, Lucette t’aime bien aussi… et, si elle ne sait pas, c’est moi qui lui dirai. » Alors, il me sembla que j’avais plus de courage pour souffrir.
Cependant, depuis quelques jours, j’observais qu’il y avait quelque chose de changé dans l’attitude de ma famille autour de moi. Les paroles étaient les mêmes, on continuait à m’appeler « mon amour, mon chéri », mais les regards étaient différents et disaient, ou plutôt dissimulaient autre chose.
Un soir, j’étais assoupi, les yeux fermés. Noémie avait enfin consenti à aller se reposer. J’entendis mes parents qui causaient dans la pièce voisine. C’était de moi qu’il était question ; et mon attention se tendit pour écouter.
— Il dort, disait ma mère.
— Tu es sûre ?
— Oui… Ah ! le pauvre enfant ! Quel malheur.
— Quelle épouvantable fatalité !
— Il était si beau, notre René !
— Hélas !
— Enfin, dit ma mère, ce qui console un peu, c’est de se sentir entouré de tant de sympathies. Les Glavaux et le sous-préfet lui-même ont envoyé prendre des nouvelles.
— Ah ! le sous-préfet ?
— Oui, le sous-préfet.
— Que c’est aimable !
— Oui, ce sont des choses qui touchent.
— Les Delbray sont partis hier, annonça mon père.
— Ah !… Et pour où ?
— Je ne sais pas.
— Tant mieux, dit ma mère, et qu’ils ne reviennent plus ! Ce malheur qui nous arrive, c’est leur faute… Ils ont eu l’audace de tenter une réconciliation. Oui, ils se sont présentés trois fois… J’ai refusé de les recevoir.
— Tu as bien fait ; nous n’avions plus rien à attendre de ces gens-là.
Il y eut un silence.
— Il dort toujours ? demanda mon père.
— Oui… Oh ! il va beaucoup mieux. Le médecin m’a encore répété, ce matin, qu’il était sauvé.
— Le malheur n’en est pas moins grand, répondit mon père… Tiens, veux-tu que je te dise : moi, j’aurais préféré le voir mort.
— Oh ! mon ami !
— Mais oui, reprit mon père, cela eût mieux valu, car que veux-tu qu’il devienne, s’il doit rester horrible comme il est ?
— Peut-être, avec le temps…
— Jamais !
— Il aura toujours pour lui l’intelligence, l’instruction, dit ma mère. Avec cela, un homme se sauve toujours.
— Non, il faut voir les choses comme elles sont, répliqua mon père. Ce sera un monstre qui nous fera honte devant tout le monde, et nous n’oserons plus le montrer. N’oublions pas que nous avons deux filles à marier… Tu comprends, nous ne pourrions plus recevoir personne… Le mieux serait de l’éloigner.
— Où ?
— C’est à quoi je songe… Ma foi, on pourrait le mettre interne dans un lycée, un peu loin, si toutefois on veut l’accepter. Ainsi, nous ne l’aurions que pendant les vacances, les grandes vacances… Qu’en penses-tu ?
— Au moins faut-il attendre qu’il soit complètement rétabli.
— Naturellement.
Un nouveau silence régna.
— Va voir à côté, dit mon père.
Ma mère entra dans ma chambre. J’avais les yeux grands ouverts et fixes.
— Tiens, tu ne dors plus, dit-elle… Comme tu me regardes ! Qu’as-tu donc ?… Nous t’avons peut-être réveillé en causant. Est-ce que tu as entendu ?
Je baissai les paupières, sans répondre.
— C’est cela, rendors-toi, mon amour, dit-elle. Demain, on te lèvera, le médecin l’a permis.
Ce fut une nuit d’insomnie cruelle. Je réfléchissais à ce que j’avais entendu, et, à la souffrance physique, s’ajoutait une angoisse morale, l’angoisse du naufragé qui sent autour de lui l’abandon universel, la solitude des espaces infinis. Ce sentiment s’accrut encore, se compliqua d’une épouvante, lorsque, pour la première fois, je vis dans une glace le masque affreux que j’étais condamné à porter toute la vie. Ma propre image me fit horreur. Il me sembla qu’une de ces fées mauvaises qui interviennent dans les contes d’enfants m’avait appliqué sa main rageuse et sinistre sur la face, pour me vouer éternellement au malheur. Je fondis en larmes.
Noémie, m’ayant habillé, me prit par la main et m’entraîna à la cuisine.
Ce jour-là, mes parents avaient du monde à déjeuner. Mon couvert à table n’était pas mis.
Ma mère vint dire à Noémie :
— René, pour aujourd’hui, déjeunera avec vous, à la cuisine.
Dès lors, chaque fois qu’il y eut des invités à la maison, je mangeai avec les domestiques. Je ne m’en plaignais pas, car ma bonne Noémie, ces jours-là, me gâtait plus encore, m’entourait de soins, d’attentions, de prévenances. Elle faisait, pour moi seul, de petits plats, flattait ma gourmandise.
Nous étions vraiment de bons amis. Il m’arrivait même d’être gai auprès d’elle, et ma gaîté la rendait joyeuse. Sa pauvre figure de vieille rayonnait de toute la maternité sacrifiée qui remontait confusément du fond de sa nature.
Elle me disait souvent que je n’avais pas changé. Sans doute voulait-elle dire que j’étais toujours le même à ses yeux. Plus l’affection de mes parents se détachait de moi, plus la sienne grandissait, se faisait douce, tendre et délicate. Même une fois, elle m’embrassa… Depuis combien de temps n’avais-je plus été embrassé !
Les jours de visites, on m’éloignait. Je n’allais jamais au salon, quand il y avait des étrangers. Maman disait maintenant que ce n’était pas la place des enfants. Pourtant on y attirait mes sœurs, surtout quand les Glavaux se trouvaient là. L’aîné des fils Glavaux avait de doux yeux pour Henriette, qui venait d’avoir seize ans. Je crois que mes parents rêvaient de ce mariage : on en causait à demi-mots ; et il arrivait à ma mère de sommeiller, quand le fils Glavaux contait fleurette à ma sœur. Ce jeune homme, riche, en plein rapport, bien apparenté, destiné à prendre la succession de son père, qui dirigeait la plus grosse maison de commerce de la région, une maison fondée en 1840, était considéré comme un garçon de grand avenir et le plus beau parti de Brive. Son seul défaut, qu’on attribuait à une timidité de bon goût, consistait en une incurable nullité. « Il finira par se dégourdir, » affirmait mon père.
En attendant, on amassait la dot d’Henriette, on redoublait d’économies, on rognait sur l’ordinaire, on diminua même les gages d’un domestique.
Je me sentais un obstacle aux projets de ma famille. Oui, j’étais de trop dans la maison, ma présence gênait, causait un malaise. A table, personne ne m’adressait la parole ; c’était comme si je n’avais pas existé. Maintenant, on ne me reprochait plus d’être tout le temps fourré à la cuisine ; au contraire, on m’y renvoyait, j’y passais des journées entières, et je finis par y prendre tous mes repas. Les caresses, les sollicitudes, toutes les espérances se reportaient sur mes sœurs. On ne parlait plus de mon avenir. Même notre chien Tom était l’objet de plus de tendresse. Il est vrai qu’il me la rendait bien, cette tendresse ; il me léchait les mains, et c’était avec lui que je jouais, c’était lui qui me tenait compagnie, quand ma bonne Noémie était occupée à son ouvrage. Et ses bons yeux de bête qui se fixaient sur moi, pitoyables et tristes, avaient plus d’humanité que ceux des hommes.
Pourtant, j’étais plus affectueux qu’autrefois, je me faisais doux, obéissant, je m’ingéniais à rendre de petits services, je m’appliquais davantage à mes devoirs. Mes parents paraissaient ne pas s’en apercevoir. Même, il semblait que mes gentillesses, mes efforts pour mériter des éloges aggravaient leur indifférence. Je rentrai un jour de promenade avec un bouquet de fleurs cueillies dans les champs, et je l’offris à ma mère… Le soir, je dînai encore à la cuisine.
On négligeait même de me vêtir convenablement ; on prétendait que j’usais beaucoup. « René a besoin de souliers, réclamait Noémie. — Oh ! il peut attendre, répondait ma mère. »
Je sortais toujours avec ma bonne, qui, des heures entières, pour me distraire, me contait des histoires de son pays. Cependant, une après-midi — on s’était enfin décidé à remplacer mes pauvres vêtements, et j’avais un petit complet neuf — j’allai me promener avec mon père et ma mère. Ils se donnaient le bras et recueillaient tout le long du chemin force saluts. Je marchais à côté d’eux. Des regards extraordinaires me dévisageaient, où il me semblait deviner de l’étonnement, de l’effroi, de la répugnance, parfois de la pitié. La plupart des passants, après m’avoir aperçu, détournaient vite la tête. J’avais la sensation d’être une gêne. Mon père paraissait nerveux, contrarié et, d’instant à autre, réprimait un mouvement d’impatience. Il se pencha vers ma mère et murmura quelques mots que je n’entendis pas, puis, brusquement, se tournant vers moi :
— Tiens, va-t’en, me dit-il, va où tu voudras, je ne veux plus te voir.
J’allai devant moi, sans but, au hasard. Je marchai longtemps, sur une grande route déserte, poussiéreuse, qui s’enfonçait toute droite dans la campagne et se perdait à l’horizon… Que faire ? Je ne voulais plus rentrer chez mes parents. Si j’avais été homme, j’aurais cherché du travail, mais je n’avais pas onze ans, et pas un sou en poche !
La nuit vint. Il faisait froid, un grand vent soufflait. J’étais rompu de fatigue. Une tentation me prit de me coucher là, au bord de la route, de m’endormir, pour ne plus me réveiller… Pourtant, je me décidai à revenir sur mes pas.
Il était onze heures du soir, quand j’arrivai devant la porte de la maison. Ce fut ma mère qui m’ouvrit.
— Tiens, c’est toi, dit-elle, d’où viens-tu ?
Je ne répondis pas.
— Faites dîner René, ordonna-t-elle à Noémie.
— Merci, je n’ai pas faim, je ne mange pas, déclarai-je.
Et j’allai me coucher, sans avoir rien pris.
Le lendemain et les jours suivants, on me questionna. Je refusai de rien dire ; je m’enfermai, en présence de mes parents, dans un silence tragique.
— Voyons, qu’est-ce que tu as ? Parle, dis quelque chose… Tu as donc perdu ta langue ?
Je persistais à me taire. Tous les efforts pour m’arracher une syllabe furent vains. On essaya, pour me dérider, de toutes les plaisanteries. On s’adressait au chien :
— Tom, dis-nous ce que René a fait de sa langue… Tu dois savoir ça, puisque c’est à toi maintenant qu’il fait toutes ses confidences.
Je ne riais pas ; aucun pli de ma figure ne bougeait.
— Laissez-le donc, puisqu’il veut faire l’entêté, dit mon père.
— Eh bien, oui, boude tant que tu voudras, ajouta ma mère ; c’est toi qui t’en fatigueras le premier.
— Il n’y a qu’à ne plus faire attention à lui, dit ma sœur Henriette.
— C’est ça, faisons comme s’il n’existait plus, approuva Suzanne.
Mais les regards continuèrent invinciblement à se tourner vers moi. On ne s’habituait pas à ce silence écrasant ; il troublait les consciences, il pesait comme un remords sur la famille.
— A la fin, c’est exaspérant ! s’écria mon père. Nous n’allons pas nous laisser embêter par ce gamin têtu. Je vais user de mon autorité paternelle. Mettons-le au pain sec jusqu’à ce qu’il se décide à desserrer les dents. Nous verrons bien qui cédera le premier.
On me mit au pain sec. Le silence persévéra.
— Allons, je vais le fourrer interne dans un lycée, dit mon père ; il n’y a que cela à faire.
— Ce sera un bon débarras ! soupira Henriette.
On opta pour le lycée de Nantes, qui est la ville de France la plus éloignée de Brive : douze heures d’express. Et il fut décidé que je partirais, dès le lendemain, avec mon père, qui reviendrait aussitôt, ne pouvant, disait-il, s’absenter plus de vingt-quatre heures, à cause des affaires.
Noémie prépara ma malle. La nuit qui précéda le jour de mon départ, je l’entendis qui pleurait. Le lendemain, elle apparut, les yeux rouges, le visage grave. Elle regardait mon père et ma mère d’un air sévère. Tom aussi avait des regards étranges. Jamais il ne m’avait autant léché, et il me suivait partout en gémissant.
— Il est l’heure, partons, dit mon père.
Je subis les baisers glacés de ma mère et de mes sœurs. Noémie et Tom m’accompagnèrent jusqu’à la gare.
Quand le train s’ébranla, j’étais à la portière du wagon ; Noémie me faisait des signes avec son mouchoir. Sa silhouette s’éloignait et s’effaçait sous mes yeux brouillés de larmes… Adieu, adieu ! C’était l’adieu définitif, car je ne devais plus la revoir !… Et mon pauvre Tom qui suivait le train en courant de toute la force de ses vieilles jambes !
— Allons, assieds-toi et ne bouge plus, me dit mon père.
— Voilà ce malheureux enfant, qui a été victime d’un déplorable accident, dit mon père en me présentant au proviseur du lycée de Nantes.
Celui-ci, un vieillard décoré, leva les yeux sur moi, m’examina un instant avec un air d’inquiétude et de malaise, puis se tournant vers mon père :
— Oui, j’étais déjà prévenu par votre lettre, qui explique le cas… En effet, c’est un déplorable accident, mais après tout, je ne vois pas pourquoi nous n’accepterions pas cet enfant… Quel âge a-t-il ?
— Onze ans, monsieur le proviseur ; et il est assez avancé, il a fait un peu de latin ; il pourrait entrer en cinquième. C’est un enfant docile, laborieux et bien doué, je crois… Et il est plein de bonnes dispositions… N’est-ce pas, René ?
Je fis un signe de tête affirmatif.
— Vous le mettez interne ? demanda le proviseur.
— Nous y sommes obligés, déclara mon père.
Le proviseur parut hésiter, réfléchir un moment, et son front se barra d’un pli soucieux.
— Enfin, dit-il, on veillera à ce que les élèves ne le tourmentent pas. D’ailleurs, ils sont très gentils, pour la plupart ; nous n’avons que des jeunes gens de bonne famille… Mais, vous savez, à cet âge, on s’amuse de tout, et, quelquefois, les nouveaux, comme dans tous les lycées, sont l’objet de petites taquineries.
— Qui n’a pas connu cela ? dit mon père.
— Enfin, espérons que tout se passera très bien, conclut le proviseur.
— Mais oui, affirma mon père… Allons, René, mon enfant, ajouta-t-il en me baisant au front, je te quitte… Fais en sorte que ta mère et moi n’ayons qu’à nous féliciter de ton travail et de ta conduite. Donne-nous quelques satisfactions, en échange des sacrifices que nous nous imposons pour ton éducation… Va, tu es heureux ! On regrette plus tard cette vie de collège, et l’on se dit : « Oui, c’était le bon temps, je n’avais alors aucun souci, j’ignorais la lutte pour l’existence… » N’est-ce pas, monsieur le proviseur ?… Allons, je vous le recommande encore… Adieu René ; adieu, mon enfant… Aux prochaines grandes vacances… Un an, c’est bien vite passé !
Mon père, après ce discours haché, entrecoupé de soupirs, se retira, et je restai en face du proviseur.
— Suivez-moi, me dit celui-ci, je vais vous conduire au censeur.
Le censeur, au moment où nous l’abordâmes, arpentait un long corridor sombre, où régnait un silence de monastère.
— C’est un nouveau, dit sèchement le proviseur comme impatient de se décharger d’une corvée ennuyeuse… Il se nomme : René Grandon — et il entre en cinquième. Occupez-vous-en.
Les deux hommes causèrent quelques secondes à l’écart. Je n’entendais pas ce qu’ils disaient, mais je devinais qu’il s’agissait de moi. L’un d’eux eut un geste qui semblait signifier : Après tout, tant pis, nous verrons bien.
Le proviseur s’étant éloigné, le censeur, à son tour, m’examina et me dit :
— Pourquoi ne portez-vous pas un masque ? Cela vaudrait peut-être mieux… Enfin, vous ferez comme vous voudrez, ça vous regarde.
Il ouvrit une porte et me poussa devant lui… C’était l’étude du soir. A notre apparition, les élèves se levèrent, puis se rassirent, sur un signe du censeur ; et celui-ci s’étant approché du maître d’étude, il y eut entre eux un court colloque à voix basse. Tous les élèves me regardaient comme une bête curieuse ; les bouches se fendaient d’un rire qui n’osait éclater, retenu sans doute par la présence du censeur. Mais dès que ce dernier eut disparu, ce fut une explosion d’hilarité.
— Silence ! proféra le pion d’une voix furieuse. — Vous, le nouveau, allez vous asseoir là-bas, sur le dernier banc.
Tout confus, j’allai prendre la place qu’on m’assignait. Des rires mal étouffés fusaient encore, çà et là. On murmurait : Oh ! cette gueule ! Oh ! ce monstre ! — Quelques pensums distribués, au hasard, par le maître, rétablirent enfin le calme.
J’avais ouvert un livre que je ne lisais pas, cherchant à me donner une contenance, à me faire oublier, et je restai immobile, les yeux baissés, la poitrine oppressée de sanglots, la figure cachée dans mes mains. J’aurais voulu disparaître, fuir bien loin, hors des regards des hommes, ou même n’avoir plus la sensation que j’existais. Je me faisais petit, menu, je me blottissais pour occuper le moins de place possible.
— Pousse-toi, me dit mon voisin en m’enfonçant son coude dans les côtes. Ce n’est pas drôle de t’avoir à côté de soi. Je demanderai à changer de place.
Mon autre voisin me repoussait aussi. J’avais beau me réduire, me recroqueviller, je recevais des coups de poing dans les flancs et des coups de pied dans les jambes.
— Je ne vous ai rien fait, laissez-moi tranquille, suppliai-je.
— Tu n’avais qu’à ne pas venir ici.
— On m’y a mis… Et ce n’est pas ma faute, si je suis ainsi… Si vous saviez, si vous saviez !…
— Alors, on reste chez soi, quand on a une bobine à dégoûter tout le monde.
— Mes parents n’ont pas voulu me garder… Si vous saviez…
— Silence ! cria le pion… Le nouveau, vous saurez qu’on ne parle pas pendant l’étude, et, pour que vous vous en souveniez, vous me ferez une demi-heure de piquet.
— Bien fait ! fit mon voisin de droite en m’allongeant une nouvelle ruade qui me fit renfoncer un cri de douleur.
Un roulement de tambour annonça la fin de l’étude. On se mit sur les rangs pour descendre au réfectoire. Là encore, personne ne voulait être à côté de moi. Il y eut des protestations, et le surveillant se décida à me faire dîner seul, à l’écart, au coin d’une table inoccupée. Les garçons eux-mêmes manifestaient une répugnance à me servir. Je ne touchai à aucun plat. L’émotion, le chagrin, la honte me composaient une nourriture dont j’étais plus que rassasié. Je me sentais écrasé sous une fatalité, sans défense contre la force cruelle du nombre, l’hostilité instinctive, irraisonnée, ce besoin de haïr et de faire souffrir qui est dans l’âme des hommes. Les pions aussi me prenaient en grippe, puisque j’avais été déjà puni injustement. Alors, que faire ? Une voix intérieure me répondait qu’il n’y avait qu’à pleurer.
Après le dîner, on monta au dortoir… Oh ! ma première nuit au lycée de Nantes ! Que de larmes je versai !… N’être qu’un enfant, n’avoir fait encore de tort à personne, et déjà se sentir détesté ! Détesté, quand on a le cœur gonflé de tendresse ! Je ne comprenais pas, j’étouffais mes sanglots dans mes draps ; je pensais à Noémie et à Tom, mes deux seuls amis, qui étaient si loin maintenant et que je ne devais plus revoir de si longtemps ! Je revoyais mon pauvre Tom courant après le train qui m’emportait vers ce lieu de malheur, et je revoyais ma bonne vieille Noémie, qui peut-être pleurait aussi, à cette heure, en songeant à moi… Cela me consolait un peu ; mes larmes devenaient moins amères et plus abondantes, presque douces… Tom, Noémie ! ces deux êtres se confondaient dans mon amour, s’élevaient dans la bonté au-dessus de l’humanité tout entière.
Ma première année au lycée de Nantes fut vraiment atroce. Ma disgrâce physique me désignait comme devant être et rester, au profit même des autres nouveaux, le petit martyr nécessaire à la vie de mes compagnons d’internat. Le lendemain de mon arrivée, à la première récréation, dès que les rangs furent rompus, toutes ces petites brutes se ruèrent sur moi, avec la fureur des bêtes de basse-cour qui pourchassent à coups de bec la pauvre poule blessée. Je fus assailli, battu, terrassé. Quand on me releva, il fallut me transporter à l’infirmerie. J’y demeurai huit jours… Je reparus ; les persécutions recommencèrent.
Tout nouveau, au lycée de Nantes, était soumis à des épreuves, dont la durée et la rigueur variaient selon le caractère du patient. Il y avait eu, avant moi, un souffre-douleur, dont j’avais pris la place et qui, maintenant, se joignait aux autres pour me torturer, et il y mettait plus d’acharnement et d’ingéniosité que personne, comme pour se venger sur moi des tourments qu’il avait endurés.
Je me souviens d’un ruisseau boueux qui traversait la cour en roulant des immondices. Un jour, un élève y ramassa un pain qui y nageait depuis la veille, et me le lança en plein visage, dans les yeux, au moment où je me retournais vers lui. Je fus aveuglé, et je passai trois jours encore à l’infirmerie.
En classe, en étude, au réfectoire, pendant les récréations surtout, c’était un supplice sans répit. Vous ne sauriez croire de quelles inventions cruelles sont capables les enfants. Et mon maître d’études n’était guère meilleur ; il ne s’interposait pas, il laissait faire ; même, il m’accablait de pensums.
Personne ne voulait de mon voisinage. Je dégoûtais tout le monde. Des parents intervenaient pour demander qu’on préservât leurs enfants de mon contact. On finit par me reléguer dans un coin solitaire, au dernier banc de la classe. Au dortoir, mon lit fut également placé à l’écart.
Ma sensibilité maladive ne résistait pas à cette oppression. Ils étaient tous plus grands et plus forts que moi, ces lâches ! Mes regards imploraient en vain leur pitié. Dès que sonnait l’heure redoutée de la récréation, je me réfugiais au fond de la cour, pour échapper à mes bourreaux… Comme elles me semblaient longues, ces récréations, même lorsqu’on s’était fatigué de me tyranniser. Plongé dans un affaissement douloureux, las d’avoir trop sangloté, je promenais à l’entour de longs regards de détresse. On était à la fin d’octobre. Les premiers froids sévissaient. Les quatre murs tout lézardés de la cour ne laissaient plus apercevoir qu’un triste soleil, dont les rayons pâlissaient dans un ciel brumeux. Les platanes chevrotaient dans leurs branches, perdant leurs dernières feuilles, que le vent balayait au hasard. Je passais ma récréation à contempler ces arbres, mes grands frères immobiles et malheureux aussi, emprisonnés dans leur circonférence de fer. Quelquefois, tout frissonnant d’être resté debout, à la même place, je me risquais, au moment où personne ne semblait prendre garde à moi, à faire quelques pas pour me réchauffer un peu. Mais ce n’était vraiment que le soir, au dortoir, après le coucher, et quand le surveillant lui-même avait éteint sa lampe, que j’éprouvais un soulagement. Je ne m’endormais pas tout de suite. Souvent même, mes rêveries me tenaient éveillé, au milieu des ronflements, jusqu’à minuit, dont les douze coups, sonnant à la grande horloge du lycée, retentissaient longuement, à intervalles égaux, dans le silence écrasant du dortoir. Alors, je baissais les paupières, je m’endormais avec le désir de ne plus voir se lever l’aurore, le nouveau jour plein de souffrances qui m’attendait !
Le dimanche, jour de sortie, je suivais des yeux les élèves que leurs parents ou leur correspondant venaient chercher. Moi aussi, j’avais un correspondant, mais il ne paraissait jamais. J’entendais appeler, un à un, tous mes condisciples, en espérant toujours qu’on m’appellerait aussi. Peu à peu, l’étude se vidait, et je finissais par rester seul, sous le regard mécontent du pion, que je privais, malgré moi, de sa liberté et qui m’en gardait une sourde rancune.
Un dimanche cependant, mon nom fut prononcé ; j’allai au parloir, j’y trouvai mon correspondant… Quelle joie ! Un jour de congé, un jour de liberté, un jour entier sans torture ! Ah ! ce n’était pas trop tôt ! Déjà, par la fenêtre ouverte du parloir, je revivais à revoir du soleil, des maisons, du monde dans la rue, à respirer un autre air, et j’embrassais la main de mon correspondant, dans un transport de reconnaissance. — Je ne viens pas te faire sortir, je viens seulement savoir comment tu vas, me dit-il. »
Je passai au lycée mes vacances de Noël et de Pâques. Nous n’étions plus que cinq ou six, cinq ou six petits malheureux, comme perdus dans cette immense caserne d’où la vie s’était un moment retirée et que le vide agrandissait encore. Un silence glacial s’abattait dans les vastes salles désertes, au dortoir, au réfectoire, partout, continuellement, et jusqu’aux heures de récréation, dans la cour, où l’ennui, un ennui dense et sévère, suintait aux quatre murs.
Les lettres de ma famille s’espaçaient de plus en plus et répétaient toujours le même refrain : on se privait pour moi, on s’imposait des sacrifices pour mon éducation, et l’on m’exhortait au travail. « Aie pitié de ton père qui s’escrime pour toi, me disait-on. » Je ne me rappelle plus sous quel prétexte on en vint à me supprimer ma semaine, les dix sous que je recevais chaque dimanche. Et l’on m’accusait de vouloir tirer la carotte, parce qu’une fois j’avais demandé dix francs pour acheter des chaussures ; celles que je portais crachaient la boue, depuis longtemps, et j’avais les pieds dans l’eau, les jours de pluie… La carotte, non, ça ne prenait pas auprès de ma famille !
Pourtant ces lettres, je les dévorais, je les relisais jusqu’à les savoir par cœur ; elles m’apportaient un peu l’air du pays ; elles étaient mon unique consolation. Avec quelle impatience je les attendais !… Elles étaient courtes, elles n’avaient jamais plus de trois pages. Moi, j’adressais d’interminables épîtres à ma mère et à ma bonne Noémie, qui ne pouvait me répondre, ne sachant pas écrire.
Deux mois s’écoulèrent, sans que me parvînt une nouvelle de Brive.
Cependant, les élèves continuaient à me persécuter. Et c’était moi, au dire des maîtres, qui avais mauvais caractère puisque mes camarades ne pouvaient me supporter.
Enfin, les grandes vacances arrivèrent. Le proviseur me fit appeler ; il avait reçu une dépêche de ma famille, qui me réclamait à Brive.
L’express m’emportait vers Brive, roulant à toute vapeur, sur ces rails rectilignes dont j’avais tant de fois, pendant les promenades, contemplé la fuite éperdue vers l’horizon. Un indicible attendrissement faisait fondre mon cœur. J’allais revoir ma vieille Noémie, Tom, le pays natal, la maison, les sites que j’aimais. Maintenant, tout était oublié, et le long isolement de cœur, et les cruautés subies, et les larmes versées dans le silence du dortoir… La vie a des ressources inépuisables. Il a toujours suffi d’un rien pour ranimer en moi l’espérance, et, tel que vous me voyez, mutilé, horrible, maudit du destin, j’ai connu aussi des heures de rêve, de ravissement, d’illusion délicieuse !
Nous approchions de Brive. Le jour commençait à blanchir les vitres du wagon. Au dehors, les arbres se sauvaient, les paysages défilaient, estompés de teintes grisâtres, envahis par les vapeurs de l’aube. Je me penchais à la portière. La ville, située sur une hauteur, apparaissait au loin, parmi les brumes, très vague encore, comme fondue dans l’irréel.
Déjà, je reconnaissais des environs, des coins de campagne qui réveillaient mes souvenirs, des souvenirs très doux, tandis que le grand air matinal m’apportait une fraîcheur d’aurore, des senteurs vivifiantes, le parfum des champs imprégnés de rosée. Les choses, lentement, précisaient leurs contours. J’aperçus la fine flèche de l’église, tout près de laquelle était notre maison… Le train ralentissait, nous arrivions. J’étais heureux… Oh ! que j’étais heureux !
Cependant, quand le train s’arrêta, je fus très étonné… Personne ne m’attendait à la gare. J’avais pourtant prévenu par dépêche de l’heure exacte de mon arrivée… Et Noémie ? Elle n’était donc pas là !… Je regardai de tous côtés, j’attendis même quelques minutes… Non, elle n’était pas venue ! Ma déception fut grande, un mauvais pressentiment me traversa comme un éclair.
J’arrivai à la maison, précédé d’un homme qui portait ma malle… Il y avait deux prix au fond de ma malle : une surprise pour ma mère… Mais, je ne sais pourquoi, je n’étais plus joyeux ; je me sentais saisi d’une appréhension soudaine, inexplicable… Je sonnai, un coup de sonnette timide, comme on sonne chez des étrangers où l’on n’est pas sûr du bon accueil et que l’on craint de déranger. Mon cœur battait à se rompre.
La porte s’ouvrit… C’était un domestique que je ne connaissais pas ; et il me regarda avec un air de stupeur et de méfiance. Même, il eut un mouvement comme pour refermer la porte.
— Qu’est-ce que vous voulez ? dit-il.
— Je suis le fils Grandon, répondis-je.
Il paraissait en douter. Puis, un rire lui fendit la bouche.
— Entrez, fit-il enfin.
Je trouvai ma mère et mes sœurs réunies autour d’une table, où était servi le premier déjeuner du matin.
— Ah ! c’est toi, me dit ma mère, nous ne t’attendions pas de si bonne heure… Ce train a presque toujours du retard.
Je m’avançai, j’embrassai ma famille. Leurs lèvres glacées, comme répugnées, m’effleurèrent à peine le front. On me demanda si je me portais bien, si j’avais été heureux, mais d’un ton qui décourageait les confidences. Je me sentais gêné, intimidé, sans contenance ; je n’étais plus chez moi. Une atmosphère d’indifférence, presque d’hostilité, me contractait le cœur. Je bégayais des mots sans suite, des commencements de phrase ; et mes regards navrés erraient à l’entour.
— Qui cherches-tu ? me demanda ma mère.
Je balbutiai :
— Noémie… Elle n’est pas ici ?
— Comment, tu ne sais pas ? me dit ma mère ; nous ne te l’avions donc pas écrit ?… Noémie a quitté la maison, il y a un mois. Elle était trop vieille, presque infirme, nous ne pouvions plus la garder… Elle est retournée chez elle, en Bretagne.
Je restai muet… C’était loin, la Bretagne ! J’aurais bien volontiers repris le train tout de suite, pour y aller… Mais c’était grand aussi, la Bretagne ! Et je ne savais même pas le nom de la ville ou du village que Noémie habitait.
Je n’osais pas non plus le demander. Sans doute l’ignorait-on, d’ailleurs.
— A quoi penses-tu, René ? dit Henriette.
— Noémie n’a rien dit pour moi, avant de partir ? questionnai-je.
— Si, il me semble, mais je ne me souviens plus… Elle radotait.
— Enfin, nous nous en sommes débarrassés, dit ma mère.
En ce moment, Tom, mon vieux chien, parut… dans quel état lamentable ! cagneux, boiteux, couvert de plaies saignantes.
— Va-t’en d’ici, sale bête ! cria Suzanne, ma plus jeune sœur.
Mais il se traîna douloureusement jusqu’à mes pieds, me lécha les mains, en levant vers moi des yeux mourants, où il me sembla voir briller tout à coup, cependant, une lueur joyeuse. Je sentis que je n’avais plus que cet ami dans la maison, et tout ce que mon cœur contenait de tendresse s’élança vers cet ancien confident de mes peines, et qui en savait long déjà… Il m’avait si souvent vu pleurer ! Et j’en avais gros encore sur le cœur à lui dire… Je l’attirai dans un coin, et je le caressai en murmurant à voix basse, pour qu’on ne m’entendît pas : « Tom, mon vieux Tom, si tu savais, si tu savais ! »
Mon père entra.
— Il faut faire abattre cette bête, dit-il.
Puis, s’apercevant que j’étais là :
— Te voilà, René ; tu dois être content d’être en vacances… Eh bien, puisque tu n’as rien à faire, tu vas conduire Tom chez le pharmacien, qui lui donnera une boulette, pour l’empoisonner.
Mais il se ravisa aussitôt :
— Non, emmène-le dans les champs, un peu loin d’ici. Tu lui donneras toi-même sa boulette, et tu le laisseras crever là. C’est plus pratique.
Et, sans attendre ma réponse :
— Adieu, je file à mon bureau.
Décidé à ne pas obéir, je passai toute la journée seul, dans une pièce, avec mon chien. Je lui donnai à boire et à manger, car on ne s’occupait plus de lui, on le laissait mourir de faim, et il dévorait en ouvrant sur moi de grands yeux chargés de tristesse et de reconnaissance. Je chassai les mouches qui s’attachaient à ses plaies. Quand la nuit vint, je l’enveloppai dans une couverture et le couchai au pied de mon lit.
Le lendemain, il ne voulait plus me quitter ; il me suivait partout en me léchant sans cesse. Mon père, en le voyant, fut pris d’une colère :
— Comment, ce chien est encore ici ! Tu n’as donc pas fait ce que je t’ai dit !… Allons, emmène-le, je ne veux plus le voir.
— Bien, dis-je, craignant, si je me refusais à la besogne sinistre, qu’on en chargeât un domestique, qui se serait empressé de l’exécuter.
Je cachai Tom dans un grenier, en laissant croire que je l’avais empoisonné. Il resta là environ une semaine. Chaque jour, j’allais le voir, je passais des heures auprès de lui, je lui composais des pâtées succulentes avec des restes que je volais dans le buffet, et nous avions ensemble des entretiens très doux, où je parlais tout seul, tandis qu’il me léchait les mains sans se lasser.
Un soir, il mourut dans mes bras, ainsi qu’un frère, en me regardant comme s’il regrettait de me laisser seul, sachant bien que je n’avais pas d’autre ami ni d’autre affection au monde. Même, je vis des larmes, de vraies larmes s’arrêter dans ses yeux qui, jusqu’au dernier moment, se fixèrent sur moi avec une expression d’infinie pitié. Il me sembla qu’il oubliait sa propre agonie pour ne penser qu’à moi, à l’heure de la séparation suprême.
Je fus quelques minutes à m’apercevoir qu’il était mort, car ses regards s’obstinaient sur moi et me léchaient encore. J’attendis que tout le monde fût couché à la maison ; puis, doucement, sans bruit, je chargeai le corps de mon ami sur mes épaules, et je m’en allai, à travers la nuit, vers la rivière qui coulait, silencieuse et lente, à deux cents mètres de là… Qu’il était lourd, ce pauvre Tom ! Je succombais sous le fardeau. Trois fois, je dus le déposer, puis le reprendre, avant d’atteindre la rivière. J’y jetai le cadavre de mon compagnon. Il y eut un clapotement sourd. Le corps s’enfonça, puis reparut à la surface de l’eau. Le courant l’emporta sous la clarté paisible de la lune. Je le suivis des yeux aussi longtemps qu’il me fut possible… Puis, je m’en retournai, seul, en pleurant.
Une semaine s’écoula. Comme par le passé, je prenais mes repas à la cuisine, car il y avait souvent des invités à la maison. Mes parents songeaient à placer leur fille aînée. Pour attirer les épouseurs, on offrait des déjeuners et des soirées. Ces jours-là, mon père me mettait dans la main une pièce de cinquante centimes, en me disant : « Tiens, va rejoindre tes camarades. » De camarades, je n’en avais point, et j’errais seul dans la ville, des après-midi entières. Et cela aussi finissait par contrarier ma famille, à la pensée que je pouvais rencontrer des amis de la maison, des gens de la Société.
— Au lieu de traîner par la ville, me disait mon père, tu ferais bien mieux d’aller te promener à la campagne, qui est si belle en cette saison.
Dès qu’une visite était annoncée, on m’ordonnait de disparaître. Aux personnes qui demandaient de mes nouvelles et s’étonnaient de ne jamais me voir, on répondait que j’étais un timide, un sauvage, à qui le monde faisait peur, et l’on affectait de me plaindre.
Depuis quelque temps, les relations avec les Glavaux s’étaient refroidies, les Glavaux jugeant insuffisante, pour leur fils aîné, appelé à un si brillant avenir, la dot de cent mille francs qu’on destinait à ma sœur Henriette. Et mes parents, à cette heure, jetaient leur dévolu sur le vicomte de Trévise, un vicomte authentique, ruiné par le jeu, pourri par la noce, mais dont la particule, aux yeux des provinciaux de Brive, avait la splendeur d’une auréole. On le jugeait charmant, distingué, plein de grâce ; et c’était encore un parti magnifique, à cause du nom et des alliances. « D’autant plus qu’il s’est complètement assagi, affirmait mon père. »
Ma mère surtout poussait à ce mariage. Moi je ne connaissais même pas de vue le vicomte. Dès qu’il entrait, on me faisait fuir par l’escalier de service. A chaque coup de sonnette, c’était une alerte.
— File vite, sauve-toi, me disait-on… Si le vicomte te voyait !
J’éprouvais profondément toutes ces blessures. Le malheur m’étiolait, car les forces de l’homme ne s’épanouissent que dans le bonheur, comme les pétales de la fleur sous les chauds rayons du soleil. Au fond, j’aimais la vie, et ma tristesse était de ne pouvoir la vivre, de n’entendre jamais une parole affectueuse.
Un jour, on m’avait permis de déjeuner à table. J’en augurais que mes parents étaient revenus à de meilleurs sentiments à mon égard. Cependant, on ne me parlait pas, on me répondait à peine, et je voyais mon père plus nerveux que d’habitude ; il me jetait de temps en temps des regards étranges.
— Quel jour sommes-nous ? demanda-t-il.
— Le 30 août, répondit une de mes sœurs.
— Comment, s’écria-t-il, il n’y a encore qu’un mois que René est en vacances !… C’est bien long, ces vacances ! Il me tarde que ce soit fini… La présence de ce gamin nous crée une situation intolérable… Dis, quand t’en iras-tu ? ajouta-t-il en me regardant.
— Tout de suite, répliquai-je en me levant de table… Je suis trop malheureux, je veux aller retrouver Noémie.
— C’est ça, fiche le camp, dit mon père… Et quelle chance, si tu ne revenais pas !
— Oh ! ne crains rien, il reviendra bientôt, dit ma mère… Où veux-tu qu’il aille ? il n’a pas d’argent.
C’était vrai, je n’avais pas un sou en poche. Je partis néanmoins, résolu à vivre n’importe comment, à coucher, la nuit, n’importe où, à solliciter tous les travaux, dans les granges, dans les fermes, dans les champs, comptant sur l’époque des récoltes, où l’on avait partout besoin de mains-d’œuvres. Je concevais le projet fou d’aller ainsi, par petites étapes, jusqu’en Bretagne, pour y rejoindre ma bonne Noémie, qui — j’avais fini par le savoir — habitait un village du Morbihan, tout près de Pontivy. C’était plus de quatre cents kilomètres à parcourir, et j’ignorais d’ailleurs la route… Le désespoir noyait ma raison ; j’allais de l’avant, vers le nord, sans savoir au juste. Je marchai huit heures sans m’arrêter… La nuit vint, une belle nuit étoilée et chaude du mois d’août. J’étais en pleine campagne, éloigné de toute habitation. J’avais faim et soif, mais la fatigue, plus forte, m’écrasa ; je m’endormis au pied d’un arbre…
Dès l’aube, hélas ! je reprenais le chemin de Brive… On ne trouvait pas facilement du travail dans les champs ! Auprès d’un village, des petits paysans m’avaient jeté des pierres. Je rentrai à la maison, affamé, accablé, désespéré.
Le lendemain, on me renvoyait au lycée de Nantes.
Mais je suis las de ressasser ces souffrances, et le souvenir même m’en est pénible. Les malheurs de l’enfance se répercutent sur la vie entière et laissent au cœur de l’homme une source intarissable de mélancolie. Que de fois j’ai souhaité ne plus être ! Mais la vie a, malgré tout, de puissantes attaches. Une force mystérieuse m’a toujours retenu au bord du néant. Quand il semble qu’on n’ait plus rien à espérer, c’est alors qu’on croit au miracle ; et le miracle quelquefois se réalise, l’imprévu se produit, qui nous sauve tout à coup d’une situation inextricable, comme il déjoue les intrigues les plus patientes, les combinaisons et les calculs les plus savants. Et rien n’est consolant comme cette parole de Byron, dont il faudrait toujours se souvenir : « Nul ne connaît l’avenir, que nul ne désespère. » Je ne crois pas à une providence qui veille sur nous, mais je crois au hasard, notre souverain maître, et j’ai foi surtout en l’humanité, dont j’ai tant souffert, mais qui recèle des trésors inépuisables… A tout prendre, la vie vaut d’être vécue ; ne faisons jamais rien contre elle d’irréparable ; sachons attendre. L’histoire est lente à se faire.
Je vous passe des années, des années d’une existence monotone et calfeutrée, au lycée de Nantes. Je ne sortais plus de l’internat, même pendant les grandes vacances. J’appris, un jour, par lettre, le mariage de ma sœur Henriette, puis, trois ans après, celui de ma sœur Suzanne.
A la longue, cependant, ma vie s’était faite plus supportable. On avait cessé de me persécuter. J’étais le premier de ma classe, et, par là, j’inspirais quelque respect à mes condisciples. Peut-être aussi finissait-on par s’habituer à ma figure, bien que ma disgrâce physique parût empirer avec le temps, car la cicatrice de la brûlure tirait les chairs de la face, en ratatinait et en dévorait tous les traits, à mesure que je grandissais. Et je me vis bientôt dans la nécessité de porter un masque. Il m’était pénible, en été surtout, à cause de la chaleur ; et, plus tard, une fois libre, je ne le gardai plus que quand les circonstances me l’imposèrent absolument. Moi aussi, je me suis habitué à la répulsion dont l’inique fatalité m’a rendu l’objet.
J’arrivai à la fin de mes études, je passai mon baccalauréat, j’obtins des accessits au concours général. Mon père me rappela à Brive. J’y fus mieux accueilli que je ne m’y attendais, car rien n’est tel encore que de réussir pour retrouver sa famille. Mon père était de bonne humeur ; il avait pu donner cent mille francs à chacune de ses filles, en les mariant, et les affaires continuaient à prospérer. Seul, le vicomte, le mari d’Henriette, était un point noir à l’horizon. En peu de temps, il avait dissipé la dot de sa femme, et il en était maintenant aux emprunts.
J’avais alors dix-huit ans, je rêvais de m’affranchir. Ce foyer d’hypocrisie bourgeoise me comprimait ; je m’y sentais gêné, amoindri, dévoyé, et le souvenir de tant de souffrances subies, le martyre de mon enfance, avait détruit en moi le sentiment de la famille. Je n’aimais plus mon père ni ma mère. Je ne les haïssais pas non plus ; ils m’étaient indifférents, et j’avais hâte d’aller vivre ailleurs, loin d’eux, de m’élancer selon ma sève. Le malheur, l’expérience précoce des hommes n’avaient pas tué mes rêves. J’avais les illusions et les innocences de mon âge. Mes parents aussi, bien que mieux disposés à mon égard, auraient préféré me voir loin. Un jour, je déclarai à mon père mon désir d’aller faire mes études de droit à Paris.
— Tu es libre, dit-il, je ne suis pas de ces pères qui contrarient la vocation de leurs enfants. Choisis la carrière qui t’attire. D’ailleurs, tu es presque un homme, maintenant. Il faut que tu sois bientôt en état de gagner ta vie, pour ne plus être à charge à ta famille. Tu sais les sacrifices que je me suis imposés pour toi. Te voilà aujourd’hui instruit, bachelier, raisonnable. Du reste, c’est une justice à te rendre, tu es intelligent et travailleur… Je suis disposé à te soutenir encore quelques années, jusqu’au jour où tu te seras fait une situation. Mais il est bon que, dès à présent, tu commences à apprendre la vie. C’est une science qu’on n’acquiert qu’à ses dépens. Va donc à Paris, amuse-toi, tout en travaillant, car il faut que jeunesse se passe. Moi, à ton âge, j’étais un boute-en-train, je faisais la cour à toutes les filles, ce qui ne m’empêchait pas d’être sérieux, économe, et de songer à l’avenir…
Mon père, lancé, parla encore longtemps, tandis que ma mère l’approuvait par de lents signes de tête. Il me donna encore de bons conseils, me fit un cours de morale sur les devoirs de l’homme envers la société, envers la patrie et envers Dieu. Puis, il m’embrassa.
— Adieu, mon enfant. Souviens-toi que tu portes un nom respecté, un nom sans tache et auquel tu te dois de faire honneur.
Ma mère m’embrassa aussi. On me remit quelques billets de banque, en me recommandant l’économie, et je partis pour Paris.
René Grandon s’interrompit. Peut-être hésitait-il à se livrer davantage, à découvrir un coin plus obscur, une blessure plus profonde de son âme. Il n’avait pas encore prononcé le nom de madame Derive, ni fait allusion à cet amour mystérieux. Et, tout à l’heure même, tandis qu’il parlait, je devinais que son esprit était ailleurs, absorbé dans un autre passé ; son regard fixe semblait voir l’invisible, et, par instants, il se penchait, il tendait la face, attentif, comme s’il entendait un appel lointain, là-bas, dans le silence. Il me tardait de savoir toute son histoire. Je le pressai de continuer.
— C’est un spectacle décevant, reprit-il soudain, que Paris vu pour la première fois, par un temps d’hiver. On s’est imaginé des merveilles, on s’attend à des splendeurs, et l’on s’étonne des rues étroites, des maisons grises, du pavé boueux, du brouillard qui fond en pluie fine sur ce vaste monde de pierres ; et l’on s’effraye de sa petite molécule humaine, instable et frêle, perdue parmi cette foule indifférente et anonyme qui se hâte, qui s’agite, s’enfièvre, tourbillonne et vous bouscule.
Dès mon arrivée dans la capitale, où je ne connaissais personne, j’éprouvai cette impression de solitude infinie, je sentis se dissoudre ma chétive personnalité, qui ne tenait à rien et qui errait au hasard, par les rues, avec la crainte de s’égarer. Je fus ainsi, plusieurs semaines, seul, désorienté, ahuri par le vacarme, éloigné, par une timidité souffrante, de cette humanité fébrile qui grouillait sans cesse autour de moi et dont le heurt me brutalisait. Non, ce n’était même pas l’hostilité permanente, universelle, qui, en province, me pourchassait de toutes parts ; c’était l’indifférence complète, absolue, l’égoïsme intransigeant que crée l’âpre conflit vital dans les grandes cités. Ma laideur même n’effarouchait personne, je passais inaperçu dans cette agglomération d’existences insoucieuses de la mienne, comme parmi les arbres d’une forêt déserte et touffue.
Au quartier Latin, où je m’étais installé, je voyais des couples joyeux, des bandes bruyantes d’étudiants qui montaient ou descendaient le boulevard Saint-Michel. Moi, j’étais seul, toujours seul, au milieu de cette gaîté, de toute cette joie de vivre ; je n’osais aborder personne, ni même entrer dans un café, car les cafés étaient pleins de jeunesse, d’illusions, d’espérances et de rires ; et les femmes surtout, les filles du quartier me faisaient peur. Je savais bien que je ne pouvais prétendre à aucune, que toutes m’auraient repoussé, peut-être insulté, si j’avais eu l’audace de leur parler. Leur regard ne rencontrait jamais le mien ; je baissais les yeux, elles détournaient la tête. Oui, même par le regard, je n’avais de communication avec aucun être, ma laideur horrible faisait le vide autour de moi, comme une barrière infranchissable. J’étais plus malheureux que les infirmes, plus délaissé que les chiens perdus, qui sont parfois recueillis par des âmes pitoyables.
J’avais une voisine dans l’hôtel garni où je logeais. Une cloison légère séparait nos deux chambres. Tout le jour, j’entendais son jeune rire et son babillage. Elle se nommait Bijoute. Du moins, c’était ainsi qu’on l’appelait.
Bijoute n’était pas sérieuse. Elle était l’insouciance et l’inconscience mêmes, rentrant tard ou pas du tout, parant de ses cheveux dorés, de son éclat de courtisane fauve, les restaurants de nuit et les bals publics, attirant et allumant tous les regards, quand elle dansait, vêtue d’une robe si étroitement ajustée, qu’elle en était troublante à la fois de grâce et d’indécence.
Elle était la parure du quartier, convoitée par tous, rayonnante et folle, intéressante aussi par ce je ne sais quoi de las et de vaincu qu’ont toutes, en dépit des artifices, les vendeuses de joie ; mais cette lassitude ne s’apercevait chez elle qu’aux heures rares où les lueurs de la conscience se reflètent sur le visage. Il y avait alors un rien d’amertume dans le pli de ses lèvres qui touchait à la joue. On lui demandait : « Qu’as-tu Bijoute ? » Et c’était toujours la même réponse : « Je n’ai rien, laissez-moi. » Elle passait pour la fille capricieuse, inconstante, amoureuse d’indépendance, congédiant ses amants au bout de huit jours, désespérant ses adorateurs, usant sa chance, sans profit, inhabile enfin à exploiter le désir de l’homme. J’entendais parfois la tenancière de notre hôtel qui la sermonnait : « Vous êtes trop gâtée ; c’est dommage vraiment ! vous êtes si jolie !… Ah ! si vous vouliez devenir sérieuse !… » — « Mais je suis sérieuse », répondait Bijoute, en prenant tout à coup un air grave et froissé, adorablement drôle.
La première fois que Bijoute m’avait vu, elle avait jeté un cri d’épouvante, puis elle était partie d’un éclat de rire inextinguible. Moi, je m’étais sauvé, et, depuis, je n’osais plus paraître devant elle, je l’évitais, je craignais de la rencontrer. Et, pourtant, il m’arrivait de la suivre à distance, et je ne sais quelle joie soudaine m’inondait, quand son jeune rire, traversant la cloison de ma chambre, éclatait dans le silence de ma solitude. J’avais peur, si elle me voyait une seconde fois, qu’elle ne quittât l’hôtel, pour fuir mon voisinage.
Un jour, je ramassai un objet qu’elle avait laissé tomber ; je le suspendis à sa porte pour qu’elle le retrouvât en rentrant ; et je veillai sur cet objet, jusqu’à l’instant où je reconnus son pas et le frou-frou de sa robe dans l’escalier.
J’aspirais avec ravissement le parfum qui traînait après elle et dont l’air restait un moment imprégné, là où elle avait passé… Non, je n’espérais rien. C’était déjà beaucoup pour moi de la sentir si près, d’être effleuré par son atmosphère et d’en pouvoir rêver… Souvent, je me cachais pour la voir, elle me frôlait, sans se douter que j’étais là. Je la trouvais adorable, cela me suffisait, cela bornait mon horizon ; il y avait des jours où je n’étais pas malheureux.
Combien avait-elle eu d’amants ? Elle-même sans doute ne savait plus. Elle était la chose éphémère et jolie, offrant au caprice qui passe l’aumône d’une caresse, l’illusion du bonheur…
Moi, j’aspirais seulement à l’approcher de plus près, à causer, un instant, avec elle. Mais cela même, ce désir naïf me semblait aussi irréalisable que le rêve de conquérir une reine.
J’avais encore dans l’oreille ce cri d’effroi qu’elle avait jeté, puis ce fou rire, plus insultant et plus cruel encore, dont elle avait été secouée, l’unique fois qu’elle m’avait aperçu. Je ne lui en voulais pas, cependant. Tant d’autres, avant elle, m’avaient fait expier plus durement le crime d’être laid !
Un matin, une idée étrange et romanesque germa dans mon cerveau.
Nous étions à l’époque du carnaval. Il y avait bal masqué, le soir, à l’Opéra. Je me procurai deux billets, et j’en adressai un, sous enveloppe, à Bijoute. « Elle ira, pensai-je, je serai masqué comme tout le monde, elle ne me reconnaîtra pas, et je lui parlerai. »
Qu’avais-je donc à lui dire ? En vérité, je l’ignorais. Une confusion de sentiments intenses, inexprimables, m’agitait comme un cyclone intérieur. J’étais vierge, je ne m’étais jamais approché d’une femme, et j’avais toujours songé à l’amour… Oh ! l’affreuse ironie du destin qui m’avait fait cette laideur inhumaine avec un cœur humain, capable d’amour !
Toute la journée, je passai par des alternatives d’exaltation, d’inquiétude, de tristesse et de joie. Enfin, vers onze heures du soir, j’entrai à l’Opéra, déguisé et masqué.
Où était-elle ? J’errai près d’une heure, à sa découverte, taciturne et gauche, dans le vertige de la fête, le flamboiement des lustres, avec la stupeur d’une bête de nuit exportée au soleil. J’examinais toutes les femmes, cherchant à la deviner à sa taille, à sa démarche, au timbre de sa voix, à la couleur de ses cheveux et de ses yeux, à la grâce troublante de ses mouvements, car elle ne pouvait faire un geste qui ne fût gracieux… Autour de moi, les couples tournaient, valsaient, sautaient, au tumulte d’un orchestre qui me mettait plus de détresse dans l’âme…
J’étais venu là pour me donner, l’espace d’une soirée, une illusion apaisante, l’illusion d’être un homme comme les autres. Un homme comme les autres !… Eh bien ! non, malgré mon masque, malgré mon déguisement qui me confondait dans la banalité de cette mascarade, je n’étais pas un homme comme les autres ! J’étais différent de tous, non seulement par ma disgrâce physique, mais aussi et plus encore peut-être par ma chair, par mes sentiments, ma pensée, par toute la souffrance muette qui s’était accumulée en moi, différent des garçons de mon âge qui osaient parler aux femmes, qui avaient goûté à des lèvres chéries ; différent des vieillards qui gardaient au cœur des souvenirs délicieux et pouvaient espérer encore… Je me sentais à part, étranger à tout, ne tenant à rien, et je restais en panne, adossé à une colonne, morfondu par cette gaieté factice, pénible et machinale, où le rire sonnait faux, où les voix s’éraillaient, aigres et criardes. Et je me trouvais bête, bête à pleurer, sous ce déguisement grotesque, où mentait et sanglotait toute mon âme.
Le temps passait ; déjà, des masques se soulevaient. Enfin, je la vis… La première de tout le bal, elle avait jeté son loup, et elle s’avançait vers moi, la figure claire et riante, essoufflée par la danse, l’air triomphant.
Je l’abordai et je trouvai le courage de lui dire :
— Bonsoir, Bijoute.
Elle s’arrêta, surprise :
— Vous me connaissez donc ?
— Oui.
— Qui êtes-vous ?
— Curieuse !
— Je veux savoir.
— Tout à l’heure.
— Non, tout de suite.
En même temps, elle tenta de soulever mon masque ; j’arrêtai son geste.
— Non, je vous en prie.
— Pourquoi ?
— Parce que…
— Alors, que me voulez-vous ?
— On peut causer un moment, dis-je.
Je faisais le brave, mais je tremblais comme une feuille. Pour ne pas laisser tomber la conversation, je lui avouai que l’inconnu qui lui avait adressé un billet pour le bal de l’Opéra, c’était moi. Elle me demanda, en me tutoyant tout à coup, si je l’invitais à souper.
— Avec plaisir, déclarai-je.
Elle me prit le bras.
— Oh ! comme tu trembles ! dit-elle.
Je ne répondis pas, je ne trouvais plus de parole, mes genoux fléchissaient… Je sentais les pulsations tièdes de sa chair sur le revers de ma main gauche, au-dessous de ses seins ; il me semblait que l’atmosphère était pleine du parfum de ses cheveux, de la chaleur douce qui émanait d’elle et qui m’enveloppait… Puis, je ne savais pas parler aux femmes, ni pourquoi je tremblais auprès d’elles. C’était ma nature ainsi… C’était peut-être aussi que j’aurais eu trop de choses à leur dire, si j’avais su m’expliquer. Tout mon être défaillait de tendresse, de passion torturante et inassouvie.
— Comme tu trembles ! répéta-t-elle… Qu’as-tu donc ?
Je continuais à me taire. Les mots s’étranglaient dans ma gorge, ma voix aurait chevroté de fièvre, si je m’étais fait violence pour prononcer une phrase, une de ces plaisanteries lourdes dont s’amusent les filles. Elle restait surprise, ne comprenant pas.
— Voyons, tu ne dis rien ? Tu es muet ?… C’est drôle. Tu n’es pas comme tout le monde… Tout à l’heure, tu voulais causer, et voilà qu’on ne t’entend plus… Allons, parle, dis quelque chose…
Une tristesse infinie, maintenant, m’envahissait. Mes larmes coulaient, silencieuses et tièdes, sous le masque qui me cachait la face. Cependant, je parvins à balbutier quelques mots, des mots sans suite, qui n’avaient pas de sens. Puis, invinciblement, je retombai dans mon mutisme.
— Non, vrai, tu n’es pas drôle, reprit-elle… Qu’est-ce que tu as ? Un chagrin ? Alors, on ne vient pas ici… Moi, je suis très gosse, je me fiche de tout… Toi aussi, tu dois être très gosse. Dis un peu ton âge pour voir… A t’entendre, on dirait la voix d’un enfant qui a pâti.
Je déclarai mon âge : dix-huit ans. Je confessai aussi que j’arrivais de province et que j’avais encore ma virginité. Elle éclata de rire.
— Non, vrai !… Ah ! c’est tordant ! Un puceau de dix-huit ans, à Paris, au bal de l’Opéra !… Alors, je ne te lâche plus… Un puceau, je ne connais pas ça, je veux voir ça… Alors, c’est pour ça que tu tremblais tantôt ?… Va, n’aie pas peur, mon gosse, on ne te fera pas de mal.
En même temps, elle essaya, de nouveau, de soulever mon masque. Ma résistance l’étonna. Pourquoi ne voulais-je pas découvrir mon visage ? Je ne trouvais que de mauvaises raisons. J’avais envie de fuir maintenant, honteux, troublé, redoutant l’issue de cette aventure, qui ne pouvait se terminer qu’à ma confusion.
— C’est bien, dit-elle, je ne te tourmente plus, laisse-moi la surprise.
Nous nous étions écartés du bal, nous longions un couloir, où le bruit de l’orchestre arrivait jusqu’à nous, intermittent et adouci, comme une harmonie lointaine apportée par la brise.
— Pourquoi donc es-tu malheureux ? me demanda-t-elle avec un accent de compassion soudaine.
— Parce que, répondis-je, je ne serai jamais aimé, parce qu’il est impossible que je le sois.
— Gosse ! fit-elle, quelle idée ! Qu’en sais-tu, si tu ne seras jamais aimé ?… D’abord, tu as de beaux yeux et une voix très douce qui caresse et qui plaît. Tu dois être joli garçon… Mais montre donc ta figure !
Pour la troisième fois, j’arrêtai sa main, au moment où elle touchait mon masque.
— Non, laisse, je t’en prie… Pas encore.
— Quand, alors ?
— Tout à l’heure.
— T’es bizarre ! Je ne te comprends pas… Regarde, tout le monde maintenant a levé son loup.
Elle crut que je voulais l’intriguer, par caprice d’original. Sa familiarité de bonne fille m’avait donné un peu d’assurance. Nous continuâmes à causer. Je ne sais ce que je lui dis ni comment elle en vint elle-même aux confidences :
— Va, mon petit, chacun porte sa croix, comme on dit. Moi non plus, je ne suis pas heureuse, malgré qu’on me voie rire, danser et chahuter, tout le temps… J’en ai assez de cette vie ! Je me sens rompue. C’est crevant, la noce ! Vadrouiller, par force, quand on est éreintée, lever des types dégoûtants, des crevés, des vicieux, des poivrots, des nègres… oui, des nègres… Ce sont encore les plus convenables… Ah ! non, ce n’est pas gai ! L’autre nuit, je me suis trouvée mal ; on m’a mise dans un fiacre, évanouie… L’hiver dernier, j’ai passé deux mois à l’hôpital. Tu sais, je te dis ça à toi, rien qu’à toi, ne va pas le répéter… Souvent j’ai du regret, quand je pense à mon pays, à ceux que j’ai quittés… C’est Paris qui m’a perdue… Quelquefois, je rêve d’aller vivre ailleurs, bien loin, en plein air, à la campagne. Il me faudrait ça pour me remettre… Oui, bien loin d’ici, avec quelqu’un que j’aimerais bien… Mais ça, c’est des rêves ! Les belles choses qu’on espère n’arrivent jamais… Toi, je crois, tu me plairais. Tu n’es pas comme les autres, tu ne me parles pas comme tout le monde… Peut-être qu’on serait heureux ensemble.
Elle se rapprochait de moi, et je sentais son haleine tiède qui se mêlait au parfum de ses cheveux… Qu’elle était jolie et charmante, à cette heure, avec ses yeux fins, un peu humides et qui semblaient fondre de tendresse, et ses joues colorées d’un rose vif !… Le sang battait dans mes veines ; mes lèvres, une fois, l’effleurèrent presque. Et désespérément je songeais au bonheur impossible de la posséder, toute, de respirer dans son atmosphère, d’habiter continuellement en elle. Je l’aurais saisie, emportée là-bas, loin de tout, dans un îlot de félicité ignoré du destin.
— Oui, être heureuse, reprit-elle, vivre tranquille, si on pouvait !… Tu ne m’as même pas dit ton nom, comment t’appelles-tu ?
— René, répondis-je.
— C’est joli, ce nom-là.
— Le tien aussi, Bijoute.
— Moi, c’est un surnom. Les étudiants m’appellent comme ça… Toi, où m’as-tu connue ?
— Au quartier Latin.
— Tu savais donc mon adresse, puisque tu m’as envoyé ce billet ?
— Oui.
— Comment ça ?
— Je t’avais suivie, un soir, jusqu’à ta porte.
— Et pourquoi ne m’as-tu jamais parlé ?
— Parce que je n’osais pas.
— Tu n’osais pas ?
— Non.
— Mais quelle idée de m’avoir fait venir ici pour me causer ! Vrai, c’est étrange, je ne saisis pas.
Je restai interdit. Nous étions tout à fait isolés de la foule.
En même temps, elle se rapprochait de moi, et je sentais de nouveau les pulsations de sa chair, un parfum tiède qui me montait au cerveau et me grisait comme un encens de volupté… Je ne sais quelle ivresse s’empara tout à coup de moi, quel désir spontané, irréfléchi, comme une impulsion irrésistible, le débordement de toute ma tendresse comprimée… je la saisis, nos corps s’élancèrent l’un vers l’autre, nos lèvres se joignirent, elle murmura dans un désir pâmé… « Oh ! chéri ! »… Et, au même instant, avant que je pusse lever la main pour le retenir, mon masque tomba, ma disgrâce lui apparut, elle recula, toute blanche, glacée soudain.
— Oh ! lui ! fit-elle d’une voix basse comme gelée par l’épouvante.
Anéanti, éperdu, je ne trouvai pas une parole, l’esprit noyé, emporté, submergé dans un flot de détresse. Le tumulte de l’orchestre m’arrivait comme le bruit monotone et sans fin de l’océan désert… Elle s’était enfuie… Lentement, je revins à moi, je remis mon masque, je gagnai la sortie à travers le tournoiement du bal… J’allai au hasard, par les rues vides, je ne savais où, là-bas, dans le silence de la nuit.
Le lendemain, je quittai mon hôtel, je louai une chambre ailleurs, dans un quartier plus solitaire.
Seul, voilà le mot qui résume toute ma jeunesse. A l’aube du cœur qui s’éveille, j’ai passé ces années qui, pour tant d’autres, sont les plus belles de la vie, à poursuivre l’amour comme un fantôme insaisissable. Je ne me résignais pas à vivre sans aimer, sans être aimé, car, pour moi, il n’était pas de pire misère, de plus grand châtiment… N’avais-je pas aussi droit au bonheur, comme tout ce qui respire ?
J’ai vagabondé, des jours et des nuits, à travers Paris, rêvant de trouver quelque être malheureux comme moi, une femme méprisée elle-même, quelque désespérée, quelque naufragée de la vie, n’ayant plus rien à attendre du destin ni des hommes. Celle-là, je l’aurais aimée, consolée, et, de l’union de nos deux misères, il serait sorti de la joie !… Il devait en exister dans ce grand Paris, refuge de toutes les détresses.
Oui, je caressais ce rêve, je souhaitais que le hasard fît cette rencontre ; je ne faisais plus attention aux femmes belles, à toutes celles en qui je pressentais une joie de vivre, une espérance. Celles-là n’étaient pas pour moi. Je ne m’arrêtais qu’aux laides, aux disgraciées, aux visages chargés d’anxiété, à celles qui n’avaient jamais dû être aimées.
Hélas ! ces dernières aussi, les humbles, les sacrifiées, les infirmes même me repoussaient. Aucune misère ne voulait s’accoupler à la mienne. J’effarouchais les femmes. La plupart me fuyaient ; les plus hardies m’insultaient au passage ou éclataient de rire. Moi-même, je n’osais plus les approcher, timide, paralysé de gaucherie, conscient de mon état. A leur vue seule, un tremblement m’agitait, et mes yeux qui voulaient implorer, s’emplissaient d’angoisse.
J’ai vécu ainsi des années, seul, toujours seul, dévoré d’une passion grandissante, sans qu’une femme ait consenti à calmer ma souffrance d’un regard de pitié.
Parfois, des révoltes me soulevaient… Sur la façade d’une église, en face de l’hôtel où je logeais, un Christ s’affaissait sur sa croix, comme accablé du malheur universel.
Et moi, je considérais ce crucifié d’un œil défiant, soupçonneux et jaloux… Parce qu’il avait été aimé aussi, celui-là ! Parce que consolateur de toutes les misères, il n’avait oublié que la mienne, la pire, la plus incurable, la plus injuste, la laideur ! Parce qu’enfin, il avait été beau, de cette beauté chlorotique et fade qui faisait choir des vierges à ses pieds et confondit depuis dans la prière des siècles d’adoratrices !
Je faisais le désert autour de moi. Dans les jardins publics, les enfants, les chéris aux yeux d’ange, se sauvaient à mon approche… Qu’avais-je fait à ces enfants ? Pourquoi cette universelle et muette hostilité, à mon égard ?… Je marchais vite, dans la hâte d’échapper aux regards humains, aux maisons, aux pierres, à toute la cruauté instinctive des êtres et des choses.
Un après-midi de juillet, je sortis, résolu, cette fois, à vaincre mon appréhension, à tenter une aventure. J’avais mis un bandage, une sorte de masque qui me cachait la plus grande partie de la face. J’allai, d’abord, devant moi, comme d’habitude, sans but précis, au hasard, seul. Un soleil de plomb incendiait le pavé, me coulait sur la nuque, me mettait un brasier dans les veines.
C’était un dimanche et l’heure de la promenade. Paris avait la lourdeur des jours de fête, le recueillement des villes de province. Le long des boulevards, des bourgeois allaient et venaient, d’une allure molle et quiète. Tous semblaient heureux d’être, trouver un surcroît de béatitude dans l’universelle torpeur de ce jour d’été. Une même banalité sculptait tous ces visages d’une ressemblance professionnelle. Dans un grand square, que je traversai, des couples s’enlaçaient, le long des allées, dont les arbres mêmes se rapprochaient comme des êtres qui auraient voulu se parler ; toute la nature s’emplissait d’un confus murmure. Une odeur troublante traînait dans l’air, s’attachait à moi, m’assaillait par bouffées tièdes que j’aspirais avec ivresse.
Je marchais pour apaiser, par la lassitude physique, mon rêve d’amour, qui s’exaspérait jusqu’à la torture.
La nuit vint, une nuit sans lune, ardente et calme. Je me trouvais au faubourg du Temple, un quartier que j’ignorais. Il m’était agréable d’errer dans des quartiers qui m’étaient inconnus, de voir d’autres figures, d’autres maisons, une physionomie nouvelle des choses, de respirer une atmosphère qui n’était pas encore imprégnée de ma souffrance. J’avais alors comme la sensation d’un recommencement de vie, d’une renaissance morale. Il me semblait que les gens autour de moi étaient meilleurs, parce qu’ils ne m’avaient encore pas fait de mal et que je n’avais à leur égard aucune raison de méfiance.
Je m’attardai là jusqu’à minuit, en flânant. Il y avait encore, çà et là, au coin des rues et le long du boulevard, quelques ombres quêteuses qui surgissaient tout à coup des ténèbres et rampaient prudemment vers le passant solitaire. L’une d’elles attira ma curiosité par ses allures étranges. Elle ne ressemblait pas aux autres, elle n’avait pas l’air d’une fille. Visiblement, elle manquait d’assurance, elle n’osait pas ou ne savait pas. Pourtant, c’était la plus âgée : une femme de trente-cinq à quarante ans… oui, au moins… Et rien, dans ses manières, sa tenue, son visage grave et pâle, de cette pâleur qui reflète les crises violentes de l’âme, la tension suprême de l’énergie, n’indiquait la professionnelle cynique, rompue aux expédients de la prostitution. Ses regards erraient, chargés d’angoisse et de détresse ; par instants, elle tressaillait d’un frisson, sous la lueur tremblotante d’un réverbère.
Je fus plus d’un quart d’heure à l’observer, à suivre ses mouvements, ses allées et venues inquiètes et timorées. La nuit se faisait plus pesante ; il commençait à pleuvoir un peu. Quelques silhouettes hâtives défilaient, comme pourchassées d’une crainte, tandis qu’aux alentours, détonnaient des voix grasses d’ivrognes.
Maintenant, elle s’était arrêtée, elle ne bougeait plus. Son ombre tragique envahissait le trottoir… Peut-être aussi attendait-elle quelqu’un qui tardait à venir… Non, pourtant, car elle me regardait avec une insistance fascinante, comme pour m’attirer. J’étais éloigné de quelques pas et presque effacé dans l’encoignure d’une porte cochère… Oui, c’était bien moi qu’elle regardait, moi l’horreur, l’épouvante, le banni !… Même je la vis sourire, mais de quel sourire !… Depuis la disparition de ma vieille Noémie — il y avait douze ans de cela ! — aucune femme, aucun visage ne m’avait souri !
Un désir, une émotion, une espérance s’éveillèrent en moi. J’abordai cette femme ; elle ne me repoussa pas ; même, elle n’eut aucun geste d’effroi ou de dégoût, lorsque je fus près d’elle… Je dis simplement :
— Bonsoir.
Elle répondit :
— Bonsoir, monsieur.
— Attendez-vous quelqu’un ?
— Non, monsieur.
Sa voix chevrotait. Il y eut, entre nous, un silence chargé de gêne. L’émotion m’étranglait… Ce fut elle qui reprit :
— J’allais rentrer chez moi… Il doit être très tard… Je n’ai pas l’habitude d’être dehors, le soir… C’est la première fois, monsieur…
Elle n’acheva pas sa phrase. Sa pâleur était extraordinaire. Je demandai :
— Habitez-vous loin d’ici ?
— Près de la Bastille, monsieur, répondit-elle… Non, ce n’est pas loin ; il faut un quart d’heure à pied, d’où nous sommes.
Je baissai la voix pour dire :
— Voulez-vous que je vous accompagne ?
Un court colloque s’engagea entre nous. De la tête, elle fit un signe d’assentiment. Je lui avais offert le bras ; nous avancions, sans nous voir, tant la nuit était dense ; et nous causions, maintenant, d’autre chose… Je ne me souviens plus de quoi. Je me rappelle seulement qu’elle tremblait au point que je craignais de la voir défaillir. Elle me disait vous, elle continuait à m’appeler monsieur. Moi aussi, bien qu’elle eût accepté, je ne pouvais m’empêcher de lui parler avec respect. Il m’eût été impossible de la tutoyer, comme une fille. C’était plus fort que moi, je subissais une sorte d’ascendant étrange, que je ne m’expliquais pas… Je sentis tout à coup qu’elle faiblissait.
— Ce n’est rien, dit-elle, j’irai bien jusqu’au bout… Nous sommes presque arrivés.
Mais, de nouveau, elle chancela. Je l’interrogeai encore.
— C’est sans doute la fatigue, murmura-t-elle… Puis, j’ai faim !
— Voulez-vous que nous entrions là ? dis-je en indiquant un café qui flambait encore au coin du boulevard.
C’était un restaurant de nuit. De la porte entr’ouverte, s’exhalait une atmosphère chaude, mêlée à d’âpres odeurs de cuisine. On entendait le son d’un piano, des bruits de vaisselle, des voix criardes de filles, des rires incongrus.
— Non, pas là, dit-elle, il y a trop de monde… J’aurais honte.
— C’est bien, attendez-moi ici, je reviens tout de suite.
Je rapportai quelque nourriture.
— Tenez, n’ayez pas de honte avec moi, mangez… Allez, je connais la vie, je comprends… oui, je comprends.
Elle eut vers moi un long regard de reconnaissance, et ses lèvres essayèrent un sourire… Oh ! vraiment, je n’avais plus de désir, je ne songeais plus à l’amour. Ce sourire exprimait trop de misère, trop de déchéance et de désespoir !… Ou plutôt si, c’était bien de l’amour que j’éprouvais, en cet instant, mais un amour tout autre, dégagé de toute impulsion sensuelle, un sentiment de profonde pitié qui me fendait l’âme, un besoin de consoler, de soulager, de crier justice, une révolte contre la société entière, quelque chose enfin comme un amour éperdu de l’humanité.
— Alors, c’est vrai, vous ne me méprisez pas ? dit-elle.
— Non, je ne vous méprise pas, répondis-je, je vous respecte, je m’incline devant vous, comme devant la souffrance humaine… C’est la société que je méprise, l’état social où de telles choses sont possibles, où une honnête femme peut être réduite à votre sort.
Nous nous étions assis sur un banc, l’un près de l’autre. Elle mangeait, elle sanglotait, elle bégayait :
— C’est la première fois, monsieur, je vous le jure, c’est la première fois !… J’aurais préféré mourir que d’en venir là, mais je ne suis pas seule, je n’ai pas le droit de mourir… Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas savoir… Je ne puis pas vous dire…
— Je vous crois, je vous crois, répétai-je… Je vois bien que vous êtes une honnête femme ; et une honnête femme, dans votre malheur, est plus que respectable, elle devient sacrée, elle s’élève au rang des martyres et des saintes devant qui on se prosterne, en se sentant coupable.
— Oh ! que me dites-vous là ! murmura-t-elle… Comme vous me parlez ! Qui êtes-vous donc ?
— Rien, répondis-je, je suis simplement un homme qui a beaucoup souffert.
— Il n’y a donc que ceux-là, dit-elle, qui comprennent et qui excusent !
Je l’interrogeai. Alors, d’une voix déchirante, elle me conta son histoire :
— Monsieur, je ne vous mens pas : L’an passé, à pareille époque, j’avais dix mille francs à moi, dix mille francs bien gagnés, amassés sou par sou, au jour le jour, en douze ans de travail, par des prodiges d’économie… Et j’étais caissière dans une maison de commerce… Avec cet argent et cette situation, nous pouvions vivre heureuses, ma fille et moi, notre avenir semblait assuré. Et il avait fallu du mérite, je vous le jure, pour en arriver là, car mon mari m’avait laissée veuve à vingt-cinq ans, avec des dettes et un enfant en bas âge sur les bras… Allez, j’en ai eu, du courage, de l’énergie ; je ne méritais pas ce qui m’est arrivé… C’est mon trop de confiance qui m’a perdue. J’ai été dépouillée de ma petite fortune par une abominable escroquerie… Ah ! je ne puis y penser sans que le sang me tourne… C’est mon patron qui m’a volée, en me persuadant que mon argent ne me rapportait pas assez, qu’il fallait le placer ailleurs, dans une affaire sûre, qui donnerait le dix pour cent… Que voulez-vous ? quand on a confiance en quelqu’un, quand on est ignorante… Enfin, j’ai tout donné et j’ai tout perdu, non seulement mon avoir, mais ma situation, car mon patron, après avoir fait ce beau coup et d’autres dupes, abandonna sa maison et passa la frontière… On ne l’a plus revu… Et, du jour au lendemain, je me trouvai ruinée, sans place et malade, une maladie qui m’a tenue trois mois dans mon lit… Tous les malheurs en même temps ! Les voisins, les connaissances, à la fin, se sont lassés de nous secourir ; ça se comprend. Et la misère est venue ; le Mont-de-Piété nous a tout pris, le propriétaire nous a donné congé… Et, maintenant, je suis là, oui, je suis là !… Mon Dieu ! mon Dieu !
Sa voix navrante d’agonie s’étouffa dans un sanglot. Deux coups résonnèrent longuement à une horloge voisine. Autour de nous, toutes les maisons éteintes, les magasins boulonnés avaient des apparences de forteresses, inviolables abris de l’égoïsme bourgeois, bien confortables aussi, protégés par toute la formidable organisation des forces sociales, sourds aux cris de détresse qui montaient des ténèbres.
— Que faites-vous, dit-elle… Je vous en prie, relevez-vous.
J’étais tombé à ses pieds.
— Je me prosterne devant vous, répétai-je, parce que vous êtes la souffrance humaine, et parce que je me sens coupable. Une femme mourant de faim, à l’époque où nous sommes et quand la terre est assez fertile pour nourrir une humanité dix fois plus nombreuse, c’est un crime social, dont chacun a sa part de responsabilité. Mais quand le poids devient trop lourd, le support s’effondre ; le jour n’est pas loin où notre vieux monde croulera sous le fardeau de ses iniquités.
— Et vous ? demanda-t-elle… Vous me disiez que, vous aussi, vous aviez souffert.
— Il est vrai, répondis-je, je suis un bien grand malheureux, mais ne parlons pas de moi. Toute ma misère s’efface devant la vôtre.
— Non, dites, je veux savoir.
— Eh bien, voyez !
Et j’enlevai mon masque.
Elle eut comme une hésitation ; puis, d’une voix très douce :
— Oui je comprends, vous avez dû bien souffrir… Voulez-vous me permettre de vous embrasser ?
— Je ne vous cause donc point de répugnance ? balbutiai-je en tremblant.
— Non, dit-elle.
Et elle m’embrassa… Elle m’embrassa plusieurs fois. Ses lèvres blêmes buvaient mes larmes, et je sentais, sur ma face, sa maigre haleine, émouvante comme l’ivresse du malheur.
— J’ai peut-être vingt ans de plus que vous, ajouta-t-elle, vous pourriez être mon fils, je puis bien vous donner cette marque d’amitié.
C’est ainsi que je reçus le premier baiser d’une femme.
Je voulus l’accompagner jusqu’à sa porte. Avant de la quitter, je la priai d’accepter ma bourse, qui contenait une trentaine de francs, en l’assurant que cela ne me privait pas… Alors, elle me prit la main, la pressa sur ses lèvres, en la mouillant de larmes.
Je n’ai plus revu cette femme. Qu’est-elle devenue ? Je ne sais, mais je lui garde, au fond de l’âme, une reconnaissance éternelle, car c’est par son baiser que je me sentis, ce jour-là, relié à l’humanité.
A quelques mois de là, une aventure plus étrange traversa ma vie, comme l’éclair qui déchire les ténèbres sans les dissiper, et dont on reste, un instant, ébloui.
C’était un soir orageux de mars. Une rafale de pluie m’avait rejeté dans un café presque désert, aux environs du Luxembourg. Il n’y avait là, au fond de la salle, qu’une jeune femme, qui, distraitement, parcourait des journaux illustrés… Elle avait une beauté douce de blonde, où s’embrumaient des yeux de songe et de mystère, des yeux qui semblaient abriter un secret… De temps à autre, elle dressait la tête, elle me regardait…
Je n’avais pas de masque, et son regard, pourtant, n’exprimait ni trouble, ni répugnance, ni surprise ; il s’obstinait sur moi, non pas avec cette curiosité malsaine que peut exciter le spectacle d’une anomalie, mais avec bonté, avec tristesse… Ce n’était pas une foudroyée, comme celle que j’avais rencontrée, l’autre nuit, sur le boulevard du Temple. Elle était élégamment mise, et je la vis changer une pièce d’or… Que venait-elle faire, seule, dans ce café ? Un rendez-vous peut-être ?… Non, visiblement, elle n’attendait personne. Près d’une demi-heure s’écoula, sans qu’elle manifestât une inquiétude, une impatience.
Elle fut, un moment, reprise par sa lecture, puis, de nouveau, elle leva le front, et son regard recommença à me fixer, à me parler : « Viens, semblait-il me dire, viens, c’est assez, je pardonne à ta laideur et à ta misère… Tu as déjà trop souffert par moi… Viens, je suis la beauté touchée par le remords et fléchie jusqu’à la miséricorde ! Viens, ton épreuve est finie, tu vas connaître enfin la joie de vivre !… »
Moi, tout tremblant d’émotion, j’écoutais cette voix magnanime, qui me venait de ce regard, comme du destin repentant. Et je me contenais pour ne pas m’écrier : « Non, n’implore pas de pardon, car tu es la beauté, et rien n’est plus grand que d’avoir souffert par toi ! »
Soudain, elle se leva, elle sortit. Je la suivis et la rejoignis dans la rue. Il pleuvait à verse. Elle s’était réfugiée dans une embrasure, hésitant à traverser la chaussée. Je m’offris à l’abriter sous mon parapluie et à l’accompagner jusque chez elle.
— Oh ! monsieur, vous êtes bien aimable, dit-elle, mais j’habite loin d’ici, aux Épinettes, et je craindrais de vous déranger…
— Nullement, répondis-je, car c’est aussi mon chemin, et je me disposais à prendre une voiture… Oserais-je vous inviter à y prendre place ?
Elle ne refusa pas. J’arrêtai un fiacre qui passait. Elle donna son adresse, et nous partîmes, au trot lent d’un cheval épuisé… Tout cela, cette rencontre, cette jolie fille acceptant sans façon ma compagnie, ce commencement d’aventure, banale pour tout autre, mais inouïe pour moi, avait été si simple, si rapide, que je m’imaginais vivre dans un songe merveilleux… N’avait-elle donc pas vu que j’étais défiguré, horrible, ou était-ce à cause de cela même, par un sentiment de pitié surhumaine, qu’elle m’accueillait ?… Je balbutiai dans un grand trouble :
— Je ne puis vous dire combien vous me touchez… Il me semble que je fais un rêve, le rêve d’un damné qui verrait s’entr’ouvrir les portes du ciel… Et j’ai peur de me réveiller, j’ai peur de revenir tout à coup à la réalité affreuse de mon existence.
— Pourquoi me dites-vous cela ? demanda-t-elle.
— Vous le devinez bien, puisque vous êtes femme ! Ne me contraignez pas à des aveux trop douloureux, à replonger mes regards dans mon enfer… Mais avec quels yeux m’avez-vous vu, avec les yeux célestes de la charité ? de cette charité que l’orgueil ne refuse qu’autant qu’il n’a pas été humilié par le malheur… Hélas ! ce n’est pas mon cas !
— Détrompez-vous, me répondit-elle, et sachez que je n’ai jamais prêté attention au physique d’un homme. Qu’importe, s’il n’a pas l’âme de son visage…
— Beaucoup de femmes disent cela, répliquai-je, mais il en est peu qui le pensent sincèrement, et il n’en est pas qui me l’ait prouvé… Seriez-vous cette exception sublime ?… Oh ! ce serait trop beau, trop généreux ! Est-il possible que je ne rêve pas ?
— Mais non, vous ne rêvez pas, dit-elle. Regardez-moi, je suis bien là, à côté de vous, et nous sommes bien tous deux en ce monde… Et nous pourrons peut-être devenir bons amis, mais il me faut d’abord vous connaître, et je ne vous connais pas, je ne sais qui vous êtes. Voici à peine cinq minutes que nous causons.
— Que ne puis-je alors vous dévoiler mon âme, au moment où je vous parle ! Affreuse est l’injustice qui fait du visage un masque trompeur, un mensonge dont nous sommes presque toujours dupes. Pourquoi le regard ne peut-il pénétrer jusqu’au fond des consciences humaines ? Pourquoi ne peut-on faire jaillir la lumière qui, soudainement, éclairerait une belle âme, comme l’aurore révèle, en quelques instants, un beau paysage ?
— Voulez-vous dire que je serais éblouie ? dit-elle en souriant. Je crois plutôt que nous aurions souvent de désagréables surprises.
— Mais il nous suffirait, pour en être consolés, d’apercevoir, quelque jour, une âme comme la vôtre.
— Vous me faites trop de compliments. Attendez aussi de me mieux connaître.
— Je vous connais assez déjà pour vous placer très haut, très haut, au-dessus de toutes les femmes.
— Détrompez-vous, dit-elle avec calme, je suis une femme comme les autres.
— Aucune, cependant, jusqu’à ce jour, n’avait daigné pencher son souverain sourire de douceur et de bonté sur mon extrême disgrâce ; aucune, avant vous, ne m’avait permis l’espérance, et aucune pourtant ne m’avait paru plus belle ni plus digne d’un grand amour… Je viens de prononcer ce mot… Excusez-moi… Je sais bien que je ne puis prétendre… Ce serait fou de ma part… Cela ne peut pas être…
— Mais si, murmura-t-elle, cela peut être.
— Votre charité va-t-elle jusqu’à vouloir me souffler au cœur un espoir insensé ?
— Non, ce que j’ai dit, je le pense… Je voudrais seulement vous poser une question.
— Parlez.
— Me répondrez-vous avec franchise ?
— Je vous le jure.
— Je vous disais tout à l’heure que le physique d’un homme m’était indifférent ; en diriez-vous autant d’une femme, et seriez-vous capable de l’aimer pour sa seule beauté morale ?
— La question, répondis-je, ne saurait vous intéresser beaucoup, puisque vous êtes belle et charmante… Elle ne m’intéresse pas non plus, car aurais-je le pouvoir et le droit de choisir, moi qui ne fus jamais aimé et qui ne puis l’être ?… Ce que je sens, ce que je puis vous dire, c’est que mon cœur vouera un culte éternel à la femme, quelle qu’elle soit, qui me fera l’aumône d’un sourire, qui me rendra la joie de vivre… Avant de vous avoir rencontrée, j’osais à peine y songer !… Mais, comment se fait-il que votre indifférence de la beauté et de la laideur physiques soit vraie, absolue, au point que mon visage, qui n’a plus même une apparence humaine, ne vous inspire aucune aversion, quand tout le monde se détourne de moi ? Cela n’est pas naturel, cela est extraordinaire ; j’ai peine à y croire. Encore, si vous étiez disgraciée, dédaignée, mais vous êtes jeune, adorable. Que de beaux jeunes gens ont dû vous offrir leur amour, se promettre auprès de vous l’éternité du bonheur ! Sans doute avez-vous vécu entourée de flatteries, d’hommages, de tendresse…
En ce moment, je vis de grosses larmes embrumer ses prunelles.
— Vous pleurez ?… Pourquoi pleurez-vous ? Qu’avez-vous ? questionnai-je tout surpris.
— Rien, dit-elle… Parlez-moi de vous… Sans doute n’avez-vous pas toujours été ainsi… Est-ce un accident, qui vous a défiguré ? Racontez-moi votre histoire.
— Permettez-moi plutôt, répondis-je, de vous raconter une autre histoire, très courte, qui vous dispensera d’entendre la mienne.
— Je vous écoute.
— C’est un conte arabe… C’est un prophète musulman qui se rend, à cheval, à La Mecque, la Ville Sainte… En traversant le désert, il entend des plaintes, des gémissements, et il voit, non loin de lui, un malheureux, assis sur le sable brûlant, et qui l’implore. — Qui es-tu et comment es-tu là ? lui demande le prophète. — Hélas ! répond le misérable, moi aussi j’allais à La Mecque, mais je n’avais pas de cheval, car je suis pauvre, et mes forces m’ont trahi, en route ; j’ai succombé sous le poids du jour et de la chaleur ! — S’il en est ainsi, dit le prophète, lève-toi et monte en croupe derrière moi ; nous atteindrons ensemble à la Ville Sainte. — Hélas ! soupire le misérable, j’ai les jambes malades, je n’ai plus même la force de me dresser ; il faut que tu m’aides. » Alors, le prophète mit pied à terre et, saisissant l’infirme à bras-le-corps, il le plaça lui-même sur son coursier. Et voilà qu’aussitôt, le misérable frappe la bête, s’élance au galop et distance le prophète. — « Arrête, lui crie celui-ci… Au nom de Dieu, arrête ! Je ne veux pas te reprendre mon cheval, je n’ai qu’un mot à te dire… Écoute ! de grâce, écoute ! » Et l’imposteur s’étant enfin arrêté, le prophète, d’aussi loin que sa voix pouvait porter dans le désert, lui cria : « Quand tu seras à La Mecque, ne raconte à personne ce qui m’est arrivé, car tu dégoûterais de la générosité ! » — Ce conte, repris-je, n’a qu’un rapport lointain avec mon histoire, mais il contient un bel enseignement et qui me fait penser : il vaut mieux aussi que je ne raconte à personne ce qui m’est arrivé.
— Il est vrai, dit-elle, on est parfois puni pour avoir fait le bien.
Nous fûmes, un moment, silencieux. Notre voiture gravissait péniblement la rue Fontaine, éclairée, d’instant à autre, par les coups de lumière des réverbères ; et, soudain, comme dans un enchantement, m’apparaissait ce fin profil de blonde, dont je craignais de trop m’approcher et qui me soulevait toute l’âme d’émotion, de désir éperdu et de reconnaissance.
— Oui, reprit-elle, vous avez dû beaucoup souffrir et je vous plains… Mais il est deux sortes de souffrances : celles qu’on voit et celles qu’on ne voit pas, qu’on n’avoue pas… Ce ne sont pas les moins cruelles !
Elle avait dit cela d’un accent si émouvant que j’en demeurai étonné. A quoi faisait-elle allusion ? A quelle obsession secrète, cette phrase répondait-elle ? Elle, si jeune, si jolie, pouvait-elle avoir tant souffert, nourrir et cacher un chagrin si profond ?
Comme pour détourner ma pensée d’une inquiétude, elle me demanda mon nom ; je le lui dis. Elle me donna le sien : Marie.
— Avez-vous de la famille ? questionnai-je.
— Non, je vis seule et je suis libre.
— Et que faites-vous ?
— Cela dépend des jours.
Je me tus, redoutant de paraître indiscret et de l’indisposer à mon égard, en insistant davantage. Aimer une femme et lui avouer sa passion — et je l’aimais déjà et lui en avais presque fait l’aveu — c’est accepter vis-à-vis d’elle un état moral d’infériorité, c’est se condamner à subir son prestige et son ascendant. Et je trouvais naturel qu’elle me cachât sa vie, je respectais le mystère qui flottait autour d’elle, le secret des larmes qu’elle avait répandues. A tout autre qu’à moi, certaines de ses paroles eussent semblé énigmatiques, mais quelle expérience des femmes et de l’amour pouvais-je avoir acquise dans l’implacable solitude où je m’étais consumé ? Je ne cherchais pas, d’ailleurs, en ce moment, à exercer mon esprit d’observation, à m’expliquer cette aventure ; j’étais grisé par l’espérance, ébloui par la perspective soudaine d’une félicité inattendue, que je tremblais de ne jamais atteindre.
Notre fiacre s’arrêta ; nous étions arrivés.
— Me sera-t-il permis de vous revoir ? demandai-je avec humilité.
— Mais oui, quand vous le désirerez, répondit-elle.
— Alors, demain.
— Je veux bien.
— Où ?
— Chez vous, à cinq heures de l’après-midi.
J’avais saisi une de ses mains, pour y poser mes lèvres, mais elle la retira, en répétant : A demain !… Et elle disparut, me laissant seul dans la voiture.
Il me semblait que je n’étais plus dans cette vie… Je fus un moment sans oser bouger, dans la crainte de me réveiller, de faite s’évanouir une hallucination radieuse, de revenir à la réalité mauvaise… Mais non, je ne dormais pas, tout cela était vrai : cette femme jeune et belle, cette espérance d’amour, ce rayon d’en haut tombé tout à coup, miraculeusement, dans mon abîme !… Lentement, je reprenais possession de moi-même, et ses derniers mots : A demain, me soulevaient au fond de l’âme une félicité si grande que j’en défaillais presque… Mon fiacre roulait dans la nuit, secoué par l’irrégularité du pavé, précipitant la monotone trépidation des vitres, dont le vacarme continu noyait ma rêverie enchanteresse… Il devait être tard. Dans les rues désertes, agrandies par le vide, les maisons éteintes alignaient indéfiniment l’uniforme sévérité de leurs murailles nues.
J’arrêtai ma voiture sur le pont des Saints-Pères, désireux de continuer ma route à pied, pris d’un besoin de marcher, d’aspirer le grand air. Il ne pleuvait plus. La nuit était douce et sereine. Jamais son silence ne m’avait impressionné à ce point. Les ombres mêmes s’imprégnaient de tendresse et de mystère. Il me semblait que je m’acheminais vers la réalisation des grands songes ; je sentais des choses extraordinaires, délicieusement étranges, en moi, en la paix de la nature, le murmure du vent. Le souffle du soir que j’aspirais avec volupté me coulait dans les veines une ivresse nouvelle, inéprouvée. Et tout prenait à mes yeux un autre aspect, le sommeil frémissant de Paris, l’incendie des lumières lointaines dont la réverbération traçait sur le courant du fleuve des traînées resplendissantes, comme des chevelures de comète, toute la vie nocturne de la grande ville reposant dans la splendeur d’une féerie mystérieuse et profonde.
Par instants, je doutais encore. Cette aventure était trop surprenante, trop incroyable, incompréhensible !… Comment, par quel miracle, dans quelle pensée, cette jolie femme s’était-elle penchée sur ma disgrâce ? Elle, la jeunesse et l’amour, elle qui n’avait qu’à choisir, pouvait-elle vouloir associer sa beauté à ma difformité ?… Non, tout se voyait, tout était possible, mais pas cela !
Pourtant, elle m’avait regardé, elle m’avait souri, elle m’avait presque permis l’espérance, et nous avions rendez-vous demain, chez moi ! Quel sentiment la faisait agir ? Quelle prodigieuse énigme était là ?… Ah ! je me hâtais peut-être trop d’être heureux ! Il y avait des miracles qui ne s’accomplissaient pas.
J’avançais lentement, le long des quais, agité, plein de trouble, assailli de mille pensées contraires, voulant croire et ne le pouvant pas… Maintenant, certaines paroles qu’elle avait prononcées, certaines réflexions, certains silences auxquels je n’avais pas arrêté sur l’instant mon attention, me revenaient à la mémoire, bizarres, inexplicables… Je me rappelai aussi qu’elle avait pleuré. Pourquoi et sur qui ? Sur moi, sur elle-même, sur ces souffrances invisibles, inavouées, peut-être inavouables, auxquelles elle avait fait allusion ?…
Je ne savais d’elle encore que son prénom — et sa douceur languissante de blonde, où s’illuminaient parfois des yeux de fièvre et de passion, vite éteints comme par un découragement… Enfin, qu’était-elle ? Une fille ? Elle n’en avait ni les allures, ni les gestes, ni la voix, ni le langage.
Paris est peuplé d’irréguliers, hommes et femmes, dont la vie serait inconcevable ailleurs, qui n’appartiennent à aucun monde, aucune classe, aucune profession, des êtres privés de boussole sociale, des âmes désorientées que l’ennui, la lassitude, le désœuvrement, la névrose, une sorte de perversité sensuelle et morale, résultant de tout cela, poussent sans cesse à la recherche des sensations nouvelles, du frisson inconnu. Sans force, sans défense contre les impulsions du moment, les extravagances d’une imagination fantasque et déréglée, elles sont capables de toutes les excentricités, de toutes les folies, de toutes les aberrations… Était-elle une de ces irrégulières-là ? Non, j’avais l’intuition qu’elle était autre chose. Quoi ? Je ne le sus jamais.
Le lendemain, je l’attendis vainement… Je me rendis à son adresse, j’interrogeai la concierge, d’autres gens ; je donnai son prénom, son signalement… Nul ne la connaissait, nul ne l’avait jamais vue. Je revins plusieurs fois, les jours suivants ; je passai des après-midi et des journées entières dans le quartier, avec l’espoir de l’y rencontrer. Cet espoir fut toujours déçu.
Peut-être cela fut-il préférable ! peut-être ai-je évité une déception plus grande ; peut-être même eus-je le tort de réfléchir trop longtemps à cette étrange aventure et d’en découvrir l’explication la plus plausible. Mais si vous ne la devinez point, pourquoi la dirais-je ? Moi-même, je l’ai chassée de mon esprit. J’ai voulu garder à cette femme une gratitude éternelle, j’ai voulu qu’elle demeurât, dans le souvenir de ma douloureuse jeunesse, l’apparition immaculée, l’idéal à peine entrevu, mais inoubliable, de la bonté toute pure, de la beauté unie à la miséricorde.
Jusqu’alors j’avais vécu dans la gêne, ne recevant que de faibles subsides de ma famille. L’on me faisait entendre qu’un garçon de mon âge devait commencer à savoir se débrouiller, à gagner sa vie, car je ne pouvais rester éternellement à charge aux miens. J’étais licencié en droit ; les professions ne manquaient pas ; je n’avais que l’embarras du choix ; et mes parents, d’ailleurs, n’étaient pas de ceux qui contrarient la vocation de leurs enfants ; ils avaient l’esprit large, mes parents ! ils me laissaient libre, se bornant à me donner de bons conseils… Pourquoi, par exemple, n’essayais-je pas d’entrer, en qualité de clerc, dans une étude d’avoué ou de notaire ?… Non, je n’essayais pas. Je n’avais pas une figure à me présenter quelque part… Je me suis souvent demandé ce que je serais devenu sans fortune. Quelle carrière m’eût été ouverte ? La société, la bienfaisance publique n’avait pas prévu mon cas. Il y avait des hôpitaux pour les malades, des asiles pour les aliénés, des établissements pour les aveugles, des écoles pour les sourds-muets, des hospices pour les vieillards et les orphelins. Pour moi, il n’y avait rien ; ma disgrâce n’était point cataloguée parmi les misères dont a cure la charité sociale. Pauvre, je n’aurais eu qu’à me rayer de l’humanité.
Brusquement, un événement changea mon existence. Mon père mourut, laissant une fortune bien supérieure à celle qu’on lui supposait.
Pendant des mois, je voyageai… J’aimais passer dans des villes où rien ne me rappelait le passé, ne ravivait mes blessures. Je me livrais à cette sensation douce que font éprouver les pays où l’on n’a pas encore souffert. Les choses me devenaient amies. Je me sentais libre, affranchi des servitudes que créent les lieux où l’on a longtemps vécu. Et tout, alors, m’apparaissait beau, humain et bon. Je sais bien, ce sont là des idées, et les hommes partout se valent. Du moins, ceux que nous ignorons ont sur les autres cet avantage qu’ils nous permettent l’illusion et de les parer de noblesses imaginaires.
Je me souviens surtout d’un séjour que je fis en Normandie, au printemps. J’avais découvert, à deux lieues de Rouen, un asile de fraîcheur, dans la sérénité de la belle campagne plantureuse et verdoyante. Il y avait là des bêtes, des fleurs, des arbres, une végétation splendide, un ciel clair, d’un bleu très haut, un épanouissement radieux de toute la nature, des coins d’ombre et de silence. Je me plaisais à contempler les canards et les cygnes et les bœufs graves qui ouvraient sur moi leurs grands yeux mystérieux et qui ne me voulaient point de mal. Mon amour des humbles et des simples s’étendait à ces bêtes ; je les comprenais, je fraternisais avec elles. Mon rêve eût été de vivre là toujours, en cette société d’êtres silencieux, sans orgueil, sans envie, sans pensée mauvaise. Je me sentais avec eux des sentiments communs d’indulgence et d’humilité ; comme eux, je n’aspirais qu’à vivre indépendant et paisible, qu’à jouir du soleil et des bienfaits du ciel. Leur âme était la mienne, une âme de tendresse, où passait parfois un peu de mélancolie. Et les arbres aussi, mes grands frères immobiles, parlaient à mon cœur ; j’écoutais leur murmure où mille voix se mêlaient harmonieusement, qui semblaient venir de loin, apportées par la brise.
Dès le premier jour, j’avais aussi remarqué une jeune paysanne, rayonnante de vie, de santé et de lumière, qui, sagement, dans le somptueux décor de cette nature normande, tricotait devant sa porte. Sa chevelure d’or, répandue sur ses épaules, mettait un ton plus chaud dans le soleil blond qui flambait autour d’elle.
Elle était si belle, si tranquille, un tel parfum de grâce, de fraîcheur et de santé émanait de sa personne, elle respirait tant la volupté de vivre, que je ne me rassasiais pas de la contempler. Ce m’était un ravissement, une joie profonde ; elle me complétait la splendeur du paysage ; elle y ajoutait de la bonté et de l’harmonie.
Même, quelquefois, je me risquais à m’approcher… Pas farouche du tout, la belle paysanne ! Ma présence ne l’intriguait pas même. Ses yeux noirs et grands ouverts ne daignaient point s’arrêter un instant sur moi, ils regardaient au loin, ils bravaient le soleil ardent sans cligner les paupières, ils semblaient avoir soif de lumière, et leur expression demeurait immuable, éternellement.
Je finissais par m’étonner de son immobilité patiente et sereine. Jamais je ne la voyais se promener. Elle restait là assise, tout le jour, à tricoter ; et les poules, les bêtes de basse-cour picoraient à l’entour, venaient jusqu’à ses pieds quémander du son, qu’elle leur jetait, de temps à autre, par poignées. Parfois, sans abandonner son ouvrage, elle chantait, toujours la même chanson, monotone, infinie, comme les plaines normandes. C’était là, semblait-il, son unique distraction.
Le soir tombé, elle rentrait chez elle, d’un pas lent, presque hésitant, et bien que le crépuscule fût doux, la campagne fraîche et odorante, jamais ne lui venait la tentation de s’éloigner un peu dans les champs, ni même de faire le tour de sa maison, une chaumière qui s’élevait un peu en deçà du chemin.
Son père cultivait une terre assez éloignée de là. Il sortait, le matin, dès l’aube, et ne revenait qu’à la nuit. Il ne paraissait pas qu’elle eût d’autre famille.
Elle m’attirait. Elle semblait heureuse comme l’on respire. J’enviais son égalité d’âme, sa placidité ; j’étais auprès d’elle comme le fleuve agité et changeant, tantôt gris, tantôt bleu, quelquefois transparent, plus souvent trouble, qui passe à côté d’une nappe d’eau immuablement claire et limpide.
Elle n’ignorait pas qu’elle était belle ; les jeunes hommes du pays devaient le lui avoir dit, bien des fois… Moi, je n’osais.
Pourtant, je ne l’effrayais pas. Même, il m’arrivait de rôder autour d’elle — un peu à distance — sans qu’elle parût s’en offenser ou s’en émouvoir… Après tout, pourquoi ne pas tenter ? Je n’avais d’autre intention que de faire sa connaissance, d’autre désir que d’entendre une voix humaine. Il y avait si longtemps que je n’avais parlé à personne !… Et que risquais-je ? Une rebuffade ? J’en avais tant subi !
Je me décidai à l’aborder, et, simplement, je lui souhaitai le bonjour. Elle eut vers moi un léger mouvement de tête, puis, doucement, murmura :
— Qui me parle ?… Qui êtes-vous ?
Je répondis :
— Votre voisin… J’habite là, en face de chez vous, depuis huit jours… et vous devez bien me connaître de vue.
— Je n’y vois pas.
— Vous êtes myope ?
— Je suis aveugle.
Je restai interdit… Je ne m’en étais pas douté, qu’elle fût aveugle, tant elle avait les yeux grands ouverts, tant elle semblait heureuse, la face illuminée d’un sourire, comme par le reflet d’une aurore intérieure.
Je demandai :
— Il y a longtemps ?
— Oui, monsieur, depuis l’âge de dix ans. Maintenant, j’en ai vingt… Mais, vous voyez, je ne suis pas malheureuse. Il faut bien se faire une raison… Seulement…
— Seulement ?
— Je suis un peu trop seule, je n’ai pas de compagnie. Mon père travaille aux champs, toute la journée, et je n’ai plus que lui… L’année dernière encore, j’avais ma mère ; elle est morte. Et, maintenant, il n’y a plus qu’une voisine, une amie, qui, de temps en temps, quand elle peut, vient causer avec moi… C’est que le village est loin d’ici, à plus d’un kilomètre. Nous connaissons bien du monde, mais les gens n’aiment pas se déranger.
Elle continuait à tricoter, mais je sentais qu’elle prenait plaisir à parler.
— Alors, dis-je, je suis content de m’être présenté, et, si vous le permettez, nous pourrons causer souvent ensemble, car, moi aussi, je suis seul, et je n’ai rien à faire qu’à me reposer.
— Monsieur n’est pas d’ici ?
— Non, et je ne suis venu dans votre beau pays que pour un mois ou deux.
— Oui, dit-elle, j’avais bien deviné, à l’accent de monsieur, qu’il était étranger… Il vient de Paris, peut-être ?
— Oui, mais après avoir fait à peu près le tour de France.
— Ça doit être beau, Paris !
— C’est la grande ville, avec son bruit, son tumulte, sa fièvre… On s’en fatigue. J’aimerais mieux vivre à la campagne, comme vous… Mais vous ?…
— Moi, je n’ai jamais connu la ville, même pas Rouen, quand j’étais petite et que j’y voyais encore. Je n’ai jamais bougé d’ici, où je suis née. Mais je ne me plains pas, j’ai le caractère gai, je me distrais à écouter des bruits autour de moi, et j’aime mes bêtes, mes poules, mes canards, qui me connaissent bien et qui viennent à moi. Cela me fait une occupation… Puis, que ferais-je, maintenant, ailleurs ? Quand on est aveugle, on est aussi bien partout.
— Je ne vous vois jamais vous promener, dis-je. La promenade vous serait aussi une distraction.
— C’est que je n’ai personne, en ce moment, pour me conduire, répondit-elle. Mon père, comme je vous le disais, est retenu aux champs par son travail, du matin au soir, en cette saison. Notre chien garde la maison.
— Vous craignez les voleurs, dans le jour ?
— Oh ! chez nous, il n’y a pas grand’chose à prendre. Tout de même, des fois, on pourrait nous voler des poules. Et notre chien est là, qui tient en respect les maraudeurs… Alors, n’ayant personne pour me conduire, il faut bien que je reste. Toute seule, je ne pourrais pas aller bien loin… Une fois, je m’étais perdue.
— Eh bien, dis-je, si vous le voulez, si vous n’avez pas peur de moi, je serai votre guide, et nous nous promènerons ensemble. Cela vous fera du bien de marcher un peu. Vous êtes trop jeune pour rester toujours immobile sur une chaise. A votre âge, on a besoin de mouvement.
— C’est vrai, mais je ne voudrais pas déranger monsieur. Ce n’est pas agréable de conduire une aveugle.
— Je vous affirme que cela me fera plaisir… C’est moi qui vous en prie.
— Monsieur, c’est trop de bonté.
— Non, ce n’est que de la justice. N’est-il pas juste que ceux qui voient aient des yeux pour ceux qui ne voient pas, et que ceux qui ont trop donnent à ceux qui n’ont pas assez ? Il faut bien s’entr’aider, puisqu’on est tous frères et sœurs par la souffrance… N’est-ce pas votre avis ?
— Oui, mais ils ne sont pas beaucoup, qui pensent comme vous.
— Parce qu’ils ne savent pas, parce qu’ils ne comprennent pas.
— Et puis, reprit-elle, j’aurais peur aussi d’ennuyer monsieur. Je suis une pauvre fille, je n’ai pas d’instruction, je ne sais pas causer.
— Aussi suis-je sûr que nous nous entendrons très bien. L’instruction — vous ne le savez pas, vous — ne sert quelquefois qu’à diviser les hommes, tandis que le sentiment les unit. On se comprend toujours, quand on a le cœur bon et qu’on a connu la misère de vivre… Ce ne sont pas les sujets de conversation qui manquent alors. Moi, je crois que nous aurons beaucoup de choses à nous dire.
Elle tourna vers moi ses yeux sans regard, et ses prunelles fixes parurent s’agrandir comme dans un effort pour percevoir la lumière. Nous fûmes, un moment, silencieux. Le jour commençait à baisser… Il y avait déjà entre nous quelque chose de très doux.
— Oh ! bien sûr, dit-elle enfin, ce n’est pas que je me défie de vous. Moi, je connais les gens à leur voix, et, à vous entendre, je sens qu’on peut avoir confiance en votre parole… Seulement, il faudra d’abord que vous voyiez mon père… Tenez, je l’entends qui siffle… Oui, c’est lui. Il rentre aujourd’hui plus tôt que d’habitude.
Le paysan s’avançait d’une allure lente, sous le poids de ses outils. C’était un mince vieillard, courbé par le rude labeur de la terre, qui fait vivre les hommes, mais qui nourrit à peine celui qui y fixe la chaîne de son existence. Et à force de la contempler, cette terre, à force de s’y pencher, son visage, labouré comme elle, en avait pris la couleur terreuse et la dureté. Je craignais qu’il ne me repoussât brutalement. Mais, dès qu’il m’eût aperçu, il vint à moi et me tendit la main.
— Bonsoir, mon voisin, dit-il… Oh ! je vous connais bien, je vous ai vu plusieurs fois, depuis que vous êtes dans le pays… Alors, vous causiez avec ma fille ?
— Oui, nous causions, répondis-je.
— Ah ! c’est un grand malheur qu’elle ait perdu les yeux, pour elle comme pour moi, car je me fais vieux, je vais sur mes soixante-quinze ans… J’ai eu d’autres enfants, il ne me restait plus qu’elle, et voilà !… Non, ce n’est pas juste !
— Non, ce n’est pas juste, répétai-je sans trouver, sur le moment, autre chose à dire, si touché par cet accueil que j’en étais interloqué.
— Vous prendrez bien un verre de vin avec nous ? proposa le vieillard.
J’acceptai, et, quand nous eûmes trinqué et vidé nos verres, j’offris à mon tour un cigare.
— Merci, dit-il, je fume la pipe.
Et il bourra sa pipe.
— Heureusement, repris-je, vous vous portez bien ; on ne vous donnerait pas votre âge.
— Vous trouvez ?… Ah ! pourtant, il y a des jours, comme aujourd’hui, où je me sens à bout, et il me semble que je ne pourrai plus continuer. Le travail de la terre est trop dur, à mon âge… Et encore ce n’est pas de la terre qu’il faut se plaindre : la terre est bonne, il n’y en a pas de meilleure, ces deux dernières années, les récoltes ont été magnifiques. Avec une terre comme ça, où le blé pousse tout seul et qui donne tout ce qu’on lui demande, il devrait y avoir du bonheur pour tout le monde… Et c’est tout juste si l’on vit, en se tuant à la peine. Pour que les inutiles aient du bien-être, faut que les travailleurs soient misérables ! Le monde est comme ça, et ça n’est pas près de changer.
Puis, carrément, franchement :
— Et vous, qu’est-ce que vous avez ? Vous vous êtes brûlé ?
— Oui, quand j’étais enfant.
— Vous avez dû vous faire bien du chagrin, dit-il d’un accent profond.
Nous causâmes longuement. Il me dit son nom : François Jamin, me conta son histoire, la mort de sa femme, ses deux fils rengagés, l’un en Afrique, l’autre au Tonkin, d’autres choses encore, vagues, qui remontaient de son passé, se noyaient dans une confusion de crépuscule, flottaient là-bas parmi les brumes, tandis qu’au loin, dans la campagne engourdie, s’élevaient, par instants, des meuglements inquiets.
— Et toi, Blanche, tu ne dis rien ?
L’aveugle parut sortir d’un songe.
— Je vous écoute, dit-elle.
— Que racontais-tu tout à l’heure à notre voisin ? questionna le paysan.
Ce fut moi qui répondis :
— Je proposais à votre fille, puisqu’elle n’a personne pour la conduire et que je n’ai pas d’occupation, de nous promener ensemble, quand ça lui ferait plaisir… Seulement, je comprends, c’est une question de confiance, une chose délicate, qu’on n’accorderait pas à tout le monde, et nous voulions d’abord vous prévenir, avoir votre consentement.
— Oui, oui, dit le vieillard, en m’enfonçant dans l’âme le rayon de sa prunelle — je vois bien que vous ne pensez pas au mal, que vous êtes un honnête homme. Quand on est vieux comme moi, on ne se trompe pas beaucoup sur les gens… Eh bien, moi, je ne dis pas non, puisque vous parlez de confiance… C’est vrai, c’est la première fois qu’on se voit et qu’on cause ensemble, mais souvent on ne connaît pas mieux son homme après trois mois qu’après une heure de conversation… Oui, j’ai de l’amitié pour vous, vous avez le regard franc et bon… Eh bien, allez vous promener tous les deux, si le cœur vous en dit… C’est même bien gentil de votre part d’avoir pensé à ça. Nous avons des voisins, des amis qui n’ont jamais tant fait pour nous. Et tant pis, si les mauvaises langues bavardent !… Tenez, donnez-moi la main.
Puis, se tournant vers sa fille :
— Et toi, es-tu contente ?
— Oui, père, répondit-elle.
Oh ! les jours qui suivirent ! C’était comme un grand soleil qui se levait du fond de moi-même et qui m’illuminait. J’allais la prendre, l’après-midi. Dès qu’elle avait reconnu mon pas, son visage s’éclairait d’un sourire, ses yeux noirs s’agrandissaient comme pour percer ses ténèbres ; elle venait au-devant de moi, et ses mains tâtonnantes me cherchaient autour d’elle.
Je la conduisais par la main. Nous allions, des heures entières, à travers la plaine, dans les sentiers ou sous les arbres. Le désir de sa possession ne m’effleurait même pas. La seule pensée d’abuser d’elle m’eût semblé criminelle. C’était, entre nous, je ne sais quoi de très doux et de très pitoyable, une association de deux misères d’où jaillissaient de l’espérance et de la joie.
Je lui offrais des fleurs. Elle rougissait, elle souriait, et ses yeux mêmes semblaient prendre de la vie, refléter l’aurore où rayonnait son âme. Je cueillais ces fleurs dans les champs, à mesure que nous avancions ; elle en aspirait lentement le parfum, tout le long du chemin, elle en faisait de gros bouquets, qu’elle rapportait, le soir, à la maison.
On n’eût pas dit une fille de la campagne, tant elle avait de grâce et de souplesse ; ses mains mêmes étaient fines. Elle était adorable quand, dans ses mouvements de tête, elle découvrait la ligne harmonieuse de son cou ; et rien au monde n’était beau comme sa chevelure d’or, abondante, qui flambait dans le soleil. Elle s’épanouissait dans le rajeunissement de la terre, parmi la floraison splendide des arbres et des fleurs.
Nous causions, elle parlait ses rêves, les visions écloses dans sa nuit éternelle. Je l’écoutais, silencieux et ravi. Elle me disait des choses naïves et profondes, l’image qu’elle se faisait de moi, d’après mes discours et le son de ma voix, et avec les yeux de l’âme, qui voient plus juste et qui voient plus loin que les yeux du corps. Son imagination évoquait des spectacles extraordinaires, lui créait un monde extérieur plus beau que le nôtre ; il devait y avoir dans ses ténèbres une féerie éblouissante et continuelle, qui lui mettait aux lèvres un sourire d’extase et de ravissement.
Il y avait, non loin de chez nous et sur les bords de la Seine, un bois touffu où nous allions de préférence. J’écartais devant elle les buissons, les branches des fourrés, pour lui frayer un passage. Je lui cueillais des fraises, des framboises et des mûres sauvages. Nous étions en juin. Une atmosphère lourde enveloppait la terre. Les feuilles ne remuaient pas. Le soleil, passant entre les branches, laissait trembler, çà et là, des taches lumineuses. D’instant à autre, un souffle tiède, s’élevant tout à coup, faisait tressaillir le bois comme d’un frémissement passionné… Alors, je lui prenais les mains, je les portais à mes lèvres. Quelquefois aussi, je baisais ses yeux éteints. Je ne lui disais pas que je l’aimais ; elle ne m’avouait pas non plus son amour, mais je la sentais émue, et je fermais les paupières, j’entrais dans ses ténèbres pour entendre battre son cœur.
Nous avions hâte d’atteindre ce petit bois, de nous soustraire aux passants, craignant la rencontre des gens du pays, pris même d’une timidité en présence des grands bœufs, immobiles en leur éternelle songerie, et dont les regards mystérieux gênaient la confidence muette de nos âmes.
Le soir venu, nous écoutions les derniers bruits du jour, le coassement des grenouilles, le chant des grillons, les aboiements continus qui se traînaient au loin, indéfiniment, dans la plaine. Et tous ces bruits s’harmonisaient, plus vagues et confus, comme ouatés par les vapeurs du crépuscule. C’était un calme très doux où s’exaltaient nos rêves. Nous aurions aimé rester là longtemps, silencieux dans l’extase.
Quelquefois, cependant, je la sentais envahie d’une tristesse soudaine.
— Je me sens heureuse et malheureuse à la fois, disait-elle. Je sais bien que ce bonheur ne peut pas durer toujours, que même il ne durera pas longtemps. Vous vous en irez, vous retournerez là-bas, à Paris, et je resterai seule.
Je lui jurais que je ne la quitterais jamais.
— Mais non, reprenait-elle, ne jurez pas, car c’est impossible… Nous ne pouvons pas passer la vie ensemble… L’amour, le mariage, ce n’est pas pour moi, il ne faut pas que je pense à ces choses… Je suis une pauvre fille, aveugle, inutile, bonne à rien. Aucun garçon du pays, même celui qui n’a rien, ne me voudrait pour femme. A plus forte raison vous, qui avez du bien, de l’instruction, de l’éducation, et qui habitez la grande ville… Non, ne promettez pas, vous savez bien que ça ne peut pas être… Encore, si j’avais la vue !…
La splendeur du soir se reflétait dans ses prunelles avides de lumière ; elle soupira :
— Heureux ceux qui voient !
— Heureux plutôt, murmurai-je, ceux qui ne voyant pas, échappent à la cécité cruelle de ceux qui ont des yeux !
Depuis quelques jours, il y avait en moi une lutte, une hésitation douloureuse entre mon égoïsme et ma pitié, entre mon désir d’être heureux et celui que j’avais de la voir plus heureuse, entre mon amour pour elle et mon amour pour l’humanité… Enfin, avec le vague espoir que la gratitude continuerait à lui fermer les yeux, je me décidai à lui demander :
— Blanche, avez-vous jamais consulté un oculiste ?
— Non, dit-elle.
— Qui vous a soignée, quand vous avez perdu la vue ?
— Le médecin du pays, un bon vieux qui habite le village, depuis vingt ans.
— Que vous a-t-il dit ?
— Je ne me rappelle pas… Il y a si longtemps ! J’avais à peine dix ans, quand je suis devenue aveugle… Mais pourquoi ces questions ?
— Je pense que vous devriez aller à Rouen, vous faire examiner par un spécialiste.
— Qu’y ferait-il, le spécialiste ?
— On ne sait jamais… On a vu des cas de guérison extraordinaire… Je ne voudrais pas vous donner un vain espoir, je n’affirme pas qu’on vous rendra la vue. Mais pourquoi ne pas tenter ?
— Alors, vous dites qu’il faudrait aller à Rouen ?
— Oui, avec votre père. Et je vous accompagnerai.
— C’est que ça coûte, dit-elle, d’aller à Rouen, de voir un grand médecin…
— Ne vous inquiétez pas, ceci me regarde… Rentrons, je veux parler à votre père.
Je causai longuement avec le vieux paysan. Il restait sceptique, incrédule. Pourtant, il finit par se décider, disant que c’était pour n’avoir point de regret. Et, le lendemain, nous partîmes pour Rouen.
Il y avait alors dans cette ville un célèbre oculiste. Nous nous rendîmes chez lui, il examina l’aveugle… Oui, il y avait peut-être de l’espoir. Toutefois, il ne promettait rien. Et la cure serait longue, sans doute, elle demanderait des semaines, sinon des mois.
Il fallut nous établir à Rouen… Quelle ivresse d’abord ! Quelle foi au miracle !… Le jeudi et le dimanche, nous conduisions l’aveugle dans un jardin public, où jouait la musique de la troupe. Éclatante, splendide, dans sa simple robe de linon blanc, sans parure, elle avançait, lente, droite, hautaine, avec la majesté d’une souveraine des ténèbres.
Elle écoutait le concert avec recueillement. Un sourire, parfois, montait à ses lèvres ; ses yeux devenaient très grands ; toute sa physionomie exprimait du rêve, comme si les flots d’harmonie lui versaient dans l’âme une onde de lumière. Des regards s’arrêtaient sur elle, d’admiration d’abord, puis de pitié, quand on s’était aperçu qu’elle était aveugle. Elle était la beauté et le malheur, et le malheur relevait sa beauté de je ne sais quelle poésie profonde, qui n’émane jamais de la joie.
Plus encore que par le passé, nous vivions l’un près de l’autre, la journée entière. Je ne la quittais plus, j’adorais la grâce qui s’exhalait de toute sa personne. Très précoce, comme les filles de la campagne, elle atteignait avant l’âge l’entier développement de sa nature. On eût dit que l’été la mûrissait comme les fruits, donnait à son teint l’éclat des fleurs épanouies. Et rien au monde n’avait la candeur de son doux visage de blonde, sous le chapeau de paille à larges bords dont elle se coiffait pour se garantir du soleil. A force de vivre ensemble et de nous pénétrer, nous nous étions fait une âme commune, nous avions les mêmes pensées, les mêmes rêves, nous nous entendions dans le silence.
Cependant, les semaines se succédaient, et le miracle ne s’annonçait pas. Le vieux paysan commençait à languir. La terre le rappelait. Sur sa mince figure terne et ridée, s’aggravait, chaque jour, la nostalgie de l’espace, des vastes horizons. Avant de partir, il avait confié la garde de son champ et de sa maison à un voisin ami. Mais on ne faisait bien ses affaires que soi-même, disait-il. Trois fois par semaine, maintenant, il faisait à pied, malgré son grand âge, le voyage de Rouen à Saintonge, où était sa terre.
Nous finissions par ne plus croire à la guérison, lorsqu’un jour, l’espoir renaquit. L’aveugle nous révéla qu’elle voyait des lumières, comme des étincelles ; et il lui semblait, par moments, qu’elle allait recouvrer la vue ; puis, tout retombait dans les ténèbres.
Cet état se prolongea deux mois encore. L’été passa, les premiers froids s’annoncèrent. Le mauvais temps nous retenait au logis.
Quelquefois, elle m’embrassait, et je ne sais quelle fierté m’emplissait toute l’âme. Ces baisers éveillaient en moi l’impatience d’une volupté plus haute. Mais, à d’autres heures, une tristesse me ressaisissait. Je souhaitais pour elle, je redoutais pour moi sa guérison. Un matin de novembre, assis près d’elle, le front collé à la vitre d’une fenêtre, je regardais le ciel se fondre en neige sur la ville. Et il me semblait que mon cœur se fondait aussi, s’alanguissait, comme la nature, sous l’immensité blanche qui la voilait. Les flocons tombaient partout en un silence surchargé de mélancolie. Ils ralentissaient leur vol en s’approchant de terre, comme pour faire moins de bruit encore en s’y posant. Les arbres les cueillaient au passage, avec une délicatesse infinie. Blanche restait songeuse auprès de moi. De ma main, j’essuyai la vitre que ternissait son haleine d’une buée légère. Elle me dit enfin :
— Vous ne parlez pas ! Qu’avez-vous ?
— Rien, répondis-je doucement.
— Si, depuis quelque temps, je sens bien que vous vous tourmentez ; votre voix n’est plus la même… Qu’est-ce donc ?
— Vous voulez le savoir ?
— Oui.
— Je vous répondrai ce que vous-même me disiez, un jour : je me sens heureux et malheureux à la fois.
— Pourquoi ?
— C’est une chose difficile à dire.
— Dites-la quand même.
— Eh bien, voilà, je suis triste en pensant que ce n’est pas moi que vous aimez, mais une illusion pure, votre propre rêve, l’image que vous vous faites de ma personne ; et peut-être cesseriez-vous de m’aimer, si vous recouvriez la vue.
— On dit que l’amour est toujours aveugle… Pour vous, je serai toujours aveugle… Mais pourquoi dit-on cela ?
— Peut-être, en effet, a-t-on tort de le dire, parce qu’il est fort possible qu’au contraire, l’amour y voie plus clair, je veux dire plus profondément, et qu’il naisse de la découverte d’une beauté cachée aux yeux de l’indifférence. C’est ainsi que des femmes laides, des hommes laids, inspirent parfois les passions les plus vives. Ils ne sont laids et elles ne sont laides sans doute que pour le vulgaire, dont les regards s’arrêtent à la surface, et ils ont en eux une splendeur secrète que l’amour seul a le don d’apercevoir… Non, ce n’est pas l’amour qui est aveugle : c’est nous qui le sommes, quand nous n’aimons pas ; et l’on n’est juste vraiment qu’envers ceux que l’on aime.
— Et moi, dit-elle, pourquoi m’aimez-vous ? Est-ce aussi pour la beauté que les autres ne voient pas ?
— Oui, et pour celle aussi que vous êtes seule, hélas ! à ne point voir.
La porte s’ouvrit, le père entra.
— Ah, vous êtes là, me dit-il, ça se trouve bien, j’ai un service à vous demander… Il faudrait que j’aille aujourd’hui à Saintonge, mais je ne puis pas, j’ai les jambes rompues.
— J’irai pour vous, père Jamin. Restez ici, reposez-vous.
Il m’expliqua ce que j’avais à faire. Je partis.
Il neigeait encore. La route de Rouen à Saintonge est longue : huit kilomètres environ ; il fallait la parcourir à pied, car aucun service de diligence ne reliait alors la ville et le village.
Je restai deux jours à Saintonge.
A mon retour, j’eus tout à coup la sensation intense et confuse de quelque chose de nouveau qui venait de se produire dans ma vie. Je ralentis ma marche, oppressé de cette inquiétude qui nous avertit parfois obscurément de l’événement qui se prépare ou s’accomplit loin de nous. Le vulgaire appelle cela pressentiment, et Shakespeare l’ombre de la destinée qui s’avance.
Maintenant, il faisait beau. Le ciel, lavé par la neige et la pluie de la veille, avait l’azur profond et précieux du saphir. Je voyais là un présage heureux… C’est étrange comme on devient superstitieux à certaines heures, surtout dans les crises sentimentales. C’est un besoin de certitude qui nous fait interpréter toutes les manifestations de la nature, si sereinement indifférente à toutes nos émotions !
J’approchais de Rouen, quand j’aperçus le vieux paysan qui venait vers moi. De loin, il me faisait des signes que je ne comprenais pas, et sa figure était joyeuse. Il pressait le pas pour me rejoindre. Et je n’entendais pas non plus ce qu’il me criait, car le vent soufflait vers lui, emportait sa voix. Enfin, comme nous nous rapprochions, je saisis ces mots :
— Elle voit !
Et, quand nous fûmes près l’un de l’autre, il me prit dans ses bras et m’embrassa.
— Elle voit, répéta-t-il, elle voit !… Ce matin, en se réveillant, elle m’a appelé et elle a crié : Père, je vois ! je vois ! Ah ! si vous aviez vu sa figure, son étonnement, sa joie !… Elle voulait tout toucher, tout regarder, et elle est allée vers la fenêtre, elle ouvrait de grands yeux sur la ville, sur le ciel… Et justement le ciel était beau, la nature était de la fête… Elle riait, elle faisait des gestes, et jamais je ne l’avais vue si belle. — Eh bien ! que je lui ai dit, tu ne m’embrasses pas ? — Et l’on s’est embrassé plus de vingt fois !… La tête me tournait, je pleurais, j’étais trop heureux, ça me semblait un rêve !… Tant de bonheur quand on ne s’y attend pas, car je n’espérais plus, ça vous accable, c’est à vous rendre fou… J’ai voulu aller à votre rencontre, pour que vous sachiez plus tôt… C’est à vous que nous devons ça, monsieur Grandon ! Comment vous revaloir un tel bienfait ?
Sans réfléchir, naïvement, je répondis les premières paroles qui, dans ma joie et l’exaltation de mon amour, me jaillirent du cœur :
— En me donnant la main de votre fille, père Jamin.
Le vieil homme parut surpris, et sa figure changea instantanément d’expression.
— Ah ! vous pensiez donc à cela, dit-il.
En même temps, il me dévisageait comme jamais il n’avait fait et d’un air qui semblait signifier : Non, tout ce que vous voudrez, mais pas cela, c’est impossible, vous devez bien le comprendre vous-même.
Puis, en phrases courtes, hésitantes, interrompues, et avec des gestes qui témoignaient de sa gêne, il balbutia :
— Mon Dieu ! vous me demandez là une chose à laquelle on ne peut pas répondre tout de suite… D’abord, faudrait réfléchir… Moi, vous comprenez bien, je ne puis pas vous dire : non… Nous vous devons trop, monsieur Grandon… Et, naturellement, ce serait avec bonheur, si ça dépendait de moi… parce que je vous connais, et je sais bien que vous êtes un brave cœur, un honnête garçon, comme on n’en voit pas souvent… Oh ! non, pas souvent !… Ah ! c’est bien malheureux, cet accident, cette brûlure ?… Ce sont des choses qui n’arrivent qu’aux bons, aux meilleurs… Enfin, ça n’empêche pas les sentiments, la reconnaissance… Ma fille et moi, nous n’oublierons jamais ce que vous avez fait pour nous, et faudrait n’avoir pas de cœur pour l’oublier…
Il s’arrêta, embarrassé, comme à bout de circonlocutions, mais son regard continuait à me dire : C’est impossible, réfléchissez ; ma fille ne voudra pas de vous, elle ne pourra pas vous aimer, vous ne devez pas espérer cela.
— C’est juste, murmurai-je, sans trouver d’autre réplique, écrasé par la conscience, brusquement réapparue, de mon état… Oui, j’avais presque oublié, durant ces quelques mois de bonheur, je m’étais aveuglé comme elle !… Oui, le vieux avait raison… C’était impossible… J’avais fait un rêve insensé !
Il reprit, comme pour réparer un peu, atténuer l’impression produite par ses premières paroles :
— Bien sûr, monsieur Grandon, ce serait un grand honneur que vous nous feriez, en entrant dans notre famille, en donnant votre nom à ma fille… Car nous sommes de pauvres gens, des paysans. Ma terre, ma maison et tout ce que je possède, ça ne va pas à mille francs… Et vous, vous êtes riche, instruit, et vous avec le cœur sur la main… Oh ! à ne voir que cela, c’est plus que nous ne pourrions espérer… Seulement…
De nouveau, il hésita, cherchant ses phrases, ne voulant pas me blesser, et il avait les gestes d’un homme qui s’excuse :
— Seulement, c’est à elle qu’il faut demander… Oh ! je sais qu’elle a de l’amitié pour vous, beaucoup d’amitié, et de la reconnaissance… Ça ne peut pas être autrement. Tant qu’elle vivra, elle se souviendra… Mais, vous savez, le mariage, l’amour, c’est une autre chose, ça ne se commande pas. Les jeunes filles ont des raisons à elles, on ne peut pas les forcer… Enfin, on va la voir, elle vous attend ; c’est elle qui m’a dit d’aller à votre rencontre…
— Non, déclarai-je, j’ai réfléchi, il vaut mieux que je m’en aille.
— Comment !
— Oui, il vaut mieux que je m’en aille, tout de suite, sans la revoir… Vous lui direz que je lui souhaite du bonheur… Je suis content d’avoir fait un peu de bien… Et, maintenant, je m’en vais…
— Voyons, dit le vieux paysan, on ne peut pas se quitter comme ça, sans avoir trinqué une dernière fois ensemble… Allons, venez… Blanche vous en voudrait, si vous partiez sans lui avoir dit adieu, sans qu’elle ait pu seulement vous remercier.
Me voyant hésitant encore, il ajouta :
— Il n’y a pas que l’amour, il y a l’amitié… C’est comme si vous étiez mon fils, c’est comme si vous étiez son frère.
— Vous avez raison, père Jamin, répondis-je, je ne m’en irai pas ainsi, ce ne serait pas brave. Allez devant, prévenez-la, je vous rejoins.
— Alors, faut lui dire que vous arrivez ?
— Oui.
— Eh bien ! à tantôt.
— A tantôt.
Et il me devança.
Je devais être très pâle, de cette pâleur ardente qui indique non la peur, mais la concentration de toutes les forces de l’âme, en face d’un abîme qui s’ouvre sous vos pas et qu’il faut franchir. La honte, la passion, le désespoir m’agitaient comme un orage. J’endurais un affreux tourment… Je l’aimais. Pendant ces deux jours d’absence, je n’avais pensé qu’à elle. Depuis six mois, son image ne m’avait pas quitté… Elle m’avait aimé aussi, elle m’aimait encore, et j’allais lui apparaître, horrible, mutilé ; j’allais, en un instant, par ma seule présence, détruire son amour, changer soudain en une vision d’épouvante l’illusion charmante qui était née dans ses ténèbres.
Comment avais-je pu croire, espérer que son amour survivrait et resterait aveugle, quand elle ne le serait plus ! que la reconnaissance continuerait à fermer ces yeux qui me devaient la lumière ? Insensé que j’étais !
La glace d’un magasin me renvoya l’horreur de mon masque. J’en éprouvai moi-même un frisson. Et il me sembla que tout insultait à ma détresse : le ciel bleu, la tranquillité des choses. Le monde me parut gouverné par une fatalité imbécile et mauvaise, frappant au hasard, sans raison et sans discernement. Tandis que j’agonisais, des gens causaient et riaient à mes côtés. Mon désespoir se noyait dans le vacarme des rues, le féroce égoïsme humain. Tout se désintéressait du drame qui m’étreignait. La vie de tous les jours continuait, insoucieuse, inconsciente, soumise à un mécanisme brutal. Rien ne changeait, rien ne s’arrêtait, parce qu’un homme souffrait. Les pires affres d’une âme n’influençaient rien dans l’inextricable complexité des lois impassibles qui menaient le monde vers des fins ignorées. Pas une branche d’arbre ne tremblait, pas un regard pitoyable n’allégeait ma torture. Le ciel conservait son immuable sérénité.
La révolte et la douleur égaraient ma raison. Je maudissais la vie, l’abominable destin ; je me prenais à haïr ces êtres anonymes, ces passants qui tous avaient connu les joies de l’amour, et dont les regards me jetaient l’anathème.
Pourquoi avais-je été un honnête homme ? Si j’avais abusé d’elle, quand elle était aveugle, peut-être, même après avoir recouvré la vue, m’eût-elle aimé encore, malgré ma disgrâce, comme l’initiateur, le premier amant, le révélateur de la volupté, qui laisse son empreinte ineffaçable.
Je l’avais respectée, et ses lèvres en m’effleurant ne m’avaient mis au cœur que le désir torturant d’une félicité désormais inaccessible.
Que dirait-elle en me voyant ? Que dirais-je à mon tour ? Il me fallait plus de courage pour lui apparaître que pour affronter le feu. Je tournais autour de la maison, ne me décidant pas à entrer. Une fois encore, je fus tenté de partir, sans l’avoir revue. Mais je ne sais quelle espérance insensée sillonnait par instants comme un éclair la nuit de mon désespoir.
Enfin, je gravis les étages, je sonnai. La porte s’ouvrit.
Blanche était assise à côté de son père.
Elle eut, en m’apercevant, un mouvement de recul involontaire, devint toute blanche, et ses lèvres se serrèrent comme pour retenir un cri d’effroi.
— C’est moi, dis-je, n’ayez pas de crainte… Je viens vous faire mes adieux, car je m’en vais. Vous ne me verrez plus… Avant de partir, j’ai voulu vous dire combien j’étais heureux de votre guérison. Mais je ne voudrais pas, maintenant, troubler votre bonheur, et je comprends qu’il est nécessaire que je disparaisse. Je serai assez content, je m’estimerai récompensé du bien que j’ai pu faire, si vous gardez de moi un bon souvenir.
Comme elle ne répondait pas, suffoquée par l’émotion, je continuai à parler, pour lui laisser le temps de se ressaisir. Je répétai à peu près les mêmes phrases, et j’ajoutai :
— C’est une grande fatalité que je sois ainsi… Je vous avais promis de ne jamais vous quitter ; j’aurais tenu ma promesse, si vous n’aviez pas recouvré la vue… Mais, aujourd’hui, les choses sont changées… Ma présence vous serait pénible, douloureuse. Je n’ai rien à espérer, il vaut mieux que je parte. Et c’est moi qui vous devrai une gratitude éternelle, pour les jours de bonheur que j’ai vécus auprès de vous… J’avais oublié ma misère dans l’illusion où vous étiez vous-même, j’étais redevenu un homme comme les autres. Tant que vous ne pouviez me voir qu’avec les yeux de l’âme…
Elle fondit en larmes.
— Je suis désolé, repris-je, d’être la cause des premières larmes que vous versez… Consolez-vous, oubliez-moi.
— Monsieur Grandon, intervint le vieux paysan, ça nous fait trop de peine de vous entendre parler ainsi. Ma fille ne peut pas oublier ce que vous avez fait pour elle… Approchez-vous, elle veut vous embrasser.
Elle-même se leva, vint à moi et m’embrassa. Ses larmes tièdes et silencieuses me baignaient tout le visage. Je pleurais aussi.
— Voyons, monsieur Grandon, reprit le père, vous n’allez pas partir, ce soir, vous dînerez avec nous.
— Non, je vous remercie, répondis-je, il vaut mieux que je parte tout de suite… Oui, croyez-moi, cela vaut mieux… Notre dernière soirée serait trop triste… Vous êtes de braves gens ; moi, je ne vous oublierai jamais… Adieu, père Jamin… Adieu, Blanche… Je vous souhaite du bonheur à tous deux…
Le mot que j’espérais, le seul mot qui m’eût retenu, elle ne l’avait pas prononcé. Peut-être y avait-il de tout dans ses larmes : de la douleur, de la pitié, de la reconnaissance, mais non de l’amour. Peut-être aussi pleurait-elle sur son amour détruit, désormais impossible. S’il en avait été autrement, elle eût dit : Restez, je vous aime… Mais elle gardait le silence.
Je m’éloignai, sans oser regarder autour de moi. Mon désespoir se fût accru de la réapparition des objets que j’avais coutume de voir tous les jours et que l’ivresse de mon amour avait imprégnés, à mes yeux, d’une mystérieuse douceur.
Je m’acheminai vers la gare… Je pris le premier train qui partait… Où allais-je ? Je n’en sais rien… là-bas… Qu’importait !
Le lendemain, je me trouvais en Bretagne, dans le Morbihan… L’idée me vint de faire un pèlerinage au pays de ma vieille bonne Noémie… Est-ce que, par hasard, elle vivrait encore, ma vieille bonne Noémie, qui m’avait tant aimé, tant consolé ?… Il y avait quatorze ans que je ne l’avais plus vue, et, quand elle avait quitté notre maison, elle était déjà bien vieille. C’était même à cause de cela et parce qu’elle ne pouvait plus faire son ouvrage, que mes parents l’avaient renvoyée chez elle.
A force de fouiller ma mémoire, je finis par me rappeler son adresse : un petit village voisin de Pontivy, et dont le nom m’échappe, en ce moment… Je m’y rendis…
Oui, elle vivait encore, ma vieille bonne Noémie !… On me montra une petite vieille assise devant sa porte et qui tremblait sous le soleil de novembre. Elle avait à présent quatre-vingts ans passés… Et l’on me dit : La voilà, c’est elle, mais elle a perdu la raison, elle est tombée en enfance… Et l’on ajouta qu’elle n’y voyait presque plus…
Alors, je m’approchai, je me baissai vers elle, je pris ses petites mains, je les embrassai…
— C’est moi, lui dis-je… Je suis René… Regarde-moi, reconnais-moi, rappelle-toi… Je suis venu de bien loin pour te voir… J’ai tant souffert depuis que je ne t’ai plus vue… Si tu savais !
— René, balbutia-t-elle… Mon Dieu, c’est-il possible ?… Oui, je vous vois, je te vois… C’est bien toi, mon petit René ! Assois-toi près de moi… Je ne t’avais pas oublié, je pensais à toi, tout le temps. Alors, c’est vrai que tu as eu tant de chagrin ?…
En même temps, elle me tendait ses bras tremblants, et elle continuait à parler, elle pleurait, elle me disait des choses que je ne comprenais plus, des souvenirs, des noms qui se brouillaient dans sa mémoire : Brive, les Delbray, Lucette…
— Lucette, dis-je, je ne l’ai plus revue !
Et, à mon tour, je parlai, je lui racontai toute ma vie, mille choses tristes qu’elle ne semblait pas entendre non plus. Et elle revenait toujours à Lucette, et à la même idée, l’idée fixe de la vieillesse tombée en enfance. Dix fois, elle me répéta :
— Va retrouver Lucette. C’est elle qui t’aimera… elle, et pas une autre !
Et, en disant cela, elle me regardait fixement, étrangement, avec des yeux de visionnaire, comme pour me faire entrer dans l’âme sa conviction, sa volonté.
Ma pauvre vieille Noémie ! que de fois je baisai ses petites mains, avant de la quitter !… Elle ne voulut même pas accepter ma bourse ; elle avait assez, disait-elle, elle était assez riche, et elle m’avait revu… Cela lui suffisait !
Pour la seconde fois, mon narrateur s’interrompit. Il regarda l’heure : minuit était passé. Je compris qu’il désirait que je me retirasse. Pourtant, il dit encore :
— Je vous ai conté ma jeunesse. Je ne rougis pas d’avoir été ce qu’on nomme aujourd’hui, en y attachant une nuance de ridicule, un sentimental. Malgré mon état, j’ai toujours recherché les joies les plus hautes de l’amour. Si je n’avais été qu’un sensuel, mon malheur eût été moins grand. Riche, j’aurais pu satisfaire des désirs vulgaires, m’infliger à ces filles que la misère oblige à subir toutes les promiscuités, à boire jusqu’à la lie la coupe des rancœurs. Car, si tyrannique s’affirme, dans notre société, le besoin d’argent, qu’il n’est pas de bourgeois obèse et difforme, de vieillard chassieux, de monstre à qui l’abominable souveraineté de l’or ne confère le pouvoir de souiller la beauté. Avec une âme basse et de la fortune, l’existence, en dépit de ma disgrâce, m’eût été souriante et féconde en ressources. Mais j’ai trop le respect de la femme pour avilir sa pauvreté. J’étais né avec un cœur d’amant, j’ai voulu l’amour qui ne s’achète pas, et c’est en cela qu’est le drame de ma vie.
Après un silence, il ajouta :
— Je ne pense pas comme ce sage antique qui nous conseille de cacher notre vie. Je voudrais, au contraire, arracher tous ces masques qui nous pèsent ; je voudrais que la sincérité devînt la vertu première, la loi suprême de l’homme véritablement civilisé. C’est l’hypocrisie qui empoisonne nos existences, c’est la contrainte où nous sommes d’adopter une grimace, de farder nos douleurs et nos joies.
Pour moi, je ne vous ai rien caché, je me suis révélé à vous dans toute la vérité de ma nature, et mon histoire, quand vous la connaîtrez tout entière, vous apparaîtra consolante, car elle enseigne qu’il ne faut jamais désespérer du cœur de la femme ni de l’amour. Si, moi, je fus aimé, qui donc peut se dire qu’il ne le sera pas, un jour ?
Il me demanda de revenir un soir prochain, et nous nous séparâmes.
Ses dernières paroles m’avaient frappé : il avait été aimé, c’était vrai. Sans qu’il m’en eût fait encore la confidence, je savais qu’il avait été l’amant de madame Derive. Là était l’énigme. Il me tardait d’en connaître le mot.
Deux fois, dans la semaine suivante, je l’aperçus qui sortait du cimetière Montmartre, et la curiosité me prit de visiter la tombe de madame Derive. Elle était couverte de roses rouges fraîchement épanouies.
Il y avait maintenant trois mois que nous étions amis, et sa laideur ne me choquait plus. Horrible, épouvantante à première vue, elle disparaissait à la longue, ou plutôt elle cessait d’être une laideur, une fois devenue familière ; il en ressortait un caractère étrange, n’ayant rien de commun avec l’expression d’un visage humain, une sorte de grandeur sinistre, comme celle qui se dégage du théâtre d’un cataclysme. Cette laideur n’avait rien de bas, de grotesque ni de répugnant, comme la plupart des difformités humaines ; elle était tout un drame. Elle effrayait d’abord, elle attirait ensuite, elle soulevait de l’émotion et de la sympathie.
Il avait été beau, étant enfant… Des choses qui furent belles, il reste toujours un reflet. Même mutilées, leur splendeur ne s’efface jamais complètement. Ce visage dévasté gardait encore le rayonnement de sa beauté première ; elle demeurait dans la qualité du regard ; et la voix était si douce, la main si fine, et il dressait avec tant de grâce le frêle décor de ses rêves déçus, qu’il s’exhalait à la fin, de cette laideur, je ne sais quel charme troublant, quelle poésie de ruines où s’éveille toute la mélancolie des choses disparues. Qu’une femme eût aimé cet homme d’un amour sincère et profond, cela maintenant cessait de me surprendre, cela ne me semblait plus invraisemblable, mais supposait seulement une âme d’élite, une femme extraordinaire, clairvoyante jusqu’à découvrir le trésor caché sous la gangue. Et peut-être y avait-il eu autre chose et plus que de la pitié dans cet amour ; peut-être l’avait-elle aimé à force de pénétration et d’admiration…
Le jeudi suivant, j’allai le revoir, et, sur mes instances, il reprit son histoire.
Je rentrai à Paris, ce grand désert humain… Un soir d’ennui et de pluie, je pris place à la Comédie-Française. On jouait — on le jouait encore, en ce temps-là — Le Roi s’amuse… Au second acte, mon attention se fixa obstinément sur une jeune femme étincelante de beauté et de parure, assise au premier rang d’une loge de balcon… En même temps, j’entendis ces vers, ces vers éternels où passe un si grand frisson d’humanité :
Pourquoi, tandis que ces vers résonnaient en mon cœur comme un chant lointain d’espérance, avais-je remarqué cette femme, entre toutes ? Peut-être existe-t-il dans l’ordre moral, comme dans l’harmonie universelle, une loi d’attraction obscure, encore mal définie. Ce ne fut qu’après quelques minutes d’observation attentive, que ce visage cessa de me paraître étranger et qu’il ressuscita soudain, au plus profond de moi-même, des émotions anciennes, ces impressions d’enfance dont la fraîcheur embaume toute la vie.
Elle n’écoutait pas la pièce, elle semblait distraite, et, de temps à autre, répondait d’une inclination de tête aux saluts qui lui venaient de divers points de la salle. Je ne voyais que son profil, et c’était bien le profil, mais plus grave et plus fier, de ma petite amie d’autrefois, de Lucette Delbray ; et c’était bien aussi et encore, malgré les années écoulées, la couleur de ses cheveux, et ces allures naturelles, comme innées de grande dame, qu’elle avait déjà, à l’âge de douze ans… Et, maintenant, mes souvenirs se précisaient, s’évoquaient, s’enchaînaient, doux, innocents, mélancoliques ; je revivais toute mon enfance sentimentale et choyée, avec un attendrissement qui me mettait le cœur sur les lèvres… jusqu’au jour fatal où, dans un vertige de folie héroïque, je m’étais jeté dans les flammes, pour la sauver !
Dans le coin où je me tenais effacé, elle ne pouvait m’apercevoir. D’ailleurs, ce soir-là, j’avais un masque… Puis, n’étais-je pas méconnaissable !…
Oui, la dernière fois que nous nous étions vus — c’était dans cette demeure des Delbray, où planaient la ruine et le malheur — elle avait rougi, quand je lui avais avoué la cause de mes larmes… Que c’était loin, toutes ces choses !
Ni monsieur ni madame Delbray n’étaient dans la loge. Il n’y avait auprès d’elle qu’un homme, jeune encore, son mari peut-être, qui, au lieu de suivre le spectacle, se penchait vers elle et la contemplait avec le sourire ravi d’un amant récent.
Sans doute avait-elle trouvé réunies, dans sa corbeille de mariage, la richesse et l’amour. Elle rayonnait de beauté et de joie sereine… Et dire que nous avions joué ensemble, si souvent ! qu’elle aimait, autrefois, à caresser mes cheveux, et que sa caresse m’était si douce, si étrangement délicieuse, que je sentais vaguement, dans mon innocence, qu’il y avait là quelque chose de défendu… Comme tout changeait ! Il me semblait que nous avions été, toute la vie, elle et moi, chacun dans un plateau de la balance que tient la justice inique du destin. Mais l’équilibre s’était vite détruit. La fortune, par son jeu de bascule, en m’abaissant dans le gouffre, l’avait élevée dans la splendeur. Maintenant, la distance, entre nous, m’apparaissait incommensurable : elle était l’étoile, j’étais le ver de terre dont parle le poète !
Le rideau tomba. C’était le second entr’acte.
Au foyer, elle passa non loin de moi, au bras de son mari. Un autre couple les aborda, et je surpris ces mots :
— Madame, je vous présente mes respects… Monsieur Derive, que pensez-vous de cette soirée ?
Il se nommait Derive ; elle était donc, aujourd’hui, madame Derive…
— Bien sombre, répondit-il, oui, c’est un drame vraiment trop sombre. J’avoue que je préfère un bon petit vaudeville bien joué. Moi, je vais au théâtre pour rire, non pour pleurer… Nous allons partir.
En effet, ils se retirèrent. Je sortis, derrière eux. Une audace m’était venue, cette audace à la fois timide et brusque de la passion qui tremble jusqu’en ses témérités… Je saurai, pensai-je, où ils habitent, je pourrai la voir encore, peut-être lui parler… Oh ! les peut-être qui ont été les points de suspension de tous mes désirs, de tous mes rêves…!
Ils prirent un fiacre, je montai dans un autre, en ordonnant au cocher de les suivre, à quelque distance, et de s’arrêter, lorsqu’ils s’arrêteraient.
Leur voiture, au grand trot, roula pendant un quart d’heure, précipitant sa course dans la nuit, à travers les rues, les places, les boulevards. Je courais, éperdu, après elle, comme après un fantôme d’espérance, en jetant, de fois à autres, un regard par la portière, pour m’assurer que ce fantôme me précédait toujours, ne s’était pas brusquement évanoui. Où allait-il, où m’entraînait-il ?… Autour de moi, à mesure que je m’éloignais du centre de la ville, la nuit s’épaississait.
Enfin, mon fiacre s’arrêta ; je descendis, je cherchai des yeux… Soudain, le couple se dessina dans le coup de lumière d’un réverbère. Ils sonnèrent à une porte qui s’ouvrit aussitôt, puis se referma sur eux… Où étais-je ? Je ne connaissais pas ce quartier. Je pris l’adresse : 12, avenue de l’Alma. Au second étage de la maison, une fenêtre s’éclaira. Je restai perdu dans la contemplation de cette clarté, comme si le fantôme d’espérance s’était subitement transformé en une apparition lumineuse…
Quelle espérance ? Je ne savais pas… Une consolation plutôt, la pensée que, si jamais je la revoyais, si je pouvais me faire reconnaître, elle ne me repousserait pas, qu’elle se souviendrait de notre enfance et qu’émue d’un malheur si prodigieux, elle deviendrait mon amie.
J’ai vécu des années dans cette attente. La récompense me vint tard de ma longue fidélité à l’espérance… Il y avait, au fond de ce cœur de femme, une charité sublime qui sommeillait dans le calme du bonheur, et qu’il appartenait au malheur seul de réveiller. Car, si le bonheur endort les grandes passions vers le bien et vers le mal, s’il a une bonté molle, s’il nivelle l’âme, le malheur, au contraire, n’est jamais médiocre, et c’est son privilège de faire surgir des profondeurs de la nature humaine tout ce qu’elle contient à la fois de meilleur et de pire…
Vous souvient-il de notre première rencontre dans cette ville d’eaux désolée par les souffles de l’automne ?
— Oui, dis-je.
— Vous souvient-il de cette jeune femme charmante qui jouait dans le parc, avec un bébé, tandis que, près de là, assis sur un banc, un homme, jeune aussi, suivait des yeux avec tendresse la mère et l’enfant ?… Et vous rappelez-vous enfin de leur effroi, quand ils m’aperçurent ?… Vous étiez là, n’est-ce pas ?
— Oui, répondis-je, ayant encore très présente à la mémoire cette scène émouvante que j’ai contée aux premières pages de ce livre. Et je revis le geste de la jeune femme, repoussant une vision d’épouvante, et l’homme qui s’avançait avec colère vers ce malheureux, pour le chasser.
— Cette jeune femme, reprit-il, était madame Derive… C’était Lucette.
Ainsi, la première fois que je lui apparus avec mon masque de hideur, preuve héroïque de mon amour — par quelle atroce ironie ! — cette créature de bonté me fit verser d’affreuses larmes !
Les Derive avaient quitté Paris, le lendemain du jour où je les avais rencontrés au Théâtre-Français, et je les avais retrouvés dans cette ville d’eaux, où l’on se lie facilement. C’est pour elle que j’étais venu là, pensant y découvrir plus aisément qu’ailleurs l’occasion de lui parler — et, le soir même — vous le savez puisque nous fîmes le voyage ensemble — je m’en retournais à Paris !
Un an après seulement, dans un jardin public, le hasard me mit, de nouveau, en sa présence… Elle était là encore avec son enfant et son mari. Celui-ci vint sur moi, menaçant, et m’intima l’ordre de disparaître. Je ne bougeai pas. N’avais-je pas le droit d’être là, comme tout le monde ?
— Monsieur a raison, dit-elle, ce jardin est public, c’est à nous de partir.
Des larmes me brûlaient les yeux. Je savourais ces humiliations, cette torture, sans rien dire. Je ne parvenais même pas à me faire reconnaître d’elle !
Et des années encore s’écoulèrent… Je ne saurais vous raconter toute ma vie ; une existence humaine enferme trop de choses, de drames inachevés, d’efforts avortés, d’événements de toutes sortes, et il est, du reste, des périodes entières qui ne laissent aucune trace dans la mémoire. Tout se confond, s’efface, s’évanouit comme ces vapeurs flottantes que la brise soulève. L’esprit cherche en vain à ressaisir l’enchaînement des faits dont se compose le passé ; et, selon le mot de La Bruyère, on a seulement, comme ceux qui s’éveillent, la sensation d’avoir longtemps dormi.
Ai-je été si malheureux, durant ces années ? Non, grâce au rêve, où je me suis constamment réfugié. Je n’habitais pas dans ma laideur, elle m’était en quelque sorte étrangère. Ma pensée s’envolait vers des espaces radieux ; j’étais dans les étoiles.
J’ai vécu dans une inaction ardente et féconde, où plus de choses me furent révélées, où mon cerveau et mon cœur s’enrichirent davantage que dans les travaux d’une profession quelconque. Car il n’en est pas qui, forcément, ne limite l’horizon de l’homme, ne l’enferme dans l’étroitesse d’une spécialité. Exclu de toute carrière, frappé d’un ostracisme impitoyable, je n’étais tenu à rien, qu’à penser sans cesse, à prêter assez d’intérêt et d’attention au spectacle de la vie pour y trouver ma raison d’être… J’aurais pu, comme tant d’autres, faire des livres. Mais les plus beaux sont ceux qu’on n’écrit pas. N’avoir rien à dire, c’est quelquefois avoir trop à dire.
J’avais aussi des heures mauvaises, ces heures où l’on constate la dérisoire disproportion des rêves avec les réalités, des heures où me reprenait la tristesse des ardeurs réprimées, des passions inassouvies, de toute mon existence d’anachorète, et qui n’avait jamais eu le soutien de la foi religieuse, où le sacrifice même, le renoncement volontaire à l’amour, trouve sa volupté.
Je ne sais pourquoi, cependant l’espérance poussait en moi de profondes racines. Rien ne me faisait prévoir un repentir de la fortune, et il me semblait que j’allais être moins misérable. Je n’apercevais pas l’îlot de félicité ignoré du destin, vers lequel me portaient les vagues, et je me sentais effleuré par le souffle divin qui me venait du rivage.
Un jour, mes pas me ramenèrent devant la demeure des Derive. Au second, un écriteau portait : Appartement à louer… J’interroge le concierge, j’apprends d’étonnantes nouvelles : M. Derive mort ! mort aussi son enfant, le charmant bébé avec qui elle jouait avec tant de grâce ! Tous deux, le père et l’enfant, couchés dans la tombe, à un mois d’intervalle. Et ces choses dataient déjà de plus d’une année… Madame Derive avait déménagé ; elle habitait maintenant aux environs de Paris, à Fontenay-aux-Roses…
Le jour même, je prends le train, j’arrive à Fontenay… C’était un après-midi délicieux de printemps, plein de vives clartés. De la terre montait le parfum des roses et des géraniums. J’éprouvais cette mélancolie qui nous pénètre invinciblement, quand la nature est en désharmonie avec notre âme et nous manifeste sa parfaite indifférence aux joies comme aux douleurs humaines… Je souffrais de la voir malheureuse… et cependant une plus grande espérance me venait de ce malheur.
J’hésitais entre ces deux partis : lui écrire et attendre qu’elle m’invitât à l’aller voir, ou me présenter chez elle simplement. Je résolus de me présenter.
Je ne saurais dire le sentiment qui m’animait. Je ne me haussais pas jusqu’à l’espoir qu’un jour, peut-être, elle en viendrait à m’aimer.
Je rêvais seulement, entre elle et moi, une amitié, une affection de frère et de sœur aînée ; et ce rêve était si beau déjà qu’il me faisait entrevoir un autre univers. Il me semblait que la vie redoublait au fond de mon cœur. C’était, en moi, comme un recommencement, un réveil, une renaissance de l’idéal.
La villa qu’elle habitait dominait le village. Je m’avançai jusqu’à la grille, derrière laquelle s’ouvrait une longue allée, sous d’épais feuillages. Un gardien me déclara que madame Derive avait donné l’ordre de ne recevoir personne.
La même réponse me fut faite, les jours suivants… Lentement, j’errais autour de la villa. Même, il m’arriva de demeurer des heures, à quelque distance de la grille, derrière une haie !
Enfin, un jour, elle m’apparut… J’étais caché… Elle venait vers moi, elle me dépassa sans me voir… Je marchai derrière elle… L’allée était sablée, elle n’entendait pas le bruit de mes pas… Personne autour de nous… Je murmurai :
— Lucette !… Lucette !
Elle se retourna… Je tombai à ses pieds en me cachant la face.
— Qui êtes-vous ? demanda-t-elle.
— Je suis René, dis-je, l’ami de votre enfance, celui qui s’est jeté dans les flammes pour vous sauver… Et maintenant, voyez… Me reconnaissez-vous ?
Je découvris mon visage… Elle était très pâle et gardait le silence… J’ajoutai :
— J’ai su votre malheur et je suis revenu…
Alors, elle se baissa vers moi, elle m’aida à me relever… Et, soudain, je vis ses yeux s’emplir de grosses larmes qui, d’abord, s’arrêtèrent, puis coulèrent, sous son voile noir, le long des joues, jusqu’au pli douloureux des lèvres…
Ici s’arrête mon histoire, celle du moins qu’il me fut permis de vous raconter, car il est des confidences qu’on ne fait pas, des secrets qu’on ne viole pas, des joies intimes qu’on ne saurait révéler sans les amoindrir et sans les ternir. Il doit y avoir en nous comme un sanctuaire impénétrable pour les souvenirs sacrés, ceux qu’il nous suffit d’évoquer pour ne point regretter d’avoir vécu. Et il en est de ces souvenirs comme de ces corps qui se conservent, à travers les temps, dans les tombeaux, et que le moindre souffle de l’extérieur réduirait en poussière.
Je puis dire seulement qu’elle m’a aimé, et il n’y a point là de mystère, il n’y a là que le miracle de la pitié plus haute et plus belle, plus juste aussi que la justice elle-même, qui, elle, ne s’élève jamais jusqu’à l’amour.
Ah ! que le bonheur est doux et puissant, quand on a été malheureux ! Avec quelles mains tremblantes et reconnaissantes on s’y attache ! Avec quelle délicatesse on manie ces félicités fragiles, si vite brisées par les autres hommes ! Ceux-là seuls dont la vie fut pauvre en aventures ont le cœur riche, et il faut sans doute avoir beaucoup souffert pour devenir capable de ces hautes félicités où étincellent les diamants du cœur lentement formés par les feux invisibles de la douleur !
Mon narrateur se tut. Le regard fixe, il se penchait en avant, dans l’attitude de quelqu’un qui écoute, comme si, de nouveau, il avait entendu cette voix lointaine qui l’appelait, là-bas, dans le silence…
Il avait terminé son récit dans cette grande simplicité, qui me laissait un peu surpris. Puis, comme pour distraire son esprit d’une idée fixe, il me parla d’un livre récent qu’il avait lu…
Tandis qu’il parlait encore, je songeais à cette femme qui, de ses mains ardentes, avait rompu la gangue horrible. Quelles expériences lui avaient appris à voir les visages au travers des âmes ?
Le hasard voulut que je l’apprisse plus tard d’une source certaine : madame Derive, après quelques années de mariage, avait été ce qu’on nomme, avec une intention mal déguisée de flétrissure, une femme légère — terme impropre autant qu’injuste, quand il sert à qualifier une de ces âmes intenses qui, prisonnières d’une erreur que la loi conjugale prétend rendre définitive, demeurent assoiffées d’idéal et d’amour sincère jusqu’à vouloir tirer de la boue même la goutte d’eau rafraîchissante…
Mais la souillure n’est ici qu’à la surface ; les pieds trempent dans la fange, l’esprit rayonne plus haut dans l’aurore, et l’idéal enfin saisi excuse le passé, chasse les souvenirs d’erreur et de honte, comme le vent du matin les impuretés de la nuit. Ces pauvres âmes altérées, dès qu’elles ont été touchées par l’amour véritable, dès qu’elles peuvent étancher leur soif ardente, se découvrent avec des fraîcheurs d’innocence qu’on n’eût point soupçonnées. Et c’est la vierge même, en toute la grâce de sa candeur, qui reparaît alors, sous la trompeuse apparence de corruption, et remonte des profondeurs troubles du passé, comme un grand lis pur qui se soulève de l’engrais.
Madame Derive n’en était que plus vénérable, à mes yeux, lavée des souillures anciennes, des passions coupables et décevantes par la magnanimité d’un amour sans exemple, où sa beauté s’unissant à la splendeur morale de cet homme, avait rétabli la suprême et définitive harmonie.
Elle était la gangue, l’enveloppe radieuse ; il était le diamant.
Un matin, au retour d’un voyage de quelques semaines, j’appris qu’il était mort subitement pendant mon absence : mort naturelle, suicide, je ne le sus jamais. Un an après, seulement, en passant sur le pont Caulaincourt, j’observai avec étonnement que la tombe de madame Derive était couverte, comme autrefois, lorsqu’il vivait, de roses rouges, belles créatures, fraîchement épanouies par la rosée…
Qui donc avait apporté ces roses ? J’interrogeai le gardien du cimetière :
— Ça, dit-il, c’est une curieuse histoire. C’est quelqu’un qui venait autrefois ici tous les jours… Je ne sais pas son nom et je n’ai même jamais vu sa figure, car il portait un masque. La dernière fois qu’il est venu, il m’a laissé une somme — et il a été très généreux — pour que j’entretienne cette tombe, tant que je vivrai… Et voilà bien un an qu’il n’a plus reparu.
FIN
ÉMILE COLIN — IMPRIMERIE DE LAGNY