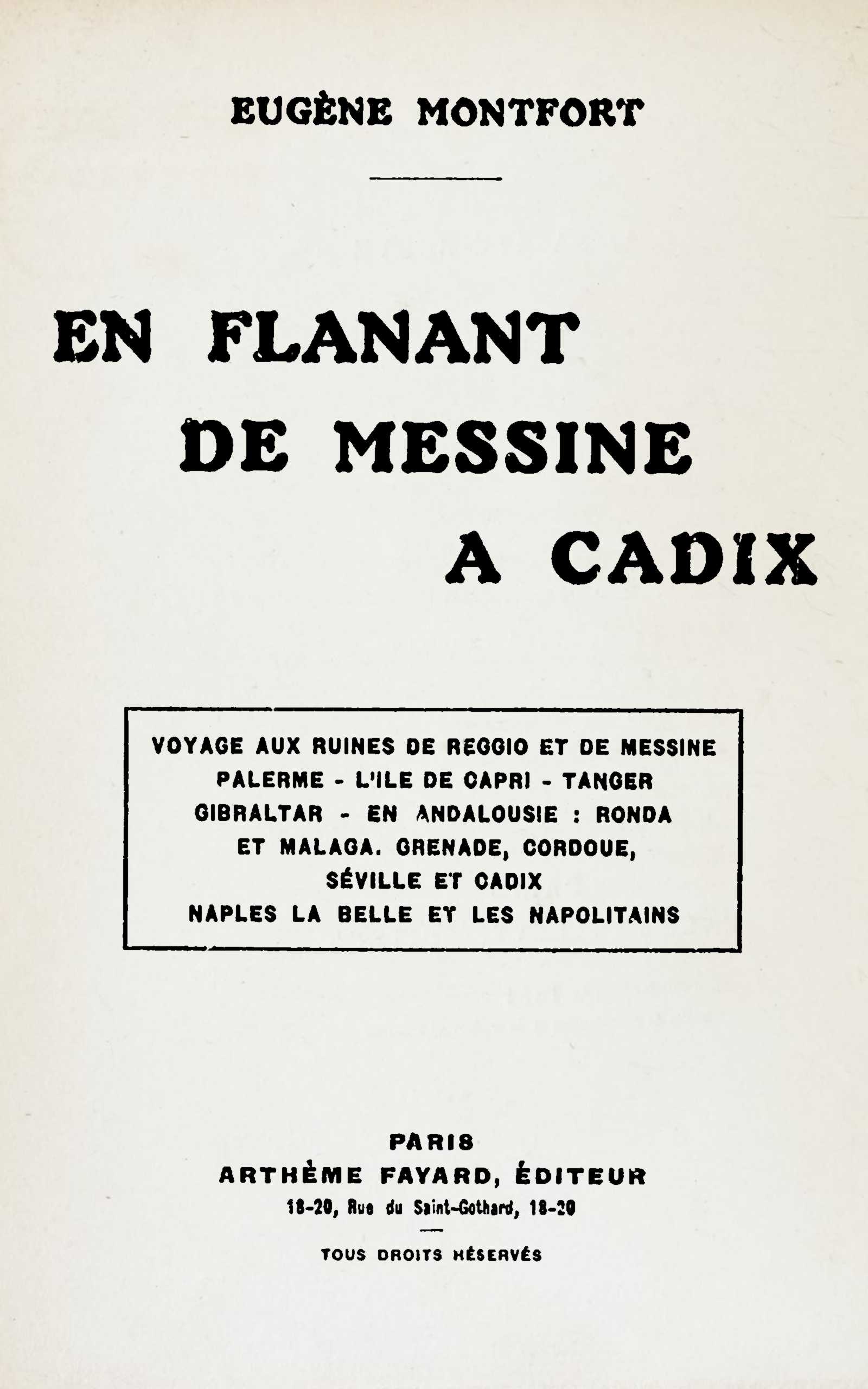
Title: En flânant de Messine à Cadix
Author: Eugène Montfort
Release date: November 20, 2025 [eBook #77275]
Language: French
Original publication: Paris: Arthème Fayard, 1911
Credits: Véronique Le Bris, Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))
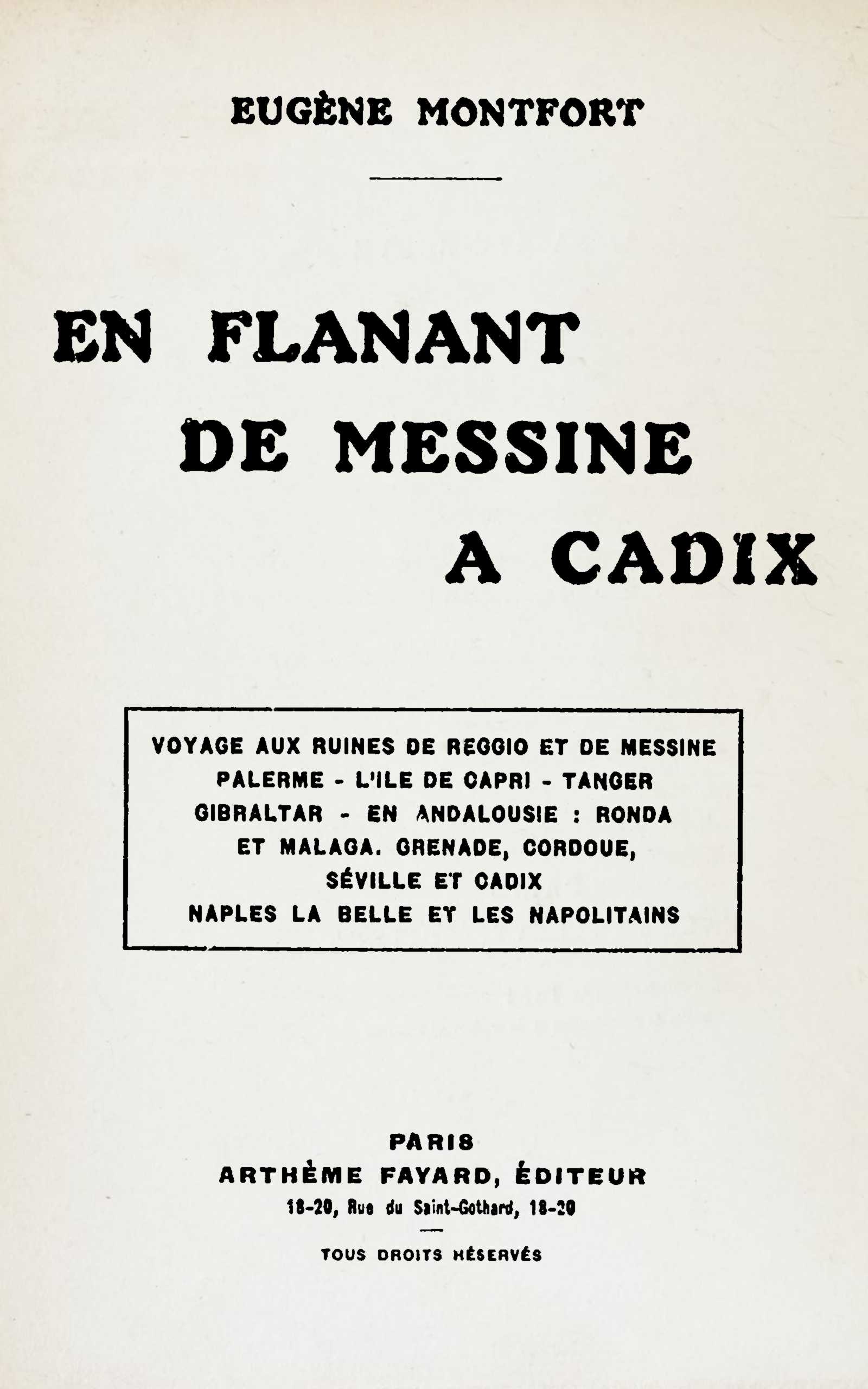
EUGÈNE MONTFORT
VOYAGE AUX RUINES DE REGGIO ET DE MESSINE
PALERME — L’ILE DE CAPRI — TANGER
GIBRALTAR — EN ANDALOUSIE : RONDA
ET MALAGA, GRENADE, CORDOUE,
SÉVILLE ET CADIX
NAPLES LA BELLE ET LES NAPOLITAINS
PARIS
ARTHÈME FAYARD, ÉDITEUR
18-20, Rue du Saint-Gothard, 18-20
TOUS DROITS RÉSERVÉS
DU MÊME AUTEUR
ESSAIS CRITIQUES
POÈMES EN PROSE
ÉTUDES DE MŒURS ET ROMANS
En préparation :
A Albert MARQUET,
à l’Artiste et au Capitaine.
EN FLANANT DE MESSINE A CADIX
Je me rappelle notre tournée à la recherche d’un bateau pour l’Espagne… Depuis longtemps, chaque fois que je quittais Naples, j’avais envie de revenir par mer en côtoyant l’Espagne… Il faisait chaud, ce jour-là, on exécutait de fameux détours pour rester à l’ombre. Quand nous apercevions une hampe de drapeau au-dessus d’une boutique, nous entrions. Nous avions vu des Allemands, des Anglais, des Espagnols et des Italiens ; nous avions monté des étages ; nous en avions descendu ; nous nous étions arrêtés devant plus d’une affiche représentant un magnifique steamer qui franchit les flots. Mais c’est à l’Ost Africa Linie, d’Hambourg, que décidément nous avions trouvé notre affaire. Un bateau surprenant ! Il faisait le tour de l’Afrique, puis, venant de Port-Saïd, il touchait à Naples et, remontant vers son Allemagne natale, passait à Marseille et ensuite à Tanger. A Tanger ! Qui nous eût dit que nous irions jamais à Tanger ! Et à Tanger, on est presque en Espagne, il suffit de franchir le détroit… Avec cela, un prix inouï de bon marché ! Et l’agent de la Compagnie était tout à fait aimable, il ne semblait pas s’amuser beaucoup dans son bureau, aussi quelqu’un arrivait-il pour bavarder un peu, il était enchanté. D’ailleurs le bateau, sans aucun doute, était excellent, puisque c’était celui-là même qui avait porté le Président Roosevelt en Afrique, le vapeur Admiral. Et maintenant, assis dans un cabaret du port, devant de fraîches granite, nous nous exaltions sur le prospectus qu’on nous avait remis. Arrivant de Kilindini, de Tanga, de Zanzibar et de Mozambique, quels passagers ne trouverions-nous pas à bord ! nous voyagerions avec des sultans noirs, sur un navire rempli de singes verts et de gazelles, chargé de noix de coco et d’arachides… Pourvu que nous fassions naufrage ! pourvu qu’il nous arrive beaucoup d’aventures !…
Cependant nous ne partions pas immédiatement pour Tanger. Nous allions d’abord en Sicile. De Naples à la Sicile, la route la plus courte, c’est encore la mer. Mais le chemin de fer, s’il met seize longues heures pour gagner Reggio, traverse les Pouilles et la Calabre. Nous voulions voir la Calabre. Nous réserverions la navigation pour le retour. Ainsi, en revenant à Naples, nous n’aurions qu’à passer d’un vapeur sur un autre, de la Regina Elena, qui fait le service de Sicile, sur l’Admiral, qui nous porterait à Tanger.
J’avais tout disposé pour mon départ. Installé à Naples depuis plusieurs mois — c’était mon quatrième séjour — j’avais pris congé de mes amis. Puis j’avais réglé mon hôtesse. Enfin j’avais expédié mes bagages à Paris. Je ne conservais avec moi que le sac et la valise du nomade. J’étais prêt à errer à travers la vieille Méditerranée.
Je me rappelle mon départ de la maison, le dernier coup d’œil aux jardins d’orangers et à la colline de San Martino, que je voyais de ma fenêtre. Là-dessus, le portier boiteux (que j’avais pris autrefois pour un ancien militaire et qui s’était seulement cassé la jambe en époussetant son escalier) s’était chargé de mes colis, et nous nous étions acheminés vers la piazza Mondragone, car sur la rampe où j’habitais, les voitures ne pouvaient point passer. Une carozzelle sautillante me conduisit à la brasserie, j’avais coutume d’y dîner tous les soirs, parce qu’elle était fraîche et bien située, sous le portique de la Galerie, en face du San Carlo, et que, entre les tables, les passants circulent et vous distraient.
J’avais vécu là de bonnes soirées. Tous les étrangers s’y retrouvent. Quand un bateau arrive, la brasserie regorge de buveurs. Je me rappelais des débarquements d’Allemands, lourds, barbus et blonds, bruyants compagnons, multipliant les prosit en levant leurs chopes, et que les petites Napolitaines venaient regarder avec une surprise moqueuse. Et quand l’escadre américaine avait jeté l’ancre à Naples, on avait vu à la brasserie, pendant trois jours, des gars décolletés, raides et rouges, qui buvaient en silence, endormis par l’ivresse, et qui achetaient au hasard les objets les plus baroques aux petits marchands ambulants. On y rencontrait quelquefois aussi des Français, des couples en voyage de noces, muets, fatigués de leurs excursions et doucement ahuris. Et, à la lumière des globes électriques, sous la haute colonnade où passaient des officiers, des jeunes filles parées pour la promenade du soir, nombre de femmes enceintes, des vendeurs de chansons, un vieux mendiant qui me plaisait et qu’on appelait le Cavalière, un marchand d’allumettes nain et bossu comme un kobold, qui me plaisait aussi, et des ruffians, on dînait assez agréablement.
J’étais arrivé avec mes sacs, qu’un garçon avait porté à l’intérieur de la brasserie, et j’avais rejoint l’ami avec lequel j’allais voyager. Le train ne partait qu’à une heure du matin. Mais comment tuer cette soirée ? Nous étions rassasiés des divertissements de la place du Plébiscite, où le soir jouent deux orchestres, tandis qu’une foule considérable va et vient devant le Palais Royal. L’Eldorado ne nous tentait pas. Le Pausilippe était trop loin… Une glace, au Gambrinus, ne nous prit qu’une petite demi-heure. Certaine vieille que, par fortune, nous rencontrâmes à Chiaia, nous tira enfin d’embarras. Elle nous proposa de nous conduire chez une de ses amies. Celle-ci était une aimable dame romaine en la compagnie de laquelle, au milieu de joyeux contes et propos badins, les heures glissèrent légèrement ; elle accepta de croire que nous étions deux capitaines au long cours, et que notre navire reprenait demain sa route pour Pernambuco. Nous lui offrîmes de l’emmener, mais elle ne pouvait quitter Naples. Elle portait un joli nom. Elle s’appelait Bianca Belfiore…
Partis de Naples dans la nuit, nous roulions, au lever du jour, dans un pays fertile et gai comme les Pyrénées-Orientales. La ligne longeait la mer, qui venait se briser doucement sur une plage de sable, au pied d’une montagne charmante. Nous traversions parfois de belles vallées, au fond desquelles coulaient des rivières poissonneuses, et nous longions des bois de chênes-liège. Rien de romantique, rien de sublime. Rien non plus d’effrayant. La Calabre se présentait à nous comme un pays agréable où l’on peut vivre avec nonchalance. Ce qui seulement est particulier, c’est que ce pays est fort peu peuplé. Des villages rares, des maisons perdues. Les villages ne paraissaient plus italiens, point de maisons peintes, point de pergole, point de terrasses ; des habitations grisâtres, couvertes de tuiles roses ou jaunâtres, et cuites comme en Provence. De temps en temps on apercevait un paysan suivant un sentier, juché sur son âne et, aux stations, des femmes en noir, dont la jupe relevée découvrait un jupon d’un beau rouge, et qui portaient sur leur tête, ornée de la funèbre coiffe en forme d’équerre, de larges paniers. A certain arrêt, vers huit heures du matin, des cuvettes pleines d’eau étant préparées sur le quai, une partie des voyageurs se mit à se débarbouiller. Des paysannes, de la route, tendaient vers nous à travers la barrière des corbeilles de pêches et de figues, et l’on pouvait faire, pour quelques sous, un grand repas de fruits. Puis le train repartit…
La voie suivait la mer sur une ligne tracée dans le roc et qui traversait des tunnels nombreux. Par des échappées, on voyait l’Océan désert. Puis on reprenait la côte, on passait au pied de quelque ville perchée et fortifiée contre les pirates. Nous nous tenions dans le couloir du wagon et nous regardions avec plaisir se succéder les baies, les criques et les promontoires. Le ciel, la mer étaient radieux. Le train ne marchait pas très vite, cependant le courant d’air était assez vif pour que nous ne sentions point la chaleur.
L’après-midi, nous entrâmes dans une contrée sablonneuse un peu ingrate. C’est là que nous commençâmes à songer au tremblement de terre. De temps en temps, on rencontrait des campements de profuges installés sous des tentes ou dans des petites baraques. Au milieu de la solitude, de fragiles villages s’étaient improvisés, où, depuis sept ou huit-mois, vivaient des misérables dont les maisons, ici ou là-bas, en Sicile ou en Calabre, avaient été détruites. Mais rien encore dans ces parages n’indiquait que la terre eût jamais bougé. C’était tantôt des plages et des dunes de sable qui s’étendaient le long de la mer à perte de vue, et tantôt des landes incultes étalées monotonément au pied de la montagne. Les pauvres gens, épouvantés, avaient fui, et ils ne s’étaient arrêtés que très loin, quand, rassurés par l’immobilité, par l’apathie du paysage, ils s’étaient cru tout à fait hors d’atteinte.
Cependant, vers trois ou quatre heures, le train se chargea de nous avertir que nous arrivions dans une contrée fragile. A partir de Bagnara, il ralentit son allure, il se mit à avancer à la vitesse d’un cheval au petit trot, et parfois plus lentement encore. Nous étions penchés aux portières : des deux côtés de la ligne, nous voyions d’énormes blocs de granit qui, détachés de la montagne en bas de laquelle passe la voie, avaient roulé tout près des rails : la terre, là, s’était violemment agitée. Nous procédions avec prudence, soit qu’on ne fût pas sûr encore de la solidité du sous-sol, soit qu’on craignît, en allant plus vite, d’ébranler le terrain, et de faire tomber de là-haut sur le train des morceaux de montagne encore hésitants.
Ces précautions-là étaient assez impressionnantes. On se sentait dans un pays blessé. On avait un peu d’angoisse et de la curiosité. Déjà nous avions aperçu des lézardes sur quelques maisons, et des ruines. Mais c’est en vue de l’antique Scylla que nous commençâmes à comprendre. Une partie de ce bourg s’élève fièrement sur le roc, et il y a une partie basse alentour. Le bas quartier était ravagé, le haut, construit sur un sol plus ferme, n’avait pas souffert… Plus loin, Ferruzzano n’était qu’un amas de ruines, on y remarquait une digue s’avançant dans la mer, dont les larges dalles étaient toutes bousculées, comme si quelque géant, pour s’amuser, avait donné un coup de pied dans ces pierres si bien rangées. Et maintenant cette digue, ce n’était plus qu’une ligne de moellons sens dessus dessous, à demi noyés dans la mer.
C’est par là — nous étions arrivés sur les bords du détroit de Messine — que nous vîmes un petit port rempli de navires chargés de planches, et des planches, partout, en piles sur les quais. Matériaux pour les baraques.
Il faisait un temps délicieux. Le soleil baissait. L’atmosphère était toute blonde. A notre droite, nous contemplions une mer vaporeuse et pleine de paresse qu’arrêtaient des rivages charmants. A gauche l’Aspromonte, d’une couleur et d’un style admirables, offrait au ciel, pour le bonheur de nos yeux, ses mamelons, ses vallées, ses sommets. Nous étions arrivés dans un pays d’une beauté parfaite et qui, tout paré par l’or du soleil, et qui, gracieux et riant, nous faisait l’accueil le plus doux, en nous présentant comme un bouquet ses citronniers au vert feuillage. Et c’est cette terre divine que l’obscure conscience du monde avait voulu frapper !
Deux jeunes gens, une demi-heure avant Reggio, montèrent dans notre compartiment. L’un paraissait très agile, très affairé, il parlait d’abondance. L’autre l’écoutait paisiblement, et faisait de temps à autre une réponse courte. Un esprit échauffé avec une calme intelligence. A les voir, si nous n’avions pas entendu leur conversation, nous eussions cru qu’il s’agissait de quelque détail tragique de la catastrophe, que l’un en était ému, et que l’autre le raisonnait. Mais non, il y a huit mois que le désastre est arrivé ; et c’est d’affaires que les deux jeunes gens parlent. Cette démolition totale, un pays où tout est à refaire, cela a agité tous les entrepreneurs, tous les ingénieurs, tous les gagneurs d’argent de la région. La fièvre de ce petit bavard, nous allions la retrouver souvent par ici. Après la période de désolation où la région de Messine et de Reggio apparaissait seulement comme une victime inouïe, comme une terre de larmes, les jours ont passé, l’impression s’est usée, et maintenant, pour les Siciliens, trafiquants et marchands, cette terre dévastée c’est un Eldorado, un pays où il y a beaucoup d’argent à gagner. Le petit jeune homme parlait avec exaltation de salaires, de hausse, de je ne sais quelles combinaisons. Je l’écoutais, et je distinguais aussi en nos deux compagnons, je ne sais quoi d’un peu factice, d’un peu feint, d’un peu « théâtre », que j’allais retrouver souvent aussi, et qui venait de ceci que ces hommes de race méridionale habitués à l’effet, se sentaient, étant calabrais, étant des victimes de la célèbre catastrophe, des personnages intéressants pour des étrangers, et qu’ils n’en étaient pas fâchés.
Nous approchions de Reggio : les gares maintenant étaient en planches. A Archi-Reggio, quelques kilomètres avant la ville, une cabane de bois était décorée du titre de Sala d’aspetta. Nous arrivâmes enfin à la ville capitale de la Calabre. Comme elle possède trois gares, et que nous ne descendions qu’à la dernière, de notre wagon nous eûmes déjà un aperçu de ce qu’il allait nous être donné de voir. Le chemin de fer suit une large rue, toutes les maisons bordant celle-ci étaient en ruines et abandonnées comme après une guerre. Nous avions le cœur serré : nous entrions dans une cité maudite.
Quand nous fûmes descendus de ce train — nous venions d’y passer dix-sept heures, — nous prîmes pied sur une petite place où un large écriteau recommandant aux voyageurs un albergo barracamento[1], attirait d’abord les regards. Nous avisâmes près de la gare un fiacre, dont l’aspect branlant faisait supposer qu’il avait dû, lui aussi, être retiré des décombres, et nous nous mîmes en marche cahin-caha.
[1] Un hôtel-baraquement.
Nous traversâmes premièrement un camp de soldats assez vaste, puis nous nous trouvâmes dans un chemin inégal, raboteux, couvert d’une poussière épaisse, blanche poudre, chaux de démolition, où les roues enfonçaient profondément. Nous commençâmes à longer des maisons écroulées. Le chemin que nous suivions était situé hors de ville, c’est-à-dire que la ville se trouvait immédiatement à notre gauche, et qu’à droite nous avions tout de suite vue sur la campagne.
Comme il avait fait un beau jour, et que le soleil couchant éclairait le paysage et les édifices abattus, cela n’était point d’une tristesse aiguë : le calme, la large paix qui tombe sur les choses le soir, enlevait à la souffrance sa pointe cruelle et disposait l’esprit à une mélancolie sereine. Les pauvres pierres dispersées, les murs éventrés, le fouillis de poutres et de solives et de plâtras étaient couverts des roses du crépuscule, et la blanchâtre poussière des ruines se dorait. Ce que nous sentons de sublime dans la majesté des grands spectacles de la nature se communiquait à ces pauvres victimes contemporaines, les reculait dans le temps et, devant elles, nous ne trouvions plus en nous que ce que nous y eussions trouvé devant des vestiges d’âges très anciens, lesquels nous enseignent seulement, dans une peine sans âcreté, la fragilité du moment et la vanité de toutes choses. Nous étions enveloppés par la beauté de la journée finissante et par la gloire que le soleil, quand il va s’évanouir, projette sur la terre. Là-bas, la belle montagne était très pure…
Nous voyions maintenant en contre-bas des baraques en bois. Bientôt, après avoir tourné par une rue écroulée, nous nous engageâmes dans une voie de la nouvelle Reggio. Elle était bordée de baraques basses et poursuivait jusqu’à une baraque beaucoup plus grande que les autres, à très longue façade et qui était l’hôtel (l’albergo barracamento). Un suprême cahot, et notre voiture s’immobilisa dans la poussière. Nous descendîmes alors, et nous entrâmes dans un vestibule en bois, où nous demandâmes deux chambres. Par un couloir semblable à ceux des chalets de montagne, on nous conduisit à deux étroites cellules, deux petites boîtes de bois où l’on pourrait nous ranger la nuit. Elles semblaient assez propres, mais étouffantes… Dans cette fragile demeure, chaque pas produisait d’énormes craquements et ébranlait la maison…
Notre toilette faite, il faisait encore jour ; nous sortîmes donc pour voir la ville. Nous gagnâmes une rue haute qui semblait limiter la cité de ce côté-là, et nous essayâmes de nous orienter pour revenir plus tard à l’hôtel sans difficulté. Cette rue, cette route plutôt, dominait un quartier de baraques et nous voyions, au-dessous de nous, celles-ci bien alignées, et toutes pareilles, et posées là sur le sol comme de grands joujoux. Cela faisait une petite ville régulière, telle qu’un plan d’ingénieur, avec des rues droites, exactement parallèles, avec, entre chaque maison, un petit espace, toujours le même, et les quartiers numérotés 1, 2, 3, 4, et les rues désignées par des lettres A, B, C, D, et c’était net, exact, précis comme un schéma… Beau contraste avec la vraie Reggio, la ville morte, où tout, maintenant, n’était plus que fouillis, désordre et chaos.
Nous passâmes devant une église de bois qui ressemblait à un petit temple norvégien. Elle était recouverte de tôle ondulée, et surmontée d’un clocheton du Nord. C’était le seul monument dont la forme ne fût pas réglementaire. Pas loin de là nous rencontrâmes un cinématographe. Nous ne nous y attendions pas. Une église et un cinématographe, aussitôt après la première confusion du désastre, voilà de quoi avait eu besoin la petite colonie qui habitait les baraques.
Nous prîmes un escalier qui descendait vers la ville, et, après avoir traversé encore un quartier de baraques, nous arrivâmes enfin au centre de la dévastation… Pas une maison intacte ! l’enceinte de la cité n’est plus qu’un immense chantier de démolition !… Dans certaines façades, on voit seulement quelques vitres brisées, on pense aussitôt : ah ! celles-ci ont été épargnées ! Non, l’intérieur est ruiné, dedans tout s’est écroulé ! Ailleurs ce sont au contraire les façades qui ont chu, et les chambres apparaissent à l’air avec leurs meubles, leur papier de tenture, au mur un tableau de travers, une bouteille sur la commode : après huit mois, cela est tel qu’au moment où l’aube se leva sur la ville détruite. D’ailleurs, qui donc se risquerait à monter dans cette pièce, là-haut, que nous voyons d’ici ? tout s’écroulerait, cela tient debout par miracle, et puis maintenant où gîte — où gît ? — la famille qui vivait là et qui se souciait des souvenirs que représentent ces choses abandonnées ?… Et ce ne sont que demeures éventrées, balcons arrachés pendant au-dessus de votre tête, pans de murs déchiquetés, décombres… Encore, et encore, toujours et partout. Et tous ces plâtras, cette chose sale et lamentable que figure une maison démolie, et si mélancolique déjà quand elle tombe naturellement sous le pic du démolisseur, devient ici angoissante, affreuse, à cause des cris qui ont été poussés là, à cause de la terreur qui a été éprouvée là, à cause des morts tragiques qui sont advenues là ; tout cela devient épouvantable. Il y a encore des cadavres là-dessous, et dans quelles attitudes ! Et le silence funèbre qui maintenant plane sur toutes ces choses, là où il y avait la rumeur d’une ville ! On est pris de cette stupeur, de cette horreur qui serre la gorge. Je me rappelle ce que j’ai éprouvé jadis devant le champ de bataille de Sedan, et à Bazeilles, à l’ossuaire…
Nous arrivions à la via Garibaldi, l’ancienne grande rue de la cité, dont une partie a été un peu moins éprouvée. On l’a complètement déblayée, on a pu rouvrir quelques boutiques, celle d’une couturière, celle d’un libraire, celle d’un cordonnier, mais personne ne passe, et ces boutiquiers sont là comme des figurants. Il n’y a plus de vie ici. Ils attendent l’avenir, le réveil, maintenant c’est toujours l’engourdissement. L’avenir ! il est difficile de le prédire, car ce sont les siècles qui forment une ville. Comment remplacer tant de familles mortes ou dispersées, tout le cerveau de la cité, tout le cœur de la cité et toutes ses richesses ?
Ce qui est resté ici, le petit peuple, conserve un air étrange, étonné de vivre, étonné d’avoir vu ce qu’il a vu, frappé. S’ils ont échappé à la démence après ce coup à rendre cent fois fou, du moins ne se sont-ils pas retrouvés dans leur âme tels qu’ils étaient avant. On sent bien, en les regardant, que quelque chose d’essentiel en eux est touché, leur terreur a été trop profonde, leur surprise trop forte, leur anxiété trop intense pour que jamais, à aucune minute, ils puissent effacer la marque tracée sur leur cœur. Ils sont à jamais assourdis, découragés. Ils sont d’une nonchalance infinie, agissent mollement et semblent penser que ce sera tellement long, tellement long, et qu’il y a tant et tant à faire que vraiment à quoi bon, à quoi bon même se mettre à l’œuvre ? Remplit-on l’océan en y versant l’eau goutte à goutte ?… Je me les rappelle, à la nuit tombante, qui, immobiles, silencieux, nous regardaient doucement, tristement, tandis que nous avions gravi, pour voir au loin, un monticule formé par des décombres ; c’était une maison étalée en pleine rue, et au sommet de l’éminence, une petite pointe de métal dépassait : le haut d’un réverbère enterré.
Nous continuâmes notre visite, muette et grave dans le jour diminuant, comme à travers un cimetière. Nous repassâmes devant la gare par laquelle nous étions arrivés. Dans les environs, nous notâmes un détail surprenant : au milieu d’une petite place, autour de laquelle les maisons ont toutes été plus ou moins touchées, s’élève une statue de marbre de Garibaldi. Cette statue a été épargnée : elle est intacte, la grille qui l’entoure est indemne ; ainsi, parmi l’énorme frisson de la terre qui a ébranlé les fondements des palais et des cathédrales, qui a renversé les assises les plus robustes, seul, ce petit terrain n’a pas bougé, et dans la ruine générale de la cité, Garibaldi subsiste, blanche effigie du courage et de l’idée italienne contre laquelle il semble que l’esprit du mal n’ait pas osé. Ce singulier ménagement du Destin nous fit rêver…
Cependant, nous nous étions laissé entraîner, et la nuit approchait. Il fallait rentrer à l’hôtel. Nous suivîmes quelque temps la route que la voiture avait prise à notre arrivée. Mais maintenant il ne faisait presque plus clair ; et nous devions nous hâter, si nous ne voulions pas nous trouver au milieu des ruines en pleine obscurité. Il nous sembla que la route de voiture devait faire des détours, nous nous orientâmes, et nous crûmes pouvoir raccourcir en coupant à travers les décombres. Nous marchions vite, aussi vite que les obstacles que nous rencontrions à chaque pas nous le permettaient. Nous étions convaincus que nous filions droit sur l’hôtel. Cependant, après un bon moment de cette marche fiévreuse, nous débouchâmes dans un quartier de baraques que nous ne connaissions pas. Les portes des habitations étaient grandes ouvertes, dans chaque pièce, devant quelque faible lumière, s’agitaient des ombres. J’interrogeai un homme qui se trouvait sur sa porte. Il me regarda sans bienveillance, puis il me répondit d’un ton bourru que l’hôtel ne se trouvait pas du tout par là, que nous en étions fort loin. Il nous indiqua le sens dans lequel nous devions avancer… Nous nous étions perdus… Les gens des cabanes nous regardaient sans mot dire, d’un air hostile. Nous ne retrouvions pas sur leurs visages l’expression que tout à l’heure nous avions remarquée sur d’autres visages. Est-ce la nuit qui, ramenant d’affreux souvenirs, renouvelait leur malheur, et les rendait plus sombres et plus durs ? Ou bien y avait-il à Reggio neuve de mauvais quartiers, des séries de cabanes mal habitées ? Nous ne nous sentions pas en un milieu sûr.
Nous nous hâtâmes dans la direction qui nous était donnée, nous voyions avec inquiétude l’ombre épaissir. Nous traversions maintenant un quartier de ruines ; si nous allions nous perdre définitivement ? Et comment s’y reconnaître maintenant, en pleine nuit, dans cette ville qui n’était plus rien qu’un amas de ruines ? Au milieu de ces murs effondrés, sur cette terre pétrie de cadavres, ah ! quelle nuit nous allions passer ! Heureux encore si quelque misérable, profitant de l’aubaine, ne nous attaque pas, nous, désarmés et harassés par le voyage et le manque de sommeil ! Un pays en plein désordre, bouleversé, sans police, une population exaspérée par le malheur et le dénuement… Plus nous allions et moins nos réflexions nous rassuraient.
Nous eûmes enfin la chance de rencontrer un homme d’assez bonne mine qui précisément rentrait à l’hôtel. Nous le suivîmes. Mais à cet instant, nous comprîmes combien tout le monde, ici, vivait troublé, dans la crainte et dans l’incertitude, chacun pour soi, ne comptant sur personne. Maintenant, notre compagnon se reprochait son imprudence, il nous regardait de côté : il ne nous connaissait pas en somme, qui étions-nous, qu’est-ce que c’était que ces étrangers ? Et nous étions deux. Si nous allions lui faire un mauvais parti au milieu de ce désert de ruines ? Il ne parut à l’aise que lorsque, en haut du chemin, la basse silhouette de l’auberge apparut.
… Enfin nous voici à table, devant une nappe blanche. Nous rentrons dans une existence civilisée… Il y a cependant quelque chose de singulier dans cette salle à manger. Elle est éclairée à l’électricité, c’est vrai, mais comme elle sent le provisoire ! C’est une sorte de grand hangar en bois, une vaste pièce, mais fragile et sans confort, et qui fait songer vaguement à ces salles de bal des restaurateurs de banlieue parisienne. C’est très rustique, et là encore on sent le campement, la demi-installation, l’attente… Et que ce public est intéressant aussi ! Pas une seule femme, rien que des hommes ; point de voyageurs et peu de fonctionnaires ; mais des gens qu’on sent ici, dans ce pays, comme à leur bureau, à leurs affaires. A la ville, les affaires vous forcent à déjeuner hors de chez vous ; elles les obligent, eux, à s’installer au dehors, très loin. La famille est ailleurs, à Rome, à Naples, à Palerme. Ils n’ont pas ici leur vraie vie. Ils sont ici pour gagner de l’argent. Ils mènent provisoirement une existence qui tient à la fois de celle du colon, de celle de l’ingénieur et de celle du marchand. Ils se retrouvent à table, tables de quatre, de cinq. Ils se parlent, parce qu’il faut bien parler, mais avec l’ennui évident de ressasser tous les jours les mêmes choses aux mêmes interlocuteurs. C’est l’exil pour le gain, c’est la corvée. On a éprouvé de la fièvre au début, quand il s’agissait de trouver ce qu’il y avait à faire. Maintenant c’est l’exécution fastidieuse. Ils se sentent loin, plus loin de chez eux, et plus anormalement que s’ils étaient en Amérique. Ils ont émigré parce que la Calabre, la Sicile, Reggio, Messine, c’est maintenant un pays neuf, c’est une contrée où l’on peut émigrer, mais ils ont émigré dans un endroit ennuyeux, morne, sans distractions. Et nous, nous avons maintenant la sensation d’être au diable. Tout ce que nous avons vu était si étrange, et le milieu où nous voilà à présent, les choses qui nous entourent sont tellement singulières, nous ne sommes plus en Europe, nous sommes quelque part aux colonies, dans une contrée à défricher, dans un pays à faire !…
Après le dîner, chacun rentra dans sa caisse. Entre mes quatre cloisons de bois, je me couchai dans mon petit lit. Je craignais d’avoir trop chaud. Heureusement en cette contrée, comme à Naples, les nuits sont fraîches. Je laissai ouverte la fenêtre, étroite comme une lucarne, qui aérait ma chambre, et je ne fus point incommodé. Cependant, malgré ma lassitude, je ne m’endormis pas tout de suite. J’avais la tête échauffée par ce que j’avais éprouvé et j’y songeais malgré moi…
Je n’imaginais pas ce désastre. Toute une cité anéantie, rasée ! Revivrait-elle jamais ? Tout est mort ou s’est enfui. Ce qui reste, vivant maintenant dans les baraques, c’est le peuple. Le peuple peut bien constituer un village, mais une ville ? Pour une ville, il faut une réunion de familles dont chacune ait son histoire, ses souvenirs, ses traditions. Or, de pareilles familles, le peu qui en survivait ici est dispersé maintenant aux quatre coins du monde. Et quand on dit : ce qui en survivait, — rien n’en survit, puisque l’état civil même a disparu. Les parentés sont abolies, le réseau intime de la ville est déchiré.
Ceux qui sont partis ne reviendront pas. On revient dans sa ville natale pour y retrouver des amis de sa jeunesse, pour voir sortir de terre, à chaque pas, ses souvenirs d’enfance. Ici plus de souvenirs, plus d’amis. Reggio sera une cité neuve où l’on ne rejoindra rien du passé, où tout vous sera lointain, où vous serez un étranger. Il faut se faire ailleurs une patrie. Et si, plus tard, l’on voit ici une cité du nom de Reggio, elle pourrait aussi bien porter un autre nom, puisque la chaîne des siècles est rompue, que le présent n’y sera pas rattaché au passé et qu’un cœur, une pensée et des mœurs nouvelles s’y seront, avec des habitants nouveaux, installés.
Tandis que je songeais, des gens qui rentraient se coucher passaient dans le couloir, et le bruit de leurs pas retentissait dans toute cette maison de bois. J’entendais mon voisin tourner dans sa cellule en se déshabillant. Mais les bruits du dehors devinrent plus rares, ma pensée s’engourdit, je ne perçus plus rien, je m’endormis.
Le matin était délicieux. Nous nous étions levés de bonne heure pour prendre le bateau de Messine. Une voiture attendait à la porte. Le patron de l’hôtel, qui avait affaire à l’embarcadère, monta sur le siège, près du cocher, on chargea nos sacs et nous partîmes. Dans l’allégresse des premières heures du jour, par le beau soleil et sous l’azur du ciel, tout avait changé d’accent. Et il n’y avait plus de place, en notre cœur reposé par une nuit paisible, que pour la confiance et l’espoir. Les gens, qui passaient à âne à travers les sentes poussiéreuses de la cité démolie, nous semblaient partager nos sentiments. Nous nous étonnions et nous nous rassurions en voyant, à la porte de quelque logis étayé par des poutres, des ménagères marchander, comme partout, courges et poivrons devant un petit charreton chargé de légumes aux somptueuses couleurs. C’était dimanche, tout s’agitait matinalement, tout semblait renaître. Nous oubliions l’horreur des maisons en ruines qui nous entouraient.
Je demandai au patron de l’albergo, qui, sur le siège, à demi tourné vers nous, nous faisait la conversation, s’il ne comptait pas bientôt reconstruire son hôtel, non plus en planches, en pierres. Mais sa réponse calma tout de suite l’optimisme auquel le mouvement que je voyais dans ce beau jour d’été m’avait vite porté. Il hocha la tête, il haussa les épaules, et avec un accent lassé, découragé, il dit : « Il faut attendre, il faut attendre. Il faut voir ce que tout cela deviendra… » Il me montrait maintenant une ruine devant laquelle nous passions. « Tenez, là, ça, c’était mon hôtel… Il y a eu trois voyageurs tués et j’ai perdu deux personnes de ma famille. Moi je me suis sauvé en me mettant sous l’encadrement d’une porte. » Et il m’expliqua comment on doit s’y prendre dans un tremblement de terre. Généralement il se produit plusieurs secousses, si l’on est averti par la première, il faut aussitôt se placer sous une porte. Les portes, en effet, sont pratiquées dans les murs ; or, quand la maison est solide, les murs restent debout, ce qui tombe c’est le parquet, les plafonds ; les chambres situées au-dessus de la vôtre sont donc précipitées, elles passent devant vous et vont s’écraser sur le sol ; avez-vous eu la chance de n’être pas atteint par les matériaux, ni enfermé par l’éboulement, vous êtes sauvé…
J’écoutais mon compagnon et j’éprouvais une sensation singulière. Ainsi, dans ce pays, on était accoutumé aux catastrophes au point qu’on s’y attendait toujours, qu’on avait des recettes pour y échapper et que d’avance on savait ce qu’on ferait quand le jour sans cesse redouté se lèverait. Il me désignait à présent des ruines dont il me disait : « Celles-là ne sont pas de cette fois-ci, elles datent d’une autre, il y a trente ans. » Et j’admirais, j’admirais cette race aventureuse et fataliste, qui sait que le destin la guette ici et qui demeure, qui espère toujours échapper, compte sur la chance, joue sa vie, et reste là, et reconstruit là, parce qu’elle est indolente et insouciante, et qu’elle aime la beauté. Vivre peu, mais vivre sur cette terre qui est la plus belle du monde ! Je songeais aux habitants des villages vésuviens qui, après chaque éruption, reviennent et reconstruisent leurs villages. Et j’admirais et j’aimais ces Italiens, artistes et enfants, de l’Italie méridionale.
J’avais une autre impression, laquelle m’étreignait maintenant le cœur. Les propos de l’hôtelier m’avaient rendu le désastre vivant. J’entendais le tonnerre formidable de la ville croulant. J’éprouvais l’affolement de ceux qui s’étaient réveillés subitement dans la nuit, et puis qui, parvenus miraculeusement à se sauver, et ayant songé naturellement à quelque catastrophe particulière, à leur maison, ou à deux, à trois maisons frappées, se trouvaient dehors, et dans le petit jour, voyaient avec une surprise, avec un effroi inouï, que la ville, toute la ville était anéantie !… A moitié nus, hagards, en larmes, je me les représentais, errant dans les décombres au milieu de cette vision incroyable, et je me demandais comment leur raison avait pu résister à un pareil ébranlement.
Comme pour me distraire des images épouvantables que je regardais en moi, notre compagnon me signala, à ce moment, des cabanes d’un aspect moins frais et moins régulier que celles de la nouvelle Reggio. C’était les premières baraques élevées après la catastrophe, avec du bois et des matériaux de fortune, par la troupe. Près de là se trouvait l’embarcadère de Messine, on délivrait les billets pour le bateau à un guichet très élevé, et l’on devait monter sur une grosse pierre pour parler à l’employé. Autour de la grosse pierre, une foule se pressait et chacun, l’un après l’autre, grimpait en se poussant. Pendant que j’attendais mon tour au milieu de tout ce monde qui parlait sicilien, tout à coup je fus stupéfait d’entendre un caporal d’infanterie s’écrier en français, avec l’accent parisien, en s’adressant à un homme qui passait : « Comment ça va, ma vieille ? ça boulotte ? » Ce petit Parisien, sous cet uniforme italien, et si loin, et dans ce pays ! Qu’est-ce que cela signifiait ?…
Maintenant nous attendions sur un corps mort auquel étaient amarrés deux vapeurs : le transport de Messine et un autre navire qui venait de Naples, et qui était chargé principalement d’une cargaison de portes en bois blanc, tout montées sur leur châssis, et destinées aux baraques en construction.
Nous attendions qu’on pût passer sur le bateau, que l’équipage était en train de laver… Il faisait un soleil éclatant, mais qui ne brûlait pas, à cause de l’air léger errant dans le détroit. C’était un glorieux dimanche, un matin d’or et d’azur… Enfin à bord, nous nous étions installés à l’ombre. Le bateau avait démarré. Et maintenant accoudés au bordage, nous regardions ce détroit de Messine, si merveilleux, nous avait-on dit, qu’il efface tous les souvenirs… Ah ! nous jouions de malheur ! Le paysage, ce matin-là, se défendait. La brume des jours d’été cachait les montagnes de Sicile. Elle diminuait la grandeur du paysage, rapetissant le canal et supprimant dans le lointain et la mer d’Ionie et la mer Tyrrhénienne… Je me retournai du côté du pont et j’aperçus, non loin de moi, le caporal qui m’avait intrigué tout à l’heure. Je le joignis, remarquant qu’il me voyait approcher avec satisfaction. Il était évidemment flatté de la curiosité qu’il avait éveillée. A mes questions, il répondit avec complaisance qu’il était né dans la Suisse italienne, mais il avait été élevé à Genève, et puis il était venu travailler à Paris. Quand il avait été appelé pour son service militaire, il ne savait pas un mot d’italien, il avait appris la langue au régiment. Nous parlions maintenant du désastre, mais je voyais qu’il ne pouvait rien dire d’intéressant. Il avait été là avec sa compagnie depuis le commencement, mais il n’avait point senti, il était trop occupé à faire le Parisien, le crâneur, celui que rien n’épate… Il n’était bon qu’à répéter ce qu’on disait autour de lui, et j’eus du moins par ses propos l’idée des légendes qui couraient. Il me répéta, par exemple, que si Messine était toujours dans le même état, c’était bien la faute au gouvernement : une compagnie française, en effet, s’était engagée à tout déblayer, et en très peu de temps, à condition qu’on lui donnât ce qu’elle trouverait dans les décombres ; le gouvernement avait refusé… il me débitait cette histoire avec conviction. Un homme à grandes bottes qui l’accompagnait l’interrompit : « Ça a tout de même bien changé… Rappelle-toi, autrefois, par où qu’il fallait passer pour arriver au camp américain… Et puis on pouvait toujours attraper un coup de fusil. » Les bottes du camarade, ce camp américain, tout ce que j’avais déjà vu hier, cette existence de hors la loi, loin du monde civilisé, cette vie de trappeur, cela m’attirait et me passionnait comme un enfant…
Cependant nous étions maintenant au milieu du détroit. Je commençais à voir Messine. A cette distance, on ne s’apercevait pas de la destruction. Comme des façades, des pans de murs sont restés debout (de loin on ne distingue pas les détails), on ne voit que les taches roses et jaunes des maisons adossées à la montagne, on ne se rend pas compte des monceaux de ruines qui s’étalent entre elles : qui pourrait croire, dans la paix, dans la douceur, dans le bercement de ce lac, à ce bouleversement effroyable ? Nulle part moins qu’ici on n’imagine la nature farouche et cruelle. Et l’idée de la catastrophe, là, devient un paradoxe absurde, une abominable plaisanterie. Mais le bateau se rapproche de plus en plus de la côte, et l’on commence à noter certaines petites choses inquiétantes. C’est une grande ligne brisée, noire, qui, du haut en bas, sillonne une maison et qui a l’air d’une lézarde ; c’est un vaste espace qu’on s’étonne de ne pas trouver meublé par des monuments et, en regardant mieux, on y distingue un amas blanchâtre et grisâtre qui ressemble à des décombres. Et puis l’on approche encore, et tous les doutes, hélas ! s’évanouissent. On voit la ville telle qu’elle est, blessée, frappée à mort. Alors je ne puis dire quelle consternation, quelle douleur, et quelle sombre rage contre le destin stupide vous soulèvent ! On regarde cet affreux spectacle avec une sorte d’égarement…
On ne peut imaginer le charme de Messine. C’était un lieu élu. La montagne, au pied de laquelle la ville s’élève, est aimable, elle s’annonce par de petits monts en avant-garde, détachés les uns des autres, d’une forme pure, comme on en voit en Lombardie et dans les tableaux des Primitifs. Au pied de cette belle montagne, facile, accueillante et sans âpreté, la cité s’étendait sur la rive de la mer, bien construite, claire, indolente, à l’abri dans le détroit, et comme au bord d’un lac paisible. Le port était charmant : le quai se développait en demi-cercle devant une grande ligne de palais du dix-huitième siècle ; leur solennité, unie à la grâce de la ville et du paysage, donnait à l’accueil de ce port un ton qui ne ressemblait à aucun autre. Les navires venaient s’amarrer devant les palais, et les nobles colonnes de marbre souhaitaient la bienvenue aux mâts dressés vers le ciel. Cet aspect de la Palazzata, unique, il sera cependant loisible de le conserver dans la reconstruction de Messine, les façades des palais ayant subsisté ; celles qui ne seraient pas assez solides pour demeurer, on pourra les reproduire telles exactement qu’elles étaient… Consolation dans la tristesse qui saisit en face de l’assassinat de cette ville, la même tristesse que devant le cadavre d’une jeune fille parée de toutes les grâces, et pourtant morte, sur laquelle on pouvait fonder tous les espoirs, devant qui une vie délicieuse s’ouvrait, et morte, morte !
En descendant du bateau, nous louâmes un jeune garçon qui porta nos sacs à la consigne.
Nous n’avions pas eu le temps de manger, à Reggio ; nous nous arrêtâmes donc au buffet de la gare pour prendre un café au lait. Au moment de payer, le garçon nous demanda un prix qui ne concordait pas avec celui du tarif affiché ; je le lui fis remarquer. Alors, lui, une grimace, un grand soupir : « Prima il disastro… (avant le désastre) signore » répondit-il. Le mensonge était évident. J’ajoutai pourtant un pourboire au prix « d’après le désastre », la comédie de l’avisé Sicilien m’avait plu.
A la sortie de la gare, nous avançâmes droit devant nous. La rue, où nous nous étions engagés, était en ruines, les maisons formaient des amas de décombres ; un peu plus loin, les façades seulement s’étaient écroulées, et l’on voyait l’intérieur délabré des appartements. L’impression cependant n’était pas la même qu’à Reggio. La rue large, les constructions restées debout très hautes : nous nous sentions dans une grande ville ; la surprise, l’horreur étaient encore plus fortes que de l’autre côté du détroit, parce que la catastrophe était encore plus formidable.
Au milieu de cette nécropole, nous tombâmes, au moment où nous nous y attendions le moins, sur une voie animée qui nous parut extraordinaire. C’était la grande rue de la nouvelle Messine. Une chaussée poussiéreuse et creusée d’ornières, bordée par deux lignes de baraques et de petits chalets, où étaient établis des marchands : bouchers, épiciers, fruitiers. Ce n’était plus une série ennuyeuse de cases régulières, toutes pareilles, allée administrative et morne, mais là chacun avait élevé la construction qu’il préférait ; il y avait des arbres, et, dans ce gai dimanche, avec la foule qui se pressait, les ânes qui trottaient, les paysans, les femmes, les marchandages, les appels, cela prenait un air de fête et de kermesse. On eût dit d’un petit village d’été, d’une rue fragile et provisoire de station balnéaire.
Au bas de cette voie, dans un grand baraquement de planches mal rabotées, construit à la hâte pendant les premiers jours, était installée la poste. Nous n’y stationnâmes guère, car nous étions pressés de visiter les ruines de la ville. Nous passâmes donc aussitôt sur la Palazzata, le quai bordé de palais que nous avions vu du bateau. Nous marchions à l’ombre, le long des maisons. La plupart de ces beaux édifices s’étaient écroulés dans leur partie supérieure : ce n’était que colonnes tronquées, que balcons brisés. Mais le bas des maisons avait généralement peu souffert, les grandes portes arquées, livrant passage aux rues perpendiculaires à la Palazzata, étaient intactes ; cependant ces rues n’existaient plus, elles étaient comblées par des démolitions. Les boutiques du rez-de-chaussée étaient closes de volets, telles encore qu’au moment où la catastrophe les avait surprises, pendant la nuit, dans leur sommeil ; aux premiers étages, on voyait des fenêtres qui paraissaient avoir été préservées, mais en prenant du recul sur le quai, on s’apercevait que ces fenêtres, de l’autre côté, donnaient sur le vide, et que, derrière ces belles façades, rien des maisons ne subsistait, que tout s’était effondré… Les larges dalles du quai étaient descellées, les unes enfoncées dans le sol, les autres au contraire projetées. Le long du bassin, la bordure du quai s’était affaissée, l’eau l’avait envahie, et les escaliers de pierre qui descendaient à la mer étaient détruits, les larges blocs de marbre qui formaient les marches, soulevés, brisés, dispersés. Parmi toute cette dévastation, seule, une statue de Neptune, dressée en face du détroit, avait été épargnée, et le dieu au trident, debout, immobile et surhumain, avait considéré avec impassibilité l’accès de fureur subite de la nature.
Nous voulûmes voir l’intérieur de la ville. Nous nous y aventurâmes par une de ces hautes portes pratiquées dans la Palazzata, et où aboutissaient autrefois les rues qui descendaient au port. La porte était obstruée jusqu’à mi-hauteur : nous grimpâmes sur une montagne de décombres, et nous dépassâmes, dans quelque chose qui avait été une rue, quelque chose qui avait été une maison. C’était une muraille percée de fenêtres, le soleil brillait dans les carreaux intacts. Cela ressemblait à un décor de théâtre. Une mince façade suffisait à indiquer et à évoquer toute une demeure… Quand nous fûmes en haut du monticule, nous redescendîmes de l’autre côté, nous nous trouvâmes alors dans une sorte de sente qu’avait tracée le pied des Messinois à travers les maisons écroulées. Cette sente, très irrégulière, montait ou dévalait, suivant que l’amas de débris, formé par les constructions en s’effondrant, était plus ou moins élevé ; elle faisait des détours pour éviter tantôt des trous et tantôt des talus, et c’était comme un chemin de montagne. De l’endroit où nous étions arrivés, nous découvrions une église dont la façade était écornée, écorchée, griffée : la muraille latérale, horriblement crevée, laissait voir l’intérieur, encombré d’un fouillis de plâtras, de statues, de moellons, de croix et de vitraux brisés. Le sol, sur lequel nous nous tenions, était composé d’un mélange sans nom : grilles tordues, fragments de balcons, morceaux de lits, toute une ferraille mêlée à des poutres et à des solives, à des restes de charpentes, à des portes arrachées, à des coffres défoncés, à des chaises sans pieds, à des débris de vases, à des bouts d’étoffes, à des cercles de tonneaux, et confondue dans une poussière grise avec des éclats de maçonnerie, des briques, des tuiles, du plâtre et du ciment. A côté de nous, un grand trou était ouvert au fond duquel avaient roulé un piano et un fauteuil. En face, une haute ruine, une maison dont il n’était demeuré, dans chaque appartement, que la pièce du centre, — le reste était éboulé — au sommet, sur la terrasse, un palmier continuait à croître, et des plantes grimpantes s’enlaçaient capricieusement au grillage d’une volière, au-dessus des chambres béantes comme des cavernes…
Nous avions emporté un plan de l’ancienne Messine, et nous essayions de nous orienter. Nous sûmes ainsi que les décombres sur lesquels nous nous trouvions, étaient ceux de la via Garibaldi, la principale rue de la ville. En continuant à suivre la sente, nous passerions devant le Municipe et devant le Théâtre. Nous marchions avec précaution, redoutant les éboulements, et nous nous arrêtions de temps à autre, devant des détails plus saisissants : un lit tout en haut d’une maison, suspendu au-dessus du vide, gardant l’équilibre par miracle, et garni encore, tel qu’en la nuit terrible, de son matelas, de ses draps, de son oreiller, de sa couverture ; les poutres hérissées du faîtage d’une bâtisse, qui se profilaient rageusement sur le ciel ; une armoire grande ouverte, à un troisième étage, et où apparaissaient, bien rangées, des jarres d’huile, des fiasques et des bouteilles… Je me rappelle l’impression accablante de toutes ces maisons ruinées, immobiles sous le soleil, et ce silence et cette solitude… Toute vie avait disparu. Nous n’avions rencontré que trois hommes, en deuil, et suivant tous les trois la sente en file indienne.
Nous parvînmes à la place du Municipe, dont les abords, par une bizarrerie du hasard, ont été presque respectés. Là, les décombres prenaient fin, et les maisons avoisinantes s’élevaient intactes devant une chaussée bien dallée, bien conservée. Sans doute, ç’avait été là le point médian, le point mort du tremblement de terre, le centre immobile du balancement.
Au milieu de la place, qui avait conservé son ordonnance et qui apparaissait agréable et bien proportionnée, sur le terre-plein du milieu, s’élevait à présent une tente entourée de vieux tonneaux. Une famille campait là. La grande place de Messine appartenait maintenant à deux hommes qui fumaient tranquillement leur pipe, assis à l’ombre sur des caisses, tandis que leur fricot cuisait sur un petit fourneau… Et plus loin, nous allions voir d’autres misérables dont le désastre avait probablement amélioré la condition : un jardin de la ville est devenu comme une sorte de village, lequel, par le beau matin d’été où nous le visitâmes, dans la fraîcheur des arbres, nous parut attirant : certainement les gens qui vivaient là y étaient plus à l’aise que dans les taudis qu’ils devaient habiter avant le désastre. Il est vrai qu’ils regrettaient peut-être leurs taudis…
En nous éloignant de la place du Municipe, nous reprîmes notre marche à travers la montagne de ruines et nous arrivâmes bientôt à la place du Théâtre. Autre monument conservé. Mais celui-ci — le seul de Messine — entièrement : l’intérieur et la façade. Même le fronton, sur lequel se voyait un groupe de trois personnages de marbre, est intact ! Singulière prédilection du monstre pour les arts ! Parmi toutes les églises, il a respecté seulement le temple de la Comédie, — et qu’il a épargné de statues !… Ce qui faisait dire au peintre, mon compagnon, que le bon Dieu décidément aimait la sculpture. La préservation du théâtre est frappante, car tout, alentour, est tombé.
Ce Théâtre nous rappela une affiche que nous avions lue tout à l’heure sur les murs : le 20 janvier, au Café du Théâtre, arrivage de vêtements de sport. Affiche qui avait fait revivre pour notre imagination les jours qui suivirent le désastre. Veuillez songer que de Messine, une ville plus importante que Rouen, presqu’aussi considérable que Lille, rien n’avait été sauvé. Rien est le terme exact. Le stock énorme de marchandises de toute espèce qu’une aussi grande cité contient était perdu tout entier : dans Messine abattue, il eût été impossible de trouver un mouchoir ! Les magasins étaient ensevelis sous les décombres, plus rien des premières denrées nécessaires à la vie, il y fallait mourir de faim, de froid et de soif, les fontaines étaient ruinées, les conduites enfouies, on n’aurait pas pour une fortune bu un verre d’eau… Il est passionnant d’imaginer ce que fut alors l’existence des voleurs, qui, pour faire du butin, au milieu de la fuite générale, étaient restés dans la ville détruite. Comment ont-ils vécu dans ce désert de ruines et de cadavres ? D’abord, il fallait qu’ils se cachassent pour échapper aux soldats qui les poursuivaient : trouver quelque tanière, un trou, dans les décombres on le pouvait. Mais manger, mais boire !… Parmi ce chaos inimaginable, on devait avoir repéré la place d’un magasin d’aliments, et creuser, et fouiller longtemps pour arriver à trouver un pain dur ou des fruits gâtés. A moins d’avoir la chance de rencontrer par hasard, au milieu de périlleuses et profitables explorations parmi les murs branlants, un garde-manger, une bouteille. Pour boire, il fallait déterrer un tuyau d’eau et le crever… Et poursuivre cette vie sous le regard fixe des morts, en suant de peur, en entendant de temps en temps, dans ce silence terrible, le coup de fusil d’un soldat abattant quelque autre loup humain !
Cependant, après les premiers jours de panique, après l’affolement du début, beaucoup de Messinois revinrent à Messine, soit pour retrouver les leurs, soit pour essayer d’arracher aux ruines de leurs maisons une partie de ce qu’ils possédaient. Alors il y eut un premier embryon de vie sociale. Cette population avait un besoin absolu de certaines denrées. Des commerçants les faisaient venir, ils en annonçaient l’arrivée par voie d’affiches… A tout cela nous avait fait songer l’affiche que nous avions vue… Puis la ville morte, pauvre et dépouillée comme un homme nu, se réveillait peu à peu, se montait petit à petit. De la nourriture, des chandelles, des vêtements, — puis des maisons. Et l’on avait commencé à construire, comme à Reggio, une ville de bois.
Pour le déblaiement de la cité en ruines, huit mois après la catastrophe, il ne nous semblait pas qu’on eût rien fait. Nous rencontrions bien, de loin en loin, une petite ligne de rails et un wagonnet, mais comment prendre au sérieux un moyen pareil pour débarrasser un sol couvert d’énormes ruines sur une pareille superficie ? Il y faudrait alors des centaines d’années. Il est vrai que le travail apparaît si formidable qu’on peut bien se sentir découragé au moment de l’entreprendre. Peut-être est-ce là le sentiment de l’État italien ; à moins toutefois qu’il ne préfère ne commencer le déblaiement qu’en hiver, de crainte d’une épidémie possible l’été, après la mise au jour de si nombreux cadavres. Le labeur, en tous cas, semble prodigieux, et, sans doute, quand on aura enfin déblayé l’ancienne Messine, une Messine nouvelle sera-t-elle déjà construite à côté, à la place occupée maintenant par les baraquements.
Pour donner une idée de l’état primitif dans lequel nous avons trouvé les ruines de Messine, voici un petit fait : En quittant les maisons écroulées qui bordaient autrefois la via Garibaldi, nous nous rapprochâmes du port, toujours suivant la crête des collines de décombres. A un certain moment, nous trouvâmes un rassemblement : quelques enfants, des petites filles et des petits garçons qui portaient des cruches. Sans doute, à proximité, plusieurs familles campaient-elles ; on envoyait les enfants faire de l’eau. Nous nous approchâmes et nous vîmes, en guise de fontaine, un simple tuyau qu’on avait déterré du fouillis des ruines et coupé ; il n’y avait aucun robinet ; l’eau en jaillissait avec abondance et continuellement. Deux soldats gardaient cette fontaine rudimentaire.
Les enfants étaient gais, ils gaminaient. Ceux d’en haut se battaient à coup de pierres avec ceux qui se trouvaient en bas des ruines, et en les voyant, je compris qu’eux, du moins, n’avaient pas dû souffrir du désastre. Après la première terreur physique, les enfants, dans le changement imprévu de toutes choses, et dans ce milieu nouveau, avaient trouvé de quoi inventer cent nouveaux jeux. Ils s’étaient amusés de tout, de l’installation sous des tentes, puis dans des baraques, et cette nouvelle vie, à la bohémienne, les avaient certainement enchantés.
En poursuivant vers la Palazzata, nous remarquâmes au milieu des ruines, une maison neuve. Elle était claire, peinte en rose, et produisait un étrange effet au milieu de toutes ces constructions écroulées. De loin, en la voyant si fraîche, j’eus l’idée qu’elle avait été construite depuis le tremblement de terre… Mais c’était trop invraisemblable, qui donc eût pu avoir la pensée d’élever un édifice nouveau au milieu de ce quartier dévasté ? En nous approchant, nous vîmes en effet qu’elle aussi avait été frappée, et qu’elle était antérieure à la catastrophe. Une lézarde, d’une ligne effrayante comme un éclair, la marquait du haut en bas. Mais pour le reste elle paraissait intacte. Peut-être avait-elle été achevée la veille même du tremblement de terre ? Et c’est une singulière destinée que celle de cette maison qui n’a jamais été, et ne sera jamais habitée, et qui semble n’avoir été édifiée que pour assister à cette effroyable désolation.
Nous nous retrouvions sur la Palazzata, avançant dans la direction des baraquements que nous avions aperçus ce matin, et où nous pensions pouvoir nous reposer et restaurer, car la matinée, déjà, était écoulée. Nous arrivâmes au baraquement de la poste, et nous commençâmes à monter la rue de chalets en bois que nous avions traversée trois heures plus tôt. Elle n’était plus aussi animée, c’était l’heure chaude, les ménagères avaient fini leur marché, les campagnards des environs étaient repartis dans leurs villages. Nous montâmes donc cette rue, dont j’ai déjà dit qu’elle ressemblait, avec ses petites boutiques légères, à quelque voie fragile et provisoire de ville d’eau. Les saloni des coiffeurs y alternaient avec les fruiteries et les épiceries. On y rencontrait aussi quelques bars et quelques guinguettes, mais le restaurant, vers lequel notre appétit nous poussait, ne paraissait pas. Nous avions dépassé seulement une ou deux trattorie, d’un aspect si médiocre, et où il semblait faire si chaud, que nous n’avions pu nous décider à y pénétrer.
Nous montions toujours, espérant toujours découvrir quelque chose de plus attirant, mais nous ne voyions plus rien… Nous étions las, nous commencions à désespérer, et nous allions nous résoudre à revenir sur nos pas, quand un spectacle inouï frappa nos regards. Une maison, une véritable maison, non pas une case de bois, mais une maison, était devant nous ! Nous nous frottions les yeux, nous n’en revenions pas… Tout autour de cette maison, qui était intacte, entourée de verdure, d’un air frais, coquet et agréable, s’amoncelaient des ruines : de hautes demeures renversées, brisées, ravagées, des montagnes de décombres, des murs lézardés, des chambres aux cloisons crevées… Qu’est-ce que c’était que cette maison ! On lisait : pension, sur la porte. Nous entrâmes, sans nul espoir d’ailleurs, car nous n’imaginions pas, bien sûr, que nous allions comme ça, du premier coup, nous humbles voyageurs inconnus, être accueillis dans ce paradis !…
Or, cela se passa tout naturellement. On nous fit asseoir à une petite table couverte d’une nappe, dans une vraie salle à manger. Un garçon nous présenta un menu. Et l’on nous servit un déjeuner qui nous parut incomparable. Le garçon avait tiré les volets pour que nous fussions bien au frais, et nous ne voyions plus rien de l’extraordinaire Messine, nous étions de retour en pays normal et nous jouissions du confort et des commodités de l’existence civilisée. Le garçon nous avait expliqué que cette maison-là, construite en ciment armé, tandis que toute la ville s’écroulait, n’avait même pas eu une égratignure, pas seulement une crevasse. Elle s’était balancée avec la terre, et quand le tremblement avait pris fin, elle s’était retrouvée telle qu’elle était auparavant… Après des poulpes à la tomate, un macaroni à la sicilienne et des escalopes au marsala, nous prîmes un verre de café glacé, en tirant béatement sur nos cigares. Les gens qui nous entouraient n’avaient pas l’air d’aventuriers, ils portaient d’honnêtes figures de fonctionnaires, et nous fermions l’oreille à leurs propos, pour mieux nous imaginer que nous étions dans quelque calme hôtel de sous-préfecture, et que tout le monde ici jouissait du bonheur ennuyeux, mais dont maintenant nous apercevions le prix, d’une vie réglée, paisible, sans surprise, ni tracas… Et quand nous sortîmes, nous fûmes étonnés de retrouver toutes les choses bouleversées, et le désordre et la ruine. Il était impossible, dans cette maison, de se croire à Messine. Nous regardions les décombres, les murs déchirés, les bâtiments effondrés, d’un œil neuf, ils nous réapparaissaient dans leur horreur : depuis deux jours que nous errions au milieu de cette destruction, nous avions fini en effet par en être moins frappés…
Nous reprîmes la route, car je désirais visiter maintenant la nouvelle Messine. Et nous arrivâmes aux premiers baraquements. Nous étions sortis de Messine ancienne, nous nous trouvions dans les plaines où l’on a installé la cité nouvelle, entre la montagne et la mer. Des deux côtés de la route, il n’y avait plus de maisons démolies, mais des files de baraques qui s’étendaient très loin. Elles étaient rangées par quartier, il y en avait de différents types. Le premier quartier que nous vîmes était composé de baraques peintes en blanc, et qui ressemblaient un peu à des habitations coloniales, on eût cru voir un petit coin du Soudan. Plus loin s’élevait le village américain, net et de lignes strictes. Nous avançâmes encore : à perte de vue, des baraques… — Cette Messine nouvelle est très importante et semble prospère.
En regardant autour de nous, nous vîmes sur notre droite une jolie petite colline boisée, dont la fraîcheur nous attira. Nous crûmes y distinguer des constructions, et nous nous demandions si c’était là une propriété close de murs, où nous ne pourrions pas entrer, ou un hameau ? Nous en étant approchés un peu, nous reconnûmes le cimetière. J’adore les cimetières d’Italie, ils sont roses, ils dominent toujours un beau paysage, et leur mélancolie n’est jamais amère, mais je refusai d’aller visiter celui-là : j’en avais vu des photographies ; les tombes bouleversées, les chapelles démolies, les cercueils troués, ce ravage effroyable d’un champ de paix et de silence, non, c’était trop cruel, et l’acharnement du monstre, qui s’était attaqué même aux morts, me faisait mal.
Nous descendîmes vers la mer, en traversant un quartier de baraques. Dans la torpeur de ce dimanche d’été, tout dormait. De loin en loin seulement, on surprenait quelque chant de mandoline derrière une porte, ou l’on dépassait une femme vidant sur le sol un bassin d’eau sale. Nous longeâmes un immense hôtel en bois, qui est la plus vaste construction de ce genre que nous ayons vue. Il a deux étages, une très longue façade, et compte peut-être une centaine de chambres. Nous vîmes aussi une grande école, puis les baraquements de l’autorité militaire, les baraques-casernes. Cette nouvelle Messine paraissait vraiment organisée et vivante. Lorsque, — dans combien d’années ? — le déblaiement de la Messine ancienne sera un fait accompli, je suppose qu’une autre Messine sera depuis longtemps installée dans le voisinage et vivra. Car, même quand le provisoire durerait davantage encore en Italie que chez nous, on en arrivera vite, cependant, à construire, on sera forcément amené à remplacer les baraques de bois si incommodes, glaciales l’hiver, étouffantes l’été, par des maisons de pierre. Une ville, une ville véritable, s’élèvera donc là, à l’endroit où florissaient autrefois les maraîchers de Messine, et, par un imprévu retour, c’est sur le sol de l’ancienne ville que s’établiront les maraîchers de la nouvelle et que pousseront les légumes pour nourrir les néo-Messinois.
Nous passâmes sur la plage où s’élevaient quelques tentes qui servaient de demeure à des familles de sinistrés. Le sable était sali, mêlé de débris, de reliefs, d’ordures. Puis nous revînmes du côté de la grande route en longeant des usines noires et dévastées. Ayant enfin regagné la voie principale de Messine en bois, nous nous attablâmes à un petit café, pour attendre l’heure du train de Taormine. La baraque de notre limonadier était précédée d’un carré sablé, à l’ombre, où quelques tables étaient rangées, on n’y était pas mal ; sur la chaussée, devant nous, c’était une allée et venue continuelle, et nous restions frappés de l’allure active, vivante et un peu fiévreuse des passants : pas découragés, ceux-là, déjà ils s’étaient adaptés à leur nouvelle existence, ils avaient un but et ils y allaient ; en face de nous se voyaient les restes d’une haute maison abattue par le tremblement de terre, personne n’y faisait attention ; cela appartenait au passé, à un passé déjà lointain ; il s’agissait maintenant d’autre chose.
Quand nous descendîmes à la gare, nous eûmes encore un spectacle d’exubérance et de vivacité messinoise, le guichet du baraquement, où se distribuaient les billets, était fort étroit, un seul employé, beaucoup de voyageurs. Quel débat, quelle éloquence, et comme on se poussait pour passer le premier ! Peuple qui sait se tirer d’affaire !
C’était un dimanche, le train était plein, et malgré tous les vêtements de deuil, on n’était pas bien triste. Cependant, tandis que nous nous acheminions vers Taormine en contemplant la belle ligne des montagnes au pied desquelles nous roulions, je rêvais. Le soleil baissait dans le ciel pur, le soir allait tomber bientôt sur cette nature sereine. Et la paix des choses me troublait. Je songeais à l’agitation vaine de ceux qui avaient survécu. A quoi bon, puisque votre tour viendra aussi ?…
Le patron de l’hôtel de Taormine, où nous sommes descendus, était allé à Messine le lendemain de la catastrophe. Voici le récit qu’il nous a fait :
« Ici, à Taormine, oui, nous avons ressenti la secousse, mais il n’y a pas eu d’accident, le sol sur lequel notre ville est construite est solide. C’est arrivé de grand matin. Il faisait nuit noire, c’était en décembre. Une bonne saison : la maison était pleine. Vous imaginez tout le monde qui sort des chambres, en criant, affolé… Alors mon frère et moi, nous avons parcouru les couloirs, nous avons rassuré les personnes, mais nous leur avons dit aussi qu’elles ne devaient pas se recoucher, parce que, vous savez, il y a souvent plusieurs secousses… Chacun, très rapidement, s’est un peu vêtu, et l’on est descendu dans la rue, sur la place. Tout le pays était dehors, parce que ces jours-là, il vaut mieux ne pas rester dans les maisons… Puis sept heures, huit heures, neuf heures ont sonné, il n’arrivait rien, on s’est peu à peu rassuré… On se disait tout de même : A Messine, à Catane, pourvu qu’il n’y ait rien eu ! on pense tout de suite, n’est-ce pas, aux grandes villes… Mais on ne savait rien. Moi, je suis parti pour une maison que nous avons à la campagne, et où j’avais à travailler. Et tout l’après-midi j’ai écrit des lettres, j’étais tranquille. Le soir, je rentre à Taormine, et je descends à la gare pour voir si l’on savait quelque chose. A la gare, monsieur, on me montre une dépêche. Sur la dépêche, il y avait : Messine complètement détruite ! »
Ici notre hôte s’arrêta, il poussa un violent soupir, comme un soupir de fureur, il serra les dents ; et son visage sombre et expressif de Sicilien se durcit…
« Messine complètement détruite !… Je n’ai rien dit. Je suis remonté ici. Je n’ai parlé à personne. Vous comprenez, on ne peut pas croire cela. Vous savez ce qu’était Messine pour nous. Vous savez quelle ville c’était. Mais pendant la soirée, le bruit s’était répandu dans le pays. Alors il a bien fallu y croire. J’ai dit : Demain j’irai ; peut-être a-t-on besoin d’hommes là-bas, je peux servir à quelque chose… Le lendemain matin, j’ai pris le train. On ne roulait pas vite, vous comprenez ; pour ce trajet qu’on fait en une heure, nous avons mis cinq heures, et, à mesure qu’on approchait, on voyait des maisons démolies, et dans chaque station c’était un désordre, une cohue, un affolement, des cris !… Enfin nous arrivons, on n’allait pas jusqu’à la gare, naturellement, elle était démolie, on s’est arrêté bien avant… je suis descendu… Et alors, monsieur, ce que j’ai vu ! des gens nus, d’autres qui avaient pris des couvertures, des tapis pour s’envelopper… on aurait dit je ne sais pas quoi, des Arabes, des tribus d’Arabes. Ils étaient comme fous… comme des fous… Et il n’y avait plus rien, plus de routes, plus de rues, rien… Maintenant on a déblayé, on peut passer. Alors, toutes les rues étaient comblées par les maisons écroulées, on ne s’y reconnaissait plus, on ne savait plus où l’on était, on se perdait… Je suis parti tout de même là dedans, dans ces ruines ; il fallait avancer doucement, on ne savait pas où l’on posait le pied, si c’était solide, des pans de murs s’écroulaient autour de vous, tout était branlant… Monsieur, il y avait par terre des fortunes, des fortunes !… Et il y a des gens qui les ramassaient… Ce qu’on a volé, monsieur, et tout ce qu’on a fait ! Ah ! je ne peux pas dire tout ce qu’on a fait… une honte, oh ! une honte ! »
Il se frappa sur la cuisse avec irritation, il soupira de toutes ses forces, et une lueur inquiétante brilla dans ses yeux très noirs, il avait l’air ivre…
« Songez que, pendant plusieurs jours, il n’y a eu aucune police. Il n’y avait là que la garnison de Messine ; elle aussi, naturellement, elle était affolée par le désastre, elle était incapable d’aucun service… Moi, j’ai vu des soldats avec des képis de généraux, des généraux avec des képis de soldats… Aussitôt, immédiatement, il aurait fallu envoyer des hommes du dehors… »
Il s’arrêta un instant, puis il reprit :
« Ah ! ceux-là qui ont eu le courage de rester à Messine se sont enrichis !… Et encore maintenant on s’enrichit… Sur tout, monsieur, sur tout… Il y a d’abord les bijoux… Mais même, tenez, les matériaux… On va reconstruire, eh bien ! les matériaux qu’on a eus pour rien, on les revendra, vous comprenez, on les revendra très cher. »
Sa voix tremblait, et il était très difficile de distinguer si c’était seulement d’indignation.
« … Et que de gens l’on aurait pu sauver, de gens qui sont morts bien après la catastrophe ! oh ! des milliers ! des milliers !… Moi, j’ai entendu, moi, monsieur, quelqu’un appeler, et je n’ai pas pu le secourir !… Je passais sur des ruines, il me semble entendre quelque chose, un bruit sous mes pieds. J’ai écouté : sûrement, là, il y avait quelqu’un, quelqu’un appelait… Mais c’est difficile, on ne sait pas exactement l’endroit, c’est sourd, c’est indistinct. Alors où creuser, où fouiller ?… Et je n’avais pas d’instruments ! Il aurait fallu un pic, une pioche : Comment faire ? Il y avait des gens qui passaient en bas, je les ai appelés : Montez m’aider. Personne n’a répondu ; vous comprenez, chacun avait d’abord son frère, son cousin, un parent, à aller voir, à secourir… Et j’ai dû, monsieur, j’ai dû m’éloigner sans avoir rien fait !
« Alors le soir j’ai pensé : A quoi bon rester ici ? On est inutile. Et où coucher ? Comment manger ? Il vaut mieux partir… Mais pour partir, c’était terrible. Tout le monde voulait partir, c’était une panique… Il y avait une bataille autour du train, on s’insultait, on se frappait, et tout cela, dans l’obscurité, pas de lumière. Les wagons étaient bondés, on suppliait qu’on vous laissât monter, ce n’était pas possible, ils étaient serrés là dedans, à étouffer. J’ai vu bien des trains s’en aller. Alors j’ai pensé que je ne pourrais jamais partir… J’ai eu l’idée d’aller à pied jusqu’à la prochaine station pour revenir à Messine par un train dont je ne descendrais pas, et dans lequel je repartirais. J’ai fait cela. Et j’étais parvenu à garder ma place, je croyais que j’allais enfin partir, un soldat arrive, il dit : tout le monde dehors, wagon pour les blessés… Et alors redescendre dans la nuit ! on marchait sur des blessés, sur des morts !… Ah ! monsieur !… Enfin, après des heures, des heures, et des heures, j’ai pu revenir… »
Je regardais l’homme qui nous parlait. Il était inquiétant. Il semblait vivre dans une fureur contenue incessante, qui, de temps en temps, se trahissait par la contraction des traits, par des gestes violents ou par une sorte de rire de colère. Il était ivre de mécontentement. Et cet état dans lequel nous le voyions paraissait son état habituel. Maintenant, il nous parlait des voleurs, et cette idée du vol, du vol général, du vol partout, semblait devenue une idée fixe :
« Tous les Messinois n’ont pensé qu’à voler. Ceux qui se sont trouvés sains et saufs n’ont plus songé qu’à cela… Et les millions, monsieur, les millions qui ont été envoyés par le monde entier pour les sinistrés, où sont-ils passés ?… Et les vêtements de mon fils, tenez, voilà quelque chose qui m’a paru bizarre… Il était au collège à Messine — la nuit du désastre, par bonheur, il se trouvait ici pour les fêtes de Noël — le collège a été détruit… Eh bien ! depuis, on a bien retrouvé son carnet de notes pour l’envoyer au collège de Catane où je l’ai mis… On a retrouvé son carnet de notes, on n’a pas retrouvé ses vêtements !… Oh ! monsieur, voyez-vous, rien n’a été droit dans tout cela… Mais quelle fortune ai-je eue, moi, que mon fils justement ne soit pas à Messine cette nuit-là !… Ah ! nous avons tous éprouvé des émotions trop fortes, vous comprenez, trop fortes !… Un de nos voisins croyait avoir perdu ses deux petits garçons, il va à Messine faire des recherches, il ne retrouve rien, il s’en revenait donc ici désolé, en larmes, et ne sachant comment il allait annoncer le malheur à sa femme. Or, les enfants avaient été sauvés par miracle, et pendant que le père était allé les chercher à Messine, ils étaient revenus ici. Il les croyait morts tous les deux, il ouvre sa porte, il les voit ! Vous comprenez cela : il les voit !…
« Ah ! ç’a été extraordinaire, vous savez, tout ce qui s’est passé… Il y a eu des familles dispersées, dont les membres ont mis des mois à se retrouver… Une maison s’écroule, le père peut se sauver d’un côté, la mère d’un autre, les enfants chacun du leur… et les voilà tous errants sur les quais de Messine, mais séparément, ne sachant ni qui est mort, ni qui est vivant ; une escouade de matelots prend la mère, l’embarque sur un vapeur pour Syracuse, une autre rencontre le père et l’envoie à Catane, une troisième dirige la fille sur Naples, une quatrième recueille le fils et le porte à Palerme… Comment cette famille se retrouvera-t-elle ?… Chacun ignore si les autres sont vivants, et, s’ils sont vivants, où sont-ils ? Vous comprenez cela ?… Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas morts et que leurs parents pleurent. Où sont-ils ?… Et il y en a d’autres aussi qui sont morts et que leurs parents espèrent toujours revoir… Il y a eu tant, tant de fous, monsieur ! on les a mis dans des maisons de santé, sans savoir leur nom, sans avoir de renseignements sur eux, puisqu’on les trouvait à peu près nus dans la rue… Eh bien ! n’est-ce pas, il y a des gens qui continuent à espérer qu’un des leurs n’est pas mort, qu’il vit dans une maison de fous, qu’il n’a pu dire son nom, qu’on ne peut donc pas les prévenir de son existence !… »
Encore une fois, il s’arrêta. Il réfléchit. Puis il dit :
« Voyez-vous, ç’a été un trop grand bouleversement : des pères qui ont perdu tous leurs enfants !… et des familles si nombreuses !… Il n’y a pas un survivant qui ne soit vêtu de noir… Et des héritages ! Ah ! des héritages ! Des pauvres devenus millionnaires… J’en connaissais un, maintenant il ne me salue plus, il a une automobile, il a perdu je ne sais pas combien de personnes de sa famille dont il a hérité. Il vit maintenant comme un fou… Ah ! un trop grand bouleversement !
« Et des riches qui sont devenus pauvres, qui tout d’un coup n’ont plus eu à eux que la chemise qu’ils portaient !… Et tous ceux-là, tous les gens ruinés, il a fallu les faire vivre. On les a secourus partout, on les a recueillis partout… Mais, vous savez, ils n’étaient pas agréables, tout leur était dû. Ce qu’on leur donnait, pour eux on ne le donnait pas. Comme ils savaient que, dans le monde entier, on avait recueilli d’énormes sommes pour leur venir en aide, ils s’imaginaient qu’on était payé pour les nourrir et les loger… Mais tout cet argent-là, Cristo ! où a-t-il passé ?… Oui, j’ai eu un profuge ici, il fallait que toute la maison fût à ses ordres, il n’était jamais content. Un jour, l’hôtel était plein, et j’avais une personne que je devais absolument loger ; je mets cette personne dans sa chambre… Le soir mon profuge était sur la porte, il attendait, l’air furieux. « Qu’est-ce que vous attendez ? — Le signor qui doit coucher dans ma chambre… Il faut que je lui parle » dit-il en serrant les poings…
« Ah ! monsieur, rien n’a été droit… vous comprenez, rien n’a été droit… »
Rien n’a été droit… Je l’écoutais, et je pensais que, peut-être, le plus terrible du désastre, c’est qu’il a déséquilibré les survivants. J’avais déjà remarqué la surexcitation, l’air singulier des gens que je rencontrais depuis trois jours. L’homme qui parlait là, me découvrait le fond de ces malheureux frappés trop fort depuis huit mois, ils n’ont pas pu y résister, leurs nerfs, leur cœur et leur raison sont ébranlés.
La réalité pour eux a été décevante. Rien ne fut tel qu’ils l’eussent imaginé. Ce désastre a fait sortir les loups, et ceux qui ont vu cela sont devenus misanthropes.
Ainsi dans ce jardin parfumé, sous le ciel de Sicile, à Taormine ! d’amères réflexions m’assombrissaient, tandis que notre hôte continuait à nous parler fiévreusement et à rire de son étrange rire.
Palerme est une ville étrange et magnifique. L’émotion qu’on y éprouve se compose d’éléments disparates, mais tous également puissants. Ce qu’on voit là ne ressemble guère à ce qu’on voit ailleurs. Toute la pompe espagnole sur une terre volcanique, une végétation des tropiques et des jardins italiens, des souvenirs de l’Inquisition et des restes de l’antiquité grecque, aux Cappuccini une façon de traiter les morts parfaitement castillane, au Musée les métopes de Sélinonte… L’impression qui domine cependant parmi cette riche nature, ces majestueux monuments surchargés et ces lignes tourmentées des montagnes, c’est qu’on se trouve, sans doute, dans quelque vieille ville de l’Amérique espagnole — il faut bien se situer quelque part — car ici on n’est certainement ni en Espagne, ni en Italie.
C’est particulièrement sur le Foro Umberto, la promenade qui longe la mer et à laquelle on accède par la Porta Felice, qui est d’un style fort noble, qu’on sent le plus vivement cette impression. Je m’y suis trouvé à midi, sous le rude soleil qui débordait du ciel. La baie, d’une forme très irrégulière, est bornée, d’un côté par le mont Pellegrino, et de l’autre par le Catalfano, deux belles masses violentes, comme sorties du feu, comme jaillies du centre de la terre dans une énorme poussée. Nous avions déjà entrevu la ville, les Quattro Canti, les plus beaux monuments et le jardin Garibaldi à la flore du Sud, — et nous voici devant ce paysage ardent, en face de la mer brûlante, sur ce quai aride… Alors vraiment nous avons cru que nous n’étions plus en Europe, et que nous nous trouvions transportés par miracle dans une riche et lointaine colonie fondée, il y a très longtemps, par les Espagnols.
Tout près de là, cependant, est située la villa Giulia, jardins qui sont peut-être ce qu’on voit de plus italien à Palerme. C’est toute l’Italie qu’a aimée notre dix-neuvième siècle, du Consulat à la fin du second Empire, depuis les jardins Tivoli jusqu’au Théâtre Italien. Les allées, les bosquets, les plates-bandes, et surtout un rond-point où s’élèvent plusieurs petits pavillons rococo à colonnes et à facettes, en marbre de couleur, et les arceaux des globes à gaz mêlés aux feuillages des orangers, et les touchants bustes de femmes, oui, tout cela est bien fait pour attendrir un vieil amant de l’Italie ! Bariolage, verdure et ciel bleu, et cette grâce, un peu de confiserie, c’est l’âme de l’Italie que nos grands-pères ont adorée. Musique de Donizetti, danseuses, la Taglioni, Italie d’Alfred de Musset et de Roger de Beauvoir, une Italie de carnaval et de veglione, une Italie folâtre et brillante, sentimentale et légère, charmante, le rêve des gandins autant que des grisettes…
Ce rond-point de la Villa Giulia réveillait en mon souvenir de vieux portraits jaunis dont j’aime encore les modes, les sourires et les charmes surannés, et je le regardais avec émotion, comme si nous avions reculé dans le temps, et que le passé — miracle ! — fût redevenu du présent…
Mais ce n’est point là Palerme. Palerme est aux Quattro Canti, à la Cathédrale, à Saint-Jean des Ermites. Les Quattro Canti, c’est une petite place quadrangulaire, située au centre de la ville et traversée par le croisement des deux principales rues. Elle a été bâtie au dix-septième siècle par un vice-roi d’Espagne. Elle a beaucoup de caractère. Les pans coupés des quatre maisons qui la bordent sont semblables. Très chargés d’ornements, ils sont couronnés d’un fronton qui porte un bel et large écusson de pierre ; au-dessous, dans une niche, la statue d’une sainte de Palerme ; au-dessous encore, un roi en armure, couronne sur le chef, dans une fière attitude ; enfin, au rez-de-chaussée, entre deux colonnes, une fontaine à double vasque surmontée d’une statue de femme, et, un peu plus haut, une large plaque de marbre entourée d’un riche encadrement et portant une inscription commémorative. Les Quatre Écussons, les Quatre Saintes, les Quatre Rois et les Quatre Fontaines se font face, deux par deux ; l’ensemble, un peu sombre, est robuste, à la fois rude et recherché, très espagnol.
Comme sur cette petite place, où toute la ville passe chaque jour, l’empreinte de l’Espagne se retrouve d’ailleurs à chaque pas dans Palerme. La Poste, par exemple, est située près du lieu où l’Inquisition allumait ses autodafés. Mais là où l’on saisit le mieux ce qu’il y a d’espagnol, non seulement dans l’aspect, mais bien dans l’âme palermitaine, c’est aux Cappuccini. On y retrouve le goût singulier de ceux de l’Èbre et du Tage pour le macabre, pour la Mort, ses horreurs et ses épouvantements.
Le couvent des Capucins s’élève dans un faubourg. C’est dans ce couvent que, avant ces trente dernières années, la haute société de Palerme mettait ses morts (je ne dis pas : enterrait). Dans les longues galeries pratiquées sous le monastère, des milliers de squelettes sont rangés le long des murs. De grands soupiraux éclairent suffisamment l’endroit, à l’exception pourtant d’une galerie fort sombre et où l’on ne voit que des prêtres, en soutane ou en surplis et la barrette sur le crâne. Les squelettes laïques sont tous en robes noires et gantés de blanc, leurs deux mains croisées sur le ventre. Il y en a une ligne, en bas, à votre hauteur ; au-dessus, d’autres sont accrochés aux murs par une corde passée autour de la taille : dans cette position, le buste s’incline légèrement en avant, de sorte que toutes ces têtes de mort ont l’air de vous fixer de leurs orbites vides et de rire. C’est naturellement le plus horrible et le plus effrayant spectacle qui se puisse voir. Ces têtes grimaçantes, ces robes flottantes ou rembourrées, ces manches vides, et l’un, que le moine vous fait remarquer, dont la peau est restée sur l’os, et cet autre qui a conservé toutes ses dents, et celui-ci dont la mâchoire est au contraire disloquée, et celui-là, qui est très grand, et cet autre qui est très petit, et les têtes penchées sur l’épaule du voisin, et le rire, toujours le rire… Ils portent sur la poitrine un numéro et une pancarte où sont inscrits leurs noms et la date de leur mort. Des couronnes, des rubans noirs, des fleurs fanées s’entassent aussi dans ce lieu effroyable. Mais le capucin qui nous conduisait ne prêtait guère attention à tout cela. Il marchait devant, avec ennui, s’arrêtait quand nous nous arrêtions, repartait quand nous repartions, et mettait consciencieusement les doigts dans son nez. Une galerie de cercueils vitrés : ce sont les femmes. Il y a là beaucoup de dames de l’aristocratie sicilienne : étendues en belles robes dans leur bière, le crâne appuyé sur un coussin et la couronne de baronne ou de comtesse posée sur le corps. Quelquefois, à côté d’elles, leur photographie, la photographie d’une jolie femme. Il y a aussi, et c’est peut-être le plus horrible, des petits enfants dans des cercueils vitrés ; ils sont parés, pomponnés, vêtus de dentelles avec des rubans roses, et l’on voit parmi la dentelle, coiffée d’un joli bonnet, une petite tête de mort.
Quand on sort des Cappuccini, on regarde le ciel bleu avec un peu d’égarement. On ne croit plus à la vie. On sait qu’il n’y a sur terre que de la mort. On flaire partout une odeur de cadavre. Je me souviens que, pendant plusieurs jours, le soir, quand j’apercevais, marchant devant moi, quelque femme du peuple en robe noire, j’avais un frisson et j’attendais qu’elle se retournât avec la terreur de voir des orbites creux, un nez écrasé, une face de squelette.
Mais à l’empreinte espagnole se mêlent, à Palerme, celle des Arabes et celle des Normands, qui ne sont point si dures. Saint-Jean des Ermites, l’église des Ermites noirs, une très ancienne construction religieuse, est étrange. On aperçoit de loin ses cinq dômes rouges, gonflés et patauds, on ne sait pas ce que c’est ; cela ressemble, si l’on veut, à des ballons attachés très près les uns des autres et sur le point d’être lâchés pour une course, ou bien aux coiffures rondes d’eunuques géants, lesquels seraient enchaînés et enfoncés dans la terre jusqu’au-dessus du front. C’est très surprenant.
L’intérieur de l’église, d’ailleurs, est peu intéressant : mais il faut visiter là un petit cloître, à peu près abandonné, dont les colonnettes sont infiniment gracieuses et qui est bourré de plantes et de fleurs. C’est charmant. Cela pousse en désordre avec exubérance ; des lianes enlacent les chapiteaux, des branches se mêlent aux arcades, et, sous le ciel pur, ce petit trou de couleurs vives et d’odeurs suaves a l’air d’un cloître du paradis…
Ce n’est pas bien loin de là que j’ai visité un des plus beaux et des plus fastueux monuments que j’aie jamais vus. Je parle de la chapelle Palatine. Dans le Palais-Royal, qu’occupe maintenant l’administration militaire, se trouve une chapelle, bijou très parfait. Ce serait l’oratoire d’un Empereur de Byzance, avec les marbres les plus rares et des mosaïques à fond d’or d’une richesse incroyable. On entre, et l’on se croit transporté dans quelque palais des Mille et une Nuits. Et cette somptuosité reste discrète, l’éclat de l’or dans la pénombre est doux ; pour l’œil qui s’émerveille, tout est régal, rien ne l’offusque ni ne le blesse ; cette œuvre d’art délicate semble le rêve d’un Arabe de l’imagination la plus raffinée.
Il me reste de cette grande ville une impression de lumière rose et dorée, exquise. C’est une heureuse cité, bien située, bien construite et qui semble marquée d’un signe. Elle rayonne : elle est belle. Il en est des villes comme des gens. Beaucoup sont agréables, saines, bien venues et proportionnées, mais les belles, mais les très belles, sont seulement quelques-unes. Quand soudain la beauté se montre à côté de ce qui n’est que la jeunesse, la grâce ou l’esprit, l’âme s’émeut, elle s’arrête, surprise, et elle se recueille un instant, avant de pousser un cri d’enthousiasme. Devant la divine Beauté, les cœurs bien nés se gonflent d’une ferveur et d’une vénération infinie. A Palerme, dans cette cité élue, on éprouve un tel sentiment. On ressent cette ivresse particulière qui vous agite dans les endroits plus doués que les autres.
Mais vous vous êtes promenés dans la ville au milieu des souvenirs espagnols ou des pensées arabes, entrez maintenant au Musée, et venez écouter les Grecs. Au rez-de-chaussée, vous verrez une cour entourée d’un portique, dont le centre est occupé par un bassin rempli de papyrus. Cette plante légère, ce subtil feuillage d’Égypte m’avait ravi à Syracuse, — dans ce Musée consacré surtout à la beauté antique, il était charmant de la retrouver. C’est comme une introduction de la nature à la contemplation des métopes de Sélinonte, dont telles sont de l’archaïsme le plus saisissant et telles autres d’un style que rien n’a jamais surpassé. Au Musée de Palerme, il faut encore visiter une curieuse collection de petits tombeaux grecs ; leurs couleurs sont demeurées vives et fraîches ; puis les vases arabo et hispano-siciliens, les faïences et les poteries.
La population de Palerme me plaît. Elle a de la distinction. Elle ne possède pas la mollesse nonchalante de Naples, mais elle n’est pas non plus gâtée par l’esprit mercantile et ennuyeux de Catane. Elle a le sentiment qu’elle vit sur un sol admirable, ce qui tempère un peu, peut-être, son élan pour le négoce. On est actif à Palerme. J’y ai vu des bars où l’on mange sans s’asseoir, à l’américaine, mais on y sait aussi s’enchanter du spectacle de la Conca d’Oro ou de la mer. Et pourtant, j’ai eu cette impression que les femmes s’y ennuyaient. C’est que là les jeunes gens travaillent, et qu’ils ne pensent pas uniquement à l’amour comme à Naples.
Je n’ai pas parlé de la cathédrale, parce qu’elle a été restaurée à chaque siècle, et à chaque siècle abîmée, et parce qu’on trouve, près de Palerme, à Monreale, une cathédrale du même style qui est fort belle.
On va de Palerme à Monreale en tramway. Cette petite ville, qui fut épiscopale, se trouve sur une plate-forme, à cent ou deux cents mètres d’élévation, dans la montagne qui borde la Conca d’Oro. On y jouit donc d’une vue étendue sur la fertile vallée, sur le moutonnement verdoyant de ses arbres, sur les montagnes d’en face, et sur Palerme, sur la mer.
C’est de là qu’on prend vraiment possession de cette radieuse contrée. Pour la cathédrale, elle est couverte à l’extérieur d’ornements, d’entrelacs, de figures et de cercles noirs. C’est un monument normand du XIIe siècle. Dans l’immense nef, les murs sont entièrement vêtus de mosaïques. Ces mosaïques, qui représentent des scènes de l’ancien Testament, sont d’un art délicieux.
A Palerme, ne manquez pas d’aller admirer, au marché, les étalages des fruitiers. Ils forment avec leurs légumes des tapisseries de verdure d’un effet singulier. Et puis voyez un peu ce peuple qui vit bien plus dans le passé que dans le présent, qui vit surtout parmi les histoires de chevalerie peintes sur ses charrettes, avec Roland, avec Lancelot, avec Tristan, comme le pêcheur vit avec Neptune et les sirènes peintes sur sa barque.
Ayez enfin notre bonheur qui nous fit quitter ce port la nuit, par la pleine lune, alors que tout était silence, calme, enchantement et magie.
Comme les dieux sur le mont Olympe, nous baignions dans l’azur. En bas le bleu de l’eau, en haut le bleu du ciel, partout l’air bleu. La pointe de Sorrente, là-bas, plongeait avec sérénité dans la mer impassible. Tout était radieux, souverain, tout avait l’aspect de l’éternité. A nous, ivres de lumière et de formes pures, l’île parfaite se donnait. Sous le feu du soleil, nous montions avec allégresse la route qui, au-dessus de la mer, suspendue au flanc de la montagne, conduit de Capri à Anacapri.
Cependant, étant arrivés très haut, et découvrant un paysage d’une splendeur merveilleuse, nous suivîmes un détour de la route, perdîmes la mer, et pénétrâmes au milieu des vignes. La poussière était éblouissante. Nous passâmes devant des pergole où, comme les avait vus Nerval, le pampre à la rose s’alliait, nous laissâmes quelques maisons. Puis, un seuil nous invitant, nous le franchîmes, et bientôt, assis à l’ombre sur une terrasse, où pendaient des raisins, nous buvions le vin frais, au bruit murmurant d’une fontaine. Nous étions à Anacapri. Valère, vous en souvenez-vous ?
Je louai sur l’heure une maison, et le soir même j’y entrai.
Elle était charmante, ma maison. Le lendemain, quand le jour parut, j’y marchai de plaisir en plaisir. Ma chambre était dallée de bleu, mon salon de rose. Chaque pièce ouvrait sur un balcon ombragé par une vigne, et ce balcon donnait, du côté du levant, sur un jardin arabe tout pavé de faïences, du côté du couchant, sur la mer et les îles. Avant d’arriver à l’azur de l’eau, le regard parcourait d’abord une terre couverte d’oliviers, de figuiers de Barbarie, de petits arbres veloutés, puis cette terre, deux cents pieds plus loin, tombait brusquement dans la mer. J’avais une cuisine délicieuse et un puits. Sur la maison, une grande terrasse d’où l’on découvrait toutes les demeures orientales des environs, le mont Solaro et le golfe jusqu’à Naples. Ma terrasse touchait presque à celle de la maison voisine, et j’eusse pu passer sur celle-ci d’un bond.
Le matin, je m’installais sur mon balcon, et je lisais, sentant sur mon front la brise fraîche qui venait de mer. Quelquefois un bruit de galoches dans mon escalier : quelqu’un s’avançait sur le balcon, disant à chaque pas : « Permesso signor !… Permesso signor !… » C’était mon propriétaire, il sacerdote. Il était en train de faire son ménage. Un chapeau de paille usé, et, sous une vieille soutane couverte de taches, un tricot de marin, composaient tout son appareil. Généralement il était en sueur, il s’excusait de ne pas me tendre la main parce qu’elle était sale. Je la lui serrais tout de même. Il avait un bon rire et de bons yeux. Il aimait les fleurs. Et il vivait avec une belle simplicité. Comme j’étais Français, il me regardait un peu comme le diable, mais non pas comme un méchant diable, je crois.
J’avais un autre visiteur, un chat noir, maigre et farouche, que je n’apprivoisai qu’à force de patience et d’assiettées de chocolat. Quelquefois je me retournais, il était assis derrière moi, et il me regardait. Mais si je faisais un geste, il s’enfuyait. Ce chat timide appartenait à une vieille femme que, de temps en temps, je voyais étendre du linge ou vanner du grain sur le toit de sa maison, et qui possédait un très fin visage.
Le type grec s’est conservé à Anacapri. Il se retrouve fort pur chez les enfants et les vieillards, car les adultes pour la plupart ne sont point beaux. C’est que les meilleurs d’entre eux vivent en Amérique. Ils n’en reviennent qu’au déclin de leur vie. Ces indigènes de Capri ont la fureur de l’émigration. Demandez à un petit garçon : « Que feras-tu quand tu seras grand ? » Il vous répondra sans hésitation : « J’irai en Amérique. » Pourtant l’île n’est pas inféconde, elle produit du vin excellent et de la bonne huile. Mais à Capri, comme à Naples, — encore qu’on en fasse beaucoup moins qu’à Naples, — on fait trop d’enfants.
L’après-midi, je sortais. J’aimais à rôder dans les petites rues blanches et noires, à l’heure de la sieste, quand personne ne se hasarde au dehors, et que tout le village paraît endormi. Les ruelles sont silencieuses, l’ombre est chaude, le ciel, là-haut, est d’un bleu dur. J’allais dans la campagne, et je marchais avec lenteur, sous les rudes rayons du soleil. J’observais les lézards, dont les variétés, dans cette île, sont innombrables. J’écoutais le chant des cigales. J’apercevais la mer étincelante entre les oliviers. Parfois je croisais une femme au foulard rouge, les pieds nus, la démarche noble, portant sur la tête quelque baricaut.
Et quand la chaleur du jour faiblissait un peu, j’allais visiter mon ami Valère qui habitait une maison perdue dans les roses.
Et nous voilà partis, Valère et moi, poussant le caillou, flânant sur la route et dans les chemins. Il y avait la petite chapelle toute blanche et ses lauriers en fleurs. Il y avait la promenade de la Migliera à flanc de coteau, où de grands filets sont tendus pour les passages d’oiseaux, d’où l’on découvre, au milieu de l’émeraude de l’eau, les Faraglioni blancs, où nous cueillions des asphodèles. Il y avait le vendeur de pastèques, qui n’avait qu’une jambe, que l’on asseyait sur le bord de la route sur un escabeau, et qui là, tout le jour, discutait avec les ménagères, loquace et violent, en attendant que le soir on le rapportât chez lui. Il y avait tous les braves gens qui nous disaient gentiment bona sera en passant. Il y avait enfin cette terrasse où, devant un flacon de lacryma-cristi, on était si bien pour voir le soleil se noyer dans la mer, et la lune apparaître.
Après dîner, j’allais m’asseoir dans la boutique de mon épicier, mon ami, Francesco Gargiulo, qui jouait de la guitare à ravir. Vous qui n’êtes pas noctambule, Valère, vous étiez déjà couché. Mais vous rappelez-vous votre ami à vous : c’était l’agent de police. Quand il vous rencontrait, il ne vous quittait plus ; un petit Calabrais, noir, bavard, pinteur aussi, et brave, parbleu ! Il était cordonnier à ses moments perdus. Mais il mettait son képi sur le coin de l’oreille… Nous ne l’épations pas celui-là ! Combien de fois nous a-t-il raconté ce crime qui avait été commis dans l’île, cinque anni fa. Mais à propos, lui avez-vous envoyé de Marseille cette pipe dont il avait si grande envie et que vous lui aviez promise ?
L’île de Capri est d’origine volcanique. Les géologues nous apprennent que, il y a quelques milliers d’années, elle était enfoncée de deux cents mètres sous la mer. Elle constituait alors un archipel de cinq petites îles, lesquelles sont maintenant les cinq points les plus élevés de Capri. En jaillissant des eaux, la montagne s’est en partie écroulée, d’où sa forme singulière d’aujourd’hui. A l’est, trois grandes dents qui se détachent sur le ciel. Au centre, dans la fraction la plus affaissée, deux petits monts coniques qui ont subsisté. A l’ouest, Anacapri qui se cache derrière une muraille immense. Partout de magnifiques brisures, lesquelles, dans cette roche schisteuse et calcaire, sont aveuglantes de blancheur. C’est le pays de la lumière, ici l’ombre même est lumineuse, le soleil défend à toute chose de n’être pas belle.
La capitale, la petite ville de Capri, est située à une soixantaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. De la Marine, on aperçoit là-haut ses murs de plâtre immaculé, et l’on croit qu’ayant quitté l’Italie, on vient d’aborder sur une terre d’Orient. Le sol, couvert de vignes, descend en gradins jusqu’à la mer. Quelques pins parasols décorent les hauteurs. Tout paraît sentir la figue sèche.
Vous gagnez la ville par un escalier pavé, enfoncé entre des jardins, et sans aucune vue. De marche en marche, il vous a conduit devant une porte que les armes de Capri surmontent. Vous franchissez la voûte, et, tout à coup, vous voilà sur une place, une toute petite place rose, avec une petite église, une petite tour et des petites boutiques. Où diable êtes-vous ? C’est un décor. Vous êtes arrivé à l’Opéra-Comique ! Vous vous frottez les yeux. Tous ces gens propres, bien groupés, et qui parlent avec sagesse, sont certainement des figurants… Cependant vous faites encore quelques pas. Par là, à droite, la place s’ouvre sur une terrasse. Ah ! par exemple ! cela vous ne l’avez pas vu au théâtre ! A vos pieds, c’est le golfe, une immensité sereine, la mer bleue paisible…
Capri déplaît fort aux Napolitains. Ils n’y viennent jamais. Et je soupçonne que ce qui les choque, c’est l’extrême propreté de l’île. Cette propreté doit les dégoûter. Il est vrai qu’elle produit un effet singulier, quand on sort de Naples. Les ruelles sont absolument nettes, les maisons absolument blanches, le ciel absolument bleu. Cela paraît extraordinaire et presque inquiétant à qui, le matin même, s’est promené à Margellina ou dans le quartier de Mandraccio. Autre chose aussi peut-être éloigne de Capri les Napolitains : l’affluence des Allemands. L’île est en effet tout à fait à eux : ils l’ont germanisée, à chaque pas on rencontre des enseignes en langue tedesca. Et les grosses blondes à l’air hommasse, et les lourds enfants de Berlin à la gueule épanouie, y remplissent les hôtels d’horribles croassements.
On peut cependant vivre là agréablement. Un jour que je me promenais en barque, le rameur me désigne du doigt une maison, sur un petit plateau : « E la casa d’oun francese, signor, del pittore Lebouf. » Lebouf ? Après quelque réflexion, j’ai compris que c’était du peintre Dubufe qu’il s’agissait[2]. Quand on possède un peu l’italien, on saisit bien des choses. — Saïn vient aussi à Capri.
[2] Écrit en 1908.
Gorki s’y est installé plusieurs mois l’an dernier. Je l’ai vu passer quelquefois. Il est très grand et très maigre. Une rude figure aux joues creuses. L’air d’un terrassier poitrinaire. Il était toujours suivi d’une horde de Russes à mines sauvages.
Quand j’étais un peu las de ma tranquillité d’Anacapri, quand j’avais besoin de mouvement et de bruit, quand j’avais soif d’orgie, je descendais à la ville. La ville pour moi, c’était Capri. Capri, avec ses rues couvertes comme en Orient, son église pareille à une église d’Amérique espagnole, l’agitation de sa place minuscule, la splendeur de sa terrasse… Le lieu de la débauche, le centre de la vie intense, c’était Heidigeigei, un café où l’on vend des boissons glacées, où l’on trouve le New-York Herald, et qui, même, possède un billard.
Je m’arrêtais sur la route, pour déjeuner, à la pension de la Syrena, dont la table m’amusait. Le patron est un vieux Munichois fort poli, qui se rappelle le temps où il venait encore beaucoup de Français à Capri. Alors on lisait Graziella, on avait envie de voir le golfe de Naples, on ne faisait pas d’automobile. A la table de la Syrena, je rencontrais un Allemand qui parlait toutes les langues et en tirait grande vanité ; il s’adressait à moi en français, en même temps il demandait en italien une assiette à la servante, puis, se tournant vers sa voisine, une vieille Anglaise, il s’intéressait, dans son langage, à la promenade qu’elle avait faite le matin. Cette vieille Anglaise était la mère d’une plus jeune Anglaise qui était folle : de temps en temps elle voulait se suicider. A côté de celle-ci, on voyait un colonel badois qui avait fait la campagne de 1870, homme correct et peu bavard ; puis une Américaine peintre, d’un grand talent, très pauvre et que toute la table respectait ; puis un peintre allemand qui exécutait de la peinture de commerce ; et enfin un jeune Russe neurasthénique, à la fois anarchiste et monarchiste, professant le plus grand mépris, d’abord pour tous les gens qui vivaient à la Syrena, ensuite pour le reste de l’humanité, et haïssant l’art grec. Il lisait beaucoup de livres français, mais son opinion sur notre littérature m’étonnait : « Il y a Anatole France, disait-il, et puis il y a… il y a Champol… » Je ne connaissais pas Champol. « Il y a Anatole France, et puis il y a… il y a Champol… » Il y a Champol.
Après un déjeuner à la Syrena, une flânerie dans Capri et un café glacé à Heidigeigei, je remontais vers ma paisible Anacapri aux doux jardins arabes, aux grandes vignes capricieuses, et qui semble planer au-dessus de la mer.
Je nous revois, voguant en barque, dans le port de Naples, vers le gros vaisseau qui venait de faire le tour de l’Afrique et que nous apercevions là-bas, au loin, immobile sur ses ancres. La matinée était lourde. Dans la barque, avec nous, se trouvaient deux Allemands qui devaient arriver pour le moins du Cap, et qui avaient profité de l’escale à Naples pour visiter la ville. Trois rameurs, en criant, en chantant, en riant, faisant tapage à la napolitaine, nageaient paresseusement, avec de loin en loin de brusques accès d’énergie, ils regardaient les étrangers du coin de l’œil et plaisantaient entre eux. Assis sur un banc, nos valises à nos pieds, nous contemplions le port et la ville charmante, tiède et rose, que nous quittions. Nous abordâmes enfin l’Admiral. On nous conduisit à nos cabines et nous nous installâmes, ce qui ne fut pas long. Comme nous devions loger une huitaine de jours à bord de ce vapeur, nous avions hâte de le visiter et d’en examiner les habitants.
Il avait voyagé quatre mois sur les côtes d’Afrique, ayant d’abord descendu celles-ci à l’ouest pour, après avoir doublé le Cap de Bonne-Espérance, les remonter à l’est. Il s’était arrêté dans toutes les colonies, au Sénégal, au Cap, à Lourenço-Marquès, à Mozambique, à Zanzibar, maintenant, après avoir traversé la mer Rouge, il passait en Méditerranée pour rejoindre l’Atlantique et regagner Hambourg, son port d’attache. Quels hommes et quelles bêtes allions-nous voir sur ce coureur de mers ?
Mais quel parfum des tropiques nous y respirions déjà ! La fade odeur de l’arachide sortait de la cale, et l’on écrasait, en passant par là, des petits grains rougeâtres qui avaient poussé sur des terres bien lointaines. L’Admiral devait s’arrêter deux jours à Marseille, puis il ferait route sur Tanger… Quand on leva l’ancre, l’orchestre des stewart nous régala d’une valse. Car, sur les bateaux allemands, tous les garçons jouent de quelque cuivre et ils composent un orchestre qui distrait les passagers. Nous étions sur le pont, nous regardâmes défiler sous nos yeux la rive délicieuse, et comme engourdie de plaisir, du Pausilippe. Nous fûmes vite à Nicida ; nous franchîmes la pointe, et le golfe de Naples, le Vésuve, Sorrente, et Capri disparurent.
A ce moment, on sonna le deuxième coup du déjeuner et nous passâmes dans la salle à manger. Elle était vraiment plaisante, en bois des îles, très claire, point européenne, et telle qu’on la souhaitait. Nous n’y rencontrâmes aucun sultan, pas de princes des Comores, mais une société, tout de même, amusante. Au bout de notre table, on voyait un gros Portugais, barbe et cheveux noirs, air cruel, qui était enveloppé dans une sorte de manteau noir à capuchon, et mangeait de tous les plats, avec un appétit terrible, comme si vraiment c’eût été du nègre. Il avait l’air d’un marchand d’esclaves, il devait avoir fait la traite sur la côte ; il revenait de Mozambique. A côté de lui sa femme, une personne paisible, d’une rotondité magnifique. En face de nous était assis un ménage d’Anglais : l’homme vêtu de flanelle, la femme en légère mousseline, déjà mûre, mais mince, gazouillante, et souriant comme une petite fille ; ils s’étaient embarqués au Cap pour Southampton. A une autre table, de grands jeunes gens blonds, habillés de khaki, devaient arriver de Dar-es-Salam ; ils parlaient avec animation à une sorte de clergyman en redingote noire, qui semblait rêveur et nerveux. Il y avait aussi, à cette table, un Anglais très rouge, qui portait des culottes courtes et exhibait avec satisfaction des mollets énormes. Il ne manquait rien qu’une jolie femme à cette assistance pour qu’elle fût parfaitement agréable. Nous la retrouvions tous les jours aux repas, et sur le pont où chacun, allongé dans un fauteuil de toile, tuait les heures de la traversée, en sommeillant ou en parcourant vaguement quelque magazine.
Pour nous, nous rôdions sur le navire. Le matin, nous allions voir nos amis les singes. C’étaient deux petits singes au ventre bleu qu’on avait attachés à l’arrière, ils appartenaient à des hommes de l’équipage. Les matelots leur faisaient de fort méchants tours, ils les suspendaient au-dessus de la mer comme s’ils eussent voulu les jeter à l’eau. Terrifiées, les pauvres petites bêtes poussaient des cris. Quand on s’approchait d’eux avec amitié, ils étaient délicieux. Nous leur attrapions des mouches, ils nous les prenaient des mains avec leurs petits doigts et les dévoraient avec gourmandise.
Nous visitions ensuite la gazelle, qui vivait dans l’entrepont et qu’on nourrissait de lentilles. Puis nous gagnions l’avant, en passant devant les cuisines où nous jetions un coup d’œil aux deux maîtres-coqs chinois. A l’avant, il y avait un âne et un chien savant destinés à un cirque de Lisbonne, et qui faisaient des tours. On y voyait aussi un aigle dans une cage, un aigle muet, fier et farouche.
Nous atteignîmes ainsi Marseille, n’ayant eu de gros temps qu’un peu, dans le détroit de Bonifacio. Arriver dans ce port, par un beau matin d’été, alors que le ciel, comme un dais de soie délicate, prête des reflets bleus à toutes les choses !… Le navire glisse avec prudence sur l’eau immobile des bassins, les ponts tournent et vous ouvrent passage ; on longe des quais de pierre, puis de plus larges lacs se proposent : l’on y passe en revue lentement tous les grands vaisseaux amarrés, et l’on suit des yeux la course pressée, adroite, des petites chaloupes à vapeur qui se hâtent de toutes parts… Là-bas, dans le lointain, au-dessus des mâts, touchant le ciel, on voit la colline blanche de Notre-Dame de la Garde.
Le spectacle était si beau, ce matin-là, que je ne me lassais pas de le contempler. J’étais perdu dans une douce rêverie. Après le monotone désert de la mer, rien n’est aussi agréable que le gai mouvement d’un port. Et la lumière, l’eau, les couleurs, tout se montrait d’une réalité pleine de rêve. Pendant que notre Admiral cherchait sa place au milieu des autres steamers, je ne pensais plus du tout à descendre à terre. Cependant, dès qu’on eut accosté et que fut jetée la passerelle, tout changea, j’éprouvai pour la ville une poussée de désirs, et l’idée que j’allais voir des rues, des foules, des boutiques, toute l’existence active de la terre, m’enivra. Un navire en mer, c’est une prison. La terre, c’est la liberté, c’est la délivrance. Et voilà pourquoi les escales sont aussi charmantes. La lourde porte de la prison s’est ouverte ; on s’est élancé au dehors, on voit tout avec des yeux ravis : l’abondance, le débordement des sensations après l’austérité et la compression du cloître… Chaque chose en prend tout son charme et tout son parfum.
Je n’ai jamais vu Marseille plus belle. Nous traversions les docks avec joie. Nous passions rapidement entre les wagons, au milieu des sacs et des ballots de marchandises, parmi le halètement et le sifflement des machines. Et nous possédâmes passionnément la Cannebière, le Vieux-Port, la Corniche et le Prado. L’escale, cette pose d’oiseau entre deux vols, était encore plus délicieuse pour nous, parce que, le lendemain nous repartions pour les pays inconnus, à l’aventure !
On voit une côte montagneuse déserte. Pas de maisons. Des montagnes nues, rébarbatives et mystérieuses. Quelque chose se cache là derrière : ce pays qui se dissimule inquiète. Un silence, une immobilité impressionnante. Le sentiment d’être guetté, d’être vu et de ne pas voir… Notre Admiral s’approche de la terre, avançant sur une eau blanche et plate qui fait mal aux yeux. Il passe entre deux navires qui, immobiles, ont l’air d’épier la côte. Nous entrons dans une baie ; nous apercevons une plage et quelques maisons, et, bientôt après, une petite ville bleue, fraîche et comme en porcelaine, bâtie sur une colline. Pas de port : seulement un môle en bois qui avance dans la mer.
Et voici l’Admiral, entouré de longues barques, qui sont montées par des hommes habillés en turcs, gesticulant, baragouinant. Et l’on est tout étonné. On est entré tout à coup dans un nouveau monde. Un de ces Turcs, qui porte une jolie veste rose, a grimpé à bord ; il s’est emparé de mon sac et il a décidé qu’il me guiderait : je le suis docilement. Dans la barque, les hommes vêtus en turcs nagent vers le môle. Notre guide nous parle français ; il est plein d’égards pour nous, — mais il parle aussi dans sa langue aux rameurs, et il discute avec eux, ce sont des cris : il nous a défendu, paraît-il, contre leurs prétentions… On débarque et nous arrivons devant la porte de la ville. Sous une voûte, un Marocain, tout de noir vêtu, solennel, est assis à la turque. C’est un douanier, à ce qu’on nous apprend. Il n’aime pas à être dérangé. Nous n’avons pas de fusils, non ? cela va bien. Visiter nos sacs, peuh ! à quoi bon ? Il nous fait signe de passer et de le laisser en paix.
Nous pénétrons alors dans Tanger, et c’est le rêve qui continue : Une rue étroite, tortueuse, qui monte, une foule tout orientale, des boutiques petites et sans profondeur, des échoppes où, sur des tapis, des gens sont assis ; un âne passant de temps en temps au milieu des groupes qui s’ouvrent pour lui faire place. Cela est si resserré, si tassé, et la ville est si bien enfermée dans ses murailles, on est tellement comme à l’abri dans un fort, et l’on voit si peu d’Européens, ni rien qui soit d’Europe, qu’on a tout de suite l’impression d’un nid de pirates. On dirait qu’ils sont là, dans la ville où ils se réunissent sur la côte barbaresque, pour partager le butin, là où ils reviennent après avoir écumé la mer. Tanger est cachée. Quand on y arrive, de la Méditerranée, on ne la voit que lorsqu’on est devant. On a l’impression qu’elle s’est dissimulée exprès. Et point de port. Et les montagnes que nous apercevions tout à l’heure du bord, ces montagnes mystérieuses ! Oui, c’est une petite ville arabe de voleurs de mer !
Et puis l’on monte, on monte la rue pavée à l’arabe, pleine de trous, et où les pieds européens se tordent… On arrive enfin à une sorte de place sur laquelle se trouvent deux cafés français, — une petite place, deux petits cafés, — puis la rue arabe recommence. Notre guide nous expliquait qu’aujourd’hui justement se célébrait une fête : si nous prenions des ânes, nous pourrions arriver à temps au plateau de Merxan où elle avait lieu… Mais nous débouchions sur un vaste terrain montueux, le Socco, le marché ; par terre des étalages de légumes et de fruits, et des gens en burnous assis sur le sol, puis le coin des étoffes où les femmes choisissent des voiles et des mousselines, puis les sucreries, et puis la ferraille. Dans un angle du Socco, des ânes, des mulets, des chevaux. Sous une petite tente, un coiffeur rasant la tête d’un patient immobile. Et c’était une foule animée. Des femmes, la figure couverte, drapées comme Marie-Madeleine, dans des étoffes blanches. On se sentait dans un pays biblique. Des petits ânes, très chargés, passaient constamment. Des cavaliers fiers, en manteau rouge, attendaient. Voilà des hommes de Sousse, d’une couleur rouge foncé, des Rifains, qui gardent sur le sommet de leur tête rasée une petite mèche de cheveux, des femmes kabyles au large chapeau de paille, des juifs en robe noire, des mères qui portent leur enfant sur le dos. De temps en temps, dinn, dinn, dinn, et c’est un marchand d’eau qui passe en courant d’un pas égal ; il a les jambes et les bras nus, il va, le corps penché en avant à cause de l’outre sur son épaule ; il est beau, il semble un esclave égyptien soudain sorti d’un bas-relief…
Sur la route, qui se dirige vers la campagne, toute cette foule se presse, regagnant les villages. Dans la poussière, les mendiants, d’une voix lamentable, récitent des prières. Un aveugle sans prunelles, aux deux orbites vides et roses, assis sur une borne, tend la main…
Le guide nous a conduits à l’hôtel, qui est en haut du Socco et domine la bleue Tanger. J’ai une chambre d’où l’on découvre la ville et la mer. C’est un hôtel d’Afrique, précédé d’un jardin sombre, avec un grand vestibule dallé et frais, et où circulent des domestiques en veste arabe, en fez, et des petites négresses pieds nus, un foulard jaune sur la tête. Un grand diable d’Anglais, aux jambes enveloppées de leggins, et sa femme, qui porte un casque colonial, un peintre, des officiers y prennent leurs repas par petites tables. Dans ma chambre, il fait froid ; ici, à Tanger, au 1er septembre, le vent vous fait frissonner, tandis qu’en face, à Gibraltar, on étouffe. L’azur du ciel devient mélancolique quand on grelotte. Et l’on souhaiterait une atmosphère moins cristalline et plus de tiédeur.
Mais notre guide nous attend à la porte du jardin avec de petits ânes. Nous nous installons sur les bâts énormes qui vous écartèlent les cuisses, et nous partons à travers un chemin ombragé que bordent, de loin en loin, de charmantes maisons de campagne espagnoles. Le chemin, comme tous les chemins en pays arabe, ne paraît tracé que par le pied des passants ; il est capricieux, il suit les inégalités du terrain, il va, vient, descend, remonte, il est charmant. Nous trottinons, dépassant les gens qui reviennent du Socco, et enfin, après avoir vu un beau paysage, nous arrivons au plateau de Merxan. C’est un immense rectangle point égalisé, point aplani, où l’herbe pousse et qu’entourent des maisons habitées par des banquiers et des riches commerçants juifs fixés depuis longtemps à Tanger. Nous croisons justement quelques-uns d’entre eux avec leur famille. Ils sont vêtus à l’européenne, d’une façon voyante et avec recherche. Mais il y a une foule arabe surtout sur le Merxan. Des femmes assises sur le sol par groupes, des cavaliers immobiles qui attendent, des enfants qui courent çà et là. Enfin, une ligne de beaux chevaux apparaît, chargeant à travers la plaine. Les Arabes brandissent en l’air leurs longs fusils et font une décharge. Puis un cavalier seul, vêtu d’un jaune éclatant, caracole. La charge repasse, soulevant des nuages de poussière dorée, faisant trembler la terre. La mer là-bas est infiniment paisible, le soleil décline et un rayonnement délicat auréole toutes choses.
Remontés sur nos ânes et quittant le Merxan, nous avons croisé avec étonnement une sorte de petite voiture à quatre roues traînée par des chevaux. C’est la seule voiture de Tanger : elle appartient à je ne sais quel consulat.
Nous sommes entrés à l’Alcazaba, la vieille ville entourée de murs crénelés. On y trouve sur une place le palais, nullement superbe, du gouverneur. On y visite la prison : des prisonniers passaient leur tête par un trou rond et nous regardaient d’un air sombre ; ils tendaient vers nous des mains avides. Dans un cachot noir, on percevait un grouillement singulier. Il y avait une cellule spéciale pour les juifs. Sur la place, des enfants, en djellaba de couleur vive, nous poursuivirent en nous demandant un sou.
Le soir, notre guide était venu nous chercher à l’hôtel. Nous traversâmes le Socco obscur et maintenant désert, et nous gagnâmes la grande rue. On y trouvait, de loin en loin, une échoppe éclairée ou quelque boutique de juif dans laquelle brillait une lampe. C’était un travail de marcher ; on ne pouvait, dans la nuit, éviter tous les trous que forment les pavés enfoncés ; il fallait avancer avec précaution. Nous parvînmes à la place aux deux cafés ; elle était éclairée, et des caftans, des burnous, des gandourah s’y promenaient. Notre guide nous fit prendre à main gauche un passage étroit, et nous commençâmes à errer à travers l’enchevêtrement des ruelles étouffantes et resserrées comme des couloirs. Nous visitâmes d’abord un café espagnol où deux danseuses en robes pailletées et un homme à veste andalouse tambourinaient du talon sur le parquet ; puis une musique arabe nous attira au fond d’une maison basse ; là, dans une salle tapissée de nattes, des matelots regardaient une famille juive sur l’estrade. Mais le plus bel endroit se trouvait justement sur la place. On poussait une porte très lourde et l’on se trouvait dans une sorte de cour, peinturlurée en bleu foncé, entourée d’une voûte carrée où les Maures, assis sur des escabeaux, buvaient du café ou de l’aguardiente en fumant.
Là aussi, il y avait une estrade sur laquelle quatre ou cinq femmes assises, frappant des tambours arabes et touchant un instrument à deux cordes, accompagnaient une grosse juive qui chantait sur un ton très élevé une mélopée monotone. Comme elle forçait sa voix, on voyait les veines de son cou se gonfler ; elle suait à grosses gouttes et elle s’arrêtait, de temps en temps, pour boire un verre d’eau. Notre guide nous avoua que ce qu’elle chantait là, c’était une complainte sur le meurtre par les Français d’un marabout de Casablanca : les Maures écoutaient. Quand elle eut tout à fait fini, elle retourna s’asseoir à côté des autres et alluma une cigarette.
A Tanger, on a l’impression constante d’une sourde hostilité de l’indigène ; il demeure indéchiffrable, il ne témoigne pas sa haine. On la sent cependant continue, dissimulée, mais toujours présente. Et l’on éprouve un malaise d’être là par la force, de s’imposer à cette race, de n’être pas accepté par elle. On soupçonne chaque propos et chaque geste ; on n’est jamais en confiance, on est chez l’ennemi. On sent qu’il faut se tenir sur ses gardes, il flotte une atmosphère de menace latente ; on se maintient par la crainte, on a le sentiment que si l’on faiblissait un peu, une force sauvage remonterait à la surface de cette race dominée et vous emporterait. Vingt fois par jour, on entend le canon du stationnaire qui se trouve toujours dans les eaux de Tanger : il multiplie les saluts, les politesses. Il faut qu’on n’oublie pas qu’il est là. Et alors une nouvelle conscience s’éveille en vous ; en même temps que vous êtes touché, séduit par la poésie de la vie arabe, devant l’impossibilité de pénétrer ces cœurs étrangers, vous sentez naître en vous une conscience européenne. Tout en vous répétant qu’il est injuste, qu’il est odieux de venir opprimer chez eux des gens qui ne vous demandent rien, vous vous sentez de la race forte, de la race dominatrice, ennemie de l’autre et voulant la réduire.
Je me suis promené dans Tanger en admirant le courage et la volonté des colons. Depuis ces dernières années, beaucoup de Français sont venus, et sur la plage, devant la mer, ils ont construit déjà une rangée de maisons européennes ; on voit là des magasins, des entrepôts bourrés de marchandises. Les Espagnols étaient établis sur cette terre depuis des siècles ; Tanger comprend tout un quartier espagnol, un quartier étouffé, compliqué et très joli, aux maisons bleues dans lesquelles, par les portes entr’ouvertes, on aperçoit de frais patios ; le Maure de Tanger parlait espagnol, maintenant il baragouine tant bien que mal le français. Et encore que la poste et le consulat allemand soient fort somptueux, c’est le Français, cependant, qui est considéré ici par l’Arabe comme l’étranger à craindre, comme le maître puissant.
J’ai loué un cheval et je suis allé galoper un peu devant la mer, sur le sable que le flot venait mouiller. Il faisait une bise aigre. Le ciel était d’un bleu froid. Dans la baie, deux cuirassés se tenaient immobiles ; un steamer était à l’ancre. Des files de petits ânes, chargés de ballots, se hâtaient sur la plage, poussés par des Arabes aux jambes nues vers les montagnes qu’on voyait là-bas. J’éprouvais un singulier plaisir à me trouver seul sur cette plage d’Afrique lointaine et barbare encore, et je devinais la joie du colon qui mène avec énergie sa vie aventureuse parmi l’inimitié de l’Espagnol et du Marocain.
Pour le simple passant, cette existence-là offre quelque chose d’attirant. D’ailleurs Tanger, si peu européenne, étonne et séduit. Le marché du Socco, les ruelles fraîches, et la foule colorée qui se presse dans la Grande-Rue, les cavaliers maures, les petits ânes, les femmes voilées, et les vieux Arabes qui veulent toujours vous vendre quelque chose, ce long fusil damasquiné, ce poignard, ou cette poire à kif, et Abdeslam, notre petit guide qui, plein de vanité, éloigne les importuns, et le vieux clown soudanais qui fait le fou, tout est nouveau, tout est frappant… Le voyageur, qui n’a fait que toucher la terre d’Afrique, et repart sur le petit vapeur de Gibraltar, croit, en payant son passage à un vieux Turc très horrible, à lunettes noires, que, comme dans les Mille et une Nuits, ce vilain récolteur de douros, se transformera tout à l’heure en belette ou en singe… Il emporte des provisions de rêve, il va maintenant désirer l’Orient.
Quand l’Admiral, filant sur Tanger, passa devant Gibraltar, c’était l’heure du déjeuner. Nous étions à table. Quelqu’un dit : Gibraltar ! La salle à manger fut vide aussitôt ; sur le spardeck, tout le monde, maintenant, regardait avec attention cet extraordinaire rocher. Théophile Gautier l’a comparé à un Sphinx, il nous fut impossible de deviner pour quelle raison. La forme de Gibraltar, en effet, ne rappelle rien. Elle est bizarre et saugrenue. C’est un morceau de pierre tombé d’une montagne, montagne qui s’est évanouie, et il reste là, ni rond, ni cubique, avec une pointe dressée vers le ciel et des versants d’une inégalité gênante. Ce n’est pas une pyramide, ce n’est point un cône, c’est un caillou absurde, mal cassé, informe et incomplet, qui se dresse tout à coup au milieu de la mer et saisit le voyageur d’étonnement. Il effraie, on le sent miné, travaillé pour le mal. On dirait même qu’il est blindé : de la mer, on aperçoit de larges surfaces en pente, nues, et qui brillent comme si elles étaient pavées d’acier.
… Sur le petit vapeur qui traverse la mer de Tanger à Gibraltar, assis sur un coffre au milieu d’Anglais, d’Andalous et d’Arabes, nous repassions notre espagnol. En regardant la Méditerranée et, tour à tour, la côte d’Afrique et la côte d’Europe, nous nous répétions les phrases de notre manuel de conversation. Et c’est dans le port de Gibraltar, en effet, dans la barque qui nous menait à quai, que nous devions entendre pour la première fois ce très superbe : Hombres Caballeros ! Le patron parlait à ses rameurs… Mais nous débarquâmes, et l’on nous mena aussitôt à un policeman qui, orné de son casque en cuir bouilli, paraissait aussi flegmatique sous ce soleil du Sud, tout au bout de l’Espagne, que s’il eût fait les cent pas à London, dans le Strand. Il nous regarda, nous demanda qui nous étions, puis nous délivra un ticket qui nous permettait d’entrer dans la ville. Alors nous passâmes une porte de forteresse, franchîmes un double rempart et nous nous trouvâmes à l’intérieur de la cité.
Je ressentis une sorte d’écœurement en voyant une rue anglaise, à la chaussée macadamisée, une ligne monotone de petites maisons de briques, et des fenêtres à guillotine. Il y a deux heures, nous étions à Tanger ! Il me paraissait tout à fait extraordinaire de nous promener maintenant en Angleterre.
On nous conduisit à l’hôtel, où nous remîmes le ticket que le policeman nous avait donné. Mesure d’ordre… Dans cet hôtel : chambres anglaises et lits espagnols. D’ailleurs, nous ne fîmes que poser nos sacs, et nous ressortîmes. Il faisait chaud à Gibraltar, on ne sentait plus la bise aigre de Tanger, ni l’air frais. On étouffait. La rue, droite, était morne, plongée dans une torpeur sans charme. Je revoyais d’un air désolé les innombrables « Tobbacconist », les bars, les boutiques correctes, aux larges vitrines, de toute cité anglaise. Pour nous, qui venions d’en face, tout ici suait l’ennui, l’ordre, la monotonie de la vie. Les gens bâillaient sur leurs portes, en regardant d’une prunelle éteinte dans la rue où il n’arrive rien. De temps en temps, deux vestes rouges, le calo sur le coin de l’oreille, la badine sous le bras, passaient, minces, raides et le pas mécanique. Une bicyclette sonnait, glissant sur le macadam. Ah ! Tanger ! les ruelles étranglées, le sol mal pavé, la foule bavarde, les échoppes arabes, les ânes et les cavaliers ! Que c’était donc propre ici ! Que c’était donc respectable ici !… Ah ! la chère, la belle crasse de là-bas !… Oh ! la bonne, la brave, la délicieuse pouillerie d’en face !
Et, en suivant cette rue de Gibraltar, toute la mélancolie anglo-saxonne, toute la platitude et la laideur britannique me donnaient mal à la tête. Il y a deux heures, j’étais encore dans le pays de la paresse divine, de la poésie et des contes, de ceux qui aiment la volupté du monde et de la vie, maintenant, et comme par un coup de baguette magique, j’avais été transporté sur une terre de régularité, de fastidieux travail, de faits exacts, où régnait par-dessus tout le besoin de comprimer la vie et d’étouffer la beauté.
Nous franchîmes les doubles remparts par une porte de la cité opposée à celle qui nous avait vu entrer, passâmes devant des canons et nous trouvâmes dehors… Là, c’était un jardin poussiéreux où l’on avait mis de faux rochers et des statues de généraux, mais tout de même, à cause de la flore méridionale, de la chaleur, de la sécheresse, on n’avait pas pu le rendre tout à fait anglais. Ce jardin s’élevait par échelons sur la colline. Nous le traversâmes, puis nous avançâmes un peu sur la route, d’où l’on découvrait la mer. Mais une grande impression d’aridité nous fatiguait. Nous redescendîmes, passant entre des cottages : sur des plaques de cuivre nettes, on lisait des noms anglais.
Une grande construction en bois nous arrêta, tandis que nous reprenions le chemin de la ville. C’était une sorte de music-hall ou de salle de bal pour soldats, un escalier menait aux étages supérieurs où se trouvaient des loges d’officiers ; un écriteau l’indiquait. A cette heure de la journée, la salle était vide. Nous pûmes cependant boire un verre d’ale au bar. On nous y rendit de la monnaie anglaise : alors nous eûmes dans nos poches, avec des douros espagnols, des écus français et des hassani marocains, des schillings de la Grande-Bretagne : nous pouvions faire du commerce avec quatre pays.
Nous continuâmes notre promenade. Près de là s’élevaient de vastes arsenaux, une armée d’ouvriers en sortaient. Puis nous rentrâmes dans la ville.
Ce à quoi nous ne fûmes pas insensibles à Gibraltar, c’est à la table de l’hôtel, elle était bonne, et, en outre, de toutes les bouteilles de Valdepeñas qui se débouchèrent pour nous en Andalousie, c’est sur le rocher de Gibraltar, certes, que nous bûmes la meilleure. Dans la soirée, je découvris pour quelques sous d’excellents havanes, et, de ce moment, je ne fis plus aucune difficulté de proclamer que, pour du moins ce qui regarde la bouche, le ventre et l’estomac, les Anglais ont bien des qualités. Pourquoi faut-il donc que ces gens-là, dont les maisons sont aussi agréables, bâtissent de si tristes villes !
Après le dîner, nous allâmes un peu dans la rue. De loin, nous apercevions une porte éclairée, nous entendions des flons-flons d’orchestre ; nous nous approchons : affiche de concert. Cela ne nous déplaisait pas, il nous semblait piquant, si près encore de nos soirées dans les cafés dansants arabes de Tanger, de voir un spectacle anglais. Nous nous disposions donc à franchir le seuil, quand un grand diable de sergent à cheveux carotte nous repoussa : « Military Only », dit-il, et il se croisa les bras, solide. C’était là encore un music-hall pour militaires, et les vestes rouges seules y pouvaient entrer. Est-ce donc un spectacle si horrible, quand ils s’amusent, qu’il ne soit pas permis au civil ? Ou craint-on des rixes entre ouvriers et soldats, entre Anglais et Espagnols ? Ou redoute-t-on qu’un espion, ayant enivré un militaire, lui arrache les secrets de la défense de Gibraltar ? Ces troupiers, condamnés à ne s’amuser qu’entre eux, et soigneusement dérobés au public, cela me parut une singulière conception britannique… Nous dûmes nous rabattre sur une sorte de casino espagnol où l’on donnait des zarzuelas qui ne nous parurent pas très drôles.
Nous quittâmes Gibraltar le lendemain matin.
Le rocher est relié à la terre par un petit isthme sur lequel il serait facile d’établir une ligne de chemin de fer. Mais les Anglais ne désirent point créer une communication qui pourrait devenir dangereuse : sans rail, ils jugent leur isolement plus sûr. Donc, pour passer en Espagne, à quoi Gibraltar tient par une langue de terre, il convient de s’embarquer. Un bac fait le service entre Gibraltar et Algésiras, où aboutissent les Chemins Andalous.
Nous voguions donc, de bon matin, sur la Méditerranée, savourant la délicatesse de l’eau, du ciel, des couleurs, et, là-bas, les laiteuses montagnes d’Afrique. Il y avait à bord, avec nous, une petite troupe d’enfants guidés par deux clergymen. Ces clergymen, sous ce ciel, sur cette mer où passait la brise voluptueuse de l’Andalousie, ces deux hommes raides et noirs au milieu de ce grand paysage bleu, cela semblait un paradoxe tout à fait bizarre. Et, tandis que le bac filait sur Algésiras, nous ne pouvions nous tenir d’admirer en nous-même la force, la ténacité, la personnalité de cette race anglaise, qui, ayant fondu là, sur ce rocher d’Espagne, y a enfoncé ses griffes, s’y est attachée, et, sur une terre où tout était contraire à sa propre nature, devait dissoudre celle-ci ou la corrompre, s’est maintenue pure, s’est conservée intacte, et loin d’être modelée par elle, l’a modelée. Modelée à ce point que Gibraltar, dans le Sud, en Méditerranée, en plein pays maure, semble seulement un rocher détaché de la Grande-Bretagne, qui, ayant flotté sur les mers, se serait arrêté là. Nous étions étonnés par cette force de rester toujours identique à soi-même, par cette dureté, par cette immalléabilité, et, bien que toutes choses ici se témoignassent admirablement opposées au caractère, à la conception de la vie, à l’idéal anglais, au moment où le bac allait aborder à Algésiras, dont notre cœur approuvait déjà le joli groupement de maisons blanches, nous nous retournâmes pour saluer avec respect le rocher des vestes rouges.
Quand nous projetions notre tour d’Andalousie, nous avions prévu Malaga, Grenade, Cordoue, Séville et Cadix. Mais à Tanger, une accueillante Anglaise de Gibraltar, chez laquelle notre petit guide maure nous avait conduits, célébra si fort la ville de Ronda, que nous décidâmes d’y coucher en allant à Malaga. Glorifiée soit-elle cette personne de noble goût, et que les étrangers honorent sa maison ! Car Ronda est une des plus belles parmi les beautés de l’Andalousie. Il est juste de dire qu’en Espagne le lieu est célèbre : il a donné naissance à des maîtres ès tauromachie.
En descendant à Algésiras du bac de Gibraltar, nous étions montés dans le train de Bobadilla. La matinée était charmante. Nous partîmes à petite allure, et ce fut une promenade sans hâte, une flânerie à travers de beaux paysages ; un ciel d’azur uni était tendu sur les montagnes, pas la moindre brume n’obscurcissait l’air, les choses s’offraient dans leur beauté, nues, sans un secret, sûres de la perfection. Accoudés aux portières, nous contemplions le rude, le fort et magnifique pays qui se déroulait sous nos yeux ; un air frais circulait dans le wagon ; nous étions heureux. De temps en temps, arrêt : on avait atteint une station ; on restait dix minutes, un quart d’heure, nonchalamment, comme des gens qui ne sont pas pressés, qui se disent : « bah ! nous avons bien le temps… » Et, en effet, les voyageurs avaient tout le temps d’examiner la petite gare paisible, le quai bordé d’arbres verts, le carabinier, son bicorne de cuir, la bretelle jaune de sa carabine, un paysan rasé, en petite veste avec un grand chapeau noir. Enfin, l’on entendait une cloche, la locomotive sifflait, elle toussait, elle crachait, il se propageait entre les wagons un vacarme effrayant de chaînes, on sentait deux ou trois secousses : tiens ! on était reparti !
D’abord, nous avions aperçu dans le lointain de belles montagnes rousses, ardentes, se détachant vivement sur le ciel. Nous nous en étions peu à peu rapprochés et, maintenant, la ligne du chemin de fer s’élevait ; tantôt nous passions un rio sur un pont hardi, tantôt nous roulions à flanc de mont, entre une muraille de roc puissante et le lit profond d’un torrent. Puis nous nous engagions dans un défilé, nous franchissions un tunnel et, tout à coup, la montagne s’ouvrant, nous apercevions, très loin au-dessous de nous, d’immenses plaines engourdies sous la caresse du soleil.
Nous arrivâmes à Ronda.
C’est une calme petite ville aux maisons éblouissantes. Dans la voiture qui nous menait à l’hôtel nous remarquions, en suivant les rues, sur les murs blancs des maisons, des manières de bow-window d’une forme gracieuse. Ces fenêtres-là, fort répandues à Ronda, mais point ailleurs, et dont je n’ai pu savoir avec certitude le nom espagnol, ajoutent du charme, une rustique élégance aux habitations villageoises de l’endroit.
Le patron de l’hôtel nous dit, après le déjeuner, qu’aujourd’hui c’était jour de feria, mais point de courses de taureaux, « à cause du Rif »[3]. Privée des courses, cette feria était modeste. Nous ne nous y attardâmes point, et nous allâmes sans délai aux jardins de l’Alameda[4].
[3] La guerre du Maroc.
[4] Alameda, c’est, en Andalousie, le nom des promenades bordées d’arbres à l’intérieur des villes. A peu près : le cours.
Il y a là une terrasse d’où l’on découvre le plus formidable paysage, une terrasse à pic, sur une plaine immense. Mais « plaine » est impropre, c’est un terrain bosselé, accidenté, qui s’étend indéfiniment jusqu’à l’horizon, un océan terrestre. Très loin, une chaîne bleue et vaporeuse s’oppose au ciel implacable. Un peu plus proches, de rudes montagnes cuivrées… Dans la vaste vallée, on dirait que sont étendus des tapis de rouille et d’or ; des maisons, un bois semblent des jouets qu’un petit enfant a oubliés là ; une mince rivière coule parmi la plaine, capricieusement elle rejoint un moulin. On voit les rubans des routes qui contournent les collines et descendent les vallons. Et la paix, une paix grandiose enveloppe tout…
Nous désirâmes nous rapprocher de la plaine. Nous franchîmes un pont qui enjambe une profonde crevasse. Au fond, la gorge est parsemée de blocs énormes, et c’est sur de géantes colonnes de granit, pareilles à des piliers babyloniens, que Ronda, toute blanche, s’élève. Il semble qu’on y soit plus près du soleil, tant son éclat est fort ; ces murs rayonnants vous aveuglent. Nous nous sommes étendus sur un plateau situé un peu au-dessous de la ville, mais dominant la vallée, et nous sommes restés là des heures, au milieu de la force de la montagne, dans l’atmosphère farouche et pure, contemplant les pics bleus des sierras. Très loin, suivant lentement une route, des caravanes d’ânes chargés de grains descendaient au moulin. Nous admirâmes dans la ville leurs harnais, des harnais rouges et jaunes, et beaux comme des cris.
Bobadilla, qui porte le nom du petit roi Boabdil, est un embranchement du chemin de fer Andalou. Nous y stationnâmes quelques quarts d’heure quand nous repartîmes sur Malaga. Le long des quais, il y avait foule, plusieurs trains étaient arrêtés sur les voies. Un petit porc noir qui, le groin fureteur, cherchait sa nourriture entre les wagons, nous y amusa un moment. Je ne pus savoir si c’était un voyageur qui changeait de train, ou bien un habitant de Bobadilla.
Les abords de Malaga sont délicieux. C’est d’une fertilité de paradis terrestre. Partout de riches « huertas » abondantes et plantureuses. Tout verdoie, de ce vert clair, oriental, des feuilles nourries de chaud soleil : un délassement. Aux stations, des enfants vous proposent — Señorito ! Señorito ! — des corbeilles de fruits et de grands verres d’eau. Un aveugle, conduit par une petite fille, de portière en portière, demande l’aumône.
A Malaga, nous trouvâmes une poussière grise comme celle de Marseille et une animation charmante. La ville est moderne et sans grand caractère. Quelque chose de Niçois, de la douceur, de la fadeur, de la mollesse. C’est une cité du Midi, prospère, avec beaucoup de cafés. Mais les filles y ont de beaux yeux, un teint velouté, des dents admirables, et les soldats semblaient recherchés. Là encore, point de courses de taureaux, à cause du Rif, mais nous vîmes un concert populaire — dans une salle peinte en bleu, autour de tables supportant des « alcarazas » rouges, des grands feutres et des gueules rasées — où nous entendîmes chanter d’admirables malagueñas, le chanteur assis sur une chaise, près du guitariste, et dévidant, immobile, tous ses couplets, tandis que l’autre l’accompagne sur un rythme bizarre, en tapant sur la caisse de sa guitare autant qu’en en pinçant les cordes.
Et dans les rues un châle noir sur une jupe rose ! Une fleur piquée dans une chevelure !…
A Malaga, nous passâmes des heures bien douces dans un bois d’eucalyptus au milieu d’un paysage de lumière, parmi la gloire des montagnes et de la mer.
Mais nous assistâmes aussi à un embarquement de troupes pour le Maroc et, malgré le soleil radieux, malgré le ciel pur d’Andalousie, ce n’était pas gai. On voyait la belle et rude montagne qui domine la ville, et qui supporte encore les ruines ardentes de l’Alcazaba, on apercevait dans l’azur les frondaisons des jardins de l’Alameda ; ce matin-là était éclatant. Mais il y avait deux files de soldats alignés sur le quai, en face d’un vapeur.
« Le départ a eu lieu avec l’enthousiasme habituel », lisait-on chaque jour alors dans les journaux espagnols. Enthousiasme peu expansif. Nous n’entendîmes pas un seul cri. Les malaguegnes au grand feutre plat, à la figure sombre et mal rasée, qui étaient montés sur des piles de planches afin de mieux voir, éprouvaient une sorte d’enthousiasme qui les rendait muets et immobiles. Ils suivaient des yeux les petits soldats, lesquels, l’exécution de l’hymne national terminée, avaient fait un à-gauche, et montaient à bord, avec beaucoup d’ordre.
Les petits soldats, dans leur uniforme de flanelle blanche à rayures, avec leur calo rouge et noir, ne posaient pas du tout aux héros. Ils ne mettaient pas le poing sur la hanche. Ils étaient très simples, quotidiens et gentils. On sentait bien du reste qu’ils étaient fort émus. Et les hommes de Malaga les regardaient monter, un à un, sur le transport, et ils songeaient à chacun d’eux : « Encore un… » Et ils songeaient à chacun d’eux : « Reviendra-t-il, celui-là ? »… Et ils avaient la vision des montagnes mystérieuses du Maroc où les petits soldats s’enfonceraient bientôt… Et ils songeaient : « Est-ce celui-là qui sera frappé ? Est-ce celui qui le suit ?… » Mais ces réflexions ne se disaient point, la foule était secrète, et sous ce grand ciel lumineux et pur, cela était poignant… Les petits soldats montaient toujours, un à un, par la passerelle, et on les voyait maintenant en haut, serrés sur le pont du vapeur qui allait les emporter.
Nous traversâmes la place, et nous gagnâmes un hangar qui se trouvait en face de la « Ciudad de Cadiz », et sous lequel l’état-major et les autorités s’étaient installés, parmi des fûts de malaga et des boîtes de raisins secs. On avait porté là un fauteuil, des rockings, quelques chaises. Un gros général, habillé de khaki et ceinturé d’un ruban couleur de framboise, assis dans le fauteuil, présidant la cérémonie de l’embarquement, causait avec un colonel et un vice-amiral, en caressant la pomme d’or de sa petite canne de commandement. Il était sérieux, digne et important. Le colonel aussi était important. Et l’alcade aussi. Quand la troupe fut embarquée, un valet de pied fit signe à un landau qui s’approcha du hangar. L’alcade salua gravement, puis il monta dans la voiture. Le général resta dans son fauteuil, le vice-amiral dans son rocking, et les officiers sur les chaises. Ils parlaient d’un air profond et faisaient des gestes nobles. Quelques curieux les considéraient avec attention, comme des personnages de théâtre, en guettant tous leurs mouvements.
Mais là-haut, sur le bateau dont la cheminée fumait, les petits soldats, accoudés aux bastingages, regardaient la ville et les montagnes, regardaient leur Espagne. Et d’en bas, une foule muette regardait les petits soldats…
Pour aller à Grenade, nous repassâmes par Bobadilla, à l’heure du déjeuner. Le train, malheureusement, ne nous laissait pas le temps de nous y asseoir. Nous achetâmes rapidement au buffet une sorte de saucisse froide à la tomate et au piment et de ce pain espagnol qui a un arrière-goût de terre et de roquefort, et nous nous régalâmes dans notre wagon. A une petite station nous trouvâmes des grenades, elles étaient vertes, elles n’étaient pas à point, l’on aurait dit des pommes : n’importe, c’était des grenades pour nous, c’était des grenades !
Dans notre compartiment, un gras Andalou chantonnait, étendait ses jambes, soupirait. Il eût bien fait la conversation, mais notre vocabulaire était un peu restreint, vraiment, pour pouvoir l’intéresser. A le regarder, un Parisien l’eût jugé sans-gêne, car la politesse parisienne comprend mal celle du Midi, qui comporte elle-même bien des variétés. Moi qui sortais de la courtoisie napolitaine, grimacière et démonstrative, j’étais enchanté du savoir-vivre andalou, plus réservé de beaucoup et d’une élégance réelle. Jamais un Espagnol, par exemple, ne mangera quoi que ce soit en public sans en avoir offert d’abord aux inconnus présents. Il est assez libre, c’est vrai, mais il vous laisse libre aussi ; il ne vous accable pas de prévenances à la napolitaine ; il garde vis-à-vis de vous sa noble attitude indifférente, cependant ayez besoin qu’il vous oblige, qu’il vous renseigne, posez une question, ce sera aussitôt le plus complaisant homme du monde.
La gare de Grenade est située dans un quartier ingrat, et, pendant dix minutes, l’on ne soupçonne absolument rien de ce qu’on va voir. On traverse une cité banale. Cependant la voiture a tourné, elle monte au pas une petite rue, et, tout à coup, métamorphose ! Sans qu’on s’y soit attendu, on est entré dans un parc, et l’on va maintenant au galop sous une voûte de verdure, parmi des grands arbres qui montent jusqu’au ciel, et à la fraîche musique de cent ruisseaux coulant sous le feuillage. Nous sortons de ce bois, rempli de mystère et de poésie, nous sommes sur un sommet, et les chevaux s’arrêtent devant une petite maison. C’est la pension, qui est charmante, avec son joli dallage de couleur, ses arcades arabes, ses murs couverts d’azulejos, son jardin et ses jets d’eau. Et, comme dans le parc que nous avons traversé à l’instant, il monte dans la maison, par les fenêtres ouvertes, un bruit délicieux d’eaux courantes.
Nous étions sur le plateau de l’Alhambra, nous l’ignorions encore… On nous dit qu’on ne servirait le dîner que dans une heure. Nous sortîmes, et le hasard nous conduisit à la terrasse, qui, au pied de l’Alcazaba, l’antique forteresse des rois maures, domine une partie de la ville. Nous nous assîmes sur le parapet et nous nous absorbâmes dans la contemplation, au crépuscule, des vieilles maisons blanches aux toits roux, des paisibles cours intérieures, des églises à tours carrées qui portent un petit chapeau. De la ville, les bruits touchants du soir montaient jusqu’à nous. Sur une plate-forme, un blanc monastère reposait, tranquille, un petit bouquet d’arbres à côté de lui. Des ruelles serpentaient. Les montagnes, derrière la ville, se superposaient, de plus en plus lointaines, de plus en plus vaporeuses. Et tout cela était plein de charme et de grandeur. Mais c’est dans la nuit, quand, après le dîner, nous revînmes à cette place, que Grenade nous apparut d’une enivrante beauté. La terrasse de l’Alhambra est située à une bonne hauteur : on est assez près de la cité pour en distinguer les détails, assez loin pour en être détaché. La nuit, ce champ de lumières, à la fois distant et prochain, toutes ces fenêtres où brillent des étoiles, cette vie qu’on devine sans la voir, derrière ces murailles, cette existence cachée, mais certaine, vous remplissent d’émotion et d’amour. Une rue muette se presse entre deux lignes de toits plus noirs que le ciel, ici un patio s’est éclairé, ses murs pâles, comme si la lune les avait caressés, se sont illuminés, là le rayonnement d’un réverbère a dessiné une ombre qui passait. On contemple la ville parée dans la nuit de tous ses petits points d’or, et l’on songe aux sentiments, aux joies, aux douleurs, à tous les moments de l’âme humaine qui veillent là dans le silence et l’ombre, et l’on est remué jusqu’au fond. Là, à nos pieds, dans cette antique Grenade : les gestes éternels que les morts ont faits, les gestes que feront ceux qui ne sont pas encore vivants, alors qu’à notre tour nous serons morts…
Un petit jeune homme s’approcha de nous et nous proposa de nous montrer des danses. Nous descendîmes avec lui vers les rues. Il parlait un français dont il était injustement fier. Je me rappelle que les deux mots « gran capitan » revenaient constamment sur ses lèvres, et j’en suis encore à me demander si c’est qu’il désirait désigner une rue, le héros d’une anecdote ou s’enorgueillir d’un fait d’armes national. Toujours est-il qu’il parlait, et il ne nous cacha point qu’il parlait aussi facilement l’allemand et l’anglais. Il nous conduisit dans un cabaret désert où quelques malheureuses femmes et un homme en bras de chemise exécutèrent pour notre plaisir un tango assez essoufflant : ils burent de bon cœur les rafraîchissements que nous leur offrîmes. L’endroit avait du caractère, cependant il ne nous satisfit qu’à moitié, nous eussions préféré sans doute que ce ne fût pas exprès pour nous que l’on dansât. Nous demandâmes à notre guide de nous conduire ailleurs, mais soit que Grenade fût mal pourvue, soit que le garçon fût peu au courant, nous ne pûmes en tirer autre chose que l’offre d’aller chez des gitanes.
Le lendemain, nous nous réveillâmes au bruit des fontaines dans notre chambre décorée à l’arabe. Nous prîmes du café dans le jardin de la pension, où il y avait une chose plus charmante encore que les autres. Dans le mur du jardin, on avait pratiqué une fenêtre. Et cette fenêtre, grillée avec art, donnait sur le beau parc que nous avions traversé hier, ce qui fait qu’en l’ouvrant on prenait, du jardin clair où l’on se reposait, vue sur les profondeurs ombreuses du bois, et la grille, qui ne permettait de passer qu’aux regards, rendait chères, plus chères et désirables, ces retraites si voisines : du jardin clos on s’échappait en rêve dans la forêt. Cette jolie idée arabe m’enchanta. Quel goût subtil de multiplier et d’aiguiser les désirs ! Celui de l’homme qui, passant dans le parc, voudrait être assis à la place de celui qui se trouve dans le jardin, celui de l’homme du jardin qui souhaite devenir le promeneur dans le parc. Ainsi, chacun dans un paradis, envie l’autre. Il n’est de paradis que sans fenêtre.
Sur le plateau de l’Alhambra et contigu à ce palais arabe, s’élève le palais espagnol que Charles-Quint y fit élever, mais qui ne fut jamais achevé. Les murs, les colonnes extérieures, les ornements des fenêtres sont terminés. Seulement, les riches fenêtres n’ont pas de vitres, et cet imposant palais pas de toit. C’est toujours l’âme mauresque la reine de ces lieux, c’est elle qui erre encore dans ces bois et qu’on sent passer sur la brise légère qui agite les feuilles. Même ces lourdes pierres, même la majestueuse fontaine du parc et même la porte aux trois grenades n’ont pu l’écraser, et Charles-Quint, ici, bien qu’il se soit inscrit avec force, n’est pas resté le maître : il est toujours chez les Arabes.
Une visite à l’Alhambra, c’est un rêve d’Orient, le rêve de cette fraîcheur dont on ne possède l’art délicieux que dans les régions brûlantes : au soleil le plus violent, l’ombre la plus forte. L’Alhambra n’est pas seulement un bijou de l’architecture, un exemple de ce qu’a pu produire l’art arabe dans son moment le plus parfait, c’est une leçon de volupté. Il ne suffit pas d’y admirer la légèreté et la délicatesse des portiques, la variété infinie et l’ingéniosité des motifs décoratifs, les couleurs des azulejos et la parfaite proportion des salles et des patios, autre chose ravit encore le visiteur délicat : c’est que ce palais était infiniment doux à habiter. Tout ici célèbre la gloire de l’eau courante et de la pénombre, les plus admirables biens des pays du soleil.
Chez ceux qui ont élevé ces murs, on sent une entente admirable des satisfactions et du délassement des sens, et c’est là qu’on comprend le mieux que, dans la connaissance du bonheur, les Orientaux seront toujours, et de bien loin, nos maîtres… D’abord, on rencontre l’eau dans le patio des myrtes, où l’on voit sous le ciel un grand bassin entouré de marbre que bordent des myrtes verts. De ce bassin, à travers les salles et les patios, et sous les portiques, court un système complet de rigoles pratiquées dans le dallage, ce qui fait que le palais entier, quand les rois maures l’habitaient, était rempli de ruisseaux courants. En outre, dans toutes les cours : bassins et jets d’eau. Quel enivrement, couché sur un tapis épais, dans une ombre exquise, les yeux errant nonchalamment sur les murs d’or d’un éclat atténué, d’entendre la voix limpide de l’eau chanter sur les marbres de la salle ! Puis s’approcher de la fenêtre à double ogive délicate, et se voir dans le ciel et planant sur Grenade !…
Car l’autre joie de l’Alhambra, c’est une situation divine. Chaque fenêtre encadre un tableau : de partout s’offre la ville et ses montagnes rousses. Une galerie extérieure longe une partie du palais d’où l’on a la plus belle vue, et à l’extrémité se trouve un petit pavillon qu’on appelle le « tocador de la Reina », ouvert de trois côtés sur le paysage. Là, au frais des zéphirs qui s’entrecroisent, on peut offrir à ses yeux un merveilleux régal. Cependant, un officier français du 2e régiment de ligne, garnisonnant à Grenade en 1823[5], n’y trouvait pas son plaisir ; pour se distraire, en effet, il a inscrit son nom et son grade, et son régiment, sur une plaque de marbre du tocador, et cet ouvrage, accompli comme par un marbrier, — ces lettres profondes, nettes et d’un alignement militaire, — n’a pas dû lui coûter moins de plusieurs mois de travail. Sans doute un des plus beaux témoignages qu’on puisse trouver de l’ennui de la caserne !…
[5] Expédition du duc d’Angoulême.
Mais il n’y a malheureusement pas que cet officier porte-drapeau pour dégrader l’Alhambra ! On le restaure. Quand nous le visitâmes, des échafaudages étaient dressés, la cour des Lions était encombrée de maçons, un âne portant des sacs de plâtre déambulait sous le portique. Aussi l’antique palais des rois maures a-t-il en grande partie l’air d’un bâtiment neuf, de quelque copie en pâtisserie élevée hâtivement pour une Exposition.
Et c’est ce qui fâche à Grenade. Comme tous les touristes du monde savent que « c’est la perle de l’Andalousie », des deux Amériques, et de Prusse, et d’Angleterre, et de France, ils accourent ! Alors on fait quelque chose pour eux. On restaure… Et il y a aussi des boutiques pour touristes, des souvenirs, des cadres qui reproduisent une porte ou une fenêtre de l’Alhambra, et des photographes qui font « format album » en costume de maure et cimeterre à la main, tel gantier de la rue Montmartre, et son épouse la gantière en odalisque, tous deux dans le décor d’une salle de palais arabe. Ils sont exposés aux vitrines : il faut les voir !
Le centre de la ville, Dieu merci ! ignore ces commerces spéciaux qui ne fleurissent que sur le plateau de l’Alhambra et dans les environs. Et c’est paisiblement qu’on peut visiter la cathédrale, et tout ce qui, à Grenade, est espagnol. Et cela mérite une visite. Si le plateau de l’Alhambra est aux Arabes, si l’âme arabe, du haut de l’Alcazaba, continue à dominer la ville, la ville basse est aux rois catholiques. Sur l’Alameda, la promenade que fréquentent les citadins, Isabelle, recevant Christophe Colomb, apparaît, et le tombeau de cette grande reine, qui a si bien agi pour l’Espagne, se trouve à la cathédrale.
La cathédrale, laquelle fut le monument de la conquête de Grenade par les chrétiens, est magnifique à l’espagnole. Ici a battu le cœur de la race, et, si les siècles ont fait que maintenant le centre vivant de l’Espagne soit bien éloigné de Grenade, ce n’en est pas moins là qu’on peut trouver un des plus émouvants souvenirs du passé. Dans un souterrain, où l’on accède en descendant quelques marches, on voit derrière une grille, au milieu d’une chambre de pourpre et d’or éclairée par une lampe brûlant toujours, les cercueils d’Isabelle et de Ferdinand. Et dans la sacristie, derrière une grande vitrine, on vous montre la couronne, le sceptre, l’épée et l’étendard. La cathédrale de Grenade, avec ses marbres bruns et noirs de la Sierra Nevada, avec ses chapelles d’une noble et fastueuse surcharge, si pompeuse et si fière, est un des plus superbes monuments du catholicisme violent de l’Espagne.
Nous allâmes ensuite à l’Albaycin. Il faut suivre, pour y parvenir, le rio Darro, rivière au cours capricieux que longent pittoresquement deux lignes de vieilles maisons. L’Albaycin, c’est le quartier des gitanes. Il est situé sur une colline qui fait face à celle de l’Alhambra ; au pied de cette colline stationne toujours un agent qui attend les étrangers, afin de les conduire parmi les gitanes et les protéger. Je pense bien que ce secours de la police n’est pas nécessaire et qu’on ne court aucun danger sur l’Albaycin. Malgré leur mine farouche, les gitanes m’ont eu l’air d’assez bonne composition. Mais pour un agent de Grenade, un petit pourboire qu’il ajoute à son traitement, c’est une fameuse fortune, aussi, dès que nous paraissons, il tient absolument à nous prendre sous sa garde et il ne nous lâche plus d’une semelle. Il a ceci d’excellent, qu’il écarte les mendiantes, les diseuses de bonne aventure, les marchandes de petits paniers vous harcelant de leurs « régal, régalito, señor », et qui, sans lui, vous composeraient vite une escorte incommode.
Les demeures des gitanes sont creusées dans le roc, ce qui fait que cet Albaycin est tout perforé comme une taupinière. Elles s’ouvrent au milieu des figuiers de Barbarie et des cactus qui pullulent en cet endroit. Parmi cette végétation, on découvre çà et là une petite ouverture peinte en blanc ; c’est la cheminée d’une habitation pratiquée plus bas. La façade, si l’on peut dire, de chacune de ces grottes artificielles est blanchie à la chaux, aussi cela n’apparaît-il point du tout, comme on pourrait bien s’y attendre, repoussant de saleté. Les gitanes vivent là tranquillement, soit à l’intérieur de leurs habitations, dont la porte est ouverte et où ils vous invitent instamment à entrer, soit devant, dans le sentier de la colline d’où l’on a une très belle vue sur l’Alhambra, sur Grenade et sur les montagnes de la Nevada. Un grand garçon, vêtu de velours noir, me demanda poliment un « cigarillo », puis il nous accompagna quelques instants avec cordialité.
Dès que nous avions commencé à gravir le chemin de l’Albaycin, nous avions été signalés. A un carrefour, devant la grotte du capitan, plusieurs femmes costumées et un jeune homme attendaient notre passage pour nous proposer des danses. Il y avait là, entre autres, une admirable fille à la peau mate, aux yeux de diamant noir, souple, l’air sauvage et doux. Mais cet étalage de costumes, ces professionnels, toute cette organisation pour étrangers ne nous séduisait pas, et nous préférâmes faire danser plus loin au grand soleil, tandis que, se réjouissant, sa vieille sorcière de mère, son petit frère vert comme une olive, et ses voisines frappaient en cadence dans leurs mains, une gamine quelconque qui nous avait ri en passant.
Nous montâmes au Generalife le lendemain matin. Il avait plu toute la nuit. Le parc de l’Alhambra, qu’il nous fallait traverser, était détrempé. Mais quand nous sortîmes de son ombre, nous trouvâmes dans un ciel lavé un jeune soleil plein de gaieté. On suit une longue allée bordée de cyprès taillés, et puis l’on est introduit dans un délicieux jardin bourré de fleurs et où des jets d’eau, gracieux comme des cols de cygne, s’entrecroisent légèrement pour retomber dans une sorte de ruisseau central qui partage en deux le jardin. On longe les buissons fleuris sur un trottoir couvert, décoré d’ornementations arabes, et l’on gagne, au fond, une construction précédée d’un portique mauresque et dans laquelle plusieurs salles, qui ouvrent sur la vallée et sur la ville, sont parées de tableaux anciens représentant des souverains d’Espagne et des ancêtres de la marquise de Campotéjar, laquelle est maintenant la propriétaire du Generalife, jadis bâti par les rois maures pour leur servir de résidence d’été. Ce qui m’intéressa le plus dans ces salles, je crois bien que c’est un arbre généalogique de la famille de la marquise ; comme il remonte assez haut, il montre le mélange du sang maure et du sang espagnol, et comment les riches maures, demeurés sur la place et convertis, ont changé leur nom arabe pour un nom chrétien, se sont unis aux Espagnols, et leur ont donné de leur âme africaine.
De charmants jardins en terrasse, domaine autrefois des plus blanches sultanes, montent jusqu’à un mirador d’où l’on peut découvrir un vaste paysage. Mais nous ne nous jugions pas encore assez haut. Nous sortîmes du Generalife, et le sol étant dur et l’herbe presque sèche, nous commençâmes à nous élever sur la montagne. Nous ne nous arrêtâmes que sur un sommet d’où nous pouvions embrasser de tous les côtés le panorama le plus admirable.
Là nous nous sommes assis. Nous avons contemplé Grenade et, tout autour d’elle, l’impassible nature. Nos regards couraient jusqu’à l’horizon à travers d’immenses étendues. Ils descendaient dans les vallées, remontaient les collines, s’étendaient dans les plaines pour repartir ensuite jusqu’aux montagnes qui, là-bas, très loin, les arrêtaient. Et, à la pensée que ce grand paysage immobile demeurait toujours identique à lui-même, tandis que les races naissaient, se développaient, vainquaient pour mourir ensuite et disparaître à jamais, une mélancolie profonde nous envahissait : A quoi bon ?
Ils sont venus de là-bas, ils ont traversé la mer, ils ont fondé cet oasis. Ils ont été puissants. Et les Espagnols les ont chassés. Et ceux-ci ont connu à leur tour la puissance. Mais aujourd’hui que je contemple Grenade, à leur tour ils sont à leur déclin. Et maintenant les pleurs de Boabdil ont rejoint dans la mort la gloire d’Isabelle. Tout a été, rien n’est plus. Seules existent les montagnes, qui semblent aveugles et sourdes, et l’indéchiffrable nature.
Mais je me disais : Vivons pour admirer, non pour questionner. Vivons pour sentir, vivons pour vivre…
Si, à cet instant, je suis mélancolique, que je jouisse de ma mélancolie. Et que mon bonheur soit d’éprouver tous les sentiments, les plus amers comme les plus doux. C’est parce que maintenant Grenade dort qu’elle m’émeut : elle renferme une puissance de rêve infinie. Laissons-nous enivrer par le songe du passé. Et regardons, jouissons de cette beauté qui nous entoure. Ici la beauté est parfaite, et elle se présente dans une merveilleuse lumière. L’Espagne se tient nue, debout, dans la lumière. Ces montagnes brûlées, couvertes d’une toison brune, sont d’une magnifique perfection. Leurs lignes sont pures, dépouillées, spirituelles. Elles paraissent des images pour l’intelligence et une musique de l’esprit.
Et voici Grenade à mes pieds. Voici Grenade, fontaines, verdure, palais, rêve d’Orient !
Un des plaisirs de la sous-préfecture : la musique sur les allées. Toutes les dames des fonctionnaires et leurs demoiselles se sont vêtues de corsages clairs, et l’on s’évente, on bavarde, en regardant passer les jeunes gens de la ville. Ceux-ci se cambrent. On échange des saluts distingués. De loin en loin, un piston impérieux ou le trombone autoritaire interrompt la conversation. Heureusement qu’un passage piano survient ensuite et qu’on peut aussitôt reprendre ses remarques sur le « genre » de la femme du receveur des contributions, ou sur « l’originalité » de l’entrepositaire des tabacs.
Arrivés dans la soirée à Cordoue, du balcon de l’hôtel où nous étions descendus, c’était le spectacle qui s’offrait à nos yeux : il y avait musique sur le Gran Capitan. L’avenue était illuminée, l’assistance était brillante, mais les dernières notes envolées, la foule se dispersa, les lanternes s’éteignirent, et le Gran Capitan ne fut plus rien qu’une large voie déserte et sombre de province.
Le lendemain matin, nous commençâmes à courir la cité. Ses rues sont charmantes, nettes, limpides et paisibles. Parfois, à travers une grille finement ouvragée, on aperçoit quelque délicieux patio où jase une fontaine au milieu de feuillages. Nous descendîmes ainsi jusqu’au Guadalquivir qui, vers l’heure de midi, nous apparut, mare miroitante et immobile. Son lit était à demi desséché, l’herbe y poussait. Nous avions passé le pont et nous regardions Cordoue qui, belle et aride, s’étendait sur le bord de son fleuve amaigri. Elle ressemblait assez à quelque cité morte du Rhône. Nous la voyions en face de nous, silencieuse et solitaire. Les quais, le pont étaient déserts. Rien ne bougeait. De loin en loin, seulement, un homme, avec un mulet, piétinant dans la poussière, gagnait la campagne. On eût dit que la cité était abandonnée, ou si ancienne qu’elle n’avait plus la force de vivre, et le vieux fleuve, gagné par toute cette immobilité, s’arrêtait, lui aussi, et il oubliait de couler. Sous une arche du pont, sur une langue de terre émergeant de la rivière, un troupeau de porcs noirs dévoraient du grain qu’un porcher leur jetait, on entendait des grognements ; deux vaches placides ruminaient sur la rive… Nous laissâmes le Guadalquivir et regagnâmes l’intérieur de la ville.
Nous entrâmes dans la Mezquita. C’est la cathédrale. C’était jadis une mosquée, la plus grande et la plus admirable de toutes les mosquées de l’Islam. Elle demeure un extraordinaire monument avec sa forêt de colonnes qui la fait paraître infinie et tous ses arceaux arabes rouges et blancs. La mosquée est devenue cathédrale, mais rien de chrétien n’y respire. Le chœur catholique, ajouté, est là en étranger et en intrus, et c’est la chapelle de San Fernando, aussi mauresque, en dépit des armes plaquées de Ferdinand et d’Isabelle, aussi mauresque qu’une salle de l’Alhambra, c’est les petits autels çà et là disséminés et décorés d’anciennes faïences orientales qui sont la réalité du saint lieu. Dieu n’est point chez lui à la Mezquita, il est en visite chez Allah. L’incroyant qui la parcourt y éprouve des impressions singulières. Il est fortifié dans son détachement de toutes les religions, ou, si l’on préfère, dans son goût égal pour toutes les religions. Cela est d’accord avec sa manière de sentir que ces mêmes voûtes, où s’élèvent aujourd’hui des psaumes catholiques, aient autrefois retenti à l’aigre voix des Arabes célébrant leur divinité. On a vu des temples romains, jadis élevés à Vénus ou Junon, devenir, après quelques siècles, des sanctuaires de la Vierge. Tout passe, et nos religions comme nous-mêmes. La mosquée d’Allah, où Dieu est logé aujourd’hui, quelle foi abritera-t-elle demain ?
Réflexions qui me maintenaient avec force dans la mélancolie de Cordoue. D’ailleurs, en voyage, tout ne conduit-il pas à la mélancolie ? On s’y trouve constamment en face du passé. Le présent, alors, prend sa vraie place, bien petite. « La vie est une auberge, la mort est la maison. » Ce triste proverbe-là vous vient à l’esprit plus d’une fois par jour, lorsque vous errez à travers pays.
Il nous arriva pourtant une petite aventure qui nous égaya. On sait que le clergé espagnol fait payer volontiers les visiteurs de ses églises, et, lorsqu’on franchit le seuil d’une cathédrale, quelqu’un aussitôt vous aborde, qui vous mène à la sacristie. Là, contre bon argent, il vous est délivré un billet détaché d’un carnet à souche. Mais vous avez payé : tout vous sera montré. Un homme, armé d’un trousseau de clefs énorme, vous conduit, il vous découvre le trésor, il vous introduit dans la garde-robe épiscopale, il vous fait voir les tableaux, il vous ouvre les portes des chapelles fermées… A Cordoue, nous n’avions rien payé. Au milieu de la mosquée, nous avisons une sorte de pièce carrée, précisément la chapelle de San Fernando, à laquelle on accédait par un escalier mobile en bois. La baie donnant sur l’église était close par un rideau, mais mal close, et l’on apercevait une riche décoration arabe. Nous poussons l’escalier contre le mur, nous montons, soulevons le rideau, et pénétrons dans cette chambre orientale. Or, un sacristain nous avait vus, et, tandis que nous admirions la magnificence de ces murs, nous entendions sur les dalles du temple son pas se hâter de notre côté. Il parut, une pancarte sous le bras. Puis, avec un sourire engageant, il nous mit sa pancarte devant les yeux. Elle portait : Capilla de San Fernando, 2 pesetas. D’un air non moins aimable que le sien, nous lui déclarâmes que nous ne paierions rien. Il n’insista pas, il en prit subitement son parti. Nous lui donnâmes alors un petit pourboire, dont il nous rendit « muchisimas gracias ».
Comme nous sortions de la Mezquita, nous rencontrâmes deux étrangers, qu’à leur air papillonnant, nous reconnûmes pour des Français. Nous les évitâmes avec soin. Ce qui, peut-être, est le plus désagréable hors de France, c’est de rencontrer des Français. Généralement ils ont l’esprit du boulevard et désirent à toutes forces le montrer, ils ne regardent rien, mais font des mots sur tout : ils sont décidément supérieurs à tout ce qu’ils voient. L’un de ceux que nous avions aperçus appartenait à l’espèce photographe, il portait une boîte noire à la main, et l’on sentait, même de loin, que, pour lui, ce qui importait surtout en voyage, c’était de faire des bonnes photographies.
Dans la journée, nous allâmes visiter l’Alcazar, l’ancien palais des rois maures. Mais il y reste fort peu de chose. C’est maintenant une prison : pour cette raison et à cause de la vue qu’on découvre de là, nous n’avons pas regretté notre visite. Nous étions montés sur un chemin de ronde, duquel nous dominions toute la campagne alentour, les eaux endormies du Guadalquivir, d’immenses plaines arides, et des collines dans le fond. Au milieu de ce grand tableau, nous respirions largement. Or, juste au-dessous de nous, nous pouvions découvrir en même temps une cour de prison, un rectangle fermé où des hommes, sans cesse, allaient et venaient comme des bêtes en cage. Le contraste entre la vaste nature libre et le petit coin étouffant des prisonniers que nous considérions à la fois était saisissant. Nous étions là-haut, nous voyions autour de nous jusqu’à l’horizon, nos regards couraient au hasard de tous côtés, capricieux, vagabonds : ils étaient enfermés et ne voyaient que le ciel sur leur tête et quatre murs. Nous ressentions l’impatience de leurs allées et venues toujours sur la même ligne ; nous devinions qu’ils voulaient abattre le temps. Et quel désir intense de s’envoler en levant les yeux ! Toute la dureté de cette vie captive nous étreignait…
Nous quittâmes l’Alcazar, mais nous ne fîmes guère d’autre usage de notre liberté que d’errer sans plaisir dans des rues inanimées… Nous nous trouvâmes, vers le crépuscule, dans un jardin planté, à l’extrémité de la ville, et où quelques Cordouans s’étiraient en bâillant. Cette liberté, à laquelle aspiraient si passionnément les prisonniers de l’Alcazar, il était trop certain qu’elle était impossible ici à employer avec satisfaction. Où aller, que faire ! Éternelle question que se posent tous les habitants des cités endormies. Du banc sur lequel nous étions assis, nous voyions le soir envelopper de vaporeuses et lointaines sierras. Les ombres s’allongeaient, mais le silence était brisé par des accents de trompette — quelque troupe, près de là, devait manœuvrer — ils n’aboutissaient qu’à souligner encore l’ennui et la torpeur universelle.
Une petite ville sommeillante qui ne semble plus avoir été élevée que pour permettre à une garnison sans importance d’y faire l’exercice, voilà donc ce qu’était devenue Cordoue, Cordoue la Sainte, la Mecque de l’Occident, la capitale des Maures !
L’image que nous nous formons d’une ville avant de la connaître, ne ressemble jamais à celle que nous voyons paraître quand les hasards de la vie nous y mènent. Mais il n’y a que les mauvais poètes pour dire que leur rêve est plus beau que la réalité. La réalité est plus belle parce qu’elle est nécessaire, et quand on met le pied dans une cité qu’on avait imaginée différente, on comprend peu à peu toutes ses raisons d’être telle qu’elle est, et ces puissantes raisons vous la font vite préférer à l’image que vous vous en étiez forgée arbitrairement.
J’éprouvai une déception en arrivant à Séville. Rien n’y était conforme à mes prévisions. J’imaginais une ville d’un pittoresque débordant, très populacière et montée de ton. Mes longs séjours à Naples, ainsi que mes passages fréquents à Marseille, avaient composé en moi un type de cité méridionale dont je m’attendais à retrouver les caractères en Andalousie, comme en Provence et dans le sud de l’Italie. Séville m’étonna par sa netteté, par son air de sagesse, par sa noblesse délicate. Je m’attendais à des ruelles grasses, à des étalages désordonnés de fruits rouges et de légumes d’or, à des nuées de moines sales et de prêtres crasseux, à d’horribles mendiants, à de la pouillerie superbe dans un grand soleil. Je trouvai des petites rues d’une propreté flamande, des maisons peintes à neuf, de beaux chevaux et de fiers cavaliers. Le faubourg de Triana, même, dont on m’avait vanté la truculence, me parut bien piètre en regard des bas quartiers de Naples et de Gênes.
Je promenai deux ou trois jours ma déception à travers Séville. Puis, peu à peu, sa fine atmosphère me pénétra, et je recueillis par-ci, par-là, des impressions charmantes. Je m’habituai enfin à l’idée de n’avoir pas rencontré ce que j’attendais. J’attachai plus de prix à ce que j’avais trouvé. Un jour, je vis que tout cela pour moi était nouveau, et d’une autre qualité que le Midi que j’avais déjà connu, et fort précieux : j’étais conquis, mes yeux étaient ouverts au charme sévillan.
Séville n’est pas une cité plébéienne, une commère bouillonnante de force, grossière et magnifique comme Marseille. C’est une fine, délicate et orgueilleuse jeune fille. Il faut avoir erré au hasard à travers les jolies calles, avoir vu se profiler sur le ciel quelques clochers bleus, avoir déniché de petites églises pleines d’azulejos et de beaux tableaux. On s’est perdu dans cette ville difficile, enchevêtrée comme une ville arabe : on a vu en passant, on ne saurait dire où, des patios délicieux… Et l’on s’est enfin retrouvé place de la Cathédrale, devant la Giralda… Mais l’on avait goûté l’atmosphère particulière de Séville, orientale, paresseuse et voluptueuse, et l’on avait senti que la vie ici devait être douce et raffinée.
Nous avions un ami à Séville. Il habitait près de la « Casa de Pilatos », qui est parée si somptueusement de faïences arabes, une petite maison andalouse. La porte de la rue, toujours ouverte, laisse voir un vestibule, puis une grille, à travers laquelle on découvre le « patio ». Si l’on se tient dans le patio, et qu’on désire n’être pas gêné par l’indiscret regard des passants, on place derrière la grille un paravent.
C’est là, dans son patio tout blanc, que nous allâmes trouver notre ami, un matin. Un jet d’eau chantait dans un bassin ; autour, soutenue par une arcade mauresque, régnait une voûte aux belles ombres. Assis dans de légers fauteuils d’osier, nous causions paisiblement, jouissant du charme de ce qui nous entourait, de la fraîcheur et du murmure du jet d’eau, de la douceur des murs blancs, de la forme des voûtes. Une servante nous avait versé du manzanille, et tout en goûtant le parfum de ce vin gracieux, nous devisions allègrement. J’exposais à notre ami mon plaisir en voyant peu à peu se découvrir pour moi la séduction de Séville, il nous contait sur le peuple d’ici, qu’il aimait, de charmantes anecdotes. Je jouissais du confortable andalou qui ressemble à celui de l’Orient et diffère totalement de celui du Nord. Ici la nature, — l’air tiède, l’atmosphère pure, le soleil — collabore pour le principal à notre bien-être. Il s’agit simplement, quant à nous, d’adapter à la beauté et au voluptueux bonheur qui flotte partout sous le ciel notre petite maison. Un velum tendu sur le patio, quand les rayons du soleil brûlent, et qu’on pourra tirer afin de voir l’azur, quand ils s’adouciront, y suffira. Et, assis à l’ombre parmi les blancs et les riches gris des murs, la musique jolie des gouttes d’eau nous berçant, nous serons divinement bien pour laisser passer nonchalamment les heures, en en goûtant toute la poésie.
Notre ami nous expliquait que, dans les maisons sévillanes, l’hiver, on vit au premier étage, et l’été, quand il fait chaud, on descend au rez-de-chaussée. Les murs sont épais. Dans la maison l’on a toujours frais : on ne sort pas. Et c’est ce qui, pour le voyageur passant par Séville en été, y rend l’existence mystérieuse. La rue est à peu près vide, et l’on n’y rencontre presque jamais de femme. Aussitôt donc, les maisons, cette vie secrète, tout ce qu’on ne voit pas derrière ces murs, devient attirant, chargé de poésie, et fait rêver. Surtout, pour peu qu’à travers une grille, l’on ait aperçu un de ces patios délicieux, qui semblent arrangés à souhait pour quelque paresseuse et tyrannique sultane.
Le déjeuner fut servi dans le patio. La maîtresse de céans, dont les beaux bras sortaient d’un peignoir très empesé, nous servit certains pâtés frits de viande au jerez qui nous firent mesurer toute la finesse de la cuisine sévillane. La chère qu’il fait indique tout de suite au voyageur de goût si le pays où il arrive est de mœurs grossières ou délicates. Dans la plus mauvaise auberge, il se peut renseigner sur ce point-là. Le plat est-il mal préparé, on reconnaît cependant s’il est conçu par un peuple à l’âme polie ou simplement rustique. Mais chez notre ami, à l’excellence de la conception se joignait une exécution impeccable. Et n’eussions-nous vu encore de Séville que ce patio, et ni la Giralda, ni les jolies rues, ni les Délicias, ni les clochers bleus, sur la seule attestation de ces pâtés au jerez, nous eussions été convaincus du raffinement de la cité où nous étions parvenus.
Le dame à la blanche robe empesée prit une guitare et en toucha paresseusement les cordes. Et elle chanta de ces chansons espagnoles qui n’ont qu’une phrase, et cette phrase est une fleur de poésie. Nous nous étions un peu écartés de la table, nous avions allumé des cigarettes, nous écoutions. Nous écoutions la belle voix qui disait des paroles passionnées, la grave et sonore guitare, et le bavardage en cristal du jet d’eau. Puis l’on dansa. La sœur de la dame fut chercher une fille qui cousait dans une salle de la maison. C’était une ouvrière à la journée ; de mise bien simple, tout en noir, elle était cependant, en véritable andalouse, coiffée et vêtue avec un soin extrême. Toutes les deux, castagnettes aux doigts, dansèrent des sévillanes aux figures vives et gracieuses. Et comme nous étions ravis de cette heure délicate et d’être tout à coup devenus des Sévillans chez eux : « Je vais essayer, dit notre ami, de vous arranger une petite fête pour ce soir. » Là-dessus, il eut un court entretien avec la petite couturière. « Eh bien, nous dit-il, je crois que cela ira… »
Nous sortîmes, nous nous promenâmes dans la ville, nous profitâmes joyeusement de cette belle journée. Puis nous allâmes dîner à l’hôtel. Et ensuite, avec notre ami qui nous avait accompagnés, nous retournâmes chez lui. Ce fut exquis. Dans le patio, cinq ou six jeunes filles étaient assises, et nous attendaient en babillant. Elles étaient parées, coiffées, vêtues de clair. Le jet d’eau jasait maintenant dans la pénombre. Des lumières éclairaient doucement le patio, laissant le haut de la maison dans une suave nuit. Sous la voûte, un vieux guitariste qui, avec son grand chapeau, avait l’air de sortir d’un tableau de Manet, jouait en virtuose et pour lui-même. Il attaqua un air de danse. Alors les castagnettes s’y mirent : quatre jeunes filles se levèrent et elles commencèrent à baller. Leurs mouvements étaient jolis et toutes leurs attitudes harmonieuses, elles dansaient avec plaisir, et pour elles bien plus que pour nous… Appuyé à une colonne dans un coin du patio, je les regardais en silence, savourant tout ce que, pour moi qui étais de si loin et d’un pays si différent, cette minute renfermait de touchant. C’est charmant et c’est mélancolique d’être un étranger : on goûte une foule de détails qui échappent à l’autochtone, et ils répandent pour vous une saveur vraiment enivrante : cependant, ne pas être un étranger, pouvoir parler tout de suite à ces filles selon leur âme ! être d’ici, être le frère, l’ami de tout ce qui est ici ! jouir de la tendresse, de la caresse, de la connaissance intime de toutes ces choses, être de la famille ! Hélas ! jamais, je ne serai chez moi dans une maison pareille et sous ce ciel ! On a la nostalgie de tous les pays qui ne sont point le vôtre, comme de toutes les époques où l’on n’a point vécu. On voudrait passionnément être de partout et de toujours… Elles dansaient, la guitare sonnait, le jet d’eau s’élançait, l’air était doux, je regardais ce spectacle comme dans un rêve.
Bientôt on entendit dans le vestibule, derrière le paravent et dans la rue, un bruit de castagnettes qui répondait à celui du patio. C’était tous les enfants du voisinage, qui, attirés par le bruit de la fête, étaient accourus, et qui dansaient maintenant, dehors, sur le pavé, profitant de la guitare. Cet amour de la danse m’enchanta.
Cependant on sonna à la porte, et une femme d’un certain âge entra dans le patio. C’était la mère d’une des jeunes filles, celle-ci bientôt partit, puis ses amies la suivirent, et puis le guitariste. Et nous restâmes seuls avec notre ami, la belle maîtresse de maison, et la servante, à laquelle on avait fait danser un tango, et qui, maintenant, après la fête, se reposait sans façons dans un fauteuil et s’éventait. « Et savez-vous, — nous dit alors notre ami, — qui étaient ces fines et jolies jeunes filles, si bien parées, et dansant avec un tel art ?… Simplement, les voisines de palier de la petite couturière que vous avez vue ici cet après-midi ; des ouvrières comme elle, et qui n’ont pas été choisies. Ici, toutes savent ainsi danser ! »
Cela n’empêche pas nos bons touristes d’affirmer en revenant d’Espagne que l’on n’y danse pas. Il est même devenu d’un esprit très courant de déclarer, avec un sourire, qu’il n’y a de danseuses espagnoles qu’à Paris. L’acteur Gémier, qui était allé se documenter à Séville pour la mise en scène de la Femme et le Pantin, en revenait naguère avec cette opinion-là. Cependant, si l’on ne peut pénétrer dans un intérieur andalou qui vous convainque que, tout en devenant un article d’exportation, la danse n’en est pas moins restée toujours dans le sang et dans les mœurs de là-bas, il suffit d’ouvrir les yeux et de regarder autour de soi pour s’en rendre compte. Dès que deux enfants s’amusent sur une place, à Séville, la petite fille joue à danser, le petit garçon joue à taurer. Pas besoin d’un bien grand effort de raisonnement pour en conclure, sachant que les jeux des enfants vivent d’imitation, qu’on danse beaucoup à Séville et qu’on y courre beaucoup le taureau. D’ailleurs, si l’on veut voir danser, on trouve presque toujours des troupes de danseurs aux « Novedades », et souvent aussi à « Miramar », un cabaret de faubourg en plein air, situé à Triana, près du Guadalquivir.
Les Andalous m’ont paru aimer autant à voir danser des grosses femmes que des minces ; j’ai d’ailleurs pu saisir, une fois, à Miramar, combien certaines Espagnoles très fortes, pouvaient cependant, en dansant, déployer de vraies grâces. Pour voir ce dernier cabaret, il faut se trouver à Séville pendant la belle saison, mais c’est naturellement en cette saison-là qu’il convient de visiter l’Andalousie, ainsi que tous les pays méridionaux. Il suffit d’éviter le mois de la canicule.
Otero, qui est le grand maître de danse de Séville, organise pour les touristes, ce qu’il appelle des « bailes ingleses », des bals anglais, ou bals pour les Anglais. J’ai assisté à l’une de ces séances, où il y avait plusieurs bons sujets. Mais bien entendu, cela est tout exhibition, et il est infiniment plus intéressant de voir des Andalous qui dansent pour eux-mêmes que des professionnels qu’on pourrait rencontrer sur une scène n’importe où en Europe. Le plus singulier peut-être de cette séance, c’est que notre ancien ministre Pelletan y assistait également. On lui présenta Otero, il garda longuement dans sa main serrée la main d’Otero, par une habitude d’homme public qui a énormément félicité dans sa vie, et tout comme si c’eût été la main d’un secrétaire de syndicat ou de meneur d’une grève d’inscrits. Et il répétait avec l’enthousiasme indifférent d’un homme politique : « Admirable ! admirable ! admirable !… » Otero, à l’espagnole, mettait pour remercier la main sur son cœur.
Je suis allé plusieurs fois, le soir, au cours de danse d’Otero. C’est bien curieux. On prétend que cet Otero serait un oncle de la belle Otero, j’ignore si c’est exact : pour lui, il est en tout cas fort laid. Mais c’est un excellent maître. Il donne des leçons particulières aux jeunes filles des meilleures familles, et, le soir, deux fois par semaine, il ouvre un cours où, pour une somme très modique, n’importe quelle belle enfant peut apprendre à danser. Le vestibule est rempli de femmes assises par terre, lesquelles n’ont pu trouver place plus avant. J’arrive au milieu d’un grand bruit de castagnettes et dans le vent de toutes les jupes qui tournent ensemble. Et comme je demande le maëstro, on va le chercher, et, tout en secouant la tête pour donner la mesure, et tout en jouant des castagnettes, Otero s’approche et m’introduit. Les murs du patio où l’on danse sont couverts de vieilles affiches de corridas, ainsi que la petite salle attenante où le piano fait rage et où l’on danse aussi. Sur le banc qui court le long du mur, des mères sont assises en rang d’oignon et regardent la danse. Il y a là, s’agitant, toutes sortes de filles, depuis celles qui viennent simplement pour apprendre et qui sont modestes, jusqu’à celles qui veulent devenir des professionnelles, qui se voient déjà lancées et reines d’élégance, s’exercent à être provocantes, et sont effrontées. A la manière dont elles dansent, on voit aussitôt d’où elles sortent et où elles vont. Il y a aussi des petites filles, de toutes petites, neuf ou dix ans, et c’est elles quelquefois qui dansent le mieux. Cependant Otero tape dans ses mains : tout le monde en place ! Le piano part, et au bruit des excitantes castagnettes, voilà tous ces corps qui virent, voltent, tournent, sautent et se ploient en même temps. C’est un extraordinaire ballet, rythmé toujours par la cadence nette et forte de cinquante claquettes et que mène le pianiste, répétant obstinément quelque phrase de danse, penché sur son clavier derrière ses lunettes noires. Et c’est, presque sans arrêt, une succession étonnante de peteneras, de habaneras, de tangos et de fandangos. On s’en donne à cœur joie. Les jolies filles y mettent un feu ardent. Et elles sont roses, elles ont chaud, leurs yeux brillent, elles sont heureuses…
La perle de Séville, c’est sans doute, avec la Giralda, l’Alcazar. Non pas le palais qui, lorsqu’on a vu l’Alhambra de Grenade, ne touche plus guère, mais les jardins. Ils sont parmi les plus beaux du monde. Ils ne contiennent point des essences infiniment rares, mais leur mahométane ordonnance sous ce ciel bleu, et le voluptueux chant du Sud de leurs feuillages est incomparable. Il y a là une poésie tout orientale et délicieuse. Sous les grands palmiers, des massifs de camélias, de magnolias et d’orangers, glorieux et chargés de parfums, se suivent, encadrés par des bordures de faïences de couleurs. Au milieu des massifs, des trottoirs dallés procèdent, sous lesquels ont été pratiquées certaines machines hydrauliques qui, sur un signe, se mettent à jouer, rafraîchissant de leurs minces gerbes entrelacées le sol de marbre. A gauche, une très haute arcade en rocaille, avec des échappées sur l’azur, borne le jardin. Et l’on voit se profiler sur le ciel, là-bas, la tour mauresque de la Giralda. Enfin un délicieux pavillon de repos, élevé par Charles-Quint, plein d’ombre et décoré d’admirables azulejos, se trouve au milieu des jardins. Au bord de ceux-ci, et pratiquée sous le palais, on rencontre la piscine de Marie de Padilla, la favorite du roi, du bain de laquelle on raconte que les courtisans, par galante flatterie, buvaient l’eau.
Mais que ces jardins-là soient si beaux, si délicats et si voluptueux, cela surprend moins qu’ailleurs à Séville raffinée et comme gonflée d’un chant d’allégresse radieux. Ce midi de l’Espagne est doux et tendre en même temps qu’éclatant. Et à Séville encore il y a de charmants jardins pour les amants, qui ne sont que de simples jardins sans l’art et la splendeur de ceux de l’Alcazar, le parc Marie-Louise, le paseo de Gracia, avec ce restaurant Eritaña aux chalets et aux bosquets discrets, cachés dans la verdure. La collaboration de la lumière, de l’azur et des arbres, prend là-bas une expression, un accent merveilleux.
A Séville, mainte chose est douce et gracieuse, et propre à faire rêver. C’est une ville noble, qui porte un tact et des manières de gentilhomme. Elle est trois fois noble, dans l’histoire, dans la littérature, dans l’art. De là sans doute qu’on s’y entende si parfaitement à bien vivre. Les cercles à l’un desquels, comme étranger et sur la présentation de notre ami, j’avais été admis pour quelques jours, sont agréables. Les meilleurs sont situés à « Las Sierpes », la rue la plus animée de la ville, et qui est curieuse et d’un charme particulier, parce que les voitures, ni les cavaliers ne peuvent y passer. On s’y promène donc à pied et, au fort de la journée, des velums, tendus d’une maison à l’autre à la hauteur des toits, protègent du soleil et maintiennent dans la rue une reposante pénombre. Assis dans de bons fauteuils, soit dans la rue même devant le cercle, soit dans un vaste hall surélevé de quelques marches, on se distrait agréablement en bavardant, tout en suivant le mouvement des passants.
Tout est disposé pour vivre avec un plaisir paresseux. A l’hôtel, dans le vestibule, les dossiers des rockings étaient munis de ventilateurs. Grâce à un mécanisme ingénieux, ceux-ci étaient mus dès qu’on se balançait, par l’effet même du balancement. Ainsi, sans seulement avoir la peine de s’éventer, on avait bien frais.
Mais ce peuple nonchalant a la plus fière attitude. Le torse de l’homme se cambre superbement dans sa petite veste courte et la sombre figure rasée ouvre, sous le chapeau de feutre plat, des yeux de mâle énergie. Les cavaliers qu’on rencontre dans les rues sont magnifiques ; montés sur d’admirables bêtes, les pieds dans de larges étriers arabes, une main sur la hanche, et droits sur leur selle, ils passent avec noblesse. Quant aux femmes, elles sont toutes exquises, les plus laides même sont charmantes, car elles ont la grâce. Coquettes et extrêmement soignées dans leur costume, elles ne portent pas de chapeau, mais quelquefois la mantille, qui fait de jolis dessins sur les corsages clairs, plus souvent elles vont tête nue. Et quel chapeau vaut, comme piquante parure, des beaux cheveux coiffés avec art ?
J’ai assisté, un soir, à une manifestation qui m’a frappé par son goût et sa discrétion. Un train de blessés et de malades, revenant du Maroc, était arrivé à Séville. De la gare à l’hôpital, les soldats étaient menés en voiture, ils traversaient la ville. Il faisait nuit, il pouvait être dix ou onze heures du soir. D’ailleurs la place, où je rencontrai le rassemblement qui s’était formé sur le passage des voitures, était très éclairée. Une voiture arrivait, la capote baissée, mais laissant cependant apercevoir la figure hâve du malade et ses vêtements déchirés et souillés par la guerre. Alors il ne s’élevait pas un cri, pas une acclamation, on ne désirait point acclamer le gouvernement, ni cette campagne qui inspirait bien des craintes et de la méfiance. Mais une salve d’applaudissements éclatait, d’applaudissements émus et enthousiastes. Cela, c’était pour les blessés, c’était pour le courage et l’honneur espagnol !
D’ailleurs tous les Sévillans sont d’esprit fin et discret. Comme je visitais une fabrique de faïences, et que je regardais un ouvrier qui, d’une main très sûre, dessinait des filets sur l’assiette qui tournait devant lui, l’ami qui m’accompagnait me cita une savoureuse réponse d’un faïencier auquel il avait dit : « Ce doit être difficile à faire… » L’autre lui répondit doucement, avec une narquoiserie paisible : « Ah ! il faut d’abord apprendre à s’asseoir ! »
Les coutumes demeurent jolies. Chaque soir, en rentrant chez moi, je passais devant un jeune homme appuyé avec passion contre la grille d’une fenêtre. Il tournait le dos à la rue, et l’on sentait qu’il ignorait profondément ce qui se passait derrière lui, il parlait à voix basse à quelqu’un qu’on ne voyait pas et qui se trouvait dans la chambre, derrière la grille. C’était un fiancé faisant la cour à sa fiancée. Car tel est l’usage à Séville. Chaque soir il vient, ils se parlent tendrement à travers la grille… Il partait tard.
J’ai visité la cathédrale. Pour mes quarante sous, j’ai eu non seulement le droit de voir une riche collection de tableaux, et le trésor qu’on vous montre, comme l’endroit est sombre, à l’aide d’une bougie fixée au bout d’un long manche, mais encore celui d’entrer dans de vastes armoires où sont rangées des chapes anciennes de grand prix, qu’on déballe l’une après l’autre devant vous. J’avais alors l’impression singulière et un peu gênante de me trouver dans la garde-robe de l’archevêque.
Au Musée j’ai vu, avec les étranges et saisissants Zurbaran que l’on connaît, la galerie de Murillo, qu’on ne peut comprendre qu’à Séville. Sévillan, il vaut surtout par la vérité andalouse de ses figures de femmes, dont il a rendu admirablement les joues rondes, la douceur tendre et enjouée, l’expression, le regard.
A la Caridad, j’ai vu, dans une chapelle aux murs somptueusement tendus de damas rouge, ce Valdés Leal si étonnant où le peintre a représenté un évêque mort, dont le squelette est chargé des ornements de sa dignité, la mitre, la chape, la crosse. Le peintre a traité les os, comme les étoffes et les ors, avec une minutie de flamand, et c’est une riche symphonie macabre. Je me rappelais les squelettes des Cappuccini de Palerme et je pouvais goûter la vérité de cette belle et horrible peinture. D’ailleurs, l’idée qu’exprimait ce tableau est chaque jour sensible au voyageur qui, errant sans cesse à travers les cimetières, s’entend répéter chaque jour par son cœur : Tu passeras… « La vie est une hôtellerie, la mort est la maison. »
Dans une salle de la Caridad, on voit le moulage de la tête de Don Juan, duquel Barrès en le voyant écrivit : « Nul doute pour qui observe ce visage, Don Juan était une âme sans complications, mais forte, et de vie intérieure trop vigoureuse pour s’embarrasser d’aucun obstacle. Il ne lui coûte pas plus d’étonner le monde par sa conversion qu’auparavant d’épouvanter les timides, de scandaliser les sages, et de désespérer ses amantes, tôt délaissées après un flot d’amour. »
Don Juan fut le fondateur de la confrérie à laquelle appartient toujours la Caridad.
Mais en visitant les curiosités et les œuvres d’art de Séville, je ne négligeais pas de parcourir les environs.
Je pris, un jour, à la Tour de l’Or, un bateau qui descendait le Guadalquivir jusqu’à Corra. Les rives, plates et monotones, sont bordées de hauts buissons de plantes d’eau. Le pays semble peu habité. Il y a là des ganaderias, de vastes propriétés incultes où l’on élève des taureaux. De temps en temps, sur le bord piétiné du fleuve, on aperçoit des troupeaux de taureaux qui boivent.
Une autre fois, j’allai de l’autre côté de Séville, jusqu’à Italica, où fut une ville romaine qui donna naissance aux empereurs Trajan, Hadrien, Théodose. Les ruines d’un théâtre y subsistent encore parmi la campagne nue et déserte, et que l’on traverse sur une route si défoncée et poussiéreuse, que mon cocher préférait la longer en roulant dans les champs moissonnés. La terre, brune et chaude, s’étendait, sans un pli, jusqu’à l’horizon. Notre poussière faisait des nuages que le soleil colorait. Nous traversions quelquefois un pauvre village. Et nous croisions de pittoresques caravanes d’ânes aux harnais éclatants sur lesquels les paysans andalous se tenaient aussi droits et aussi fiers qu’à cheval. Je crois que les hommes de cette race sont les seuls qui puissent, même à âne, garder de la noblesse. Cette campagne unie n’était point morne ni ennuyeuse : elle était rude, âpre et forte.
J’ai acheté au marché de Séville un souvenir, un grillon dans une petite cage qu’on me donna pour un réal. Je le mis sur mon balcon, il chantait éperdument la nuit, et quand je rentrais, de très loin je l’entendais me crier où était ma maison. Il devint un objet de grande sollicitude pour la servante de l’hôtel : elle le bourrait de friandises, de tomates et de concombres.
Je tombai à Cadix en plein enthousiasme patriotique. Le soir de mon arrivée, on avait précisément reçu la nouvelle de la prise du Gurugu. Le dîner s’achevait quand j’entendis un grand tumulte dans la rue : des sonneries de trompettes, des cris, le piétinement d’une foule. Je me précipitai dehors : dans l’étroite rue noire une cohue d’hommes se pressait. Je suivis le flot… Nous arrivâmes sur une place où une musique militaire jouait le chant national, de tous les côtés s’élevaient des acclamations ; on criait : « Viva España ! Viva el ejercito español ! » Les cloches sonnaient à toute volée. On distribuait des bulletins qui portaient la dépêche parvenue quelques heures auparavant et annonçant la victoire ; des gamins passaient, agitant des drapeaux ; les fenêtres étaient illuminées ; un marchand de cravates avait laissé sa vitrine éclairée, et il avait dessiné en nœuds de cravates : Viva el ejercito español ! Enfin, toute la soirée, ce fut une agitation, une ivresse patriotique qui ne semblait pas pouvoir se calmer.
J’avoue que j’étais ému moi-même par toute cette émotion, par cette explosion de joie populaire. J’y distinguais du soulagement : en cette minute les Espagnols sentaient se soulever et se retirer de leur poitrine le poids qui les oppressait. Enfin des jours meilleurs allaient donc luire pour l’Espagne ! C’était donc fini d’être vaincu, humilié, diminué[6] ! Cette prise du Gurugu, c’était l’espoir qui renaissait, l’espoir de redevenir superbes, de redevenir soi-même, de redevenir des citoyens de la grande et puissante Espagne. Et moi-même, étranger, je me disais : Si cela était vrai ! Si l’Espagne pouvait revivre ! Ah ! quel dommage que cette race si belle soit ainsi frappée ! Un sang qui a dominé l’Europe, qui a couvert les mers de sa gloire, qui a porté sa couleur sur tout un lointain continent. Ce noble sang ! Et sera-ce vraiment les ours d’Allemagne et les barbares d’Amérique qui auront raison de nous, latins ? Ah ! pourquoi ne peut-on rêver une union des peuples espagnols, des républiques d’outre-océan et du royaume d’ici, une fraternelle alliance entre tous ces hommes de même langue et de même origine ?… Cela ferait encore un bel empire, et l’Espagne, avec le sentiment de sa puissance, retrouverait la force de vivre, de croître, de dominer, d’assurer enfin le combat entre notre idéalisme, notre poésie et la platitude germanique et anglo-saxonne. Ah ! ce n’est qu’un rêve, car un Brésilien d’aujourd’hui ne se désire pas davantage Espagnol qu’un Canadien ne se veut Français !
[6] La perte des Antilles, après tant d’autres malheurs, a beaucoup frappé et découragé les Espagnols.
Le lendemain matin, toute cette fièvre avait disparu. J’ouvris ma fenêtre au soleil, et je passai sur le balcon pour apercevoir un peu Cadix dont je n’avais pas distingué grand’chose la veille au soir. Tout était blanc, et, au-dessus de beaucoup de maisons, s’élevaient des tours carrées, couronnées par une terrasse, des miradores, desquelles on pouvait observer au loin la mer. Bien que tout blanc, cela ne ressemblait pas à une ville maure, mais c’était très différent aussi d’une ville andalouse. On voyait de tous côtés l’océan, et l’on se fût cru au bout du monde, dans quelque colonie de rêve. Je me rappelais le mot des Arabes qui disent de Cadix que c’est un plat d’argent posé sur la mer.
Je me promenai dans les rues qui sont très étroites et claires. Beaucoup de maisons portaient des sortes de balcons vitrés ; d’une autre forme que celles de Séville, elles n’étaient point closes comme elles : les Gaditans s’enfermaient moins que les Sévillans, ils s’intéressaient davantage à la vie extérieure. Je vis des places bourrées d’arbres, l’une entre autres, la plaza de Mina, qui est un ancien jardin de couvent, dont la végétation est exubérante et qui, avec la tache rouge de ses massifs au milieu des palmiers, et entourée de la blancheur des maisons, se montre d’une extraordinaire beauté. On dirait d’ailleurs que sur cette petite presqu’île où le terrain est mesuré aux arbres et aux plantes, ceux-ci se rattrapent en poussant avec une force double. Plus je cheminais à travers la ville, plus mon impression se précisait. Je n’étais plus dans un port de la Méditerranée, — de Malaga, par exemple, rien n’est plus dissemblable que Cadix, — j’étais arrivé dans une autre Espagne, je me trouvais en quelque colonie des tropiques, dans quelque blanche cité de mirage, lointaine et inimaginable. Cette cathédrale semblait avoir été bâtie par des Jésuites ayant franchi les mers, et, devant l’Océan, cette ligne de maisons blanches, avec ces blanches tours carrées, vous accueillaient, paisibles et exotiques, comme les terres qui sont au bout du monde accueillent le voyageur étonné.
Et le soir, dans Cadix qui est presque une île, une tristesse particulière que je connais bien, la mélancolie des îles, m’envahissait peu à peu le cœur.
J’avais décidé de rentrer en France par mer, et j’avais trouvé un bateau qui remontait jusqu’à Vigo, au nord-ouest de l’Espagne. C’était le Cabo-Quejo. De ma vie je n’ai vu un bateau plus sale que le Cabo-Quejo. Il était ancré dans la rade, et quand j’y parvins l’après-midi, on opérait le chargement. Des balancelles, pleines à couler de marchandises, se détachaient du quai, lequel se trouvait à un bon mille, cinglaient vers notre navire, l’accostaient, et leurs marchandises : grenades, pastèques, arrobes de vin, tonneaux d’huile, passaient de leur bord sur le nôtre. C’était pittoresque et cela m’amusa un instant, mais c’était fort lent et me désespéra bientôt. Quand partirions-nous ? Personne ne le savait : lorsqu’on aurait fini de charger… Je fis un tour sur le bateau et qui ne me rasséréna pas, car le fond était aussi mal tenu que le dehors : dès qu’il fut entré dans cette cabine, mon grillon cessa de chanter. C’était aussi, sans doute, parce qu’il allait quitter son beau pays…
Nous naviguâmes dans la brume, et ce n’est que le surlendemain, au petit matin, que nous arrivâmes au port de Vigo.
Et là, c’était déjà, hélas ! l’air du Nord.
Et je continuai à monter.
Et mon grillon mourut…
Au bord d’un golfe excessivement bleu, une ville ensoleillée où l’on rencontre des lazzaroni et où l’on danse la tarentelle au son du tambour de basque. Leporello, Graziella. Des pêcheurs en bonnet rouge et des entremetteurs. « Connais-tu le pays où fleurit l’oranger ? » Le Vésuve se voit dans le fond, exhalant une petite fumée blanchâtre. Un pin parasol termine le dessin. Dans la tête d’un Français cultivé, lequel cependant adore l’Italie, deux ou trois chromos, un nom de femme et une phrase d’opéra, voilà tout ce que le nom de Naples éveille.
C’est qu’en Italie, on visite Venise, Florence, Pise, Padoue et Sienne. Il faut savoir parler de la place Saint-Marc et des Offices : cela est élégant. Les deux ou trois cents écrivains français qui écrivent chaque année sur l’Italie connaissent tous admirablement les catalogues des musées toscans et les guides de Lombardie. Pour le golfe de Naples ? — Pour le golfe de Naples, vous avez Lamartine… Le golfe a changé peut-être depuis Lamartine ? — Certes… Mais il existe un préjugé artiste : Naples, qui renferme la plus étonnante collection d’art antique du monde, Naples n’est point, pour les écrivains artistes une « cité d’art », car d’abord, Naples n’est pas une ville-musée comme Florence ou Venise ; ensuite ce n’est pas une ville de la Renaissance, et l’art antique n’est point « à la mode ». Enfin, à Naples, il faudrait regarder la vie, il faudrait s’intéresser à ce qui se passe autour de soi… Or, ce n’est pas cela que vont faire les écrivains artistes en Italie.
Cependant, pour qui aime, avant le tableau, le frisson qu’il rend, pour qui chérit le pittoresque, avant qu’il soit saisi et copié et qui le sent à même la vie, pour qui enfin sait voir par lui-même, directement, et non pas seulement regarder ce qu’ont vu les autres, pour celui-là, il jouira infiniment à Naples.
Une cité d’un caractère unique en Europe : une grande ville, une capitale, qui n’est pas moderne. Cette énorme agglomération de six cent mille âmes, encore qu’éclairée à l’électricité, demeure ce qu’une ville était avant la civilisation du XIXe siècle : un immense village. Naples, ses ânes, ses chèvres, c’est une capitale qui vit en paysanne. Elle n’a pas divorcé avec la campagne, comme nos étouffantes métropoles modernes. Et c’est une cité antique catholicisée. Mais avant d’entrer dans le détail de son pittoresque, faisons connaissance avec les Napolitains.
Dès que le navire est arrivé à son mouillage dans le port, cinquante barques l’assaillent, chargées de petits singes dépenaillés, qui gesticulent et crient ; c’est l’accueil du Napolitain. Dans les barques, il y a des enfants nus pour qu’on jette des sous à la mer, des mandolinistes qui grattent leur instrument, des mendiants aveugles ou sans bras, des camelots avec une pacotille d’écailles et de corail, des faquins qui vous demandent votre bagage, enfin toute la racaille qui vit du voyageur dans les escales, et ils font un bruit du diable, et des grimaces et des signes des doigts, et ils se disputent, et ils gigotent, et ils coassent et traînent. Ils vous gâtent incontinent toute la beauté rose, chaude et épicée du port. Le temps qu’on attend la Santé, (et elle ne se presse jamais la Santé), ils restent le long du bateau à tapager. Le passager qui va plus loin, jusqu’à Constantinople ou Batoum, les regarde sans impatience ; c’est une heure qui s’écoule, c’est une distraction à la monotonie du bord. Mais celui qui s’arrête à Naples, et qui descendra tout à l’heure, se sent un peu inquiet ; il préférerait une autre réception. Enfin le médecin du port a passé, on peut débarquer. Des porteurs, en se chamaillant, se jettent sur votre attirail. La mouche à vapeur qui vous porte à terre, vous et vos colis, à une distance d’une centaine de mètres généralement, exige 2 fr. 50. C’est une « camorra »[7], et il faut vous y soumettre. Elle n’est pas réservée aux étrangers, car j’ai lu plusieurs fois dans les journaux de Naples, des récriminations de Napolitains à ce sujet. Vous avez enfin abordé, au milieu de vociférations assourdissantes, et la douane a consenti à vous examiner, vous vous installez alors dans une carozzella, et vous y disposez vos bagages. La malle est près du cocher, vous placez votre valise à côté de vous, et votre sac derrière, dans la capote. Mais aussitôt vingt bras se lèvent au ciel et dix bouches vous crient que : « Signore ! signore ! il ne faut rien mettre là ! on vous volerait »… Et, c’est ainsi, accueilli par le braillement, la gesticulation et la friponnerie napolitaine, et vous sentant de moins en moins content, que vous faites votre entrée dans la ville, la légère voiture, toute disloquée et ferraillante, s’étant élancée au grand galop vers votre hôtel en vous cahotant sans pitié.
[7] La camorra, c’est un impôt prélevé par le fort sur le faible. C’est de là que vient le nom de la célèbre association napolitaine.
Les premiers jours, en observant les Napolitains, on se demande dans quelle famille il convient de les ranger, si c’est dans celle des nègres ou celle des singes.
Du nègre, ils semblent posséder l’enfantillage, le fétichisme, la paresse, l’amour du clinquant, la prononciation molle et la mélopée. En outre, on adore le feu à Naples ; dès que traînent dans une rue trois ou quatre bouchons de paille et un morceau de journal, les gamins y portent l’allumette ; ils veulent voir le feu. La quantité de feux d’artifice qu’on tire en été dans toutes les rues de la ville est inimaginable[8]. Cet étonnement constant devant le mystère du feu, cet amour du feu se retrouvent chez toutes les peuplades primitives. Faut-il classer les Napolitains dans la catégorie des nègres ? Mais leur vivacité, leurs grimaces, leurs yeux qui regardent vite et ne se posent pas, leur amour des farces, leur mimique de l’intelligence, est-ce que ce ne sont pas plutôt des singes ? Des singes ou des nègres, les cochers déguenillés, à moitié couchés sur leur siège, qui vous harcèlent de leurs psitt ! et de leurs hé ! hé ! qui, en dépit de tous les refus, vous suivent au pas en vous faisant des signes engageants pendant des quarts d’heure, qui sont collants et exaspérants comme des mouches. Paisiblement, vous passez sur une place. Tout à coup, de loin, vous entendez venir un bruit de fantasia arabe. Un cocher, là-bas, vous a aperçu et il a lancé son cheval au galop, il fond sur vous. Il s’arrête net à votre côté : « Vulite, vulite, vulite, signo ?… » Vous allez avoir un bon moment à vous énerver… La pensée du Napolitain, c’est qu’on lui cédera afin de se débarrasser de lui. Il fait du chantage. Ainsi le mendiant, le marchand d’allumettes, le marchand de chansons, le marchand de cartes postales, etc. Il est d’un entêtement à ne pas croire. Un de mes amis m’a raconté qu’une fois, comme il était à sa fenêtre, — il habitait dans le quartier des étrangers, — un trio de musiciens mendiants, chanteur, mandoline et guitare, s’installa sur le trottoir et commença à jouer. Pour les éprouver et voir combien de temps la chose allait durer, mon ami leur dit de s’en aller, qu’ils n’auraient rien. Bien entendu, ils restèrent. Ils restèrent une heure et demie !… Mais dans l’insistance napolitaine, il y a aussi, outre l’idée de vous lasser et de vous contraindre par fatigue à céder, l’arrière-pensée que le premier refus de votre part n’est pas sincère, que c’était pour jouer, et que vous vouliez leur faire une farce… Mais je me demandais si c’étaient des singes ou des nègres.
[8] La merveille que, jouant constamment avec le feu, et se montrant imprudent et négligent à l’extrême, le Napolitain n’allume jamais d’incendie ! Les incendies sont très rares à Naples. Il faut vraiment que les maisons soient réfractaires à la flamme.
Voleurs ! voleurs comme en Orient ou comme au marché de Pont-l’Évêque. A Naples, on compte deux ou trois magasins qui vendent à prix fixe ; partout ailleurs, il faut marchander. Il ne s’agit pas pour un commerçant d’obtenir d’un article donné un bénéfice déterminé, mais de tirer du chaland qui se présente le plus d’argent possible, la valeur de la denrée n’étant point considérée. Comme au marché de Pont-l’Évêque. Et tous les tarifs à Naples sont fictifs. Le prix des places de théâtre que vous lisez sur les affiches sont mensongers : allez au bureau, on vous laissera les places à plus bas prix. Le tarif des fiacres, c’est un mot ; avant de monter en voiture, vous « faites le pacte » avec le cocher : le tarif est de quatre-vingt centimes la course, les Napolitains ne paient jamais que cinquante et souvent quarante.
Quant à l’étranger, il est considéré universellement comme un personnage d’une richesse fabuleuse ; il est envoyé par la Providence pour faire vivre à lui tout seul tous les Napolitains ; il doit payer le double, le triple, le quadruple de ce que n’importe qui paierait. Et il est inadmissible pour le peuple qu’un Napolitain soit l’ami d’un étranger. Un jour, au restaurant, comme un de mes amis de Naples, avec lequel je déjeunais, m’avait dissuadé de prendre des huîtres, le marchand lui dit sur un ton de reproche indéfinissable : « Il voulait en prendre ! et c’est vous qui l’avez empêché ! » Que mon ami eût défendu mon intérêt et non pas le sien, cela lui paraissait monstrueux, inconcevable. Il ne pouvait pas imaginer qu’un Napolitain eût été avec un étranger contre un autre Napolitain. « Mais si nous ne gagnons pas avec les étrangers, avec qui gagnerons-nous ? »
Des nègres ? On est environné ici par le fétichisme le plus naïf. A chaque instant, vous rencontrez des reposoirs improvisés sur des chaises dans la rue par des petits enfants. Des hommes en promènent, disposés sur une planche au-dessus de leur tête, ou dans des petites voitures pavoisées, comme je l’ai vu un matin au Pausilippe. Partout des veilleuses brûlent devant des images. Chacun porte sur soi une main ou une corne en corail contre le mauvais œil. Sur les murs, des mendiants dessinent au charbon des Vierges des Sept-Douleurs et des Ecce Homo.
On a souvent décrit le miracle de saint Janvier. Mais le plus étonnant dans ce miracle, c’est la façon dont on l’annonce, comme une chose certaine, immanquable — au moment du miracle : feux, dit le programme de la fête, — et la régularité avec laquelle il se produit : deux fois par an, à jour et à heure fixe[9]. Les journaux en rendent compte le lendemain, ainsi que d’un événement tout à fait naturel, prévu et ordinaire, comme de la revue du Statuto ou de la réouverture du San Carlo. Les Étrusques, dont les Napolitains descendent, étaient le peuple le plus crédule de la terre…
[9] On sait en quoi consiste le miracle de saint Janvier. Le premier samedi de mai et le 19 septembre de chaque année, à dix heures du matin, le sang coagulé de saint Janvier, contenu dans une ampoule, se liquéfie. Une foule énorme et surexcitée assiste à ce miracle, qui se produit dans la cathédrale, en présence de l’archevêque de Naples et de tout le haut clergé.
Et l’amour de tout ce qui brille (on comble de joie une négresse en lui donnant un collier de verroterie ; ici les femmes du peuple riches, les « maeste », se couvrent invraisemblablement de bijoux beaux comme de la verroterie) et l’amour du bruit (le dernier des Napolitains fait partie d’un orphéon, d’une « banda ») et l’amour du jeu (en 1906 la contribution des Napolitains au lotto, à la loterie royale, a été de 14 fr. 44 par habitant. Naples, qui est pauvre, a dépensé en 1906 dix millions pour jouer au lotto). Et leur enfantillage, leur besoin de s’amuser continuellement : ils ne sont pas cochers, maçons, gentlemen, ils jouent à être cochers, maçons, gentlemen… Tout cela me paraissait partir d’une âme de nègre.
Et quand je fermais les yeux, et que je les entendais tapageant, nasillards et criards[10], j’avais tout à fait l’illusion, je me croyais transporté dans un village du centre africain, au milieu de quelque peuplade primitive.
[10] La prononciation napolitaine, longue et vulgaire, déforme et enlaidit l’italien. Le Napolitain dit Margellina pour Mergellina, uno zoldo pour uno soldo, bosta pour posta, garozze, etc. Et il prononce une syllabe sur trois : la via Carracciolo devient la via Carrac’, Ischia devient Isc’, etc.
Et puis les jours, les semaines, les mois passèrent, et je fis plus ample connaissance avec ce peuple. Je le pénétrai mieux, je le vis moins à la surface, et il commence à éveiller ma sympathie et à m’intéresser. J’avais remarqué d’abord tous ses défauts. J’aperçus bientôt ses qualités. Et je distinguai alors avec quelle finesse, de quelle façon jolie, ils jouissaient de la vie, ces nègres, et combien, sous leur apparence bruyante et désagréable, ils étaient peu grossiers. Auprès du nègre obscène, je vis le Napolitain qui est sentimental et qui est réservé. Dans cette cité, réputée pour la facilité de ses mœurs, en effet, je n’ai jamais vu seulement deux amoureux s’embrassant dans la rue sur un banc comme, au printemps, on en rencontre à chaque pas à Paris. La tenue du Napolitain est d’une absolue décence[11] et les vertueux Anglais et les Allemands, si vertueux aussi, pourraient peut-être aller à Naples prendre des leçons tout au moins de bonne tenue dans la rue. Ce qui ne signifie pas que le ruffianisme et la prostitution ne fleurissent pas ici, comme l’ont rapporté tous les voyageurs. Mais du moins le Napolitain n’est-il ni libertin, ni dissolu[12], il est sentimental.
[11] Se bien tenir est capital pour un Napolitain. Il ne faut pas qu’on puisse dire qu’il manque d’éducation. Et dans toutes les classes. Chaque classe a un code de courtoisie qu’elle observe exactement.
[12] Le vice est inconnu au Napolitain : il n’est pas moral, il fait naturellement, sans vice, des choses immorales. Chez un peuple moral, au contraire, nourri de la Bible, la plus petite immoralité pue le vice épouvantablement.
Autre chose. On ne rencontre jamais un ivrogne à Naples. L’alcoolisme y est inconnu. Encore un exemple, peut-être, pour les honnêtes pays à Bible. La sobriété de ce peuple est admirable. Je me rappelle les coups d’œil de coin des voisins, au café, à une étrangère qui avait pris un petit verre de cognac. On ne boit que du café, du chocolat et des glaces. Très rarement du vermout. L’apéritif n’existe absolument pas. Quant au peuple, que le bourgeois de Naples s’imagine extraordinairement goinfre, il est également modéré. Dans les grandes fêtes, comme à Piedigrotta ou au Carmine, il se régale d’une tranche de pastèque et il fait bombance et satisfait sa gloutonnerie avec une assiette de coquillages.
Dans les fêtes surtout je les aimais. Ils y témoignent d’une simplicité, d’une grâce de l’âme tout à fait charmante. Une fête se compose d’illuminations et de musique. On regarde et on écoute. On est content. Il ne s’agit pas ici de s’enivrer de bruit, de grands manèges violemment éclairés, de sifflets de machines à vapeur, de montagnes russes, d’avoir des sensations violentes et de se surexciter. Non : regarder les illuminations, les décorations de la fête et écouter la musique… J’aimais cette sagesse et cette finesse de goût dans le plaisir. Ce sont des plaisirs d’art, ceux du Napolitain. Eh ! non, ce n’était pas des nègres ! Je connais des civilisés, des peuples qui savent lire et qui sont plus sauvages.
Et le dialecte napolitain qui avait l’air, avec sa prononciation large et ses appels prolongés comme une note chantée dont le ton s’abaisse graduellement, d’un patois nègre, ce dialecte était en réalité une belle langue populaire, vive et savoureuse, pleine d’images et bien faite pour réjouir l’amateur, avec ses hyperboles et sa grandiloquence, son ingénuité et sa malice, sa poésie, sa licence.
Et je continuai à voir, et les choses me parlèrent. Et je me mis à saisir des nuances. Et un jour, je regardai cette ville et ce peuple avec vénération, parce que j’avais enfin compris que je vivais dans une ville antique, au milieu d’un peuple antique. Et je commençai à rêver et à voir la réalité.
A Naples, on retrouve facilement la vie antique et l’on en respire l’air avec ivresse. Car rien n’a changé qu’à la surface, et le cœur est resté le même sous les siècles. Ces marchands de fruits aux pieds nus, assis par terre derrière leur corbeille tressée, ces marchands d’eau fraîche avec leur amphore, ces marchands de légumes qui passent en tenant la queue de leur âne, toute cette vie de la rue, est-ce qu’elle n’est pas pareille non seulement dans l’esprit, mais aussi par la forme des choses qui l’accompagnent, à la vie qui fleurissait sur ce sol en des temps très anciens ? Les objets, tout ce que l’on manie quotidiennement, sont ici d’une forme très simple, et l’on sent que leur aspect n’a jamais changé.
Quand on sort du musée, à Naples, on ne souffre pas de ce brusque dépaysement qui vous frappe partout en pareille circonstance. On a tout de suite retrouvé les types qu’on examinait tout à l’heure en bronze et en marbre, et les mêmes expressions : les mêmes âmes. Et le mystère, le mystère irritant et passionnant qu’on sentait là-bas devant les statues arrachées à la terre, des statues d’hommes qui avaient vu les siècles morts, ce mystère, on le retrouve dans les rues, devant les mêmes visages qui recouvrent l’âme très antique que l’on regrettait tout à l’heure au musée. On a l’impression qu’elle vit encore, cette âme, et la demi-illusion qu’on va retrouver toute la splendeur et les merveilles antiques du golfe de Naples. Et cela endort, pour un instant, votre nostalgie du passé.
Beaucoup de marchands des rues et de gens du peuple, vêtus seulement de leurs braies et de leur chemise, ont vraiment une allure antique. Il y a des débardeurs que l’on a vus, exactement semblables, dans des bas-reliefs. Et le nu qui ici n’est pas honteux, ces enfants nus et demi-nus qui sont la fleur, la grâce et le charme de Naples, cela est antique.
Et d’ailleurs c’est une impression éparse, diffuse, éparpillée dans chaque chose. De même que cette terre que vous foulez est toute mêlée d’antiques débris, de même tout ce que vous voyez et entendez vous paraît contenir quelque chose de très rare, d’unique. L’exclamation monosyllabique, le Hach ! du cocher qui pousse son cheval, le bruit que fait le vacher en agitant la sonnette de la vache, le sautillement des roues minces sur les dalles, le chant étrange des marchands, tout cela vous paraît très vieux, très lointain. Vous ne vous sentez plus le contemporain de ce peuple, vous avez envie de l’arrêter et de l’interroger, de le faire parler de ce temps merveilleux que vous n’avez pas connu. Mais, hélas ! son souvenir, que vous retrouvez dans tous ses gestes, dans toute sa façon d’être, est inconscient. Il ne sait pas qu’il se rappelle.
Mais quand vous vous promenez du côté de la Pignasecca ou à Tribunali, et que l’illusion vous prend, alors vous passez à Naples des heures uniques.
Malgré des alluvions continues, dont on retrouve constamment les marques (beaucoup de visages espagnols et arabes), le type grec s’est conservé dans toute sa pureté ici. Et vous croisez à chaque instant les plus beaux masques. Quant à la face vulgaire, au bas peuple, elle ressemble étonnamment à la face vulgaire latine, le gros nez un peu épaté, la large bouche prête à l’invective et au rire énorme ; elle a du style.
Ainsi le Napolitain se découvrait à moi. Je voyais qu’il n’était pas mon contemporain, que mes idées et mes mœurs lui étaient étrangères, car il était le survivant d’une civilisation ancienne, et sous ses usages, sous ses habitudes, je voyais les vieilles coutumes vénérables. Je le respectais comme mon ancêtre, comme le témoin des origines de la société dans laquelle je vis. Je voyais maintenant que son fétichisme n’était pas celui d’un nègre, d’un primitif sans race. Il était celui d’un homme du peuple contemporain de Virgile et d’Auguste. Sa religion, qui portait faussement le nom de christianisme, c’était l’antique paganisme.
Je le voyais : chaque quartier, ici, avait son dieu. Les saints, les innombrables madones : des anciens dieux, dieux qui se jalousaient aussi et qui se disputaient la prépotence. Dans les affiches annonçant la fête du Saint, je le voyais, on insinuait que le saint d’ici était plus puissant que le saint du voisin. Le Napolitain croyait plus à son saint qui le connaissait, qui était son protecteur, qu’à Dieu qui ne le connaissait pas et qui, d’ailleurs, a trop à faire.
Chez nous, les traces du greffage du christianisme sur le paganisme se sont peu à peu perdues, elles ne sont plus guères apparentes. Ici, au contraire, elles sont très visibles. A Rome, la fête du 15 août s’appelle toujours « la Ferragosto » et c’est l’ancienne fête d’Auguste, laquelle se célébrait à la même date. Ici, à Naples, on fait toujours les Bacchanales, on fête Bacchus le 7 octobre, au commencement des vendanges. Le prétexte chrétien de cette fête est de célébrer la Madone de Piedigrotta. C’est une réjouissance extrêmement curieuse. Il s’agit de faire un bruit énorme, incomparable. Cent mille Napolitains soufflent ensemble, jusqu’à bout de souffle, dans d’énormes trompes en fer blanc. Ils ne sont pas gais, ils ne rient pas, ils soufflent dans leurs trompes. C’est la tradition de la bacchanale qui les pousse et ils ne résistent pas.
Le bruit qu’ils font ne peut se comparer à rien. Il est proprement infernal. Au milieu de ces démons armés de trompes, passent des marchands de raisins, portant sur l’épaule une perche, à laquelle des grappes pendent gracieusement. On voit aussi des chars ornés de feuillages, sur lesquels des chanteurs, profitant d’une accalmie, chantent une chanson nouvelle. Car c’est la coutume de lancer à Piedigrotta, le jour de Bacchus, les nouvelles chansons.
Le Napolitain répète fidèlement chaque année ses gestes de l’année passée. Il est extrêmement traditionaliste. Pourquoi voudrait-il que les choses changent autour de lui, puisque lui-même ne change pas ?[13] Et c’est pourquoi l’on peut admirer tant de coutumes très anciennes à Naples, et tant de vieilles mœurs. On y rencontre des cortèges de fous, comme au moyen âge : quelque roi grotesque, à cheval sur un âne, vêtu d’une loque rouge, suivi d’une douzaine de gars débraillés qui font tapage. La façon de se réjouir est antique ou sauvage ; car il y a peu de différence entre ce que nous appelons aujourd’hui un sauvage et un ancien latin du bas peuple : seulement quelques nuances. Et il n’y a que quelques nuances entre un Napolitain d’aujourd’hui et un nègre. Mais ces nuances nous importent. Derrière le Napolitain, on compte trente siècles de grande race. Ce primitif-là a des aïeux. Tout ce qu’il fait inconsciemment, et par l’effet d’une obscure mémoire, nous touche ; ses traditions, en effet, sont les nôtres, et nous le reconnaissons de nos proches. Le Napolitain nous semble sauvage, parce qu’il est resté rustre ; la démarcation entre l’homme des villes et l’homme des champs n’est pas chez lui nette comme chez nous, de même autrefois chez le latin ; mais s’il est sauvage, c’est un sauvage de chez nous. Je sais bien que chez lui l’œil, comme chez les êtres les plus simples, comme chez les enfants, joue le plus grand rôle. On s’adresse toujours aux yeux, à Naples. Quand l’œil du Napolitain est pris, lui-même est pris tout entier. Il est tout à la sensation première, et ne fait pas réflexion. C’est pourquoi l’on voit si souvent, dans les rues de là-bas, des infirmes et des contrefaits devenir les souffre-douleur des scugnizzi. Je rencontrais tous les jours un gamin que les autres battaient, parce qu’il faisait une grimace extraordinaire en pleurant. Ils ne se lassaient pas de cette grimace. Ils étaient tellement saisis, chaque fois, qu’il n’y avait plus place pour un mouvement de pitié. Mais ce même peuple, qui martyrise les phénomènes, pour jouir entièrement d’eux, par amour du spectacle, est passionné aussi pour ses admirables marionnettes, qui ne peuvent pas ne pas nous toucher nous-mêmes, et où nous nous retrouvons dans notre passé.
[13] Il ne change pas, parce qu’il ne sait pas lire. Alors le mouvement moderne n’arrive pas jusqu’à lui. Il n’a que des renseignements oraux. D’ailleurs il ne s’en soucie pas. L’instruction obligatoire n’est qu’un mot en Italie méridionale. Il y a à Naples, à la conscription, 50% d’illettrés. J’ai eu une portière qui était la mère de sept enfants ; aucun n’avait appris à lire : l’école est trop loin, disait-elle.
Les marionnettes de Naples jouent des pièces tirées des romans de chevalerie du moyen âge. Elles sont grandeur nature, vêtues somptueusement et vraiment vivantes. Je n’ai jamais vu de spectacles plus lyriques que ceux auxquels j’assistai là, dans des petites salles pouilleuses, au milieu d’un peuple aux yeux brillants, pieds nus et chemise ouverte. Au moment du combat des deux guerriers, accompagnant le bruit des armes entrechoquées, le piano mécanique tourne frénétiquement pour exalter les cœurs, combat rituel, et, comme une danse, admirablement réglé, plein de tradition. Ici, la transposition de la réalité au théâtre est exacte et m’émeut autrement que n’importe quelle représentation théâtrale ; mais le Napolitain sent toute la beauté de cela.
D’ailleurs, hâtez-vous de l’aller regarder. On a déjà éventré la ville. Des quartiers curieux, et comme on n’en reverra jamais nulle part, disparaissent chaque jour. Il existe une catégorie de Napolitains qui rêvent de transformer Naples. Les uns veulent en faire une cité industrielle. Les autres une nouvelle Nice. Les journaux sont pleins de ces folies. On ne changera pas le Napolitain, mais dans cinq ou six ans, certainement, il sera plus difficile à bien voir, et la ville sera abîmée. N’attendez pas.
« Hier, vers une heure de l’après-midi, la foule qui se pressait aux environs de la galerie Humbert Ier, fut frappée par un étrange spectacle : du vico Sergent-Major descendait un groupe caractéristique, entouré de scugnizzi[14] qui cabriolaient furieusement tout autour. Au milieu du groupe, se trouvait un petit jeune homme blond, aux vêtements en désordre, aux yeux hagards : ses mains étaient attachées derrière son dos avec une grosse corde, et sur sa poitrine un écriteau pendait : « Voilà Errico, le directeur du « Squillo » châtié par l’avocat Fumo. »
« Le jeune homme était tiré avec des cordes. A peine pouvait-il se mouvoir, serré dans ses liens comme un Christ. Il criait d’une voix étranglée : « Carabiniers ! carabiniers ! »
[14] Des voyous.
Tel est le récit que je lisais, il n’y a pas longtemps, dans un journal de Naples. Et ce curieux cortège, le châtiment imaginé par l’avocat Fumo, pour se venger d’un petit journaliste malhonnête, me faisait remonter à l’esprit toutes les singulières images, toutes les choses surprenantes que j’ai vues, au hasard de tant de promenades dans les rues de Naples. Aucune cité, en Europe, n’est aussi amusante : la variété des spectacles y est infinie, c’est que l’esprit des Napolitains est ingénieux, et il possède en même temps quelque chose de simple et de suranné, qui est tout à fait inattendu pour les hommes modernes que nous sommes. J’estime que la rue à Naples est plus intéressante pour nous qu’une rue d’Orient. Nous comprenons en effet ce qui s’y passe. L’on y voit ce qu’on pouvait y voir chez nous dans l’ancien temps. On vit là sur des traditions qui sont les nôtres ; ce que nous rencontrons remue en nous d’obscurs souvenirs : nous sommes de cette race, nous appartenons à cette civilisation, nous avons dépassé le point où ils en sont restés, mais autrefois nous y avons été.
Je dirai ici, sans ordre, suivant le caprice du souvenir, ce que j’ai vu là-bas de surprenant.
Le récit de journal, qui décrit le cortège formé par l’avocat Fumo, ne rend pas le bruit au milieu duquel le malheureux petit jeune homme blond devait avancer. J’ai logé, à différentes reprises, à l’auberge, dans un des quartiers les plus grouillants de Naples, du côté de la Pignasecca. Souvent dans la rue éclatait une discussion, alors c’était de grands cris, par chacun des adversaires tous les saints et toutes les madones étaient pris à témoins de l’ignominie, de la bassesse, des vices honteux et de la laideur inouïe de l’autre, aussitôt sortaient de tous les pavés de méchants gamins, des scugnizzi, la ruelle retentissait de clameurs, des huées s’élevaient, les sifflets faisaient rage, on ne s’entendait plus… Les discussions entre commères dans les rues populeuses de Naples sont incessantes, et presque toujours elles prennent naissance des enfants. Il y a des nuées d’enfants à Naples, qui courent partout : une femme a donné une taloche au petit d’une voisine, celui-ci se précipite chez sa mère en pleurant, la mère arrive, elle demande de quel droit on a battu son fils : discussion, hurlements, on se souhaite les accidents les plus terribles, on espère du ciel des vengeances éclatantes. Chacun est d’une loquacité intarissable et les prises de bec durent souvent fort longtemps. Je me rappelle deux femmes, dans le quartier du Marché ; elles se chamaillaient : non loin il y avait une grande tablée de gens qui jouaient au loto. D’abord les joueurs s’étaient levés, ils avaient entouré les deux commères. Mais cela ne finissait pas. Alors ils étaient retournés à leur table. Et, tandis que d’une voix effrayante, tout près d’eux, elles continuaient à se promettre mutuellement à l’enfer, avec une indifférence délicieuse, comme s’ils n’entendaient rien, ils avaient repris leur partie, une petite fille tirait paisiblement les numéros d’une bouteille d’osier, et chacun, d’un air d’extrême attention, regardait son carton.
Bien qu’ils figurent à l’origine de beaucoup d’épouvantables discussions, les petits enfants sont d’ailleurs un des charmes de la ville. Ils fleurissent de leur chair rose les ruelles ombreuses : ils sont presque toujours nus ; ils se confondent sur le sol avec les petits chiens et les petits chats. Ils sont l’image vivante de l’admirable fécondité de ce peuple. Fécondité trop grande, folle fécondité. Ici, les estropiés, les difformes, les êtres bizarres sont légion. Il y a ici une végétation de vie humaine prodigieuse, mais ce n’est pas un jardin ni un parc, c’est une forêt vierge. On ne ratisse pas, on n’émonde pas. C’est l’exubérance de la nature, un fouillis hasardeux, désordonné, inextricable ; tout a poussé, c’est la forêt mystérieuse et magnifique, — mais à côté des chênes superbes, combien d’arbres mal venus, rabougris, à demi morts !
Le cortège du petit jeune homme blond me rappelle d’autres cortèges. Celui d’un roi fou, comme au vieux temps, que je vis passer un jour à Toledo, déguisé, à cheval à l’envers sur un âne, sa tête tournée du côté de la queue de la bête. Il était entouré de joueurs de putipu et cheminait gravement sur la chaussée.
J’ai vu aussi bien des processions singulières, la procession aux sonnettes, coup de sonnette : tout le monde à genoux, les prêtres, les pénitents, les passants… On repart… Nouveau coup de sonnette, et de nouveau agenouillement général. — Le passage du Saint-Sacrement est curieux : au-dessus du prêtre qui le porte, un clerc tient une sorte de parasol chinois, quatre porteurs de lanternes anciennes l’escortent, sortes de lanternes de carrosses fichées au bout d’un long manche, un enfant de chœur sonne, la rue s’agenouille.
Quelquefois, à Naples, on entend une musique joyeuse, un orphéon s’approche, faisant vacarme : c’est un enterrement. Deux lignes de pénitents en cagoule s’avancent, tenant de gros cierges et précédant un haut catafalque rouge au sommet duquel trône un cercueil doré. Pour les enterrements de riches, le cercueil se trouve dans un carrosse entièrement vitré, traîné par six ou huit chevaux habillés de draps éclatants.
D’ailleurs, à Naples, tout ce qui tient à la mort ou à la religion est infiniment curieux. Il y a plus de quatre cents églises dans la ville. Souvent elles se font face ou elles se touchent. La concurrence entre toutes ces églises est sérieuse ; le clergé, qui est considérable, meurt de faim. J’ai vu des vieux prêtres vêtus de soutanes rapiécées et verdâtres, couverts de chapeaux à poils informes, tendre la main dans la rue. Les dimanches, si vous passez dans les ruelles voisines de la Pêcherie, on vous tirera par votre veste, on vous demandera d’entrer à l’église, on vous dira que : « Signore, la messe est prête »… Je me rappelle, à la porte d’une chapelle, un marchand de fruits à la fois criant sa marchandise et agitant par une corde une sonnette destinée à appeler les fidèles. Il disait tantôt : « Fichi, fichi, a tre soldi, tre soldi ! » et tantôt : « Alla messa ! alla messa ! alla messa ! »
Il y a dans les rues, fixés sous verre aux murs, un grand nombre de reposoirs : l’image d’une madone, un bouquet, une lumière. Les jours de fête, les enfants disposent des reposoirs sur des chaises, devant les maisons. A l’intérieur des maisons, partout des reposoirs ; point de boutiques où ne brûle une petite flamme devant quelque image ; j’en ai vu un superbe, brillant de mille feux, une fois, dans le sous-sol d’un café, là où se trouvent les cuisines et les caves.
Les moines sont innombrables ; on en croise de tous poils et de toute vêture. On voit des nonnes en robe de bure avec un très large chapeau de paille. Mais les religieux les plus communs sont les frères de Saint-François, généralement dépenaillés et fort sales. Ils ne jouissent pas dans le peuple, d’une trop bonne réputation, le fait est que j’en ai vu arrêter un dans la galerie, un soir, et c’était un curieux spectacle. Le moine marchait devant son accusateur, un petit jeune homme mince, une grande foule suivait. On passa devant la station de voitures de Saint-Ferdinand, et pour indiquer de quoi le moine s’était rendu coupable, un cocher fit en riant le plus joli geste obscène que j’aie jamais vu.
Une autre fois, au restaurant, j’avais fait l’aumône à un moine, doué d’une honnête figure. Le patron accourut : « Qu’avez-vous fait ! me dit-il. C’est un usurier. Il prête à la petite semaine avec l’argent qu’il recueille en mendiant. »
On les accuse d’ivrognerie. Un camelot, du premier janvier à la Saint-Sylvestre, gagne sa vie en vendant une petite poupée articulée représentant un franciscain. En tirant sur son capuchon, il baisse la tête en arrière, le bras, en même temps, se lève, portant à la bouche une fiasque minuscule. Toute la journée, le marchand annonce d’une voix monotone « O muonac ’mbriacone », le moine grand ivrogne.
Les moines sont entourés cependant d’un petit respect familier dans le menu peuple napolitain. Ils sont réputés connaître à l’avance les numéros qui sortiront à la loterie. Aussi le matin, quand ils font leur tournée dans les rues, leur besace finit-elle par se remplir ; ici ils attrapent une pomme de terre, là une carotte, plus loin une figue ou un piment. En échange, ils bénissent la maison de leur bienfaiteur. J’en ai vu qui bénissaient des étalages de fruitières, c’était naïf et touchant, c’était joli.
On trouve à Naples, dans le quartier de San Domenico, une rue entièrement occupée par des marchands d’objets de piété. Il y a là des enfants Jésus en plâtre à la chevelure blonde, des gros bouquets de fleurs en papier, des petits personnages pour les crèches de Noël, des flambeaux et luminaires de cuivre. C’est un endroit intéressant : très souvent on voit installé au milieu de la ruelle un sculpteur en train de donner le dernier coup de pinceau à un saint grandeur nature. Le saint, debout sur un socle en bois, la face débonnaire et le bras étendu, dessine toute la journée le même geste pacifique sur la tête des passants.
En vous promenant dans les rues, vous rencontrez souvent des enfants et même de grandes personnes habillées d’un vêtement d’un vert particulier. Ce vert est une couleur votive. La madone les a sauvées autrefois d’un danger, et elles se sont vouées à ce vert qui d’abord surprend par son ton inusité.
A midi, le canon tonne. C’est à Saint-Elme qu’on annonce le milieu de la journée. Vous verrez alors tout le petit monde qui vous entoure faire le signe de la croix en baisant son pouce.
Ce geste pieux n’est qu’un des mille gestes napolitains. Si vous voulez étudier les gestes de ce pays, gestes gracieux et très expressifs, allez dans un café, surtout au Fortunio, dont les habitués sont tout à fait du cru, et regardez les bavards. Vous admirerez alors ce que l’on peut faire dire à une main, à des doigts, sans compter le visage, d’une richesse de grimaces infinie.
Les gestes obscènes aussi ne sont pas des plus rares. Vous avez vu tout à l’heure celui du cocher regardant passer le mauvais moine. Il y en a d’autres, traditionnels et qui remontent à l’antiquité. Le peuple a conservé la superstition du mauvais œil, de la jettatura, elle existait chez les anciens, et l’on s’en préservait de la manière même dont on s’en garde aujourd’hui : en touchant ses parties basses. La représentation du sexe a toujours eu pour objet d’écarter le mauvais destin, et tous les phallus qu’on a trouvés à Pompeï, dont beaucoup énormes, sur la façade des maisons, n’avaient pas du tout pour but, comme l’ont dit les idéalistes et les amateurs de symboles, de glorifier la semence, la reproduction et la continuité de la vie. Ils étaient destinés, tout simplement, à écarter des maisons, sur lesquelles ils s’érigeaient, le mauvais sort, les événements funestes, la destinée contraire. Aujourd’hui, entrez inopinément à la Pêcherie : bien rare si vous ne voyez pas tous les pêcheurs, à l’aspect d’un visiteur étranger, porter en même temps la main à leur sexe, et même le mettre en l’air : ils se préservent contre le mauvais œil dont rien ne dit que vous ne soyez affligé.
Un de mes amis de là-bas m’a conté, à propos de la Pêcherie, un fait curieux. Il partait en voyage et avait pris, pour se rendre à la gare, une carozzella. Le cheval s’emballe, parcourt la Marine à une allure effrénée et finit par s’abattre exactement devant le Christ de la Pêcherie. Le cocher et mon ami étaient sains et saufs. Voilà tous les pêcheurs criant au miracle. Ils s’agenouillent et rendent grâce au ciel. Mon ami voulait prendre son train. A genoux, d’abord, à genoux !… Il arriva au chemin de fer bien après l’heure.
Cette piété napolitaine, très enfantine et, justement, parce qu’elle est enfantine, d’un sentiment frais, a du charme. Elle comporte beaucoup de superstition, mais elle est aussi très chrétienne : le Napolitain est bon et charitable. Un jour de fête, j’ai vu à Barbaia un banquet de pauvres. C’était délicieux. Sur la nappe blanche, chaque pauvre avait son beau morceau de pain blanc, qu’il contemplait. On le servait. Il était à l’ombre, le ciel était bleu : c’était comme au paradis. Les bonnes gens du voisinage entouraient les convives, faisant mainte et mainte réflexion gracieuse.
De là vient peut-être que le socialisme a encore peu réussi à Naples. Le fond de haine qu’on y peut découvrir s’accorde mal avec le climat doux du pays et la bonté de cœur naturelle à ses habitants. Certes la misère est aussi grande là qu’où que ce soit : elle est sans doute plus facile à supporter, à oublier, que dans des régions sombres. En hiver, au printemps, le soir vers quatre ou cinq heures, la noblesse, qui est allée défiler en landau sur la via Caracciolo, vient se montrer à Toledo : on monte la rue, au pas, pour se faire admirer, droit et digne sur les coussins de la voiture ; de chaque côté de la chaussée, un rang de badauds bénévoles regarde, très satisfait, et jamais on n’entend un cri, une parole de violence ou de jalousie. Lutte de classes, voilà un mot bien dépourvu de sens à Naples.
Ce sentiment religieux donne naissance à de belles fêtes. J’ai parlé ailleurs du retour de Montevergine qui provoque un si extraordinaire défilé de voitures sur la Riviera di Chiaia. La fête de saint Janvier, avec le miracle bi-annuel, est connue. Il y a des fêtes de quartiers, dont la plus belle est celle du Carmine, mais je l’ai décrite dans un roman. Il y a la Fête-Dieu ou des Quatre-Autels qui se célèbre principalement à Torre del Greco. Il y a enfin la bénédiction de la mer par le cardinal-archevêque. Et toutes les petites fêtes de tous les saints, dans toutes les rues, avec musique, pétards, et le gros ballon de papier portant une queue d’éponges imbibées de pétrole enflammé et qui, généralement, s’accroche à une maison et y flambe comme une torche…
C’est charmant de sortir le matin, quand le soleil n’est pas encore chaud, et d’errer à l’aventure dans les ruelles. Tous les travailleurs sont à l’ouvrage : les savetiers, les blanchisseuses, les menuisiers, les tourneurs. La rue est un vaste atelier, chacun s’agite et fait son œuvre : celui-ci rabote sur son établi ; celui-là, un rétameur, se meut au milieu de sa ferraille et tapage. La rue est un vaste magasin : voici, alignées sur le trottoir, des rangées de chaises toutes neuves ; voici de grands lits de fer, des commodes et des armoires. Un peu plus loin, c’est une ruelle qui ressemble à un abattoir : d’énormes quartiers de viande, de rouges moitiés de bœuf pendent à des crocs de fer, et des terrines de sang traînent sur des étals au milieu de foies, de tripes et de cervelles. Même un boucher a attaché un agneau vivant à un pieu et s’apprête à l’égorger.
Mais voilà un rassemblement, une musique de flûte et de violon s’élève ; cinq musiciens aveugles, assis sur des chaises, donnent au peuple un concert. Ils ont des yeux blancs ou les paupières fermées et font des gestes raides. Ils se sont installés par hasard devant une porte où se trouve assise une vieille que je reconnais ; c’est une entremetteuse de Toledo ; ce matin, elle n’est pas coiffée, ses cheveux d’un gris sale lui tombent dans le visage ; elle a une tête sinistre d’oiseau de proie.
Cependant, une autre musique s’approche, et c’est un tintamarre de tambours accompagné de l’aigre voix du fifre : quatre garçons, vêtus de costumes bariolés, précèdent un mondor qui porte le chapeau à plume et la veste rouge du charlatan ; d’une main il tient une longue canne, de l’autre une fiasque de vin. Il s’arrête, il parle, et il fait goûter à chacun du vin de sa fiasque, le goulot passant de bouche en bouche. Il annonce le vin nouveau.
Parmi les gens qui l’entourent, j’en vois un qui, sur sa tête, porte tout un reposoir : une statue de la Madone, des bouquets de fleurs et des lampes ; à côté de celui-ci, un nain à figure de vieillard fait des grimaces aux enfants qui le regardent.
Mais la rue à Naples est constamment curieuse. De quelque côté qu’on pose les yeux, on rencontre des objets ou des êtres qui vous mènent très loin et par le temps, car ici on se retrouve toujours, non pas aujourd’hui, mais dans le passé, et par l’espace, car nous sommes en plein Midi, c’est-à-dire avec des gens totalement différents, tout à fait lointains des gens du Nord, parmi une race qui commence à Marseille et ne finit qu’à Ceylan, avec cette espèce de gens dont les mœurs sont celles des êtres habitués à vivre au soleil. Après déjeuner, de grosses femmes dorment assises devant leurs portes, tandis que les mouches les dévorent, et des hommes en caleçon fument leur pipe sur les balcons. La nuit, quelquefois, rentrant chez vous, vous entendez à vos pieds un ronflement sonore : il y a un matelas sur le trottoir.
J’ai parlé des enfants nus ; ceux qui ne sont pas nus, mais qui le semblent parce que leur peau, en dépit du vêtement, apparaît de tous côtés, sont innombrables… Et si les Napolitains sont intéressants en général, ils le sont plus encore en particulier. La rue fourmille de types. La population qui rôde autour des cafés, par exemple, est charmante ; tous les camelots qui veulent vous vendre quelque chose, si importuns, indiscrets et gênants qu’ils soient, sont originaux : voici un marchand d’écaille et de corail, son petit coffre de bois sous le bras ; il le pose sur votre table, il l’ouvre avec lenteur et précaution comme s’il allait découvrir à vos yeux émerveillés les plus fabuleuses richesses, et le voilà qui vous présente, avec une délicatesse infinie, un collier qui vaut bien treize sous au bazar et un peigne magnifique en celluloïd. Puis il épie sur votre visage les signes d’admiration que vous allez donner. Ce camelot fait le muet : quand on lui demande le prix de sa marchandise, il montre ses lèvres pour expliquer qu’il ne peut parler, et c’est les doigts levés qu’il indique le nombre de lire que, selon lui, vaut chaque objet. Mais ceci ne vous convient pas : il va vous montrer autre chose ; il soulève lentement, très lentement, le petit plateau mobile de son coffret : Ah ! attendez ! vous allez voir ce qu’il y a là-dessous !… Il y a d’affreuses petites broches en laves du Vésuve. Hein, c’est joli, cela ! Il en prend une entre le pouce et l’index, et, la tournant et la retournant sous vos yeux, vous la fait admirer minutieusement. Il en dépose deux ou trois sur la table : Oh ! vous pouvez toucher !… Mais cela ne vous plaît pas ! Madone ! Par sa mimique, il exprime que ce n’est pas bien de se moquer ainsi d’un aussi pauvre homme que lui, et qu’il est désolé vraiment, car c’est tout ce qu’il a, et oui, certes, ce n’est pas assez beau pour votre seigneurie… Il s’éloigne. Un autre approche. Il vous parle. Il a compris que vous ne vouliez pas acheter du corail. Il sait bien, lui, ce que désire le signor. ’Na bella ragazza… Ah ! il en connaît, lui ; il connaît une ragazza, une jeune fille jolie comme les anges, il va aussitôt, si vous le voulez, vous conduire chez elle. Mais comme vous l’avez écarté, voilà des gamins qui se faufilent sous votre table, ils font des grimaces, ils vous supplient : ce qu’ils vous demandent, c’est de les laisser sucer le fond de votre verre où restent encore trois gouttes de granita fondue.
La place Saint-Ferdinand, sur laquelle se rencontrent toujours beaucoup d’étrangers, fourmille de ces types. Il faut voir, le soir, Amoroso, un vieux ruffian célèbre, arpenter toute la place en tirant la jambe, son feutre sur les yeux. On ne distingue pas ses yeux. Embusqués dans l’ombre de son chapeau derrière ses lunettes, ils fouillent toute la place. Il a aperçu un client possible. Il s’élance et il commence à le circonscrire, trottinant à côté de lui, boitillant, et frappant à petits coups le pavé de son bâton. Il porte le bras droit dans une brassière noire. Il connaît les longues attentes immobiles. Il guette. Il tire sur son cigare qu’il regarde de temps en temps ; il met les doigts dans son nez. Il est un peu voûté. Parfois il tourne la tête : on voit briller ses lunettes. Il y a cinquante ans qu’il fait la place Saint-Ferdinand, il a connu le temps des Bourbons, il a vu construire la galerie, il se rappelle l’époque où le Gambrinus s’appelait le « Café d’Italie ».
Il y a de très jolis types de mendiants : un petit bossu, portant devant lui une tablette couverte de boîtes d’allumettes et de sucreries, qui ressemble à un kobold, avec son nez crochu et sa barbiche grise… Il y a enfin le « cavalière », petit vieillard aux beaux yeux de chien, à la figure lamentable, qui veut toujours vous vendre des allumettes, inglese, signore, inglese, et dont la légende dit que c’est un gentilhomme ruiné ! Il sert de jouet à tous les gamins de la place, et l’on entend parfois des cris épouvantables, c’est le cavalière, qui, exaspéré, lève son bâton en maudissant encore quelque garnement. Pauvre cavalière, pauvre vieux chevalier ! Je l’ai vu, un jour, au café, tandis qu’un consommateur lisait son journal, s’approcher tout doucement. Il prend la tasse sur la table, y verse le fond de la petite cafetière, tire de sa poche un morceau de sucre, se sucre, tout cela avec quelles précautions pour ne faire aucun bruit !… L’autre était immobile derrière son journal. Le cavalière boit le café. Mais l’autre, qui ne disait rien et voyait tout, sort brusquement de son journal. Bah ! le cavalière n’a pas fui. Il en a vu bien d’autres. Que peut-il lui arriver ? Rien, il sait d’ailleurs que son air lamentable désarmera tout le monde. Il baisse simplement la tête. Puis, de ses bottes éculées, il s’en va, d’un pas traînant.
Et il y a les hasards de la rencontre. Ce sont eux qui veulent que je passe dans Toledo, tandis qu’y passe aussi cet homme, lequel, allant livrer un palmier de trois mètres de haut, le porte sur sa tête, ce qui fait que la dernière branche monte à la hauteur d’un second étage et qu’on dirait là un arbre marchant. Ce sont eux aussi qui me permettent de voir une voiture de prison, une simple charrette avec une bâche, sur le siège de laquelle se trouve un carabinier, et dans le fond un homme enchaîné. Une femme aux cheveux épars suit la voiture en courant et cause avec le prisonnier.
Ce sont eux qui, un soir, m’ont permis d’être racolé par une fille, toute parée, qui portait son petit enfant dans ses bras. Et cela n’était point triste comme ce l’eût été chez nous, cela n’était pas à pleurer. C’était naturel et sans désespoir, parce qu’on était à Naples, à Naples par une soirée belle et chaude.
Ce sont eux enfin, ces hasards, qui m’ont fait rencontrer dans les rues de ce port des petits pelotons de marins japonais, qui marchaient sagement, deux par deux, une gourde d’eau en bandoulière, parce qu’il leur était défendu d’entrer dans les buvettes, et, une autre fois, les Américains, tandis que leur escadre était dans la baie, lesquels au contraire, toujours ivres, faisaient tumulte dans la ville, passaient en carozzelle au grand galop, s’attablaient, achetaient au hasard tout ce que les camelots leur présentaient, criaient, se battaient, et se faisaient presque chaque jour reconduire à leur bord par la police.
Je revenais de Poggioreale. Le tramway, bondé de voyageurs, filait sur les rails en bordure de la route. Tout à coup, je vis le geste d’une femme assise en avant ; avec effroi elle levait les mains pour se cacher les yeux ; la voiture bloqua ses freins et s’arrêta brusquement. Alors, il s’éleva un grand bruit de voix, et le wattman, étant descendu, s’accroupit près du tramway. Il se redressa : il tenait dans ses bras un pauvre petit garçon, dont un pied pendait affreusement, avec la chaussure. Coupé net à la hauteur de la cheville, le pied tenait à la jambe par une lanière du pantalon déchiré ; il se balançait. L’enfant avait eu si peur, ou il souffrait tant, qu’il ne criait pas : sa bouche grande ouverte était muette, mais le visage était contracté, épouvanté, effrayant.
Les voyageurs descendirent sur la route. Ils parlaient tous en même temps. Ils tournaient sur eux-mêmes et ils levaient les bras vers le ciel. Je n’ai jamais vu un si beau tableau. Tous leurs gestes étaient purs et naturellement lyriques ; ce jour-là, je compris que les peintres de la Renaissance italienne n’avaient pas eu besoin de composer leurs tableaux : il leur suffisait de regarder autour d’eux. Ce peuple-là a le génie de la belle expression dans le mouvement.
On menaçait le wattman, on voulait lui faire un mauvais parti, on était exaspéré. Cependant, un fiacre était arrivé avec un agent. On y avait placé le misérable petit blessé ; l’agent le conduisait à l’hôpital. Je songeais que cet enfant qui, cinq minutes auparavant, jouait, libre, heureux et sans soucis, était maintenant estropié pour la vie. L’existence était à jamais gâtée pour lui. Une seconde avait suffi.
Et je comparais l’attitude de mes compagnons exaltés, émus, débordants de pitié, à celle de gens d’un autre pays. J’avais vu, à Londres, un ouvrier, qui travaillait sur un toit de verre, dans une gare, tomber. Une chute de douze ou quinze mètres. On avait entendu un fracas de verre brisé, puis quelque chose de lourd s’était abattu sur le sol. Le corps demeurait immobile, par terre. Un ou deux passants s’étaient arrêtés. Pas un mot. Et les autres, ayant à peine tourné la tête, avaient continué leur chemin, du même pas égal.
Le tramway était reparti. Les voyageurs ne s’asseyaient pas. Ils criaient. Ils tendaient le poing vers le wattman. Alors le contrôleur passa de banquette en banquette, et il se mit à parler. Il démontrait qu’il n’y avait pas eu de la faute du wattman : une voiture avait empêché celui-ci de voir le petit garçon ; dès qu’il l’avait vu, il avait bloqué ses freins. Il parlait comme un orateur, avec exorde, développement, conclusion. Il avait le geste et la période ; il convainquait. Et grâce à lui le tramway s’apaisa.
Cependant une petite jeune fille, bouleversée par ce qu’elle avait vu, s’était mise à pleurer. Un jeune homme, assis à côté d’elle et qui ne la connaissait pas, en profitait pour faire connaissance. Il la consolait, il lui disait des choses douces, et l’on voyait qu’il lui dirait bientôt des choses tendres.
Le tramway arrivait à Naples. On était calmé. Chacun descendit, s’en fut à ses affaires. Le jeune homme partit du même côté que la jeune fille.
J’avais saisi là sur le vif plusieurs traits du caractère napolitain : la faculté de s’exalter tout d’un coup, de prendre feu, et aussi de se calmer rapidement ; nature violente, mais feu de paille. Le goût de la parole et des discours. Enfin, le penchant à l’amour, la galanterie qui n’abandonne jamais un cœur napolitain.
Heureux pour le wattman que l’accident se fût produit hors de Naples. Dans la ville, il ne s’en fût pas tiré à si bon compte. Il arrive souvent que les tramways écrasent des enfants : ces derniers sont en si grand nombre et si peu surveillés. Mais quand le fait se produit dans une voie fréquentée, au Rettifilo, par exemple, cela se termine souvent par une émeute. La première année de mon séjour, un tramway avait écrasé un enfant ; la foule brûla le tramway, puis elle occupa la voie ; on avait envoyé des agents, on fut obligé de les soutenir par des carabiniers et de l’infanterie. Toute la journée on se battit. On se disputait le corps : tantôt il était entre les mains de la troupe, tantôt dans celles de la foule. Mais le lendemain, tout était rentré dans l’ordre et il n’y paraissait plus.
Le Napolitain se monte promptement. Il parvient tout de suite à la dernière violence. Puis, fatigué par cet effort, il se calme, et son indolence naturelle reprend le dessus. Il a des colères d’enfant.
Par un bel après-midi d’été, j’étais descendu sur la Marina Grande, à Capri, je voulais me faire conduire aux grottes. Deux ou trois mariniers causaient paresseusement. Je m’adressai à eux. Ils s’étiraient et ne répondaient pas. Enfin l’un d’eux se décida : « Moi, signore, j’y vais. Trois lire. » C’était au-dessus du tarif, je le fis remarquer, et j’obtins la promenade pour deux lire. Il tira mollement sur la corde de sa barque, l’amena à quai ; j’y descendis, il y descendit à son tour, puis il saisit ses avirons d’un air las et dégoûté. Il regardait la terre, les deux autres qui étaient restés là-bas et qui continuaient à ne rien faire. « Tre lire, signore ? » — « Non, due. » Il se mit à ramer avec nonchalance, et nous fîmes une centaine de mètres. A ce moment, il observa que je souriais. Je souriais de sa petite comédie, qui m’avait amusé. Mais il crut que je me moquais de lui, parce qu’il avait cédé, parce que je l’avais fait marcher malgré lui. Il fut touché dans son amour-propre. Il lâcha les rames et se croisa les bras : « Trois lire pour aller aux grottes, signore ; je ne vais pas aux grottes à moins de trois lire. » Furieux de ce manque de foi, je me fâchai, je ne voulais pas céder à sa camorra. « Trois lire ou je retourne. » — « Retourne. » Il reprit ses avirons, nous revînmes à terre.
Et c’était bien napolitain. Le Napolitain ne peut supporter qu’on se moque de lui. Ce marinier-là avait cru que je riais à ses dépens. Alors ne pas aller aux grottes, à quoi sa paresse, le beau temps, le plaisir de ne rien faire sous le beau ciel bleu n’avaient pu le déterminer, son amour-propre blessé l’y décida subitement.
L’amour-propre, la vanité, c’est un des grands mobiles napolitains. Il est ostentatoire. Il aime l’emphase, la façade, les discours. Il aime le costume, la parure. Sa femme est couverte de gros bijoux ; dans le peuple, les femmes des marchands sont parées comme des châsses. Quant à lui, il est l’Italien le mieux habillé de la péninsule. Il raffine en fait de vêtements, c’est un esclave de la mode. Un été, il était élégant de porter des lunettes noires à grosse monture en corne : c’était affreux, cela enlaidissait tout le visage. Eh bien, pas un jeune homme à prétentions qui n’en portât : d’abord la mode, n’est-ce pas ?
Il faut les voir sur la place Saint-Ferdinand, coquets, pimpants comme s’ils sortaient d’une boîte : pantalon blanc, chaussettes et souliers blancs, chapeau de paille de la dernière forme, fin mouchoir dépassant la pochette. Ils sont minces et nerveux. Ils se regardent, s’examinent mutuellement d’un œil de critique, comme des femmes élégantes.
A ce goût de la toilette, on peut découvrir trois causes principales : d’abord le besoin de paraître, de faire de l’effet, d’être considéré, puis le plaisir artiste de s’amener à son point le plus parfait, de se montrer dans son beau, enfin la satisfaction de s’occuper de choses futiles, car l’esprit ici est brillant, mais superficiel.
Mais il existe encore une raison, très forte pour un Napolitain : il aime à se déguiser, à paraître ce qu’il n’est pas. Il ne s’agit pas seulement de faire illusion aux autres, mais encore à soi-même. S’il est pauvre, il s’imaginera qu’il est riche. Il se nourrira d’un croissant dans une tasse de café, mais il sera vêtu comme si son gousset était bien garni. Et il se promènera avec des airs de gentleman. L’employé veut passer ici pour un bourgeois, et le bourgeois pour quelqu’un de l’aristocratie. Un garçon de café porte un habit de bonne coupe et, pour ranger le billet de cinq lire que vous lui avez donné, il tire de sa poche un portefeuille parfaitement élégant. Aussi comme les gens vraiment riches sont regardés, imités, copiés ! tous leurs gestes et toutes leurs manières sont longuement commentés. On prend sur la place une granita de cinq sous pour pouvoir les observer, les voir passer. Et quel plaisir si par hasard on en connaît un, quel coup de chapeau ! Un petit jeune homme pauvre de Naples saura toutes les histoires des gens riches : quand vous le mettez sur ce chapitre, il ne tarit pas. Par contre, il feindra pour le peuple le plus grand dédain, bien qu’au fond il l’aime beaucoup ; mais il ne veut pas qu’on le confonde avec lui, il l’accusera donc de tous les vices, il le calomniera, il dira volontiers, par exemple, qu’il est ivrogne, ce qui est un mensonge tout à fait gratuit, le Napolitain de toutes les classes étant, comme je l’ai déjà dit, d’une admirable sobriété.
Cependant, outre l’amour-propre, ce qui encore empêchait le marinier de Capri d’aller aux grottes, c’est que cela lui était apparu comme un travail. Il faisait beau temps, il faisait chaud, ramer ne l’amusait pas. Or, le Napolitain veut toujours s’amuser, continuellement il joue. Il joue au cocher, au pêcheur, au maçon. Il a de la fantaisie dans l’esprit. Que son métier d’abord lui paraisse amusant ; si c’est, purement et simplement, du travail, il abandonne. Il faut voir ses mines rebutées, son découragement, son dégoût, quand il est contraint de faire quelque chose qui ne lui plaît pas ; c’est tout à fait curieux.
Le Napolitain a des goûts très fins. Il est sobre. Il n’aime pas boire. Il n’aime pas à faire le grossier. Dans les grandes fêtes vous verrez d’énormes tablées, beaucoup de gens devant des verres. Approchez, vous vous apercevrez que cette débauche est toute d’apparence : une poignée de coquillages, un verre d’asprino, voilà tout le festin. Quels sont donc ses goûts ? D’abord paraître. Puis la musique. Il raffole de la musique. J’ai vu un gamin, l’oreille collée à la devanture d’une boutique de chansons où l’on jouait du piano, il en perdait le souffle.
Enfin le théâtre. L’amour du théâtre est développé à Naples comme nulle part ailleurs. Pour une population sensiblement égale, il y a à Naples trois fois plus de théâtres qu’à Marseille. On y voit des acteurs du cru, depuis Scarpetta jusqu’à Pantalena, tout à fait supérieurs. On y joue en dialecte des pièces burlesques succulentes. Et je ne parle pas des théâtres à musique, du célèbre San Carlo ou du Mercadante.
J’ai assisté, au Mercadante, à une curieuse représentation. C’était à l’époque de la fête de Piedigrotta. On sait que sortent alors toutes les chansons de l’année. On organise des concours. Ce soir-là, au Mercadante, on donnait un choix de chansons nouvelles ; les auteurs des paroles et de la musique étaient dans la salle. Le commencement de la représentation fut troublé par un orage. Le plafond du théâtre, probablement, n’était pas étanche, il se mit à pleuvoir dans la salle : les spectateurs des fauteuils d’orchestre ouvrirent leur parapluie, et ceux qui n’en avaient pas déménagèrent précipitamment. Les employés du théâtre se précipitèrent avec des housses pour couvrir les rangs de fauteuils menacés. On criait, on riait, on battait des mains, on réclamait le lever du rideau.
Le rideau se leva. Le décor représentait le port, avec le Vésuve au fond. Il y avait d’abord un chœur d’hommes et de femmes qui chanta la première chanson, puis une grosse chanteuse, très aimée du public, Rispoli, alla chercher l’auteur derrière un portant : on applaudit. Alors l’auteur montra de la main la chanteuse, pour signifier que si sa chanson paraissait bonne, c’est qu’elle avait été bien chantée. Mais la chanteuse, à son tour, montrait l’auteur pour dire que si elle avait bien chanté, c’est que la chanson était excellente. Ces congratulations, ces courtoisies expressives étaient tout à fait amusantes. Elles se trouvaient exactement du goût du public qui criait « bissa ! bissa ! bravissimo ! » La Rispoli recommença sa chanson.
Après elle parut Pasquariello qui chanta sur des paroles de Ferdinando Russo. Il obtint aussi un grand succès. Alors Russo, qui était assis dans une avant-scène, se leva ; en se penchant il tendit la main à Pasquariello, lequel de la scène lui donna une poignée de main. On applaudit. Russo montra au second étage un gros homme, c’était l’auteur de la musique : c’est à lui, à lui seul, qu’on devait que la chanson fût belle. Le gros homme se leva, et du second étage il tendit le bras vers l’avant-scène de Russo : il voulait dire que sur d’aussi belles — ah ! si belles ! — paroles que celles de Russo, il était trop facile vraiment de faire de la bonne musique…
On est très poli à Naples. On est trop poli. On s’égare en compliments, en cérémonies, en élégances de toutes sortes. La tournure de l’esprit napolitain est telle : on perd beaucoup de temps en bavardages. L’esprit y est fin et très subtil. Mais il n’y est point robuste. Les Napolitains sont des amateurs délicats, ils ont tous le goût et l’intelligence de l’art, ce sont rarement des vrais artistes, rarement des créateurs.
Cette finesse d’esprit, cette subtilité les rend un peu féminins. Ils possèdent toutes les roueries, toutes les perfidies et les lâchetés de la femme. Je ne les crois donc pas braves. Ils sont braves si la passion les aveugle, si la colère les pousse hors d’eux-mêmes, ou bien quand on les regarde. Pas à froid. Mais que leur façon de se battre est étrange !… J’ai vu une fois deux jeunes gens s’empoigner dans la rue. L’un accompagnait une femme ; l’autre, en passant, avait regardé la femme d’une façon qui n’avait pas plu au premier. Celui-ci interpella l’insolent. Ils se parlaient en souriant, très doucement, et je ne pensais pas du tout qu’ils en viendraient aux mains. Tout à coup ils se jetèrent l’un sur l’autre, mais ils ne se battaient pas comme des gens de chez nous, avec les poings, ils se battaient comme des femmes ou des chats, avec les ongles, ils cherchaient à se griffer la figure : des gestes tordus, félins… On les sépara, ils avaient tous les deux le visage en sang.
Les Napolitains s’efforcent toujours de se défigurer. Leur grande vengeance, c’est le sfregio. Une balafre avec un rasoir. C’est une blessure qui n’est pas dangereuse, mais dont la cicatrice est à jamais visible.
Ils cherchent à se défigurer, à s’enlaidir, parce qu’ils savent bien que leur plus grand désespoir, c’est de ne pouvoir plus faire l’amour. Or, à Naples, un homme qui n’est pas beau, ne compte pas. Comme dans tous les pays du Midi, on y est directement sensible à la forme, à la grâce, à la beauté physique. Et l’on sait aimer. L’amour est la grande affaire. Il ne s’agit pas de la bagatelle, d’aventures faciles et plaisantes, de grivoiseries et de plaisirs licencieux. Non, ici, sur cette terre chaude, au bord de la mer des Sirènes, c’est la voix ardente de la passion qui parle. Ces belles créatures d’instinct n’aiment pas mollement, elles adorent. L’être qui leur plaît, les passionne, les affole, elles le veulent posséder tout entier, elles l’absorbent, elles l’aspirent, elles s’en grisent. Pas un de ses gestes, une de ses paroles qui ne les pénètre jusqu’au fond d’elles-mêmes. Ce sont de merveilleuses lionnes d’amour.
Aussi, dans cette atmosphère de volupté, tout le monde sait-il parler le langage de l’amour. Et s’il est absurde d’imaginer, en n’importe quel autre pays, une femme de haute race prenant son amant dans le peuple, cela, dans cette ville, se comprendrait bien. Un marchand de fleurs ou un jeune chevrier saura dire tout de suite les mots les plus tendres avec l’accent le plus enflammé, il raffinera en sentiments comme une petite maîtresse, il a le don. D’ailleurs, ici, comme chez tous les peuples du Midi, on a beaucoup de réserve. Je l’ai déjà dit : jamais dans la rue, dans un jardin, dans un endroit public, vous ne verrez deux amants s’embrasser ; jamais une attitude équivoque. Les yeux seuls se caressent. Mais ils se caressent bien. Regard d’homme n’aura nulle part ailleurs cette expression d’admiration extasiée, éblouie, pour la beauté de la femme, ni regard de femme cette docilité enivrée d’amoureuse. Et nulle part ailleurs le bonheur d’être beau ne s’exprimera de cette façon émouvante.
Il est curieux, à Naples, de lire à la dernière page des journaux, la petite correspondance. Les amants s’expriment là, en phrases exaltées, leur passion. Ils se désirent follement, ils se baisent divinement. Ils sont séparés, quel désespoir ! Ils sont jaloux, quelle atroce souffrance ! Ils se reverront, quelle affolante joie ! Ils se font de cruels reproches, ils se font d’enivrantes promesses…
Et tout cela est délicieux.
Et cette race passionnée, violente et rêveuse, crédule et enfantine, riche d’émotions, bavarde, brillante et vaine, naturelle et menteuse, et généreuse, compose, pour celui qui la regarde, le plus varié et le plus attachant des spectacles.
Lorsque je fus, pour la première fois, à Naples, il y a cinq ans passés, je m’installai aux rampes Brancaccio, d’où je jouissais d’une très belle vue sur le golfe. Le matin, de bonne heure, j’entendais s’élever de la chaussée le tintinnabulement de mille petites sonnettes : c’était les troupeaux des chèvres qui descendaient vers la ville. Elles avançaient capricieusement, surveillées par un chien attentif, suivies par un jeune homme en chapeau mou, qui brandissait une longue canne. Plus tard, si l’on se promenait à travers Naples, on les rencontrait çà et là, couchées sur la chaussée, tandis qu’une ménagère, descendant son petit panier par la fenêtre, attendait là-haut, penchée, que le chevrier eût rempli de lait le verre qu’elle lui avait envoyé à travers les airs. On rencontrait encore, dans les ruelles, des vaches, marchant gravement, suivies de leur veau.
Il y a de cela cinq ans. Aujourd’hui, plus de chèvres ni de vaches. On s’applique à rendre Naples propre et moderne. Et, chaque jour, un peu de son antique pittoresque disparaît. Un terrible assesseur est venu, le comte Piscicelli, qui, soutenu par la bourgeoisie napolitaine, fait la guerre à tout ce qui était joli, mais sale. En parcourant la ville, l’année dernière, je ne la reconnaissais plus : du côté de la Marine, aux alentours de la Pêcherie, en cinq ans, elle a été transformée. Il y avait jadis, sur le quai, une maison ornée de loggias, qui était célèbre, qu’on avait peinte et photographiée sur toutes les coutures : abattue. Il y avait maint vico amusant, gluant et charmant, où j’errais autrefois avec délices : supprimé. A la place, des maisons neuves, laides et sans caractère. Et à quoi rime cette destruction organisée, impitoyable ? C’est la plus grande folie. Car il ne faut pas rêver. Ces maisons-là ont l’aspect du neuf aujourd’hui ; mais avant très peu, dans un délai incroyablement court, elles ne seront ni moins sales, ni moins délabrées que les précédentes : avec le Napolitain, en effet, le neuf ne dure pas. Et l’on n’aura rien changé, rien qu’une chose : le pittoresque ; les premières maisons en avaient, celles-ci n’en ont plus.
Depuis vingt-cinq ans, un vent de démolition a soufflé sur Naples. D’abord on a fait aboutir le grandiose projet du Sventramento, de l’éventrement. Il s’agissait de supprimer les quartiers populeux situés entre la place du Municipe et le chemin de fer. Éventrer Naples, pour lui donner de l’air et de la santé. Notez ce que cela comporte de chimérique, puisque les habitants des anciens quartiers, qu’on réputait peu salubres, ont émigré vers d’autres quartiers qui ne sont pas moins malsains. Mais ce qu’on désirait surtout, au fond, c’était que l’étranger, qui arrive par le chemin de fer, eût l’impression d’entrer dans une grande cité. On voulait lui dissimuler que Naples n’est en réalité qu’un immense village. Comme si l’étranger venait à Naples pour y retrouver Londres ou Paris !… En tout cas, le projet a été réalisé, et maintenant la gare est située sur une grande place, et l’étranger, qui descend du train, gagne son hôtel par une voie très large et toute droite, le Rettifilo, qui lui donne tout de suite l’impression que Naples est moins intéressante qu’il ne l’avait supposé.
Le Sventramento n’est pas achevé, il continue tous les jours. Même les terribles démolisseurs ne bornent pas leurs efforts à ce malheureux quartier de la Marine. Le Castel Nuovo ne ressemble plus à ce qu’il était lors de mes premiers séjours, et, de Santa-Lucia, il ne restera bientôt plus rien : on a comblé le petit port de pêcheurs qu’on y voyait jadis, et l’on a construit à la place, dans le plus pur style de New-York, des hôtels cosmopolites. En vérité, il faut vous hâter d’aller à Naples si vous voulez y découvrir encore quelques vestiges de ce que fut cette cité unique. Ah ! je sais bien que les quartiers populeux ne manquent pas, et que les vicoli, remplis de détails savoureux, sont encore innombrables, mais de jour en jour ils deviennent plus difficiles à trouver : il faut connaître la ville afin d’y parvenir. Évidemment, des siècles seraient utiles pour arriver à faire de Naples une cité tout à fait moderne, cependant du train et avec le cœur dont on y va…
Il s’était produit ceci de singulier. Les Napolitains, lesquels sont fiers de Naples et l’adorent, en rougissaient devant les étrangers. Ils ne pouvaient plus supporter d’entendre répéter, sur tous les tons, par les Italiens du Nord, que Naples est sale. Ils étaient blessés de la mauvaise réputation de la ville et des griefs qu’on formulait contre sa population. Quand on leur disait que cela était mieux ainsi, qu’on préférait Naples telle qu’elle était, ils croyaient qu’on se moquait, ils vous regardaient avec méfiance, pensant que vous parliez de cette façon devant eux, mais que vous colporteriez sans faute dans tout l’univers que leur ville est inhabitable. Alors ils tombaient à bras raccourcis sur le peuple, ils l’accusaient de tous les méfaits et de tous les vices, et, finalement, ils en arrivaient à déclarer qu’ils n’étaient pas, quant à eux, d’origine napolitaine : comme un grand passage de races s’est produit à Naples, tous, ils descendaient ou des Espagnols, ou des Arabes, ou des Français.
Il fallait lire alors, dans les journaux, les plaintes des malheureux bourgeois exaspérés. Chaque jour, ils découvraient quelque nouvelle horreur. Une fois par semaine, les plus importantes feuilles de la cité parthénopéenne les recueillaient. J’en cite quelques-unes :
« Le vico des Florentines à Chiaia est dans un état à faire pitié ! Le matin seulement un balayeur daigne y donner un coup de balai et le reste de la journée il s’y accumule immondices sur immondices. »
« Derrière l’église de Saint-François, à la Torretta, il y a des montagnes d’ordures qui augmentent de temps en temps. On peut même y trouver parfois quelque charogne qui pourrit. »
« Les chevriers et les vaches abusent de la via Mancinelli. De sept heures du matin à huit heures et demie, et le soir de cinq heures à sept heures et demie, c’est un spectacle dégoûtant. Ils s’arrêtent là et s’endorment sans nul souci des habitants. Quelle quantité d’excréments ! Quelles exhalaisons pestilentielles ! Quels torrents d’urine ! »
Mais voici le bouquet :
« Dans la via Salute, gît étendu sur un misérable matelas, un jeune homme tuberculeux, qui a été mis à la porte de son basso par le propriétaire et qui attend la fin de ses souffrances sur le trottoir. Le reste de son misérable mobilier est placé à côté de lui, près d’une latrine, en face du mur de la prison. »
Devant ce déluge de plaintes, un journal concluait en ces termes : « Que faire ? Tant que Naples sera une cité peuplée d’une plèbe qui est privée du sens de la propreté et de celui de la mesure, elle sera infestée de vaches, de chèvres et de mégères vociférantes, de pianos ambulants, de gens qui hurlent, de cochers qui assaillent les passants, de mendiants, de charrettes encombrant les ruelles, de montagnes d’ordures, de boue, de poussière et d’immondices s’éparpillant à tous les vents.
« Nous avons, par tous les moyens, engagé le conseil municipal à prendre des mesures. Nous continuerons à élever la voix. Mais rien d’efficace ne pourra s’accomplir tant que la population ne s’habituera pas à être propre, discrète, sobre de gestes et de paroles, respectueuse du droit d’autrui, respectueuse des voisins, respectueuse des vivants, respectueuse des morts, qu’elle outrage de la manière la plus bruyante, soucieuse de la santé publique contre laquelle elle commet à chaque instant, sous toutes les formes les plus laides, des attentats petits et grands. Il faut, en un mot, que nous portions nos efforts à former l’âme urbaine de ce peuple. »
Voilà donc où en étaient les lamentations des Napolitains, quand l’assesseur Piscicelli a décidé d’améliorer tout cela. Il a, nous l’avons dit, interdit les chèvres et les vaches. Mais il était question, l’année dernière, d’établir un règlement plus funeste encore que tous les autres pour le pittoresque de Naples.
Il s’agissait de créer des marchés afin d’interdire la vente dans les ruelles des fruits et des légumes. Adieu donc les piments et les poivrons aux couleurs éclatantes, qui éclairaient toute une rue, les tas de pastèques rondes, et les tomates, les pommes d’or, richesse et faste du Midi !
Et Naples, qui était une ville où l’on n’était pas enfermé ! On ne s’y sentait point séparé des champs, selon le système moderne si pénible et, en quelque sorte, féroce. C’était une ville antique, traversée par la campagne, mêlée à la campagne… Fini, tout cela !
Mais il ne s’agit pas seulement de rendre Naples propre, saine, claire et aussi belle que Chicago. On veut à présent qu’elle soit riche. La fièvre industrielle et commerçante, qui agite aujourd’hui l’Italie, a gagné la douce cité du farniente et de l’amour. Que d’avocats, que de docteurs pérorent maintenant là-dessus dans les cafés ! Et chacun préconise son projet, qui doit amener le Pactole à Naples et remplir de dollars les poches vides de ses compatriotes. Les uns sont partisans de l’industrialisation de la cité des sirènes, ils ne rêvent qu’usines, hauts fourneaux, chaudières, courroies de transmission, cheminées noires… Leur idéal serait de voir le golfe couvert d’une épaisse fumée, qui effacerait celle du Vésuve, et d’y entendre, au lieu du chant des mandolines, le sifflet des fabriques. Ceux-là sont peut-être, d’ailleurs, les moins dangereux.
Les autres rêvent d’une Naples hivernale, qui serait le Nice ou le Caire de l’Italie du Sud. On édifierait un Palais de la Jetée, un Casino, et tous les étrangers viendraient se réjouir au pied du Pausilippe. C’est à cette conception grandiose que se rattache la construction des caravansérails, des énormes hôtels cosmopolites de Santa-Lucia. Veuillez remarquer qu’on compte déjà tout un vaste quartier, le rione Amedeo, habité par les étrangers, et il en vient chaque année des dizaines de mille. Mais ce n’est pas assez : on veut faire de Naples une vraie station hivernale. Ah ! ce sera délicieux !…
En vérité, je vous le dis, hâtez-vous d’aller à Naples, si vous voulez avoir encore une idée de ce que fut cette ville unique.
La première fois que je revins de Naples, après un long séjour, — j’avais passé là-bas six mois consécutifs, — je fus très frappé, en arrivant à Marseille, par la grossièreté, par la sensualité vulgaire de cette ville. L’impression fâcheuse que j’éprouvais, je ne voulais pas admettre que ce fût la France qui me la donnât, et je la rejetais tout entière sur Marseille, cité puissante, mais élémentaire. Or, au printemps suivant, lorsque, venant de Paris, je repassai par Marseille, sa grossièreté ne me toucha plus si vivement : Paris était donc semblable à Marseille, Paris m’avait rehabitué à la vulgarité, et, à côté d’un Italien, d’un Napolitain, un Français était donc un brutal ?
Depuis, chaque fois que je suis revenu de Naples, j’ai, hélas ! éprouvé le même sentiment. Marseille, d’abord, que jadis j’aimais tant, me blessait de vingt façons. J’avais quitté une ville noble pour débarquer dans une ville plébéienne : ainsi me semblait-il. La Cannebière, ses odeurs d’alcool, ses cafés bondés, tous ces gens buvant : à Naples, une glace et un verre d’eau. L’atroce bruit du violon qui sortait des cafés : à Naples, dans les pires mélodies, de la musique. On sentait ici une atmosphère de grosse jouissance. Des filles passaient, multicolores, que les hommes regardaient d’un œil brillant. A Naples, on se retourne sur les femmes, mais c’est avec admiration. Tous ces gens, ces trafiquants et ce peuple, on les devinait animés de préoccupations basses. Les hommes voulaient de l’argent pour manger, boire, avoir la femelle ; les femmes pour ne rien faire, s’habiller avec éclat et vexer la voisine. Le Marseillais est riche, il jouit brutalement de la vie ; le Napolitain est pauvre et jouit de la vie finement.
Et ainsi, constamment, je comparais avec regret la ville que j’avais quittée à celle où je venais d’arriver. Les visages, les corps, l’aspect physique, les vêtements, tout ici était grossier. Des gros nez, des grosses bouches. Là-bas, les visages étaient fins et pâles, les corps minces, nerveux. On était élégant, là-bas, et raffiné, coquet : quelles jolies chaussettes blanches, quels pantalons blancs immaculés, quels vestons d’une coupe parfaite ! Cela ici ne comptait pas, nul ne se mirait pour voir s’il était bien vêtu ou mal mis, agréable ou point à regarder. On vivait pour les autres, là-bas, pour la société : ici, chacun pour soi. Là-bas, c’était un peu un salon, ici seulement un entrepôt.
Et ces différences, je les retrouvais partout, jusque dans les derniers détails. Au restaurant. A Naples, la cuisine était délicate : grossière ici. Finesse d’esprit là-bas, finesse de goût : ici, aucune finesse. Ah ! les gens de là-bas avaient de la race !…
Or, je n’avais pas lu de journaux français depuis des mois. Les deux premières feuilles que j’ouvris m’écœurèrent. Tout ce bluff, ce désordre, le grossissement absurde donné au premier fait insignifiant venu, pourvu qu’il soit de nature à intéresser la plus médiocre partie du public, et les vraies nouvelles d’importance mal présentées ou bien reléguées derrière tel ou tel scandale placé en tape-à-l’œil, ce luxe de détails touchant un viol au Bois de Boulogne, avec le portrait du « satyre » et l’« interview » du concierge de la victime, tandis qu’en une dépêche de trois lignes tel grand fait international se résume… Non, les journaux italiens n’étaient pas ainsi, aucun n’offrait ce caractère ! Peut-être pas aussi « modernes », peut-être ne possédant pas autant de « fils » et peut-être pas aussi « rapidement informés », ou bien pas aussi « littéraires », mais eux ils n’étaient point vils, ils ne semblaient pas s’adresser toujours à la plus ignorante catégorie des lecteurs, ils suivaient — par exemple — ce qui se passait à l’étranger avec intelligence, non pas à coup de télégrammes sensationnels, mais dans des articles écrits avec une compétence véritable. Ma foi, je ne m’imaginais pas la presse de mon pays telle que je la voyais là, j’avais oublié qu’elle était ainsi. Je n’eusse supposé de pareilles feuilles qu’en Amérique.
On me passa les illustrés et je regardai les petits journaux pour rire. Il était question, uniquement, des filles. Toutes les légendes roulaient sur l’amour, mais sur un amour totalement dépouillé de sentimentalité. Ce n’était pas grivois, pas salé, non : des lourdes plaisanteries de matelots ou d’hommes à argent, — ainsi que disait Beyle. Ah ! on n’y allait pas par quatre chemins pour exprimer la chose !… Et l’on sentait bien que ce n’était point paresse des dessinateurs, c’était la consigne : le journal voulait cela. Il savait que plus on était direct, plus le lecteur était content. Je ne revenais pas d’Italie plus vertueux que j’y étais parti ; mais cet étalage d’obscénités me fut désagréable. Là-bas, ce n’était pas sur ce ton-là qu’on s’occupait des choses de l’amour. Et j’avais oublié que les gens de chez nous en parlaient et y pensaient comme des charretiers ou des banquiers.
Mais ce fait d’avoir aussi mal accueilli les journaux de France, les revoyant après six mois, m’était pénible. Car enfin ce n’était pas Marseille qu’ils représentaient, ces journaux-là : ils valaient comme une indication très forte sur l’esprit public en France.
Là-dessus, le soir, j’entrai, ne sachant que faire, au Palais de Cristal. Au cours de la représentation, paraissait le chanteur Mayol. Je ne l’avais jamais vu. Il eut un succès énorme. Ses sous-entendus, à lui, étaient d’un ordre spécial. Il était tout entier lui-même, d’ailleurs, un sous-entendu d’un ordre spécial. Et son succès paraissait venir en partie de là. On aimait son talent, car il a du talent, mais son talent était accueilli avec plus de sympathie, parce qu’il éveillait dans l’esprit du public une certaine curiosité. Cependant, cette curiosité-là, elle n’était point particulière à Marseille : le succès de Mayol avait été fait par Paris, — et quel succès ! — Ainsi, voilà ce qui préoccupait, attirait, touchait maintenant les gens de chez nous…
Je rentrai me coucher, mélancolique. Plus le temps passe, à l’étranger, plus la figure de la patrie embellit. Elle prend peu à peu un caractère idéal. On a beau aimer le pays où l’on est, tout de même, on y respire en étranger : il y a contrainte ; le seul fait de ne pas parler sa propre langue est une dure contrainte. Au bout de six mois de Naples, les mots France et Français m’émouvaient particulièrement. Je ne voyais des nôtres que les seules qualités, et aux plus belles époques ; ils étaient devenus, dans mon esprit, parfaits. Eh bien ! c’était cela, maintenant, les Français !… Il allait falloir vivre avec ces gens-là !… Si je n’eusse pas su que, tout de même, aussi naturalisé que l’on soit, jamais on ne parvient, dans un pays étranger, à se sentir dans son pays, je me serais fait Italien.
En tout cas j’eusse voulu être né Italien.
Et je savais bien, d’ailleurs, tout ce qu’on pouvait reprocher aux Napolitains, je savais bien qu’ils étaient futiles, que toute leur finesse tourne en subtilité, qu’ils tombent toujours dans l’excès ; que s’ils sont élégants, ils le sont trop, et lorsqu’ils ont de la grâce, ils sont trop gracieux. Je savais bien qu’ils manquaient de force et qu’à tant de finesse un contrepoids faisait défaut. Ils manquaient de force, de cette force dont Marseille, elle, débordait, alors qu’elle eût eu besoin, par contre, d’un peu de cette finesse en excès là-bas.
Je savais que si, ici, il n’y avait pas de goût et s’il y en avait beaucoup là-bas, là-bas, tout de même, cela ne s’achevait pas en art : on aimait l’enjolivé, le paré, un marchand décorait d’une rose son panier, un cocher mettait un ruban à la crinière de son cheval (et pas pour les clients, pour lui-même), mais que l’esprit tendît à l’art, aimât l’art, il était trop léger, pourtant, trop menu, trop grimacier pour aboutir à lui. Il ne pouvait se fixer, il ne pouvait se concentrer, méditer. Bavard, et son bavardage l’éloigne de la réflexion, son bavardage le distrait. Ils ont parlé, ils ont raconté, après c’est fini, tout a passé en paroles. Là-bas, tout était trop fragile, les roues des voitures trop minces, et le verre des bouteilles… Seulement, voilà, l’atmosphère était agréable : tout le monde avait le sentiment artiste ; peut-être aussi, d’ailleurs, est-ce pour cela qu’il n’y avait pas d’artistes ?… Chez nous, personne n’est artiste : mais en revanche il y a des artistes… Combien de fois donc a-t-on répété que le Français est artiste ! Cela n’est pas vrai : le Français ne nourrit point du tout cette âme artiste que l’Italien possède si véritablement ; il ne sent pas la beauté. Allez à Poggioreale, le cimetière de Naples ; sur plus d’une tombe vous lirez : Il aima le beau, il aima l’art. Ah ! cela, chez nous, importe bien peu à nos héritiers que nous ayons aimé le beau et l’art !… Le Français n’a pas l’instinct de l’art. Dans une œuvre d’art, il cherche l’anecdote, le sujet, le trait. L’Italien va de suite au sentiment. Le Français n’est pas poète : il ne peut guère s’élever au-dessus de Béranger, de Coppée ou de Rostand… C’est qu’il est le peuple qui a le plus corrigé l’instinct ; il s’est tourné vers l’intelligence. Ce qu’il préfère donc, c’est le théâtre et l’anecdote, la représentation terre à terre ou comique de l’existence : son esprit net et sans poésie l’y porte. Les arts, en France, se sont toujours développés contre le public. La foule a toujours soutenu ce qu’il y avait de pire. Seulement, chez nous, si personne n’est artiste, il y a des artistes.
Je faisais toutes ces réflexions, étant repassé d’Italie en France. J’exagérais sans doute. Nous nourrissons beaucoup d’amour-propre pour notre pays. Nous le voudrions voir le plus beau de tous et le plus parfait. Et chaque fois que nous nous en revenons de l’étranger, nous sommes furieux et déçus, parce que nous avons rencontré au dehors certaines choses qui nous paraissent supérieures à ce que nous retrouvons chez nous. Or, nous voudrions que tout ce qu’il y a chez nous fût supérieur à tout ce qu’il y a chez les autres. Aussi exagérant inconsciemment notre déception, nous grossissons encore les sujets que nous avons d’être déçus. Cependant, aujourd’hui, des marques trop nettes, trop évidentes, s’étalent pour qu’on ferme les yeux : la France devient grossière, elle va vers la vulgarité, et les Français ne répondent plus guère à l’image idéale que nous nous faisons d’eux. Au retour d’Italie, ce qui frappe surtout, je le répète, c’est leur manque de penchant pour s’intéresser aux choses du sentiment et à l’art, en général, à ce qui est élevé ou délicat. Mais peut-être est-ce là un mouvement universel. Possible que le monde entier se dirige vers la platitude ? Il existerait alors pour chaque pays des causes particulières. L’une d’elles, pour le nôtre, serait probablement l’extraordinaire invasion des villes par la campagne. Chacun, d’ailleurs, peut trouver cent autres raisons. Et ce n’est pas mon projet de les chercher. Ni de tirer nulle conclusion. J’ai pensé seulement qu’il pouvait être intéressant de dire avec précision et sans détour l’impression ressentie par un Français rentrant chez lui après six mois de vie au dehors.
1909-1910.
Pages | |
| Le Départ de Naples | |
| Voyage à Reggio de Calabre et à Messine | |
| Palerme | |
| A Capri | |
| Tanger | |
| Gibraltar | |
| En Andalousie : | |
| Ronda, Malaga, Grenade | |
| Cordoue, Séville, Cadix | |
| Naples la Belle et les Napolitains : | |
| Antiquité de Naples | |
| Curiosités dans les rues | |
| Le caractère napolitain | |
| Naples nouvelle | |
| Le Retour en France |
PARIS — IMPRIMERIE MICHELS FILS
6, 8 et 10, Rue d’Alexandrie.
ARTHÈME FAYARD, Éditeur
Rue du St-Gothard, 18-20, PARIS (XIVe)
Collection à 3f.50 le volume
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
MYRIAM HARRY
TUNIS LA BLANCHE
MAURICE DUPLAY
CE QUI TUA FARGET
HENRI DUVERNOIS
LA BONNE INFORTUNE
CAMILLE MARBO
L’HEURE DU DIABLE
Paris. — Imp. Michels Fils.