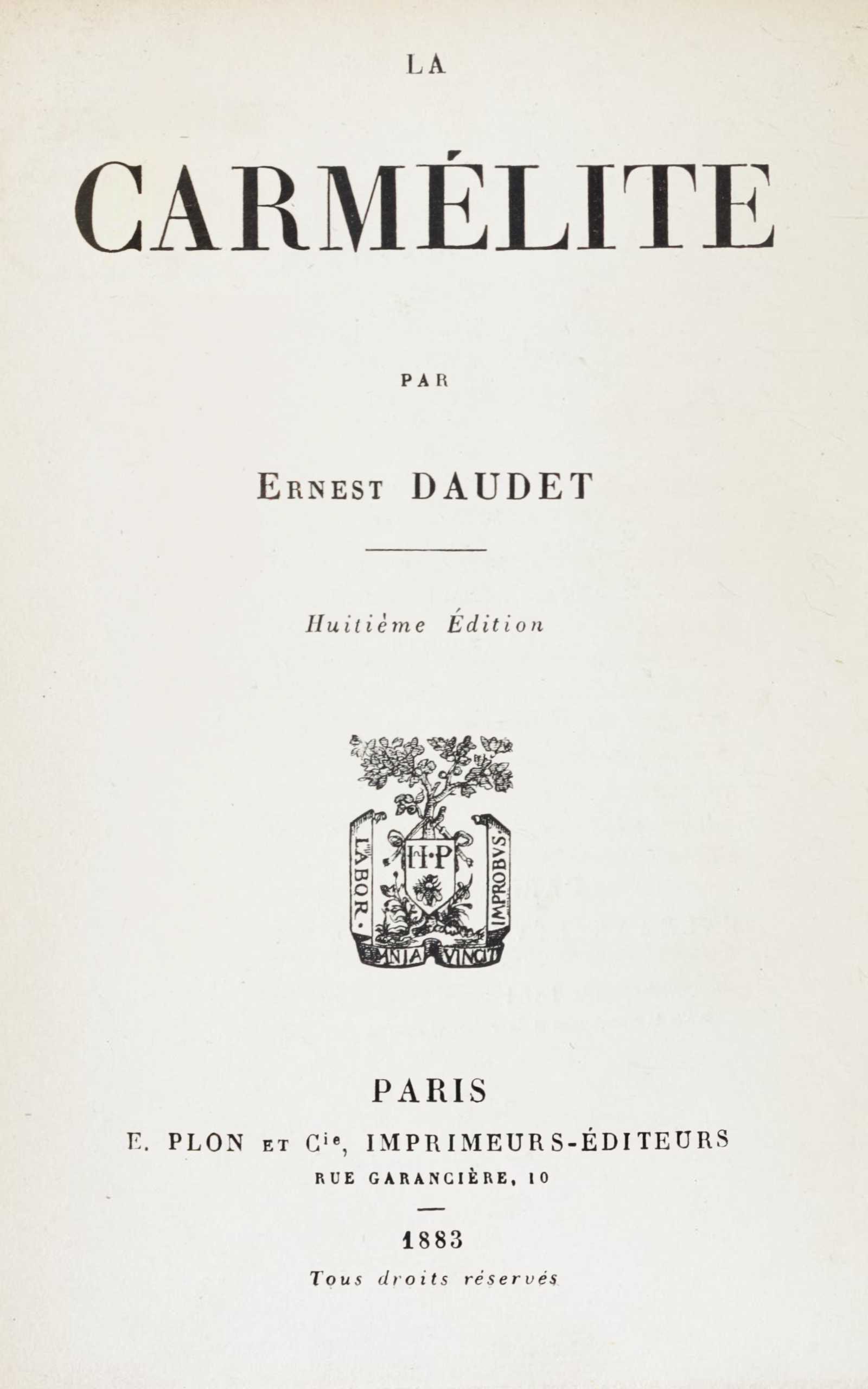
Title: La Carmélite
Author: Ernest Daudet
Release date: November 19, 2025 [eBook #77272]
Language: French
Original publication: Paris: Plon, 1883
Credits: Laurent Vogel (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))
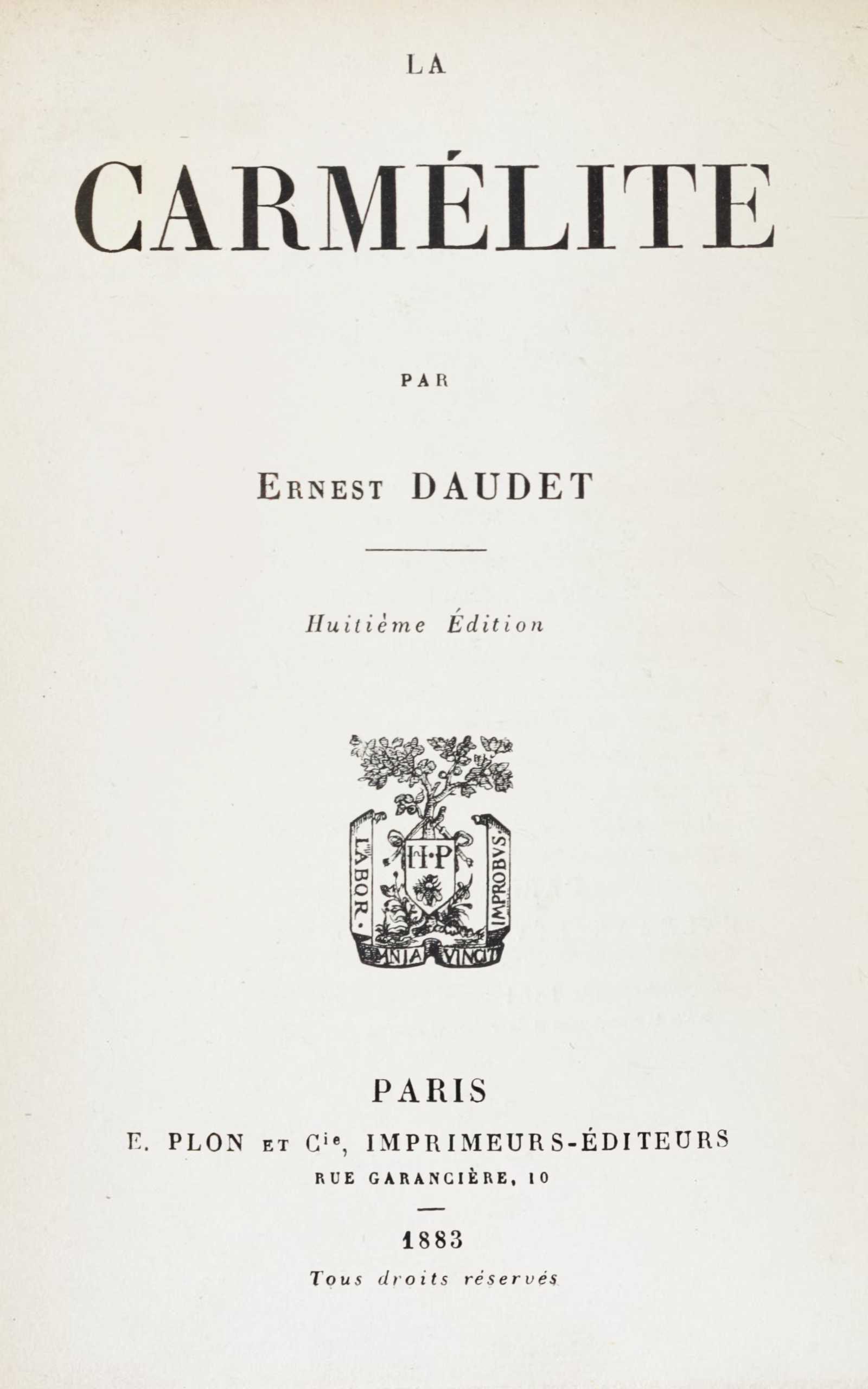
PAR
Ernest DAUDET
Huitième Édition
PARIS
E. PLON et Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS
RUE GARANCIÈRE, 10
1883
Tous droits réservés
Cet ouvrage a été déposé au ministère de l’intérieur (section de la librairie) en mars 1883.
A LA MÊME LIBRAIRIE, DU MÊME AUTEUR :
| Les Persécutées | 1 vol. |
| Daniel de Kerfons | 2 — |
| La Marquise de Sardes (4e édition) | 1 — |
| Clarisse (4e édition) | 1 — |
| Madame Robernier (4e édition) | 1 — |
| La Maison de Graville (7e édition) | 1 — |
| Le Mari (10e édition) | 1 — |
| Mon frère et moi (Souvenirs d’enfance et de jeunesse) 6e édit. | 1 — |
| Défroqué (12e édition) | 1 — |
| Pervertis (10e édition) | 1 — |
Reproduction interdite, tous droits réservés. — Ent. Sta. Hall. S’adresser pour la traduction à l’Agence Th. Michaelis, 45 et 47, rue de Maubeuge, Paris.
PARIS. TYPOGRAPHIE DE E. PLON ET Cie, RUE GARANCIÈRE, 8.
LA CARMÉLITE
Le couvent des Carmélites est construit aux portes de Beaucaire, sur un rocher qui baigne dans le Rhône. C’était autrefois une commanderie de Templiers. Son ancienneté se devine à la physionomie architecturale des bâtiments restaurés, flanqués de deux tours massives, à l’épaisseur des murailles, à la hauteur des voûtes, à la coupe ogivale des fenêtres.
Le parloir dans lequel la sœur tourière venait de faire entrer Nicolette, était une vaste pièce éclairée par deux croisées s’ouvrant sur le fleuve, et divisée dans sa largeur par une haute grille en fer, revêtue, sur toute sa surface, de pointes menaçantes. De l’autre côté de cette grille, un long voile noir tendu dérobait les religieuses à la curiosité des visiteurs. Les murs blanchis à la chaux n’avaient d’autre ornement qu’un crucifix, une statuette de saint Joseph en bois peint, et imprimées en grosses lettres noires sur des tableaux en carton, des maximes empruntées à sainte Thérèse : « Tout passe. — Qui possède Dieu ne manque de rien. — Que rien ne te trouble. — Dieu est toujours le même. — Dieu seul suffit. » Le mobilier se composait de douze chaises et d’une table en sapin. Sur la table, un tapis brun ; devant chaque chaise, une étroite natte de paille jetée sur la nudité des larges dalles.
Depuis trois années que Nicolette habitait Beaucaire, il ne se passait guère de jour qu’elle ne visitât le couvent du Carmel, tantôt pour prier dans la chapelle, tantôt pour s’entretenir avec la prieure, dont les conseils éclairaient et fortifiaient son âme indécise, en proie aux luttes qui, dans toute conscience chrétienne, précèdent l’épanouissement d’une vocation religieuse. On la connaissait dans la maison ; elle y était traitée en amie qu’on veut attirer, qu’on savait devoir s’y fixer, tôt ou tard, et ce fut avec un empressement familier que la tourière revint au bout de quelques instants lui annoncer que la Mère supérieure allait se rendre à son appel.
Restée seule dans le parloir, Nicolette s’approcha d’une fenêtre, appuya son front contre la vitre tiède encore de la chaleur du jour, et se tint là, toute rêveuse, le regard captivé par l’immensité du paysage qui se déroulait sous ses yeux.
Aux pieds du roc taillé à pic, verdâtre à sa base, et à sa cime doré par le soleil couchant, coulait le Rhône avec ses vagues tumultueuses, ses tourbillons redoutables, son écume blanchâtre, et les reflets dont la lumière méridionale, ardente et crue, rayait ses eaux rapides, entraînées ainsi qu’un torrent débordé. Sur la largeur de son lit, parallèlement au viaduc du chemin de fer, dont les arches brunies encadraient des coins d’horizon tremblant, où se confondaient dans une brume argentée le bleu du ciel et le vert du flot, un pont suspendu se balançait à l’extrémité de câbles en fer, fixés aux piles massives, plantées en plein courant. De l’autre côté du fleuve, le château de Tarascon dressait ses vieilles murailles et ses créneaux, qui allongeaient leur ombre sur le quai descendant vers la grande place de la ville. Le long des rives aux berges escarpées, se déroulait un double rideau de cyprès et de saules, au delà duquel les toitures rouges, les façades grises, les volets verts parsemaient de taches toutes vibrantes sous le soleil, les verdures roussies et poussiéreuses. Sur la droite, à l’entrée de la plaine de Beaucaire, le canal du Midi traçait un sillon lumineux, droit et régulier, qui allait se perdre au loin entre des champs couverts d’oliviers rabougris et difformes, étalant leur feuillage sombre sur le sol desséché. Puis, à travers les vastes étendues bornées au loin par la chaîne des Alpilles, c’étaient des routes toutes blanches, se croisant et s’enchevêtrant, fuyant entre les blés jaunis et les vignes aux longs rameaux rampants. Le jour éclatant s’apaisait, remontait le long des collines aux flancs roses, au sommet desquelles commençait à se lever une brise fraîche dans l’ombre dont les enveloppait peu à peu le soleil déclinant.
— Qu’il serait doux de vivre ici, toujours, en présence de Dieu et de son œuvre ! soupira Nicolette. Je l’aimerai avec plus de passion, je le prierai avec plus de ferveur s’il daigne m’ouvrir cette sainte maison.
Comme si ce cri de son âme eût été écouté, un bruit se fit de l’autre côté de la grille, et une voix de femme dit avec douceur :
— Loué soit Notre-Seigneur Jésus-Christ.
— A jamais, se hâta de répondre Nicolette en venant s’asseoir contre la grille, afin de se rapprocher de la prieure qu’elle entendait, mais ne pouvait voir, la règle des Carmélites leur interdisant de se montrer à des étrangers, autrement que voilées.
— Est-ce vous, mademoiselle Suarez ? reprit la voix.
— Je vous attendais, ma mère !
— Vous désirez me parler, ma chère fille ?
— Toujours au sujet des résolutions que je dois prendre, oui, ma mère.
— Je vous écoute.
— Vous savez, ma mère, reprit Nicolette, que depuis trois ans, je suis décidée à embrasser la vie religieuse ; que ce désir, longtemps combattu par ma famille, est devenu plus puissant et plus irrésistible après la mort de mon père. J’avais perdu ma mère étant encore au berceau. Le nouveau malheur qui m’a frappée m’a faite orpheline. Je n’ai plus d’autre parent que ma sœur ; elle est mariée et heureuse. Je ne manquerai donc à personne en me donnant à Dieu, et je suis libre, alors qu’il m’appelle, d’aller à lui. Vous avez reçu sur ce point mes confidences.
— Et j’en ai gardé le souvenir, car elles m’ont vivement impressionnée. J’ai cru y voir un symptôme de votre vocation, surtout quand vous m’avez révélé qu’à l’âge de seize ans, vous aviez spontanément fait vœu de chasteté perpétuelle, et que ce vœu, vous ne l’avez jamais regretté.
— Jamais, ma mère, pas plus que je n’ai douté de ma vocation. Le doute qui s’était élevé dans mon âme tenait, vous ne l’ignorez pas, à une autre cause. Le divin Sauveur me voulait, j’en étais sûre, sa volonté s’étant manifestée à moi par des signes certains. Mais sous quelle forme désirait-il que j’entrasse à son service ? Devais-je me consacrer aux malades et aux pauvres ? Devais-je frapper à la porte d’un cloître tel que celui-ci ? J’ai longtemps hésité, suppliant le ciel de me désigner clairement l’ordre que je devais choisir. Enfin, sur le conseil de mon directeur, l’abbé Cardenne, j’ai fait une retraite, au terme de laquelle une confession générale lui a permis de discerner dans mon âme le témoignage décisif de la volonté du Seigneur. Je viens donc vous annoncer que cette volonté s’est trouvée d’accord avec mon secret désir.
— Votre choix est fait ? s’écria vivement la prieure.
— Oui, ma mère, et dans quelques semaines, je vous prierai de m’ouvrir les portes du Carmel. J’aurai alors atteint l’âge de ma majorité ; le consentement de mon tuteur ne me sera plus nécessaire ; je serai libre.
— Les portes du Carmel s’ouvriront devant vous, ma chère fille, si vous persistez dans votre dessein. Jusque-là, continuez à prier, afin que le Seigneur vous éclaire !
— Oh ! ma mère, répondit Nicolette, depuis le jour de ma première communion, j’ai souhaité, passionnément souhaité de le servir, d’être à lui, de n’être qu’à lui, de lui offrir toute ma vie.
— Ce souhait pieux n’implique pas forcément une vocation religieuse. Vous pouvez servir Jésus en restant dans le monde ; là, aussi, il faut des exemples.
— Que d’autres les donnent ! A chacun sa tâche ! Moi, je sens bien que je ne saurais être heureuse que dans la paix du cloître !
— Notre règle est sévère, mon enfant, insista la prieure.
— Serait-elle plus sévère encore, je la trouverais douce ! Prier au pied de la croix, continua Nicolette d’un accent où se révélaient l’enthousiasme de son âme surnaturalisée et l’ardeur de sa foi, contempler Dieu, l’implorer pour ceux qui l’oublient, expier les péchés de ceux qui l’offensent, se mortifier, jeûner, se vêtir de bure, porter un cilice, cela n’est que volupté, ma mère, vous le savez bien. Est-il au monde une joie qui vaille la joie de s’immoler à Jésus-Christ ?
Et ses beaux yeux rayonnant d’une flamme étrange, Nicolette redressait sa fine tête brune, regardant, transfigurée, la voûte du parloir, comme si par delà cette voûte elle eût aperçu le Crucifié dans sa gloire, l’amant divin qui nous ravit nos filles, embrase d’amour leur cœur extasié, leur inspire les sacrifices héroïques et les pousse au martyre.
— Qu’il soit donc fait comme vous le voulez, mon enfant, reprit la supérieure, remuée jusqu’aux entrailles par le cri qu’elle venait d’entendre. Aussitôt que vous m’aurez fait savoir que vous êtes prête, je soumettrai votre demande à nos mères professes. Elles vous accueilleront avec bonheur, je le sais, et pendant la durée de votre noviciat, nous aurons le loisir de rechercher si véritablement notre Sauveur vous veut.
Le visage de Nicolette s’épanouit dans un sourire de contentement. Toute radieuse, elle se leva.
— Adieu donc, ma mère ! s’écria-t-elle ; à bientôt.
Elle sortit du parloir, traversa une petite cour, entra dans la chapelle, et s’agenouilla. Comme elle était heureuse ! Elle touchait enfin au but si longtemps poursuivi. Quelques jours encore, et, parée comme une fiancée, elle viendrait se prosterner sur les marches de l’autel, célébrer ses noces avec l’Époux qu’elle se donnait librement. Puis elle franchirait la grille mystérieuse qui s’étendait à gauche de cet autel ; elle prendrait place dans le chœur des religieuses ; elle aurait sa part de leurs prières et de leurs travaux ; elle se préparerait à prononcer les vœux éternels dont elle savait par cœur la formule, tant elle s’était accoutumée à la répéter, dans le silence de ses veilles consacrées à des méditations, véritable apprentissage de la vie monastique, dont son pieux enthousiasme ne lui laissait voir que les roses. Et dans un élan d’ardeur confiante et jeune, elle évoquait le tableau de son existence future, elle remerciait Dieu qui lui préparait tant de douces heures que ne connaîtront jamais ceux qui n’ont pas subi l’indescriptible folie de la croix. Toute brûlante était la prière qui montait de ses lèvres vers son divin Maître et vers l’immortelle et sainte Thérèse, la grande réformatrice du Carmel, brûlée aussi de toutes les flammes du céleste amour, et dont elle voulait imiter les exemples et pratiquer les vertus.
Tout à coup, de l’autre côté de la grille claustrale qui séparait le chœur des religieuses de la partie de la nef réservée aux fidèles, elle entendit un bruit de pas. La Communauté se réunissait pour l’office du soir. Bientôt une psalmodie lente et monotone s’éleva dans le silence de la chapelle assombrie par la chute du jour. Il semble que ces accents uniformes ne pouvaient émouvoir l’âme de Nicolette accoutumée à les écouter. Mais dans l’état d’esprit où elle se trouvait, il lui parut qu’ils arrivaient à ses oreilles pour la première fois. Toutes les joies du cloître, ces joies qu’elle brûlait de connaître, lui apparaissaient dans ce cantique triste et doux, chanté sur un ton de mélopée, sans harmonie et sans couleur.
Elle fut bouleversée. Des larmes roulèrent de ses yeux sur ses mains croisées, fiévreuses et tremblantes, tandis que son âme se répandait aux pieds de Dieu, en supplications passionnées. Elle resta ainsi, abîmée dans sa prière, et ne songea à partir que lorsque l’office eut pris fin.
Taillé à pic du côté du Rhône, comme un mur de forteresse, le rocher à la cime duquel s’élevait le couvent, s’abaisse par une pente douce du côté de la plaine. Le chemin circule à travers les garigues, en coupant un bois de chênes verts, bas et clair-semé, venu parmi les blocs calcaires. Le feuillage de quelques figuiers égaye seul cette végétation desséchée sur laquelle le mistral impétueux pousse d’en bas des flots de poussière. C’est ce chemin que prit Nicolette en sortant de la chapelle. Toute agitée encore par l’émotion qu’elle venait de ressentir, elle emportait avec soi l’ineffaçable impression de ces moments qui lui avaient montré son bonheur prochain.
Maintenant, la brusque fraîcheur de l’air annonçait la nuit. Le ciel se violaçait. Au bord des vapeurs pâlies, entraînées dans l’espace, s’éteignaient lentement l’or et la pourpre des derniers rayons du jour. Les astres, l’un après l’autre, perçaient l’azur blanchissant. Le Rhône devenait noir, sa rumeur plus plaintive et plus grave. Dans les rues de Beaucaire, des lampes s’allumaient aux fenêtres béantes des maisons assombries ; les réverbères, peu à peu, étoilaient l’ombre.
Autour de la maison, le long des treilles grimpantes, la nuit se faisait plus obscure. Sur le perron, Nicolette, en entrant dans le jardin, aperçut, appuyée à la balustrade en pierre, une fine et blanche silhouette de femme. Elle reconnut sa sœur.
— Me voilà, Irène ! lui cria-t-elle en traversant la pelouse pour la rejoindre plus vite.
— Je commençais à être inquiète, ma chérie, répondit Irène en la recevant dans ses bras tout essoufflée.
Nicolette l’embrassa :
— Le temps passe vite quand on prie. Puis elle ajouta : Ton mari est-il arrivé ?
— Non ; il m’a télégraphié de Marseille que son retour est remis à demain.
— Je respire ; c’est lui surtout que je craignais d’avoir fait attendre. Rentrons.
Nicolette entraîna sa sœur dans la maison. Le dîner était servi. Sous la flamme de la lampe, le couvert dressé, l’ameublement de la salle à manger, la toilette d’Irène révélaient la vie large et luxueuse, des habitudes de bien-être et d’élégance.
Madame Malivert était vêtue d’une robe blanche dont le corsage aux plis amples flottait autour de sa taille. Aux épaules et aux bras, l’étoffe transparente se dorait de la chaude couleur de la peau. Une dentelle jetée sur les cheveux en assombrissait la masse blonde, soyeuse et légère. La figure, aux traits délicatement dessinés, quoique ronde et pleine, s’éclairait de l’expression douce et caressante des yeux bleus où se révélait une âme plus tendre qu’ardente. C’était, dans l’épanouissement de son opulente beauté, un saisissant contraste avec Nicolette, petite et brune, si maigre dans sa robe noire qu’elle semblait n’avoir que le souffle, et comme consumée par un feu intérieur dont son regard, détaché de la terre, trahissait la violence. Jamais fleurs d’un même arbre ne furent plus dissemblables que ces deux jeunes femmes nées des mêmes parents.
Leur mère était morte en mettant Nicolette au monde. Élevées par leur père, Joseph Suarez, architecte à Paris, elles l’avaient perdu seize ans plus tard. A cette époque, Irène était déjà mariée. Toute jeune, elle avait épousé, quoiqu’il eût le double de son âge, un riche propriétaire du Gard, M. Jacques Malivert. Elle habitait Beaucaire avec lui. Après la mort de son père, elle avait offert à Nicolette, qu’elle chérissait, un asile accepté avec reconnaissance.
Depuis cette époque, les deux sœurs vivaient en commun. Nicolette rêvait déjà des douceurs de la vie monastique qu’elle se proposait d’embrasser. Elle ne faisait pas mystère de ses projets ; mais elle en avait ajourné l’exécution jusqu’au moment où, ayant atteint sa majorité, elle pourrait disposer librement d’elle-même et obéir au penchant qui l’entraînait vers le cloître, sans avoir à lutter contre la volonté de son tuteur Jacques Malivert, qui lui refusait son consentement.
En attendant la réalisation de ses espérances, elle se considérait comme consacrée à Dieu. De pieux exercices remplissaient ses journées. Quoique retenue encore dans le monde qu’elle était résolue à fuir, elle se plaisait à y vivre comme une religieuse. Elle écartait tout plaisir et toute distraction ; elle allait toujours vêtue d’une robe noire, jeûnait, priait, s’imposait des privations de toutes sortes, et n’était heureuse que lorsqu’elle pouvait s’agenouiller, tantôt dans sa chambre où elle prolongeait ses veilles, prosternée devant Dieu, tantôt dans la chapelle des Carmélites, vers laquelle l’attiraient une puissance secrète et un invincible attrait.
La douleur dans l’âme, Irène voyait approcher le moment où sa sœur lui échapperait. Elle l’aimait tendrement. Dans la tristesse de son existence, elle ne connaissait d’autre joie que celle de cette affection payée de retour, mais condamnée à être brisée tôt ou tard. Mariée à un homme plus âgé qu’elle, elle n’avait pas trouvé les félicités qu’engendre l’amour. Séduit un jour par sa beauté, peut-être aussi par le chiffre de sa dot, Malivert, en l’épousant, n’avait rien compris à cette créature délicate et sensible qui s’était laissé prendre sans se donner. Après avoir cru la conquérir, il n’avait pas su se faire aimer d’elle. Irène, en lui, voyait un maître, et non un amant. A ses côtés, elle était sans confiance. Le temps, en s’écoulant, loin de la rapprocher de celui dont elle portait le nom, la détachait de lui. Par surcroît de malheur, elle n’avait pas d’enfant ; existence vide et dépossédée. Nicolette seule trompait encore son amer désenchantement en lui tenant lieu de tout ce qui lui manquait. Aussi Irène était-elle saisie d’une âpre angoisse toutes les fois qu’elle constatait que Nicolette allait la quitter pour toujours.
Cette préoccupation la dominait ce soir-là, tandis que le dîner se continuait silencieusement. Elle regardait sa sœur avec inquiétude, cherchant à deviner ce que pensait la jeune fille, se demandant si l’événement qu’elle redoutait allait se produire et Nicolette l’abandonner. Les yeux baissés, Nicolette mangeait du bout des lèvres, touchait à peine aux plats, choisissait les mets les plus simples, repoussait les plus recherchés, comme si elle eût voulu déjà se mortifier et s’essayer aux privations qu’elle subirait dans le cloître. Au dessert, composé de sucreries et de fruits, elle plia sa serviette, la posa près d’elle sur la table, et se croisant les bras, après avoir fait le signe de la croix, elle attendit pensive que sa sœur eût achevé son repas.
— Tu as fini ! Déjà ! Tu n’as pas mangé ! s’écria Irène.
— J’ai mangé à ma faim et bu à ma soif, répondit Nicolette. Tout le reste serait superflu.
Le domestique qui venait de servir se retirait. Irène plus libre reprit :
— Tu es rentrée bien tard, ma chérie. Je ne t’ai pas demandé où tu t’étais oubliée ; mais je devine que c’est chez les Carmélites.
— Chez les Carmélites, en effet.
— Encore !
— Encore et toujours, Irène ; je ne suis heureuse que là.
Irène se leva, fit le tour de la table pour se rapprocher de sa sœur, et l’ayant prise par la taille d’un geste maternel, elle l’entraîna doucement jusque dans le salon qui communiquait avec le jardin par une grande porte vitrée. Cette porte ouverte à deux battants laissait entrer avec le parfum des fleurs la fraîcheur du soir. Irène s’assit, et retenant Nicolette debout devant soi, elle lui dit :
— Ingrate enfant, les efforts que je fais pour que tu sois heureuse près de moi ne sont donc rien ?
— Mon cœur en gardera fidèlement le souvenir, ma bonne Irène, et tu sais bien que ma reconnaissance demeurera éternelle comme ma tendresse pour toi. Mais personne ne peut rivaliser avec Dieu pour assurer le bonheur de ses créatures. Il est la source de toute joie et de tout amour. Allons ! embrasse-moi et ne gronde pas.
— Oh ! je ne gronde pas, soupira Irène. Mais je suis si triste, en devinant que tu songes à me quitter !
— Pourquoi parler de notre séparation ? L’heure est proche où j’abandonnerai cette maison ; mais elle n’a pas encore sonné. Jusque-là, jouissons paisiblement de la joie d’être ensemble.
— C’est donc vrai ? tu veux partir !
— Peut-on résister à la voix du ciel ? Longtemps j’ai pu mettre en doute sa volonté ; je ne le peux plus aujourd’hui. Au printemps prochain, j’entrerai chez les Carmélites.
Ce fut dit d’un accent dont la douceur cachait mal la fermeté, et qui révélait un dessein définitivement arrêté. Irène connaissait trop bien sa sœur ; depuis trop longtemps elle était initiée à ses perplexités et à ses espérances pour tenter un effort qu’elle savait devoir être vain. Mais elle ne put retenir ses larmes ni les lui dissimuler.
— Ne dirait-on pas que je me condamne à quelque affreux supplice ! s’écria Nicolette joyeusement. Si tu pouvais comprendre combien je suis heureuse, petite sœur, tu ne pleurerais pas. Loin de pleurer, tu te réjouirais avec moi.
— Me réjouir quand je vais te perdre !
— Tu ne me perdras pas. Tu pourras me voir…
— T’entendre peut-être, mais non te voir. Ne seras-tu pas derrière une grille, sous un voile qui me dérobera tes traits ? Ah ! Nicolette ! Nicolette ! enfermée dans ton cloître, pourras-tu songer sans remords à la douleur que tu m’auras causée ! Je l’aime si tendrement, ma chérie ! N’es-tu pas plus que ma sœur ? n’es-tu pas ma fille ? Après la mort de notre mère, n’est-ce pas moi qui l’ai remplacée près de toi ? Quand tu étais toute petite, et quoique je ne fusse ton aînée que de sept ans, ne t’ai-je pas prodigué des soins maternels ? N’ai-je pas veillé sur ton enfance maladive ? N’est-ce pas à ma sollicitude que tu dois de vivre ?
— Tais-toi ! tais-toi ! murmura Nicolette en posant l’une de ses mains sur la bouche de sa sœur. Ce que tu rappelles là, je ne l’ai jamais oublié, et je ne l’oublierai jamais. Mais est-ce l’oublier que de vouloir se consacrer à Dieu ? Là-bas, ma sœur bien-aimée, je te prouverai encore ma tendresse en priant pour toi.
— Eh ! cela fera-t-il que ton départ ne me laisse seule au monde ?
— Seule au monde ! Et ton mari !…
— Mon mari ! murmura Irène avec découragement.
— Jacques t’aime.
— Il m’aime à sa manière, en égoïste, en despote, avec les brutalités et les emportements de sa nature. Quand, après quelque violence, il me fait un présent et m’embrasse en me l’offrant, il croit avoir réparé ses torts ! Hélas ! il ne sait pas quelle meurtrissure il me laisse au cœur. Ah ! si les jeunes filles savaient à quoi elles s’exposent en se mariant au gré de leurs parents et non à leur propre gré, elles y regarderaient à deux fois avant de s’engager.
— Mais tu m’affliges, ma chérie, fit Nicolette en s’agenouillant devant sa sœur. Es-tu donc si malheureuse ? Souvent, trop souvent, j’ai été témoin des scènes dont tu parles ; j’ai pu juger ton mari ; je sais qu’il n’a pas une âme égale à la tienne ; je sais qu’accoutumé à commander à ses ouvriers, à les contenir sous le frein d’une discipline rigoureuse, il apporte ici des exigences déplacées ! Souvent je t’ai vu pleurer ; mais souvent aussi je l’ai surpris à tes pieds, te demandant pardon. Je te croyais résignée à ses défauts.
— Se résigner est aisé quand on aime.
— Ne l’aimes-tu donc pas ? demanda Nicolette avec un accent d’effroi.
— Il a vingt ans de plus que moi ! répondit Irène, et plus bas, elle ajouta : — Si encore j’avais un enfant !…
Et comme elle pleurait, Nicolette la prit entre ses bras en disant :
— Je prierai pour toi, ma sœur bien-aimée ; le ciel m’exaucera ; il te rendra la paix avec le courage.
— Le courage et la paix me seraient rendus si tu me restais, Nicolette. T’ayant à mes côtés, je me sentais forte. Mais, toi partie, que deviendrai-je ? Je n’ai compris toute l’étendue de mon malheur que depuis ces quelques jours où je te devine toute frémissante du désir de t’en aller ailleurs. La solitude dans laquelle tu vas me laisser m’épouvante.
Un silence suivit ces paroles. On n’entendait rien que les sanglots qui gonflaient la poitrine d’Irène et les baisers sous lesquels Nicolette essayait de les apaiser.
— Je ne suis pas encore partie, dit enfin celle-ci, cherchant à calmer la peine dont elle venait de recevoir la confidence ; je t’aime trop pour t’abandonner si tu es malheureuse.
— Tu renoncerais à tes projets ? fit Irène en relevant la tête.
Cette question parut surprendre Nicolette. Subitement, son effusion tombait, son visage se transformait, exprimait son étonnement, devenait froid comme si dans le langage qu’elle venait d’entendre, elle eût découvert un piége.
— Y renoncer est impossible, dit-elle sèchement. Je ne peux que les ajourner jusqu’au moment où tu seras faite à l’idée de notre séparation.
— Je ne m’y ferai jamais, s’écria Irène avec emportement, et puisque tu dois quitter cette maison, autant à présent que plus tard. Ah ! implacable égoïsme des âmes qui se livrent au Christ, je te reconnais. C’est toi qui me prends ma sœur. Pars, continua-t-elle en se levant, le regard fixé sur Nicolette toujours agenouillée ; pars quand tu voudras. Je ne te disputerai pas à Dieu.
Sans rien ajouter, elle marcha vers la porte ouverte sur le jardin. Mais au moment où elle allait en franchir le seuil, un cri de sa sœur l’arrêta.
— Est-ce toi qui me parles, Irène ? demandait celle-ci.
Irène se retourna. Elle vit Nicolette qui la regardait toute pâle, et tendait de son côté ses mains suppliantes. Le ressentiment qui la dominait s’évanouit. Elle se précipita sur elle, la releva d’un mouvement passionné, et la tenant entre ses bras, la couvrit de baisers et de larmes.
— Pardonne-moi, lui disait-elle ; tu n’as jamais su, tu ne peux savoir combien je suis malheureuse. Ah ! si je pouvais te dire ! Mais, non, je ne dois pas troubler la sérénité de ton âme, ma chère sainte ; je dois garder le silence. Tout à l’heure, tu me promettais de prier pour moi ! Oui, prie, prie pour ta pauvre Irène, ma chérie.
— Mais que me caches-tu donc ? s’écria Nicolette effrayée par le trouble où elle voyait sa sœur.
— Tais-toi, tais-toi ! reprit celle-ci ; ne m’interroge pas ; il n’est pas en mon pouvoir de te répondre.
De nouveau, elle s’éloigna à grands pas et disparut dans l’ombre du jardin, sans que cette fois l’appel de sa sœur pût la retenir.
Vers minuit, Nicolette, retirée dans sa chambre, priait encore. C’était ainsi tous les soirs. Depuis longtemps, elle s’astreignait à une règle sévère, tout heureuse de sa servitude volontairement acceptée. Elle ne se couchait qu’après avoir longuement médité, ayant aux doigts, quand elle s’étendait sur sa dure couchette, le rosaire qu’elle égrenait en s’endormant.
Ce jour-là, elle s’était adressée à Dieu avec une ferveur où respirait sa tendresse pour Irène ; elle le suppliait de couvrir de sa protection sa sœur malheureuse, de la consoler, de lui donner la paix intérieure et de lui rendre le bonheur perdu.
Un grand calme berçait la maison. Des bruits de roues sur la route, quelque cri de bateliers descendant le canal au fil de l’eau, troublaient seuls le silence. Par la croisée que la chaleur obligeait Nicolette à laisser entr’ouverte, un rayon de lune faisait sa trouée dans la chambre, allongeant sur le parquet sa lumière ainsi qu’un sillon d’argent, et dans ce sillon, comme ravivées par ses feux, passaient les suaves émanations qui montaient du jardin.
Au moment où l’horloge de la ville répandait dans l’air les douze coups de minuit, Nicolette se leva, ayant fini ses dévotions. Elle ouvrit la croisée toute grande, s’accouda au balcon et respira la brise fraîche du Rhône, qui chantait dans les feuillages, en secouant la poussière dont le vent durant le jour les avait chargés. Elle resta ainsi, les yeux levés vers le ciel tout embrasé de la clarté des étoiles flamboyantes. Ses lèvres demeuraient immobiles. Mais de son cœur montaient des prières nouvelles dans lesquelles elle s’abîmait, détachée de la terre, emportée dans le rêve qui lui montrait au delà de l’azur les félicités éternelles promises aux élus. Enfin elle rentra, tira le rideau sur la fenêtre close et commença sa toilette pour la nuit, debout au milieu de la chambre, évitant de se regarder dans la glace, détournant les yeux de son corps de vierge, comme pour ne pas s’exposer à tirer orgueil de sa beauté, et tressant en une natte épaisse ses cheveux dénoués.
Tout à coup, dans le silence, du côté de la chambre de sa sœur, à l’autre extrémité de la maison, éclata un cri de détresse, tombé d’une bouche de femme, et suivi presque aussitôt de la détonation d’une arme à feu qui fit trembler les murailles. Puis, ce fut dans l’escalier le bruit d’une course affolée, et, dominant le vacarme, des exclamations de colère poussées par une voix que Nicolette reconnut pour celle de son beau-frère Jacques Malivert. Le sang glacé par l’effroi, elle demeurait immobile, les pieds cloués au parquet. Mais cette immobilité ne dura qu’une seconde. Convaincue que sa sœur courait un péril, elle s’élança pour lui porter secours ; elle fut arrêtée aussitôt. La porte venait de s’ouvrir, poussée avec fracas par un bras vigoureux. Nicolette ne put retenir une plainte et recula terrifiée jusqu’au fond de la chambre, croisant fiévreusement les bras sur sa poitrine que voilait à peine le corsage dégrafé. Sur le seuil béant, encadrant l’obscurité de la galerie, Irène apparaissait, les cheveux sur les épaules, la face convulsée. Elle n’était pas seule. Sa main crispée étreignait celle d’un jeune homme, tête nue, horriblement pâle sous l’épaisse moustache noire qui balafrait son visage, et revêtu de l’uniforme des officiers de hussards que Nicolette se souvenait d’avoir rencontrés à Tarascon où ils tenaient garnison. Il résistait et se débattait ; mais elle le traînait derrière elle, quelque effort qu’il fît pour retourner sur ses pas. Elle l’obligea à entrer, et le désignant à Nicolette, elle dit, tremblante, folle d’épouvante :
— Sauve-nous, Nicolette ; dis que c’est pour toi qu’il était ici.
Sans attendre la réponse de sa sœur, elle traversa la pièce en courant. A la tête du lit, une porte donnait accès dans une chambre non habitée par où elle pouvait regagner la sienne. C’est par là qu’elle disparut.
— Qui êtes-vous, monsieur ? Que faites-vous ici ? s’écria Nicolette.
— M. Malivert nous a surpris en haut de l’escalier, au moment où sa femme me ramenait. Il a tiré sur nous et il nous cherche. C’est elle qui m’a conduit ici.
Alors Nicolette comprit. Ses traits se décomposèrent ; une horrible pâleur les voila, et se redressant, elle protesta.
— Mais c’est infâme ! Allez-vous rejeter sur moi la responsabilité de votre crime ?
L’officier se rapprocha d’elle.
— Soyez sans inquiétude, mademoiselle, nous ne sommes pas encore morts. J’ai mon épée, et je vous défendrai.
— Contre qui, malheureux ?
Elle ne put achever. Jacques Malivert se dressait sur le seuil. Grand, les épaules larges, une encolure de taureau, la barbe rousse, sillonnée de poils grisonnants, l’œil allumé par la colère, brandissant un revolver, il était terrible. D’abord, il ne vit que l’officier.
— Je te tiens, misérable, rugit-il, et cette fois, tu ne m’échapperas pas. Après toi, ta complice y passera.
Son bras se levait, dirigeant l’arme sur l’amant de sa femme. Celui-ci bondit. D’une main ferme, il abattit ce bras menaçant et le contint, malgré les efforts de Malivert pour se dégager de cette étreinte. Ce fut, pendant une minute, un combat corps à corps. L’officier violemment repoussé dut lâcher prise. Mais le revolver tomba. Il y mit le pied, bravant du regard son adversaire désarmé, qui de nouveau se serait jeté sur lui si Nicolette, sortant de l’ombre où elle se dissimulait, ne s’était avancée brusquement.
— Pourquoi voulez-vous nous tuer, Jacques ? demanda-t-elle. Quel mal vous avons-nous fait ?
— Vous, Nicolette ! s’écria Malivert stupéfait. Ce n’est donc pas Irène !
— Vous le voyez bien.
— C’est pour vous que monsieur est venu ?
— C’est pour moi.
Le regard assombri de Jacques s’éclairait ; le drame tournait à la comédie. Railleur, presque gai, il continua :
— Vous la sainte, vous la pure, vous l’hermine immaculée, vous recevez la nuit un jeune homme dans votre chambre ! Sous cette odieuse accusation, elle se sentit défaillir, et ouvrit la bouche pour se justifier. Mais Jacques ne lui en laissa pas le temps, et désignant sur la table un chapelet à côté d’un livre d’heures, il ajouta : — Est-ce pour le convertir et lui apprendre à réciter des Pater et des Ave que vous l’avez appelé ? Allons, répondez-moi !
— Je pourrais vous répondre si vous étiez en état de m’entendre, balbutia-t-elle. Mais nous ajournerons toute explication jusqu’au moment où vous aurez recouvré quelque sang-froid. Si vous n’aviez tiré sur nous tout à l’heure ; si vous ne nous aviez obligés à fuir devant vous, je vous aurais déjà démontré…
— Et que m’auriez-vous démontré ? Tout cela n’est-il pas assez clair, et la présence de monsieur…
Il n’acheva pas. Son regard brusquement venait de s’arrêter sur le petit lit blanc non encore défait, au-dessus duquel un grand crucifix étendait son ombre sainte. Oh ! comme il protestait, ce lit virginal ! Comme il attestait clairement l’innocence de Nicolette !
— Eh bien, non, s’écria Malivert, détrompé, je me refuse à croire qu’une fille telle que vous ait à ce point oublié ses devoirs. Vous avez menti pour détourner de la tête de votre sœur ma légitime colère ; vous vous dévouez pour elle.
De nouveau, la fureur grondait dans sa voix, s’allumait dans ses yeux. Nicolette comprit qu’en cette heure suprême, c’en était fait de sa sœur si elle marchandait son dévouement. Elle prit héroïquement son parti du mensonge et du sacrifice auxquels elle se condamnait.
— En affirmant ce que j’ai affirmé, fit-elle, j’ai dit la vérité. Je suis fiancée à monsieur. C’est par ma volonté qu’il est à cette heure dans votre maison. Mais cela ne vous donne pas le droit de m’accuser d’avoir oublié mes devoirs. Nous n’avons rien à nous reprocher, si ce n’est une imprudence de laquelle, après tout, je ne dois compte à personne, étant libre de mes actes. Quant à ma sœur, si vous la soupçonnez, interrogez-la ; la voici.
Irène entrait, enveloppée dans une robe de chambre, ainsi qu’une femme chassée à l’improviste de son lit, essayant de dissimuler sous une surprise feinte sa violente émotion, non encore dissipée.
— Pourquoi ce bruit ? demanda-t-elle.
Jacques Malivert, au lieu de lui répondre, courut à sa rencontre. La prenant par la main, il l’attira brusquement à lui, et les yeux dans les yeux, l’interrogea.
— Savais-tu que ta sœur avait renoncé à entrer aux Carmélites et songeait à se marier ?
— Je le savais, répondit Irène toute troublée. Elle m’a parlé plusieurs fois de M. Frédéric de Varimpré.
— Pourquoi ne m’en avoir rien dit ?
— Ce n’était pas mon secret.
— Savais-tu aussi que monsieur venait la nuit ?
— Cela, je l’ignorais.
— C’est la première fois qu’il vient ! objecta Nicolette.
Malivert regardait tour à tour sa femme, Nicolette et l’officier, qui assistait silencieux à cette scène, indécis sur le rôle qu’il devait y prendre. L’attitude du mari disait clairement que l’explication qu’il avait provoquée le laissait incrédule et défiant. Il parut enfin se décider à la tenir pour vraie, et se tournant vers celui qu’Irène venait d’appeler Frédéric, il reprit :
— Votre présence à cette heure chez moi, monsieur, est un outrage qui nous atteint tous, cette jeune fille que vous avez compromise, ma femme que j’ai soupçonnée, et moi-même dont vous avez violé le domicile. Il est une seule manière de le réparer, et je veux croire que vous êtes prêt à vous conduire en homme d’honneur.
— Je suis prêt, monsieur, répondit Frédéric, dominé par les événements, résigné à les subir.
— Veuillez donc vous retirer. Demain, je vous ferai parvenir mes ordres, oui, mes ordres ; — il accentuait ces mots pour répondre à un geste de l’officier ; — mademoiselle Suarez n’est pas encore majeure, et je suis son tuteur.
Frédéric de Varimpré obéit. Il s’éloigna à pas lents, après s’être incliné devant Irène et devant Nicolette, mais en évitant de saluer Jacques Malivert. Celui-ci le suivit pour le ramener jusqu’à la porte de la maison. Irène les écouta s’éloigner. Quand elle cessa d’entendre le bruit de leurs pas, elle se précipita vers sa sœur en murmurant :
— Je n’oublierai jamais combien tu m’as été miséricordieuse ; tu m’as sauvée.
— Et toi, tu m’as perdue ! s’écria Nicolette farouche.
— Pardonne-moi, ma sœur !
— Que je te pardonne, quand me voilà obligée de me marier et d’épouser ton amant !
— Dois-je maintenant me jeter aux pieds de Jacques et lui faire l’aveu de ma faute ? A ce prix, tu recouvreras ta liberté.
Au lieu de répondre, Nicolette pressa le bras de sa sœur en murmurant :
— Tais-toi ; le voilà qui revient.
Jacques rentrait en effet. Pendant sa courte absence, il avait retrouvé sa bonne humeur. D’une voix apaisée, presque caressante, il dit à Nicolette :
— Vous avez été étourdie et légère, petite sœur, et votre conduite pouvait avoir de graves conséquences. Je ne vous ferai pas de reproches cependant, puisqu’il est convenu que vous allez devenir la femme de ce beau lieutenant. Le mariage réparera tout, et nous voilà délivrés de la crainte de vous perdre. C’est égal, ajouta-t-il, un sourire ironique sur les lèvres, qui se fût attendu à cela de la part d’une jeune fille qui prétendait, il y a trois jours encore, finir ses jours chez les Carmélites ? Vous nous avez joliment trompés.
Nicolette se taisait. Mais chacune de ces paroles entrait dans son cœur comme une lame acérée, et lui faisait une blessure. Irène eut pitié d’elle.
— Laisse-la, dit-elle à son mari. La pauvre enfant est anéantie.
— Nous reprendrons demain cet entretien, répondit Jacques. Bonsoir, ma chère ; tachez de dormir ; le sommeil vous apaisera.
Il sortit en faisant signe à sa femme de le suivre, comme s’il eût redouté de la laisser en tête-à-tête avec Nicolette. Tremblante, Irène obéit, après avoir embrassé sa sœur, sans oser lever les yeux sur elle. Celle-ci les regarda partir et entendit le bruit de la porte se fermant derrière eux. Alors, un flot de larmes longtemps contenu s’échappa de ses yeux, et se tordant les mains dans un accès de désespoir, elle s’écria :
— Seigneur, j’ai juré d’être à vous ; c’est à vous seul que je me suis donnée, à vous seul que je veux appartenir. Vous ne voudrez pas que je viole les vœux que j’ai prononcés ; ne m’abandonnez pas et ne permettez pas qu’on m’arrache à vos bras.
Lorsqu’après une nuit d’angoisse et de fièvre, n’ayant pu s’endormir qu’au petit jour, elle s’éveilla, elle était toute brisée. A la sereine joie dont la veille encore son âme était pleine, avait succédé un trouble douloureux. La terrible scène effacée par le sommeil se reconstituait dans son esprit, revivait avec tous ses incidents, la frappait de stupeur, au fur et à mesure qu’elle en ressaisissait la cruelle réalité un moment évanouie. Non, elle ne rêvait pas. C’est bien elle qui s’était trouvée, tout à coup, mêlée innocente à cette effroyable aventure ; c’est bien elle qu’avait souillée le contact d’un inconnu jeté dans sa chambre au milieu de la nuit ; c’est bien elle que l’égoïsme de sa sœur affolée et son propre dévouement exposaient sans défense à une infâme accusation.
Qu’allait-elle devenir maintenant ? Comment échapper au gouffre creusé sous ses pas ? Résolue à se consacrer à Dieu, allait-elle voir sa vocation religieuse se ternir et se briser dans les bras d’un mari aux caresses duquel elle ne songeait qu’avec horreur ? Ce mari, elle ne pouvait le subir sans violer le vœu de chasteté prononcé jadis. Mais si elle refusait de l’accepter, elle abandonnait sa sœur aux vengeances de Malivert outragé. Ce n’est qu’en se sacrifiant qu’elle sauverait Irène. Ce sacrifice en perspective l’épouvantait, arrachait à ses lèvres et à son cœur, pour la première fois, un cri de révolte. Dans quel but le ciel la choisissait-il pour de si terribles coups ? S’il voulait qu’elle se vouât à lui, pourquoi élevait-il entre elle et le cloître un si redoutable obstacle ? C’est en vain qu’elle le lui demandait ; il ne répondait pas, et toute tremblante, craignant de l’avoir offensé en essayant de scruter ses desseins, elle retombait découragée, brisée par les entraves imposées tout à coup à son essor vers Dieu.
Dans l’extrême détresse où elle se trouvait, sa pensée la ramenait au souvenir de son confesseur, l’abbé Cardenne. Depuis longtemps, elle était accoutumée à se confier à lui. Elle lui avait ouvert son âme dans ses plus intimes replis ; c’est avec son appui qu’elle avait franchi successivement les diverses étapes par lesquelles elle tentait de s’élever vers la perfection chrétienne. Lui seul pouvait à cette heure lui montrer la route qu’en ce moment critique elle devait prendre. Elle se décida à aller le consulter sur-le-champ, bien qu’elle comprît qu’il serait impuissant à changer ce qui était et à écarter le dénoûment qu’elle prévoyait.
Les yeux rougis par les larmes, exténuée de corps et d’âme, elle se leva, fit machinalement sa toilette, et selon son habitude de tous les jours, s’agenouilla pour prier. Mais, hélas ! les paroles saintes qui voltigeaient sur ses lèvres ne venaient pas de son cœur. Dans son cœur désolé, la ferveur était refroidie, dissipée par l’obsession qui le dominait. Obsession déchirante ! C’était la vision de son avenir transformé, substituée aux espérances longuement caressées. Pour toujours, le couvent se fermait devant elle. Au lieu de l’amant divin dont elle avait souhaité passionnément de porter les douces chaînes, elle aurait un époux qui lui imposerait le joug grossier et abhorré de l’amour humain. Sa virginité offerte au Seigneur, destinée à fleurir pour lui, se flétrirait sous d’impurs et corrupteurs baisers. Cette vision la brûlait, imprimait à son cœur de cruelles morsures, déchaînait dans sa chair un frisson de répulsion et de honte, et glaçait sur ses lèvres, accoutumées à prier, les adjurations qu’elle adressait à Dieu.
Le soleil se levait dans un ciel clair, au fond duquel s’évanouissaient les vapeurs de la nuit. Ses rayons fouillaient les rues étroites, à travers les tentes grises tendues au devant des maisons ; ils coloraient d’une ardente teinte d’or les murailles blanches et nues, les pavés étroits et pointus, arrosés dès l’aube ; ils tiédissaient peu à peu la brise qui montait de la mer le long du Rhône et soufflait sur la ville toute resplendissante dans la joyeuse clarté du matin. Ce n’était déjà plus la nuit ; mais ce n’était pas encore cette lumière crue et aveuglante qui, dans le Midi, enveloppe les choses et les êtres, au milieu des journées d’été, d’une chaleur de feu.
Sa messe dite chez les Carmélites, dont il était l’aumônier, l’abbé Cardenne, rentré dans la petite maison qu’il habitait, parcourait à pas lents l’unique allée de son jardinet, en lisant son bréviaire. Ce n’était ni un jeune homme ni un vieillard. Grand, mince et très-pâle, ses yeux clairs sous les boucles de ses cheveux grisonnants donnaient à son visage amaigri une saisissante expression de douceur et de bonté, expression non trompeuse, qui révélait sa tolérance, sa mansuétude, son ardeur au bien et son zèle à remplir les devoirs de son état. Il résidait à Beaucaire depuis plusieurs années. Autrefois missionnaire, il était venu s’y fixer quand sa fragile santé, ébranlée par les fatigues du plus vaillant apostolat dans les pays africains, l’avait contraint à renoncer aux périls et aux émotions des longs voyages.
Il vivait là, tranquille, sinon oublié. Ses supérieurs diocésains connaissaient trop bien son mérite et ses vertus pour l’oublier. En diverses circonstances, ils avaient voulu lui faire accepter de hautes fonctions sacerdotales. Mais aux dignités ecclésiastiques il préférait la modeste retraite qu’il s’était choisie ; il persistait à écarter les offres qui lui arrivaient fréquemment ; il s’efforçait de se faire chaque jour plus humble et plus obscur, comme s’il eût redouté la destinée que d’autres rêvaient pour lui, et dont il était le seul à se croire indigne.
En apercevant Nicolette à cette heure matinale, il ne put cacher sa surprise. Elle venait rarement chez lui ; c’est au couvent qu’elle avait contracté l’habitude de le voir. Fermant son livre, il fit quelques pas au-devant d’elle.
— Ma visite vous étonne, monsieur l’abbé, dit Nicolette en le saluant. Elle ne vous étonnera plus quand vous en connaîtrez l’objet.
La pâleur de son visage, l’éclat de son regard, le frémissement de sa voix, firent comprendre à l’abbé Cardenne qu’elle était sous le coup d’une violente émotion.
— Ce que vous avez à me dire est-il donc si pressé ? demanda-t-il en la ramenant dans la pièce modestement meublée qui lui servait à la fois de salon et de cabinet de travail.
— Vous allez en juger, monsieur l’abbé. Ce n’est pas pour me confesser que je suis venue, c’est pour vous demander un conseil. Je me trouve dans des circonstances délicates et douloureuses, si douloureuses, si délicates, que j’aurais hésité à les confier à qui que ce soit, même à vous, si je savais que les confidences que vous allez recevoir resteront à jamais enfermées dans votre cœur, et qu’aucun événement ne pourra les en faire sortir.
— Parlez vite, mon enfant ; vous m’effrayez un peu, je vous l’avoue.
Ils étaient seuls, elle, assise, comme écrasée par le fardeau du secret qui allait s’échapper de sa bouche, le regard fixé sur le jardin désert où les buis en bordure, chauffés par le soleil, répandaient leurs parfums ; lui debout, anxieux, se demandant s’il allait entendre l’aveu d’un crime, ou le cri de quelque profonde misère. Nicolette voulut parler, mais les mots fuyaient ses lèvres, et tout à coup un flot de larmes jaillit de ses yeux. L’abbé poussa une chaise contre le fauteuil où elle était assise, et rapproché d’elle, il dit à demi-voix :
— C’est donc bien grave ?
Elle fit un effort pour dominer sa défaillance passagère et tout à coup se mit à parler rapidement, le rouge au front, toute honteuse de ce qu’elle était contrainte de révéler, pressée d’avoir fini et ne voulant cependant rien oublier de ce qui pouvait permettre à son confident d’apprécier l’inextricable difficulté contre laquelle elle se débattait.
— Voilà ce qui s’est passé, dit-elle en finissant. Que dois-je faire ?
L’abbé commença par garder le silence. Il s’était levé et marchait dans la pièce étroite, les mains derrière le dos, s’arrêtant parfois au dehors, sur le perron, puis reprenant sa marche, et regardant tout ému mademoiselle Suarez.
— Puisque vous avez eu le courage d’un si généreux dévouement, dit-il enfin, je crois, mon enfant, que votre devoir est de vous dévouer jusqu’au bout et d’achever votre œuvre.
— J’attendais cette réponse, gémit-elle.
— Je ne saurais vous tracer une autre conduite. Votre sœur a été coupable ; mais si Dieu vous a inspiré le devoir de lui sauver l’honneur, et peut-être la vie, c’est qu’il n’a pas voulu la châtier impitoyablement. A l’heure même où il lui infligeait un effroi salutaire et par un coup retentissant la ramenait à lui, il entendait se servir de vous pour la détacher du péché. C’est Dieu, mon enfant, qui vous a dicté les paroles par lesquelles a été arrêté le bras du mari prêt à se venger. Sa volonté apparaît si clairement, que tenter de s’y dérober serait l’offenser.
— N’est-ce pas l’offenser davantage que de manquer aux promesses solennelles que je lui ai faites ? A l’âge de seize ans, vous le savez, mon père, j’ai prononcé un vœu de chasteté perpétuelle ; hier encore, je prenais devant le ciel l’engagement de revêtir le saint habit des Carmélites.
— Ces promesses inspirées par votre piété n’ont été entendues que par Dieu ; elles lient votre conscience, mais non votre personne, et il sera aisé de vous en relever.
— Ainsi, mon père, vous me conseillez de me marier ?
— Je vous le conseille, et tout autre à ma place vous le conseillerait.
— Me voilà donc condamnée au malheur pour toute ma vie ! soupira Nicolette ; je suis innocente, cependant ; pourquoi la responsabilité du crime que d’autres ont commis va-t-elle peser sur moi ?
— N’interrogez pas le ciel, ma fille ; ce qui arrive, il l’a voulu, et vous devez vous y résigner.
— Être obligée de me marier au moment où j’allais me donner à Dieu, d’épouser un homme qui m’est inconnu et que sa conduite me défend d’estimer, le sacrifice est cruel !
— Oui, certes, le sacrifice est cruel, et Dieu vous éprouve. Mais loin de vous affliger qu’il vous ait choisie pour faire peser sur votre front sa colère, vous devez vous en réjouir, et puisque vous n’avez rien à vous reprocher, lui rendre grâce sans chercher à deviner ce que cachent ses arrêts. Vous aviez résolu de vous immoler à lui ; immolez-vous ! Tôt ou tard, sur cette terre ou dans son royaume, il vous dédommagera des souffrances que vous aurez endurées pour la gloire de son nom. Et comme Nicolette, tout en pleurs, secouait la tête, sans trouver en soi la force de se résigner, l’abbé Cardenne ajouta : — Ce qu’il ordonne est pour un bien. Qui sait si nous ne nous étions pas trompés, vous et moi, dans le choix de votre vocation ? Qui sait si en choisissant la vie monastique, vous n’aviez pas trop présumé de vos forces ? Et puis, mon enfant, toutes les âmes pures doivent-elles se réfugier égoïstement dans le cloître ? N’est-il pas bon qu’il en reste dans le monde ? Là aussi, vous pourrez faire votre salut, et en même temps que vous y travaillerez, travailler par la parole et par l’exemple au salut de ceux parmi qui vous vivrez. Le mariage qui vous épouvante aura des douceurs, soyez-en sûre, et entre toutes celles que vous pourrez y trouver, la douceur d’avoir converti l’homme dont vous aurez accepté le nom. Pour une âme chrétienne, la vie n’est jamais aussi sombre, aussi désespérée qu’elle vous apparaît dans l’épreuve. L’adversité a ses lendemains. A la peine que vous ressentez aujourd’hui succéderont des heures plus clémentes. Vous serez toute surprise de l’apaisement qui se fera dans votre âme, quand vous songerez au dévouement exercé sans faiblesse et au devoir accompli avec vaillance.
L’abbé Cardenne parla longtemps ainsi. Peu à peu, sous l’influence de ses exhortations, Nicolette se rassérénait. Tout ce qu’il lui disait, elle se l’était dit à elle-même durant les heures qui venaient de s’écouler. Mais, dans la bouche du prêtre, ce langage revêtait une autorité plus grande ; il berçait son mal, il la disposait à souffrir sans se plaindre. Elle se résignait aux changements survenus.
— C’en est donc fait ! s’écria-t-elle, quand il cessa de parler ; je ne serai pas religieuse ! Que la volonté de Dieu s’accomplisse ! Et vous, mon père, unissez vos prières aux miennes, afin qu’il me donne le courage de l’accomplir. A bientôt ; je vous reverrai.
Elle s’éloigna lentement, accompagnée jusqu’à la porte de la petite maison par le prêtre miséricordieux dont les accents venaient de lui montrer clairement son devoir. Une fois dehors, elle se dirigea vers une église qui se trouvait sur son chemin et entendit la messe. Elle pria longuement et ardemment. Sa ferveur était revenue. Fière d’avoir été choisie pour de dures épreuves, son âme, qui maintenant brûlait de souffrir, les appelait avec un enthousiasme de martyr.
Ses dévotions terminées, elle rentra. Ses résolutions prises, elle avait hâte de les faire connaître à Jacques Malivert, et en même temps de se justifier, en lui expliquant la présence de M. de Varimpré dans sa chambre. Elle voulait bien sauver sa sœur, en se sacrifiant, mais non rester exposée aux soupçons injurieux que les apparences laissaient peser sur elle. Elle entendait que Jacques fût convaincu qu’elle n’avait pas cessé d’être pure, afin que personne ne pût l’accuser de ne se marier que pour cacher une faute.
Jacques était déjà sorti. Il possédait aux portes de la ville, sur la route de Nîmes, des carrières de pierre de taille. La pierre de Beaucaire est célèbre dans la Provence et dans le Languedoc. C’est de là que le mari d’Irène tirait la plus grosse portion de ses revenus. Une partie de la dot de sa femme avait été consacrée à créer une exploitation qu’il dirigeait lui-même. Chaque matin, il se rendait dans les carrières pour s’assurer que les ouvriers avaient pris le travail à l’heure réglementaire. C’est au milieu d’eux, en exerçant sa surveillance, qu’il était devenu l’homme emporté, brutal et dur, dont la colère avait éclaté si terrible durant la nuit.
En attendant son retour, Nicolette s’enferma chez elle, négligeant d’aller embrasser sa sœur, ainsi qu’elle le faisait tous les jours à son réveil. Quelque résolue qu’elle fût à épuiser le dévouement et à pardonner, son cœur conservait encore, en ce moment si rapproché de l’aventure qu’elle déplorait, un ressentiment légitime que le temps seul pouvait dissiper. Elle craignait de ne pouvoir le cacher en présence d’Irène, et cette crainte lui faisait fuir l’occasion d’un entretien qui n’aurait pu avoir d’autre objet que les événements de la nuit. Mais l’entretien qu’elle redoutait, Irène le cherchait. En proie à d’amers regrets, malheureuse de l’infortune de sa sœur, elle n’avait pu ni fermer les yeux, ni donner libre cours à ses larmes, contenue par la présence de son mari endormi à côté d’elle et qu’elle redoutait d’éveiller, pressentant les questions qu’il lui adresserait s’il surprenait son trouble. Après l’avoir vu se lever, s’habiller et partir, elle s’était précipitée chez sa sœur, dévorée du désir de la revoir, de l’embrasser, d’implorer son pardon. A la même heure, Nicolette se rendait chez l’abbé Cardenne. Irène, inquiète de cette sortie matinale dont elle ignorait le but, avait conçu de mortelles inquiétudes qui ne se dissipèrent que lorsqu’elle apprit que sa sœur venait de rentrer. Elle alla sur-le-champ la trouver.
En la voyant, Nicolette ne put retenir un geste d’impatience. Ses yeux rougis par les larmes, ses traits décomposés, sa pâleur exprimaient sa peine avec tant d’éloquence qu’Irène se fit horreur. Son affection fraternelle l’emporta sur la prudence.
— Apaise-toi, ma sœur chérie, dit-elle. Si j’ai eu hier recours à ta tendresse et fait appel à ta pitié, c’est que le retour de Jacques avait troublé ma raison. La mort que j’ai vue de si près m’épouvantait. L’épouvante m’a jetée à tes pieds. J’étais folle. Mais, cette nuit, le calme est rentré dans mon cœur, et la résignation avec le calme. Je sais ce que mon devoir m’ordonne. J’expierai ma faute…
— Et que m’importe ton expiation ! C’est affaire entre ta conscience et toi. Ton repentir ne me rendra pas le bonheur.
— Tu ne m’as donc pas comprise ? Jacques saura la vérité. Je suis prête à lui en faire l’aveu.
Nicolette, à ces mots, se redressa, et étreignant sa sœur d’un mouvement où se confondaient son amour et sa colère non encore domptée, elle reprit :
— Je te défends de le détromper. Pour lui comme pour toi, il faut qu’il ignore toujours que tu as oublié tes devoirs. Le bonheur de toute ta vie est à ce prix.
— Mais s’il ne peut être assuré qu’au prix du tien, je n’en veux pas.
Un silence suivit ces paroles. Nicolette, les mains dans celles de sa sœur, le regard fixé sur l’horizon auquel servait de cadre la fenêtre ouverte, semblait y chercher l’apaisement. Ses traits peu à peu se détendaient ; l’attendrissement qui montait dans son cœur, au souvenir du passé durant lequel Irène lui avait prodigué sa tendresse maternelle et ses soins, la transfigurait. Les paroles de son confesseur lui revenaient en mémoire.
— Rien n’arrive que par la volonté de Dieu, dit-elle enfin d’un accent triste et doux. Je suis dans ses mains ; il a disposé de moi ; je me soumets à sa volonté.
— Me pardonneras-tu jamais ? demanda Irène.
— Oui, si tu peux m’affirmer que tu oublieras celui qui va devenir mon mari et que tu lutteras par la prière contre le sentiment criminel qui t’a faite faible devant lui.
— O Nicolette, suis-je donc si dégradée à tes yeux que tu me supposes capable de l’aimer encore, maintenant qu’il va t’appartenir ! Ne redoute rien de moi. Je passerai ma vie à regretter le mal qu’involontairement je t’ai fait. Je n’accepterais même pas le sacrifice auquel tu as consenti, si je n’avais le ferme espoir que tu aimeras ton mari. Et plus bas, elle ajouta : — J’ai été plus coupable que lui ; il est digne de toi.
— Cela, je le saurai plus tard, répondit Nicolette.
Ce fut tout, et sous son visage attristé, les pensées qui se pressaient dans son cœur demeurèrent impénétrables.
Le lieutenant Frédéric de Varimpré appartenait à une ancienne famille dont plusieurs membres avaient porté les armes avec honneur. Son père, général en retraite, vivait aux environs de Sancerre dans une terre de laquelle il tenait son nom ; sa mère était elle-même fille de soldat. Ils n’avaient que cet enfant. Il devait recevoir d’eux pour héritage le prestige d’une vie sans tache et une honnête aisance. Dans la carrière où il était entré, l’éclat de ses mérites ne le protégeait pas moins que le souvenir de la gloire paternelle. Ses camarades l’aimaient ; ses chefs l’estimaient ; ils lui prédisaient un brillant avenir. Le parti était avantageux pour Nicolette, que son éducation, sa dot, sa famille rendaient digne aussi de ceux à qui elle allait s’allier. La dramatique aventure qui subitement avait troublé son repos semblait donc n’être arrivée que pour un bien.
Quand elle connut les renseignements recueillis par Malivert sur le fiancé que lui donnait le hasard, elle se rassura. Si ces renseignements exprimaient la vérité, elle pouvait espérer non le bonheur, — elle ne croyait plus au bonheur, — mais une existence honorée, paisible, dont elle consacrerait à Dieu une bonne part. Cette espérance fut son unique consolation durant les jours qui préparèrent la première visite que lui fit Frédéric avec l’agrément de Jacques Malivert.
Cette visite avait été précédée de longs pourparlers entre les deux hommes et d’une démarche officielle du général de Varimpré et de sa femme, venus à Beaucaire tout exprès pour demander la main de Nicolette. Lorsque l’officier entra un soir dans le salon où se trouvait la jeune fille avec sa sœur et son beau-frère, elle ne put se défendre d’une émotion douloureuse. Elle parvint cependant à la surmonter. Son sacrifice étant résolu, elle entendait l’accomplir jusqu’au bout avec autant de bonne grâce que de dévouement. En outre, pour prolonger l’erreur de Malivert et protéger Irène contre les soupçons de son mari, elle était tenue de traiter Frédéric comme un ancien ami, de feindre, en le revoyant, une joie égale à la sienne. Il fallait continuer, sous cette forme, son généreux mensonge.
Elle trouva dans le lieutenant un complice habile et aimable. Pendant cette soirée, les dernières défiances de Malivert furent dissipées. Quant à Irène, quelque pénibles que fussent les sentiments qui obsédaient son cœur, elle demeura froide, simple, impénétrable. Personne ne put deviner le terrible secret qui existait entre elle, sa sœur et Frédéric. Nicolette elle-même fut convaincue de son repentir. Toute son attitude disait que l’amour brisé était mort et ne ressusciterait pas.
Le général et madame de Varimpré témoignèrent à leur future bru une paternelle bonté. Ils lui firent l’éloge de Frédéric ; avec un mari tel que lui, elle ne pouvait manquer d’être heureuse. Elle répondait de son mieux à ces marques d’affectueuse sympathie, et quand un amical débat s’engagea pour la fixation de l’époque du mariage, elle approuva tout ce qu’on voulut décider, ne montrant pas plus de répugnance que d’impatience devant le courtois empressement du lieutenant.
Il est certain que toute femme à sa place en eût été flattée. Son fiancé avait vingt-huit ans. Le brillant uniforme des hussards seyait à sa taille élégante et robuste. Sous ses cheveux bruns, coupés en brosse, le front bronzé se dessinait pur et intelligent. Une moustache épaisse accentuait sa physionomie énergique ; mais la douceur caressante des yeux tempérait la dureté des traits. La voix, grave, vibrait harmonieusement, trahissait une âme ardente et tendre. En entrant, Frédéric s’était avancé vers Nicolette pour la saluer, et lui avait tendu la main, en lui offrant un énorme bouquet de roses. Durant toute la soirée, elle garda ce bouquet dans les mains. Lorsque quelque parole prononcée de trop près faisait monter le sang à ses joues, feignant de vouloir respirer le parfum des fleurs, elle y plongeait son visage pour en dissimuler la rougeur.
Tout contribuait ce soir-là à la rendre sensible. Pour la première fois, elle venait de rompre avec les sévérités de sa vie passée. Elle avait quitté ses vêtements noirs, remplacés maintenant par une robe en soie de couleur claire, entr’ouverte sur sa poitrine et dont les manches courtes et larges laissaient voir, sous un flot de dentelles, la blancheur de ses bras. Ses cheveux, qu’elle arrangeait ordinairement sans coquetterie, étaient coiffés avec art. Irène, empressée à la faire belle, avait voulu piquer dans leur masse épaisse et lourde, sur le derrière de la tête, une touffe de grenadier, qui avivait de son chaud incarnat le teint doré de la nuque. L’émotion que ressentait Nicolette allumait dans ses yeux une flamme dont l’ardeur se répandait sur son visage. Elle se sentait belle ; et tout embarrassée du rôle qu’elle était condamnée à jouer, mal à l’aise sous ses parures, presque honteuse de l’étonnement provoqué chez ceux qui avaient coutume de la voir, par sa grâce subitement révélée, elle laissait se dégager d’elle, à son insu, sans effort de sa volonté, le charme infini d’une beauté qui s’épanouit et d’une pudeur qui s’alarme.
Au bout de quelques instants, on s’éloigna d’eux pour les laisser se parler librement. Alors, Frédéric, qui s’était assis auprès d’elle, se leva et lui dit :
— Mademoiselle, puisqu’on nous permet de rester en tête-à-tête, voulez-vous me suivre dans le jardin ? Nous y serons mieux qu’ici pour échanger quelques paroles indispensables.
— Oui, bien indispensables, murmura Nicolette, en appuyant sa main tremblante sur le bras de Frédéric.
Ils traversèrent lentement le salon pour gagner la large porte vitrée qui s’ouvrait sur le perron dont ils descendirent les marches. Impassible, sous un sourire, Irène, qui s’entretenait avec la générale, les accompagna d’un long regard.
Toujours silencieux, ils firent le tour de la pelouse qui déroulait sous un rayon de lune son tapis jauni par le soleil d’été. Au delà de la pelouse, une allée de pins s’enfonçait dans l’ombre. Ils la suivirent, le lieutenant tortillant sa moustache, un peu embarrassé pour commencer l’entretien, Nicolette toute frémissante au seuil de sa vie nouvelle, qui semblait à sa sainte ignorance des choses de l’amour, plus obscure que l’allée sous laquelle ils venaient de pénétrer.
— Il est de toute nécessité que je me fasse connaître à vous, mademoiselle, dit enfin Frédéric résolûment. Si vous m’avez jugé sur les apparences, au point de vue de vos principes religieux, vous avez dû me considérer comme un homme sans honneur et sans loyauté. Il m’est cruel de le penser au moment où vous allez me confier votre destinée ; je voudrais plaider ma cause…
— C’est inutile, monsieur, répondit Nicolette. Quelle que soit ma tendresse pour ma sœur, je ne serais pas ici, nous ne serions pas à la veille du jour qui va confondre votre existence et la mienne en une seule, si je vous avais jugé ainsi que vous le dites. J’ai plaint votre égarement, et j’ai prié pour vous. Je n’ai suspecté ni votre honneur ni votre loyauté.
— Votre sœur ne m’avait donc pas trompé en me disant que vous étiez une âme généreuse, reprit Frédéric. Merci, mademoiselle. Croyez que la mienne est pénétrée de reconnaissance. Ainsi, c’est bien de votre plein gré que vous m’épousez ?
— Pourquoi cette question, monsieur ?
— Pourquoi ? Les circonstances qui nous ont poussés l’un vers l’autre sont si extraordinaires ! Elles m’imposaient le devoir de vous fuir, si un devoir plus impérieux encore ne m’avait ordonné de m’associer à votre dévouement pour assurer le repos de celle que j’avais compromise et que vous avez sauvée. Elles me commandent aujourd’hui, avant que vous vous engagiez pour toujours, de vous interroger, et de vous dire que si vous regrettez votre héroïque décision…
— Que deviendriez-vous si je vous prenais au mot ? s’écria Nicolette. Que deviendrait ma sœur ? N’avez-vous pas compris que si j’ai fait ce que j’ai fait, c’est que le péril qui menaçait Irène était redoutable et pressant.
— C’est vrai, mais peut-être est-il conjuré.
— Il renaîtrait encore aussi pressant, aussi redoutable, si je vous éloignais de moi. Non, certes, ce n’est pas de mon plein gré que j’ai renoncé à la vocation qui m’entraînait loin du monde. Mais aujourd’hui, je ne regrette rien.
Elle prononça ces mots d’une voix ferme qui révélait l’énergie de sa volonté. Frédéric pressa la main qui s’appuyait sur son bras, en disant :
— Jusqu’à la mort, je me souviendrai de cette parole.
— Non, je ne regrette rien, continua Nicolette, et j’espère que la vie qui s’ouvre devant nous ne changera pas ces dispositions de mon cœur. Le repos de l’avenir dépend de vous seul. Si vous estimez que mon sacrifice est grand, vous vous efforcerez de m’en dédommager.
— Si c’est par le respect, par l’estime, par une tendresse profonde, l’effort sera facile.
— Cette tendresse, monsieur, vous n’attendrez pas de moi que j’y réponde. Je suis malhabile aux choses de l’amour, et le passé nous défend les emportements de ce que vous autres vous appelez la passion. Il y a quinze jours encore, j’étais au moment d’entrer chez les Carmélites ; vous-même vous ne me connaissiez pas. Je ne saurais donc être pour vous autre chose qu’une compagne dévouée, une sœur plus encore qu’une femme.
— Me sera-t-il interdit de vous aimer ou d’essayer de me faire aimer ?
— Cela, je ne saurais vous le défendre ; mais nous en sommes encore bien loin. Il y eut un silence qui se prolongea, tandis qu’ils continuaient leur promenade. Puis Nicolette ajouta avec moins d’assurance : — Il est même une condition de vie commune que je dois loyalement poser dès aujourd’hui.
— Laquelle ? D’avance je l’accepte.
— Avant de vous connaître, monsieur, j’avais fait vœu de chasteté perpétuelle ; je m’étais donnée à Dieu. Ce n’est pas une femme que vous allez épouser, fit-elle en souriant tristement, c’est une religieuse. Je vous demande l’engagement de respecter ce vœu jusqu’au jour où l’Église m’aura déliée.
— Je ne veux vous tenir que de vous-même, répondit simplement Frédéric.
— Vous me permettrez aussi de pratiquer librement, dans toute leur rigueur, mes devoirs de chrétienne ?
— Vous serez souveraine maîtresse dans notre maison.
— Enfin, vous consentirez vous-même à remplir les vôtres ?
— Vous voulez me convertir, dit Frédéric avec enjouement. Hélas ! je dois vous avouer que vous aurez un long chemin à me faire parcourir pour me rendre digne de vous qui êtes une sainte. Au régiment, il est malheureusement aisé d’oublier le catéchisme ; mais vous pouvez être assurée de ma docilité, si elle a pour effet de me donner un jour votre cœur. Et se penchant vers Nicolette, il ajouta : — Je consentirai volontiers à me laisser conduire au ciel, si les portes doivent m’en être ouvertes par un sourire des beaux yeux que voilà.
— Oh ! monsieur ! murmura Nicolette effarouchée et rougissante.
La moustache du lieutenant venait d’effleurer sa joue, et le regard fixé sur elle, de faire passer dans son corps de vierge un frisson inconnu.
— Vous ai-je offensé ? demanda-t-il suppliant.
Elle secoua la tête.
— Non, mais vous m’offenseriez si vous parliez légèrement des choses religieuses. Ce n’est pas pour l’amour de moi que vous devez revenir à vos devoirs oubliés, c’est pour l’amour de Dieu, et pour faire votre salut.
Frédéric inclina le front et resta silencieux. Nicolette crut que la leçon qu’elle venait de lui infliger portait déjà ses fruits, bien loin de se douter que son langage irritait la curiosité de son fiancé, aiguillonnait son désir naissant, et qu’en croyant se dépouiller à ses yeux par la sévérité de ses paroles, de tout attrait et de tout charme, elle s’offrait au contraire comme un fruit savoureux et tentateur. C’était une chose si nouvelle pour Frédéric que cette jeune fille craintive, frêle, timide, qui lui parlait avec des accents d’apôtre et qui, au moment de l’accepter pour maître, lui donnait Dieu pour rival ! Il rêvait déjà de se faire aimer. Il caressait par la pensée toutes les joies que lui réservait l’entreprise. Détourner à son profit les ardeurs passionnées qu’il devinait, entrer en conquérant dans ce jeune cœur, lui inspirer l’amour, n’était-ce pas suave et doux ? Un mot qu’elle prononça le ramena à des préoccupations moins souriantes.
— Je ne vous ai pas parlé de ma sœur, monsieur, dit-elle ; j’estime qu’il est inutile que je vous en parle. Les préoccupations que le passé a pu me faire concevoir ne sont pas encore dissipées ; mais elles me laissent sans crainte pour l’avenir.
— Devrons-nous ne plus voir madame Malivert ? demanda-t-il comme un homme dont la résolution est prise.
— Ce serait éveiller les soupçons de son mari et me priver moi-même d’une grande joie. Non, nous la verrons, et nous entretiendrons avec elle des relations fraternelles. Vous voudrez bien vous souvenir cependant de ce que j’ai le droit d’attendre de vous.
— Mademoiselle, je suis un honnête homme répondit gravement Frédéric.
Il n’y eut pas d’autre allusion au passé. Ils ne voulaient ni l’un ni l’autre en parler longtemps. L’entretien ne roula plus que sur les projets d’avenir. Le mariage était fixé au mois suivant. Après la cérémonie, les nouveaux époux devaient partir pour le Berry, passer leur lune de miel au château de Varimpré, et au retour, s’établir à Tarascon, où un appartement serait préparé pour eux, en leur absence, par les soins de Jacques Malivert.
Quand ils eurent épuisé les confidences qu’ils avaient à se faire, ils revinrent au salon sans s’être dit un de ces mots qui créent entre des fiancés un commencement d’intimité. Frédéric, impressionné par ce qu’il venait d’entendre, convaincu qu’il lui faudrait beaucoup de prudente habileté pour pénétrer dans ce cœur où Dieu régnait seul, dominé peut-être aussi par le souvenir d’Irène, se tenait sur la réserve, n’osait s’abandonner à l’entraînement de sa jeunesse surexcitée par l’étrangeté de la situation. Quant à Nicolette, elle avait senti sur son front un souffle de passion. C’en était assez pour la rendre méfiante et craintive. Elle redoutait, en se livrant trop vite, en montrant trop de confiance, d’encourager des sentiments dont elle était résolu à repousser les témoignages. Elle fuyait l’amour ; elle en avait peur ; elle se roidissait dans un suprême effort de volonté pour demeurer froide et ne donner prise, par aucun côté, à l’attaque qu’elle pressentait.
En les voyant rentrer, Irène se leva souriante, s’avança au-devant de sa sœur qui venait d’abandonner le bras de Frédéric et dit à demi-voix, de manière à être entendue :
— Êtes-vous d’accord, ma chérie ?
— D’accord sur tous les points.
— Il ne pouvait en être autrement, ajouta Frédéric, puisque j’étais résolu d’avance à regarder comme des ordres les désirs de mademoiselle.
— Alors, tout est dit, reprit Irène.
— Tout est dit ; nous nous marions dans un mois.
Une légère pâleur se répandit sur les traits de la jeune femme ; elle sentit monter à ses yeux les larmes qui depuis le commencement de cette soirée gonflaient sa gorge. Mais il fallait dissimuler. Elle fut assez maîtresse d’elle pour y parvenir. Sa sœur se rapprochait de madame de Varimpré. Frédéric seul devina, et feignant de plaisanter avec Irène qui cachait son visage sous son éventail, il murmura à son oreille :
— Ce mariage est votre œuvre. Je n’y consens que parce que vous l’avez ordonné. Mais ma vie est toujours à vous. Dites un mot, et cette nuit, nous partons ensemble…
Il s’était cru obligé de laisser tomber comme une aumône cette dernière preuve d’amour, aux pieds de la pauvre abandonnée. Mais sa déception eût été grande si elle avait prêté l’oreille à ce cri qui cachait un suprême adieu sous une forme passionnée. Soit qu’elle ne s’y fût pas trompée, soit que son repentir fût sincère, elle ne se laissa pas prendre et répondit :
— Nous serions des misérables. Je ne peux plus être pour vous qu’une sœur, Frédéric. Si vous rendez Nicolette heureuse, vous m’aurez donné la seule preuve de tendresse que je veuille désormais accepter de vous.
Elle s’éloigna avant que ce rapide colloque eût attiré l’attention de son mari, et Frédéric se considéra comme délivré. Il voulait de bonne foi se consacrer à ses nouveaux devoirs, oublier Irène et se faire aimer de Nicolette. L’œuvre était difficile ; mais il ne désespérait pas d’y réussir. Il avait les illusions de sa jeunesse ; il se flattait de l’espoir d’avoir su plaire dès cette première entrevue et d’obtenir, à force d’attentions et de soins, tout ce qu’on semblait si peu disposé à lui accorder. Cet espoir, et sa confiance en lui-même, le rendirent séduisant durant les visites qui suivirent. Il venait tous les soirs faire sa cour à Nicolette. A l’accueil qu’il rencontrait, il croyait comprendre que, quoique fermé à l’amour, ce cœur fier et dédaigneux n’était pas invincible.
Il ne se doutait pas qu’après son départ, Nicolette, agenouillée dans sa chambre jusqu’à une heure avancée de la nuit, procédait à un scrupuleux examen de conscience, se reprochait comme une faute la complaisance qu’elle avait mise à écouter les galants propos de son fiancé, à subir le charme de son esprit, à admirer sa mâle beauté ; que dans le silence de ses veilles, elle s’accusait comme d’un crime de sa faiblesse, de la facilité avec laquelle, en présence de Frédéric, elle se consolait de la perte de son divin amant. C’était comme un effort désespéré pour retenir les regrets qui se dissipaient, pour les retenir par la prière, par la méditation, par les pénitences qu’elle s’imposait, pour ramener sous le frein de la discipline son cœur rebelle et transformé jusqu’à prendre plaisir à ce nouvel état, qui d’abord ne lui avait inspiré que de l’horreur.
Pendant la semaine qui précéda la célébration de son mariage, elle disparut, après avoir averti Frédéric, et passa trois jours en retraite au couvent des Carmélites. Au moment de mettre entre elle et le cloître un infranchissable obstacle, elle avait voulu s’imprégner, en une fois, de toutes les joies auxquelles elle allait renoncer. Pendant ces trois jours, elle vécut de la vie des religieuses. Quoique séparée d’elles par l’inflexibilité de la règle, elle assista à leurs offices, se conforma à leurs rigoureux devoirs, s’imposa leurs veilles et leurs privations. Elle demeura prosternée durant toute une nuit devant le Saint Sacrement offert à l’adoration des Carmélites. Elle répandit des larmes aux pieds de son Sauveur, lui promit de n’oublier jamais qu’elle avait été sur le point d’embrasser son service, et condamnée à rester dans le monde, d’en repousser les séductions afin de se rapprocher autant qu’elle le pourrait, et malgré les périls qu’elle y rencontrerait, de la perfection des saintes créatures dont elle enviait le sort sans pouvoir les imiter. Elle voulait au moins être un exemple, et en travaillant à son propre salut, contribuer à celui des autres.
Le matin du jour où elle devait quitter le couvent, elle descendit à la chapelle, en même temps que les religieuses. Elle entendit la messe et communia, l’âme exaltée, le corps exténué par le jeûne auquel elle s’était astreinte. Sa prière sortait de ses lèvres tremblantes au milieu des larmes que le regret lui arrachait. Enfin, dans un mouvement de sainte folie et de sacrifice, elle offrit à Dieu sa douleur, acceptant comme un châtiment la volonté qui la chassait de ces lieux si tendrement aimés. Ce fut son dernier adieu au Carmel. Il ne précédait son mariage que de quelques jours.
Les cloches de la grande église de Beaucaire sonnent à toute volée ; sur les degrés du temple, la foule se presse bruyante, pour voir arriver la noce. Il est dix heures ; le ciel est pur, le soleil radieux. Par les portes ouvertes, on aperçoit au fond du chœur, parmi les fleurs répandues à profusion, l’autel illuminé, un tapis jeté sur les marches, deux prie-Dieu recouverts de velours rouge. La blancheur luisante des marbres, les ors des décorations, les découpures des dentelles, la variété des couleurs confondues, resplendissent dans la lumière.
Du chœur jusqu’à la porte, les invités déjà placés laissent entre eux un large passage pour le cortége ; dans ce passage, se promène, important et fier, le suisse, hallebarde au poing, épée au côté, plumet au chapeau. Parmi les invités, les officiers du 25e hussards, venus de Tarascon, le colonel à leur tête, pour faire honneur à leur camarade ; dans une des nefs latérales, la fanfare du régiment. A travers la rumeur confuse qui monte jusqu’aux voûtes, on entend des éclats d’instruments, des notes résonnantes arrachées aux cuivres par les musiciens qui préludent au morceau qu’ils vont jouer tout à l’heure.
Tout à coup, le bruit du dehors s’élève, grossit, devient tumultueux, couvre celui du dedans. La noce arrive ; la foule groupée aux portes l’acclame. L’une après l’autre, les voitures viennent se ranger devant le perron. Sur le seuil, sous l’arcature de la porte encadrant un large morceau de ciel bleu, les invités voient se dresser la fine silhouette de mademoiselle Nicolette Suarez. Elle s’appuie au bras de son beau-frère, Jacques Malivert. La fanfare entonne une marche triomphale ; le cri strident des trompettes imprime aux vieilles murailles une longue vibration, électrise les assistants, donne aux physionomies des airs belliqueux et plisse les lèvres dans un sourire de chauvinisme attendri.
Traînant derrière soi un flot de satin, le front penché sous les regards qui la dévisagent, Nicolette s’avance, tremblante, plus blanche en sa pâleur que sa couronne de fleurs d’oranger. Écrasée par l’émotion, elle s’agenouille devant l’autel et s’abîme dans une prière ardente. Quand elle relève la tête, l’abbé Cardenne est debout devant elle. Il commence une allocution simple, d’une éloquence touchante, que Nicolette écoute toute bouleversée, en se souvenant que la bouche qui lui retrace aujourd’hui les devoirs du mariage et lui prêche la soumission, la fidélité à son mari, lui retraçait naguère les devoirs de la vie religieuse, lui vantait le bonheur des vierges qui s’immolent à l’amour divin.
Quand l’allocution est terminée, l’officiant descend les degrés de l’autel, s’avance vers les époux. Il s’adresse d’abord à Frédéric, qu’il interroge et qui lui répond. Puis il s’adresse à Nicolette. Elle sent son cœur défaillir quand elle l’entend lui dire :
— Acceptez-vous pour légitime époux M. Frédéric de Varimpré ici présent ?
— Oui, répond-elle, d’une voix expirante.
Elle s’agenouille en laissant tomber sa main glacée dans la main de Frédéric. La bénédiction nuptiale descend sur leurs fronts courbés. A quelques pas d’eux, Irène debout, fière et belle, toute resplendissante dans la toilette rose qui avive l’éclat de son teint et l’or de ses cheveux, écoute, et regarde, en apparence impassible, dissimulant sous un sourire le frémissement de ses lèvres, seule manifestation extérieure de la torture que subit son cœur.
Parti de Tarascon dans la soirée, le train roulait depuis plusieurs heures. Montant lentement dans la nuit profonde, de pâles lueurs d’aurore blanchissaient le ciel, dentelaient de teintes roses les montagnes de l’Ardèche aux pieds desquelles coule le Rhône.
Blottie dans un coin du wagon-lit où elle avait pris place avec Frédéric, le front appuyé à la vitre voilée de buée, Nicolette, que le sommeil fuyait obstinément, laissait errer ses regards à travers le paysage. Sur la plus grande partie du parcours, la voie longe le fleuve. La masse lourde des eaux, sous le clair de lune, descendait entre les berges, argentée et miroitante, balafrée dans sa longueur d’une estafilade lumineuse, qui s’éteignait peu à peu, au fur et à mesure que se dissipait la nuit.
La fatigue de l’insomnie pesait sur Nicolette, pâlissait son visage, assombrissait l’éclat de ses yeux. De temps en temps, elle les tournait vers Frédéric. Étendu sur le lit tiré des parois du wagon, il dormait. Au départ de Tarascon, au début de ce long tête-à-tête qui lui livrait sa femme et du mettait à sa discrétion, il s’était efforcé de plaire, de se montrer tendre pour lui arracher un sourire. Mais, toute vibrante des émotions de cette journée de noces ; douloureusement impressionnée par la tristesse des derniers moments passés avec Irène ; défiante encore, quoiqu’elle se fût départie de sa sévérité en le connaissant mieux, contre ce mari qui représentait toujours pour elle le tentateur, elle avait si froidement accueilli ses avances, que, rebuté presque aussitôt et fidèle au rôle qu’il voulait garder, il s’était installé pour dormir, en l’engageant à en faire autant.
Sous le tremblant rayon de la lanterne, affaibli par le rideau tiré, tamisant une lumière adoucie, elle l’apercevait immobile et les yeux clos, paisible dans son sommeil comme un enfant.
— Il est donc sans remords ? se demandait-elle en pensant aux événements qui avaient précédé le mariage. A cette question qui s’imposait, sa mémoire lui rappelait qu’avant de la conduire à l’autel, Frédéric s’était confessé. — En descendant dans son cœur, pensait-elle, l’absolution prononcée par le prêtre y a porté la paix. Il est en état de grâce ; voilà pourquoi il est calme.
Dans son repos, Frédéric gardait une mâle attitude. Son fin profil se dessinait sur l’ombre ; la moustache coupait la rectitude des lignes sans en altérer la pureté ; le corps abandonné révélait, même en cet état, la vigueur des membres et la grâce des mouvements. Cette contemplation éveillait dans le cœur de Nicolette des pensées troublantes. Elles activaient la circulation de son sang, embrasé tout à coup dans un mouvement d’effroi et d’inconscient désir, dominé par l’attrait de l’inconnu, comme si elle eût senti, femme avant d’être sainte, un aiguillon de curiosité à la surface de sa chair et interrogé malgré elle le mystère qu’elle ne voulait pas connaître. Alors, fiévreuse, irritée, elle ramenait son regard au paysage pour y chercher l’apaisement, en même temps qu’une prière s’élançait de ses lèvres frémissantes.
Au petit jour, Frédéric s’éveilla.
— Je crois que j’ai dormi, fit-il tout haut, en se redressant.
— Vous dormez depuis onze heures, reprit doucement Nicolette sans se retourner.
— Et vous ?
— Moi, j’ai regardé les étoiles, les montagnes et l’eau.
— Il fallait m’appeler, mon amie ; je vous aurais tenu compagnie.
Elle garda le silence, un peu émue par l’affectueuse expression de cette phrase où pour la première fois, depuis qu’ils étaient mariés, s’affirmait l’intimité naissante. Tout à coup, elle tressaillit. La moustache de Frédéric venait d’effleurer son cou ; elle avait senti à la racine des cheveux le contact des lèvres toutes chaudes.
— Je vous en prie, murmura-t-elle, en se rejetant dans l’angle du wagon.
— Pardonnez-moi, répondit Frédéric avec douceur ; c’est bien peu de chose, cela, le moindre de mes droits… ne vous offensez pas… N’ai-je pas été docile jusqu’ici ?
— Il faut l’être toujours.
Elle prononça ces mots à demi-voix, sans colère, obligée de reconnaître que le mari tenait toutes les promesses du prétendu, pénétrée de gratitude pour la timidité dont en ce moment même, son obéissance fournissait un nouveau témoignage. Il ne répondit pas. Mais comme il se mettait debout lestement pour replier le lit sur lequel il avait dormi, elle l’entendit qui murmurait railleusement :
— Singulière nuit de noces !
Ce fut tout. Il élevait le bras pour prendre dans le filet son nécessaire de voyage. Il l’ouvrit, en tira un peigne qu’en un tour de main, il passa dans ses cheveux. Puis, il déboucha un flacon revêtu d’osier, et dans une petite timbale d’argent, versa du vin de Malaga qu’il offrit à sa femme, en disant :
— Prenez ceci ; il faut se mettre en état de résister aux malsaines influences des brouillards du matin. Elle refusa d’un geste. — Je vous en prie, supplia-t-il. Vous ne pouvez me refuser. Ordonnance du médecin.
Elle accepta et but. Lentement, un chaud bien-être succédait au malaise qu’elle subissait tout à l’heure, au frisson causé par sa lassitude et ses anxiétés. Quand elle eut fini, il but à son tour. Mais, avant, il dit gaiement :
— Vous savez que je vais connaître votre pensée.
— Oh ! cela, je vous en défie, par exemple, répliqua-t-elle, désireuse d’encourager cette bonne humeur qui résistait à la rigueur de son attitude.
— Vous me défiez, s’écria-t-il avec gravité. Eh bien, écoutez. En buvant, ma chère sainte s’est reproché le plaisir qu’elle y prenait, et involontairement, elle a songé aux Carmélites qui abandonnent en ce moment leur dure couchette, brisées et l’estomac vide, pour descendre à la chapelle, où elles vont chanter les louanges du Seigneur. N’est-ce point cela ? C’était vrai : elle l’avoua décontenancée, tandis que s’asseyant auprès d’elle, il continuait : — Évitez ces rapprochements, Nicolette ; épargnez-vous les regrets. Tant que je les sentirai s’agiter en vous, je me considérerai comme un criminel ; je croirai que vous refusez obstinément d’être heureuse près de moi, et je serai bourrelé de remords, en m’accusant d’avoir fait votre malheur.
L’accent de cette supplication remua Nicolette. La sympathie qui, malgré sa résistance, la poussait vers Frédéric eut raison de ses résolutions, soit qu’elle fût touchée par la bonne grâce de son mari, comme par sa patience, soit qu’elle se résignât à céder maintenant pour être en état de mieux résister plus tard. Elle laissa tomber sa main dans la main tendue vers elle, et dit :
— Ne m’en veuillez pas, mon ami ; votre délicatesse aura raison des regrets qu’involontairement je vous laisse surprendre, et si je ne puis être jamais pour vous une femme assez oublieuse de ses vœux passés pour répondre, comme vous le voudriez, à votre amour, vous trouverez en moi une compagne dévouée et reconnaissante.
Était-ce un encouragement ? Frédéric le comprit ainsi. Sa jeunesse provoquée fut plus forte que ses promesses. Il étreignit avec ardeur Nicolette et l’embrassa, en murmurant :
— Ma chère femme !
Ce fut involontaire et spontané. Nicolette ne protesta pas. Mais elle resta comme écrasée. Lorsque quelques instants plus tard, le train arrivait à Lyon, son émotion et son trouble n’étaient pas encore dissipés.
Ils ne firent à Lyon qu’un arrêt de quelques instants, sans quitter la gare. Ils voulaient arriver à Sancerre le même soir. Quand ils remontèrent en wagon, Nicolette, délassée par cette halte matinale, rassurée maintenant, comprenant qu’elle n’avait rien à redouter de son mari, respira plus librement. Le train se mit en marche pour gagner le Bourbonnais. Elle avait repris sa place, après avoir ôté son chapeau et jeté sur ses cheveux une voilette noire. Le sang avivé par la fraîcheur de l’air mettait sur ses joues, à fleur de peau, des teintes roses. Le regard exprimait de nouveau la sérénité de son âme. Sur son visage amaigri, la beauté commençait à poindre. Frédéric, qui s’y connaissait, devinait qu’avant peu, retrempée dans une vie nouvelle, délivrée des mortifications auxquelles jusqu’à ce jour elle s’était astreinte, elle serait jolie. Il éprouvait un piquant plaisir à penser que c’est lui qui, enveloppant de son amour cette créature frêle et défiante, ferait épanouir la fleur de grâce en germe dans la jeune fille.
Il s’était assis auprès de sa femme. Il tenait la main qu’elle lui abandonnait, indifférente en apparence, mais en réalité heureuse de se sentir déjà dominée. C’était une sensation toute nouvelle, d’une incomparable suavité, comme si elle eût vu s’élever peu à peu autour d’elle un abri doux et chaud, et pris plaisir à s’y laisser faire prisonnière, Elle subissait, à son insu, le charme de Frédéric. Son âme de dévote s’ouvrait à la séduction de l’homme, qui trouvait là pour s’y exercer un sol déjà fécondé par les mystiques ardeurs de la chrétienne. Dans son cœur défaillant et troublé, l’amour humain se substituait à l’amour divin. Singulière métamorphose, résultat d’une nuit d’insomnie passée par Nicolette près de ce mari jeune et beau, qui n’attendait qu’une parole pour se jeter à ses pieds.
Ils demeurèrent longtemps ainsi, pressés l’un contre l’autre, silencieux. Mais comme le train s’enfonçait dans un tunnel, Nicolette sentit, sous l’étreinte caressante qui la dominait, monter un flot de passion. De nouveau, ce fut un soupir suivi d’un baiser. Elle se dégagea doucement. Frédéric, toujours docile, n’essaya pas de s’imposer ; et même, comme s’il eût voulu se faire pardonner son audace, il se mit à parler avec volubilité. Au sortir du tunnel, il ne parut occupé que de montrer à sa femme le site sauvage dont ils traversaient les profondeurs entre des montagnes escarpées.
L’entretien commencé se continua, durant tout le voyage. Frédéric était instruit, sa parole facile et chaude. Il avait voyagé ; les grandes excursions scientifiques formaient le principal objet des études auxquelles il consacrait les longs loisirs de la vie de garnison. Il lui fut aisé de captiver jusqu’au soir l’attention de sa femme, d’exciter son intérêt ; elle l’écoutait, charmée, heureuse de se convaincre qu’elle avait épousé un homme studieux, à l’esprit vif et ouvert, et touchée par-dessus tout de la docilité dont il faisait preuve. C’est par cette docilité que Frédéric trouvait le chemin de son cœur. Elle en était attendrie, agitée intérieurement de ne pouvoir demeurer fidèle aux promesses qu’elle s’était faites, sans causer un chagrin à ce mari si doux et si bon.
La soirée était avancée déjà quand ils arrivèrent à Sancerre. Une voiture envoyée de Varimpré les attendait à la gare. A l’extrémité de la ville endormie, elle traversa un pont jeté sur la Loire, et au delà de ce pont s’engagea sur une route déserte. La curiosité tenait Nicolette éveillée. Elle savait déjà que le château de Varimpré, situé sur la lisière du Berry, dans une contrée d’aspect grandiose et mélancolique, était une antique construction, à physionomie féodale. C’est là, dans son pays natal, que Frédéric, au temps déjà lointain où, enfant, il suivait ses parents dans les garnisons, venait passer ses vacances. Ces lieux dont il parlait avec enthousiasme étaient pour lui remplis de souvenirs. Durant le voyage, il en avait entretenu Nicolette, en lui promettant de les interroger avec elle, afin qu’elle partageât les émotions du passé, qu’il voulait faire revivre. Par la pensée, Nicolette se voyait déjà aux termes de la route, dans cette maison qui serait un jour sa maison, et dont elle allait pouvoir, dès ce moment, se croire maîtresse, les parents de Frédéric ne devant y rentrer qu’au bout de quelques semaines, afin d’y laisser les époux libres et seuls, dans l’épanouissement de leur jeune bonheur. C’est là qu’elle vivrait près de son mari, elle n’osait dire près de ses enfants, bouleversée par l’émotion, au fur et à mesure qu’elle voyait approcher l’heure où éclaterait la lutte entre ce qu’elle considérait comme un devoir et ce qu’elle devinait être l’amour.
Vers onze heures, la voiture s’arrêta au milieu d’un parc, devant un étroit perron accédant à un vestibule voûté. Dans l’obscurité, Nicolette ne vit rien que des arbres, une pelouse, une masse confuse de constructions. Sous le vestibule, deux vieux domestiques, un homme et une femme, lui souhaitèrent la bienvenue. Frédéric les embrassa. Puis, sans s’arrêter au rez-de-chaussée, il fit monter Nicolette au premier étage, par un escalier pratiqué dans une tour. A l’extrémité d’un couloir, une porte était ouverte. Nicolette entra la première et se trouva dans une vaste chambre, tendue de vieilles tapisseries à personnages, meublée avec un luxe de bon goût, où se devinait la main d’un habile ouvrier. Au milieu de la chambre, un lit large et bas, entre des rideaux de couleur claire ; suspendue au plafond, une veilleuse ; dans la cheminée, un feu clair, jetant sur les murailles sa lumière joyeuse ; un nid adorable pour l’amour.
— C’est notre appartement, dit Frédéric.
— Vous avez fait des folies pour moi, répondit Nicolette tremblante, regardant autour d’elle, les joues brûlées par le sang qui brusquement venait d’y monter.
Frédéric sourit et reprit :
— Fallait-il mettre ma chère femme dans une cellule de carmélite ? Elle garda le silence, se demandant s’il allait vouloir rester là, exercer déjà ses droits de mari, au mépris de ses promesses. Comme s’il eût compris sa pensée, il ajouta : — Vous êtes ici chez vous. Voici votre cabinet de toilette, et ici la porte de ma chambre. Il l’ouvrait tout en parlant. Nicolette aperçut une étroite pièce, avec un petit lit de fer. — C’est ici que je couchais quand j’étais enfant, reprit-il, ici que je coucherai, tant que ma femme exigera que je reste loin d’elle.
Nicolette fut vaincue par ce trait, où de nouveau apparaissait cette délicatesse que depuis la veille elle mettait à l’épreuve.
— Vous êtes bon, murmura-t-elle, merci.
— Je subirai sans me plaindre, et toujours si vous l’exigez, le martyre que vous m’imposez, Nicolette, répondit Frédéric. Mais vous ne pouvez me défendre d’espérer, vous ne pouvez me défendre de croire que votre rigueur ne sera pas éternelle. Cela, vous ne pouvez pas plus me le défendre que vous ne pourriez, sans méconnaître vos devoirs d’épouse, exagérer longtemps vos devoirs de chrétienne. J’espère donc et j’attends le bonheur de votre bonté et de mes efforts pour vous plaire. Comme elle ne répondait pas, il la prit par la main, et la ramenant dans le cabinet de toilette qui séparait les deux chambres, il lui montra à la porte de ce cabinet un verrou. — Ce verrou n’était pas nécessaire pour vous protéger contre l’ardeur de mon amour, continua-t-il ; votre volonté aurait suffi. Mais il nous épargnera à moi des supplications qui pourraient vous déplaire, à vous une résistance pénible. Chaque nuit, comme un amoureux jamais découragé, je pousserai cette porte… et si elle résiste, je m’éloignerai. Je vous ai dit que je ne veux vous tenir que de vous.
— Pardonnez-moi, si vous souffrez à cause de moi, soupira-t-elle ; mais rappelez-vous…
— Plus un mot, s’écria-t-il ; je n’oublie pas… Allons souper.
Ils descendirent au rez-de-chaussée, où le repas était servi au coin du feu dans la salle à manger de famille. Délivrée de toute crainte, confiante dans l’avenir, déjà faite à son nouvel état, Nicolette s’abandonna librement au bien-être de cette intimité charmante, à la joie de se sentir aimée, sans qu’il en coûtât rien à sa conscience. Pour la première fois, depuis qu’il la connaissait, Frédéric vit sur les lèvres de sa femme un sourire sans contrainte. Il ne s’y laissa pas prendre cependant ; il se défiait encore, il craignait d’effaroucher la chère sensitive. Il était moins pressé de mordre au bonheur que désireux de le goûter sans faire couler des larmes.
Le souper fini, il ramena Nicolette dans son appartement ; et comme elle restait debout devant lui, embarrassée et craintive, il l’embrassa en murmurant :
— Bonne nuit, ma chère femme ; à demain. Et surtout, ajouta-t-il en montrant la porte, n’oubliez pas.
Il sortit sans manifester aucun regret. Vivement, Nicolette poussa le verrou et rentra dans sa chambre, secouant la tentation dont elle venait de sentir le premier trait, à la minute même où son mari s’était séparé d’elle. Une fois seule, elle fit rapidement sa toilette pour la nuit ; puis elle s’agenouilla, pria longtemps sans ferveur, un peu lasse, l’esprit troublé par des pensées confuses, à travers lesquelles revenaient les souvenirs du voyage dont les paisibles incidents lui avaient appris à connaître son mari. Enfin, elle se coucha, avec l’espoir qu’elle allait trouver le sommeil. Mais trop de sensations nouvelles l’agitaient.
Pouvait-elle dormir, alors qu’à quelques pas d’elle, de l’autre côté de cette porte close, grondait la passion qui tour à tour l’avait attirée et épouvantée ? Après tout, il lui appartenait, ce mari jeune et beau ; c’était son bien à elle, comme elle était son bien à lui ; elle avait juré de lui obéir. Attendrait-elle qu’il ordonnât ? Et si, rebuté par sa rigueur, il n’ordonnait jamais ! s’il retournait à Irène, si quelque catastrophe éclatait, sur qui retomberait la responsabilité de l’événement, sur qui, sinon sur la femme dont la résistance l’aurait provoqué ? L’époux et l’épouse doivent être une seule et même chair ; c’est la loi du mariage. Cette loi, quelles promesses, quels vœux étaient assez forts pour lui permettre de s’y dérober ?
Et tandis que ces questions se formulaient dans son esprit, sous l’influence de l’amour qui se dégagerait de ses souvenirs, un brûlant désir sourdement s’allumait dans son corps de vierge. Son âme, accoutumée à pousser vers Jésus le bien-aimé des prières ardentes et de fiévreux soupirs, exhalait vers l’amant désiré et redouté les mêmes soupirs et les mêmes prières, confondus dans un cri, dans un appel désespéré. L’appel, c’est la détresse de la femme déjà vaincue, qui le proférait, se raccrochant encore aux engagements du passé, suppliant le protecteur des faibles de ne pas l’abandonner ; le cri, c’est l’épouse qui le poussait, avide de sentir sur ses lèvres le miel du baiser, ciment des chaînes amoureuses dont elle voulait maintenant sentir à travers ses sens embrasés les douces meurtrissures.
Ainsi s’évanouissaient les résolutions énergiques de Nicolette. La tentation montait autour d’elle, mettait devant ses yeux l’image de son mari, désormais plus éloquente que l’image du Sauveur. Elle se voyait dans ses bras, se sentait emportée dans sa tendresse ; il lui semblait que sa tête allait se presser contre cette poitrine robuste pour deviner à travers les battements d’un cœur d’homme la science de l’amour. Ce violent désir revêtait, en s’accentuant, la physionomie des choses illicites. Il exerçait sur l’âme de Nicolette le même attrait que le péché ; il lui causait les mêmes terreurs ; il ouvrait à son imagination le ciel et l’enfer à la fois. Elle redoutait en même temps d’offenser Dieu en aimant son mari, et de perdre son mari en lui préférant Dieu, et dévoyée, ballottée, secouée par tant d’entraînements contraires, elle épuisait dans cette lutte l’énergie de la résistance.
Tout à coup, elle crut entendre à la porte de sa chambre, du côté de celle de Frédéric, un bruit de pas, une pression contre la boiserie. Elle prêta l’oreille. Dans une vision rapide, elle embrassa d’un seul coup la déception de son mari, sa colère, les suites de son ressentiment ; une angoisse cruelle lui fit au cœur une morsure ; elle eut peur, peur de détruire en un instant le bonheur de l’avenir, peur de ne connaître jamais l’amour, peur surtout de perdre l’amant. En une minute, Dieu fut vaincu, oublié… Dans le silence lourd qui pesait sur la maison, s’éleva de la bouche de Nicolette un gémissement, suprême manifestation de ses craintes désormais dissipées ; elle se jeta hors de son lit ; sous la lueur pâle de la veilleuse, elle traversa, affolée, courant les pieds nus, la chambre et le cabinet de toilette, tira le verrou bruyamment, et revint se coucher, des désirs pleins les sens, de la passion plein le cœur, anxieuse, frissonnante, craintive comme si elle avait commis un crime.
Ce fut pendant quelques semaines une frénésie de bonheur. Nicolette s’était donnée, dans l’entraînement de son cœur et de ses sens, emportée par sa jeunesse, par la curiosité de la femme. Elle s’abandonnait à son ivresse, vaincue par la passion de son mari. Après l’avoir jetée dans un tourbillon de désirs ardents et surexcités, cette passion l’enveloppait, ne lui laissait ni repos ni répit, la ramenait toujours aux bras de l’homme à qui elle devait de connaître la douceur d’aimer.
La fougue de son âme exaltée l’avait poussée jadis toute jeune au pied du crucifix ; elle se manifestait maintenant sous une forme nouvelle. C’était une autre nature se révélant dans sa personne, substituant à la vierge craintive, vouée au ciel, la femme possédée d’amour, heureuse de se donner. Elle ne se souvenait plus des circonstances qui l’avaient contrainte à épouser Frédéric. Ses défiances s’étaient évanouies sous les protestations ardentes qui la laissaient extasiée. Le premier baiser l’avait désarmée, en lui montrant au delà des rigueurs du cloître l’horizon sans fin d’une tendresse partagée. Elle voulait être heureuse, heureuse par ce mari qu’elle devinait sincère et qui lui répétait à satiété qu’il ne cesserait jamais de la chérir.
Ces heures furent délicieuses. Chaque matin les ramenait plus sereines, plus fécondes en espérances ; chaque soir des ramenait plus brûlantes, et la félicité des époux revêtait le caractère de celle des amants. C’étaient tous les jours de longues promenades dans les champs, pleines de charme, les mille détails de la vie du foyer, embellis par la confiance mutuelle, l’étreinte de tous les instants, rendue plus étroite par le désir sans cesse ravivé ; puis, le soir venu, le lent attendrissement qui précède le repos des êtres et des choses, se communiquant aux cœurs, les préparant aux nuits amoureuses. Quand Frédéric et Nicolette, après ces journées trop courtes, se retrouvaient seuls dans leur chambre, leurs lèvres altérées se rapprochaient ; et l’amour recommençait, comme s’ils eussent repris au point où ils l’avaient laissé la veille, la lecture du livre éternel qu’ils épelaient ensemble.
C’est à ce moment que parfois un vague remords s’élevait dans l’âme de Nicolette, sans qu’elle parvînt à s’en défendre.
— Est-ce bien moi qui suis ici ? se demandait-elle, entre les bras qui la pressaient, éperdue et subjuguée.
Sa conscience parlait ; lui rappelait les vœux oubliés, lui demandait si le mariage l’avait à jamais dégagée, si quelque jour elle n’aurait pas à rendre compte de cet oubli. Elle se roidissait contre ce reproche ; elle se jetait plus profondément dans l’amour pour étouffer ses remords. Vis-à-vis d’elle-même, elle plaidait la légitimité de son bonheur. Mais, quoi qu’elle fît, elle ne pouvait empêcher que le reproche un moment apaisé ne ressuscitât, ne la poursuivît jusque dans son rêve, auquel il donnait le caractère d’une faute dont, tôt ou tard, il faudrait se repentir et entreprendre l’expiation. Alors elle détournait ses yeux, fermait ses oreilles ; elle ne voulait pas voir ; elle refusait d’entendre ; toute sa vie était dans l’amour ; le sourire de son mari avait pour elle plus de prix que ne pouvait avoir d’efficacité la revendication du passé.
Dans cette lutte, sa pieuse ferveur tombait, sa dévotion s’attiédissait ; elle négligeait ses devoirs religieux, n’en pratiquait plus que l’indispensable ; les prières que proféraient ses lèvres distraites ne possédaient plus le pouvoir de faire de son salut éternel le but principal de sa vie.
Un événement douloureux troubla tout à coup ce bonheur suave, en abrégeant la durée du séjour que Frédéric et Nicolette comptaient faire à Varimpré. Ils étaient mariés depuis deux mois, lorsqu’un matin, une dépêche d’Irène leur apporta la nouvelle de la mort de Jacques Malivert. En parcourant, ainsi qu’il le faisait tous les jours, une des carrières qu’il exploitait aux portes de Beaucaire, un faux pas l’avait précipité tête en avant sur un rocher. Il s’était tué sur le coup. Irène suppliait sa sœur de hâter son retour. Il fallut partir.
Ce fut avec un cruel serrement de cœur qu’elle abandonna Varimpré. Dans la solitude, elle venait de goûter tant d’innombrables joies ! Les retrouverait-elle ailleurs ? La vie, en la reprenant, n’allait-elle pas la livrer à des perplexités, à des angoisses, et troubler sa quiétude ? Et puis, une crainte s’éveillait dans son esprit. Elle ne doutait pas, elle ne voulait pas douter de son mari ! Mais si de nouveau il allait aimer Irène ; concevoir, en la retrouvant libre, le regret d’avoir enchaîné si vite sa propre liberté ! Si ce regret, Irène allait le partager ! Elle repoussait avec horreur ces terribles questions. Elle refusait de croire à des catastrophes nouvelles. Elle se rattachait avec énergie à l’espoir d’un bonheur sans fin. Mais la jalousie lentement se glissait dans son cœur, alarmait sa tendresse, troublait sa confiance inébranlable jusque-là.
C’est torturée par ces doutes qu’elle arriva à Beaucaire. Sa première entrevue avec Irène fut dominée par la tristesse de celle-ci. Mais il était aisé de comprendre que la mort de Malivert n’atteignait pas la jeune veuve jusqu’aux sources d’où jaillit la douleur qui dure, et qu’elle se consolerait bientôt. Cette conviction, acquise en peu de jours, accrut le trouble de Nicolette. Elle redoubla de soins affectueux pour Frédéric, tout en se faisant violence pour demeurer auprès d’Irène. Elle n’eut de repos que lorsque, après s’être consacrée à elle pendant quelques jours, habitant sous son toit, ne la quittant jamais, vivant de sa vie, il lui fut permis de s’installer à Tarascon dans la maison louée par son mari.
Séparée de sa sœur, allant la voir seule, l’attirant peu, la mettant rarement en présence de Frédéric, elle crut avoir écarté tout péril. Frédéric avait repris ses occupations de soldat. Il était studieux, s’appliquait aux choses de son état, à d’autres encore ; ses loisirs étaient remplis ; il ne faisait trêve à ses travaux que pour prodiguer à sa femme les témoignages de son amour. Il fuyait loyalement les occasions de se rapprocher d’Irène. Il entendait demeurer fidèle à celle dont la tendresse, répondant à la sienne, l’avait captivé ; il voulait même éviter de troubler sa sérénité.
Mais le soin qu’il y mettait démontrait qu’il n’était pas guéri, que le danger qui lui faisait peur restait encore redoutable. Avec plus d’expérience, Nicolette l’eût deviné. Malheureusement, elle ignorait les surprises de la passion. Elle ne comprit pas ; elle ne vit rien au delà du présent, et se crut à l’abri du malheur.
La nuit venait. Le vent du Rhône soufflait avec fracas à travers les rues de Beaucaire. Il montait autour du rocher dont le couvent des Carmélites couronne la cime ; il enveloppait de ses rafales froides et poussiéreuses les murailles assombries, et se brisait en longs gémissements aux vitraux de la petite chapelle. Au milieu de la nef étroite, Irène se tenait assise vêtue de noir, toute pâle sous ses voiles de veuve. Elle attendait sa sœur qu’elle avait accompagnée au couvent. Depuis plus d’une heure, elle l’apercevait agenouillée dans le confessionnal, les lèvres collées à la grille de bois, au delà de laquelle l’abbé Gavella prêtait l’oreille aux aveux de sa pénitente.
Désigné pour succéder comme aumônier des Carmélites à l’abbé Cardenne, le jour où ce prêtre doux et tolérant s’était laissé nommer vicaire général du diocèse de Nîmes, l’abbé Gavella arrivait d’Espagne. Pendant l’insurrection carliste, on l’avait vu dans les bandes du prétendant, tour à tour prêtre et soldat, faire le coup de feu comme un simple partisan, ou donner l’absolution à ceux que sa fanatique éloquence conduisait à la mort. L’insurrection vaincue, pour sauver sa tête mise à prix, il s’était réfugié en France. Conduit à Beaucaire par les hasards de sa fuite, y trouvant libre encore la place laissée vacante par l’abbé Cardenne, il l’avait sollicitée et obtenue.
Aux approches de Noël, Nicolette était venue se confesser à ce prêtre sans le connaître. Elle désirait se réconcilier avec Dieu qu’elle se reprochait d’oublier. Maintenant, après avoir longuement parlé et répondu aux questions inquisitoriales du confesseur, elle écoutait, tremblante, ses remontrances et ses conseils. Il s’exprimait durement. Dans sa bouche, les avis prenaient des airs de menaces. Il était de ces prêtres qui savent mieux traduire la colère du ciel que sa clémence, mieux décrire les peines éternelles que les récompenses promises aux élus. Les larmes qu’il faisait couler étaient des larmes d’effroi, et non des larmes de repentir.
De la place où elle se trouvait, bien qu’il eût laissé la porte du confessionnal entr’ouverte, Irène ne pouvait le voir ; mais elle entendait les éclats de sa voix, quelques-uns des mots rudes que son accent revêtait d’une forme bizarre. Elle devinait les violents reproches qu’il adressait à Nicolette. Au fur et à mesure que le temps passait, elle tournait du côté de sa sœur ses yeux où éclatait son inquiétude aggravée par la durée de cette confession.
Tout à coup, un bruit sec traversa le silence de la chapelle. La grille du saint tribunal venait de se fermer ; le confesseur sortait pour regagner la sacristie. Il marchait à grands pas, balançant ses bras, autour desquels s’agitaient, comme des ailes, les larges manches du surplis. Sa maigreur d’ascète, son front bas, étroit, sillonné de rides profondes, l’éclat sombre de ses yeux qu’il tenait baissés, mais dont la flamme trouait ses paupières, la dureté rugueuse de ses traits, rendue plus sensible par la coloration du teint violacé, donnaient à sa physionomie un aspect redoutable. Son cou, ses épaules de portefaix, révélaient la vigueur sauvage de cet apôtre étrange, tout violence et tout emportement, qu’on ne pouvait se figurer baissant la tête sous les coups du destin et se résignant à les subir sans révolte. Par larges enjambées, il franchit la distance qui séparait le confessionnal de la sacristie, d’un mouvement à la briser poussa la porte, et disparut, avant même que la boiserie du chœur eût cessé de trembler sous la pression de ses pieds.
Alors, Nicolette quitta la place où, comme une martyre, elle venait d’être soumise à un odieux supplice, obligée de livrer à son juge les secrets de son cœur. Défaillante, elle se traîna jusqu’à la chaise que lui gardait Irène. Elle tomba là, brisée, exténuée, n’en pouvant plus. La chapelle était solitaire ; sur l’autel, des cierges s’allumaient, perçaient de leur lueur pâle l’ombre agrandie ; de l’autre côté de la grille claustrale, les religieuses commençaient l’office du soir ; leur psalmodie monotone montait glacée jusqu’aux voûtes au-dessus desquelles le vent leur répondait, en imprimant aux tuiles une bruyante vibration.
— Sais-tu que tu es restée là plus d’une heure, ma chérie ? dit Irène à voix basse en se penchant sur sa sœur. Je me suis gelée à t’attendre. Alors seulement elle vit les larmes de Nicolette et sa pâleur. — Qu’as-tu donc ? lui demanda-t-elle.
— Oh ! ce prêtre ! comme il m’a parlé ! murmura Nicolette frissonnante…
— Oui, c’est un homme effrayant… Je t’avais avertie. Mais tu as voulu venir à lui…
— Il m’a dit des choses terribles…
— Dictées par son intolérance, sans doute ?
— Non, non, mais par le souci de mon salut.
Et comme si les accents qui la terrifiaient tout à l’heure, de nouveau, s’étaient fait entendre, Nicolette se prosterna si violemment que sa sœur entendit le choc de ses genoux sur la dalle nue.
— Apaise-toi, ma chère aimée, reprit Irène ; tu n’as pas le droit de te livrer à ces tourments. Tu le pouvais autrefois, quand tu étais libre, quand tu voulais te donner à Dieu. Mais, aujourd’hui, tu ne t’appartiens pas ; tu as un mari ; bientôt, tu auras un enfant…
— Oh ! un enfant ! gémit Nicolette ; voilà la preuve de mon crime ! Tout à l’heure, tandis que j’étais agenouillée là, j’ai senti, pour la première fois, dans mes entrailles remuer le pauvre être… et il m’a semblé que déjà, avant même de naître, il me reprochait sa naissance.
— Que dis-tu, malheureuse !… Si ton mari t’entendait…
— Ah ! si tu pouvais savoir !
— Savoir quoi ! Tu m’épouvantes… Parle-moi.
— Non, non, tu ne comprendrais pas.
Un geste compléta sa réponse. Elle refusait de s’expliquer ; elle imposait silence à sa sœur et se replongeait dans ses méditations. Irène resta debout près d’elle, attendant qu’elle eût fini de prier. Mais Nicolette paraissait avoir oublié que d’autres devoirs l’appelaient ailleurs. Accroupie, la tête penchée, les bras au long du corps, dans une attitude d’accablante fatigue, elle ne voyait rien, n’entendait rien, et il fallut pour la décider à partir qu’Irène lui imposât sa volonté.
Elles sortirent ensemble ; silencieusement, elles s’engagèrent dans le chemin désert qui descendait vers la ville. Au bas de ce chemin, une voiture les attendait. Elles y montèrent, et quelques minutes plus tard, Nicolette ayant laissé sa sœur chez elle, sans vouloir lui révéler les causes de son trouble, arrivait à Tarascon. Son mari n’était pas encore rentré. Heureuse de se trouver seule, elle s’enferma dans sa chambre. Là, elle pouvait s’abandonner librement à sa douleur.
Jamais elle ne s’était sentie si malheureuse. Le bonheur qu’elle échafaudait depuis quatre mois venait brusquement d’être détruit par la parole acerbe et vengeresse du confesseur. Interrogée par lui sur les causes qui si longtemps l’avaient éloignée des sacrements, en substituant l’indifférence à sa ferveur d’autrefois, elle s’était vue contrainte de révéler les voluptueuses joies de son ardent amour, d’avouer qu’en amant passionné, son mari l’avait menée par des chemins trompeurs et doux jusqu’à ces régions brûlantes, où, dans la langue de l’Église, la passion devient péché. Se livrant sans résistance à ses caresses, heureuse de se donner, elle s’était laissé convaincre que le devoir de la femme est de rendre à l’époux le plaisir qu’elle reçoit de lui, et que les chaînes du mariage ne deviennent fortes que si elles sont forgées au feu qui brûle le cœur et embrase les sens. C’est ainsi que folle de son corps, elle avait oublié son âme, ses devoirs de chrétienne, les exigences de son salut éternel. L’enfant que maintenant elle était sûre de porter dans ses entrailles avait été conçu dans le plaisir, enfanté dans l’amour, selon le langage des hommes ; dans le libertinage et la débauche, selon le langage du confesseur.
Et le prêtre s’était redressé, menaçant et redoutable, rappelant les devoirs méconnus, les vœux oubliés, formulant des interdictions rigoureuses, infligeant des pénitences, exaltant la virginité, la continence, parlant avec des termes de répulsion et de mépris de ces voluptés fécondes dont la saveur avait transformé Nicolette, et auxquelles elle devait d’être mère. Il lui avait montré l’enfer ouvert, le ciel à jamais fermé, si par la sévérité d’une vie nouvelle elle ne purifiait sa chair souillée et ne sanctifiait son âme. Il avait dit enfin qu’elle devait se dérober aux exigences de son mari, le contraindre ainsi à obéir aux commandements de l’Église.
— Vous êtes responsable de son âme comme de la vôtre, s’était-il écrié ; après avoir aimé, redouté Dieu, si vous l’offensez en vous faisant complice du péché de votre époux, vous qui savez mieux que lui la rigueur des peines éternelles, prenez garde que le ciel vous châtie, et qu’il vous châtie dans l’enfant que vous portez. Toujours cet enfant doit vous rappeler combien vous avez été coupable ; non-seulement vous devez l’élever chrétiennement, pour racheter vos fautes passées, mais le souci de son avenir doit vous empêcher d’en commettre de nouvelles.
En se rappelant ces remontrances, Nicolette était épouvantée. Ce qu’on exigeait d’elle, c’est qu’elle brisât de ses mains son bonheur. Elle ne pourrait obéir qu’en éloignant son mari, qu’en se dérobant à sa tendresse, et puisqu’on lui imputait à crime les joies qu’elle devait à l’amant, c’est l’amour même qu’elle était tenue d’immoler. L’accomplissement d’un si rigoureux devoir ne serait-il pas au-dessus de son courage ? Saurait-elle affecter l’indifférence pour glacer les désirs de l’amant ? Saurait-elle mater les siens ? Tout son être se révoltait contre cette dure loi. Elle ne voulait pas se résigner ; et un cri de rébellion montait à ses lèvres, s’en échappait au milieu des larmes qui de ses yeux roulaient sur ses joues blêmies. Mais, hélas ! où la conduirait la révolte ? Dieu lui-même n’avait-il pas parlé par la bouche du prêtre ? Refuserait-elle de se soumettre à Dieu ?
Frédéric la trouva bouleversée, pâle, dominée par ses angoisses. Vainement il l’interrogea ; il ne put obtenir qu’elle en révélât les causes. Tout ce qu’il parvint à lui arracher, c’est qu’elle avait vu Irène. Mais cet aveu n’expliquait pas le changement survenu dans sa conduite. Écartant tour à tour les diverses hypothèses que l’inquiétude suggérait à son mari, elle persistait dans son silence, se contentant de faire remarquer que sa grossesse justifiait sa fatigue. Elle ne disait rien de plus. Ils dînèrent tristes et silencieux, lui blessé par le défaut de confiance qu’il venait de surprendre, elle mangeant peu, osant à peine lever les yeux sur son mari, en proie aux plus cruelles tortures. En quittant la table, elle allégua sa fatigue, rentra dans sa chambre, laissant Frédéric seul, et pour la première fois depuis qu’ils étaient mariés, le privant, comme elle s’en privait elle-même, de cette exquise intimité qui, chaque soir, les rapprochait l’un de l’autre, dans le chaud bien-être de leur paisible maison.
Alors, devant le mystère contre lequel se brisait sa sollicitude, et qu’il considérait comme un caprice de femme, il eut un mouvement de colère. Se levant tout à coup :
— Je veux voir Irène, s’écria-t-il ; elle me dira ce qui s’est passé.
Il sortit, et par la nuit froide se dirigea vers Beaucaire. Dans sa hâte de savoir, il s’était mis en route sans réfléchir. Ce fut seulement sur le pont du Rhône qu’il se souvint que depuis son mariage, il ne s’était jamais rencontré seul avec Irène. Toujours sa femme avait été entre eux ; ils évitaient toute occasion de tête-à-tête, toute explication sur le passé. Lui-même ne songeait plus à elle que pour écarter le souvenir de leur brûlant amour, emporté par un coup d’orage et qu’il croyait à jamais détruit. En pensant qu’il allait la revoir, sans témoins, délivrée par le veuvage, maîtresse d’elle-même, il se troubla. Si puissante fut l’émotion qui s’empara de lui qu’il eut peur. Brusquement, il s’arrêta au milieu du pont que le vent de la mer balançait avec fracas sur les câbles en fer accrochés aux piles. Il n’osait plus continuer son chemin ; il voulait revenir sur ses pas. Mais l’état de sa femme l’inquiétait. Irène seule pouvait le mettre sur la trace de la vérité qu’on lui cachait. Cette considération le décida ; il reprit sa marche, et quelques minutes après, il frappait à la porte de sa belle-sœur.
Irène était seule, ce soir-là comme tous les soirs. Depuis la mort de son mari, elle vivait retirée, non que sa douleur fût de celles qui aiment la solitude et qu’importune le bruit, mais parce qu’il s’y mêlait l’amer regret des circonstances fatales qui lui avaient enlevé Frédéric à la veille du moment où elle aurait pu se l’attacher pour toujours. Ce n’est pas le mort qu’elle pleurait ; elle pleurait le vivant à jamais perdu. Pour le mieux pleurer, elle voulait être seule ; elle s’enfermait avec ses souvenirs, et quoique décidée à tenir loyalement la promesse faite à Nicolette, elle laissait un vague espoir bercer sa peine, espoir conçu contrairement à sa volonté, qu’elle repoussait comme criminel, mais qui la charmait, et dans l’avenir douloureux lui montrait la possibilité d’un bonheur reconquis. Elle avait beau faire, elle aimait toujours.
Assise au coin du feu, sous la clarté de la lampe, elle lisait. En entendant annoncer Frédéric, elle tressaillit. Lui, seul chez elle par cette soirée d’hiver ! Qu’y venait-il faire ? Nicolette, qu’elle avait laissée si lasse et si triste, était-elle plus souffrante ? Est-ce là ce que Frédéric venait lui annoncer ? Ou bien…? Sa pensée demeura inachevée ; l’émotion pâlissait son visage. Une étrange anxiété la prenait au cœur, dominée par une joie inconsciente.
— Ce n’est pas vous que j’attendais, dit-elle, debout, la main tendue vers Frédéric, essayant de dissimuler son trouble.
— Si quelqu’un m’eût dit, il y a une heure, que je serais ce soir chez vous, répondit-il, ce quelqu’un-là, ma chère Irène, m’aurait plus étonné que vous ne paraissez l’être vous-même.
Comme elle reprenait sa place, il s’assit souriant, affectant une entière liberté d’esprit :
— Alors, pourquoi êtes-vous venu ? demanda Irène. Est-ce Nicolette qui vous envoie ?
— Non, je suis ici pour vous parler d’elle. Avec une grande volubilité, comme s’il eût tenté de noyer son émotion dans le flot des paroles, il raconta l’accueil qu’il avait reçu de sa femme, en rentrant chez lui. — Vous avez passé plusieurs heures avec elle aujourd’hui, ajouta-t-il. J’ai pensé que je connaîtrais par vous les motifs de sa métamorphose.
Interrogée avec cette précision, Irène ne pouvait se taire. Elle dit ce qu’elle savait, le désir de Nicolette de ne pas laisser célébrer les fêtes de Noël sans s’approcher des sacrements, la visite au Carmel, la confession à l’abbé Gavella, et la terreur de la jeune femme en quittant le confessionnal. C’en était assez pour révéler à Frédéric la vérité. Il comprenait maintenant. Les craintes et les scrupules de Nicolette lui étaient familiers. A diverses reprises, il les avait dissipés sous ses baisers.
— Vont-ils détruire le repos de ma vie, me prendre le cœur de ma femme ? s’écria-t-il, la colère aux yeux et sur les lèvres.
— Comme vous l’aimez ! soupira Irène, dont ce cri éveilla la jalousie. Il la regarda. Sur ses traits, où, en d’autres temps, il savait lire, il devina le reproche que contenaient ces paroles. Il n’osa répondre. Elle continua toute frémissante. — Elle est heureuse, elle, tant mieux… C’est égal, quand je songe au passé, à vos serments… Ah ! mon pauvre ami, comme vous m’avez eu vite oubliée !
— Oubliée ! fit-il durement. Vous vous trompez.
Elle fut toute remuée par ce cri ; mais elle eut peur de l’explication qui allait infailliblement suivre son imprudente réflexion ; elle s’arrêta. La suite de l’entretien n’eut trait qu’à Nicolette. Frédéric savait maintenant ce qu’il voulait savoir. Il quitta sa belle-sœur sans avoir pu recouvrer le calme. La séduction d’Irène venait de rouvrir à son cœur la plaie ancienne, une de ces plaies qui ne se cicatrisent jamais.
La soirée était avancée quand il rentra. Le froid de la nuit, la rapidité de sa marche, n’avaient pu dissiper son émotion. L’image d’Irène retrouvée le poursuivait. La beauté de la jeune femme avait ressuscité le souvenir des voluptés refroidies, des heures brûlantes, de tout ce passé qu’il croyait à jamais oublié. Ses yeux gardaient la vision des attraits vainqueurs dont, en d’autre temps, le charme l’avait enveloppé. Vainement, il se faisait violence pour ne pas se les rappeler ; ils s’imposaient à sa mémoire, dans une sensation d’effroi et de vague désir. Avec le souvenir, la faiblesse revenait. L’effort désespéré de sa raison le défendait mal contre la tentation tout à coup ravivée. En revoyant Irène, il avait compris qu’elle l’aimait toujours, que faible comme lui, elle n’attendait qu’un signe pour lui ouvrir les bras. De là son trouble. Le crime l’épouvantait ; mais la femme l’attirait. Dans sa chair, le désir s’allumait. Et tandis que ses lèvres se reprenaient à la saveur des baisers d’autrefois, son imagination déchaînée enfantait des projets qu’il repoussait à peine conçus, et qui obsédaient son cerveau, quelque effort qu’il fît pour en briser la séduction.
— Ce serait infâme ! pensa-t-il tout à coup, au moment où, dans le calme de sa maison endormie, il montait lentement l’escalier.
De nouveau il se promit d’éviter de revoir Irène, — il ne pouvait rien de plus, — de chercher l’oubli dans l’amour de sa femme, cet amour qui depuis quatre mois se révélait à lui, ingénieux et ardent, et lui versait le bonheur. Il s’attendrit en y pensant ; les témoignages touchants par lesquels il s’était manifesté lui revinrent en foule à l’esprit. Brusquement, il courut vers l’appartement de Nicolette, assuré de trouver là un refuge contre les périls qui le menaçaient. Il allait ouvrir la porte, quand la femme de chambre, qui veillait en attendant son retour, apparut et lui dit :
— Madame s’est couchée très-souffrante ; elle prie monsieur de ne pas troubler son repos. Elle lui a fait préparer un lit au second étage.
— C’est bien, répondit Frédéric stupéfait ; vous pouvez rentrer chez vous.
Il resta seul, agité par une colère soudaine, surpris et attristé. Sa femme le chassait de son lit, l’exilait loin d’elle. Dans cet ordre inattendu, il retrouvait l’influence du confesseur ; il devinait qu’entre lui et ce prêtre, une lutte allait s’engager, et il doutait de la victoire. En une minute, il vit sa femme rejetée dans la rigoureuse observance des pratiques religieuses, sacrifiant l’amour à ce qu’elle appelait le devoir, se refusant, s’enveloppant comme autrefois, avant qu’il lui eût révélé le bonheur d’aimer, dans la froide austérité de sa dévotion de nonne. Il sentit son cœur se glacer, des larmes brûler ses yeux, tandis qu’il comparait la vie sans charme qui s’apprêtait pour lui, à la vie que lui eût faite Irène, qu’elle lui ferait encore s’il voulait. Cette comparaison lui rendit moins cruelle la déception qu’il venait de subir. Elle lui montrait, au delà du malheur qu’il prévoyait, un dédommagement qui en amoindrirait l’amertume. Mais elle le terrifiait. Cette vision troublante eut la durée d’un éclair. Il refusait de désespérer, il se rattachait au seul bonheur qu’il pût légitimement connaître et goûter. Il voulait le défendre, n’y renoncer qu’après avoir tout tenté pour le retenir.
Sa volonté, formulée nettement dans son esprit, l’entraîna à tenter sur l’heure un effort assez efficace pour lui rendre le cœur de Nicolette. Il poussa la porte de la chambre. En entrant, il aperçut, sous la lueur pâle de la veilleuse, sa femme couchée et immobile. Il s’approcha sans bruit vers le lit et dit à voix basse :
— C’est moi, Nicolette. Elle ne répondit pas. Il reprit : — Es-tu souffrante ? Je t’en prie, parle-moi.
Un soupir entr’ouvrit les lèvres de Nicolette. Elle parut sortir d’un profond assoupissement et murmura :
— C’est mal à vous de me réveiller ; je vous avais fait prier de me laisser seule ce soir.
— Ce soir… et pour la première fois, fit-il d’un accent de reproche. Sera-ce du moins la dernière ?
— Je suis lasse, bien lasse, dit-elle, au lieu de répondre à la question de son mari.
En toute autre circonstance, Frédéric se serait résigné à obéir. Nicolette touchait au cinquième mois de sa grossesse désormais certaine. Sa lassitude s’expliquait aisément. Mais ce qu’il avait appris par Irène, ce qu’il savait de la visite de sa femme au Carmel lui rendait suspectes ses paroles. Il doutait de sa sincérité. Le motif qu’elle alléguait pour l’éloigner lui semblait n’être qu’un prétexte et cacher un motif plus vrai qu’elle ne voulait pas avouer.
— Je m’en vais donc, reprit-il tristement ; mais avant, embrasse-moi ; répète-moi que tu m’aimes toujours.
— Si je vous aime ! soupira-t-elle. Pouvez-vous en douter ? Mais il y a amour et amour… celui que Dieu condamne, et celui qu’il bénit…
— Je n’en connais qu’un seul, moi, s’écria Frédéric, celui qui nous a rendus heureux.
Il se pencha, pénétré déjà par la moiteur du corps étendu sous les draps ; il l’attira vers lui, cherchant les lèvres comme s’il eût voulu y retrouver la trace de ses baisers et étouffer là, dans une caresse plus puissante encore, les paroles que sa femme venait de prononcer. Mais elle se détournait en disant :
— Oh ! non, non, pas cela…
— Mais cela, c’est ce que tu voulais hier encore…
— Depuis hier, j’ai compris que c’est mal.
Il se redressa furieux, saisissant sur le vif la cause de sa disgrâce.
— Est-ce ton confesseur qui t’a défendu d’embrasser ton mari ?
— Qui vous a dit ?
— Qu’importe, puisque je sais… Est-ce lui qui t’a fait cette défense odieuse, Nicolette ? Est-ce lui qui a rendu de glace ton cœur embrasé du même feu que le mien ? Est-ce lui qui veut y tuer l’amour ?
Ces questions précipitées épouvantaient Nicolette. Si elle se laissait entraîner dans la discussion à laquelle l’invitait Frédéric, elle allait, sous peine de lui infliger une torture, subir de nouveau la séduction et retomber dans le péché. Il fallait à tout prix l’écarter, l’écarter sans l’offenser, et gagner du temps, s’assurer les moyens de le préparer doucement à une vie nouvelle, plus conforme que la vie passée aux préceptes du confesseur.
— Pour l’enfant que je porte, supplia-t-elle doucement…
Il ne la laissa pas achever ; il s’éloigna du lit, traversa la chambre en proférant un adieu qui ressemblait plus à une menace qu’à une parole de tendresse, et il s’enfuit. S’il se fût arrêté à la porte, il aurait entendu les sanglots de Nicolette que désespérait sa brusque sortie. Mais trop vif était son dépit pour que des larmes eussent le pouvoir de le dissiper. Il monta dans la chambre où désormais sa femme l’exilait. Déshabillé en un tour de main, il se coucha, mais ne put dormir, livré aux réflexions les plus contraires, inquiet, désespéré, se plaignant et menaçant tour à tour, irrité surtout contre le prêtre qui lui enlevait le cœur de sa femme.
En vérité, elle choisissait bien son moment pour se dérober à sa tendresse, pour rompre les liens de leur intimité : le moment où il venait, tout à coup rapproché d’Irène, de subir une influence dont il ne connaissait que trop les entraînements et la douceur ! S’il était conduit à violer ses devoirs, à outrager la morale, à souiller son foyer de toutes les hontes de l’adultère et de l’inceste, Nicolette ne l’aurait-elle pas voulu ? N’est-ce pas sur elle que retomberait la responsabilité de ses désordres ? Durant toute la nuit, ces questions troublantes hantèrent son esprit obsédé par le souvenir d’Irène. Il s’endormit au petit jour, brisé de corps et d’âme, se demandant découragé, avant même d’avoir résisté, s’il parviendrait à reconquérir sa femme, et ce qu’il deviendrait s’il n’y parvenait pas.
Cette soirée douloureuse amena des lendemains cruels et amers. Partagée entre l’amour de son mari et la crainte du péché, Nicolette, livrée à l’influence de l’abbé Gavella, se laissait dominer par la crainte plus encore que par l’amour. Durant les jours qui suivirent cette étrange métamorphose, Frédéric, à diverses reprises, essaya de ressaisir son influence ébranlée. Mais ses efforts furent vains. Entre sa femme et lui, il voyait s’élever un obstacle qu’il se sentait impuissant à détruire. La grossesse de Nicolette, les souffrances qui résultaient pour elle de son état, devinrent l’argument à l’aide duquel elle éloignait implacablement son mari et le glaçait quand il venait vers elle, une caresse dans le geste et dans le regard. Elle lui opposait une froideur calculée. Si parfois, attendrie par les prières qu’il faisait entendre, elle semblait prête à se fondre sous ses baisers et à se donner, tendre comme autrefois, elle se roidissait tout à coup sous l’impression d’un remords subitement déchaîné. Alors, elle le fuyait, disparaissait pendant quelques heures, allait s’agenouiller dans le confessionnal où l’attendait le prêtre, et d’où elle rapportait une énergie de résistance sous laquelle Frédéric demeurait vaincu et désarmé.
Il tentait cependant encore de la ramener à lui ; il évoquait les souvenirs des mois écoulés, de l’amour fort et profond qui avait suivi leurs noces. Il lui parlait avec éloquence de l’enfant qu’elle portait. N’était-il pas le lien solide qui devait les empêcher de se désunir, cet enfant fruit de leur mutuelle affection ? Elle lui répondait par des larmes auxquelles il se trompait. Il croyait avoir raison de sa rigueur. Mais soudain elle l’écartait, comme si cette allusion à l’être formé dans ses entrailles ne lui eût rappelé que le péché auquel cet être innocent allait devoir la vie.
En quelques semaines, l’intimité de leur vie fut détruite. Toutefois, Frédéric ne désespérait pas encore. Il attribuait à la grossesse de Nicolette l’incompréhensible caprice dont les conséquences pesaient sur ses épaules d’un poids si lourd. Il se plaisait à penser que lorsqu’elle serait délivrée, il la retrouverait telle qu’autrefois. Cette espérance lui donnait le courage de subir cette épreuve trop longtemps prolongée. Elle le consolait dans sa détresse, l’aidait à éteindre la vision brûlante que les dédains de sa femme ramenaient sans cesse devant ses yeux, et qui lui montrait le bonheur dans l’amour d’Irène.
Plus Nicolette le rendait malheureux, plus il songeait à sa première maîtresse, libre maintenant et toujours éprise de lui. Il la fuyait ; il redoutait de se trouver de nouveau seul avec elle, de lui laisser deviner son mal. Il craignait, en le lui confiant, d’être entraîné à solliciter un dédommagement à sa dure vie. Comme si elle eût soupçonné ses terreurs, elle ne cherchait pas à l’attirer dans sa maison. Ils ne se voyaient qu’en présence de Nicolette, n’ayant plus rien à se cacher de leur état réciproque, mesurant le péril qui les menaçait, sachant bien qu’à la première tentation, ils succomberaient, écartant loyalement tout prétexte de la faire naître. Irène affectait de ne venir chez sa sœur qu’aux heures où Frédéric ne s’y trouvait pas. Lui-même s’était jeté avec une sorte de fureur dans les occupations de la vie du régiment. Il cherchait par tous les moyens à combler le vide de ses jours, convaincu qu’il ne pourrait vivre longtemps ainsi, le cœur dépossédé de toute tendresse, mais résolu à attendre quelque temps encore que sa femme lui revînt. Il s’était assigné à lui-même, comme terme de sa patience et de ses efforts, le moment où Nicolette, devenue mère, n’aurait plus aucun motif apparent pour se refuser à l’amour de son mari.
Ce moment arriva. Moins d’une année après leur mariage, un soir, Nicolette mit au monde un fils. Le premier vagissement du nouveau-né effaça dans la mémoire et dans l’âme de Frédéric le souvenir de toutes ses souffrances. Il lui semblait que son bonheur compromis se reconstituait. Dans l’émotion de la mère, encore que cette émotion fût dépourvue de toute joie et qu’il n’en comprît pas le caractère mélancolique et douloureux, il croyait entrevoir l’aurore d’un avenir doux et consolateur.
Hélas ! s’il avait pu lire dans ce cœur désormais fermé, il eût été épouvanté. Nicolette ne goûtait rien du bonheur des mères. Dans cet enfant, sang de son sang et chair de sa chair, elle ne voyait encore autre chose que le fruit de ce qu’elle appelait son péché. Il serait toujours un vivant remords. Ses frêles bras tendus, son regard innocent seraient pour elle comme un reproche qui sans cesse remettrait en sa mémoire le souvenir de sa faiblesse, des vœux violés, des serments trahis, de la virginité perdue, du criminel abandon aux caresses d’un homme de son corps promis à Dieu. Les premiers sourires de la petite créature ne pouvaient rien contre ce remords provoqué par les farouches rigueurs de l’abbé Gavella. Nicolette entendait sans cesse les paroles du confesseur, ses avertissements, sa colère d’ascète, quand elle avait étalé devant lui les secrets de sa conscience et le récit de ses longues nuits d’amour. Il fallait expier, avait-il dit ; si elle n’expiait pas, Dieu se vengerait sur l’enfant. Elle ne comprenait l’expiation que par un éternel renoncement au bonheur de se laisser chérir par son mari. Elle voulait même associer à son repentir le nouveau-né, détourner de lui les colères divines en le consacrant au ciel, en ne s’occupant que de son salut, en faisant de lui un saint.
Ces résolutions lentement formées et arrêtées dans sa pensée, elle les cachait encore. Elle n’en voulait rien trahir, de peur d’être empêchée de les exécuter, et Frédéric espérait. Il fut donc cruellement déçu quand Nicolette lui annonça qu’elle désirait nourrir son fils. En toute autre circonstance, il eût trouvé ce désir légitime. Mais au lendemain des jours qui venaient de passer, jours gros de douleurs et de larmes, il l’interpréta comme la preuve que Nicolette voulait prolonger et consommer la séparation commencée. Quoique irrité, il s’efforça cependant de la détourner de ses desseins. Ils étaient irrévocablement arrêtés. Elle ne consentit pas à y renoncer. Alors, dans une tentative suprême et désespérée, il retraça les douleurs qu’il avait subies, celles qu’il subirait encore si elle ne changeait pas de résolution. Il plaida avec éloquence la cause de son cœur. Il fit le tableau de ce que deviendrait leur vie si l’amour cessait d’y présider. Il comparait la réalité douloureuse aux espérances jadis caressées. Il suppliait sa femme de lui revenir.
Elle lui répondait en parlant de ses remords, en l’invitant froidement à s’associer à elle pour faire pénitence et se sanctifier en vue de leur salut éternel.
— Ce doit être notre unique but, disait-elle ; qu’importe le bonheur en ce monde ! il n’y faut point être heureux si nous voulons vivre éternellement dans la contemplation de Dieu. Acceptez l’épreuve qu’il vous impose aujourd’hui ; il vous en dédommagera un jour.
Ce langage, qui résumait les avertissements de l’abbé Gavella et exprimait le nouvel état de Nicolette, trouvait Frédéric rebelle, déjà las de cette lutte incessante, achevait de lui prouver que désormais il avait perdu toute influence sur le cœur de sa femme, qu’il ne pouvait plus en attendre aucune félicité, et que s’il voulait avoir la paix dans sa maison, il devait se livrer aux dévots exercices auxquels se livrait Nicolette, ou tout au moins se résigner à ne plus la considérer que comme une sœur. Mais une paix achetée à ce prix ne pouvait être la félicité. Cette conviction acquise tout à coup fut le dénoûment de ses longues incertitudes, le trait décisif qui consomma son malheur.
S’il se fût écouté, il aurait confié son chagrin à Irène. Elle venait de vivre au chevet de Nicolette durant les nombreuses journées nécessaires à la convalescence de l’accouchée, et pendant ce temps ils s’étaient vus tous les jours. Quoique les explications survenues entre le mari et la femme eussent eu lieu hors de sa présence, elle devinait toutes les péripéties du drame intime qui commençait la destruction du foyer domestique. A tout instant, Frédéric pouvait surprendre les regards de sa belle-sœur fixés sur lui, y lire tantôt la pitié, tantôt un encouragement. Une tentation violente l’entraînait, le poussait à lui conter ses peines, quel que dût être le lendemain de ces confidences dangereuses. Mais il était, malgré tout, dominé par la terreur de ce péril ; sa loyauté, plus puissante que son infortune, le retenait encore. Irène quitta la maison de Nicolette pour rentrer dans la sienne et reprendre sa vie accoutumée, sans que Frédéric lui eût livré son secret.
A dater de ce jour, l’intérieur des Varimpré devint un enfer. Pour le cœur sur lequel Frédéric avait cru son empire à jamais assuré, il ne comptait plus. Nicolette partageait son temps entre les devoirs de la maternité et de pieux exercices. C’étaient chaque matin de longues stations dans les églises, toutes les après-midi une visite au couvent des Carmélites. Sévère était sa piété, exigeante sa vertu. Elle ne souriait plus à son mari ; son visage trahissait à toute heure la gravité de ses méditations. Il n’exprimait quelque attendrissement que lorsqu’elle adressait la parole à son fils, soit qu’elle lui donnât le sein, soit qu’elle le berçât entre ses bras. Elle témoignait à ceux qui vivaient à son service la même rigueur qu’à elle-même. Elle affectait de dédaigner les élégances qui embellissent la grâce des femmes. Comme au temps où elle était jeune fille, elle n’allait plus que vêtue de noir, dans une tenue d’une austérité monacale, songeant non à plaire à son mari, mais à éteindre le charme de sa jeunesse, à effacer sa beauté.
Autour d’elle, les choses prenaient une physionomie de cloître ; elle avait exclu de son appartement les meubles confortables et luxueux. Elle apportait cette austérité dans l’ordinaire. A diverses reprises, Frédéric dut exiger une nourriture plus conforme à ses habitudes et à ses goûts. Contrainte d’obéir, Nicolette faisait apprêter des mets pour lui seul et refusait d’y toucher. Quand il mangeait en face d’elle, le silence qu’elle gardait était un constant reproche adressé à ce qu’elle considérait comme une offense pour sa propre foi. S’il laissait échapper une plainte, elle répondait avec aigreur, en lui rappelant qu’il vivait en dehors des lois de l’Église ; et s’il tentait de prouver que le premier devoir de la vertu est de se faire douce, bienveillante, tolérante, elle répliquait qu’on ne gagne le ciel qu’en imposant à son corps de dures privations.
Une catastrophe domestique fit trêve un moment à cet état aggravé de jour en jour. En moins de trois mois, Frédéric perdit coup sur coup son père et sa mère. Le général mourut le premier, presque subitement. Sa veuve, désespérée, ne put résister au coup, et n’y survécut pas. Ce douloureux événement obligea les époux à se rendre au château de Varimpré, les y retint longtemps, et amena même entre eux un rapprochement.
Si triste était Frédéric, que Nicolette parut se relâcher de sa froideur. Pendant quelques jours, il put croire qu’elle lui revenait, obéissant aux suprêmes conseils de la morte, confidente des chagrins de son fils. Il s’abandonna sans défiance à cette tendresse renaissante, sans voir le but qu’elle dissimulait. Ce but lui apparut tout à coup. Nicolette voulait entreprendre de le convertir, profiter de son accablement, de cet état d’âme qui suit la perte d’êtres aimés, pour l’entraîner aux offices qu’elle suivait avec assiduité, pour lui imposer ses propres croyances et les pratiques religieuses qu’elle observait jusqu’à l’excès.
Le passé le disposait mal à subir ces influences. Dans la tentative de sa femme, il vit surtout l’intention de le dominer. Sa défiance, un moment évanouie, brusquement ressuscita. Lorsque, quelques jours après la mort de sa mère, il entendit Nicolette lui rappeler qu’il ne trouverait de consolations qu’aux pieds du crucifix, qu’il devait s’y jeter humblement, prier avec elle, se repentir de ses fautes et détourner ainsi la colère céleste appesantie sur sa maison, il se révolta. Il était à bout de patience. Il refusa de condescendre aux désirs qu’elle exprimait. Ce fut encore une source d’âpres querelles qui se prolongèrent durant le séjour qu’ils firent à Varimpré, se continuèrent encore après leur retour à Tarascon, emportant ce qui restait d’amour entre leurs cœurs.
En moins d’une année, Nicolette eut rendu sa maison haïssable à son mari, brisé à jamais les liens qui les avaient naguère unis. Si quelqu’un lui eût dit que c’était là le résultat de sa ferveur exagérée, de sa piété farouche, peut-être eût-elle fait effort sur elle-même pour retenir le cœur qui lui échappait. Il eût suffi qu’elle se montrât affectueuse et tendre comme aux premiers mois de son mariage. Par la douceur, elle aurait eu aisément raison de son mari. Elle l’eût retenu près de soi, empressé à lui plaire, et malgré ce qu’il y avait d’extrême dans les transports de sa dévotion, ils auraient pu être encore heureux.
Malheureusement, elle était entre les mains de l’abbé Gavella ainsi qu’une matière inerte et molle qu’il pétrissait à son gré. Terrible comme les moines de son pays, au temps où l’Église faisait des prosélytes par le fer et par le feu, l’ancien aumônier des bandes carlistes lui montrait dans Frédéric l’ennemi de son salut, celui dont elle devait se défier, à la tendresse duquel elle devait résister. Cette tendresse, disait le prêtre, cachait sous des dehors trompeurs d’ardents désirs contraires à la loi de chasteté imposée par l’Église aux époux, contraires surtout aux vœux que, jeune fille, Nicolette avait prononcés en se consacrant à Dieu. Il ajoutait qu’entre Dieu et son mari, elle était tenue de choisir, qu’on ne saurait appartenir à la fois à la terre et au ciel. Tout autre jadis le langage de l’abbé Cardenne, inspiré par une tolérance intelligente, par l’esprit de l’Évangile. Mais l’abbé Cardenne n’habitait plus Beaucaire, et Nicolette, livrée à l’abbé Gavella, avait oublié la parole douce et simple de son premier confesseur.
La vie commune, faite désormais de colère, de défiance, d’aigreur, troublée par des querelles durant lesquelles les dernières tentatives de Frédéric pour reconquérir le cœur de sa femme se brisaient contre une implacable froideur, devenait chaque jour plus difficile. Nicolette puisait des consolations dans la prière ; elle demandait à Dieu de toucher de sa grâce l’endurcissement de son mari, rebelle aux ordres de l’Église. Pour expier les fautes de ce mari qu’elle considérait comme un pécheur, elle se livrait chaque jour davantage aux exercices pieux, aux mortifications. Elle jeûnait, répandait autour d’elle des aumônes, s’imposait une discipline rigoureuse, les longues veilles aux pieds du crucifix. Elle avait brisé toutes relations avec le monde, ne sortait jamais au bras de Frédéric. On ne la voyait au dehors que lorsqu’elle allait assister à la messe à sa paroisse ou aux Carmélites. Elle s’était même affiliée au tiers ordre du Carmel, et suivait autant qu’elle le pouvait les règles de la vie monastique. Elle goûtait dans ces pratiques un étrange bonheur, propre à lui faire oublier le martyre qu’elle avait imposé à son cœur, en y tuant l’amour.
Mais, à côté d’elle, Frédéric ne pouvait trouver un dédommagement analogue. Son existence, de jour en jour, devenait plus vide, plus désenchantée. Il fuyait maintenant sa maison, à laquelle tout autre séjour lui semblait préférable. Sa femme ne lui inspirait plus qu’un sentiment douloureux, fait d’horreur et de pitié. Il ne pouvait comprendre que ce fût là cette créature dont il avait entendu le cœur battre près du sien, dans une même extase de bonheur amoureux et de passion vibrante. A toute heure, maintenant, il songeait à Irène. Il devinait que le jour où il frapperait à la porte de la jeune femme, cette porte s’ouvrirait, qu’il trouverait dans l’ancien amour le bonheur dont il était dépossédé. Mais il hésitait encore ; il avait peur, peur surtout de mettre des torts de son côté, alors que jusqu’à ce moment il pouvait se rendre cette justice d’avoir rempli tout son devoir.
C’est dans ces circonstances qu’un simple incident le remit tout à coup en présence d’Irène. Un soir, comme, après une longue journée de manœuvres militaires dans les plaines qui entourent Tarascon, il rentrait chez lui, la nuit venue, il trouva sa femme en proie aux plus vives alarmes. Une indisposition qui depuis plusieurs jours tenait son fils alité, s’était subitement aggravée. Le médecin, appelé en toute hâte, redoutait une attaque de croup. Déjà Nicolette voyait l’enfant perdu. Allait-il être arraché à ses bras, alors que depuis dix-huit mois elle l’entourait de soins et de sollicitude, et au moment d’atteindre cet âge charmant où chez ces petits êtres l’intelligence s’éveille, leurs lèvres commençant à balbutier les premiers mots ? Cette question, en se dressant dans son esprit, provoquait un bruyant désespoir que sa résignation chrétienne était impuissante à apaiser.
Dans sa détresse, et son mari absent, elle avait mandé sa sœur. Quand Frédéric, prévenu par ses domestiques, entra dans la chambre, ayant en une minute oublié les maux qu’il endurait depuis si longtemps pour ne songer qu’à la douleur de la mère, douleur qui brusquement le rapprochait d’elle dans la communauté de leurs angoisses, il vit les deux femmes debout auprès du petit lit, penchées sur l’enfant dont elles épiaient anxieusement la respiration oppressée. Nicolette, à peine vêtue, pâle, les cheveux en désordre, pleurait et se lamentait. Il s’avança. N’écoutant que son cœur, il la prit doucement par la taille, en prononçant quelques mots propres à la rassurer, à apaiser ses craintes. Mais d’un brusque mouvement Nicolette se dégagea, et fixant sur lui un regard gros de reproches, elle lui montra son fils en s’écriant :
— Voilà votre œuvre. Dieu s’est offensé de votre indifférence pour lui. Il vous punit ; le malheur est qu’il m’enveloppe dans le châtiment que vous avez attiré sur vous.
Une protestation monta aux lèvres de Frédéric. Il la contint pour ne pas provoquer une querelle, baissa la tête sans répondre. Mais ses yeux, au moment où ses paupières se fermaient, s’arrêtèrent sur Irène, surprise et affligée, comme pour la prendre à témoin de l’injustice de ce reproche. Durant toute la nuit et jusqu’au matin, ils restèrent auprès du berceau sans que les allusions de Nicolette à ce qu’elle appelait l’impiété de son mari parvinssent à ébranler la patience de Frédéric. Il s’était enfermé dans un mutisme impénétrable. Du reste, loin d’empirer, l’état de l’enfant semblait s’améliorer. Au petit jour, le médecin arriva, et, après avoir examiné son malade, déclara qu’il répondait de sa vie. Alors seulement, Nicolette consentit à aller se reposer. Elle s’éloigna sans rétracter les odieuses paroles arrachées à son désespoir, laissant Irène et Frédéric seuls.
— Je suis à bout de courage, murmura alors ce dernier. Vous l’avez entendue. Voilà comment elle me juge et ce qu’elle pense de moi.
Irène le regardait sans oser l’interroger. Mais Frédéric, dont le cœur trop plein avait besoin de se répandre, se décidait enfin à lui confier ses peines. D’un accent ému, tremblant, il les lui racontait à demi-voix. Assis auprès du berceau, elle écoutait anxieuse cette confession.
— Pourquoi m’avoir poussé à ce mariage ? s’écria Frédéric en finissant. Il valait mieux nous soustraire par la fuite aux vengeances de votre mari que par le stratagème auquel vous avez voulu recourir. Délivrés maintenant, nous serions à jamais l’un à l’autre. C’est vous seule que j’aimais, vous seule que j’aime toujours. Et comme, toute frissonnante, elle gardait le silence, il ajouta d’un ton résolu : — Vous êtes ma vraie femme, Irène. J’ai beau résister à l’évidence, tout le proclame dans mon cœur. Voulez-vous vous expatrier avec moi ? Ma vie vous appartient ; je vous la livre pour toujours. Ici, près de Nicolette, c’est l’enfer ; au loin, près de vous, ce sera le ciel.
— Avez-vous bien compris la gravité de vos paroles ? demanda Irène, dont le cœur se troublait au souvenir ressuscité de la passion non éteinte qu’un mot venait de ranimer.
— Voilà plus d’une année que je veux vous parler, répondit Frédéric. J’ai longtemps résisté. Maintenant, je ne peux plus. Le supplice qu’on m’inflige est au-dessus de mes forces. J’affirme que j’ai tout tenté pour vous oublier ; je l’ai voulu fermement, de toute l’énergie de ma volonté et de ma raison. Mais, quoi ! le cœur de Nicolette m’est à jamais fermé ; c’est sa rigueur qui me ramène vers vous. Abandonnez-vous à mon amour, Irène ; il ne vous fera jamais défaut ; nous pourrons encore être heureux. Dites un mot, et je préparerai à loisir notre fuite. Seulement, nous emmènerons mon fils ; je ne veux pas que sa mère le façonne à son image.
— Le lui prendre ! fit Irène avec effroi…
— Elle sera vite consolée… Dieu ne lui tient-il pas lieu de tout ? Irène, par pitié, promettez-moi de me suivre…
Il était presque à ses genoux, les mains suppliantes, les yeux brillant d’une ardeur passionnée. Éperdue, Irène se taisait, bouleversée en voyant si près de se réaliser le rêve que tant de fois, dans le silence de ses tristes nuits, elle avait caressé.
— Ce serait un trop grand crime ! soupira-t-elle enfin.
Ce fut son unique protestation. Elle se sentait reprise par l’amour ; elle ne s’appartenait plus, enveloppée déjà dans le flot des désirs inassouvis et ravivés. La prière de Frédéric montait autour d’elle, désarmait sa résistance, et encore qu’elle protestât d’un geste affaibli, il devinait que désormais elle était à lui, qu’il lui suffirait de parler pour être obéi.
Assise sur le bord d’une chaise, dans un coin de la chambre pauvre et nue que l’abbé Gavella occupait hors de l’enceinte du couvent, Nicolette, repliée sur elle-même dans une attitude d’accablement et de douleur, écoutait le prêtre. Ainsi qu’elle le faisait souvent depuis que s’abandonnant à sa direction spirituelle, elle lui avait accordé sa confiance, elle était venue lui raconter ses angoisses et lui demander conseil.
Jamais ses confidences n’avaient eu un caractère plus douloureux. Elle connaissait, depuis quelques heures, la liaison criminelle renouée entre Irène et Frédéric. Une lettre surprise venait de lui en révéler l’existence. Bouleversée, elle était accourue à son confesseur. Entrant comme une folle, elle avait poussé vers lui le cri de sa détresse. Ce n’est pas qu’elle fût atteinte profondément dans son cœur, où l’amour n’était plus que comme une victime expiatoire immolée, offerte à Dieu. Après avoir lassé pendant trois années la tendresse de son mari, découragé ses efforts, elle n’attendait rien de lui. Mais trop grande était l’infamie du crime qu’elle venait de découvrir ! Quoi ! trahie, trompée par ceux à qui jadis elle avait sacrifié sa vocation religieuse ! l’adultère et l’inceste s’étalant à ses côtés ! deux âmes se livrant au démon ! Elle se révoltait, indignée, résolue à ne pas tolérer le scandale, se demandant comment elle pourrait le faire cesser.
Mais, en même temps, tout au fond de son cœur, s’élevait pour la première fois un reproche contre elle-même, et, avec ce reproche, la crainte que l’abbé Gavella eût contribué par ses conseils à éloigner d’elle son mari. N’est-ce pas pour lui obéir qu’elle s’était refusée à l’amour de Frédéric ? pour lui obéir qu’elle avait transformé sa maison en cellule monacale, détruit sa beauté afin d’éteindre des désirs auxquels le prêtre lui ordonnait de se dérober ? Si son mari l’avait prise en horreur, s’il avait cherché le bonheur hors de son foyer, à qui la faute ? Ce qu’elle pensait, elle n’osait l’exprimer ; c’est à peine si elle osait se l’avouer à elle-même. Elle s’était contentée de révéler l’effroyable découverte. Maintenant, brisée par ses aveux, elle attendait que le prêtre parlât, qu’il lui fît connaître comment elle devait agir pour se tirer de peine.
L’abbé Gavella, après l’avoir écoutée silencieusement, arpentait la chambre à grands pas, le front courbé, les mains derrière le dos, passant et repassant devant la femme abandonnée, sans même la regarder. Terrible était son silence ; il pesait lourdement sur Nicolette. Elle tournait les yeux vers son directeur, avec une expression de prière et d’angoisse, suspendant un suprême espoir aux lèvres muettes de qui elle attendait un avis efficace. Elle essayait de comprendre ce regard impénétrable qui évitait de se poser sur son visage, et le sien n’exprimait plus que le désenchantement dont ses confidences ne pouvaient, hélas ! la guérir. Elle suivait la promenade monotone du prêtre tour à tour vu de face avec sa physionomie farouche, et vu de dos dans le profil des larges épaules dont l’ossature saillante faisait craquer la soutane fripée et luisante, usée jusqu’à la corde.
— Cet homme est un grand pécheur, dit-il tout à coup.
— Un grand pécheur, oui, objecta timidement Nicolette ; reste à savoir si ce n’est pas ma rigueur qui l’a plongé dans le péché. Peut-être, si j’avais persisté à demeurer pour lui ce que j’étais aux débuts de notre mariage, il ne m’aurait pas abandonnée.
— Des regrets ! murmura dédaigneusement le prêtre.
— Oui, des regrets, s’écria Nicolette. D’abord, mon mari m’a été fidèle et dévoué. Il n’a cessé de l’être que lorsqu’il a compris que j’avais peur de son amour.
— Cet amour était impudique. Vous ne pouviez continuer à y répondre, sans exposer votre âme à la damnation.
La jeune femme baissa la tête, écrasée par cet argument décisif.
— J’avais cependant le droit d’aimer mon mari et d’être aimée de lui.
— Oui, c’est cela, payez-vous de mots… Y a-t-il deux manières de comprendre le mariage chrétien ? N’est-il pas vrai que votre mari l’avait compris d’une manière offensante pour Dieu ? N’est-il pas vrai qu’il entraînait votre âme à l’enfer ? J’ai dû vous ouvrir les yeux, vous tracer vos devoirs, vous rappeler les imprescriptibles lois de la chasteté, lois plus impérieuses pour vous que pour d’autres, puisqu’en d’autres temps, vous aviez juré de les observer. C’est un grand malheur que votre mari ait refusé d’entrer dans vos vues, une épreuve redoutable que le ciel vous impose… Mais je n’ai rien à retirer des conseils que je vous ai donnés.
— Que me reste-t-il donc à faire ? Ce malheureux entretient avec ma sœur des relations criminelles. Dois-je laisser se prolonger ce scandale ? N’y a-t-il pas là deux âmes à ramener au bien !
— Ah ! si vous n’obéissiez qu’au désir de les tirer du péché !… Mais n’est-il pas vrai que vous obéissez surtout à votre jalousie !
— C’est mon mari, murmura Nicolette.
Il y eut un silence. L’abbé Gavella marchait toujours ; son visage osseux s’empourprait ; l’expression de son regard devenait plus sombre.
— Quelle femme est votre sœur ? demanda-t-il tout à coup.
— Une âme passionnée et faible, mais honnête…
— Si vous dites vrai, tout espoir n’est pas perdu. Je la verrai, je lui parlerai.
— Oh ! non, pas vous, mon père !
— Pourquoi ? fit-il défiant.
— Vous l’épouvanteriez peut-être, mais vous n’obtiendriez rien d’elle ; elle chercherait dans les bras de son amant l’apaisement de son épouvante et l’y trouverait. Sur une créature comme elle, l’amant exerce plus d’influence que le confesseur.
— Oui, jusqu’à l’article de la mort, reprit ironiquement le prêtre… A ce moment, nous avons notre revanche… On nous écoute.
— Ma sœur n’est pas à l’article de la mort.
— Mais si, de votre propre aveu, je ne dois rien faire pour arrêter ce débordement d’infamies, pourquoi êtes-vous ici ?
— Le besoin de laisser se répandre mon cœur et de confier à quelqu’un ma détresse.
— J’ai passé par des détresses plus profondes que la vôtre, et je ne les ai confiées qu’à Dieu.
— Mais n’êtes-vous pas le représentant de Dieu sur la terre ?
L’abbé Gavella se mordit les lèvres et d’abord ne répondit pas. Puis, brusquement, il dit :
— Si vous ne me laissez pas la faculté de faire entendre à votre sœur les reproches qu’elle a mérités, et de l’adjurer au nom de son salut, je ne peux rien.
— Avant de vous laisser lui parler, mon père, je veux la voir.
— Des demi-mesures ! s’écria l’abbé Gavella. Tant de ménagements sont-ils donc nécessaires avec les âmes qui se vautrent dans le péché ? Faut-il leur laisser le temps de réfléchir, d’hésiter, de discuter avec elles-mêmes ? Ne vaut-il pas mieux les arracher tout d’un coup à leur pourriture ?
Il parlait durement, en continuant sa promenade fiévreuse et irritée. Son rude accent espagnol donnait à ses paroles un caractère inquisitorial, révélait l’habitude de traiter ses pénitentes comme autrefois il traitait ses miquelets quand il faisait la guerre dans l’Aragon. Homme terrible qui dans toute créature humaine voyait une proie pour le ciel à qui il s’efforçait d’en assurer, coûte que coûte, de gré ou de force, la possession.
— Celle dont nous parlons est ma sœur, supplia Nicolette qui entendait gronder de nouveau dans ce langage la domination à laquelle elle s’était peu à peu assouplie et cause de ses malheurs. Laissez-moi la voir, mon père. Si je ne parviens pas à la détourner du mal, vous serez le premier à l’apprendre, et alors, vous pourrez tenter à votre tour…
L’abbé Gavella ne la laissa pas achever. Il l’interrompit avec brutalité.
— Soit ! fit-il, j’attendrai. Mais puisque mon secours ne vous est pas encore nécessaire, vous auriez pu vous dispenser de me déranger ce matin.
— Pardonnez-moi, mon père…
— Bien ! bien ! allez, ma fille, Dieu vous garde ! et puisse-t-il vous inspirer d’énergiques résolutions ! Croyez-moi, hâtez-vous de décliner la responsabilité qui pèse sur vous. Ce n’est pas seulement votre honneur domestique qui est en jeu, à cette heure ; c’est aussi le salut de deux âmes, de deux âmes dont vous êtes responsable devant le ciel, car vous pouvez faire cesser le scandale abominable par lequel il est grièvement offensé. Les lois humaines elles-mêmes vous donnent des armes dans ce but. Vous devez agir à la fois sur votre sœur et sur votre mari, les menacer de la rigueur de ces lois, revendiquer vos droits d’épouse, employer au besoin la contrainte. Si vous n’êtes pas en état de faire ainsi, il vaudrait mieux substituer à vous ceux à qui vous avez confié vos soucis, moi par exemple. Ah ! si vous me mettez en présence des coupables, je leur ferai entendre les paroles vengeresses ; je leur montrerai le ciel fermé, l’enfer béant, et je les aurai bientôt courbés à mes pieds, humiliés et repentants. En prononçant ces mots, avec une expression de menace, le terrible aumônier s’arrêta devant Nicolette silencieuse, et, l’enveloppant de son regard soupçonneux, il ajouta d’un accent où éclatait son mépris pour les inquiétudes de cette conscience troublée : — Ame débile ! âme de femme ! Allez ! je prierai pour vous.
Nicolette frissonna et sortit défaillante. Depuis longtemps, elle souffrait de l’influence que l’abbé Gavella exerçait sur elle, pouvoir mystérieux qu’elle subissait comme celui d’un maître dont on ne peut s’affranchir. Elle le voyait souvent. Mais loin de puiser dans leurs fréquents entretiens des consolations et du courage, elle n’en emportait qu’inquiétude et accablement, effrayée de l’entendre parler de Dieu comme d’un justicier redoutable et non comme d’un père compatissant, de ne saisir dans son langage que des allusions à l’enfer et jamais la promesse du ciel. Quand elle le quittait, toute brisée par ses reproches, elle doutait de la possibilité de gagner le paradis, et durant de longues heures, elle pleurait sur son impuissance à se sanctifier. Malgré tout cependant, elle se laissait entraîner vers lui par un invincible attrait ; c’est toujours à lui qu’elle venait, sincère et humiliée, avouer ses faiblesses et jusqu’aux terreurs qu’il lui inspirait.
Jamais cette étrange influence ne s’était appesantie sur elle aussi lourdement que ce jour-là. La malheureuse femme se trouva dans la rue, décontenancée, tout en pleurs, sans énergie, regrettant presque de s’être confiée à ce prêtre dont la main semblait ne se lever que pour maudire, et non pour bénir. Depuis trois ans, elle s’était si complétement livrée à lui, qu’elle ne pouvait, dans son infortune, solliciter ailleurs un appui et un secours. Quel secours, quel appui trouvait-elle près de lui, à cette heure cruelle ? Il ne savait ni la consoler ni lui rendre le courage. Ame débile ! âme de femme ! s’était-il écrié. Eh bien, oui ! mais c’est pour cela qu’elle aurait eu besoin d’être soutenue. Ce qui lui arrivait n’était-il pas au-dessus des prévisions humaines ?
Maintenant qu’allait-elle faire ? Elle venait de s’opposer à ce que l’abbé Gavella vît les coupables pour leur parler des devoirs oubliés ; elle venait de revendiquer pour elle, pour elle seule, comme son droit d’épouse et de sœur, cette difficile tâche, non qu’elle se sentît entraînée à l’accomplir, mais parce qu’elle redoutait qu’en l’accomplissant avec les procédés d’inquisiteur qui lui étaient familiers il en compromît le succès. Il fallait donc agir, agir sur-le-champ, formuler des reproches, envenimer ses peines déjà si lourdes, de l’âpreté des querelles domestiques. C’était affreux. Pour trouver en soi la force d’obéir aux exigences de sa situation, elle dut se rappeler qu’il y avait deux âmes à tirer du péché, qui ne pouvaient en être tirées que par son intervention.
La nuit venait quand elle arriva chez Irène. L’ombre naissante voilait sa pâleur et son trouble. — Ma sœur est-elle là ? demanda-t-elle au domestique qui lui ouvrait la porte.
— Madame est partie pour Marseille, répondit cet homme ; elle reviendra demain.
Que sa sœur eût quitté Beaucaire pour vingt-quatre heures, sans l’avertir, il n’y avait rien là qui pût la surprendre. Depuis longtemps, elles se voyaient peu. La rareté de leurs entrevues était la conséquence des incidents qui avaient précédé le mariage de Nicolette, le témoignage de la volonté d’Irène de rassurer sa sœur, en évitant de se rencontrer avec Frédéric. Elle eut pourtant le cœur serré, comme si elle eût pressenti la gravité des circonstances et les causes de ce départ. C’était un répit cependant. Elle éprouva ce soulagement que procure aux esprits craintifs l’ajournement d’une explication pénible.
— Ce sera pour demain, pensa-t-elle.
Accablée, elle reprit le chemin de sa demeure, en se demandant si Frédéric y serait déjà rentré, si dans ce cas elle aborderait le sujet odieux dont elle était tenue de l’entretenir, et s’il ne convenait pas d’éviter toute discussion jusqu’à ce qu’elle eût parlé à Irène. Elle tournait et retournait la question dans son esprit. Elle se trouva chez elle sans l’avoir résolue.
— Où est mon fils ? dit-elle à la femme de chambre chargée de veiller sur l’enfant.
— Il n’est pas encore rentré, madame.
— Il est donc sorti ! s’écria-t-elle stupéfaite.
— Madame ne le savait-elle pas ? reprit la femme de chambre. Monsieur est venu prendre le petit pour le conduire chez sa tante Irène. Du reste, il a laissé cette lettre pour madame.
Nicolette s’empara de la lettre, vivement, sans comprendre, dominée déjà par la surprise et l’effroi. Elle ne se souvenait pas que Frédéric fût jamais sorti avec son fils. Dans quel but l’avait-il emmené ? Ce ne pouvait être, quoi qu’il eût dit, pour le conduire chez Irène, puisqu’Irène était partie. Ces pensées traversèrent son esprit, d’un trait, tandis que ses mains tremblantes déchiraient l’enveloppe. Fiévreusement, elle ouvrit la lettre et lut ce qui suit :
« Quand on vous remettra cette lettre, j’aurai quitté Beaucaire pour n’y plus revenir, décidé à ne vous revoir jamais. Vous serez libre, moi aussi, et vous pourrez vous considérer comme veuve. C’est vous qui me chassez de notre maison, et qui m’avez réduit à l’extrémité à laquelle je recours pour me délivrer.
« Depuis plus de trois années, je suis la victime de votre dévotion. En rebutant par vos dédains et vos rigueurs un cœur plein de vous, qui ne demandait qu’à se consacrer à vous éternellement, vous avez fait de moi un martyr. Longtemps j’ai subi mon supplice ; mais vous l’avez rendu intolérable, et c’est afin de m’y dérober que brisant ma carrière, je vais mettre l’Océan entre vous et moi.
« Je n’appartiens plus à l’armée, j’ai donné ma démission. De ma fortune personnelle, en possession de laquelle m’a mis la mort de mes parents, j’ai fait deux parts, après avoir vendu le château de Varimpré, où, grâce à vous, je ne reviendrai plus ; j’emporte l’une ; je vous laisse l’autre ; elle grossira votre dot demeurée intacte. Mon notaire vous fera connaître les dispositions que j’ai prises, et dont il ignore d’ailleurs le but.
« Vous auriez fait de mon fils un être à votre image ; vous l’auriez livré à des prêtres aussi violents et aussi intolérants que celui qui nous a perdus. Je regarde comme un devoir de le soustraire à l’éducation que vous vouliez lui faire. Peut-être le reverrez-vous un jour ; s’il me demande sa mère, je ne lui défendrai pas de venir vous rejoindre. Mais alors, il sera un homme, et armé par moi contre toute tentative qui aurait pour effet d’en faire un catholique semblable à vous.
« Ne cherchez pas à nous retrouver. Mes précautions sont prises pour vous empêcher de découvrir nos traces. Le monde vous plaindra ; il me blâmera. Vous saurez, vous, que je ne mérite pas la flétrissure qui me sera infligée, et que je suis encore plus à plaindre que vous ne l’êtes vous-même. D’ailleurs, dans l’exaltation de votre piété, vous trouverez un refuge contre votre douleur. Puissiez-vous en trouver un aussi contre vos remords ! »
C’était tout. Pendant une minute, les yeux voilés par l’épouvante, elle agita dans ses mains cette horrible lettre. Puis, tout à coup, le souvenir de sa sœur dont elle venait de constater l’absence se dressa devant elle comme une lumière aveuglante. Elle comprenait : Frédéric et Irène fuyaient ensemble, en emportant l’enfant.
— Mon fils ! mon fils ! gémit-elle.
Éperdue, affolée, elle voulut s’élancer au dehors, comme si elle espérait encore rejoindre les fugitifs et les ramener. Mais ses forces l’abandonnaient ; un nuage tremblant se formait devant ses regards ; ses genoux fléchirent. Elle étendit les bras, cherchant autour d’elle un appui. Il lui manqua, et elle tomba lourdement sur le plancher, sans connaissance.
FIN DU LIVRE PREMIER
Les premiers rayons d’un chaud soleil d’été, empourprant un ciel clair, doraient les toitures vermoulues et les murailles grises du couvent. Par les larges croisées aux vitres étroites, entr’ouvertes derrière leurs grilles de fer, ils pénétraient dans les profondeurs de la pieuse maison, où circulait librement l’air matinal, tout imprégné de la fraîcheur du Rhône montant, dans un flot de vapeurs roses, au long du roc au sommet duquel le Carmel dresse ses vieilles tours.
En bas, dans la plaine, la ville s’éveillait. Des clochers de Beaucaire tombait, dans le silence du jour naissant, la sonnerie de l’Angelus à laquelle répondait, franchissant le fleuve comme un vol d’oiseaux invisibles, la sonnerie des cloches de Tarascon. Au delà de la ville, la lumière embrasait déjà l’espace des champs, les prairies roussies et calcinées en cette brûlante saison par les feux du ciel, les cyprès, les oliviers et les saules, au feuillage tout poudreux de la poussière blanchâtre que soulève le mistral.
Quelques instants avant cinq heures, une sœur sortit de sa cellule. Sur sa chemise de serge et son jupon de laine, elle portait une robe de bure brune, serrée à la taille par une ceinture de cuir ; sur la robe, un long scapulaire. Chaussée de bas en étoffe grossière et d’alpagattes, elle avait sur ses cheveux coupés ras une guimpe et un voile. Sous ce vêtement tombant autour du corps en longs plis roidis comme s’ils eussent été pétrifiés, la grâce du sexe s’évanouissait. En se consacrant à Dieu, la religieuse abdique tout ce qui fait le charme de la femme. Celle-ci marchait à grands pas dans les couloirs où l’ombre se dissipait. Sa main droite tenait, en l’agitant, une matraque, petite planchette revêtue de deux barrettes d’acier qui frappaient le bois de coups secs et résonnants.
A ce bruit, les Carmélites subitement réveillées sautaient à bas de leur dure couchette, posant leurs pieds nus sur les carreaux froids. Le jour entrait joyeux dans les cellules ; il resplendissait sur la nudité des murs blanchis à la chaux, ornés d’une croix et de deux images de piété. En quelques instants, les religieuses eurent procédé à leur toilette, retourné les draps en laine sur leur matelas de paille soutenu par deux planches. Au coup de cinq heures, toutes les portes s’ouvrant à la fois, les saintes filles apparurent ensemble dans les couloirs, remplis soudain du frôlement de leurs sandales sur la pierre. Elles descendaient à la chapelle, toutes frissonnantes dans leur chair macérée, accablées sous la lassitude un moment vaincue par le sommeil, et renaissante avec le jour qui allait de nouveau faire peser sur leurs membres exténués le fardeau des longues privations, du jeûne et des maigres repas.
Maintenant, dans le chœur de la chapelle, derrière la haute grille à gauche de l’autel, les sœurs étaient agenouillées. Durant une heure, elles restèrent en oraison. Sur l’autel, deux cierges se consumaient ; leur flamme tremblante rougissait sous la lumière du dehors entrant par les vitraux. Tandis que dans la maison tout était pauvre et nu, dans l’oratoire plein de plantes vertes et de fleurs épanouies, la pourpre des étoffes, la finesse des dentelles, la blancheur des marbres, les ors des statues flamboyaient. On devinait que tout le luxe de la communauté se déployait là, pour Dieu seul, et qu’à ses pieds seulement les religieuses retrouvaient un souvenir affaibli du bien-être auquel elles avaient renoncé en renonçant au monde. La nappe de l’autel, taillée dans un lambeau de robe blanche, rappelait à quelqu’une d’entre elles le vêtement qui jadis, avant qu’elle eût fait vœu d’éternelle pauvreté, parait sa beauté sacrifiée depuis ; à quelque autre, le tapis déroulé sur les marches redisait les jeux de la maison paternelle où elle l’avait foulé, sous ses pieds d’enfant, avant d’en faire don au couvent, en y entrant. Les plantes et les fleurs parlaient aussi à ces âmes subjuguées par la folie de la croix ; dans les couleurs éclatantes des pétales et dans les parfums des calices, elles aspiraient le passé auquel elles ne songeaient plus que pour en expier les innocentes joies et les rêves d’avenir, qu’avait brisés l’implacable vocation dont elles subissaient les lois rigoureuses.
Au bout d’une heure, pendant laquelle le bruit des respirations contenues troubla seul la quiétude silencieuse du couvent, une sœur se leva. D’une voix douce et simple, elle entonna le chant des psaumes sacrés. Toutes s’unirent à elle aussitôt. Rien de joyeux ni d’expressif dans cette psalmodie. C’était une mélopée traînante et monotone, d’une mélancolie maladive. Les paroles latines tombaient des bouches sans accent de ferveur, avec une naïveté enfantine, comme un texte incompris, récité par habitude et par devoir. Mais de la froideur apparente de ce chant, l’ardeur de la prière se dégageait.
La messe succéda à l’office psalmodié. De la sacristie, un prêtre était sorti précédé d’un enfant de chœur, pour célébrer le saint sacrifice. De toutes parts, autour de lui, ce n’étaient qu’extases et soupirs. Quand la communion groupa les religieuses derrière la grille à travers laquelle il devait déposer l’hostie sur leur langue en récitant les paroles saintes, il y avait dans l’attitude des corps penchés une expression d’adoration passionnée et de fiévreuse attente, comme si l’amant divin que sollicitaient ces vierges béatifiées et qu’elles allaient recevoir, devait éteindre leurs désirs, combler le vide de leurs cœurs exaspérés par la contemplation et l’espoir des jouissances éternelles qu’elles cherchaient à mériter et dont cette union solennelle avec Jésus leur révélait déjà, quoique imparfaitement, l’ineffable volupté.
Tout en haut du chœur, dans une stalle, près de l’autel, se tenait la prieure. La croix abbatiale qui brillait sur sa poitrine la distinguait des sœurs sur qui elle régnait canoniquement et dont elle était l’élue pour trois années, conformément à la règle. Quoiqu’elle fût de petite taille et qu’on devinât, sous les amples plis de sa robe, un corps amaigri, l’autorité qu’elle exerçait se manifestait visiblement, révélée par la place où elle se tenait, par son geste, par des regards rapides jetés sur son troupeau. Lorsque, la messe terminée, le prêtre eut quitté l’autel, les religieuses, après de courtes actions de grâces, sortirent de la chapelle. Avant de sortir, elles défilèrent toutes devant la prieure, en faisant une longue génuflexion. La prieure ne quitta sa stalle que lorsqu’elle eut ainsi reçu de toutes ses sœurs cet humble salut. Elle les suivit dans le jardin. Déjà, elles s’éloignaient pour vaquer aux occupations manuelles qu’ordonne la règle des Carmélites. D’un signe, elle appela l’une d’elles, qui accourut et tomba à genoux le front courbé.
— Sœur Marie du Calvaire, dit la prieure d’une voix froide et tranchante, tout à l’heure, pendant la messe, vous avez adressé la parole à votre voisine, sœur Claire Magdeleine, et je vous ai vue sourire.
— C’est vrai, ma Révérende Mère, répondit la religieuse interpellée. Je ne trouvais pas dans mon bréviaire l’hymne du jour, et j’ai demandé à quelle page il se trouvait. Si j’ai péché, ma Révérende Mère, je m’accuse. Punissez-moi.
En prononçant ces mots, elle se prosterna, baisa la terre et demeura ainsi, le front dans la poussière, attendant un ordre pour se relever, exposée à demeurer dans cette attitude, si la prieure l’eût voulu ou l’eût oubliée, jusqu’à ce que la cloche l’appelât à un acte prescrit par la règle.
— Vous avez eu tort de rire pendant la messe. Vous ferez dix fois le tour du jardin, les pieds nus, en récitant l’Ave Maria et en portant la croix.
La pénitente se releva silencieuse. Sous le porche qui séparait le jardin de la chapelle, il y avait, appuyée dans un angle, contre le mur, une lourde croix en bois noir, plus haute qu’elle. L’ayant soulevée après s’être déchaussée, elle en chargea ses épaules comme Jésus-Christ avait chargé les siennes de l’instrument de son supplice, et le corps courbé sous le faix, elle commença sa fatigante promenade en passant et repassant devant une de ses compagnes qui se tenait accroupie dans un coin du jardin, en plein soleil, les yeux bandés, une corde au cou, les mains liées derrière le dos, — acte d’humiliation volontaire que les plus ferventes dans les communautés aiment à s’imposer.
La sévérité de la prieure n’avait surpris aucune des sœurs. A tout instant, les Carmélites sont témoins ou victimes de pénitences analogues ordonnées de la sorte, ou subies du plein gré de celles qui l’accomplissent, et toujours accomplies joyeusement.
Les religieuses s’étaient dispersées. Toute la communauté maintenant se livrait au travail. Les unes montaient des fleurs artificielles pour orner l’autel ; les autres ravaudaient leurs vêtements usés ou préparaient dans la cuisine les mets destinés au déjeuner.
La prieure était rentrée dans sa cellule. Assise devant une table couverte de papiers, elle répondait aux lettres arrivées le matin, et s’occupait des divers détails relatifs à la direction qu’elle exerçait. Un grand silence régnait autour d’elle. De temps en temps, elle se levait, faisait quelques pas vers la fenêtre et aspirait une bouffée d’air pur, en laissant errer ses regards à travers le jardin où se balançaient, au souffle de la brise du Rhône, les fleurs tremblantes sur leur tige.
Il était frais et charmant, ce petit jardin dessiné dans les terres apportées à grand’peine sur le rocher. Un lierre épais, entremêlé de vigne vierge et de jasmin d’Espagne grimpant au long des bâtiments, encadrait les croisées. Entre les bordures de buis, s’allongeaient les pelouses coupées à intervalles égaux par les bandes de dahlias, de rosiers et de lys. Un rideau de cyprès fermait l’horizon du côté du fleuve, rappelant sans cesse à celles qui habitaient ces lieux qu’au delà de cette barrière verdoyante, rien ne devait les émouvoir ni les préoccuper, que dans ce cadre étroit se concentraient les seules distractions qu’il leur fût permis de connaître. Entre ces rares distractions, une des plus douces était la contemplation des beautés de la nature, arbres et fleurs, ordonnée par la poétique sainte Thérèse. C’est pour obéir à leur illustre fondatrice qu’aux heures de récréation, les religieuses cultivaient le parterre, dont les produits embaumés allaient chaque jour orner la chapelle.
La prieure se tenait devant la croisée, suivant d’un œil indifférent la sœur Marie du Calvaire, qui, toute lasse, accablée sous le fardeau de la croix, achevait d’accomplir sa pénitence, quand, à la porte de la cellule, un coup léger se fit entendre. La prieure tressaillit, et revint lentement s’asseoir devant la table en répondant :
— Entrez.
La porte s’ouvrit. Sur le seuil apparut une belle jeune fille, grande et blonde, à l’œil brillant et doux, vêtue de l’habit des postulantes.
— C’est vous, Jeanne Mauroy, dit la prieure avec bienveillance ; avancez. Que désirez-vous ?
La jeune fille fit quelques pas, les yeux baissés, les bras croisés sur la poitrine. Arrivée devant la prieure, dont elle n’était séparée que par la table, elle s’agenouilla et dit :
— Mon confesseur m’a ordonné de venir vous trouver, ma Révérende Mère.
— Oui, je me souviens ; il m’a parlé de vous. Vous pouvez vous relever. Jeanne obéit et se tint debout. La prieure continua : — Vous êtes donc impatiente de voir arriver le jour de votre prise d’habit ?
— Voilà six mois que je suis postulante, ma Révérende Mère, et je serais heureuse d’être admise au noviciat.
— L’épreuve que vous venez de subir vous suffit-elle ?
— Sous la forme où elle m’a été imposée, oui, ma Révérende Mère. Jusqu’ici, je reste convaincue que Dieu m’ordonne d’embrasser son service. Si je me trompe, si ma vocation est autre, ce n’est qu’une épreuve plus complète qui me l’apprendra. Quand je porterai l’habit, quand je subirai toutes les rigueurs de la règle, alors seulement je pourrai décider si je suis en état de m’y soumettre pour toute ma vie.
— Vos parents sont-ils avertis ?
— Je ne dépends que de mon tuteur et d’un conseil de famille dont les membres, vous le savez, ma mère, sont d’accord avec lui et avec moi. Tous nous aimons et nous craignons Dieu. Aucun de nous ne veut résister à ses ordres. Ceux qui m’aiment m’envient, alors même qu’ils regrettent de me perdre. C’est eux qui m’ont confiée à vous…
Il y eut un long silence. La prieure observait ce candide et fier visage, au regard caressant, dont la chevelure sous la coiffe sans grâce ceignait le front d’une auréole d’or, les contours de la taille robuste et souple, les hanches saillantes et fines ; elle admirait le charme exquis, fait de jeunesse et de grâce, que Jeanne exerçait partout autour d’elle à son insu.
— Vous êtes belle, mon enfant, fit soudain la prieure. Vous pourriez briller dans le monde.
— Je ne veux briller que pour le ciel.
— En quelques années, la vie qu’on mène ici, les rigueurs de la règle, les privations auront flétri votre beauté. Jeune d’âge, vous serez vieille de corps. Ne regretterez-vous pas les biens que vous aurez sacrifiés ? Réfléchissez, mon enfant. Malheur à vous si, après avoir prononcé des vœux éternels, s’élevait dans votre cœur le regret de ce que vous auriez volontairement perdu.
— Je ne regretterai rien, ma mère.
— J’ai été jeune comme vous, insista la prieure en se levant, oui, jeune, et l’on disait que j’étais jolie. Voyez ce que le cloître a fait de moi.
Brusquement, elle se mit en pleine lumière comme pour obliger Jeanne à regarder les traits défaits, les joues ridées, les cheveux presque blancs et le regard sans vie de Nicolette Suarez, veuve de Frédéric de Varimpré, en religion Sœur Thérèse de Jésus, prieure du Carmel de Beaucaire.
Jeanne Mauroy sentit un frisson monter de ses pieds à sa tête, sans comprendre si le langage qu’elle entendait contenait une plainte ou un suprême conseil. Elle se redressa cependant, et dit avec respect :
— Que ne pouvez-vous me révéler aussi votre âme, ma Révérende Mère ? Ne s’est-elle pas embellie de tous les attraits qu’a perdus votre corps ?
Émue par cette réponse spontanée, la sœur Thérèse de Jésus s’assit, en disant :
— C’est mon devoir de vous montrer toutes les duretés de la vie que vous voulez embrasser ; rien ne serait plus fatal qu’une erreur. C’est aussi mon devoir d’ajouter que si votre vocation est sincère, les sacrifices que Jésus vous demande en échange de son amour vous seront doux et légers. Cet amour est infini ; il vous tiendra lieu de tout. La prise d’habit que vous sollicitez ne constitue pas d’ailleurs un engagement définitif. Elle n’est qu’une initiation au noviciat, durant lequel nous aurons le temps d’étudier votre âme et de décider si vous devez rester parmi nous. Allez, mon enfant.
— Alors, ma mère, je peux espérer d’être bientôt novice ? demanda Jeanne.
— Pourquoi m’interrogez-vous ? répliqua la prieure durement. Vous aspirez à la perfection, et vous ne savez même pas réprimer les impatiences de votre curiosité. Offrez à Dieu l’attente qu’on vous impose, et remettez-vous-en à la décision de nos mères que je dois consulter.
Jeanne s’agenouilla contrite, baisa le plancher, et, se relevant silencieuse, elle s’éloigna. Nicolette la regarda sortir sans rien ajouter. Dans ses yeux où depuis longtemps semblait tarie la source des larmes, des larmes lentement montaient qu’elle ne voulait pas laisser voir. Se parlant à elle-même, elle murmura :
— C’est moi à vingt ans. Il me semble que je me revois vivre telle que j’étais alors. Puisse la vocation de cette enfant être aussi sincère que la mienne, Seigneur ! Daignez lui épargner les douleurs que vous m’avez prodiguées.
Elle fit le signe de la croix, et courbant la tête sur sa table de travail, elle reprit sa tâche interrompue.
La sœur Thérèse de Jésus avait alors quarante-cinq ans. Si la plupart des femmes soucieuses de conserver leur beauté semblent jeunes encore à cet âge, halte au seuil de la vieillesse et préparation au temps désenchanté qui verra les hommes se détacher d’elles, la prieure des Carmélites, elle, ne possédait plus ni la jeunesse, ni même les apparences de la jeunesse. Des rides plissaient son front qu’écrasait le lourd fardeau des soucis. Sous ses yeux, les larmes avaient tracé un sillon violacé. L’insomnie des nuits fiévreuses, l’altération de la santé, les luttes douloureuses soutenues par l’âme toujours debout contre les tentations de la chair, se trahissaient sur les joues creusées et osseuses. Tout le corps s’inclinait dans une attitude d’accablante fatigue, dans une habitude d’énervantes privations.
Personne n’eût reconnu sur ce pâle visage et ces traits amaigris, dans ce triste regard et sous ces cheveux grisonnants, la jeune fille passionnée et ardente dont le charme troublant avait un jour, vingt-cinq ans avant, séduit Frédéric de Varimpré. La vie religieuse avec ses austérités et ses mortifications, aboutissant toutes à un éternel renoncement des joies humaines, produit ces effets. Elle éteint sur la face de ceux qui l’embrassent les belles flammes de la jeunesse. Elle les éteint dans le regard qu’elle refroidit, et les concentre dans le cœur où elles ne brûlent plus que pour Dieu. Lui seul en connaît l’intensité, révélée dans les élans de la prière. L’homme peut croire qu’elles sont étouffées, et ces saintes âmes devenues, rayon de foi dans un bloc d’égoïsme, indifférentes à ce qui n’est pas leur salut. Il se trompe ; il ne sait pas quelle tendresse pour l’humanité souffrante vibre dans ces cœurs extasiés. Il y a là des trésors d’infinie bonté qui n’ont d’autre manifestation que la prière, se répandant, comme un parfum, quand la religieuse prosternée devant l’autel implore le ciel pour les pécheurs, et dans des privations incessamment renouvelées, volontairement acceptées, expie leurs fautes, aussi repentante que si elle les avait commises. Folie, dit le monde en raillant. Soit, mais folie qui même en ses excès mérite le respect autant que la pitié, puisqu’elle fait des martyrs.
Il semble que Nicolette, après avoir si passionnément et si longtemps souhaité ces austères douceurs, aurait dû être heureuse dans la plénitude de son rêve réalisé, et posséder la paix de l’âme, l’unique bien qu’elle lui eût demandé. Mais cette paix lui manquait. Ce n’étaient pas seulement les duretés monastiques qui l’avaient réduite à cet état où elle n’apparaissait que comme une ombre de ce qu’elle avait été jadis, c’était ce défaut de paix intérieure. Quand l’âme ne traîne derrière soi ni regrets ni remords, le corps, après maintes défaillances, se redresse, se durcit, s’assouplit aux souffrances ; il les endure sans en être éprouvé. Mais si les cheveux de Nicolette avaient blanchi, si la source de ses larmes s’était épuisée, si son regard n’exprimait plus que la tristesse, c’est que partout la suivait le cortége de ses amers souvenirs, ces souvenirs dont elle ne pouvait se délivrer.
Partout, dans la chapelle, sur son grabat, sur la dalle froide du cloître ou sur la terre nue du cimetière, et même quand, agenouillée dans sa cellule, elle meurtrissait ses reins en les frappant d’une lanière de cuir, partout elle le retrouvait, ce long cortége des souvenirs implacables. Elle se revoyait dans sa maison, d’abord heureuse, et heureuse par l’amour, puis se refusant à la tendresse de son mari et l’obligeant à fuir pour toujours. Elle se rappelait le terrible prêtre dont elle avait subi l’influence fatale. Il était mort depuis longtemps, sans que le bonheur détruit par lui fût ressuscité. Elle se rappelait l’inoubliable soirée témoin de son infortune, la lettre de Frédéric lui apprenant qu’il partait et disparaissait à jamais, emmenant son fils et Irène. Oh ! le malheureux ! De cet oubli de tous ses devoirs, de l’enlèvement qui arrachait un enfant à sa mère, du rapt qui faisait de l’époux longtemps fidèle un époux adultère et incestueux, il ne pouvait être excusé. Mais, en lui rendant son foyer odieux, en lui fermant ses bras, en le rejetant dans ceux d’Irène, n’avait-elle pas été aussi coupable que lui ?
Tel est le remords qu’elle portait. Pendant dix ans, déchirée par sa douleur maternelle, pleurant son fils perdu, elle s’était efforcée d’oublier. L’oubli n’avait pas répondu à son appel. Toujours saignante, la plaie de son cœur, sans qu’un espoir trompé sans cesse et une prière non interrompue eussent pu la cicatriser. Elle avait rempli des clameurs de son désespoir son foyer désert, invoqué la justice des hommes, cherché son fils de tous côtés. Vains efforts, tentatives inutiles. L’enfant n’était pas revenu. Puis, un jour, elle avait appris le décès de son mari, mort au Brésil, laissant orphelin le cher petit et Irène sans appui. Elle s’était empressée de jeter sur leurs traces un homme investi de sa confiance. Mais quand cet homme arrivait au Brésil, Irène et l’enfant avaient déjà disparu. Alors, devenue veuve, Nicolette obtenait la faveur longtemps sollicitée d’entrer au Carmel. Elle y était depuis, deux fois élue prieure par ses sœurs, parmi lesquelles elle reprendrait modestement sa place, à l’expiration de son pouvoir triennal renouvelé.
Mais vainement elle cherchait à oublier le passé. Il revenait sans cesse à sa mémoire, lui ramenant l’image de son fils, enfant quand on l’avait arraché à ses bras, homme maintenant s’il vivait encore. Oh ! ce doute, quelle douleur il engendrait dans cette âme qui aurait voulu ne songer qu’à Dieu ! Vivait-il, l’être adoré, fruit de ses entrailles ? S’il vivait, pourquoi ne venait-il pas retrouver sa mère ? Ne la connaissait-il pas ? Peut-être luttait-il contre la misère ! Peut-être, du fond de l’abîme où il se débattait, implorait-il le secours maternel ! Que n’entendait-elle sa voix ! Avec quelle ardeur elle aurait volé à son aide, la main tendue, les bras ouverts ! Peut-être était-il mort ! Mais alors, goûtait-il dans le sein de Dieu la joie des élus ? Toujours elle pensait à lui ; elle pensait à Irène, dont elle ignorait aussi le sort, dont elle déplorait le crime, en suppliant le ciel de pardonner.
Le souvenir de Frédéric pesait d’un poids non moins lourd sur sa conscience. En rendant l’âme, avait-il eu le temps de se repentir ? La main d’un prêtre s’était-elle étendue sur lui pour l’absoudre ? Jouissait-il de l’infinie miséricorde ? Questions cruelles, toujours menaçantes, jamais satisfaites ! Elles infligeaient à Nicolette une horrible torture, troublaient son repos, la poursuivaient jusque dans les pieux exercices de son état, répandaient sur ses jours l’amer poison du remords, sa conscience lui rappelant à toute heure et partout qu’elle avait une large part dans la responsabilité des catastrophes accomplies ou redoutées, et qu’elle aurait à en répondre au divin tribunal.
Depuis le lever du soleil, une grande agitation régnait dans le couvent, où tout se préparait pour la vêture de Jeanne Mauroy. Il est d’usage que le matin du jour où elle doit prendre l’habit religieux, la postulante quitte le Carmel, dès l’aube, afin de passer auprès de sa famille les heures qui précèdent la cérémonie, et que sa famille elle-même la conduise à la chapelle. Mais Jeanne Mauroy étant orpheline, son tuteur et ses proches venus pour l’assister en ce moment solennel, n’habitant pas Beaucaire, elle était restée au couvent. C’est de là qu’elle devait sortir pour aller à l’autel. Retirée dans la cellule qu’elle habiterait désormais, elle attendait l’heure de la cérémonie, cette heure ardemment appelée. Agenouillée devant la croix, elle priait, parée déjà de la robe de mariée et de la couronne de fleurs d’oranger, toilette virginale dans laquelle elle était tenue de se présenter au Carmel.
Jamais sa beauté n’avait eu plus d’éclat ; elle resplendissait sur le visage transfiguré par la béatitude de l’âme, dans le regard où brillait une flamme joyeuse, et sur tout le corps dont les pures lignes se dessinaient sous le blanc satin des vêtements. Au moment de s’immoler, cette beauté s’affirmait une dernière fois dans l’épanouissement merveilleux de ses trésors prodigués. Des adjurations brûlantes tombaient des lèvres de la néophyte. Elle se laissait ravir par l’extase, comme si, prête à consommer sa rupture avec le monde, elle eût entendu la voix de son maître lui dire :
— Je ne veux plus que tu converses avec les hommes, mais seulement avec les anges.
Dans l’emportement de cette extase, elle embrassait par la pensée, comme dans une vision surnaturelle, sa vie future à chaque étape de laquelle elle devait trouver un sacrifice à accomplir, une indicible joie à goûter. Les vœux de pauvreté, de chasteté, d’obéissance qu’elle se préparait à prononcer ne lui coûtaient rien. En se donnant à Dieu, elle allait renoncer à tout ce qui n’était pas lui ; mais elle était heureuse de se donner ainsi entièrement, sans restriction, corps et âme. Elle se regardait comme déjà morte au monde, ensevelie avec Jésus-Christ derrière les grilles inaccessibles, convaincue qu’une âme n’est grande qu’anéantie par l’humilité. Dans ce bonheur par avance savouré, il y avait de la volupté.
Elle se voyait consacrant ses jours à la méditation, à la prière, au silence, se détachant des préoccupations de la terre pour mieux s’assurer le ciel, meurtrissant son corps sous un cilice, expiant les fautes de l’humanité dans d’incessantes mortifications. Les flèches de l’amour divin, de part en part, perçaient son cœur ; elle ambitionnait d’en sentir profondément les déchirures et, toute saignante de ces coups réitérés, d’arriver à la mort, au delà de laquelle rayonnait la suprême récompense.
Elle avait vingt ans, et c’est la mort qu’appelait surtout sa jeunesse sacrifiée, la mort, aurore des noces éternelles. Sur ses lèvres vermeilles, voltigeait déjà la prière qu’elle réciterait au moment de franchir les portes de l’éternité : « O mon Seigneur et mon époux, l’heure est enfin venue ; nous allons nous voir. Mon tendre maître, voici le moment du départ. Soyez-en mille fois béni, et que votre volonté s’accomplisse. Il est temps que je sorte de cet exil et que mon âme, ne faisant qu’une avec vous, jouisse de ce qu’elle a tant désiré. »
L’espoir de cette union mystique déchaînait dans son cœur une ardeur amoureuse, dans son corps le frémissement des mystérieuses attentes qui s’empare des vierges au seuil du lit nuptial, frémissement embelli pour elle et purifié par la conviction que l’amant dont elle sollicitait les étreintes était, non un homme, mais un Dieu. Et son âme, toute ravivée, se répandait en appels et en larmes, crise délicieuse à laquelle elle s’abandonnait dans un transport poussé jusqu’au delà de la raison.
La porte de sa cellule s’ouvrit. Elle s’était laissé emporter si haut, si loin de la terre, qu’elle n’entendit pas le bruit. La prieure, qui venait d’entrer, s’approcha d’elle, lui toucha l’épaule et dit :
— Voici l’heure, ma fille, suivez-moi.
Elle se leva silencieuse. La prieure, dont le voile laissait le visage découvert, l’embrassa, puis, la précédant, quitta la cellule. Elles traversèrent les couloirs tranquilles, et par l’escalier désert descendirent. Au pied de l’escalier, par delà la porte de clôture ouvrant sur la grande cour, se tenaient le tuteur et les parents de Jeanne. La prieure la leur confia, et s’éloigna pour entrer dans le chœur où les religieuses se trouvaient déjà réunies. Jeanne et les siens franchirent la porte, traversèrent la cour se dirigeant vers la chapelle. Les fidèles venus pour assister à sa prise d’habit l’attendaient là. Ils saluèrent son apparition d’un long murmure. Elle s’avança le long de l’espace resté vide entre les chaises jusqu’au prie-Dieu préparé pour elle devant l’autel. Elle souriait, en saluant à droite et à gauche, au moment de leur dire adieu, ceux qu’elle aimait. Mais le tremblement de ses mains gantées, l’expression séraphique de son regard, trahissaient la violente émotion qui la dominait à cette heure solennelle où elle allait se donner à Dieu, en attendant l’engagement suprême qu’elle prendrait à un an de là, après avoir subi les épreuves du noviciat.
La chapelle avait la physionomie des jours de fête. Tout autour de l’autel, sur les degrés recouverts d’un tapis, entre les cierges allumés autour du tabernacle, et sur les murs jusqu’aux voûtes, ce n’étaient que plantes et fleurs. Les lys et les roses étoilaient la sombre verdure des lauriers et des palmes. Leurs parfums s’exhalaient dans la vapeur tiède qui flottait sous les lumières. L’or des candélabres, les marbres des degrés, les ferrures de la grille placée à gauche de l’autel, devant le chœur réservé, brillaient de mille reflets avivés et scintillant entre les feuilles, comme les rayons du soleil à travers les ramures d’une forêt.
Ordinairement, devant cette grille, un rideau noir est tendu. Relevé ce jour-là, il laissait voir l’intérieur du chœur des religieuses resplendissant de lumières, et les sœurs debout dans leur stalle, un cierge à la main, les novices voilées de blanc, les professes voilées de noir, attendant le moment de se mettre en marche pour aller vers la porte de clôture à la rencontre de la postulante qui ne les avait quittées un moment que pour les rejoindre bientôt.
Elle s’était agenouillée, anéantie dans un ravissement qui derrière les barreaux farouches lui montrait le paradis et ses joies ineffables. Autour d’elle, des prêtres allaient et venaient, mettant la dernière main aux préparatifs de la cérémonie solennisée par la présence de l’évêque de Nîmes, qui devait officier et consacrer de ses mains la nouvelle novice. Des rumeurs de voix poursuivant doucement des entretiens d’une chaise à l’autre, le bruit des arrivants qui se plaçaient peu à peu, troublaient encore la paix de la chapelle. Tout à coup le silence se fit. Le prélat sortait de la sacristie, entouré des prêtres assistants et des enfants de chœur.
A ce moment, un nouveau venu se présentait au couvent. C’était un jeune homme à la figure pâle, aux cheveux châtains, avec un regard vif et doux à la fois, révélant l’esprit d’initiative et d’énergie. Une moustache très-fine, aux tons fauves, relevait le caractère un peu féminin de sa physionomie. Il avait la taille élevée, mince et bien prise. La poussière blanchissait ses vêtements et ses chaussures. Un petit sac en cuir, retenu par une courroie, achevait de lui donner l’air d’un voyageur fraîchement débarqué.
A la faveur de l’agitation qui, ce jour-là, troublait la tranquillité du couvent, il avait pu pénétrer dans la vaste cour conduisant à la chapelle. Il s’était arrêté, laissant errer ses regards de tous côtés, dans l’attitude d’un homme qui cherche quelque chose ou quelqu’un. Debout sur le seuil de la chapelle ouverte, la tourière suivait l’office de cette place sans perdre de vue l’entrée. Elle l’aperçut et alla vers lui :
— Vous venez pour assister à la cérémonie, monsieur ? dit-elle à demi-voix.
— Quelle cérémonie ? demanda-t-il surpris.
— Que voulez-vous, alors, si vous n’êtes venu pour cela ?
Mais, au lieu de répondre, il interrogea :
— C’est bien ici la communauté des Carmélites ?
— Oui, monsieur.
— Cette communauté est dirigée par madame de Varimpré, en religion sœur Thérèse de Jésus ?
— C’est en effet le nom de notre Révérende Mère.
— Je veux la voir.
— Elle n’est pas visible aujourd’hui.
— Il faut que je lui parle sur-le-champ, il le faut, répondit l’inconnu avec l’expression d’une ferme volonté.
— Personne ne peut lui parler en ce moment, reprit la tourière troublée par l’exigence formulée devant elle. Elle est au chœur avec toutes nos mères. Nous avons une prise d’habit ; vous pouvez vous en assurer par vous-même. Après la cérémonie, si ce que vous avez à dire à madame la prieure est pressé, elle pourra vous recevoir.
— C’est bien ; j’attendrai.
— Vous pouvez entrer dans la chapelle, monsieur, dit encore la tourière.
Puis, voyant que le visiteur ne se hâtait pas de profiter de l’invitation, elle regagna sa place sous le porche, le laissant au milieu de la cour. Il y resta, se promenant à grands pas, inquiet et fiévreux, à l’ombre des murailles derrière lesquelles son regard curieux semblait vouloir pénétrer. Parfois, il s’arrêtait, prêtait l’oreille, et après avoir constaté que les chants n’étaient pas achevés, il reprenait sa promenade, sans dissimuler son impatience, surexcitée par l’attente.
Tout à coup, s’éleva dans la nef un grand bruit de chaises. Les rares personnes qui, n’ayant pu y trouver place, s’étaient tenues sur les degrés extérieurs, se rangèrent à droite et à gauche pour laisser la sortie libre. La tourière courut au jeune homme et lui dit :
— Vous ne pouvez rester là, monsieur. Voici la postulante.
Il se jeta contre le mur, les yeux fixés sur l’intérieur de la chapelle au fond de laquelle la flamme des cierges poussait jusqu’aux voûtes une lumière rougeâtre, tremblante sous l’éclat du jour qui entrait par les vitraux. Dans le cadre de la large baie, il vit apparaître Jeanne Mauroy. Jamais plus radieux visage ne s’était offert à ses regards. Suivie du clergé qui chantait le Magnificat et les fidèles, hommes et femmes, attristés comme s’ils eussent suivi son cercueil, elle marchait modeste et calme, dans une attitude de recueillement. Sur ses lèvres errait un sourire ; un rayon de joie céleste brillait dans ses yeux. Ils s’arrêtaient au passage, ces yeux extasiés, sur les figures amies, consternées. Ils exprimaient l’étonnement que causait à cette adorable enfant la tristesse surprise autour d’elle, quand tant de bonheur l’enveloppait. En arrivant auprès du visiteur inconnu, elle les leva aussi sur lui, comme pour lui donner une part de ses adieux. Mais, soit que la présence d’un étranger l’eût surprise, soit qu’elle eût été troublée par l’expression d’admiration et de pitié qu’elle venait de saisir sur des traits qu’elle voyait pour la première fois, un flot de sang empourpra ses joues, montant jusqu’aux paupières subitement abaissées. Elle hâta le pas, et passa, non assez vite cependant pour empêcher que le souvenir de sa beauté se fixât dans la mémoire de ce jeune homme que sa présence venait de bouleverser. Il s’était tourné vivement vers la tourière inclinée à son côté et disait à demi-voix :
— Le nom de cette personne, madame ?
La tourière resta silencieuse une minute ; puis elle répondit :
— Qu’importe son nom ! Tout à l’heure, elle ne s’appellera plus que sœur Nicette de la Croix.
De l’autre côté de la cour, la porte de clôture venait de s’ouvrir de nouveau. Sur le seuil, trois religieuses s’avançaient ayant le voile baissé. Deux d’entre elles tenaient un cierge à la main. L’autre les précédait, portant une croix en bois noir sans christ. La postulante s’agenouilla et baisa l’extrémité de cette croix. Puis elle se releva, salua les assistants qui l’avaient accompagnée jusqu’à cette porte et ne pouvaient la suivre au delà. C’était la première étape de l’éternelle rupture avec le monde, et lorsque les lourds battants de bois se refermèrent sur la procession qui s’éloignait en psalmodiant une hymne à la Vierge, un frisson passa sur le petit groupe des fidèles. Tandis qu’ils regagnaient leur place dans la chapelle, la postulante traversa le cloître à la suite des sœurs, conduite au chœur par la prieure et jusque devant la haute grille où elle s’agenouilla. Maintenant, de l’autre côté de la grille, elle apercevait l’évêque, debout, entouré des prêtres assistants, coiffé de la mitre, appuyé sur sa crosse, vêtu d’une chape aux reflets d’argent.
— Ma fille, que demandez-vous ? dit-il.
— La miséricorde de Dieu, la pauvreté de l’Ordre et la compagnie des sœurs, répondit-elle.
— Est-ce de votre propre mouvement et de votre plein gré que vous vous présentez pour recevoir l’habit de ce saint Ordre ?
— Oui, monseigneur.
— Avez-vous dessein de persévérer dans l’Ordre jusqu’à la fin de votre vie ?
— Oui, monseigneur.
— Voulez-vous donc entrer dans l’Ordre pour le seul amour de Notre-Seigneur ?
— Oui, avec la grâce de Dieu et les prières des sœurs.
Elle avait parlé d’une voix ferme.
— Que Dieu achève en vous son ouvrage ! reprit l’officiant.
Puis il lui adressa une brève et touchante exhortation qu’il termina en disant :
— Que le Seigneur vous dépouille du vieil homme !
Quand il eut fini, la postulante fut emmenée par la prieure. Tandis qu’elle était absente, le prélat bénit le scapulaire, la ceinture et le manteau qu’elle allait recevoir de ses mains.
Elle revint bientôt, transformée déjà, préparée pour l’ensevelissement volontaire qu’elle s’imposait. Elle avait quitté ses vêtements de mariée et revêtu une robe de bure qui l’enveloppait comme d’un suaire. A ses pieds, les bas de laine et les sandales remplaçaient les souliers de satin. Une guimpe cachait la pureté des épaules, s’étendait sur le corsage en plis roidis sous lesquels semblait s’être évanouie la grâce des formes. Enfin, de la soyeuse chevelure qui tout à l’heure couronnait sa beauté, les boucles épaisses n’existaient plus. Elles gisaient là-bas comme des fleurs flétries. Les ciseaux les avaient coupées jusqu’à la racine, ne laissant sur la tête que des cheveux ras, qui se redressaient sous la coiffe blanche comme révoltés contre le barbare traitement qui venait de dépouiller le front de sa plus belle parure.
De nouveau, la postulante se tenait devant la grille. Quoique découronnée, sa tête fine et fière resplendissait toute radieuse. Les assistants purent alors admirer le visage où s’exprimait une divine sérénité, et dont aucun regret n’altérait la quiétude. Des mains d’un prêtre, le pasteur recevait tour à tour la ceinture, le scapulaire, le manteau blanc. Il les passait à la postulante en prononçant pour chacun de ces objets les paroles sacrées. En lui mettant la ceinture, il disait : — Quand vous étiez plus jeune, vous vous ceigniez vous-même et vous alliez où il vous plaisait. Mais lorsque vous aurez vieilli, un autre vous ceindra. En lui mettant le scapulaire : — Prenez le joug de Jésus-Christ qui est doux et son fardeau qui est léger. En lui mettant enfin le manteau : — Ceux qui suivent l’agneau sans tache, marcheront avec lui vêtus de blanc. C’est pourquoi que vos vêtements soient toujours blancs, en signe de votre pureté intérieure.
Tout était dit. Le prélat jeta l’eau bénite sur la novice, et, se mettant à genoux, il entonna le Veni, Creator. Après la première strophe, tandis que les religieuses se tenaient debout à leur place, la prieure prit la sœur Nicette par la main et la conduisit au milieu du chœur, où elle la fit étendre sur un tapis de serge, les bras en croix. Tant que dura le chant sacré, elle resta ainsi, la face contre terre, dans l’immobilité de la mort. Elle ne se releva que pour aller porter à ses compagnes le baiser fraternel. Puis les religieuses sortirent du chœur processionnellement, et les assistants se retirèrent. Le visiteur étranger fit comme eux.
Il avait observé tous les détails de la cérémonie, des larmes aux yeux, le cœur étreint par l’angoisse. De nouveau, il se trouva dans la cour, attendant la prieure. Mais maintenant son impatience de tout à l’heure s’était apaisée. Un lourd accablement pesait sur lui, une impression cruelle qui détournait sa pensée du but de sa visite. Il mesurait du regard les lourds bâtiments du monastère. Peut-être rêvait-il d’y pénétrer de gré ou de force pour en faire sortir la créature qu’il venait de voir s’enterrer vivante. Peut-être se demandait-il où puise son énergie la passion indomptable qui jette aux bras d’un amant crucifié les vierges de vingt ans et les pousse à choisir une vie martyrisante comme le plus beau et le plus enviable des destins.
— Veuillez me suivre au parloir, monsieur, dit tout à coup près de lui la voix de la tourière. Ma mère prieure va s’y rendre.
Il obéit en silence, ramené à la réalité par cette invitation, repris par l’impatient émoi qui le dominait tout à l’heure quand il s’était présenté au couvent pour parler à la sœur Thérèse de Jésus. Étant entré dans le parloir, précédé de la tourière, il s’assit sur une chaise, devant la grille aux pointes menaçantes, rendue plus épaisse et plus impénétrable par le rideau tendu de l’autre côté des ferrures. Presque aussitôt, il entendit ces mots prononcés par une femme qu’il ne pouvait voir :
— Loué soit Notre-Seigneur Jésus-Christ !
Surpris, il regarda la tourière.
— Répondez : A jamais ! fit-elle.
Et docilement, il répéta :
— A jamais.
La tourière sortit, le laissant seul, la pâleur aux joues, un frisson dans tout le corps, escaladant des yeux cette grille effroyable derrière laquelle il espérait trouver ce qu’il était venu chercher dans cette maison de paix et de prière.
— Vous avez désiré me parler, monsieur, dit la prieure avec douceur. Me voilà prête à vous entendre.
— Vous êtes bien madame Nicolette Suarez, veuve du lieutenant Frédéric de Varimpré ? demanda le visiteur.
— C’est ainsi que je m’appelais, en effet, quand je vivais au milieu du monde. Mais depuis longtemps, je suis morte pour lui.
— Allez-vous me condamner à vous parler sans vous voir, madame, et ne pouvez-vous tirer ce rideau qui me cache vos traits ?
— A quoi bon ? Vous n’apercevriez rien qu’une femme voilée, à qui la règle qu’elle a fait vœu d’observer interdit de montrer son visage.
— Je voudrais vous voir, madame, reprit-il, suppliant.
— C’est impossible, répondit la prieure ; nous ne pouvons nous découvrir que devant nos proches parents. Puis elle ajouta plus bas : — Ici, ceux qui m’adressent la parole m’appellent ma mère.
Le jeune homme s’était levé brusquement, les bras tendus, des larmes dans les yeux, la bouche entr’ouverte, comme s’il voulait faire entendre une supplication nouvelle. Mais le cri monté à ses lèvres n’en sortit pas. Il retomba sur sa chaise, accablé, et reprit avec une tranquillité feinte :
— Eh bien, ma mère, je vous apporte des nouvelles de votre fils, Adrien de Varimpré.
A ces mots, les anneaux qui fixaient le rideau en haut de la grille roulèrent en grinçant sur leur tringle de fer, et une ombre noire se jeta contre les barreaux, impétueusement, en s’écriant :
— Mon fils ! Vous connaissez mon fils ! Il est vivant ?
— Il est vivant, ma mère.
— Mon Dieu ! mon Dieu, soyez béni, fit-elle en joignant les mains… Vous le connaissez, monsieur ?… Parlez-moi de lui… Le verrai-je bientôt ?
— Oui, bientôt, madame, dans quelques instants… Il a redouté pour vous une émotion trop forte. Il a voulu que vous fussiez préparée à le recevoir. Mais il n’est pas loin de vous… Non, il n’est pas loin.
— Alors, monsieur, allez le chercher… Mon fils ! Mon Adrien !
L’ombre noire s’agitait. Sous son voile, elle poussait des sanglots, et laissait deviner la fièvre de ses mains tremblantes, à tout instant portées à ses yeux.
— J’irai le chercher tout à l’heure, répondit le visiteur ; mais vous me demandiez de vous parler de lui…
— Vous êtes son ami, n’est-ce pas, puisqu’il vous a envoyé près de moi ? Vous le connaissez bien, alors. Il a vingt-trois ans maintenant. Il doit être beau, mon cher enfant, superbe et fier.
— La souffrance flétrit la jeunesse et abat la fierté. Il a beaucoup souffert.
— Beaucoup souffert, répéta la prieure d’un accent lamentable.
— Il ne connaît pas sa mère. Il avait douze ans quand son père mourut au Brésil, où il s’était établi. Il se trouva seul alors avec celle que M. de Varimpré appelait Irène. Les soins maternels de cette femme avaient protégé la jeunesse d’Adrien. Il ressentait pour elle une tendresse filiale, ardente et profonde. Il croyait qu’elle était sa mère. Après la mort de M. de Varimpré, ils se rendirent aux États-Unis, à Boston, où un premier séjour leur avait donné quelques amis. Ils vécurent là, pauvrement, car M. de Varimpré ne laissait qu’une fortune déjà compromise. Votre fils allait au collége ; il s’appliquait à l’étude, ayant hâte de venir en aide à la chère créature qui s’était dévouée à son bonheur. Parfois, il la suppliait de retourner en France avec lui ; il n’ignorait pas que la France était leur patrie à tous deux ; il souhaitait passionnément de la connaître et d’y vivre. Mais celle qu’il appelait sa mère reculait sans cesse l’époque du départ. Un jour qu’il insistait auprès d’elle afin de la décider à partir, elle lui déclara que le cher mort avait exprimé la volonté formelle que son fils n’allât pas en France avant d’avoir atteint sa vingt et unième année.
— Hélas ! il redoutait mon influence ! soupira Nicolette.
— Le temps s’écoulait tristement, continua l’inconnu ; les ressources s’épuisaient de jour en jour, la détresse devenait plus grande, et la santé de madame Irène s’altérait. Elle s’éteignit un soir doucement, entre les bras de l’enfant désespéré. Avant de mourir, elle lui remit une lettre écrite par son père, et qu’il ne devait ouvrir qu’à l’époque de sa majorité. C’est ainsi qu’à dix-huit ans il se trouva orphelin, pauvre et seul, sans ressources. Il fallait vivre, il travailla. Il donnait des leçons de français, car sa langue maternelle, longtemps parlée devant lui, lui était familière. Oh ! les dures années de misère et de solitude ! Si elles n’ont pas abrégé ses jours, c’est qu’il fallait qu’il vécût, qu’il vécût pour revoir son pays. C’est aussi que Dieu voulait qu’il vous retrouvât, ma mère.
Sous son voile, sœur Thérèse de Jésus pleurait à chaudes larmes, en écoutant ce récit.
— Apaisez-vous, reprit le narrateur, et veuillez m’entendre jusqu’au bout. Avant d’embrasser votre fils, il faut que vous connaissiez sa vie passée, que vous n’ignoriez pas surtout pourquoi il vous revient.
— Mais, pour parler de lui, ainsi que vous le faites, qui êtes-vous ?
— Son ami, vous l’avez dit tout à l’heure.
— Vous êtes pâle, attristé, las.
— Oui, pâle comme lui, attristé comme lui ; nous avons souffert ensemble.
— Achevez, monsieur, j’ai hâte de le revoir, de vous faire oublier vos maux à tous deux. Puisqu’il vous aime, je vous aimerai.
L’inconnu, défaillant, fit un effort pour se roidir contre son émotion grandissante ; puis il continua :
— Sur son mince revenu, ma mère, l’orphelin économisait, sou par sou, la somme nécessaire aux frais du voyage qui devait le ramener en France. Il avait calculé qu’il lui faudrait trois ans pour réaliser cette somme. Elle se grossissait lentement, et il se serait bien gardé d’y toucher. Plus d’une fois, il lui arriva de s’endormir, l’estomac vide et les membres glacés, à côté de ce trésor, qui représentait pour lui la délivrance, un avenir plus heureux, et qu’il redoutait de diminuer. Enfin, sonna l’heure de sa majorité. Ce jour-là, il ouvrit la lettre de son père.
— Que disait cette lettre ? demanda la prieure anxieuse.
— Elle racontait à Adrien l’histoire de Frédéric de Varimpré et de Nicolette Suarez.
— Tout entière ?…
— Tout entière ; elle le faisait juge de la conduite de ses parents.
— Comment les a-t-il jugés ?
— Avec le respect qu’il leur doit. Il n’a pu méconnaître les fautes graves du mari, mais il lui a été impossible de n’en pas faire remonter la responsabilité jusqu’à la femme. Elle appartenait à son époux ; elle ne devait pas se donner à Dieu, ainsi qu’elle l’a fait, et par les excès de sa dévotion, rendre le séjour de sa maison intolérable à l’homme dont elle avait reçu la foi, en lui donnant la sienne.
— Mon fils a-t-il su qu’après sa disparition, j’ai remué ciel et terre pour le retrouver ? A-t-il connu l’étendue de mon désespoir ? Ignore-t-il que je ne suis pas encore consolée, et que la faute qu’il me reproche, je l’expie ici depuis longtemps ?
— Votre fils ne vous reproche rien. Lorsque la vérité lui fut révélée, il n’eut d’abord pour vous que des paroles de colère et que compassion pour les morts. Il s’était promis de ne pas tenter de vous revoir. Si vous étiez sa mère par le sang, vous ne lui apparaissiez pas encore comme sa mère par le cœur, une autre ayant reçu de lui les témoignages de son amour filial. Il vint en France avec la ferme volonté de vous oublier, de ne jamais se mettre à votre recherche. Longtemps il se tint parole. Mais une curiosité plus forte que ses résolutions le poussait vers vous. Sa mère vivante, et rester ignoré d’elle, était-ce possible ? Et puis, dépossédé de toute affection, il était si malheureux ! Comment résister à son cœur ? Un vague désir de vous voir de loin, sans vous parler, le conduisit à Tarascon. Il ne vous connaissait pas d’autre domicile. C’est là qu’il apprit que madame de Varimpré, depuis douze ans, vivait dans un cloître. Alors, de nouvelles incertitudes s’emparèrent de lui. Si vous aviez embrassé la vie religieuse, c’est que vous le supposiez perdu pour vous ; c’est que vous aviez renoncé à l’espoir de l’embrasser. Viendrait-il troubler votre quiétude ? Viendrait-il réclamer sa place dans ce cœur à qui Dieu suffisait ? Il hésitait, et son infortune vous eût fait pitié !
L’attendrissement montait dans la voix de l’inconnu. Il regardait l’ombre noire debout devant lui. Il devinait les yeux de la mère anxieusement fixés sur les siens. A travers l’étoffe épaisse, il sentait ces yeux pénétrer son cœur d’une caresse, tout embrasée d’amour maternel. Soudain, il la vit se redresser, saisir fiévreusement les barreaux de fer, les secouer à les briser, et il l’entendit l’appeler, dans un élan irrésistible :
— Mon enfant ! mon enfant ! Je veux voir mon enfant.
— Il est devant vous, ma mère ! s’écria-t-il, saisissant à son tour les extrémités acérées de la grille.
— Toi ! toi ! je m’en doutais.
D’un bond, lâchant les barreaux, elle disparut dans l’obscurité. Adrien la cherchait des yeux, quand brusquement elle entra dans le parloir. Elle avait enfreint la règle pour accourir vers son fils, dont elle sentait maintenant, dans un ravissement de bonheur inénarrable, la tête pâlie rouler sur sa poitrine, dans les plis du voile déchiré.
— Mon Adrien, mon chéri, mon sang, murmurait-elle dans un débordement de sanglots et de baisers, je t’ai retrouvé ! Te voilà ; tu m’es rendu. Je ne te quitterai plus ; désormais, nous vivrons ensemble. Je te dédommagerai de tout ce que tu as souffert ; j’effacerai les traces de tes peines dans ton pauvre cœur meurtri… Tu sauras ce que vaut la tendresse d’une mère.
Et passionnément, elle l’embrassait, l’attirait sur son sein, l’y retenait, puis l’écartait tout à coup pour le regarder plus longtemps, sans rassasier ses yeux de cette longue contemplation. Heureux, il se baignait dans ces témoignages de maternel amour qui le dédommageaient des maux passés et faisaient luire à ses yeux un avenir meilleur.
— Vous dites, ma mère, que vous ne me quitterez plus, fit-il soudain. Serez-vous libre de ne plus me quitter ? N’êtes-vous pas retenue ici par les vœux que vous avez prononcés ? Ne vous engagent-ils pas pour toujours ?
Cette question la ramenait à la réalité, lui rappelait la solennité de ses engagements, la faute qu’elle commettait à cette heure contre la règle. Toute sa joie s’évanouit.
— Attends, dit-elle ; je ne peux rester ici plus longtemps. — Elle l’embrassa encore ; puis elle s’éloigna pour reparaître bientôt derrière la grille. Là, continuant l’entretien commencé : — Oui, j’ai juré de vivre sous les lois du Carmel et de mourir sous l’habit que je porte, murmura-t-elle tristement. Hélas ! je ne prévoyais pas qu’un jour tu me serais rendu, mon pauvre enfant. Si j’avais su, j’aurais gardé mon indépendance, et tu me retrouverais aujourd’hui toute à toi. Mon implacable égoïsme m’a livrée à Dieu. Je l’oubliais ; tu m’en fais souvenir. Non, il n’est pas vrai que nous pourrons désormais vivre ensemble.
— Ne vous ai-je donc retrouvée que pour vous perdre aussitôt ? demanda-t-il, étreignant plus étroitement la main de sa mère, passée à travers la grille.
D’un geste, elle protesta.
— Non, mon fils bien-aimé, non, mon enfant chéri, tu ne me perdras pas, répondit-elle. Le ciel ne saurait exiger que je t’abandonne. Il ne me défend pas de m’occuper de toi, en songeant à lui. Assez grande est mon âme pour contenir deux amours. Je ne peux renoncer à Dieu ; mais je ne dois pas renoncer à mon fils. La règle me permet de te voir tous les jours, de t’assister de mes conseils. A quelque heure que tu viennes ici pour t’entretenir avec ta mère, elle accourra à ton appel.
— J’avais rêvé une vie commune.
— Elle est impossible. Mais qu’importe ? tu sais bien que jamais je ne te manquerai. Nous nous verrons.
— C’est que j’avais projeté d’habiter Paris. Là, seulement, je pourrai travailler, me faire une carrière. Il faut que je songe à l’avenir ; je suis pauvre.
— Pauvre, toi, mon enfant ! Mais, au contraire, tu es riche. Quand je suis entrée ici, je n’y ai porté que la dot d’usage. La fortune que je tenais de mes parents, grossie de celle que ton père m’avait laissée, n’a pas été aliénée. Elle est restée aux mains du notaire de notre famille, et depuis ce temps, elle s’est accrue de ses revenus accumulés. Ton avenir est donc assuré ; tu es à l’abri du besoin. Je comprends cependant que tu préfères le séjour de Paris au séjour de Beaucaire. A Paris, tu trouveras des occupations pour ton esprit. Je ne veux pas que tu restes oisif. L’oisiveté serait indigne d’un homme de ton âge. Mais, en quelque endroit que tu ailles, il me sera facile de me rapprocher de toi. Si c’est à Paris, je demanderai à y être envoyée, dans une maison de notre Ordre. Ce ne sera pas l’existence que tu souhaitais… Mais nous nous résignerons, en pensant que nous observons la volonté du Seigneur.
Adrien soupira en disant :
— Je me résignerai.
— Je voudrais t’entendre parler de ton père, reprit bientôt Nicolette. En mourant, s’est-il souvenu de sa femme ?
— S’il s’en est souvenu, c’est le secret de la mort. Ses lèvres expirantes n’ont pas prononcé votre nom, ma mère ; mais peut-être se l’est-il rappelé dans le suprême entretien qu’il eut avec un prêtre appelé au chevet de son lit.
— Il a reçu les derniers sacrements ?
— Il les a reçus, ma mère.
— Alors, il a dû me pardonner, et je peux espérer que Dieu lui a ouvert le ciel. C’est pour moi un bonheur infini de le savoir. Et ta tante Irène ?
— Elle est morte chrétiennement, elle aussi, et repentante. Ses dernières paroles furent des paroles de regret et de contrition. Je ne les comprenais pas alors, ces paroles émouvantes. Je ne les ai comprises que plus tard, quand l’histoire de mes parents m’a été connue. Le souvenir que j’en ai gardé me permet d’affirmer que ma tante Irène n’est pas restée impénitente.
— J’en remercie Dieu. Il me devait bien cette consolation. Je l’ai tant prié pour ces malheureux !
Elle s’arrêta. A la joie qu’elle goûtait en retrouvant son fils, se mêlait la joie de penser que ceux dont elle s’était si durement reproché les fautes et l’infortune savouraient maintenant, grâce à la clémence divine, les délices de l’éternelle paix.
Durant toute la matinée et jusqu’à l’heure où la cloche du couvent appela les sœurs au réfectoire, elle resta près d’Adrien. En se séparant de lui, elle lui fit promettre de revenir dans la journée. Il revint, et ce fut entre eux un long échange de confidences embrassant à la fois l’avenir et le passé. Elle insistait sur ce passé ; elle en voulait connaître les détails douloureux ; elle n’en interrompait l’émouvant récit que par des allusions à l’avenir, en vue duquel Adrien formait des projets dont il lui faisait part. Puis, c’étaient des recommandations maternelles. Elle le trouvait pâle, malade, l’air minable dans ses vêtements trop étroits où se révélaient la fatigue des longues routes et les privations des jours de misère. Elle exigeait qu’il soignât sa santé, qu’il s’habillât désormais selon sa condition. Elle avait écrit à son notaire pour lui ordonner de mettre Adrien en possession de son patrimoine. Elle était impatiente de savoir son fils heureux, dégagé des soucis matériels contre lesquels depuis si longtemps il se débattait. Elle lui parlait de son séjour à Paris, du séjour qu’elle y ferait elle-même. Elle voulait qu’il se créât là une existence paisible et souriante ; résolue à consacrer ses efforts à la lui embellir. Ravie, elle l’écoutait sans se lasser, s’attendrissant au récit de ses malheurs, se réconfortant à la pensée des jours fortunés qu’elle rêvait pour lui.
Ce n’est pas uniquement pour le plaisir de l’entendre qu’elle l’interrogeait, l’accablait de questions, le poussait à parler. Elle cherchait aussi à le connaître, à deviner ses qualités et ses défauts, et surtout ses opinions en matière religieuse. Avait-il la foi ? Songeait-il au salut de son âme ? Pratiquait-il ses devoirs de chrétien ? C’est de cela qu’elle s’était préoccupée d’abord. Rassurée par le langage qu’il avait tenu en racontant les derniers moments de son père et d’Irène, elle découvrait maintenant que, quoi qu’il eût dit, il était la proie de l’indifférence, un de ces catholiques tièdes qui s’expriment avec respect sur leur religion, mais ne l’observent pas. Désireuse de s’éclairer à ce sujet, elle le pressait de questions. Elle lui demanda même s’il priait.
— J’ai beaucoup prié, ma mère, répondit-il. Mais lorsque j’ai vu que Dieu ne m’exauçait pas, que loin de m’exaucer, il se plaisait à alourdir sans cesse le fardeau de mes malheurs, j’ai douté de sa justice et de sa bonté, de son existence même ; ma ferveur pour lui s’est refroidie. Je me suis déshabitué de l’invoquer.
Cette réponse la bouleversa. C’était un nuage sur son bonheur.
— Ah ! mon pauvre enfant, comme je t’ai manqué ! lui dit-elle. C’est maintenant que je m’en aperçois. Heureusement, rien n’est désespéré, puisque tu m’es rendu. Désormais, c’est moi qui veillerai sur ton âme.
Il garda le silence. Il se demandait comment elle s’y prendrait pour tenir cette promesse, alors qu’elle allait rester séparée de lui par la grille de son cloître et par les dures exigences de la règle du Carmel.
En attendant que sa mère fût autorisée à changer de résidence, Adrien, après un court séjour à Beaucaire, l’avait précédée à Paris. Depuis trois mois, il y était installé. C’est là que désormais il voulait vivre. Riche, grâce à la sollicitude maternelle, indépendant, libre d’obéir à ses goûts, il pouvait croire qu’après les longs jours de détresse, il entrait enfin dans l’ère des jours heureux. Résolu à ne pas demeurer oisif, il songeait à embrasser la carrière du barreau, avec l’espoir que la profession d’avocat, en même temps qu’elle donnerait à son nom la notoriété et remplirait ses loisirs, le rapprocherait des milieux intelligents vers lesquels l’entraînaient les tendances de son esprit.
L’exécution de ce projet nécessitait des études incessantes. Ayant vécu longtemps loin de France, il ne savait rien, quoique instruit, de ce qu’il devait savoir. Il s’était logé dans le voisinage de l’École de droit, avait pris ses inscriptions et suivait les cours avec assiduité. Il fréquentait aussi la Sorbonne, courait les bibliothèques, se tenait au courant du mouvement intellectuel de son temps et donnait à ses ambitions, sous ces diverses formes, l’aliment que, longtemps contenues, elles réclamaient maintenant.
Il la trouvait charmante, cette existence d’étudiant. Il en acceptait les obligations avec courage et en écartait les désordres. Elle le mettait en commerce constant avec des hommes jeunes et studieux comme lui. Il lui devait des jouissances exquises. Quand à la fin de ses laborieuses journées, il rentrait dans son appartement où l’attendait le bien-être d’un intérieur élégant et confortable, et dans le recueillement prolongeait l’étude jusqu’à une heure avancée de la soirée, il estimait que la destinée le dédommageait amplement des maux passés. Il regardait avec confiance l’avenir, un avenir embelli par l’espoir que caressait sa jeunesse.
C’était une âme fière et tendre, que l’épreuve avait fortement trempée, à qui manquait seulement l’expérience des hommes et de leurs passions. Il croyait à la vertu, au désintéressement, à l’amitié, à l’amour. Son regard énergique et doux, l’étreinte loyale de sa main, révélaient sa droiture. La fraîcheur de son cœur se manifestait dans la spontanéité avec laquelle il applaudissait à tout noble sentiment exprimé devant lui. Dupe de sa crédulité, il pouvait se laisser pousser à une imprudence, jamais à une bassesse.
Parmi les jeunes gens qu’il rencontrait sur les bancs de l’école, on l’aima dès qu’on le connut. Outre l’aménité de son caractère, il avait pour lui son long séjour à l’étranger, sa connaissance de plusieurs langues, son application au travail, et surtout cette fortune dont il ne faisait pas étalage, encore qu’elle lui permît de rendre à ses camarades de fréquents services. C’était là son prestige à leurs yeux, la cause de la considération dont ils l’entouraient. Ce jeune homme grave, de mœurs presque austères, qui parlait rarement de lui, de son passé, de sa famille, et laissait deviner combien il était digne du bonheur dont il semblait jouir, leur en imposait. Il respectait les opinions des autres, mais il exigeait qu’on respectât les siennes. Il est vrai qu’il les exprimait rarement, comme si elles n’eussent pas encore été formées. Il écoutait plus qu’il ne parlait, moins soucieux de convaincre que de s’instruire.
Sur deux sujets surtout, il ne s’expliquait jamais : les croyances religieuses et l’amour. On le plaisantait quelquefois à ce propos. Mais la raillerie n’avait pas prise sur lui. Il répondait avec simplicité :
— Je ne peux discuter de ce que j’ignore.
Sincère était cette réponse. Élevé par un père qui attribuait ses malheurs domestiques à l’excès des convictions religieuses de sa femme, Adrien éprouvait une invincible défiance pour toute manifestation de foi, entachée d’exagération.
C’est une ardeur déréglée qui lui avait pris sa mère, l’avait privé de ses soins, dépossédé de son amour, et même encore pour toujours la tenait séparée de lui. Il ne pouvait secouer ce souvenir, et c’est surtout quand un débat sur ces graves sujets s’engageait devant lui qu’il en était écrasé.
Il voulait croire en Dieu cependant ; mais il doutait que ce Dieu ait institué une Église pour perpétuer son culte, l’ait investie de ses pouvoirs et recoure à elle pour dicter ses lois aux hommes. Il doutait qu’elle ait reçu de lui le privilége de le représenter sur la terre, et qu’une religion, quelle qu’elle soit, ait le droit de faire remonter son origine à l’intervention personnelle du Créateur des âmes et des choses. Ramenant sans cesse ce doute au regard de sa propre vie, il se demandait si les maux dont il avait tant souffert étaient le témoignage de la volonté divine. Il se demandait si cette volonté pouvait se targuer de sagesse, lorsqu’elle troublait l’esprit et le cœur d’une femme jusqu’à lui faire oublier, dans un accès de ferveur extatique, ce qu’elle devait à son mari et à son fils, jusqu’à la jeter dans un cloître, sous l’empire de devoirs imaginaires, quand sa place était dans le monde, où d’autres devoirs, non moins sacrés, sollicitaient sa conscience. Il ne niait rien, mais n’osait rien affirmer. Sa pensée poursuivie par ces problèmes les fuyait comme un péril. Elle en avait peur.
Quant à l’amour, il n’en voulait pas parler, parce qu’il n’en connaissait que le nom. Jusqu’à ce moment, austère était restée sa vie, intacte sa chasteté. De la femme et de la passion qu’elle allume dans les jeunes cœurs, il ignorait tout, sauf cette théorie imparfaite dont la science s’acquiert dans les livres ou dans les exemples d’autrui. En butte à d’amers chagrins, pauvre, seul, intimidé par sa misère, il n’avait jamais vu un regard de femme arrêté sur lui. Aucun souvenir troublant ne ternissait la candeur virginale de son âme.
La seule émotion de ce genre qu’il se rappelât était d’une époque récente. Elle datait du jour où, attendant sa mère dans la cour du couvent des Carmélites, avait passé devant ses yeux ravis une novice, d’abord resplendissante sous ses vêtements de mariée, puis touchante comme une victime, dans son habit de nonne et le front dépouillé. C’était là sa première extase amoureuse, dissipée ensuite sous les baisers de sa mère. Son cœur n’en gardait plus rien qu’un souvenir affaibli, une image à demi effacée, dont le temps emportait d’heure en heure un contour.
C’est dans cet état qu’il était arrivé à Paris. Depuis, sa fierté naturelle, les préoccupations d’une vie laborieuse l’avaient éloigné des aventures faciles et vulgaires de la vie d’étudiant. Quoiqu’il fût entré en relation avec divers membres de sa famille et qu’il eût reçu d’eux un aimable accueil, il sortait peu, vivait retiré, dans l’attente de sa mère, dont les lettres toutes imprégnées de sollicitude inquiète et de conseils annonçaient la prochaine arrivée. Les femmes qu’il rencontrait dans son quartier, éhontées et provocantes, les récits des bonnes fortunes de ses camarades, les excitations que partout il trouvait, sous des formes diverses, répondaient trop peu à l’idéal qu’il s’était fait de l’amour pour livrer son cœur aux entraînements irrésistibles ou communiquer à ses sens autre chose qu’un trouble de surface et tout passager. Ces tentations glissaient sur lui, et jusqu’à cette heure, la passion l’avait épargné.
Mais si le passé le laissait paisible, il n’en était pas de même de l’avenir. Le souci de l’éternel féminin le poursuivait. Il avait soif d’aimer et d’être aimé. Bien que l’amour l’épouvantât, il brûlait d’en connaître la douceur. Dans son cœur s’allumaient d’inextinguibles flammes pour des héroïnes imaginaires du milieu desquelles il espérait voir surgir celle qui prendrait sa vie. Il voulait n’aimer qu’une seule fois, donner à l’élue toute son âme, lui consacrer toute sa passion. Il sentait en soi des ardeurs inépuisables. C’était comme une source qui toujours coulerait et jamais ne serait tarie. Ce besoin de combler le vide de sa jeunesse incessamment se renouvelait, durant ses soirées solitaires et dans le calme de ses nuits. A son réveil, il le retrouvait inapaisé. Alors, il rêvait d’une aventure qui lui révélerait enfin, en la lui livrant, la créature qui devait l’initier à l’amour.
Ces sensations vives et chaudes étaient son secret. Il les dissimulait à ses amis. Il ne les avait confiées qu’à l’un d’eux. Celui-là se nommait Jacques Roudier. Tête fine et brune sur un corps robuste, œil noir, où se lisait la ruse, langue acérée, Roudier roulait, sans y rien faire de sérieux, à travers le Quartier Latin. Emprisonné dans sa paresse, il préparait depuis plusieurs années un examen qu’il ne passait jamais, servait de guide aux nouveaux arrivés, vivait à leurs dépens, portait assez fièrement une existence sans dignité, de gré ou de force se faisait accepter de ceux même qui l’estimaient peu, grâce à un esprit de bon aloi, toujours en éveil, grâce à la serviabilité dont il faisait preuve envers quiconque était jugé par lui comme capable de prendre à sa charge une part, grande ou petite, de sa vie aux besoins de laquelle il s’était déshabitué de suffire.
Comment ce joyeux garçon, bruyant et gouailleur, gagna-t-il la confiance du mélancolique Adrien et devint-il son ami ? Il serait difficile de l’expliquer, si l’on ne savait combien les contrastes s’attirent, et surtout combien sont trompeuses les illusions de l’inexpérience. Ils s’étaient rencontrés pour la première fois dans un restaurant ; ils se retrouvèrent un soir d’hiver, coude à coude, à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Adrien était venu là pour consulter un ouvrage qu’il ne possédait pas chez lui, Jacques Roudier pour chercher un abri contre le froid. Ils échangèrent quelques mots et sortirent ensemble pour revenir chez eux. Ils habitaient la même rue.
Cette première rencontre en entraîna d’autres. Roudier avait deviné dans Adrien un étudiant riche, proie séduisante et facile pour ses dents longues et son estomac exaspéré par les longues privations. Adrien se laissa prendre à la popularité dont jouissait dans le quartier des écoles ce bohème que tout le monde connaissait, qui connaissait tout le monde et parlait de tout avec esprit. Il se laissa prendre à sa familiarité et surtout au tableau que l’autre lui retraça des prétendus malheurs de sa famille et de sa misère. Il crut faire œuvre pie en l’invitant à sa table. Il lui ouvrit même sa bourse, où Roudier puisa avec l’avidité d’un homme à qui une telle aubaine n’était point familière, exprimant sa reconnaissance en un langage qui lui conquit le cœur d’Adrien.
Leur intimité s’accentua. Moins de trois semaines après le début de leurs relations, Roudier était devenu le commensal et le confident de ce jeune enthousiaste, qui saluait en lui son premier ami. C’est alors qu’il entreprit de lui faire connaître Paris, ingénieux moyen de se rendre utile et de ne plus se séparer. Il le conduisit dans les théâtres, dans les concerts, au bois de Boulogne. Adrien était enchanté de ce compagnon, qui flattait ses goûts, prévenait ses désirs et, tout en lui donnant des conseils, feignait de partager ses opinions. Il s’accoutuma à lui. La communauté de leur vie provoqua de sa part des confidences. Il ne cacha ni ses ambitions, ni ses caprices, ni l’état de son cœur. Roudier connut ainsi son histoire et fut initié à des secrets qui, jusqu’à ce moment, n’avaient été livrés à personne.
Il commença par railler l’innocence de son ami. Durant plusieurs jours, il ne l’entretint pas d’autre chose.
— A ton âge, ne pas connaître l’amour ! lui disait-il ; c’est à n’y pas croire. Si, comme toi, j’étais allé au Brésil et aux États-Unis, si j’avais navigué sur les deux Océans, parcouru les savanes, visité des tribus indiennes, je posséderais, en matière de femmes, la science infuse. Qu’as-tu donc fait, malheureux, pendant les années de ta belle jeunesse ?
— J’ai souffert et j’ai pleuré, répondait Adrien.
— Et tu oubliais que l’amour console !
— J’étais trop jeune pour me marier.
— Est-il donc nécessaire de se marier pour aimer ?
— Je n’aurai jamais de maîtresse. La femme que j’aimerai sera ma femme.
Roudier bondissait, la raillerie sur les lèvres :
— Même si c’est une aventurière ?
— Je n’aimerai qu’une créature digne de moi.
— Qu’en sais-tu ? Si, l’ayant crue digne de toi, tu découvres que tu t’es trompé, seras-tu maître de cesser de l’aimer ? Tente donc plusieurs épreuves avant de t’engager pour toujours. Fais l’apprentissage de l’amour, et si tu ne veux pâtir toute ta vie, n’arrive au mariage qu’avec l’expérience de la femme.
Ce langage indignait Adrien, lui arrachait des protestations. Mais la spirituelle humeur de Roudier le désarmait. Et puis, à travers ces railleries, il devinait des conseils dictés par une expérience tirée de la réalité des choses, sinon d’une morale rigoureuse. Peu à peu son esprit entrevoyait la possibilité d’une liaison qui lui révélerait ce qu’il ignorait, sans l’engager pour toute sa vie. Ce n’était pas encore une résolution prise, mais le « pourquoi pas ? » qui prélude aux capitulations de conscience. La fougue de sa jeunesse, longtemps comprimée, commençait à puiser des excitations dans ces entretiens fréquemment recommencés et aboutissant toujours à la même conclusion, dans les milieux où il vivait, dans les exemples qu’il y rencontrait. Cependant il résistait encore. Lorsque Roudier, s’essayant à le soumettre à son influence, voulait l’entraîner aux sources empoisonnées où lui-même s’était abreuvé, en y laissant la pureté et la fraîcheur de son cœur, Adrien se dérobait, toujours dominé par l’effroi d’une chute vulgaire, qui ne pourrait trouver son excuse dans un excès de passion ou dans la sincérité d’un grand sentiment.
— Eh bien, soit, lui disait Roudier en riant, il est entendu que tu ne veux pas recevoir une maîtresse de ma main. Je n’insiste plus. Mais cherches-en une alors, dans le monde où tu vas. Cherche, trouve. Tu dois trouver, que diable ! Il le faut. L’homme n’est pas fait pour vivre seul.
Adrien souriait tristement et soupirait sans répondre.
Il fréquentait de loin en loin des parents de sa mère, avec qui, pour lui obéir, il entretenait des relations régulières, des amis de la famille de Varimpré chez lesquels l’attendait toujours un accueil affectueux. Mais jusqu’à ce moment, charmé par la tranquille uniformité d’une vie dégagée des préoccupations matérielles, il fuyait les occasions d’en troubler le cours, quoique ces occasions fussent fréquentes. Aux dîners et aux bals auxquels on l’invitait, il préférait l’intimité des longues heures passées chez lui, les pieds sur les chenets, tantôt seul, un livre à la main, tantôt en compagnie de Jacques Roudier, ou encore une soirée à l’Opéra, à la Comédie française, son ami à ses côtés, les rentrées tardives succédant à la représentation et embellies par les impressions échangées durant le trajet, quand vibrait encore dans son esprit l’enthousiasme provoqué par ce qu’il venait d’entendre.
Il aurait voulu ne rien changer à cette manière de vivre. Mais lorsque l’hiver fut venu, il lui devint impossible de se dérober aux invitations qu’il recevait. Il dut se montrer dans quelques salons. Partout, le nom qu’il portait, sa distinction, sa tenue réservée, le faisaient bienvenir. La pâleur répandue sur ses traits, la tristesse qui caractérisait sa physionomie, ajoutaient au charme de sa personne. Les jeunes filles regardaient à la dérobée ce jeune homme silencieux, à l’air timide et doux, que semblait poursuivre une incurable mélancolie. Les mères lui souriaient, séduites par ce qu’elles savaient de sa conduite et de sa fortune. Son histoire était connue ; elle faisait de lui presque un héros de roman ; elle augmentait l’intérêt qu’il inspirait à première vue.
Malgré tout, cependant, le monde à ses yeux restait sans attraits. Les blanches épaules, les yeux profonds, le sourire des lèvres vermeilles, les boucles des chevelures soyeuses, les bras aux pures formes, tous ces trésors des jeunesses en fleur et des beautés épanouies, le laissaient insensible. C’était à croire que son cœur demeurerait éternellement rebelle à l’amour.
— Veuillez vous mettre au piano, mademoiselle Malestra. Ces jeunes filles désirent danser.
La personne interpellée ainsi par la maîtresse de la maison se leva du milieu d’un groupe de vieilles femmes, où depuis le commencement de la soirée elle se tenait silencieuse, comme quelqu’un dont on paye les services et qui attend un ordre. Adrien, debout, parmi les hommes, dans l’embrasure d’une porte, la vit traverser le salon, grave et fière, la lèvre dédaigneuse, plissée dans un sourire contraint, une étrange expression de froideur dans ses yeux bleus, dont la blancheur laiteuse de son teint de rousse et les tons fauves de ses cheveux semblaient éteindre l’éclat.
Mademoiselle Laure Malestra était jeune et belle. Mais sa jeunesse et sa beauté ne saisissaient pas au premier abord. Il fallait presque un effort pour les découvrir, tant il y avait de tristesse répandue sur les traits, comme un voile. La grâce du corps se perdait dans une robe montante en soie noire, sans ornements et dépourvue d’élégance. Un fichu en dentelles, dont les extrémités se nouaient à la taille, derrière le dos, cachait les pures lignes du buste. Assombrie par le voisinage des toilettes claires et brillantes qui l’entouraient, celle-ci trahissait une âpre misère, la bourse souvent vide, la petite chambre sous les toits, la poursuite acharnée après l’argent, les longues courses dans les rues boueuses pour donner quelques rares leçons, les soirées sans feu, peut-être même les jours sans pain.
Elle révélait encore d’autres souffrances, cette pauvre robe usée : les révoltes sourdes contre le destin, les larmes des nuits sans sommeil, les basses jalousies se déchaînant dans une âme aigrie, l’obsession des rêves tentateurs, vainement écartés, les chutes accidentelles dans le vice, l’effort désespéré pour remonter vers la lumière, le scepticisme, fruit des cruelles désillusions, s’implantant dans le cœur découragé.
Adrien devina ces choses tout à coup en regardant mademoiselle Malestra retirer ses gants et s’asseoir au piano. Une compassion subite s’empara de lui. Sans l’avoir voulu, il se sentit intéressé au sort de cette jeune fille, dont nul parmi les invités ne s’occupait, et qui semblait ne connaître aucun d’eux. Sans quitter sa place, il fixait les yeux sur elle, détaillait ses traits, les idéalisait au gré de son imagination qui les transfigurait, en les lui montrant, tels qu’ils avaient été jadis et pourraient l’être encore, embellis par le bonheur.
Après un court prélude, mademoiselle Malestra venait d’attaquer une valse. A la fougue de son jeu, à la sûreté de sa main, à l’habileté avec laquelle elle traduisait la pensée du compositeur, Adrien reconnut vite une musicienne consommée.
Il écoutait ravi.
— Vous ne dansez pas, monsieur de Varimpré ? lui dit la maîtresse de la maison, en le rejoignant à travers les couples des valseurs entraînés.
— Non, madame ; j’aime mieux écouter la musique. Elle a beaucoup de talent, votre instrumentiste.
— Mademoiselle Laure Malestra ! Je crois bien. Si vous pouvez lui trouver des élèves, vous ferez une bonne action. Bien intéressante, cette pauvre fille, et pas heureuse. Son père, petit commerçant, a fait faillite voici quelques années, et s’est suicidé. Elle avait déjà perdu sa mère. Orpheline et sans un sou, elle dut chercher à gagner sa vie en donnant des leçons de piano. Le malheur a voulu qu’elle se soit laissé séduire par un homme qui lui avait promis le mariage et l’a ensuite abandonnée. Son aventure a eu du retentissement. Beaucoup de mères qui lui avaient confié l’éducation musicale de leurs filles, ont cessé de la recevoir. Avec ses élèves, elle a perdu le prestige que lui donnaient ses infortunes et son courage. Elle lutte pour le reconquérir ; mais douloureuse est cette lutte. Laure méritait mieux, et quant à moi, je la défends et la défendrai, quoi qu’on en dise. A tout péché miséricorde, n’est-ce pas, monsieur ?
Ce récit était fait presque gaiement, par une bouche souriante, d’un accent d’indifférence. Adrien en eut le cœur serré. Tout ému, il se rapprocha de mademoiselle Malestra lentement, en se glissant le long des murs, et se trouva assis presque à côté d’elle, derrière le piano. D’abord elle ne remarqua pas sa présence. Ce fut seulement quand, la valse finie, elle cessa de jouer, que s’étant retournée, elle aperçut ce jeune homme qui l’enveloppait d’un regard sympathique. Elle était femme et devina sur-le-champ tout ce qu’elle lui inspirait. Une rougeur légère monta à ses joues. Ses doigts tremblants volèrent sur le clavier, plaquant des accords, comme si elle eût voulu dissimuler son embarras.
— Avec le talent que vous possédez, mademoiselle, comment vous abaissez-vous au rôle où vous voilà ?
A cette question faite par Adrien d’une voix qu’étranglait l’émotion, elle répondit simplement, sans paraître choquée :
— Je suis pauvre, monsieur, et il faut vivre.
— N’avez-vous donc trouvé personne qui vous vînt en aide ?
— Je ne demande rien que le prix de mes leçons. Mais il n’est pas aisé de trouver des élèves.
— Je m’efforcerai de vous en trouver, moi, répondit Adrien en parlant doucement, et très-vite. Jusque-là, si vous estimez que je peux vous servir, disposez de moi.
Vivement, elle se retourna étonnée et reprit :
— Vous ne me connaissez pas, monsieur.
— Je vous demande pardon, mademoiselle ; vos malheurs me sont connus.
— On vous les a racontés ! tous ?
— Tous, oui, mademoiselle. Elle baissa la tête, mais sans pouvoir dissimuler deux larmes qui roulaient sur ses joues. Il continua : Je vous plains et voudrais contribuer à réparer l’injustice du destin qui pèse sur vous.
Ce fut dit avec tant de spontanéité, d’un accent si sincère, que Laure subitement s’apaisa. Son visage exprima la reconnaissance dans un sourire attristé, et elle dit :
— Merci, monsieur ; on ne m’avait jamais parlé ainsi.
De l’autre côté du piano, passait un domestique portant un plateau chargé de rafraîchissements ; Adrien se levant, l’arrêta au passage, prit sur le plateau un verre et l’offrit à Laure Malestra. Elle but et lui rendit le verre. De nouveau, il allait s’asseoir ; elle l’en empêcha.
— Je suis sensible à vos attentions, monsieur, dit-elle. Mais je vous supplie de vous éloigner. Si vous restiez plus longtemps près de moi, on jaserait, et j’ai tant besoin de reconquérir ici le respect de tous…
— Ne pourrai-je donc vous revoir ? demanda-t-il anxieux, oui, vous revoir, et continuer avec vous cet entretien ?
— A la fin de la soirée, attendez-moi en bas, répondit-elle sur le même ton ; si vous ne craignez pas de vous détourner de votre route, vous pourrez me ramener jusqu’à ma porte.
Il la quitta, tandis que bruyamment elle jouait les premières mesures d’un quadrille. S’il avait possédé une expérience des femmes égale à l’ardeur de son imagination, il eût été surpris de la facilité avec laquelle mademoiselle Malestra lui accordait un rendez-vous. Mais loin de le choquer, cette facilité lui semblait un témoignage de confiance. Il nageait dans le bleu, brusquement saisi par la séduction de cette étrange fille. Pour la première fois, il subissait l’entraînante émotion d’un désir. Un voluptueux frisson se répandait par tous ses sens. C’était une révélation soudaine de la femme, l’attente fiévreuse des joies qu’elle donne, l’irritant plaisir qui naît de l’incertitude d’être aimé, un espoir confus, comprimé par un doute. De loin, il la regardait avec ivresse ; il cherchait à rencontrer ses yeux ; il tressaillait lorsque, provoqué par son attention persistante, un sourire s’arrêtait sur lui, pénétrant sa chair, fouillant son cœur, où s’allumait l’amour.
Que ne pouvait-il être initié aux calculs que dissimulait ce sourire ! Que ne pouvait-il surprendre les visées de cette âme à laquelle le vice avait imprimé sa flétrissure indélébile ! Il aurait compris qu’il allait être dupe de sa naïveté. Il tombait dans la vie de Laure Malestra, en une de ces heures de découragement et d’immense lassitude qui désarment les vertus fragiles. Accablée par son malheur et révoltée contre le sort, prête à tout pour sortir de sa détresse et secouer sa misère, Laure saluait en lui le libérateur. Elle se savait belle, et de sa beauté voulait faire l’instrument de sa délivrance. Elle n’en était plus à chercher un mari ; sa première chute l’avait déclassée, elle ne l’ignorait pas. Mais elle souhaitait un amant qui la déchargerait de ce lourd fardeau de privations matérielles qu’elle traînait après soi. Jeune ou vieux, aimé ou non, qu’importait, pourvu qu’il fût riche ?
Sous les candides accents d’Adrien de Varimpré, elle avait cru comprendre qu’il possédait la fortune. C’était une proie qui s’offrait à elle et qu’il ne fallait pas laisser échapper. Désireuse d’être renseignée, elle fit trêve à la froideur qu’elle apportait dans les salons où l’appelait son humble emploi. Elle devint prévenante pour se rendre aimable et provoquer la sympathie. Elle manifesta de l’entrain, de la bonne volonté, obligea les danseurs à se rapprocher d’elle pour la remercier. Vaguement, à demi-mot, avec beaucoup d’habileté, elle interrogea les uns et les autres. A la fin de la soirée, elle connaissait l’histoire d’Adrien et se confirmait dans la résolution, puisqu’il s’offrait à elle, de le prendre.
Pendant qu’elle se livrait à ces calculs d’où naissaient des espérances par lesquelles était embellie et parée sa beauté, Adrien buvait le charme qui se dégageait d’elle. L’or jaune de sa chevelure, l’intelligence rayonnant au front, le dessin des traits, la finesse du profil, la blancheur de la peau, les pures lignes du corsage, le modelé des bras, deviné sous les plis disgracieux de la pauvre robe, entraient dans ses yeux. Il en restait ébloui. L’espoir de s’approprier ces trésors troublait sa raison.
Quand, vers une heure de la nuit, la fête commença à prendre fin, il fit un signe à mademoiselle Malestra pour lui rappeler ce qui était convenu entre eux, et s’esquiva sans bruit. En bas, dans la rue Taitbout, il arrêta une voiture, la fit ranger au ras du trottoir, puis se promena devant la porte, regardant sortir les invités. Son attente dura peu. Au bout de vingt minutes, sous la voûte illuminée, il vit apparaître mademoiselle Malestra, la tête encapuchonnée, un châle noir sur les épaules. Il se montra, en désignant la voiture. — Elle y monta précipitamment. Il s’assit à côté d’elle, en lui demandant où il fallait la conduire. Elle désigna la rue des Saints-Pères.
— Cela se trouve bien, dit-il ; c’est sur mon chemin.
La voiture se mit en route. Laure restait silencieuse, et lui, tout saisi, cherchait en vain des mots qui ne venaient pas. Laure parla la première.
— Je crains d’avoir été imprudente en vous engageant à me ramener, dit-elle. Cela va vous donner une mauvaise opinion de moi.
— Une mauvaise opinion de vous, quand je suis si heureux ! s’écria-t-il.
— Heureux ! Est-ce donc un si grand bonheur de ramener au milieu de la nuit une pauvre fille ?
— Oui, c’est un grand bonheur, quand on espère provoquer chez cette pauvre fille, comme vous dites, la réciprocité des sentiments qu’elle a inspirés à première vue.
— La première vue peut tromper.
— Je ne me trompe pas. Je vous sens bonne autant que vous êtes belle, et tout mon être s’est jeté vers vous avec trop d’emportement pour que j’aie à redouter de m’être trompé.
— Mais c’est une déclaration, cela, monsieur.
— Interprétez mes paroles comme vous voudrez. Ma bouche ne répète que ce que dit mon cœur. Que n’y pouvez-vous lire, dans ce cœur où vous venez d’entrer tout à coup ! Vous y saisiriez la preuve de la plus ardente amitié.
— Voilà un bien gros mot pour des gens qui se connaissent à peine.
— Il me semble que je vous ai toujours connue, Est-ce votre beauté qui m’attire ? Est-ce la compassion qu’a éveillée en moi le récit de vos malheurs ? Je ne sais… Ce que je sais, c’est que, maintenant et toujours, je voudrais vivre près de vous.
Elle garda le silence ; il osa lui prendre la main ; cette main ne se déroba pas à son étreinte et resta dans la sienne, moite et brûlante, comme si l’émotion provoquée par sa parole fût venue se concentrer là pour se communiquer à lui. Il continua :
— J’ai vingt-quatre ans bientôt, et je n’ai jamais aimé.
— Comment alors pouvez-vous savoir si ce que vous ressentez n’est pas seulement un désir qui se sera vite évanoui ?
— Il ne tient qu’à vous de me mettre à l’épreuve.
— Encore faudrait-il que j’y fusse poussée par un sentiment égal au vôtre.
— Oh ! laissez-moi espérer que vous m’aimerez ! soupira-t-il.
— Je ne peux vous défendre d’espérer. Mais, croyez-moi, monsieur, avant d’aller plus loin, connaissez-moi mieux. Peut-être ne suis-je pas ce que vous supposez. Et puis une cruelle déception m’a aigrie et rendue défiante. J’ai cru à des protestations aussi éloquentes que les vôtres. Elles m’ont emportée dans le plus beau des rêves. Affreux a été le réveil. A quoi bon vous dissimuler mon passé, puisqu’on vous l’a dévoilé ? Ce passé me défend de m’indigner de votre langage et de m’étonner que vous me teniez des propos que vous n’oseriez tenir à une honnête femme. Je ne peux même prétendre que je ne répondrai pas à votre sympathie. Hélas ! je suis si seule, j’ai tant souffert, j’ai tant besoin d’un ami ! Mais permettez qu’avant de vous laisser exercer les droits d’un ami, je m’assure de votre sincérité.
— Je ne vais m’appliquer qu’à vous en convaincre ! s’écria Adrien avec feu.
Quelques instants après, la voiture s’arrêtait à l’extrémité de la rue des Saints-Pères.
— A bientôt, monsieur, dit mademoiselle Malestra à son compagnon en lui tendant la main.
— Me permettez-vous de venir vous voir ? demanda-t-il.
— Pas chez moi, fit-elle ; et plus bas, elle ajouta en soupirant : C’est si misérable là-haut !
— J’hésite à vous prier de venir dans ma maison.
— Pas cela, non plus.
— Où alors ?
— Paris est grand, et dans cette saison, la nuit vient vite. Rien ne nous empêche de nous promener. Demain, vers six heures, je vous attendrai dans l’église de la Madeleine.
Il promit de s’y trouver, et ils se séparèrent. Adrien dormit mal. Mais les plus douces pensées bercèrent son insomnie. Jusqu’au soir, il ne cessa pas de penser à Laure Malestra. Son désir surexcité lui donnait toutes les illusions de l’amour, charmait son attente, et le jetait dans les anxiétés délicieuses qui précèdent un bonheur qu’on croit assuré. Roudier vint le voir, devina à son air qu’un événement grave se préparait, mais ne put deviner son secret, et se retira sans l’avoir pressenti.
A six heures, à la Madeleine, dans une chapelle, Adrien aperçut, assise, les mains croisées sur les genoux, mademoiselle Malestra. Elle se leva, et vint à lui. Ils sortirent ensemble ; elle prit son bras ; ils s’engagèrent dans la rue Royale. Arrivés aux Champs-Élysées, ils montèrent vers l’Arc de triomphe, marchant à grands pas, car la nuit était froide et se prêtait peu aux promenades lentes et sans but. L’entretien recommençait au point où ils l’avaient laissé la veille. Adrien parlait de son amour avec la même fougue ; Laure l’écoutait avec le même sang-froid. Puis elle revint sur son passé, traça à grands traits le tableau de son enfance heureuse, de la ruine et de la mort de son père, de son isolement, de sa détresse. Elle parla de la séduction dont elle avait été victime, voulant, disait-elle, qu’avant de s’abandonner au penchant qui le poussait vers elle, Adrien connût toute la vérité.
En marchant, suspendue à son bras, elle se pressait contre lui. Il pouvait croire que déjà elle était sienne. Tout ce qu’elle disait n’était-il pas comme une préparation à la liaison qu’il rêvait ? Dans l’air glacé du soir, il sentait tout son être embrasé par le flot de ses jeunes désirs déchaînés avec violence dans son corps vierge. L’amour l’enveloppait, et l’espoir du bonheur mouillait ses yeux de pleurs brûlants.
Sans s’en apercevoir, ils étaient arrivés à la grille du bois. Ils rebroussèrent chemin. Tout à coup, Adrien s’arrêta devant les fenêtres éclairées d’un restaurant.
— Voulez-vous me causer un grand plaisir ? demanda-t-il.
— Si cela est en mon pouvoir, j’y consens.
— Dînons ensemble.
— Oui, comme deux amis ?
Ils entrèrent, et bientôt, attablés dans un cabinet, ils continuaient la conversation de tout à l’heure. Seulement, maintenant, ils pouvaient se voir. Dans l’intimité de ce tête-à-tête, pimenté par la chaleur, par l’éclat des lumières, par l’odeur des mets et des vins, les mots prenaient une signification particulière. Les regards se croisaient, les mains s’étreignaient. La beauté de Laure, la veille voilée de tristesse, s’avivait dans la certitude d’un triomphe qui transformait sa vie, dissipait l’inquiétude des lendemains incertains, éveillait toutes ses cupidités de fille vénale à qui jusqu’à ce jour avait manqué l’occasion de donner carrière aux instincts pervers qu’elle dissimulait. Adrien la dévorait des yeux. Par la pensée, il dépouillait des vêtements ce corps jeune et frais, offert à ses caresses craintives, et dont la contemplation passionnément souhaitée devait lui révéler la séduction puissante de la femme, en l’initiant aux mystérieuses voluptés de l’amour.
La fin du repas les trouva dans les bras l’un de l’autre. Mais ce ne fut qu’une étreinte d’une minute. Comme honteuse de sa faiblesse, Laure se leva brusquement et voulut partir. Adrien obéit à regret, chancelant, les narines pleines du parfum des cheveux dans lesquels il avait noyé son visage. Il allait demander une voiture. Laure préféra rentrer à pied. En moins d’une heure, ils eurent regagné le quartier qu’ils habitaient.
Alors, au moment de voir son rêve interrompu, Adrien fit entendre une prière. Pourquoi se séparer quand une passion plus forte qu’eux les rivait l’un à l’autre ? A quoi bon une attente qui désormais serait une torture ? N’était-elle pas convaincue de son amour ? La suprême faveur qu’il sollicitait ne ferait-elle pas de lui l’amant le plus docile et le plus dévoué ?
— Ne vous refusez pas, suppliait-il. Révélez-moi le bonheur que je brûle de connaître. C’est le vôtre que vous assurez en faisant le mien, un droit que vous m’accordez de me charger de votre avenir.
Tout en priant, il entraînait Laure Malestra non chez elle, mais chez lui. La rusée créature se laissait conduire, résistait faiblement, et ne semblait se refuser que pour exciter davantage la passion qu’elle avait allumée.
— Peut-être serez-vous comme les autres, dit-elle enfin, toute tremblante, comme écrasée par les accents qu’elle entendait, et après avoir juré que vous m’aimez, me ferez-vous repentir de ma faiblesse.
— Jamais ! s’écria-t-il transporté.
— Si vous mentez aujourd’hui, si vous oubliez vos promesses, que votre conscience vous le reproche éternellement. Pour moi, je suis vaincue. Votre ardeur m’a touchée, murmura-t-elle en soupirant ; faites de moi ce que vous voudrez ; je vous donne ma vie.
Nuit de passion exaltée et fiévreuse que cette nuit durant laquelle Adrien connut l’amour. De son côté, tout fut candide et sincère ; tout feint et joué du côté de Laure. Ce n’est pas qu’elle demeurât insensible à cette tendresse manifestée en protestations éloquentes, avec des accents d’une adorable naïveté. Mais elle voulait s’attacher ce jeune amant, le captiver à jamais. Jusqu’en ses ardeurs les plus brûlantes, elle eut assez de sang-froid pour ne pas perdre de vue le but qu’elle poursuivait. Elle ne se donna qu’en arrachant des promesses qu’elle ne semblait pas solliciter. Entre les baisers, il y eut place pour les projets d’avenir. Elle savait qu’Adrien était libre et riche ; habilement, elle l’amena à prendre l’engagement de la mettre pour toute sa vie à l’abri du besoin. Elle ne lui demandait rien ; mais elle lui faisait de ses jours de misère une image si poignante qu’il s’écriait exalté :
— Tout cela est fini, à jamais enseveli. Oublie ce passé odieux, ma bien-aimée. J’embellirai ta vie en donnant à ta beauté, comme à notre amour, un cadre digne d’eux.
On louerait dans la maison ou dans une maison voisine un appartement spacieux et gai. Laure s’y fixerait seule en apparence, de manière à laisser croire à ceux qu’elle connaissait que son indépendance recouvrée était due, non aux générosités d’un amant, mais à un héritage. C’est là qu’Adrien viendrait tous les jours, prendrait ses repas et coucherait, ne gardant lui-même le logement qu’il occupait que pour dissimuler à sa mère le secret de ses amours. Que de bonheur ils attendaient de leur existence arrangée ainsi ! Adrien continuerait ses études ; puis, durant la belle saison, ils voyageraient. C’étaient des rêves exquis dont ils jouissaient par avance, et qu’ils n’interrompaient que pour se plonger dans une réalité plus délicieuse encore.
Au milieu de ces transports, Laure cependant ressentait un regret. Elle se demandait si elle avait été habile en cédant si vite aux supplications d’Adrien, si, malgré ce qu’il connaissait de sa première chute, il n’eût pas été possible, en se refusant plus longtemps, de faire de lui un mari au lieu d’un amant. Ce doute répandait un nuage sur le contentement de mademoiselle Malestra. Elle comprenait bien que la rapidité qu’elle avait mise à se livrer, se retournerait contre elle, quand s’apaiserait la première fougue d’Adrien. Alors, préoccupée de conjurer ce danger encore lointain, elle jetait brusquement le spectacle de ses larmes et d’un repentir simulé dans la béatitude de ces heures inoubliables.
— Ne me reprocheras-tu pas un jour la facilité que tu as eue à me convaincre ? murmurait-elle.
— Te reprocher ce qui fait ton plus grand charme à mes yeux ! s’écriait Adrien ; te reprocher de n’avoir pas voulu me torturer par des coquetteries et des résistances calculées, de t’être laissé emporter par ton cœur ! Je serais un misérable. Certaine de la sincérité de mon amour, tu t’es donnée. Je ne veux me le rappeler que pour te chérir davantage.
Et c’étaient des baisers plus tendres, des étreintes plus passionnées auxquelles Laure ne se dérobait que pour trahir des terreurs nouvelles, et faire croire que la joie d’être aimée s’évanouissait dans la peur d’être abandonnée. Alors il la berçait en de douces paroles, aboutissant toutes à cette promesse qui les résumait :
— Je ne t’abandonnerai pas.
— Ta mère voudra te marier !
— Je résisterai ; je ne peux être à une autre femme, puisque je t’appartiens.
Au petit jour, il fallut se séparer. Mademoiselle Malestra ne voulait pas être vue chez son amant. Elle y était entrée à la nuit, les traits cachés sous un voile épais ; elle entendait en sortir de même, entourer de mystère les visites qu’elle lui ferait encore, jusqu’à ce que l’appartement qu’elle devait habiter fût prêt à la recevoir. Par les rues désertes et froides, au long desquelles l’eau gelée des ruisseaux étendait sur les pavés de larges coulées de verglas, Adrien la conduisit jusqu’à sa porte. Sa profession l’obligeait à prolonger ses veilles pendant la saison des bals ; elle était accoutumée à rentrer tardivement. Ils se quittèrent en se promettant de se retrouver le soir. Il revint en toute hâte chez lui, se recoucha et dormit plusieurs heures, poursuivi jusque dans son sommeil par le souvenir de ces moments enchantés.
La femme qui le servait ne le réveilla que pour lui annoncer son déjeuner. Depuis longtemps déjà, Roudier l’attendait dans son cabinet en lisant les journaux. Roudier, maintenant, prenait presque tous ses repas chez son ami. Il n’attendait même plus qu’on l’invitât. Pour la première fois, Adrien regretta de lui avoir laissé contracter cette habitude. Après de si violentes émotions, il eût été heureux de se trouver seul.
— Et l’école, paresseux ! qu’en faisons-nous ? C’est par ces mots que Roudier le salua ; il ajouta ensuite, d’un ton railleur : — Ça sent la femme, ici. Adrien voulut protester. — Ne nie pas, reprit l’autre, l’évidence t’accable.
Et du bout de sa canne, il désignait un mouchoir bordé de dentelles, oublié sur un fauteuil, et sur le tapis, une rose tombée du corsage de Laure Malestra.
— Trêve aux plaisanteries, répondit Adrien ; j’ai une maîtresse, tu l’as deviné, garde-moi le secret.
— Une maîtresse ! toi, le pur, le chaste ! Et tu ne m’as rien dit !
— Tu la connaîtras plus tard, si tu t’engages à ne pas railler, blagueur féroce. Elle est digne de ton respect.
— Digne de mon respect, une personne qui a passé la nuit chez toi !
— Jacques !
— C’est bien, je la vénérerai comme une madone. Est-ce assez ? Où l’as-tu connue ?
— Je te le dirai un jour. Jusque-là, tu m’obligeras en ne me parlant pas d’elle.
Roudier se tint pour averti. Ils passèrent dans la salle à manger. Le déjeuner fut silencieux. Adrien se recueillait, craignant de laisser se dissiper le trésor de ses émotions, s’emprisonnant volontairement dans ses souvenirs. Mais quand, le repas fini, il fut revenu dans son cabinet et s’y trouva seul avec Roudier, il ne put se défendre contre l’impérieux besoin de lui confier son bonheur. Sans avoir été sollicité, le secret sortit de sa bouche, avec l’histoire de son amour. Il révéla ce que tout à l’heure il entendait garder caché.
Roudier l’écoutait sans l’interrompre, mécontent de sentir s’élever une influence en face de la sienne, et la redoutant.
— Allons, je vois bien que je n’ai plus rien à faire ici, soupira-t-il. L’amour est venu ; c’en est fini de l’amitié.
— Es-tu fou ? dit Adrien. T’ai-je donné le droit de me croire capable d’oublier le passé ? Tu seras toujours mon ami, je l’espère bien ; notre ami, continua-t-il en appuyant sur ces mots. Quand tu connaîtras Laure, tu comprendras qu’il ne tient qu’à toi de garder ta place à mon côté.
Quelques jours après, mademoiselle Malestra abandonnait la mansarde où depuis longtemps elle se morfondait dans une lutte désespérée contre l’âpre nécessité. Même au moment d’en sortir pour toujours, elle refusa d’y recevoir Adrien. Elle craignait d’être vue par lui dans ce cadre sombre où partout se révélaient sa détresse, les humiliations subies, les désespoirs amers, les expédients pour vivre. Montrer à Adrien ces lieux maudits, c’eût été lui donner une idée trop haute de ses bienfaits, imprimer ineffaçablement dans sa mémoire le souvenir de la misère à laquelle il arrachait Laure, et lui laisser le droit de supposer qu’en cédant à ses amoureuses supplications, elle était moins préoccupée de le rendre heureux que de secouer le joug odieux de sa pauvreté.
L’appartement loué pour elle et meublé en quelques jours par Adrien, était situé dans la rue qu’il habitait, non loin de sa maison. Les croisées prenaient jour sur un vaste jardin. Décorateurs et tapissiers avaient fait merveille. L’argent et le goût sont des magiciens puissants et ingénieux. La prodigalité de l’amant et la fantaisie de la femme s’étaient unies pour créer là un vrai nid d’amour.
Mademoiselle Malestra vint s’installer un soir dans sa nouvelle demeure, conduite par Adrien, qui lui en fit les honneurs. Le logis était chaud, éclairé et riant, le dîner servi, les domestiques discrets. Au moment où les amoureux allaient se mettre à table, Jacques Roudier arriva. Présenté par Adrien comme un ancien et fidèle ami, il fut à l’aise tout de suite. A la fin de la soirée, il causait avec Laure familièrement comme avec un vieux camarade. Il reprenait là ses habitudes, bruyant, railleur, impérieux, sans gêne, s’allongeait dans les fauteuils, secouait sur les tapis la cendre de son cigare, s’invitait pour le lendemain et pour les jours suivants.
Accoutumé à ses excentricités, Adrien ne s’en étonnait plus ; le bonheur le rendait indulgent. Quant à Laure, loin d’être choquée par les allures de Roudier, elle subissait son charme. Avec sa grosse gaieté lourde, sa verve intarissable, sa paresse révélée dans le négligé de ses vêtements, la promptitude de son coup d’œil où pétillait la ruse, ses instincts rapaces qu’elle devinait sous le sourire bon enfant et l’apparente insouciance du lendemain, sa serviabilité un peu brutale dissimulant des calculs sans fin, il plaisait à cette femme, qui retrouvait en lui ses goûts, ses désirs, ses ambitions basses, les préoccupations qui l’obsédaient elle-même. Elle admirait ses larges épaules, son cou de taureau, sa lèvre lippue où éclataient les appétits sensuels. Elle le regardait à la dérobée, déjà séduite. La femelle reconnaissait son mâle dans ce garçon encombrant et robuste, bien plus que dans le jeune homme nerveux, frêle et doux, aux bras de qui l’avait jetée sa misère et qu’elle feignait d’aimer.
Au premier regard échangé, leurs deux perversités se comprirent. Pour l’ami comme pour la maîtresse, Adrien de Varimpré était une proie, sur laquelle, gueux, dépenaillés, affamés, ils comptaient se remplumer, chacun d’eux exerçant son influence par les moyens qui lui étaient propres et au mieux de ses intérêts. Dès cette rencontre, et sans qu’ils se fussent rien confié, un pacte tacite se formait entre ces natures vénales et fausses. C’était le « part à deux » que se jettent comme un cri d’entente et de ralliement deux larrons acharnés sur la même victime.
Cette complicité encore inactive, mais déjà menaçante, se créait en présence d’Adrien, qui n’y voyait rien. Il souriait, heureux, confiant, croyant les autres tels qu’il était lui-même, se reposant sur leur loyauté, aveuglé par l’amour qui le livrait sans défense à une créature déchue, dégradée et pervertie, et la lui montrait dans un horizon radieux comme la compagne de sa vie, rapprochée de lui par l’identité de leurs infortunes passées, maintenant à jamais oubliées.
Au moment où ces périls imminents, quoique invisibles encore, montaient autour de lui à la faveur de son inexpérience et de sa crédulité, sa mère se préparait à le rejoindre. Elle lui devait ses conseils, son appui, les témoignages de son amour. Responsable de son salut, elle était tenue de veiller sur cette âme tendre et sensible, qu’elle devinait meurtrie, découragée, jetée hors du droit chemin. Ces graves considérations, l’étrangeté et l’imprévu de l’événement qui venait de lui rendre son fils, avaient déterminé ses directeurs à lui permettre de quitter le Carmel de Beaucaire pour résider dans une des maisons de Paris. La date de son départ n’était pas encore fixée. Elle ne le serait que lorsque le chapitre aurait procédé à l’élection d’une nouvelle prieure, en remplacement de la mère Thérèse de Jésus.
Les nombreuses lettres que recevait Adrien depuis qu’il s’était fixé à Paris, l’entretenaient de ces détails, lui apportaient des avertissements dont le témoignage d’une tendresse profonde tempérait l’austérité. Elles lui parlaient plus souvent du ciel que de la terre, de l’avenir que du présent. L’objectif suprême qu’elles lui rappelaient sans cesse, c’était l’éternité. Parfois, cependant, elles manifestaient le regret qu’éprouvait Nicolette de s’être donnée pour toujours à Dieu, d’avoir enchaîné sa liberté, de ne pouvoir la ressaisir pour se consacrer à son fils. Il est vrai que ce regret, à peine exprimé par la mère, la religieuse essayait d’en atténuer l’expression en disant que bientôt Adrien pourrait la voir tous les jours, et trouverait auprès d’elle l’affection à laquelle il avait droit. Mais il jugeait que c’était là une faible compensation à tout ce qui lui manquait. Malgré tout, l’implacable égoïsme de la dévote, après avoir pesé sur la vie d’Adrien, se trahissait encore, lui apparaissait plus cruel, aigrissait son cœur, amenait sous sa plume des paroles amères.
Cet état se prolongea jusqu’au jour où il connut Laure Malestra. Alors, son ressentiment s’apaisa. Pendant les quelques semaines où, jouet de ses illusions, il put croire qu’il avait trouvé avec une maîtresse aimante et dévouée un bonheur sans fin, le souvenir de l’égoïsme maternel s’évanouit. Quand lui parvint la nouvelle de la prochaine arrivée de madame de Varimpré, désormais certaine, cette nouvelle, loin de lui causer toute la satisfaction qu’il en espérait naguère, le laissa froid. Elle lui fit même concevoir une inquiétude. Il vivait en plein bonheur. N’aurait-il pas à défendre ce bonheur contre les scrupules religieux de sa mère, si elle le découvrait ? Les liens qu’il venait de former étaient criminels, selon la loi de l’Église ; ils compromettaient son salut. Sa mère s’efforcerait de les briser. C’est de cela que vaguement il s’alarmait.
Cette préoccupation eut aussi peu de durée que son bonheur. En moins d’un mois, elle fut emportée par le rapide désenchantement qui succédait dans le cœur d’Adrien aux premières illusions de l’amour. Pendant les premiers jours de leur liaison, alors que Laure Malestra s’appliquait à séduire ce jeune homme jeté par le hasard sur son chemin, elle avait joué la comédie pour obtenir de lui tout ce qu’elle en attendait. Elle s’était faite douce, caressante, réservée, docile, approuvant tous les plans qu’il formait, sa manière d’envisager la vie, en apparence uniquement possédée du désir de lui plaire, de ne vivre que pour lui, dans l’ombre, à ses côtés, sans autre ambition que celle de le rendre heureux. C’est ainsi qu’elle l’avait enveloppé de sa séduction.
Trompé par les manifestations de cette tendresse feinte, Adrien s’était livré tout entier, allant lui-même au-devant de la domination que Laure entendait exercer sur lui. Maintenant, elle le tenait solidement. Elle le tenait par les compromissions qu’il avait subies, par les responsabilités qu’il avait acceptées, par tous les engagements arrachés à sa première ivresse, et surtout par l’amour. Déjà, elle le connaissait assez pour savoir que, quoi qu’il arrivât, il ne chercherait pas à se dérober à ses promesses, et que, même dans le cas d’une séparation, il ne l’abandonnerait pas sans assurer sa vie matérielle. C’est là surtout ce qu’elle voulait de lui. Sûre de l’obtenir, elle entrevoyait la possibilité d’une rupture qui la rendrait libre. Elle rêvait une autre existence que l’existence paisible, solitaire et cachée dont Adrien vantait sans cesse la douceur. Trop peu semblable aux autres hommes, trop supérieur à elle était cet amant ; elle en souhaitait un autre, un Jacques Roudier, mieux fait pour la comprendre, pour devenir son mari, et qui accepterait d’elle une fortune en échange de son nom, sans vouloir en connaître l’origine.
Quand elle eut mesuré l’étendue de son pouvoir, — ce fut fait en huit jours, — elle ne se contraignit plus et jeta son masque. Sa vraie nature apparut, sa nature vulgaire, cupide, affamée de revanche contre cette société qui lui avait fait des jours sombres et durs, la grossièreté de ses aspirations, l’indifférence de son cœur, la violence de son caractère, le bruyant scepticisme et les envies incessantes d’une âme flétrie au contact du vice. Elle fut tout à coup une femme nouvelle, capricieuse, acariâtre, n’apportant dans la vie d’Adrien, au lieu de tout ce qu’il espérait, que scènes pénibles, âpres querelles, torture de tous les instants qui troublait son esprit, le déshabituait du travail, de la paix domestique, et qu’il ne cessait de subir un jour que pour la sentir renaître le lendemain.
Il tombait de si haut que, d’abord, il ne voulut pas croire à la réalité de sa chute. Les hommes, les meilleurs, sont ainsi faits qu’il leur en coûte de reconnaître qu’ils se sont trompés. Il garda pour lui le secret de son mal. Il le cacha même à Roudier, qui cessait de lui inspirer confiance. A mille traits qui ne l’avaient pas frappé quand ils s’étaient produits, mais qui lui revenaient maintenant en mémoire ; à l’ardeur que mettait en toute occasion son ami à soutenir et à défendre Laure, à lui donner raison, il devinait l’identité de leurs idées, de leurs goûts, de leurs intérêts ligués contre lui dans une sympathie croissante. Il pressentait un accord tacite, des espérances communes, des projets formés en vue d’un avenir auquel on faisait allusion en son absence, et auquel on ne l’associait pas. C’était un soupçon vague encore, mais raisonné, causé par l’étrangeté déplaisante des allures de la maîtresse en présence de l’ami, par des rapprochements surpris, par des silences subits quand il rentrait et les trouvait ensemble. Avec le soupçon commençaient à poindre la fatigue et le dégoût.
Cependant, il se leurrait encore de l’espoir que l’amour et l’amitié lui resteraient fidèles. Il se dépensait en efforts multipliés pour plaire à Laure. Il redoublait d’attentions, de soins, de générosité pour arrêter ce flot montant d’ingratitude et d’oubli. Mais plus il apportait de courageuse ardeur à lui opposer les témoignages de son amour, plus ce flot montait. Dédaigneuse de cet amour, Laure ne dissimulait plus. Brisé par cette lutte, surpris en plein rêve, désabusé, Adrien, moins d’un mois après avoir rencontré Laure Malestra, voyait approcher la fin de son bonheur, et de nouveau était entraîné à rendre sa mère responsable de ses souffrances.
C’était au sortir de table, après le maigre repas que les Carmélites prennent à midi. Elles se répandaient dans le jardin pour s’y livrer à la récréation prescrite par la règle. Vif était le froid de cette journée de décembre, glacé le vent qui montait du Rhône. Mais, dans le ciel bleu, flambait un tiède soleil dont les rayons égayaient les champs dépouillés, vus du haut du rocher, immensité lumineuse, sans verdure et sans fleurs, bornée par la cime neigeuse des Alpes qui tremblait sur l’horizon, ainsi qu’un nuage vaporeux et lointain.
Habituellement, sous cette lumière joyeuse et réconfortante, les religieuses se divertissaient comme des enfants. Les unes couraient par les allées pour réchauffer leurs membres. D’autres battaient du pied, en marchant en mesure, la terre durcie. Les plus âgées se promenaient en devisant des bontés de Dieu, de la beauté du jour, de l’infortune des pauvres, des fleurs flétries, des oiseaux morts de froid, des petits événements d’une vie uniforme et retirée, dégagée des préoccupations extérieures ; exercices et entretiens innocents qui délassaient l’esprit et le corps, tendus par l’austère contemplation des choses éternelles.
Mais ce jour-là les promenades manquaient de gaieté, les conversations d’entrain. Sur les visages émaciés, fouettés par l’air, et dont le sang attiré à la peau colorait la pâleur maladive, se devinait une grande tristesse. C’est que depuis le matin, la communauté était avertie du départ définitif de la mère Thérèse de Jésus. La prieure devait quitter Beaucaire dans la soirée, après avoir transmis ses pouvoirs à la religieuse élue pour lui succéder. Elle était descendue dans le jardin, à cette heure de récréation, pour faire ses adieux à ses sœurs. Elle se trouvait au milieu d’elles et recevait leurs embrassements. Dans tous les yeux montaient des larmes.
Après avoir longtemps vécu sous sa direction spirituelle, les saintes filles qu’elle abandonnait se souvenaient, non de ses rigueurs, justifiées par celles de la règle, mais de ses vertus et de ses exemples. Leurs regrets naissaient de ces souvenirs. Ils se manifestaient avec tant de fraternelle effusion, que la mère Thérèse de Jésus, quoiqu’elle eût provoqué cette séparation afin de se rapprocher de son fils, ne pouvait se défendre d’un douloureux émoi. C’était une famille aussi, et une famille bien-aimée, que cette communauté religieuse de qui elle avait reçu maintes joies et des consolations ineffables. Elle ne pouvait la quitter sans déchirement. Ni ses sœurs ni elle-même n’ignoraient qu’elles ne se reverraient plus sur la terre. Les unes finiraient leurs jours dans ce couvent où s’était écoulée leur vie ; les autres iraient remplir les vides survenus dans d’autres maisons de l’Ordre. Il n’y avait pas lieu de croire qu’elles se retrouveraient un jour. Au ciel seulement, il leur serait permis de se revoir, et c’est au ciel qu’au moment de se séparer, elles se donnaient un suprême rendez-vous. L’espoir de s’y rencontrer tempérait la tristesse des adieux. La mère Thérèse de Jésus essayait de sourire ; chacune tachait de l’imiter, en échangeant avec elle une dernière étreinte et un dernier baiser.
— Dieu nous réunira, murmurait-elle en refoulant ses pleurs, toute bouleversée par ces témoignages d’affection, qui saluaient mélancoliquement son départ.
Entre les religieuses que ce moment solennel réunissait autour d’elle, se trouvait Jeanne Mauroy, en religion sœur Nicette de la Croix. La novice cherchait avec persistance le regard de la mère, la suivait d’un œil anxieux et interrogateur, comme si elle eût attendu une réponse dans un signe. Elle marchait dans son ombre, lui parlait à tout instant, témoignait de ses regrets par des soupirs, et, volontairement, s’imposait à son attention.
— Vous viendrez me rejoindre tout à l’heure, dans la salle capitulaire, dit tout à coup la mère Thérèse de Jésus. J’ai besoin de m’entretenir avec vous.
Sœur Nicette tressaillit ; elle devint très-pâle. L’angoisse révélée par son visage parut se faire plus poignante ; mais, à partir de ce moment, ses yeux éteints sous ses paupières abaissées n’interrogèrent plus. Elle demeura à l’écart des religieuses groupées autour de la prieure. Pourquoi l’importuner des manifestations de sa douleur, puisque tout à l’heure elle allait la voir seule ?
Trop émue pour prolonger cette scène, la mère Thérèse de Jésus peu à peu se dérobait aux embrassements des sœurs. Maintenant elle avait hâte d’en finir. Pendant quelques instants encore, on échangea des souhaits d’avenir, des paroles de paix.
— Ne nous oubliez pas, ma mère !
— Au revoir, ici-bas ou là-haut, mes chères filles.
— Priez pour nous.
Puis, la prieure, exerçant ses pouvoirs pour la dernière fois, fit un geste qui contenait une supplication et un ordre. Les sœurs s’inclinèrent tandis qu’elle quittait le jardin, au moment où la cloche annonçait la fin de la récréation.
Elle s’était rendue dans la salle capitulaire, vide à cette heure du jour. Elle y marchait de long en large, en attendant sœur Nicette. La novice ne tarda pas à venir. Elle avait toujours sur ses traits ce même air de doute anxieux, qui depuis quelques jours y semblait gravé. En la voyant entrer, la prieure interrompit sa promenade. La jeune fille s’approcha et tomba à genoux :
— Relevez-vous, mon enfant, dit la mère avec bonté ; je ne suis plus votre supérieure.
— Vous serez toujours ma mère spirituelle, répondit sœur Nicette en obéissant. C’est vous qui m’avez ouvert le Carmel, ma mère, en me parlant des joies qu’on y trouve. Cela, je ne l’oublierai jamais, alors même qu’on me séparerait de vous.
La fin de la phrase fut couverte par les larmes, larmes émouvantes. Elles trahissaient la détresse de cette âme candide qui dans le cloître avait cherché et trouvé une affection qu’elle était maintenant menacée de perdre. La mère Thérèse de Jésus ne se laissa pas attendrir. D’une voix sévère et froide, elle reprit :
— Dieu nous défend ces violents attachements pour ses créatures. Toutes les religieuses qui vivent ici sont au même degré que moi vos mères et vos sœurs en Jésus-Christ. Vous devez les aimer également. La préférence que vous me témoignez est une offense pour lui. Il nous défend aussi l’esprit de révolte. Or, c’est l’esprit de révolte qui a mis sur vos lèvres les mots que vous venez de prononcer.
Sœur Nicette baissa les yeux.
— Dieu ne nous défend pas l’amitié ! objecta-t-elle doucement.
— Sans doute ; mais il veut que nous soyons toujours prêtes à la lui sacrifier. Depuis douze ans que je vis dans ce monastère, j’ai perdu des compagnes que j’aimais tendrement. Les unes ont été appelées à embellir de leurs vertus des maisons de notre Ordre ; d’autres sont allées en recevoir la récompense dans l’éternité ; je me suis résignée.
La novice éleva sur la mère ses yeux navrés.
— On nous sépare donc ? murmura-t-elle. S’il en est ainsi, je ne prononcerai pas mes vœux. Je quitterai le Carmel plutôt que de me résigner à y vivre sans vous.
Ce langage exprimait une peine vive et sincère. La mère Thérèse de Jésus en fut touchée. Elle réprima l’avertissement qui montait à sa bouche, provoqué par cette menace si peu conforme à l’esprit de la règle.
— Vous avez bien à faire pour vous rendre digne de prononcer les vœux, sœur Nicette, dit-elle avec compassion. Si vous m’aviez laissée parler, vous sauriez déjà que le désir que vous avez manifesté est exaucé. On a eu égard à votre jeunesse, à vos incertitudes ; on a trouvé bon que je demeurasse chargée de veiller sur vous, d’éclairer votre route, de rechercher si vous avez la vocation. Ce qu’on n’eût point accordé à une professe, on l’a accordé à une novice, sur vos pressantes sollicitations.
— Alors je suis autorisée à vous suivre, ma mère ! s’écria joyeusement sœur Nicette de la Croix, déjà consolée.
— J’espère que la décision dont vous êtes l’objet disposera votre âme à recevoir avec docilité les conseils qui vous seront donnés. Vous partez ce soir avec moi. Vous prendrez pour la durée du voyage vos vêtements séculiers. Allez, mon enfant.
Cédant à l’habitude, la novice se prosterna, baisa la terre ; puis s’élançant au dehors, légère comme un oiseau, elle disparut, un sourire sur les lèvres, transfigurée par le bonheur.
— Pauvre enfant ! murmura la mère, je crains bien qu’elle ne soit perdue pour le Carmel. Trop sévère est la règle pour cette âme tendre. Pourra-t-elle en supporter les rigueurs ? Éclairez-la, mon Dieu, et que votre volonté s’accomplisse.
Dans la soirée de ce jour, vers onze heures, un modeste cabriolet conduisait la mère Thérèse de Jésus et la sœur Nicette de la Croix à la gare de Tarascon, où elles devaient prendre le train de Paris. Elles avaient quitté leurs habits de religion. C’est la coutume des Carmélites quand elles voyagent, coutume justifiée par la nécessité d’échapper à la curiosité qu’exciterait sur leur passage l’austère costume de l’Ordre. Elles étaient vêtues de noir, comme des femmes en deuil, coiffées d’un chapeau qui cachait entièrement la tête, de manière à dissimuler les cheveux coupés ras. Elles pouvaient ainsi passer inaperçues. Quand le train arriva en gare, elles montèrent dans le wagon des secondes réservé aux dames seules, et quelques minutes après, elles étaient emportées vers Paris.
Quoique sœur Nicette se fût promis de veiller en priant, sa jeunesse fut plus forte que ses résolutions. Après avoir échangé quelques mots avec la mère, elle s’endormit, enveloppée dans son manteau, le rosaire aux doigts, en récitant des prières. Sous la clarté tremblante et pâle de la lanterne, son fin profil se dessinait, noyé dans la voilette noire attachée au chapeau et descendant jusqu’au menton. Son corps, secoué par la marche saccadée du train, se balançait sans que son robuste sommeil fût interrompu. Les mains, enlacées par le long chapelet de bois, étaient croisées sur les genoux. La mère Thérèse de Jésus la regardait avec sollicitude, se demandait de nouveau si cette enfant qui cédait à la première fatigue, ne serait pas vaincue par les austérités du cloître, et loin que son propre souvenir la rassurât, elle s’alarmait comme si la frêle créature endormie là, sous ses yeux, eût été sa fille.
Elle l’aimait d’une maternelle affection. La persistance et l’ardeur avec lesquelles sœur Nicette allait à elle, cette admiration confiante dont à toute heure elle recueillait les témoignages, avaient fini par la toucher. Après le bonheur de son fils, elle ne souhaitait rien plus passionnément que le bonheur de la jeune novice. C’est parce qu’elle doutait que la vie religieuse pût réaliser ce bonheur qu’elle avait voulu continuer à veiller sur cette âme et obtenir de ne pas la quitter. Elle se promettait de l’observer quelques temps encore, puis, si ses craintes se confirmaient, de la détourner de cette vie, faite de privations et de souffrances. Les chrétiens peuvent assurer leur salut ailleurs que dans le cloître. Ils peuvent l’assurer aussi dans le monde, et y donner des exemples édifiants. Si Jeanne Mauroy renonçait à se faire Carmélite, elle serait une épouse chaste, une mère dévouée ; elle élèverait ses enfants dans l’amour de Dieu.
Nicolette se répétait ces choses, et brusquement, dans sa pensée en travail, naissait l’idée qu’il faudrait à son fils une femme telle que Jeanne. Sous l’empire de ses préoccupations, elle arrivait à désirer, sans oser se l’avouer, que la novice renonçât à prononcer les vœux éternels et quittât le couvent. Ce désir soudain, allumé dans une vision rapide de l’avenir, fut comme une poussée de son cœur vers Jeanne Mauroy. Elle aurait voulu l’embrasser. Elle se contint ; mais sa sollicitude maintenant devenait plus profonde. Elle veillait anxieusement sur le sommeil de la jeune fille. Craignant qu’elle eût froid, elle jeta un châle sur ses genoux. Cette précaution prise, elle croisa les bras et resta immobile, laissant son imagination la devancer au terme de cette route où elle allait retrouver son fils, à peine entrevu pendant son court séjour à Beaucaire et qu’elle brûlait de mieux connaître. Depuis quelques jours, les lettres d’Adrien étaient moins fréquentes, plus brèves. On y devinait une lassitude, un souffle de mélancolie. Que faisait-il ? Comment vivait-il ? Elle avait hâte de le savoir, hâte surtout d’entrer dans sa vie et de préparer l’avenir.
Elle se rappelait aussi que la route qu’elle faisait en ce moment, elle l’avait faite vingt-quatre ans avant, le soir de son mariage, en compagnie de Frédéric, quand il la conduisait au château de Varimpré. Il lui semblait qu’elle reconnaissait le paysage ; elle croyait voir les arbres s’incliner sur son passage, entendre une voix mystérieuse lui dire :
— Est-ce toi ? Nicolette, est-ce bien toi ? Que d’événements et que de malheurs causés par ta faute, depuis ces jours lointains où l’avenir te souriait !
Au souvenir de ce passé, le remords grondait dans sa conscience. Il lui répétait qu’après s’être refusée à son mari, elle se devait à son fils ! Mais, hélas ! que pouvait-elle, liée par des vœux éternels qui la retenaient dans un cloître comme dans une prison ? Elle n’avait pas le droit de secouer ses chaînes. Elle ne se trouvait pas dans un de ces rares cas prévus par l’Église, où le père ou la mère d’une religieuse étant tombés dans le besoin, et le travail de celle-ci leur étant nécessaire, elle peut quitter le couvent et reprendre la vie séculière. Libre, elle eût été utile à son fils ; mais elle ne lui était pas indispensable. Elle ne pouvait que le voir souvent, séparée de lui par la grille claustrale, l’assister de ses conseils, l’exhorter au bien et prier le ciel de le rendre heureux. C’était beaucoup, mais pas assez pour satisfaire aux ardents désirs de son amour.
Elle demeura ainsi jusqu’au matin, en face de sœur Nicette endormie. A Lyon, la novice se réveilla. Confuse de son long sommeil, elle allait s’excuser. La mère Thérèse de Jésus l’arrêta avec bonté. Puis elle voulut la conduire au buffet, et l’obligea à y déjeuner, tandis qu’elle-même observait le jeûne, bien que pendant la durée du voyage, elle en fût dispensée. Après un court arrêt à Lyon, le train se remit en route.
Alors, les deux religieuses seules dans leur wagon firent en commun leurs prières, et récitèrent de même l’office qui se psalmodiait à la même heure dans toutes les maisons de l’Ordre. Au delà des monts de l’Ardèche, le soleil se levait, dorait les sommets, descendait au long des pentes, et traversant le Rhône dont il empourprait les tourbillons écumeux, buvait la buée aux vitres de la voiture. Leur méditation finie, elles admirèrent ce spectacle. Sœur Nicette, transportée par la joie de voyager avec la mère et la certitude de ne la plus quitter, ne cherchait pas à taire son contentement. Elle l’exprimait tout haut dans ses paroles, dans son rire, jusque dans ses gestes. La règle des Carmélites prescrit une honnête gaieté. Elle laissait la sienne librement se répandre. Elle n’y fit trêve que lorsqu’un incident du voyage entraîna Nicolette à parler de son fils. La novice alors devint attentive. Elle ne savait presque rien de l’histoire de ce jeune homme rendu à sa mère quand déjà elle ne l’attendait plus. Elle en écouta ce que la prieure voulut lui en raconter.
Celle-ci vantait les qualités de son Adrien, révélées par ses lettres, parlait de tout ce qu’il avait souffert, de l’avenir, et devant Jeanne émue et surprise, se révélait sous un jour inconnu. Jusque dans les remercîments qu’elle adressait au ciel à travers son récit, la mère perçait sous la Carmélite. La nature longtemps opprimée prenait sa revanche, l’amour maternel revendiquait ses droits. Jeanne se demandait si c’était la même femme qui, la veille encore, sous l’habit monastique, semblait morte au monde et n’avoir plus qu’un cœur glacé, à jamais fermé aux sentiments humains.
Jusque vers le milieu du jour, le voyage n’offrit pas d’autre incident. Mais à Sens, une violente émotion attendait Nicolette. Comme le train ralenti entrait en gare, elle aperçut son fils debout sur le trottoir. Il essayait de voir dans les wagons.
— Adrien ! s’écria-t-elle.
Et penchée, tout émue, à la portière, elle lui souriait, l’appelait du geste. Il ouvrit, se jeta dans ses bras, en disant :
— J’avais hâte de vous voir, chère mère. Quand j’ai su que vous arriviez, je me suis mis en route de mon côté pour venir à votre rencontre. Nous allons pouvoir passer quelques heures ensemble.
— C’est que ce wagon est réservé aux femmes seules, objecta-t-elle.
Adrien sourit, fit un signe au conducteur du train qui s’approcha, et à sa demande, enleva la plaque indicatrice pour la placer sur un compartiment voisin. Il put donc monter auprès de sa mère. Elle murmurait, en l’embrassant :
— Je suis heureuse de te revoir, cher enfant. C’est bien à toi de m’avoir fait cette joie.
Dans l’emportement de leur bonheur, ils avaient oublié sœur Nicette. Timide et discrète, la novice les regardait, un peu troublée par la présence de ce jeune homme qui allait voyager avec elle jusqu’à Paris.
— C’est mon fils, lui dit tout à coup la mère Thérèse de Jésus.
Adrien contenait mal sa surprise. Il ignorait que les Carmélites ne voyagent pas vêtues de l’habit de l’Ordre. Il s’était attendu à voir sa mère en religieuse. Il lui semblait qu’en la trouvant vêtue comme toutes les femmes, il était plus libre de l’aimer. Il s’inclina respectueusement devant la novice, stupéfait en reconnaissant sous la voilette ce visage suave, entrevu, comme dans un rêve, lors de sa première visite au Carmel de Beaucaire. Il l’avait presque oubliée depuis. Maintenant, les traits de l’adorable enfant remplissaient son regard, entraient dans sa mémoire, ravivaient l’ancien souvenir effacé. C’était comme un ami qu’on retrouve et que désormais on n’oubliera plus. Il s’assit à côté de sa mère, tandis que Jeanne Mauroy, pour les laisser causer librement, regardait le paysage, le front appuyé contre la vitre froide. Le train se remettait en marche.
Maintenant, penchée sur son fils, Nicolette lui exposait les causes du retard apporté à son voyage. Par ordre de l’autorité ecclésiastique, elle avait dû attendre l’expiration de ses pouvoirs de prieure. Ces pouvoirs expirés, elle allait rentrer dans le rang des simples religieuses. Mais ce changement dans son état, prévu depuis longtemps, ne l’empêcherait pas de voir son fils toutes les fois qu’il se présenterait au couvent. Elle exigeait qu’il y vînt tous les jours. Les Carmélites possèdent à Paris plusieurs maisons. C’est dans celle de la rue d’Enfer qu’elle allait vivre désormais, non loin du quartier qu’habitait Adrien. Après lui avoir donné ces détails, elle l’interrogea. Était-il tranquille, heureux, en paix avec lui-même ? En lui posant ces questions, elle l’enveloppait de ses yeux pénétrants ; elle fouillait sa conscience. Tout à coup, elle s’écria :
— Comme tu es pâle et triste, mon pauvre chéri ! Es-tu malheureux ? As-tu souffert depuis que tu m’as quittée ?
Il protesta, dissimulant son mensonge sous un sourire. Il aurait consenti plutôt à mourir qu’à faire à sa mère l’aveu de la vérité. La faute qu’il avait commise en se livrant à une femme sans cœur, les orages de cette liaison, les querelles incessantes, ses désillusions successives, la destruction de ses espérances, les meurtrissures de son âme, la honte de s’être si grossièrement trompé, voilà le mal dont il souffrait, le mal qu’il refusait d’avouer. Non, il ne voulait pas dire combien lui pesait cette chaîne ; il ne voulait pas raconter que la veille de ce jour, à la suite d’un violent débat, où s’était révélée toute l’infamie de sa maîtresse, il l’avait quittée avec le dessein de la fuir pour toujours. Ces turpitudes ne sont pas faites pour être confiées aux saintes. Il voulait bien en souffrir, mais non les avouer. L’excès de son désespoir l’avait jeté à la rencontre de sa mère. Il ne demandait qu’à se reposer dans la paix de l’amour filial, sans être contraint d’altérer la sérénité de ces douces heures par une confession inutile.
Ses dénégations ne parvinrent pas à convaincre Nicolette. Accoutumée à étudier les âmes, elle devinait que celle de son fils traînait après soi une âpre douleur, quoiqu’il refusât de s’en laisser arracher le secret. Ce secret, elle renonçait à le surprendre ; elle espérait que le temps, en des circonstances plus favorables, le lui livrerait. Mais une fois de plus s’élevait en elle, quoi qu’elle fît pour l’étouffer, le regret de sa liberté perdue, ravivé par la vue de son enfant, par le mystère qu’elle pressentait, impuissante à le déchirer.
Cet entretien confidentiel dura jusqu’à Paris, sans que sœur Nicette quittât sa place, prononçât une parole et tournât la tête du côté d’Adrien. Mais lui, tout en écoutant sa mère, tout en lui répondant, regardait la jeune fille. Il admirait cette physionomie douce, voilée de mélancolie, ce pur regard où se trahissait la candeur de l’âme. Sous les vêtements noirs, il devinait la jeunesse et la beauté, volontairement ensevelies. Il se disait que c’était une âme telle que cette vierge maintenant vouée à Dieu, qu’il aurait voulu associer à sa destinée. Pourquoi ne l’avait-il pas connue plus tôt ? Il l’eût aimée et n’aurait pas rencontré l’odieuse femme qui ne lui avait révélé l’amour que pour lui infliger mille humiliations et mille tortures. Et peu à peu, la vision délicieuse se gravait dans son cœur, où une première fois elle n’avait laissé qu’une trace légère.
— Qui est cette jeune fille ? demanda-t-il tout à coup à sa mère, de façon à n’être entendu que d’elle.
— Mademoiselle Jeanne Mauroy, en religion sœur Nicette de la Croix. Elle appartient à une honorable famille du Midi, et a voulu entrer aux Carmélites ; elle y fait son noviciat. C’est une fille accomplie.
— Elle n’est donc pas irrévocablement engagée ?
— Non, et je doute qu’elle prononce ses vœux. Je ne la sens pas faite pour le cloître. Si elle rentre dans le monde, elle y brillera de l’éclat des plus belles vertus.
Nicolette n’ajouta rien, et Adrien n’osa pousser plus loin ses questions. Mais sans qu’il pût encore expliquer pourquoi, il était satisfait d’apprendre que mademoiselle Mauroy n’était pas à jamais enchaînée à Dieu.
Quand on arriva à Paris, la nuit se faisait obscure, et les réverbères s’allumaient. Adrien se chargea du petit sac qui contenait les pauvres hardes des deux sœurs, et les conduisit vers une voiture commandée le matin. Il y monta avec elles et jeta au cocher l’adresse des Carmélites de la rue d’Enfer.
— Il m’est interdit d’entrer dans ton appartement, lui dit sa mère avec tristesse. Tout à l’heure, les portes du couvent se fermeront sur moi ; elles ne se rouvriront plus ; il me sera interdit de sortir. C’est la règle. Je voudrais au moins passer sous tes croisées, voir la maison que tu habites.
— Elle est sur notre chemin, répondit Adrien. Quelques instants après, il désignait à sa mère des fenêtres au second étage. — C’est là.
Elle se pencha, et tant qu’elle le put, elle resta ainsi, les yeux fixés sur la maison, pénétrant par la pensée derrière les murailles, toute navrée de l’empêchement qui paralysait sa curiosité.
Dans la rue d’Enfer, devant une haute porte cochère, accédant à un bâtiment peu élevé que prolongeait le mur d’un jardin, la voiture s’arrêta. La porte franchie, Nicolette et Jeanne, toujours suivies d’Adrien, traversèrent une cour, faiblement éclairée par une lanterne. Au fond de cette cour s’étendait la façade du couvent, au sommet duquel se dressait dans une niche la statue de la Vierge.
Puis venait un porche. A droite, au pied d’un étroit escalier, on apercevait la chapelle ; à gauche, la loge de la tourière ; au milieu, la porte de clôture, qui ne s’ouvre qu’aux jours de prise d’habit, pour laisser entrer les postulantes, reçues sur le seuil par la communauté. Avant cette porte, derrière une grille, un petit oratoire se creusait dans l’épaisseur du mur, au fond duquel, sur un autel, entre des cierges toujours allumés, un reliquaire restait exposé à la vénération des fidèles. Sur la blancheur de la chaux, à hauteur d’homme, on lisait deux inscriptions en lettres noires : « Les renards ont leur tanière, et le Fils de l’homme n’a pas une pierre pour reposer sa tête. » — « Le Fils de l’homme viendra au moment où vous ne l’attendrez pas. »
Un grand silence régnait dans le couvent. Du côté de la chapelle, venant du chœur des religieuses, on entendait leurs voix grêles, psalmodiant l’office. Adrien jeta les yeux de ce côté et aperçut comme à travers un nuage d’or l’intérieur de la nef solitaire, le Saint Sacrement exposé au-dessus du tabernacle, des lampes allumées se balançant à l’extrémité des chaînes accrochées à la voûte, et des guirlandes de fleurs grimpant au long des murs, derrière l’autel que surmontait un grand tableau représentant sainte Thérèse, fondatrice et patronne du Carmel. La mère Thérèse de Jésus et la sœur Nicette de la Croix s’étaient agenouillées dans l’oratoire. Adrien se tenait derrière elles, son chapeau à la main, impressionné, recueilli, attendant qu’elles eussent fini leurs prières. Debout devant sa loge, la tourière regardait les nouveaux venus, un peu intriguée par la présence de ce jeune homme, qui, debout devant l’autel, ne priait pas. Quelques minutes s’écoulèrent ainsi. Puis, la mère se releva, et la novice fit comme elle. L’heure de la séparation avait sonné.
— A demain et à toujours, mon fils, dit Nicolette suspendue au cou d’Adrien. Aime-moi comme je t’aime. Songe à moi, prends l’engagement d’être docile à mes conseils. Bientôt, je t’entretiendrai de ton âme ; c’est mon devoir. Je veux te mettre en état de résister à l’esprit du siècle ; — esprit pervers, — te soumettre à la douce loi de Jésus. Crains Dieu, prie-le souvent, et n’oublie pas qu’il se venge des offenses commises contre lui.
Adrien écoutait ces avertissements, répondait aux tendresses maternelles. Mais il regardait aussi Jeanne, immobile et les yeux baissés, et demandait à cette vision suprême l’éternité du souvenir. Quand il dut se retirer, il s’inclina devant la jeune fille ; il la quitta sans avoir entendu le son de sa voix.
Tristement, Adrien se dirigeait vers sa demeure. Il venait de se convaincre que sa mère ne pouvait être pour lui que comme si elle n’eût pas été. Séparé d’elle après avoir cru la retrouver, sans illusions désormais sur Laure Malestra, doutant de l’amitié de Roudier, il portait, accablé, le fardeau de son isolement. Le souvenir de Jeanne Mauroy même lui était cruel. Toujours ce souvenir lui rappellerait la femme qu’entre toutes, il eût préférée. Quoiqu’il lui fût doux de se répéter qu’elle n’avait pas prononcé des vœux éternels, et que peut-être il lui serait donné de la revoir, trop précaire était cette espérance pour le consoler.
En rentrant dans sa maison, il y trouva Roudier, qui, à sa vue, s’écria avec un accent de reproche :
— Voici plusieurs heures que je t’attends.
— Tu aurais pu m’attendre plus longtemps encore. Je n’ai pas passé la journée à Paris.
— Tu as voyagé ? demanda Roudier vivement. D’où viens-tu ?
La curiosité de son ami choqua Adrien.
— C’est mon secret, répondit-il avec froideur.
— Bien, bien, je n’insiste pas. Garde-le, ton secret. Je te ferai remarquer seulement que tu m’avais accoutumé à plus de confiance.
— Tu l’as détruite, en devenant l’ami de Laure plus que tu n’as jamais été le mien.
— Ceci est de l’injustice.
— Crois-tu que je n’aie pas surpris tes conciliabules avec elle, votre intimité, votre entente ? Depuis que cette misérable fille m’a révélé sa nature basse et méchante, toutes les fois qu’une querelle a éclaté entre elle et moi, tu lui as toujours donné raison.
— Parce que tu l’aimais et que je voulais t’épargner la douleur de la perdre. Je me suis conduit en véritable ami. Ah ! l’éternelle histoire : « Deux coqs vivaient en paix ; une poule survint, et voilà la guerre allumée. » Qui pouvait prévoir cela : jaloux, toi !
— Non, pas jaloux, mais malheureux, répondit doucement Adrien, honteux d’avoir adressé des reproches à son ami.
— Malheureux ! Tu n’es pas seul à l’être. Depuis hier, cette pauvre femme est dans les larmes. Elle se désespère, elle regrette de t’avoir irrité ; elle t’appelle. Je suis venu pour te l’apprendre, et je lui ai promis de te ramener à ses pieds.
— Je n’y veux pas retourner ; c’est fini. Je me suis trompé quand j’ai cru l’aimer et pouvoir vivre à ses côtés. Elle-même ne m’aimera jamais. Il vaut mieux reconnaître notre erreur que d’en souffrir plus longtemps.
— C’est toi qui parles ainsi, quand il y a moins d’un mois, tu me confiais que tu ne la quitterais jamais !
— Elle ne s’était pas encore révélée… Du reste, je ne lui dois rien. Je l’ai trouvée dans la misère, je l’en ai tirée ; elle est à l’abri du besoin. Non, je ne lui dois rien.
— Eh ! ce n’est pas de cela qu’il s’agit, reprit Roudier ; c’est de son chagrin. Je te dis qu’elle te ferait pitié, si tu la voyais.
— Elle se consolera… Cesse de me parler d’elle.
Roudier comprit à cet accent résolu qu’une plus longue insistance ne ferait que fortifier la décision d’Adrien.
— A ton aise ; mais tu regretteras ta rigueur. Tu ne trouveras pas une autre Laure. Elle t’aime, quoi que tu en dises.
Comme Adrien semblait peu disposé à se laisser convaincre, Roudier renonça pour le moment à obtenir ce qu’il était venu lui demander. Mais au lieu de s’éloigner, il resta, se contentant de mettre l’entretien sur un autre sujet. Adrien l’écoutait distraitement, lui répondait à peine. Sa pensée était ailleurs. Il songeait à sa mère, à Jeanne Mauroy, à tout le bonheur qu’il aurait goûté s’il eût pu vivre avec elles. Ce bonheur lui était refusé. Il restait isolé, découragé, désabusé, sans savoir s’il pourrait jamais trouver une affection plus sincère que celle de Laure et qui comblât le vide de son cœur. Son accablement le rendait faible. Roudier le devina. Feignant de vouloir se retirer, il prononça le nom de mademoiselle Malestra, en poussant un soupir qui exprimait sa compassion.
— Réfléchis, ajouta-t-il ; es-tu décidé à ne plus la revoir ?
Au moment de prendre un parti si grave, de renoncer à son amour et de briser de ses propres mains son idole, Adrien hésita. Roudier tira très-habilement parti de cette hésitation.
— Consens à y retourner au moins une fois, dit-il, je t’en prie.
— Pourquoi tiens-tu donc à me ramener vers elle ? demanda Adrien soupçonneux.
— Pourquoi ! parce que je suis ton ami, et que Je voudrais t’éviter une faute dont tu te repentirais longtemps.
Il se donnait des airs affectueux et désintéressés. A l’en croire, il n’agissait que pour servir Adrien. Mais il mentait, le misérable ! Tout autre était le mobile de sa conduite. Depuis vingt-quatre heures, durant la courte absence d’Adrien, il avait reçu les aveux de Laure Malestra. Il savait qu’elle le considérait comme le plus séduisant des hommes. Il ne pouvait douter de ces sentiments passionnés qui flattaient son orgueil et réchauffaient sa décrépitude morale. Conquise par ses vices, Laure lui en avait fourni les preuves les plus éloquentes qu’une femme puisse donner. Maintenant qu’elle était hors de la misère, elle voulait vivre avec lui, ne souhaitait rien qu’une union qui les enchaînerait pour toujours l’un à l’autre.
— Nous aurons des jours heureux et tranquilles, lui disait-elle ; on ne nous connaît pas ; nous passerons inaperçus au milieu de la foule ; librement, nous nous aimerons. Je possède assez pour être rassurée au point de vue matériel pendant quelques années. Nous verrons ensuite.
Jacques Roudier ne disait pas non. Déshabitué du travail, incapable de gagner son pain, n’attendant de ses parents qu’un mince patrimoine, l’étrange amour qu’il inspirait lui assurait des ressources dans le présent, une grasse paresse dans l’avenir. Il s’appliquait cependant à calmer les impétueuses ardeurs de Laure. Il voulait bien cette maîtresse qui s’offrait, spontanément attirée par ce qu’elle découvrait en lui de perversité égale à la sienne. Mais il n’entendait pas la pousser à un coup de tête qui malgré tout l’appauvrirait, ni s’exposer à porter un jour la responsabilité de cette exaltation, si jamais elle en regrettait les suites. Il lui démontra qu’elle avait eu tort de décourager si vite l’amoureux Adrien, qu’elle devait réparer sa sottise, aller à lui la première, se faire pardonner, le reprendre, et pour le retenir, au moins jusqu’à ce qu’elle eût obtenu des libéralités nouvelles, continuer à jouer la comédie de l’amour. Il inaugura son influence sur elle en exigeant qu’elle se conformât à ces plans. Elle promit d’obéir.
C’est alors qu’il était accouru chez Adrien, afin d’empêcher que la rupture survenue entre les amants se consommât. Pendant une heure, il plaida pour Laure avec une habile éloquence. Il rappela les émotions des premières rencontres. Il prouva qu’Adrien ne pouvait se détacher aussi aisément qu’il le croyait d’une fille dont il avait troublé le cœur en lui parlant d’amour et détournée du devoir en lui parlant d’union éternelle. Adrien protestait. Il se défendait d’avoir été le premier amant, d’avoir provoqué la séparation. Il rappelait ses bienfaits, ses complaisances, toutes les preuves de sa tendresse, méconnues et payées d’ingratitude. Mais Roudier lui fermait la bouche en lui parlant de la beauté de Laure, de cette beauté au pouvoir de laquelle Adrien ne s’était pas si complétement dérobé que le souvenir des joies qu’il lui devait pût le laisser insensible. Puis, quand il vit son ami ébranlé par ses accents, il lui porta le dernier coup en lui montrant Laure malheureuse de son départ, triste à en mourir. Adrien finit par se laisser toucher. Roudier l’entraîna.
Il avait fait la leçon à Laure. Celle-ci voulait passionnément tout ce qu’il voulait, parce que c’était le plus sûr moyen de lui plaire. Restée seule, tandis qu’il allait chez Adrien, elle s’était demandé avec angoisse si l’entreprise réussirait. Elle attendait anxieuse. Quand elle vit entrer Roudier traînant Adrien derrière soi, elle fut saisie d’une si réelle émotion qu’elle n’eut à feindre ni la joie ni les larmes. Elle se jeta dans les bras de son amant, repentante, docile, humiliée, en promettant de l’aimer toujours. Il fut dupe de cette comédie. Elle le disposa à laisser se renouer les chaînes qu’il avait voulu briser. La réconciliation fut complète. Pendant quelques heures, après que Jacques Roudier les eut laissés seuls, il put croire aux transports de Laure, à sa propre ivresse, que l’amour renaissait pour ne plus mourir.
Mais le charme était rompu. Jusque dans les ardeurs rallumées, jusque dans les baisers donnés et reçus, il retrouvait l’âcreté de ses premières souffrances et de ses désillusions. Non, la maîtresse qu’il tenait pressée entre ses bras, cette échevelée qui ne parlait qu’à ses sens et à qui son cœur se dérobait malgré lui, n’était pas, ne serait jamais la compagne qui embellit et honore la vie. De celle-là, il avait vu l’image vivante sous les traits de Jeanne Mauroy. Ces souvenirs le poursuivaient dans le déchaînement des fiévreuses ardeurs, empoisonnait ces heures de délire et paralysait sa passion. Il tentait cependant de faire revivre encore ce qui était mort. Mais ce qui est mort ne revit pas. A la fin de cette nuit, durant laquelle Laure se flattait de l’avoir repris, il ne serait pas revenu s’il n’eût été convaincu de la sincérité de ces sentiments qu’il ne partageait plus. L’amour avait cessé d’être assez puissant pour le retenir ; la pitié seule allait le ramener auprès de sa maîtresse.
En la quittant ce matin-là, il courut au couvent de la rue d’Enfer. Il avait hâte de revoir sa mère. Quand il se présenta pour la demander, les religieuses étaient au chœur. En attendant qu’elles eussent fini leurs oraisons, il entra dans la chapelle. Par ce brumeux matin d’hiver, le jour pâle qui pénétrait dans la nef la laissait assombrie. Les ors et les marbres restaient sans éclat. Les cierges qui se consumaient sur l’autel ne répandaient qu’une lumière brouillassée et rougeâtre. Tout frissonnant, il s’assit dans un coin, caché dans l’ombre d’un confessionnal.
Un calme chargé de mélancolie montait autour de lui. Quelques rares fidèles agenouillés priaient en silence, et là-bas, derrière la grille, la psalmodie monotone traînait sur les lèvres grelottantes. Alors dans cette paix suave, succédant aux orages d’une passion malsaine, il ressentit une saisissante impression de bien-être et de béatitude, comme s’il se fût trouvé tout à coup transporté dans un refuge d’où il pouvait braver les malheurs qu’il redoutait et se laisser emporter par les espérances que lui suggérait son imagination surexcitée. Les chants berçaient sa somnolence, entretenue par les teintes grises du matin. Il prêtait l’oreille, et, l’illusion aidant, entre les voix qui éveillaient les voûtes, il croyait entendre la voix de Jeanne Mauroy. Elle le ravissait, déchaînait l’amour dans son cœur meurtri.
Il demeura là jusqu’au moment où la tourière vint l’avertir que la mère Thérèse de Jésus descendait au parloir. Il se leva et alla l’y rejoindre. Il resta longtemps avec elle. La grille les séparait ; mais ils pouvaient se voir, et c’était une grande douceur. Malheureusement, la mise en scène de ces entrevues, imposante dans sa simplicité, la nudité des murailles, le sévère habit que portait sa mère, la retenue imposée à leurs entretiens par la grille, ne favorisaient guère les effusions de cœur, qui lui eussent été salutaires dans ce moment de détresse. Elles étaient paralysées. Sa mère l’interrogeait, car elle comprenait bien que de graves soucis le poursuivaient. Mais il protestait contre ses soupçons, ne répondait pas à ses demandes, n’osant entretenir la carmélite ni de l’amour qui expirait, ni de celui qui venait de naître.
Malgré tout, cependant, il emporta de cette entrevue un apaisement salutaire. A force de lui répéter, avec l’accent d’une indestructible confiance dans la miséricorde de Dieu, qu’elle priait pour lui, sa mère avait ébranlé ses doutes. Si ces prières d’une âme pure, en vue de son bonheur, allaient porter des fruits ! Cette espérance le ramena au couvent le lendemain, puis tous les jours. Il venait de bonne heure. Il restait longtemps dans la chapelle, assis dans un coin obscur, se pénétrant de la paix réparatrice de ces lieux.
Il allait toujours chez sa maîtresse. Mais il était obsédé par le désir de rompre une liaison qui ne lui donnait rien de ce qu’il en avait espéré et ne répondait plus aux aspirations de son cœur. Ce désir fortifié, il le dissimulait encore, quoique de plus en plus il devînt indifférent aux efforts incessants de Laure Malestra pour reconquérir toute son influence sur lui. Il ne songeait qu’aux moyens de s’y dérober. Encouragée et conseillée par son complice, dupe comme elle de l’apparente docilité d’Adrien, elle croyait son pouvoir solidement rétabli. Elle trouvait facile et douce son existence, heureux son destin. Elle feignait d’aimer Adrien ; en réalité, c’est Roudier qu’elle aimait ; elle saisissait toutes les occasions de le lui dire et de le lui prouver, menait avec cynisme cette odieuse intrigue, devenue très-habile à ce métier dont son préféré partageait allègrement la honte. Mais cette situation ne pouvait se prolonger. Adrien n’en portait plus le fardeau qu’avec impatience. Quand ce fardeau fut devenu trop lourd pour ses épaules, elle se dénoua.
Ce jour-là, Adrien se trouvait auprès de sa mère, à l’heure où il avait l’habitude de la voir. Il lui parlait de ses études qu’il essayait de continuer, en leur demandant l’oubli de ce qui le torturait. Nicolette écoutait son fils, cherchant avec persévérance à surprendre les causes du mal dont il souffrait. Ce mal, quelque effort qu’il fît pour le cacher, ses traits en gardaient la trace de plus en plus accentuée. En quelques semaines, il avait beaucoup maigri ; des rides creusaient son front ; une tristesse poignante s’était figée dans son regard. Des larmes qu’il essayait de retenir oppressaient sa poitrine, rougissaient ses yeux, communiquaient à tout son être une sensibilité maladive. Sa mère s’alarmait de cet état, dont elle fut frappée alors plus qu’elle ne l’avait été jusque-là. Elle trahit son inquiétude dans des questions réitérées auxquelles Adrien tenta d’abord de se soustraire. Mais ces questions devenaient pressantes, et comme il y résistait encore, un reproche, pour la première fois, tomba des lèvres de Nicolette.
— Tu as des secrets pour moi, dit-elle avec amertume ; ils me causent mille tourments. Ce sera ainsi tant que tu ne me les auras pas révélés. C’est mal de nier, quand la dénégation constitue un mensonge. Confie-toi à ta mère, mon enfant. A qui ouvriras-tu ton cœur, si ce n’est à elle ?
Ces supplications, cette fois, le trouvaient à bout de force. Mais il ne pouvait confesser sa liaison avec Laure Malestra, la honte qui l’accablait, son dessein d’en finir. Un fils respectueux n’avoue pas ces choses à sa mère. Il redoutait non les reproches de la sienne, mais les manifestations de sa douleur. Nicolette ne sut donc rien de cette douloureuse histoire. Il n’avait pas les mêmes raisons pour cacher son amour naissant ; il en fit l’aveu. Nicolette respira soulagée ; elle s’attendait à des révélations plus graves.
— Celle que tu aimes est-elle digne de toi ? demanda-t-elle.
— Plus digne de moi que je ne suis digne d’elle.
— Il faut lui faire partager tes sentiments et l’épouser.
— Elle n’est pas libre, objecta Adrien.
— Tu aimes une femme mariée ?
En poussant ce cri, avec un accent de surprise et d’effroi, la Carmélite s’était levée, pâle, l’indignation dans les yeux, les mains jointes.
— Non, ma mère, non, reprit son fils ; celle que j’aime et que j’eusse voulu pour femme n’est pas mariée… Elle est religieuse ; elle habite près de vous, dans ce couvent ; vous la connaissez bien. Elle se nomme Jeanne Mauroy.
— Sœur Nicette ! Comment peux-tu l’aimer à en être si triste ? tu la connais à peine.
— Je l’ai vue deux fois, ma mère, et en ces deux fois, assez longtemps pour être convaincu que c’est une telle compagne qu’il m’eût fallu.
Complétant son récit, il raconta comment il avait rencontré la novice, l’inoubliable souvenir que sa mémoire conservait d’elle, le faible espoir qu’il caressait depuis qu’il avait appris par sa mère que peut-être cette jeune fille quitterait le couvent. Ah ! si cet espoir se transformait en une certitude, il redeviendrait joyeux et heureux. Il tacherait de se faire aimer ; il y réussirait peut-être, et alors c’était de la félicité pour toute sa vie, car l’amour sincère et pur auquel il aspirait effacerait les souffrances du passé. Malheureusement, il n’osait espérer ; le doute le mettait au supplice ; et c’est ce supplice qui détruisait la santé de son corps et la sérénité de son âme.
Nicolette écoutait silencieusement, un peu dédaigneuse de cette passion tout humaine, où les sens avaient leur part, ne comprenant pas, elle, qui si souvent s’était immolée dans son cœur et dans sa chair, que son fils fût incapable de l’imiter, d’offrir à Dieu sa souffrance et de s’y résigner. Mais c’était son fils, et puisqu’elle le voyait malheureux, elle avait le devoir de lui venir en aide.
— Si tu m’as dit toute la vérité, mon enfant, fit-elle, je suis rassurée. Puisque, sans prévoir les conséquences de mes paroles, je t’ai révélé les scrupules de mademoiselle Mauroy, l’espoir que tu as conçu n’est pas coupable. A ton âge, on peut penser sans rougir à un honnête amour, tout en se tenant prêt à le sacrifier, si Dieu l’exige. Il ne nous a pas révélé ses desseins. Celle dont nous parlons ne se trouve pas encore assez éclairée pour prendre un parti.
— Mais vous qui vivez auprès d’elle et à qui elle a accordé sa confiance, ma mère, ne prévoyez-vous pas celui qu’elle prendra ?
Nicolette hésitait à répondre. Ce que lui demandait son fils, c’était le secret d’une autre. Avait-elle le droit de le révéler ? Mais tandis qu’elle interrogeait sa conscience, elle voyait le regard d’Adrien anxieusement fixé sur elle ; elle comprenait que de ce qu’elle allait répondre dépendait le repos de son enfant. D’un mot, elle pouvait l’apaiser, comme aussi le rejeter dans ses cruelles incertitudes. L’amour maternel lui arracha les paroles qu’elle n’osait prononcer.
— Je prévois que mademoiselle Mauroy ne persistera pas, et rentrera dans le monde, dit-elle.
— Et si cette prévision se réalise, ma mère, reprit Adrien dont l’angoisse se dissipait ; si je parviens à faire agréer mes sentiments, consentirez-vous à ce que j’épouse cette jeune fille ?
— Oui, j’y consentirai, et je bénirai le ciel qui t’aura poussé vers elle. Je ne connais pas une âme plus pure ni plus aimante. Épouse et mère, elle sera dévouée à son devoir, dévouée jusqu’à la mort, aussi bien que si elle fût restée dans le cloître.
— Alors, ma mère, priez afin que mes vœux soient exaucés, car je sens bien que mon bonheur est dans l’amour que Dieu m’a mis au cœur.
— Espère, mon fils ! espère ! murmura Nicolette remuée par ce cri. Elle le regardait s’éloigner, tremblante et toute troublée, et murmurait : — Serai-je coupable à vos yeux, Seigneur, si j’enlève à vos autels une angélique créature pour la donner à mon enfant ? Révélez-moi votre volonté, mon divin Maître. Vous m’avez pétrie pour l’obéissance ; faites qu’en vous obéissant, j’assure le bonheur de l’être que j’ai le plus aimé après vous.
Quelques semaines après son arrivée à Paris, Jeanne Mauroy, enfermée dans son cloître, se débattait contre le découragement et le doute. Tous ceux que la vie religieuse a tentés connaissent les amertumes de ces crises de conscience, soit que, les surmontant, ils aient persévéré dans leurs desseins, soit au contraire qu’éclairés par les épreuves du noviciat, ils aient renoncé à ce qui d’abord les avait séduits.
Jeanne était entrée au Carmel, convaincue que Dieu l’appelait. Les conseils affectueux de la prieure, la bienveillance des sœurs pendant la durée de son postulat, la paix infinie que l’on goûte dans une existence détachée du monde, avaient accru ses illusions. C’est de son plein gré qu’elle avait pris l’habit. Si quelqu’un lui eût dit à l’issue de la cérémonie que le noviciat n’aurait d’autre effet que de la ramener dans ce monde qu’elle venait d’abandonner, elle se serait révoltée. Elle voulait alors être à Dieu et n’être qu’à lui.
Tant qu’elle resta à Beaucaire, sa vocation ne fut pas ébranlée. Là, sous le ciel de son pays, dans le voisinage de sa famille, elle ne sentait pas encore le déchirement des séparations éternelles. L’autorité de la mère Thérèse de Jésus lui était douce. Le petit nombre des novices permettait des égards quasi maternels envers chacune d’elles. On mesurait à leur vigueur, à leur sensibilité, les austérités de la règle. On ne les initiait que lentement à la joie souvent mortelle de souffrir pour Jésus. Puis, dans ce couvent, Jeanne connaissait toutes les sœurs ; elle était pour elles comme une enfant gâtée, à qui l’on veut rendre facile l’apprentissage des dures privations.
Mais à Paris, ses illusions s’évanouirent en peu de temps. Entourée de visages étrangers, placée sous une autorité nouvelle, elle se trouva aux prises avec toutes les rigueurs de la vie monastique. Ces rigueurs, elle les croyait légères, quand elle les jugeait par ce qu’on lui en disait ; maintenant qu’elle les subissait, elle en était comme accablée. Tout ce qu’elle avait cru pouvoir supporter aisément choquait ses délicatesses, tout, depuis la chaussure qui déchirait ses pieds jusqu’au voile noir jeté sur son front, depuis le jeûne quotidien rigoureusement observé jusqu’à la couchette dont la paille durcie meurtrissait ses reins. Puis, c’était la serge grossière collée au corps et rarement changée, la discipline dont chaque religieuse se frappait, le vendredi, pour mortifier sa chair, en ce jour anniversaire de la Passion du Sauveur, la coulpe où chacune venait confesser à haute voix devant la communauté réunie les fautes commises contre la règle, les pénitences infligées par la prieure, les dénonciations des zélatrices, chargées de veiller sur les sœurs et de dévoiler leurs imperfections, les mortifications volontaires par où éclatait une mystique ardeur, brûlante et exaspérée.
Ces degrés qui conduisent l’âme à la perfection, elle désespérait de les gravir. Elle ne pouvait se résigner aux immolations perpétuelles qu’exige la règle. Elle aurait bien voulu être à Dieu, se consacrer à son service, mais sous des formes moins âpres et plus humaines. Le regret de ce qu’elle laissait au dehors éveillait en son cœur de fréquents et subits attendrissements que ni les avis de son confesseur ni les exhortations de la mère des novices ne pouvaient dissiper. Quand, dans le jardin du couvent, aux heures de récréation, ou dans le réfectoire, elle voyait quelques-unes des sœurs s’infliger une torture, demeurer à genoux, les bras tendus vers le ciel, s’humilier devant ses compagnes, leur baiser les pieds, refuser de partager leur repas et solliciter d’elles l’aumône d’un morceau de pain, Jeanne se demandait anxieusement si jamais elle saurait s’assujettir à ces pratiques d’une dévotion exaltée. La pensée qu’elle ne sortirait plus du couvent, qu’elle ne verrait plus ceux qu’elle aimait, ajoutait à son inquiétude. Elle interrogeait sa conscience. Dans le silence de ses nuits sans sommeil, elle lui disait :
— Suis-je faite pour ces mœurs d’ascète ?
Sa conscience ne répondait pas, et son imagination, brusquement allumée, enfantait des rêves dans lesquels elle voyait ce que serait sa vie, si elle persistait à rester dans le cloître. Cet avenir tout à coup évoqué la terrifiait, tandis que des visions fiévreuses ouvraient à ses yeux le monde abandonné par elle, lui en montraient le charme et les séductions. Sa jeunesse lui disait que prier n’est pas l’unique destinée de la femme, que le mariage est également une fin ordonnée par le Maître des choses, que la chasteté n’est pas le seul moyen de sanctifier l’âme, que la maternité est aussi un devoir. Des tentations étranges, inexpliquées, troublaient son chaste esprit, répandaient dans son corps un frisson. L’image d’un mari montait devant ses yeux. Ce mari avait la physionomie et les traits d’Adrien de Varimpré, le seul homme qu’elle eût rencontré depuis qu’elle était au couvent.
Chaque matin la trouvait plus découragée, plus anxieuse. D’où naissaient les troubles de son esprit ? Était-ce le démon qui les déchaînait ? Était-ce sa jeunesse qui se révoltait et revendiquait sa liberté ? Elle ne savait. A la chapelle, durant les longues oraisons ; dans sa cellule, aux heures des méditations pieuses, les tentations la poursuivaient, lui rendaient plus intolérable la réalité. La sévérité dont elle était l’objet, et qui ne se lassait jamais, devenait un supplice. Elle la trouvait partout, toujours debout, toujours exigeante, acharnée à humilier l’orgueil, à mater la chair, à paralyser la volonté, à châtier jusqu’aux goûts les plus innocents.
Il suffisait, par exemple, qu’elle manifestât de l’attachement aux personnes et aux choses, pour s’en voir aussitôt séparée et privée. Un jour, peu après son arrivée à Paris, elle avait parlé avec chaleur de sa filiale tendresse pour la mère Thérèse de Jésus. Dès le lendemain, celle-ci, docile à des ordres supérieurs, affectait de la fuir. Une autre fois, elle avait commis l’imprudence de dire tout haut, avec satisfaction, que sa cellule ouverte sur le jardin recevait, dès l’aube, les premiers rayons du soleil, et le soir, elle apprenait brusquement que désormais elle en habiterait une autre où le soleil n’entrait jamais.
Ces privations n’étaient pas nouvelles dans l’Ordre ; on ne les inventait pas pour la novice. C’est la loi commune ; mais elle ne pouvait s’y résigner. Une sourde rébellion grondait dans son cerveau, éteignait sa ferveur, la disposait à railler les traits par où se trahissait l’exaltation de ses compagnes. Vainement, elle voulait se repentir de ces manquements au devoir ; vainement, elle s’en accusait. Sa raison lui répétait qu’elle n’était pas coupable.
Dès ce moment, il lui semblait que l’épreuve était complète et décisive, qu’il serait inutile de la prolonger, qu’il ne lui restait qu’à reconnaître son erreur, qu’à quitter cette maison où elle ne pouvait trouver le bonheur. Mais une fausse honte, la peur de rentrer dans le monde, d’y devenir l’objet des railleries de ceux qui la connaissaient, la retenait, bien qu’elle eût compris déjà qu’elle ne pouvait rester.
Des craintes analogues l’empêchaient de confier à la prieure ou à la mère des novices l’état de son âme. Dans ses angoisses devinées ou surprises, celles-ci ne voyaient rien qui différât de ce qu’elles étaient accoutumées à voir dans les jeunes filles confiées à leur vigilance. Chez toute novice, il y a les mêmes doutes et les mêmes anxiétés. Presque toujours, les vœux seuls y mettent fin. Les supérieures de sœur Nicette de la Croix pensaient qu’il en serait d’elle comme des autres, que ses inquiétudes s’apaiseraient à l’heure où un engagement définitif se substituerait à l’engagement provisoire. Elles se trompaient.
Leur erreur venait du silence gardé envers elles. Si Jeanne eût parlé, elles auraient compris et renvoyé au monde cette enfant victime d’une ferveur passagère. La règle des ordres religieux à cet égard est absolue. Elle ordonne non de séduire les novices pour les retenir, en atténuant à leurs yeux l’étendue du sacrifice qu’on leur demande, mais de leur montrer, au risque même de les décourager, la vie monastique dans toute son austère réalité. Elle ordonne aussi de n’accepter leurs vœux que lorsqu’il ne peut plus exister de doute sur la sincérité de leur vocation. Aucun symptôme apparent n’indiquait que cette sincérité fît défaut à la vocation de Jeanne. Du côté de ses supérieures, elle ne trouvait donc ni secours ni lumière.
Il n’était qu’une femme à qui elle aurait osé tout dire : la mère Thérèse de Jésus. Celle-là, c’était l’amie, la confidente des premiers jours. Elle avait encouragé les aspirations naissantes, conseillé, soutenu, éclairé cette âme virginale qui cherchait sa voie. Elle en connaissait la pureté, la docilité, le charme. Elle l’avait toujours aimée, autant aimée que le lui permettait la règle inexorable qui défend aux Carmélites de donner à leurs compagnes une trop grande part de leur cœur, où Dieu seul doit régner. Elle l’aimait plus encore depuis que les aveux de son fils lui avaient révélé l’inoubliable impression produite sur lui par l’angélique visage de la novice. Il lui était doux de se dire que cette enfant de laquelle la loi monastique l’obligeait à détourner sa maternelle tendresse ne resterait pas dans le cloître. Elle priait pour que Dieu la rendît au monde et fît d’elle la femme d’Adrien. Elle aurait pu lui tendre la main, la tirer de la tourmente, lui montrer la route droite. Mais loin d’encourager ses confidences, elle était tenue de s’y dérober, la mère des novices ayant blâmé l’attachement passionné de sœur Nicette de la Croix pour son ancienne prieure.
Il restait, il est vrai, à la jeune religieuse son confesseur. Un saint, ce vieux prêtre ; mais un humble, un timide, qui reculait devant la nécessité de conseiller un parti décisif, et peu habile à discerner la réalité des scrupules dont il recevait la confession. Il prêchait la résignation, la patience. Il voulait que sœur Nicette de la Croix poursuivît l’épreuve commencée, au moins jusqu’à la fin de son noviciat.
Elle ne résistait pas, se montrait docile à ces ordres qu’on lui représentait comme les ordres de Dieu. Elle persévérait dans la dure tâche, imprudemment assumée ; mais elle n’y persévérait qu’au prix d’un violent effort, véritable martyre qui altérait sa santé, effaçait les roses couleurs de son teint, flétrissait sa jeunesse et torturait son âme.
Un matin, elle descendit au jardin, comme de coutume, à l’heure de la récréation, si pâle et si triste que la mère Thérèse de Jésus, qui depuis longtemps soupçonnait sa détresse, n’en douta plus. Ce que Jeanne n’osait s’avouer à elle-même, Nicolette le comprit clairement en observant la physionomie désolée, les traits amaigris de cette enfant candide et pure. Elle alla vers elle, avec la sollicitude empressée d’une mère, au mépris des avertissements qu’elle avait reçus.
— Marchez avec moi, mon enfant, lui dit-elle. Je vous sens malheureuse. Pourquoi l’êtes-vous ? N’hésitez pas à m’ouvrir votre cœur.
— Dieu m’éprouve, ma mère, répondit Jeanne, en réglant son pas sur celui de Nicolette. Voilà longtemps que je voulais vous en avertir, vous demander conseil. Mais vous restiez éloignée de moi, et j’ai dû me taire. Votre indifférence a aggravé mon mal.
— Cette indifférence n’est qu’apparente. On me l’a ordonnée ; j’ai dû obéir.
— Étais-je donc coupable, ma mère, en manifestant mon aveugle confiance en vous ?
— Dieu exige qu’on n’ait une telle confiance qu’en lui.
— Alors, pourquoi la trompe-t-il ?
— Oh ! ma sœur, ne jugez pas ses desseins. Soumettez-vous à ce qu’il exige.
— Ce qu’il exige ! Mais qu’il me le révèle alors ! S’il entend que je reste à son service, pourquoi me refuse-t-il l’énergie dont j’aurais besoin pour surmonter les tentations qui m’assaillent ? S’il veut au contraire que je quitte cette sainte maison, que ne manifeste-t-il sa volonté ? Je suis toute prête à lui obéir. Mais encore dois-je savoir ce qu’il veut de moi. Je le lui demande, avec ferveur, avec des larmes, dans l’effusion d’une âme qui le cherche, et plus je le sollicite, plus il semble se dérober. Vous, ma mère, allez-vous me répondre ?
Bouleversée par ces accents, Nicolette se taisait. Elle le connaissait pourtant, le mal dont souffrait Jeanne Mauroy : c’était la cruelle incertitude des vocations fragiles, compagne inévitable du noviciat, qui exerce son empire sur ces pauvres cœurs troublés par l’excès même de leur dévotion et les oblige à se demander s’ils ne se sont pas trompés en choisissant la vie religieuse. Peut-être aurait-il suffi qu’elle parlât pour verser dans l’âme de Jeanne l’apaisement, pour lui montrer dans le supplice qu’elle subissait le chemin du ciel et pour l’attacher à jamais à Dieu, en lui décrivant les douceurs du cloître. Mais le langage qu’il eût fallu tenir, elle ne le tenait pas. Elle bénissait les larmes qu’elle voyait couler ; elle songeait à son fils, et c’est pour lui qu’elle voulait délivrer Jeanne de ses chaînes.
— Qu’éprouvez-vous donc ? demanda-t-elle tout à coup. Je dois le savoir, si vous voulez que je vous éclaire.
Alors Jeanne raconta ses souffrances, ses craintes, ses tentations, tout ce qui choquait ses instincts et blessait sa raison. Elle ne dissimula pas ses répugnances pour les austérités de la règle. Trop lourd à ses épaules cet habit de serge, trop acérées les lanières de cuir qui sillonnent de rougeurs la peau délicate, trop grossière la nourriture quotidienne, révoltantes enfin ces mortifications volontaires et ces pénitences imposées, dont elle était témoin chaque jour. La mère Thérèse de Jésus l’écoutait en silence, heureuse de ce qu’elle entendait et qui de toute autre l’eût affligée ; puis brusquement, elle dit :
— Nous nous sommes trompés ; vous n’avez pas la vocation, mon enfant ; tout le démontre, il faut sortir d’ici. Retournez au monde. Vous y ferez votre salut, si vous voulez vous souvenir de ce que vous avez vu et entendu au Carmel.
— Est-ce vous, ma mère, qui me conseillez d’en sortir ? demanda Jeanne, toute troublée à la pensée de changer d’existence.
— C’est moi qui vous le conseille, et c’est le chapitre qui vous l’ordonnera, quand j’aurai répété à nos sœurs ce que je viens d’entendre. Vous n’êtes pas faite pour nous, ma chère fille.
— Mais si je sors, comment me recevra le monde ?
— Avec bienveillance. Un acte sincère et désintéressé est toujours respectable.
— Que ferai-je une fois hors du Carmel ?
— Vous vous marierez !
— Oh ! pour cela, non ; jamais.
— Gardez-vous de le dire. Savez-vous si vous n’êtes pas destinée à servir d’exemple à ceux qui contractent mariage ? Du reste, quand vous aurez reconquis votre liberté, rien ne vous pressera de prendre un grand parti ; vous observerez jusqu’à ce que Dieu vous ait montré le chemin où il veut que vous vous engagiez. Écrivez à votre tuteur. Demandez-lui de venir vous chercher. Puis, apprêtez-vous à abandonner cette maison. Quittez-la résolument, le front haut, sans crainte. Vous vous étiez trompée en y entrant ; vous réparez votre erreur ; rien de plus honorable ni de plus légitime.
Jeanne écoutait silencieuse et les yeux baissés. Soudain, elle releva la tête en murmurant :
— Je suivrai vos avis, ma mère, et je partirai convaincue qu’en agissant ainsi, je ne fais rien que puisse blâmer ma conscience. Hélas ! pouvais-je prévoir que je prendrais un jour ce parti si peu conforme à ce que j’avais espéré ?
— Vous n’en pouvez prendre d’autre, insista Nicolette.
Son regard trahissait la joie que lui causait la résolution de Jeanne. Elle songeait déjà aux moyens de la rapprocher de son fils et de la retenir assez longtemps à Paris pour qu’Adrien eût le loisir d’apprendre ce qu’était et ce que valait cette jeune fille.
— Je partirais sans regrets, ma mère, ajouta Jeanne Mauroy, oui, sans regrets, si je ne vous laissais derrière moi. Oh ! plus d’une fois, en pensant à ma mère spirituelle, je verserai des larmes.
— Peut-être vous trompez-vous, mon enfant. Peut-être aussi est-ce à l’heure où vous gémissez sur notre séparation qu’à votre insu, Dieu prépare des événements qui créeront entre vous et moi un lien durable et fort.
Jeanne regarda la mère Thérèse de Jésus en l’interrogeant des yeux, car elle ne comprenait pas ces énigmatiques paroles. La mère n’en dit pas plus long et demeura impénétrable. Mais dans le fond de l’âme, elle se réjouissait. Il lui semblait qu’en enlevant cette âme au Carmel, elle venait de jeter les fondements du bonheur de son fils.
Elle n’en aurait pas douté si elle avait connu les causes et l’étendue du mal dont souffrait Adrien. C’était un supplice intolérable que chaque jour rendait plus aigu, car de plus en plus l’influence de Laure Malestra pesait sur ce cœur malade, qui n’osait s’y soustraire, bien qu’il eût cessé d’aimer. Sa loyauté habilement exploitée par Laure le fixait à sa chaîne, en lui rappelant les engagements pris par lui, lorsque, dans une heure de faiblesse et d’erreur, il avait associé cette femme à sa vie.
La misérable créature comprenait bien que les témoignages de sa tendresse feinte devenaient odieux à son amant. Mais plus elle en recueillait de preuves, et plus elle s’attachait à sa victime, poussée non par l’amour, mais par les féroces et vils calculs dont Jacques Roudier s’était fait l’inspirateur et le complice. Elle exerçait tous les droits d’une maîtresse impérieuse et jalouse, et ne les exerçait que pour être payée d’un plus haut prix, le jour où elle y renoncerait.
Ce fut pour Adrien une suite de jours remplis d’amertume, durant lesquels il connut les orages des passions malsaines, scènes de violence où se révélait dans les reproches mutuels l’impossibilité de vivre en commun, et que dénouaient des réconciliations dépourvues de sincérité, auxquelles les sens seuls avaient part, et qui laissaient les cœurs excités l’un contre l’autre. Il sortait de ces querelles honteux, brisé, avec le sentiment de sa dégradation. Il voulait rompre, et demeurait, n’ayant même plus l’énergie de l’effort qu’il eût fallu faire pour se délivrer. Ah ! Laure le connaissait bien. A tout instant, elle lui rappelait qu’il était allé à elle le premier, et que si elle avait succombé, c’est qu’il parlait d’amour éternel. Elle lui reprochait ses visites à sa mère, elle l’accusait de puiser là le dégoût de l’amour.
— Tu as cessé de m’aimer le jour où ta mère est arrivée, disait-elle ; c’est ta mère qui t’entraîne loin de moi.
— Elle ne te connaît pas, répondait-il pour sa défense.
— Tu l’affirmes ; mais est-ce vrai ? J’ai mesuré l’étendue de ta faiblesse, et peut-être me caches-tu que tu lui as tout avoué et qu’elle veut me disputer ton cœur.
Il protestait ; mais Laure se retranchait dans son argumentation ; elle affectait de ne tolérer qu’avec impatience les relations de la mère et du fils ; elle attribuait à ces relations les troubles quotidiens dont il était seul à souffrir, puisque c’est elle qui les provoquait pour amener son amant à la rupture qu’elle souhaitait, sans vouloir en prendre l’initiative. Ces luttes sourdes incessamment recommençaient. Que n’eût-elle pas dit, si elle avait su qu’en même temps qu’il cessait de l’aimer, son amant commençait à aimer la novice ! Mais cette affection naissante était le secret d’Adrien, son unique consolation, la meilleure part de sa vie. Il s’enfermait dans son espérance ; il y puisait la force de supporter les épreuves dont il appelait la fin. Au parloir des Carmélites seulement, il trouvait la paix intérieure qui partout ailleurs lui faisait défaut. S’il la trouvait dans cet asile, où chaque matin le ramenait l’habitude, c’est que là tout lui parlait de Jeanne Mauroy, c’est qu’il s’y sentait rapproché d’elle, encore qu’il ne pût la voir et n’osât prononcer son nom.
Cependant, la santé d’Adrien s’altérait. Nicolette le constatait avec inquiétude. Elle s’apercevait du dépérissement de son fils sans en connaître les causes, et ne songeait qu’au moyen d’en arrêter les progrès. Ce moyen consistait à son avis dans un amour partagé. Cette conviction l’avait déterminée à entreprendre de décider Jeanne à abandonner la vie religieuse, et son entreprise menée à bonne fin, elle commençait à croire que son fils allait être heureux.
Le soir de ce jour, après avoir averti la prieure des résolutions de Jeanne Mauroy, elle les fit connaître à la communauté réunie pour la coulpe, quand les novices et les converses se furent retirées, et que les professes se trouvèrent seules. Elle déclara qu’en sa qualité d’ancienne prieure du Carmel de Beaucaire et de première confidente de sœur Nicette de la Croix, elle avait considéré comme un devoir de provoquer ces résolutions. Autorisée à la conduire à Paris, quand elle-même avait obtenu la faveur de s’y fixer, elle connaissait mieux que personne l’âme de cette jeune fille ; elle en restait responsable devant Dieu.
Si grandes étaient dans l’Ordre la réputation de prudence et l’autorité de la mère Thérèse de Jésus qu’aucune de ses sœurs ne songea à blâmer sa conduite. Dès ce moment, Jeanne Mauroy devenait libre. Après s’être dépouillée de l’habit de l’Ordre, elle ne devait rester dans la communauté qu’à titre provisoire, comme pensionnaire, parmi les postulantes, en attendant que sa famille vînt la chercher.
Jamais les heures n’avaient paru plus longues à la mère Thérèse de Jésus. C’est en vain qu’à tout instant, elle s’attendait à être appelée au parloir. Le temps passait, et pour la première fois, la matinée allait s’achever sans qu’elle eût vu son fils.
La veille, elle lui avait annoncé les résolutions de Jeanne Mauroy, elle lui avait promis de disposer la jeune fille à l’accueillir et à l’écouter, dès que son tuteur serait arrivé. Adrien s’était retiré en manifestant à sa mère le bonheur que lui causait cette nouvelle, et en annonçant pour le lendemain sa visite accoutumée. Et voilà que malgré sa promesse, il ne venait pas. Nicolette ne savait que penser de ce manquement à une douce habitude ; elle en était bouleversée. Le cœur des mères est prompt à s’alarmer. Une sensibilité maladive remplissait le sien, la disposait à trembler sans cesse sur son bonheur qu’elle ne semblait avoir ressaisi que pour souffrir de ne pas le goûter pleinement, obligée qu’elle était de le sacrifier sans cesse aux devoirs de son état. Elle voyait déjà son fils malade ou victime d’un accident, mort peut-être. Une sueur glacée baignait son front, et l’angoisse étreignait son cœur.
A midi, la cloche appela les religieuses au réfectoire. La mère Thérèse de Jésus se rendit à cet appel. Mais l’inquiétude lui ôtait l’appétit. Avec l’autorisation de la prieure, elle alla s’agenouiller au milieu de la salle, demandant humblement à ses sœurs de prier Dieu pour une âme en proie à une grande affliction. Cette âme, c’était la sienne, malade et toute meurtrie par l’absence d’Adrien.
Ah ! comme en ce moment la règle lui paraissait cruelle ! Quoi ! peut-être son fils sollicitait son secours, avait besoin de sa tendresse, et elle était retenue loin de lui ? Une mère emprisonnée ainsi, quand ce qu’elle aime souffre et l’appelle ! Et s’il allait mourir, serait-elle condamnée à le laisser expirer sans le revoir ? C’était un commencement de révolte que ces questions se succédant dans sa tête en feu. Malgré tout, elle se sentait mère. Longtemps annihilée dans la collectivité de l’Ordre, sa personnalité se dégageait et s’affirmait sous l’empire de ses anxiétés. Sa volonté renaissait après une longue abdication. Elle se demandait ce qu’elle ferait si tout à coup on venait lui apprendre que son fils avait besoin d’elle. Elle n’hésitait pas, elle était prête à sortir ; mentalement, elle désobéissait à la règle pour obéir au cri de son âme. Avant d’être la sœur Thérèse de Jésus, elle était Nicolette de Varimpré. C’est de cela surtout qu’elle se souvenait, et elle énumérait dans sa pensée les devoirs qui s’imposaient à elle à ce titre.
Cependant, cette rébellion involontaire brusquement lui fit peur. Pour une religieuse accoutumée à scruter sa conscience vingt fois par jour, à considérer comme un péché la plus légère infraction à la règle et à s’en accuser publiquement, c’était une faute grave que ce désir soudainement conçu de franchir le seuil du couvent et de savoir ce qui se passait au dehors. Effrayée de son audace, elle se prosterna, les yeux remplis de larmes, et demeura ainsi dans une attitude de pénitence expiatoire. Mais presque aussitôt le souvenir de son fils lui revint, lui fit comprendre la légitimité de sa fiévreuse impatience, et lui rendit quelque énergie.
Jeanne Mauroy, de la place où elle prenait son repas parmi les postulantes, voyait son ancienne prieure s’humilier et pleurer. Attristée déjà en pensant qu’elle allait pour toujours se séparer d’elle, Jeanne s’affligeait encore d’une douleur dont elle devinait la violence, sans en connaître les motifs. En quittant l’habit des Carmélites, elle avait reconquis la liberté de céder aux entraînements de son cœur. Lorsque les religieuses sortirent de table pour se rendre au jardin, elle se rapprocha de la mère Thérèse de Jésus, et lui dit craintive :
— Je souffre de vous savoir malheureuse, ma mère ; ne puis-je rien pour soulager votre peine ?
— Non, ma pauvre enfant, non, vous ne pouvez rien ; je suis dans l’angoisse parce que je n’ai pas vu mon fils ce matin, bien qu’il ait coutume de venir tous les jours et qu’il m’ait promis hier de venir aujourd’hui.
— Mais il peut venir encore, ma mère.
— Je pressens une catastrophe.
Comme elle prononçait ces mots, la sœur tourière entrait dans le jardin, une lettre à la main. Elle s’avança vers la prieure, s’agenouilla et lui remit la lettre. La prieure la lui rendit aussitôt sans l’ouvrir, après avoir jeté les yeux sur l’adresse et en lui désignant la mère Thérèse de Jésus.
— C’est pour moi ! s’écria celle-ci.
Elle se précipita au-devant de la tourière ; d’un geste rapide, elle lui enleva le pli dont elle déchira vivement l’enveloppe. Elle dévora d’un regard les quelques lignes tracées sur la page blanche. Son fils lui écrivait pour expliquer son absence. Une légère indisposition le retenait chez lui et l’empêchait de venir voir sa mère. Mais il s’annonçait pour le lendemain, convaincu, disait-il, que cette indisposition ne durerait pas.
Nicolette soupira longuement. Un doux et triste sourire éclaira son regard.
— Avez-vous lieu d’être rassurée, ma mère ? demanda Jeanne timidement.
— Rassurée ! s’écria Nicolette ; je ne saurais l’être avant d’avoir vu mon fils. Il est souffrant, il me l’écrit, sa lettre ne manifeste aucune inquiétude ; mais qui sait s’il ne me cache pas la vérité ? Ah ! mon enfant, soupira-t-elle, combien je vous envie votre liberté…
Elle allait continuer, quand, se détachant d’un groupe de religieuses parmi lesquelles elle causait en riant, la prieure se dirigea de son côté. Discrètement, Jeanne s’éloigna. Les deux mères restèrent en présence.
— Vous venez de manifester une impatience qui n’est d’un bon exemple pour personne, ma sœur, dit la prieure d’un accent sous lequel se dissimulait mal un reproche.
Nicolette était tombée à genoux. Un geste de la prieure la releva. Debout, les bras croisés sous son scapulaire, les yeux baissés, elle répondit :
— C’est vrai, ma mère ; mais peut-être ai-je une excuse. Depuis hier, j’étais sans nouvelles de mon fils.
— Il est fâcheux que vos préoccupations maternelles troublent à ce point votre vie. A diverses reprises déjà, je me suis aperçue des distractions et des vivacités qu’elles vous causent.
La mère Thérèse de Jésus ne put contenir un mouvement de surprise et d’impatience. Mais il fut aussitôt réprimé. Elle baissa la tête, en murmurant, résignée :
— Si j’ai péché, ma mère, punissez-moi.
— Rentrez dans votre cellule, continua la prieure, et priez pour que Dieu vous rende docile à sa sainte volonté.
La religieuse admonestée s’inclina, et, traversant le jardin où ses sœurs marchaient pour réchauffer leurs membres engourdis par le froid, elle disparut, sans qu’aucune d’elles se permît une réflexion sur l’incident. Jeanne l’accompagna des yeux, impressionnée par ce qu’elle venait de voir et d’entendre.
En arrivant dans sa cellule sans feu, toute glacée des rigueurs de l’hiver, Nicolette s’agenouilla pour prier, conformément à l’ordre qu’elle venait de recevoir. Mais, hélas ! ce n’étaient pas des prières qui de son cœur troublé montaient à ses lèvres blêmies. En dépit de ses efforts, sa pensée l’entraînait loin du calme asile où elle avait juré de vivre toujours.
Le supplice dont elle souffrait, jamais, avant elle, aucune Carmélite ne l’avait enduré. Nulle ne s’était trouvée dans cette extrême détresse, placée entre un devoir rigoureux et les angoisses légitimes de l’amour maternel. Quelque sincère qu’eût été la vocation qui l’avait conduite au couvent, elle regrettait à cette heure d’avoir cédé aux entraînements de sa ferveur. Hélas ! quand, obéissant à la voix impérieuse qui lui parlait, elle s’était consacrée à Dieu, pouvait-elle prévoir qu’un jour son fils lui serait rendu et aurait besoin de sa sollicitude ? Elle avait alors tout prévu, sauf ce qui arrivait. Elle se trouvait maintenant en présence de devoirs nouveaux. Que devait-elle faire ?
La règle des Carmélites est rigoureuse. Elle ne permet pas les sorties accidentelles. Sous aucun prétexte, quelque sacré qu’il puisse être, les religieuses ne peuvent être autorisées à s’éloigner de leur cloître. Elles y sont comme dans une prison, enchaînées par les vœux prononcés. S’il arrive que quelque circonstance grave les appelle dans leur famille, elles n’ont d’autre ressource que de solliciter de l’autorité ecclésiastique, souverainement juge de l’opportunité de leur demande, la faveur d’être relevées de ces vœux solennels. On a vu quelquefois des religieuses cloîtrées abandonner, à la suite d’événements inattendus, le couvent pour n’y plus rentrer. On n’en a jamais vu s’en éloigner pour y revenir. Si donc elle voulait aller au secours de son fils, elle devait changer de vie, retourner au monde, après avoir obtenu l’agrément de ses supérieurs spirituels. Et encore, pour en arriver là, fallait-il du temps, des démarches, une enquête, des formalités minutieuses, trop longues au gré de son impatience.
La gravité des résolutions à prendre l’épouvantait. Depuis qu’elle avait retrouvé son fils, elle souffrait de ne pouvoir vivre à ses côtés, d’être retenue loin de lui. Mais elle s’était résignée, convaincue que le bonheur de le voir tous les jours lui donnerait le courage. Malheureusement, il suffisait qu’il eût manqué une fois à leur rendez-vous quotidien pour lui enlever l’énergie. Elle relisait sa lettre ; elle en interrogeait chaque ligne, et telle était l’exaltation de son esprit qu’elle se figurait que la mort s’installait au chevet d’Adrien.
Hors d’état de prendre un parti, elle resta jusqu’au soir accablée par la peur. Elle traîna derrière soi ses préoccupations, à la coulpe, dans la salle capitulaire, à la chapelle, sans pouvoir recouvrer la sérénité d’âme indispensable à la méditation et à la prière. Et cependant, elle voulait prier, et lorsque son pauvre corps las et meurtri fléchissait sous le poids de sa fatigue, elle se suspendait aux grilles du chœur pour se tenir éveillée. Enfin, quand elle étendit sur son dur matelas de paille ses membres exténués, elle ne parvint pas à trouver le sommeil, poursuivie toujours par une mortelle inquiétude et tiraillée entre les partis contraires que lui suggérait son imagination affolée.
Vers le matin, cependant, sa fièvre s’apaisa. La nuit écoulée la rapprochait du moment où elle espérait voir son fils. Elle assista aux offices, distraite, impatiente. Après la messe, elle attendit anxieuse. Mais, comme la veille, le temps passa sans qu’elle fût appelée au parloir. Elle espérait au moins une lettre. Elle ne la reçut pas. Alors ses craintes s’aggravèrent. Le silence d’Adrien rendait plus pénible son absence. Elle le devinait couché, pâle et malade, livré à des soins mercenaires, appelant sa mère, et peut-être expirant sans l’avoir revue. C’en était trop pour ses forces épuisées par l’insomnie. Elle alla trouver la prieure, lui fit part de son malheur, et tout en larmes, lui demanda conseil. Pour la rassurer, la prieure promit de faire prendre des nouvelles d’Adrien. Une postulante converse reçut l’ordre de se transporter chez lui et de s’enquérir de la vérité. En attendant son retour, Nicolette resta dans la chapelle, le front sur les dalles froides, suppliant Dieu de lui rendre son fils. C’est là que la tourière lui rapporta la réponse. Depuis deux jours, Adrien était alité, en proie à la fièvre, sans que le médecin qui lui donnait des soins eût pu préciser la nature du mal. La tourière tenait ces détails d’un ami du malade, installé chez lui, et qui n’avait pas voulu permettre qu’elle lui parlât.
Ces renseignements, loin de calmer les angoisses de Nicolette, achevèrent de la troubler. Sûrement, on lui cachait la vérité. Son enfant était plus mal qu’on ne le lui disait. Son visage exprimait une douleur si violente, que la prieure, prise de compassion, lui prodigua les plus vifs témoignages de la fraternelle affection qui unit les religieuses entre elles. Elle essaya de la consoler. Mais la mère ne voulait rien entendre. Son regard fixé devant elle semblait percer les murailles, et franchir la distance qui la séparait de son fils. Il s’agissait bien vraiment, comme on le lui conseillait, d’offrir cette torture au Sauveur, en expiation des péchés de l’humanité ! La foi de la Carmélite n’était plus assez ardente pour que ce langage pût l’apaiser. Elle écoutait, et n’entendait rien, en proie à la préoccupation qui de plus en plus l’étreignait. Pour dérober le spectacle de ses larmes à la communauté, la prieure l’engagea à rentrer dans sa cellule.
— Est-ce un ordre, ma mère, ou un conseil ? demanda-t-elle, la fièvre aux yeux et dans la voix.
— Un ordre, répliqua sévèrement la prieure, choquée par le ton de cette question.
— J’obéis, alors, oui, j’obéis… Et plus bas elle ajouta : — Pour la dernière fois.
Elle s’éloignait, cédant à des résolutions spontanées, la tête haute et d’un pas pressé. Son absence dura peu. Quelques instants après, au moment où la lumière du jour déclinait, elle reparaissait devant la prieure, mais transformée. Elle ne portait plus l’habit du Carmel. Elle l’avait quitté pour se vêtir de la pauvre robe noire et du manteau sous lesquels, quelques semaines avant, elle avait fait le voyage de Beaucaire à Paris.
— Que signifie ce costume ? demanda la prieure stupéfaite.
— Il signifie, ma mère, que mon fils m’appelle et que je vais à lui.
— Vous voulez sortir du cloître !
— J’en veux sortir.
— Vous savez qu’une fois hors de la maison, vous n’y pourrez plus rentrer.
— Je n’y rentrerai pas.
— Si c’est votre liberté que vous voulez reprendre, vous ne le pouvez faire qu’avec l’autorisation de vos supérieurs ecclésiastiques. Seuls, ils peuvent vous relever de vos vœux.
— Ils m’en relèveront.
— Sans doute ; mais vous devez attendre ici leur décision.
— Attendre ! quand mon fils, peut-être, meurt faute de mes soins.
La prieure n’en revenait pas. Quoi, révoltée, cette sœur Thérèse de Jésus, une des lumières de l’Ordre, cette religieuse modèle dont on rappelait sans cesse aux novices le nom et les vertus ! C’était à n’y pas croire. Il fallait que l’esprit de Dieu se fût retiré d’elle et l’eût abandonnée au démon.
— Ma sœur, supplia la prieure, revenez à vous. Songez aux suites du scandale que causera votre départ ; songez surtout à la responsabilité qui va peser sur votre âme, si vous abandonnez cette maison malgré moi. Vous aurez à rendre compte, un jour, de votre désobéissance, et ce sera terrible.
— Je suis mère, et Dieu me comprendra, objecta froidement Nicolette.
— Vous avez fait le serment de demeurer à son service.
— Je ne savais pas alors qu’il me rendrait mon fils. Pourquoi me l’a-t-il rendu, si ce n’était pour me rappeler que la maternité crée aussi des devoirs sacrés ? Il est clément, il est miséricordieux, et sa bonté ne me fera pas défaut.
— Sœur Thérèse de Jésus, insista la prieure, je vous ordonne de rentrer dans votre cellule, de reprendre l’habit que vous n’aviez pas le droit de quitter, et d’attendre parmi nous les décisions que je vais provoquer. Je vous l’ordonne, et vous adjure de ne pas enfreindre mes ordres.
— Ce que vous me demandez, ma mère, est impossible. Ah ! si vous aviez un fils, vous ne me parleriez pas ainsi que vous le faites. Mais, hélas ! vous ne pouvez me comprendre ; votre cœur n’a jamais éprouvé ce qu’éprouve le mien en ce moment. Aucune volonté, entendez-le, aucune n’est assez puissante pour me retenir ici malgré moi.
— Aucune volonté, dites-vous ! Mais le souci de votre salut !
— Il est moins exigeant que le souci du salut ce mon fils !
— Encore une fois, je vous supplie, obéissez à votre prieure, sœur Thérèse de Jésus.
— Je ne peux obéir, ma mère.
— Mais l’enfer, malheureuse, l’enfer !
— Il ne me fait pas peur. Non ! Je ne crains pas d’être châtiée pour avoir refusé de fermer l’oreille aux appels de mon enfant. Si je me trompe, j’aime mieux encore être damnée pour toute l’éternité que d’abandonner le cher être qui me tend les bras. La prieure, à ces mots, baissa la tête, et toute gémissante, fit le signe de la croix. En les entendant, elle venait de comprendre qu’elle ne parviendrait pas à briser la rébellion de la mère Thérèse de Jésus. Il n’y avait qu’à se résigner et à prier Dieu de pardonner l’offense commise contre son nom. La révoltée ajouta : — Ce soir, je cours où le devoir m’appelle ; demain, j’écrirai à mes supérieurs pour expliquer ma conduite, prête à me soumettre à ce qu’ils décideront, soit qu’ils exigent que le Carmel me reste à jamais fermé, soit qu’ils me permettent d’y rentrer, quand mon fils n’aura plus besoin de mon amour et de mon dévouement. Adieu, ma mère !
La nuit était venue. Après s’être inclinée devant la prieure pétrifiée, Nicolette s’éloignait par les corridors, où des quinquets répandaient une lueur tremblante et pâle. Sur son passage, des ombres silencieuses se rangeaient en allongeant sur les murs blancs leur silhouette noire, et se garaient de la fugitive comme d’une pestiférée. Quand elle arriva au bas de l’escalier, elle se trouva seule sur le seuil de la chapelle entr’ouverte. A la vue du chœur silencieux, sombre et froid, elle s’arrêta haletante, comme si les souvenirs qu’elle retrouvait à cette place fussent redevenus tout à coup assez puissants pour la retenir. Les battements de son cœur se précipitèrent. Dans le silence, elle entendit alors, venant du premier étage, la rumeur confuse et faible des gémissements provoqués par sa révolte. Le froid de la mort glaça son cœur. Elle chancela défaillante. Encore une minute, et c’en était fait de son énergie. Le passé allait la reprendre, l’envelopper de nouveau dans les exigences de la règle, et son fils l’appellerait en vain. La peur de ne pas le revoir si elle n’allait à lui la redressa. Elle se remit en marche. Comme elle arrivait à la grille de clôture, une voix faible l’appela. Elle se retourna. La voix reprit, légère comme un souffle :
— Puisque vous partez, ma mère, emmenez-moi.
— Ah ! chère enfant ! soupira-t-elle en pressant Jeanne sur son cœur, vous emmener ! Je le voudrais. Mais votre famille compte vous retrouver ici ; elle me blâmerait peut-être de vous avoir associée au scandale que va causer mon départ ; je ne peux pas, je ne dois pas vous emmener. Mais lorsque vous serez hors de cette maison, rien ne s’opposera à ce que vous veniez me voir.
— Où serez-vous, ma mère ?
— Chez mon fils, si, comme j’en ai le ferme espoir, le Seigneur me l’a conservé.
— Alors, à bientôt, ma mère.
— A bientôt, ma fille !
Ce fut tout. Nicolette hâta le pas, et, ayant passé devant la loge d’où la tourière effarée la regardait fuir, elle s’élança au dehors, consommant ainsi sa rupture avec ce Carmel bien-aimé où jadis elle n’était entrée que pour y mourir, et d’où elle s’échappait maintenant parce qu’elle voulait vivre, vivre pour son fils.
Après une longue soirée d’insomnie et de fièvre, Adrien commençait à s’assoupir. Depuis déjà trots jours, un mal mystérieux ébranlait son cerveau, secouait ses nerfs, troublait son intelligence et le tenait alité. C’était une accablante lassitude répandue par tout son corps, pesant sur son âme, le résultat d’une défaite suprême, succédant à une longue résistance enfin vaincue.
Devant ses yeux, des visions maladives se détachaient sur le fond obscur de sa chambre. Elles lui montraient tantôt sa mère qu’il s’étonnait de n’avoir pas vue encore, bien qu’à deux reprises il l’eût appelée par des lettres suppliantes ; tantôt Jeanne Mauroy, à laquelle il songeait sans cesse depuis qu’il la savait libre et déliée de ses vœux. Dans ces hallucinations, sa mère tendait vers lui ses bras, chargés de lourdes chaînes. Elle l’enveloppait d’un regard navré, où éclatait la douleur enfantée par son impuissance à le secourir. Jeanne Mauroy lui souriait, resplendissante dans l’éclat de sa beauté souveraine. Sous ce sourire doux, empreint de raillerie, il croyait lire un reproche. Pourquoi, s’il l’aimait, n’allait-il pas à elle ? Pourquoi ne lui parlait-il pas de l’amour dont les ardeurs l’embrasaient ?
Alors, une prière montait à ses lèvres, s’en échappait en accents de délire, imprimant à tout son être un spasme douloureux. Il adjurait les deux femmes, en invoquant sa tendresse pour elles, l’une de lui venir en aide, l’autre de lui pardonner. Mais elles demeuraient sourdes à sa voix. Leur ombre tremblante s’évanouissait, ne rendant à son esprit quelque lucidité que pour lui montrer Laure et Roudier, installés dans sa maison, devenus, malgré lui, ses gardiens, et veillant autour de son lit, afin d’empêcher les bruits du dehors d’arriver jusque-là.
En dépit des témoignages de leur intérêt prodigué à toute heure, avec des formes obséquieuses, ces deux êtres, à qui, trop longtemps, il avait accordé sa confiance et livré sa vie, ne lui inspiraient plus que de l’horreur. Sous leurs airs tristes, il devinait leurs calculs odieux. Ses illusions dissipées lui laissaient voir toute l’infamie de la maîtresse vénale et de l’ami traître, dont il ne pouvait secouer le joug, ce joug détesté, imposé à sa faiblesse. Sous prétexte de le soigner, ils l’avaient séquestré ; il le savait, et néanmoins il était contraint de les subir et d’accepter leurs soins.
Ils essayaient encore de dissimuler leurs visées. Mais leur attitude les révélait. Il y avait déjà dans leur parole une menace, comme si, le voyant perdu, ils n’eussent plus eu que le souci de le rendre docile à leur volonté, en exploitant l’inquiétude et la peur qui s’emparent des mourants. Ils voulaient se faire attribuer, sinon la totalité, au moins la plus grande partie de sa fortune. C’est à exciter ses libéralités qu’avait travaillé Laure quand il était debout. Maintenant, elle s’appliquait à lui arracher un testament qui la ferait héritière. Elle s’y appliquait, en fille habile, soumise à Roudier dont la perversité avait touché son cœur, et aux mains de qui elle n’était plus qu’un instrument qu’il dirigeait à son gré.
Il n’avait pas eu de peine à lui démontrer la facilité de l’entreprise. Sans parents pour le protéger et défendre ses droits, séparé de sa mère, Adrien de Varimpré était une proie sur laquelle leur cupidité pouvait s’exercer sans effort. Le médecin l’avait presque condamné. Pour le sauver, il aurait fallu un dévouement maternel ou une sollicitude conjugale, une de ces volontés énergiques que seul l’amour peut inspirer. Dans leurs soins intéressés, les misérables n’apportaient rien de pareil. Laisser mourir Adrien, après avoir obtenu de lui le testament qui devait les enrichir, ils ne poursuivaient rien au delà. Sous une forme insaisissable, c’était déjà le crime. Et pâle, blême, anéanti sous les étreintes du mal, le malheureux s’en allait vers la mort, sans défense et sans secours.
Vers six heures, au moment où l’ombre agrandie montait le long des rideaux de son lit, il fut tiré tout à coup de son assoupissement. Roudier était devant lui, une méchante expression sur ses traits à peine éclairés par la blanche lumière de la lampe posée sur un guéridon. Dans la cheminée, des bûches se consumaient lentement sur les cendres embrasées. Par la porte ouverte à côté de cette cheminée, l’œil encore à demi clos d’Adrien embrassait le salon, et apercevait au milieu de cette pièce Laure assise dans un fauteuil, essuyant ses larmes.
— Je suis donc bien bas ? demanda-t-il à Roudier. Et comme Roudier se taisait, il ajouta : — Pourquoi m’as-tu éveillé ? Que ne me laisse-t-on en repos ?
— C’est que tu étais terriblement agité, mon camarade. Tu as eu le délire, un délire violent. Tu parlais de ta mère, et aussi d’une certaine Jeanne…
— J’ai prononcé son nom ? s’écria Adrien.
— Tu vois, puisque je le sais. Ce n’est pas très-gai pour Laure de découvrir qu’il y a dans ta vie une autre femme qu’elle.
— Qu’est-ce que cela peut lui faire, puisque je vais mourir ?
— Ce que cela peut lui faire ! Demande-le-lui.
— Non ; je ne veux à cette heure ni explication ni scène. Il respira bruyamment ; puis il continua : — As-tu envoyé à ma mère la lettre que j’ai écrite ce matin ?
— Je l’ai envoyée.
— On n’a pas répondu ?
— Le commissionnaire est revenu les mains vides, sans avoir pu arriver à la sœur Thérèse de Jésus. La tourière a pris la lettre, en promettant de la faire parvenir.
— C’est épouvantable ! gémit Adrien.
— Renonce à te tourmenter, mon pauvre ami ; ta mère ne viendra pas. Il est interdit aux Carmélites de franchir l’enceinte de leur cloître.
— Il faudra donc mourir sans la revoir !
— Que parles-tu de mourir ! s’écria Roudier. Tu es bien bas, sans doute ; et entre hommes, on se doit la vérité ; mais si je te la dis, c’est que je suis sûr que nous te sauverons. Oui, nous te sauverons, fit-il avec lenteur, pesant ses paroles toutes pleines d’insinuations et de réticences. Cependant, le médecin prétend le contraire ; il m’a dit ce matin que si tu as des dispositions à prendre… Oh ! tu sais, ce n’est pas difficile de faire un testament, et après tout, cela ne te rendra pas plus malade.
— Un testament ! Dans quel but ? Ma mère hérite de son fils…
— Oui, d’après la loi. Mais tu dois à Laure une preuve d’amour, une preuve bien méritée, car depuis deux jours, elle t’a soigné avec un dévouement dont je ne la croyais pas capable.
— Elle a déjà reçu de moi de quoi vivre.
— De quoi vivre ! objecta Roudier dédaigneusement. Trois mille francs de rente à peine.
— C’est plus que ne vaut le bonheur qu’elle m’a donné.
— Comme tu parles d’elle ! Tu la hais donc bien ?
— Oui, je la hais. Ame vulgaire, âme vénale ! Elle a flétri la mienne ! C’est elle qui me tue. — Roudier protestait du geste. Adrien continua avec amertume : — Ah ! fou que j’ai été de me laisser tromper par son visage menteur, et de me livrer à elle !
Roudier prit brusquement la main de son ami, et désignant Laure toujours assise dans le salon :
— Ne vois-tu donc pas qu’elle se désespère !
— Comédie !
— Persiste à le penser, puisque tel est ton caprice ; mais, crois-moi, ne le lui dis pas. Si tu dois mourir, n’ajoute pas à ses larmes la cruauté d’un mépris immérité, succédant à ton amour ; ce serait lâche, car, fût-elle coupable, ce que je nie, elle est maintenant digne de pardon. Si tu dois vivre, qu’elle ne puisse pas un jour supposer que la haine t’a rendu capable de l’oublier en ce moment, et de la mettre à la discrétion de ceux qui la détestent, parce qu’elle leur a pris ton cœur.
Les supplications de Roudier expirèrent dans un attendrissement joué avec un grand art. Il resta debout devant le lit, épiant, anxieux, sur la figure d’Adrien l’impression produite par sa parole. Mais tout à coup le malade se souleva et reprit avec violence :
— Pourquoi la défends-tu, si tu es mon ami ?
— Parce que mon devoir d’ami est de te mettre en garde contre l’injustice que tu vas commettre. Oui, une injustice, je l’affirme. Parlerais-tu de Laure comme tu le fais, si tu n’aimais une autre femme, cette Jeanne sans doute, dont j’ai entendu tout à l’heure le nom dans ta bouche pour la première fois ?
— C’est infâme de me tourmenter ainsi ! murmura Adrien, dont cet entretien achevait d’ébranler les forces et de paralyser la volonté.
Sa plainte laissa Roudier insensible. Il se pencha sur le lit, et toujours impitoyable, il dit :
— Allons, Adrien, reviens à toi et comprends que tu dois faire ce testament. Il le faut, je le veux…
Ses yeux sombres ne priaient plus ; ils ordonnaient, et maintenant Adrien le regardait avec une surprise mêlée de crainte.
— Tu le veux ? soupira-t-il.
— Je le veux, répéta Roudier, qui avait pris sur la table de nuit un buvard, une feuille de papier et une plume.
Un sourire éclaira les traits d’Adrien. Il se souleva avec lenteur. Assis sur le lit, le dos appuyé aux coussins relevés, il prit les objets que lui tendait Roudier, en murmurant.
— J’obéis… Si je n’obéissais pas, tu serais capable… Allons, dicte ; tu connais ma fortune mieux que moi.
Roudier dicta :
« Dans la crainte de la mort, malade de corps, mais sain d’esprit, j’écris de ma main l’expression de mes dernières volontés.
« Je désire qu’aussitôt après mon décès, l’inventaire de ma succession soit dressé sans aucun retard, et ma mère admise à reprendre, dans cette succession, une somme égale à la fortune personnelle qu’elle possédait au moment de son mariage, et dont elle m’a fait donation quand j’ai eu le bonheur de la retrouver. Sous cette unique réserve, j’institue mademoiselle Laure Malestra ma légataire universelle, afin qu’elle soit mise après ma mort en possession de tous mes biens meubles et immeubles, tels qu’ils existent et se comportent, et sans autre exception que celle que je viens d’indiquer. J’entends reconnaître ainsi le fidèle et affectueux dévouement que m’a prodigué mademoiselle Laure Malestra, depuis que je la connais jusqu’à ce jour.
« Les dispositions que je prends en ces termes ne dépouilleront pas ma mère, puisqu’elles visent seulement la fortune que je tiens de mon père, Frédéric de Varimpré. D’ailleurs, ma mère, enfermée pour sa vie dans un cloître, a fait vœu de pauvreté, et, considérât-elle que ses droits d’héritière légale sont lésés par le présent testament, elle m’a trop tendrement aimé pour s’opposer à l’exécution de ma volonté formelle, que je consigne solennellement dans ces lignes autographes. »
Adrien avait écrit silencieusement sous la dictée de Roudier ; il s’arrêta pour se reposer, en disant :
— Je ne te savais pas si habile ; tu as tout prévu.
— Continue, fit brutalement Roudier.
— Sera-ce long encore ?
— Plus rien qu’une phrase :
« Je désigne mon ami Jacques Roudier comme mon exécuteur testamentaire ; je le prie d’accepter, avec mes remercîments fraternels, un tableau à son choix parmi ceux qu’on trouvera chez moi. »
— Est-ce tout ? demanda de nouveau Adrien.
— Oui ; date et signe, lisiblement surtout. Le misérable s’inclina pour s’assurer que sa recommandation était exécutée. Puis il prit le testament, le plia en quatre sans le lire, le glissa sous une enveloppe qu’il cacheta et qu’il posa sur le buvard devant Adrien, en ajoutant : — Écris là : « Ceci est mon testament. »
Quand ce fut fini, il s’empara du pli. Une joie folle errait sur ses lèvres frémissantes, allumait un éclair dans ses yeux. Sans prononcer un mot de gratitude, il s’éloigna, tandis qu’Adrien, épuisé, laissait retomber sur l’oreiller sa tête pâlie.
De la place où elle se trouvait, Laure avait feint de se désintéresser de ce qui se décidait à quelques pas d’elle. Mais, à travers ses doigts ouverts sur son visage, elle suivait tous les mouvements de son complice. Au geste qu’il fit, elle devina le succès de sa tentative. Alors elle se leva, et toute dolente, vint s’agenouiller devant le lit, en touchant de sa bouche la main amaigrie, pendante sur les couvertures. Elle jouait son rôle jusqu’au bout, avec le désir de faire croire à sa reconnaissance. Mais Adrien retira son bras, sans essayer de dissimuler sa répulsion ; puis il demeura immobile, anéanti par l’effort auquel il venait d’être condamné. Cet accablement effraya Laure. Elle quitta la place et se rapprocha vivement de Roudier.
— Est-il mort ? lui demanda-t-elle à voix basse.
— Non, mais il ne vaut guère mieux que s’il était mort, répondit Roudier sur le même ton. Ah ! il était temps d’en finir. Encore quelques heures, et l’héritage nous échappait. Te voilà riche, grâce à mon énergie…
Ils revenaient à petits pas dans le salon, ne s’arrêtant que pour jeter un coup d’œil derrière eux, sur cette couche privée de secours et de soins, où Adrien demeurait étendu, sans mouvement, comme un cadavre. Pour causer sans contrainte, ils fermèrent la porte. Le malheureux, maintenant, pouvait mourir en paix. Personne ne troublerait plus son repos, personne. Une fois seuls, ils se regardèrent en riant.
— La fortune, enfin ! s’écria Roudier en brandissant le pli.
Sa voix résonna dans le salon silencieux, à peine éclairé par deux bougies qui se consumaient sur la cheminée.
— Doucement, donc ! murmura Laure. S’il allait entendre !…
— Lui, il ne peut plus entendre, ni voir ni entendre. Il mourra cette nuit.
Laure frissonna ; puis elle se pressa contre son complice, et touchant du doigt le testament :
— Alors, mon nom est écrit là dedans ! fit-elle.
— Veux-tu le voir… attends… Il tendit le pli vers la bougie, en présentant à la flamme le cachet. La cire lentement se liquéfia. Il ouvrit l’enveloppe avec dextérité, sans la déchirer. Il en retira le papier et le passa à Laure : — Lis. Elle y jeta les yeux, la figure empourprée, toute tremblante de l’émotion subite qui s’emparait d’elle. — La joie te rend belle, lui glissa Roudier à l’oreille. Mais, au lieu de répondre au compliment, elle restait bouche béante, stupéfaite, hébétée. — Qu’est-ce qui te prend ? demanda-t-il.
— Nous sommes joués !
Il lui arracha le testament d’un geste de fureur, tandis qu’elle bégayait le nom de Jeanne Mauroy, écrit à la place du sien sur l’acte testamentaire, par lequel elle s’était crue enrichie.
— Le diable l’emporte ! s’écria Roudier. Il s’est moqué de moi.
— Jeanne Mauroy ! répéta Laure. Connais-tu, toi ?…
— C’est ta rivale, ma fille ; car tu as une rivale. Il te trompait.
— Alors tout est perdu ?
Roudier garda le silence. Il examinait attentivement les caractères tracés par Adrien ; il pressait entre le pouce et l’index la feuille couverte d’écriture pour en calculer l’épaisseur ; il en étudiait le grain et la transparence. Peu à peu, il se rassurait.
— Il n’est pas impossible d’effacer ce nom et d’y substituer le tien, dit-il enfin.
— Un faux ! jamais… je ne veux pas aller en prison.
— Laisse donc ; on n’est pas chimiste pour rien.
— Alors tu crois.
— Je réponds de tout. Cette nuit, je travaillerai, et tu hériteras, continua-t-il, en laissant tomber le testament sur le marbre de la cheminée, pour se rapprocher de Laure ; oui, tu hériteras, ma petite ; c’est-à-dire, nous hériterons, car c’est part à deux, n’est-ce pas, madame Roudier ?
— Tu es bête, fit-elle, en se dérobant aux lèvres avides qui cherchaient les siennes.
Mais Roudier la retenait par la taille ; un soudain et brutal désir le secouait. Il voulait, à cette heure décisive, sceller d’une caresse les projets anciens, formés lorsque encore il n’en croyait pas la réalisation si prochaine.
— J’ai peur, soupira-t-elle, en essayant de lui résister.
— Qu’avons-nous à craindre ?
Il n’eut pas le temps d’achever. Laure, poussant un grand cri, s’arrachait à ses bras, se réfugiait à l’autre extrémité du salon, effarée et tremblante, les yeux fixés sur la porte de la chambre, avec une persistance qui obligea Roudier à regarder du même côté. Sur le seuil de cette porte qui s’était ouverte sans bruit, se tenait Adrien cramponné à la boiserie, un manteau sur les épaules, offrant aux complices épouvantés le spectacle de sa face livide, rendue plus sinistre par le désordre de ses cheveux. En une minute, il eut tout vu et tout deviné.
— Misérables ! murmura-t-il.
— Deviens-tu fou ? demanda violemment Roudier, en s’élançant vers lui.
— Ne me touche pas, scélérat, continua Adrien.
Roudier insista pour le ramener vers son lit ; il y eut un commencement de lutte. Adrien s’était adossé à la porte ; il se débattait, poussait des gémissements, faits de plaintes et de reproches, tandis que Laure, perdant la tête, n’écoutant que sa terreur, se précipitait au dehors, en appelant la femme de service, à qui depuis la veille l’entrée de la chambre du malade restait interdite.
Cette femme accourut. Elle rencontra dans l’antichambre Laure, chancelante sous le coup de son effroi brusquement déchaîné.
— Pourquoi tout ce bruit, madame ? demanda-t-elle, soupçonneuse.
— Venez vite, répondit Laure. Adrien a quitté son lit, en proie à un accès de fureur. Il menace…
Un violent coup de sonnette l’interrompit ; sa phrase resta inachevée. La servante, qui se trouvait devant la porte d’entrée, n’eut qu’à se retourner pour ouvrir, et dut se jeter de côté pour n’être pas renversée par une inconnue, une petite vieille, vêtue de noir, qui se précipita dans l’appartement en appelant Adrien. A l’air de cette étrangère, à ses accents, à son inquiétude, Laure comprit et murmura :
— Sa mère ! Sa mère ici ! Allons, il n’y a plus d’espoir.
Et saisie de peur, prenant à peine le temps de décrocher son chapeau et son manteau suspendus à une patère, elle descendit l’escalier, affolée, laissant Roudier se tirer d’affaire comme il pourrait.
Déjà Nicolette en savait long. Un entretien de quelques minutes avec le portier lui avait révélé le danger que courait son fils ; son instinct maternel complétait cette révélation, lui faisait pressentir le rôle odieux de l’ami et de la maîtresse, installés au chevet du malade.
— Me voilà, mon enfant, me voilà, cria-t-elle en se précipitant dans la chambre.
— Ma mère ! ma mère ! gémit Adrien, qui roulait sur son lit, vers lequel Roudier l’avait brutalement ramené, venez me défendre ; chassez cet homme, chassez sa complice.
— Oui, je te défendrai, et je ne te quitterai plus, reprit Nicolette avec une vigueur que décuplait le sentiment du péril. Elle prit Roudier par le bras, et le repoussa en se jetant devant son fils renversé. Une sainte colère animait son regard. Avant que Roudier fût revenu de sa surprise, elle se dressait terrible, en lui montrant la porte. — Sortez, monsieur, dit-elle.
— Mais, madame, qui donc êtes-vous, et de quel droit…?
— Éloignez-vous, ou j’appelle. Je suis la baronne de Varimpré.
Roudier hésita un moment. La tête basse, il promenait autour de lui ses yeux où grondait la haine. Puis, tout à coup, il releva le front, cherchant à couvrir sa retraite.
— Oui, je sors, fit-il, mais c’est pour revenir. Vous entendrez parler de moi, madame.
Nicolette dédaigna de lui répondre. Au moment où, furieux et déçu, il quittait pour toujours cette maison, Roudier put voir la mère courbée avec sollicitude sur son fils que cette scène violente, qui devait le tuer, venait de sauver, en provoquant dans son pauvre corps brisé une réaction salutaire.
Lorsque le même soir, après une longue conférence avec le médecin, mandé par ses soins, elle se trouva seule au chevet de son cher malade, elle remercia Dieu qui lui avait inspiré la volonté de quitter le cloître pour venir à ce chevet où l’appelait un devoir sacré, et qui permettait qu’elle y arrivât assez tôt pour en éloigner la mort.
Assise auprès de son fils endormi, toute frissonnante dans la nuit silencieuse, Nicolette fut longtemps avant de pouvoir se recueillir. Si troublants étaient les incidents de cette journée dans leur succession inattendue ! Ses angoisses, ses larmes, sa révolte contre la prieure, sa fuite du couvent, son arrivée dans la maison d’Adrien…
Et si nouvelle aussi sa situation !
Depuis douze années qu’elle portait l’habit de la religion, elle se trouvait pour la première fois hors de sa cellule, embarrassée de sa liberté, gauche aux exigences de la vie sociale longtemps abandonnée et oubliée. Pour la première fois, elle allait passer la nuit loin du cloître où elle avait juré de vivre et de mourir, et où peut-être elle ne rentrerait jamais !
Quand tout à l’heure, n’obéissant qu’à ses alarmes maternelles, elle violait ses vœux et brisait les barrières pour accourir auprès de son enfant, son âme était sans remords. Elle avait agi dans la plénitude de sa volonté, sûre de ses droits, oublieuse du ciel pour ne songer qu’à la terre. Maintenant, au fur et à mesure qu’elle se rassurait, elle s’effrayait de sa témérité, de ses résolutions exécutées aussitôt que conçues, et de leurs conséquences.
Elle connaissait trop la rigueur des règles du Carmel pour se faire illusion sur la gravité de l’acte qu’elle venait d’accomplir. Toujours miséricordieuse, l’Église lui pardonnerait sa rébellion, légitimée par les saintes obligations de la maternité ; elle restait sans inquiétude à cet égard. Mais le cloître se rouvrirait-il pour elle ? Et s’il était à jamais fermé, quel serait son destin ? Se verrait-elle condamnée à vivre dans le monde, à reprendre sa place dans une société dont elle méprisait les préjugés et les lois, et où elle n’espérait pas retrouver la paix perdue ? Ce fut sa plus cruelle préoccupation durant cette nuit où la certitude de sauver son fils fut assez puissante pour lui permettre d’interroger son âme, de sonder l’avenir et de regretter le passé.
Il remplissait sa mémoire, ce passé sans ombre. Elle le revivait dans ses détails les plus minutieux : son entrée comme postulante au couvent de Beaucaire, les premières épreuves, les longues veilles devant l’autel, les mortifications incessamment renouvelées, les dures pénitences, les douces extases dans la contemplation du ciel ; puis l’émouvante cérémonie de la vêture, les étapes du noviciat, embellies par la joie de souffrir, la profession, les vœux solennels, et enfin la prise de voile, couronnant d’un bonheur inénarrable son union mystique avec Jésus.
Elle pleura, en se rappelant cette matinée radieuse où le voile noir des Carmélites était tombé sur son front, l’infinie volupté de cette suprême immolation, tandis que le prêtre disait : « Recevez le voile sacré, qui est le signe de la pudeur et de la modestie : portez-le au tribunal de Jésus-Christ, pour avoir la bienheureuse immortalité », paroles divines auxquelles elle répondait : « Il a mis un signe sur mon visage pour bannir de mon cœur tout autre amour que le sien. » Elle se souvint comme d’une félicité qu’on ne goûtera plus, de l’heure solennelle où dans le chœur des religieuses, derrière la grille hérissée de pointes acérées, au chant du Te Deum, elle s’était prosternée, les bras en croix, sur la serge grossière, dans l’immobilité de la mort, un drap noir jeté sur elle, demeurant ainsi jusqu’au moment où la prieure l’ayant aspergée d’eau bénite, ainsi qu’on fait sur les cercueils, l’avait relevée. C’était longtemps après la fuite de son mari et la perte de son fils, et ce jour-là, seulement, son cœur avait commencé à s’apaiser.
Et depuis, en dépit des remords et des tristesses, que de consolations suaves ! que de voluptés exquises, longuement savourées ! Les recouvrerait-elle, ces biens sans prix ? Rentrerait-elle dans la cellule froide et sombre comme un tombeau et joyeuse comme un paradis ? Étendrait-elle encore sur la dure couchette ses membres meurtris, déchirés par le cilice ? Goûterait-elle enfin la douceur de vivre dans la compagnie des sœurs, en expiant par la prière et les mortifications les péchés du monde ? Questions brûlantes, qui s’imposaient à son âme toute pénétrée de ces souvenirs sacrés dont elle ne voulait pas croire que la chaîne fût à jamais brisée.
Vers le matin, ses regrets se dissipèrent. Adrien s’était éveillé après un long et tranquille sommeil. Il la regardait, en lui tenant la main, heureux de se sentir près d’elle, délivré de la présence des misérables qui souhaitaient sa mort. Il lui souriait doucement et murmurait :
— Ma mère, je savais bien que vous ne m’abandonneriez pas.
Ces accents la jetaient dans le ravissement, l’attachaient à sa vie nouvelle ; ses craintes s’évanouissaient. Elle répondait :
— Rien ne nous séparera plus, mon enfant chéri.
Et elle ne songeait même pas à se demander comment elle parviendrait à tenir cet engagement.
Durant les jours qui suivirent, le mal qui s’était brutalement abattu sur Adrien, céda aux soins maternels ; la guérison fit des progrès rapides ; la convalescence vint. Nicolette eut enfin le bonheur de voir son fils se lever et marcher dans l’appartement, appuyé à son bras. Elle en goûta un autre encore qui ne ne fut ni moins doux ni moins réparateur, celui d’amener un sourire aux lèvres du convalescent, en prononçant devant lui le nom de Jeanne Mauroy.
Il n’avait guère cessé de penser à cette adorable fille, depuis le trop court voyage qui ne les avait rapprochés que pour provoquer dans son cœur l’épanouissement de l’amour. Son souvenir l’avait poursuivi jusque dans sa maladie. Maintenant qu’il était guéri, il se rappelait que Jeanne sortie du cloître avait recouvré sa liberté. Il se flattait de l’espoir d’être heureux par elle et avec elle. Mais de cet espoir il ne parlait pas. Ce fut sa mère qui en obtint l’aveu, en lui racontant qu’à diverses reprises mademoiselle Mauroy était venue avec son tuteur prendre des nouvelles, et qu’elle n’avait pas encore quitté Paris.
— Je voudrais la revoir, dit Adrien doucement.
Il la revit. Elle vint un soir dans sa maison, accompagnée du parent qui lui tenait lieu de père et qui était accouru pour la faire sortir du couvent. Pour la première fois, il leur fut permis de s’entretenir librement. Cette entrevue décida de leur destinée. L’amour est contagieux, il appelle l’amour ; celui d’Adrien ne tarda pas à être partagé. Le souvenir de Laure Malestra était déjà loin, aussi loin que cette passionnante personne, conquête glorieuse de Jacques Roudier, tombée en son pouvoir et disparue avec lui dans ce tourbillon parisien qui ne rend guère ses victimes. Adrien, délivré, pouvait donc s’abandonner sans contrainte à la chaste tendresse éclose dans son cœur, et dont la floraison radieuse en cicatrisait les blessures. Il s’y livra avec enthousiasme. Il avait la certitude de ne pas se tromper. Jeanne était bien la compagne rêvée, l’épouse aimante et fidèle qui partage toutes les peines comme toutes les joies. Elle ne trahirait pas ses espérances ; chaque jour, il découvrirait en elle de nouveaux trésors ; elle ferait sa vie douce et fortunée.
Le mariage eut lieu. Le même jour, ils partaient afin d’aller cacher dans une retraite lointaine le printemps de leur bonheur réalisé. Nicolette avait promis d’attendre leur retour avant de retourner au Carmel. Car maintenant, sa tâche accomplie et l’avenir de son fils assuré, elle espérait fermement d’y pouvoir rentrer. C’était son plus ardent désir.
Il ne lui suffisait pas que ses supérieurs ecclésiastiques, prenant en considération les angoisses maternelles qui l’avaient affolée, quand lui était parvenue la nouvelle des dangers que courait la vie de son fils, eussent excusé sa fuite et se montrassent disposés à la relever de ses vœux ; elle voulait porter encore la chaîne des engagements contractés devant Dieu, dût-elle recommencer les épreuves du noviciat et repasser par toutes les étapes depuis longtemps franchies.
Ce n’est pas qu’elle fût entraînée par la nostalgie du cloître. Hélas ! à présent qu’elle avait vécu de la vie de son enfant, elle trouvait au monde un charme inattendu, et regardait à l’égal d’un bien sans prix la douceur d’y vivre dans l’ombre de ce jeune foyer édifié de ses mains. Mais quoi que pût alléguer l’Église pour lui rendre le repos, Nicolette ne croyait pas qu’elle eût le droit d’être heureuse ailleurs que sous la règle des Carmélites ; elle entendait épuiser les demandes et les démarches avant de renoncer à en sentir de nouveau le joug. Il lui semblait qu’elle devait cela à Dieu, à titre de réparation, pour lui avoir un jour préféré l’enfant né de ses entrailles ; qu’elle se le devait à elle-même, par respect pour la vocation sacrée à laquelle, en d’autres temps, elle avait obéi.
Elle demeura dans ces alternatives tant que dura l’absence de son fils, ne goûtant d’autres joies que celles qu’elle puisait dans les lettres qu’elle recevait de lui, et s’efforçant de conformer sa conduite aux lois du Carmel.
Chaque matin, au petit jour, elle entrait dans la chapelle de son couvent ; elle y entendait la messe, y communiait, et demeurait là, durant de longues heures, anéantie devant Dieu, priant pour le bonheur de ses enfants, pour leur salut et pour le sien. Elle écoutait les religieuses psalmodiant l’office derrière la grille voilée ; elle s’associait à elles, et sa pensée perçant le voile noir, passant à travers les barreaux, la transportait dans le chœur où si longtemps elle avait connu les extases de ces saintes créatures. Elle se revoyait au milieu d’elles, dans sa stalle, récitant les oraisons et prenant sa part des exercices prescrits par la règle. Alors, le besoin de recommencer cette vie inoubliable la ressaisissait. Elle se levait, courait au parloir, interrogeait anxieusement la prieure, afin de savoir si les démarches qu’on faisait pour lui rouvrir le cloître étaient au moment d’aboutir. Puis, tout à coup, lorsque dans les réponses provoquées par ses questions, elle rencontrait la preuve que son espérance ardemment exprimée se réaliserait, un frémissement douloureux s’emparait d’elle ; la crainte d’être de nouveau séparée de ceux qu’elle chérissait la livrait aux angoisses, et elle revenait dans sa maison, inquiète, en proie à mille tourments, tenaillée par le remords, pleurant sa ferveur, gémissant sur l’attiédissement de son zèle pour Dieu, mais, par-dessus tout, épouvantée par l’appréhension de perdre encore son fils.
L’absence d’Adrien et de Jeanne se prolongea trois mois, durant lesquels Nicolette persécutée par son incertitude ne put recouvrer le repos. Elle attendait le bonheur de les revoir avec une impatience maladive, accrue chaque jour davantage. Enfin, leur retour ramena dans son cœur la sérénité. L’été venait. Ils allèrent s’installer ensemble dans une villa située aux environs de Paris et louée pour la saison. Là, entre son fils et sa belle-fille, Nicolette commença à savourer la douceur des affections humaines, et à comprendre qu’à côté de la joie de s’immoler pour Dieu, il est d’autres joies qu’il ne défend pas à ses créatures. Loin du Carmel, son exaltation privée d’aliments tombait peu à peu ; dans son esprit, s’élevait le désir de voir le cloître qu’elle avait quitté volontairement, et où ses scrupules seuls la poussaient à rentrer, rester à jamais fermé pour elle. Mais ce désir demeurait timide encore ; elle se demandait même s’il n’était pas criminel.
Ce qui faisait l’objet de ses préoccupations ne s’agitait jamais entre elle et son fils. Il aurait voulu connaître les projets que formait sa mère en vue de l’avenir ; il n’osait l’interroger. Parfois, en la voyant près de lui, toujours souriante, prodiguant sa tendresse à Jeanne, environnant de sollicitude cette jeune femme, jadis sa fille spirituelle, à laquelle l’unissaient depuis longtemps des liens mystérieux, formés dans les pratiques de la religion, Adrien se plaisait à croire qu’elle était heureuse et avait renoncé à retourner chez les Carmélites. Parfois aussi, cet espoir se transformait en doute, quand il la trouvait agenouillée dans sa chambre, ou lorsque, le matin, il surprenait sur son visage les traces des larmes versées pendant les nuits sans sommeil, passées à délibérer avec elle-même sur ce qu’il convenait de faire pour ne pas offenser Dieu. S’il avait pu lire au fond de ce cœur troublé, il aurait eu pitié de l’angoisse qui le torturait, engendrée par la crainte d’être rappelée au couvent. Mais Nicolette dérobait ses larmes à son fils, ne faisait pas plus d’allusions à l’avenir qu’au passé, et évitait de lui parler de ce qui les inquiétait également tous deux.
Un matin, elle entra à l’improviste dans le cabinet d’Adrien. Elle était pâle, des pleurs avivaient l’éclat de ses yeux. Sans lui dire un mot ni lui laisser le temps de s’informer des causes de sa tristesse, elle lui tendit une lettre qu’elle venait de recevoir. Il la lut d’un trait. Cette lettre, écrite par l’aumônier du couvent, exposait à Nicolette l’état des démarches entreprises pour régulariser sa situation. Ces démarches multipliées n’avaient eu encore d’autre résultat que de réconcilier avec l’Église et avec l’Ordre la mère Thérèse de Jésus. La question de savoir si elle pouvait rentrer au Carmel n’était pas résolue et ne semblait pouvoir l’être que si la Carmélite portait elle-même à Rome ses regrets et ses vœux. L’aumônier engageait donc Nicolette à partir, convaincu qu’elle était résolue à épuiser les juridictions ecclésiastiques avant de renoncer à reprendre l’habit religieux.
— Qu’allez-vous faire, ma mère ? demanda Adrien.
— Je dois me conformer à ce qu’on attend de moi, répondit-elle.
— Ainsi, vous voulez nous quitter ?
— Le devoir l’ordonne.
— En êtes-vous sûre, ma mère ? Ne vous ordonne-t-il pas aussi, et avec plus de force encore, de vous consacrer à votre fils ? Vous lui avez manqué longtemps, trop longtemps. Allez-vous lui manquer de nouveau ?
— J’ai assuré ton bonheur, mon enfant, fit Nicolette ébranlée par cette prière. Je t’ai donné un ange gardien. Ma présence près de toi n’est plus nécessaire.
Il s’avança vers elle, la prit par la taille, et, l’attirant à lui, l’embrassa sur le front, en disant :
— Comptez-vous donc pour rien la douleur de vous perdre encore ? Et vous-même, êtes-vous certaine qu’après avoir connu la douceur des caresses de vos enfants, vous pourrez être heureuse loin d’eux, privée de les voir et de les embrasser ?
— J’offrirai ma souffrance à Dieu.
— En les condamnant eux-mêmes à souffrir ! s’écria Adrien. Ah ! ma mère, Dieu n’exige pas de si cruels sacrifices ! Et s’il lui plaît de m’éprouver une fois de plus, — cela peut arriver, le bonheur n’est pas éternel, — si quelque jour je dois encore connaître l’adversité, pourrez-vous vivre paisiblement dans votre cloître, et allez-vous, sans nécessité, vous exposer à en sortir de nouveau pour m’apporter l’appui de votre amour ? Croyez-moi, puisque vous êtes près de nous, restez-y.
— Tais-toi ! tais-toi ! fit Nicolette en étendant les mains pour fermer la bouche de son fils.
Mais il ne l’écoutait pas ; il s’éloignait d’elle, et courant à la porte de la chambre de Jeanne, il appelait sa femme. Elle apparut sur le seuil, surprise, inquiète de cet entretien qu’elle n’avait osé interrompre, et toute tremblante. Adrien la prit par le bras, et l’entraînant vers Nicolette :
— Tiens, fit-il, dis-lui que maintenant elle ne peut plus partir, ni se dérober à la joie d’être grand’mère.
— Ne nous quittez pas, supplia Jeanne, pressée tendrement contre Nicolette. Restez au moins jusqu’à la naissance de notre enfant.
— C’est donc vrai ! soupira la mère transfigurée et chancelante.
L’énergie de ses résolutions se dissipait. Un voile se déchirait. La vie lui apparaissait sous un jour nouveau, avec d’autres joies et d’autres devoirs. Sa conscience tout à l’heure impérieuse à lui montrer le cloître, les mortifications, la prière, comme le but suprême de sa vie, s’humanisait, changeait de langage, lui rappelait qu’elle était libre. Puis, devant son regard attendri, défilaient les douceurs de la maternité soudain révélées : le sourire d’un enfant, ses vagissements, ses bras roses, les soins qu’elle lui prodiguerait, les premières manifestations de l’intelligence qui s’éveille, les premiers mots errant sur les lèvres innocentes, l’éducation à faire. Ces douceurs, elle les avait si peu goûtées jusque-là ! Ce serait une fête de les savourer à longs traits. Non, Dieu ne pouvait vouloir qu’elle y renonçât, qu’elle brisât de ses mains une félicité si grande.
— Mes chéris, j’attendrai ! soupira-t-elle, défaillante.
Quelques mois plus tard, Jeanne mettait au monde un fils. Nicolette le reçut dans ses bras. Elle le tint un moment serré contre sa poitrine, interrogeant le regard innocent qui fuyait encore la lumière, comme si elle avait espéré y surprendre la volonté du Dieu à qui jusqu’à ce jour elle était accoutumée à s’immoler.
— Ceci est pour moi, dit-elle tout à coup ; puis levant sur ses enfants son front éclairé par le bonheur, elle ajouta : — Que Dieu me pardonne si je l’offense, mais je ne crois pas l’offenser. Je reste, ma place est ici et non ailleurs. Je vous resterai toujours.
Elle ne les a plus quittés.
PARIS. — TYPOGRAPHIE DE E. PLON ET Cie, RUE GARANCIÈRE, 8.