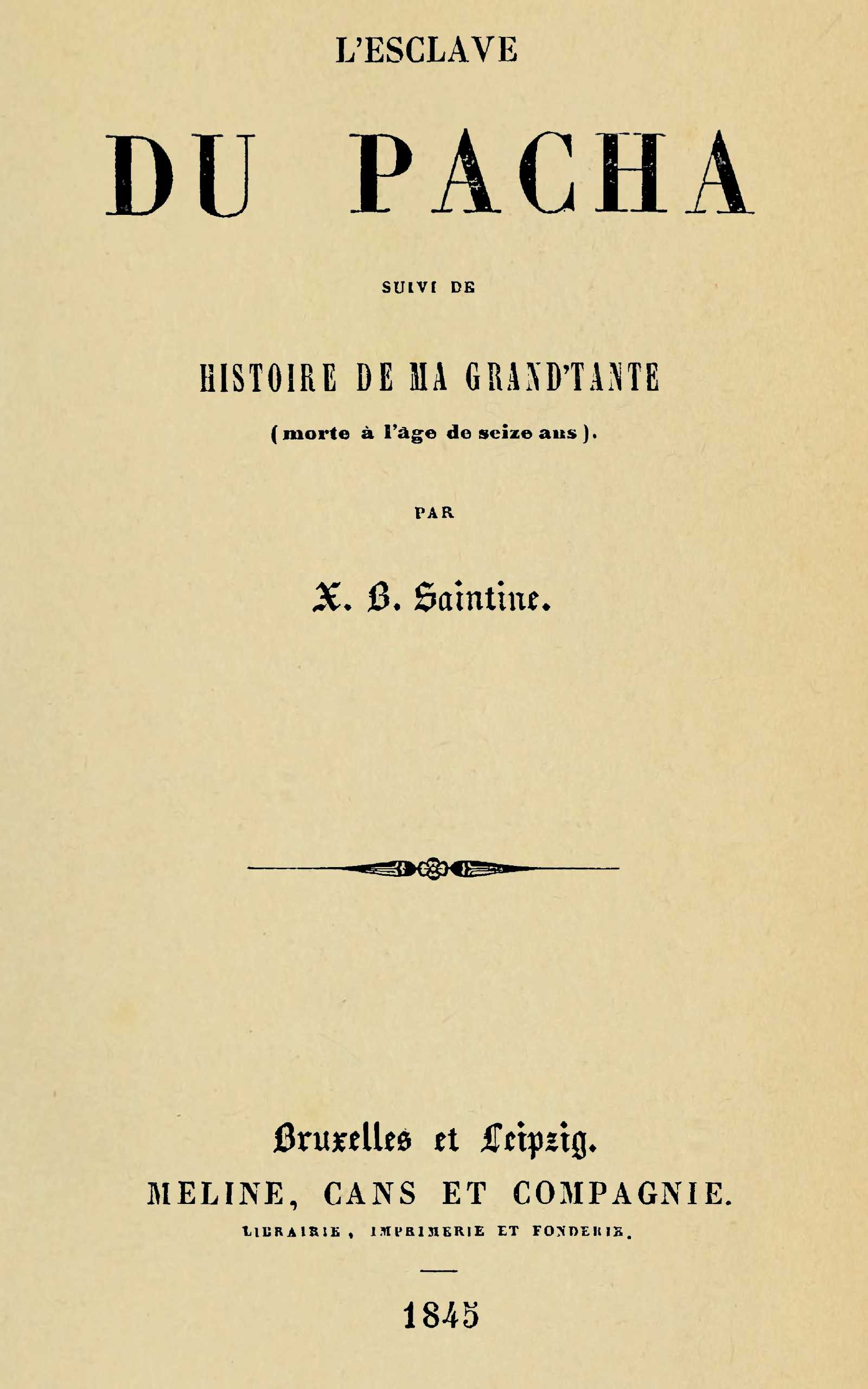
Title: L'esclave du pacha, suivi de Histoire de ma grand'tante
Author: X.-B. Saintine
Release date: November 18, 2025 [eBook #77266]
Language: French
Original publication: Bruxelles: Meline, Cans et compagnie, 1845
Credits: Véronique Le Bris, Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Library of Congress)
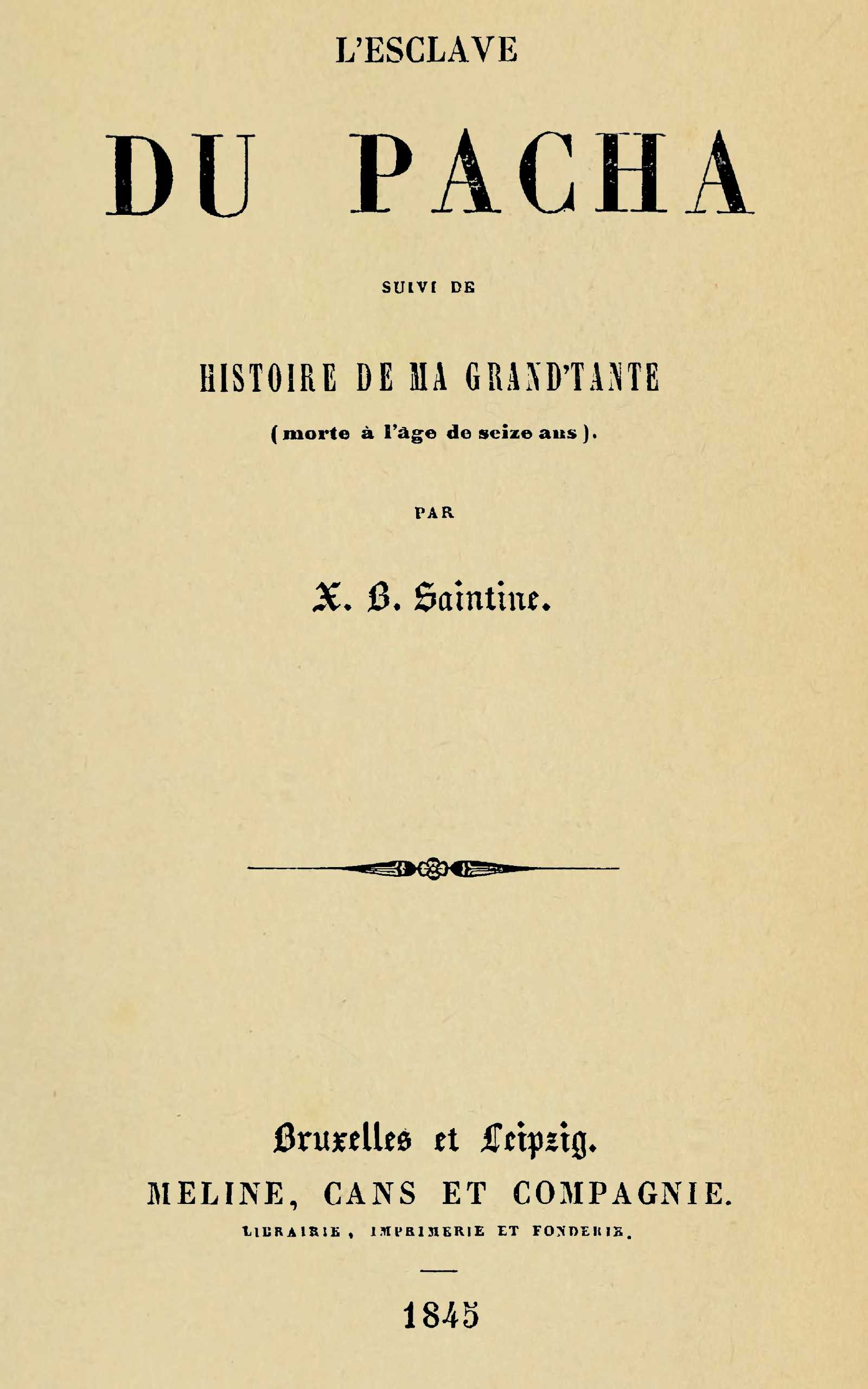
SUIVI DE
HISTOIRE DE MA GRAND’TANTE
(morte à l’âge de seize ans).
PAR
X. B. Saintine.
Bruxelles et Leipzig.
MELINE, CANS ET COMPAGNIE.
LIBRAIRIE, IMPRIMERIE ET FONDERIE.
1845
L’un des jours de la semaine dernière, j’herborisais dans les bois de Luciennes avec un de mes amis, orientaliste distingué, botaniste émérite qui, il y a quelques années, a fait deux mille lieues et couru vingt fois le risque de sa vie pour aller ravir une poignée d’herbes aux flancs du Taurus et aux plaines de l’Asie Mineure. Après nous être promenés dans le bois, en ramassant çà et là quelques gramens, quelques orchis, seulement pour renouveler connaissance avec eux, nous longions le joli village des Gressets et la délicieuse vallée de Beauregard, nous dirigeant vers un déjeuner que nous espérions trouver un peu plus loin, lorsque, sous une allée de hauts peupliers jetés sur la gauche des prairies du Butard, nous aperçûmes, venant à nous, un couple de promeneurs, homme et femme, jeunes tous deux.
Du plus loin que mon compagnon les aperçut, il fit un mouvement de surprise.
— Vous connaissez ces personnes-là ? lui demandai-je.
— Oui.
— De quelle classe, de quel genre et de quelle espèce sont-ils ?
Ici, j’employais les mots simplement dans le sens botanologique.
— Analysez, observez et devinez, me répondit mon illustre voyageur.
J’observai donc, en appliquant à mes deux individus, non le système de Linné, mais le système de Jussieu ; celui des affinités et des analogies. Celui-là me parut plus convenable et plus facile que l’autre.
Le jeune homme, d’une mise fort simple et même négligée, quoique chaussé de ces hauts souliers à talons, véritables quarts de bottes qui ont succédé aux demi-bottes (la botte, chez nous, depuis l’introduction du comfort, va toujours en s’amoindrissant), n’avait même pas de sous-pieds à son pantalon. Une twine gris clair, une chemise de couleur et une casquette à large visière complétaient l’ajustement.
Il portait à la main un de ces paniers de ménage, fermés à leur partie supérieure par deux battants d’osier, dont l’un, à moitié entr’ouvert, laissait passer un goulot de bouteille.
Près de lui cheminait une jeune femme, de taille moyenne et bien prise, mais chez laquelle une indolence de mouvements, une certaine flexibilité de la tige, un certain dandinement des hanches, décelaient une origine méridionale ou un défaut de distinction. Tous deux s’avançaient la tête baissée, se parlant sans se regarder, marchant côte à côte sans se donner le bras ; seulement, de temps en temps, ils s’appuyaient l’un sur l’autre de l’épaule, par un mouvement plein d’affection.
Ce ne fut que lorsque nous nous croisâmes avec eux que je pus voir la figure des deux promeneurs ; jusque-là je n’avais eu à étudier que leur costume et leur tournure.
Le jeune homme rougit en reconnaissant mon compagnon, et nous salua d’un air plein d’humilité ; à peine si j’eus le temps de saisir une seule ligne pathognomonique de son facies. La dame était fort jolie : l’élégance de son cou, la régularité de ses traits lui donnaient un certain air de bonne maison, contredit cependant par ce qu’il y avait de provoquant dans son regard.
Quand ils furent passés et déjà à distance :
— Eh bien ! me dit mon ami, quel jugement porterez-vous sur nos deux individus ?
— Eh bien, lui répondis-je résolûment, le jeune homme est votre confiseur, qui vient d’épouser sa première demoiselle de comptoir.
Et lisant un signe négatif sur la physionomie de mon interlocuteur, j’ajoutai aussitôt :
— Ou un commis marchand en bonne fortune, avec une comtesse sans préjugés.
— Vous n’y êtes pas.
Je demandai un instant de réflexion de plus, et pour perfectionner mon travail d’observateur, je me retournai vers le couple.
Ils avaient gagné, près de l’endroit où nous étions, les bords d’une source, nommée dans le pays la Fontaine-au-Prêtre ; déjà la jeune femme s’était assise sur l’herbe, et, développant une serviette, elle l’étendait près d’elle, tandis que le jeune homme tirait soigneusement de son panier un pâté et diverses autres provisions.
— Certes, m’étais-je déjà dit en moi-même, il y a évidemment, dans la physionomie de cette belle personne, de la grande dame et de la grisette ; mais, en songeant à son allure déhanchée, et surtout en jugeant d’elle d’après son cavalier, alors courbé pour déboucher sa bouteille, et dont le pantalon sans sous-pieds, relevé à mi-jambe, laissait à découvert ses souliers-bottes à grandes oreilles, le type grisette prévalut dans mon esprit.
— La dame, repris-je, mais avec moins d’assurance que la première fois, est figurante dans un de nos théâtres, ou écuyère au Cirque-Olympique.
— Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites là.
— Quant à lui, c’est un garçon limonadier.
J’en jugeais ainsi d’après la facilité toute pratique avec laquelle il me paraissait avoir débouché sa bouteille.
— Vous y êtes moins que jamais, me dit non compagnon.
— Au diable ! et parlons d’autre chose.
Une fois au Butard, nous ne pensions plus à nos deux badauds parisiens. Tandis qu’on préparait notre déjeuner, et même en déjeunant, mon ami en revint naturellement à me parler de ses courses dans le Taurus et l’Anti-Taurus, dans les Balkans, dans le Caucase, sur les rives du Phase et de l’Euphrate, puis pour me reposer de toutes ses descriptions botaniques et géologiques, il me raconta, pièce à pièce, sans paraître y attacher la moindre importance, commençant par le dénoûment, finissant par l’exposition, une histoire qui ne laissa pas que de m’intéresser vivement. Cette histoire, accomplie non loin des bords de la mer Noire, entre Erzeroum et Constantinople, durant son séjour dans cette partie de l’Asie Mineure, il en avait recueilli tous les détails de la bouche même de l’un des principaux acteurs.
J’essayerai de la redire après lui, non tout à fait dans le même ordre ou le même désordre quant aux événements, mais du moins en respectant leur exactitude, et en mettant à profit la connaissance acquise par mon voyageur, des hommes et des lieux.
Vers le milieu du mois de juillet de l’année 1841, au pachalik de Sivas, dans de vastes jardins situés près de la rivière Rouge, une jeune fille, vêtue à la turque, le front courbé, se promenait lentement, suivie d’une vieille négresse. De temps en temps, elle tournait brusquement la tête, et quand son regard, à travers les massifs d’érables et de sycomores, avait pu entrevoir l’angle d’un grand bâtiment à grillages dorés, à balcons de bois de cèdre découpés finement, alors, son teint, d’ordinaire d’un blanc mat et diaphane, se colorait tout à coup, son petit pied se crispait contre le sol, sa poitrine se soulevait, et c’est à grand’peine qu’elle retenait le soupir qui voulait s’en échapper.
Toujours silencieuse, préoccupée, elle s’arrêta et, du doigt, désigna un platane à la négresse. Celle-ci entra aussitôt dans un élégant kiosque, placé à quelques pas, et en revint chargée d’une peau de tigre qu’elle étendit au pied de l’arbre.
Après diverses allées et venues de la négresse, de l’arbre au kiosque et du kiosque à l’arbre, la jeune fille, assise, les jambes croisées, sur la peau de tigre, adossée au platane, dont la séparait cependant un épais coussin de velours noir, soutenait nonchalamment de sa main gauche une pipe narghilé, à tuyau de cerisier de Perse, et de sa droite, dans un léger portant de filigrane d’or en forme de coquetier, une petite tasse de porcelaine de Chine que la vieille esclave remplissait coup sur coup d’un moka brûlant.
Baïla avait dix-sept ans ; ses cheveux noirs et lustrés s’allongeaient sur ses tempes comme deux ailes de corbeau ; ses sourcils minces et formant l’arc parfait, quoique de même couleur que ses cheveux, étaient cependant, ainsi que ses longs cils et le bord de ses paupières, recouverts d’une préparation d’antimoine appelée sourmah ; une petite raie noire verticale lui descendait même du front pour séparer ses arcades sourcilières. D’autres couleurs avaient encore été employées pour donner plus d’éclat à sa beauté. L’incarnat de ses lèvres avait disparu sous une légère couche d’indigo et, par un effet contraire, sous ses yeux où le fin réseau de ses veines projetait naturellement une légère teinte bleue, la pourpre du henné resplendissait. Le henné, sorte de carmin végétal, fort en usage en Orient, rougissait aussi les ongles de ses mains, de ses pieds et jusqu’à ses talons, qui ressortaient nus et vifs de ses petites galoches béantes, brodées d’or et de perles.
Ainsi tatouée à la mode asiatique, Baïla n’en était pas moins belle. Son costume se composait simplement d’un cafetan de velours, de pantalons de mousseline rayée d’argent et d’une ceinture de cachemire ; mais tous les colifichets du luxe oriental complétaient sa toilette. La double rangée de sequins qui brimbalait sur sa tête, les larges bracelets d’or qui paraient ses bras, qui descendaient sur ses chevilles ; les chaînes, les pierreries qui couvraient ses mains, son corsage, qui vacillaient à l’extrémité de ses longues tresses flottantes et brillaient jusque sur sa pipe même, rehaussaient d’un charme étrange ses jeunes attraits.
Afin de mieux comprendre quel genre d’étonnement admiratif sa vue devait produire en ce moment, aux détails rapides donnés sur sa personne et ses atours, il en faudrait ajouter d’autres sur cette vieille esclave noire qui, par son âge comme par sa couleur, par sa taille courte et ramassée, par son regard terne et glauque, opposait un contraste si frappant avec la fraîche blancheur de Baïla, avec sa taille fine et souple et son regard, encore vif et pénétrant, malgré la pensée soucieuse qui alors le voilait à demi.
Pour faire ressortir, pour éclairer ce tableau, il faudrait suspendre sur la tête de ces deux femmes, si dissemblables, un peu de ce beau ciel bleu de l’Asie, et décrire, comme encadrement, quelques accidents de terrain, quelques singularités de cette végétation toute locale qui les environnait.
A quelques pas en avant du platane contre lequel s’appuyait Baïla, un petit bassin circulaire de marbre cipolin, dont le jet d’eau s’épanouissait en gerbe, faisait régner une douce fraîcheur autour d’elle ; un peu plus loin, sous son regard, deux palmiers se dressant, l’un à droite, l’autre à gauche, et confondant leurs têtes, présentaient deux colonnes surmontées d’une arcade de verdure. C’était comme l’entrée, le portique de ce réduit sacré. Mais devant cette entrée, selon toute apparence, l’ombre même d’un homme ne devait pas se montrer. Baïla appartenait à un maître jaloux ; sa beauté, entretenue avec tant d’art et de coquetterie, devait croître, s’épanouir et s’effeuiller sous les regards d’un seul.
Du pied des palmiers, partait une double haie de hêtres pourpres, de poiriers-saules argentés, de nopals aux formes bizarres, aux fleurs safranées, de symphorines, de lyciets et d’airelles, aux fruits d’albâtre, de corail et de jayet. Les périplocas, avec leurs étoiles de velours violacées, les morelles avec leurs grappes écarlates, jetaient leurs lianes au milieu des mimosas, d’où ressortaient les pompons d’or des cassies, les aiguilles d’ivoire des leucanthes, les longues étamines rouges des julibrizins. Mêlant leurs branches aux branches inférieures du platane sous lequel elle était assise, des figuiers de l’Inde faisaient descendre, comme en guirlande, sur la tête de Baïla, leurs larges feuilles creusées en coupes, et si étrangement bordées de fleurs et de fruits d’une couleur orangée mêlée de cramoisi.
Au dernier plan, derrière le platane, sur un terrain rougeâtre et sablonneux, croissaient en nombre des ficoïdes glaciales, offrant à l’œil abusé comme des plantes saisies par le givre durant un hiver de nos climats septentrionaux, et des soudes couvraient le sol de plaques cristallisées.
Le tableau devait s’animer encore.
Bientôt le grand soleil d’Orient, penché vers l’horizon, jetant obliquement ses dernières flammes sous le fronton verdoyant des palmiers, fit scintiller la terre comme si elle eût été couverte de diamants ; ses rayons, brisés au milieu des gerbes du bassin, à travers tous ces massifs de fleurs et de feuillages si divers, rejaillirent en arcs-en-ciel, en reflets d’or, de pourpre et de nacre ; ils glissèrent de l’écorce du platane à la coupe diaprée des figuiers indiens ; ils illuminèrent toute la personne de Baïla, depuis son front couronné de sequins jusqu’à ses babouches pailletées ; ils se mêlèrent même à la fumée de son narghilé, à la vapeur du moka, qui montait comme un parfum du fond d’une cassolette de porcelaine, et, sur la soyeuse peau de tigre qui lui servait de siége, semblèrent rouler de petites vagues étincelantes.
Quand le vent du soir, en se levant, agita doucement les fleurs et la verdure, mélangea toutes ces couleurs chatoyantes, toutes ces zones d’ombre et de lumière, oh ! n’était-il pas à regretter alors qu’un regard humain ne pût contempler la belle odalisque, au milieu de ces magiques lueurs, resplendissante du triple éclat de ses pierreries, de sa jeunesse et de sa beauté ?
Eh bien, ce tableau prestigieux, un homme en devait jouir, et cet homme ce n’était pas le maître !
Mariam, la vieille négresse, venait de s’endormir au pied d’un arbre, tenant encore à la main le petit mortier dans lequel au fur et à mesure des exigences de sa maîtresse, elle broyait le café ; Baïla, à moitié assoupie, tendait machinalement vers elle sa porcelaine de Chine, quand un étranger parut inopinément entre les deux palmiers.
A sa vue, l’odalisque crut d’abord rêver, puis, ensuite, retenue par un sentiment de terreur, peut-être de curiosité, elle resta en place, immobile, sans articuler un mot. Seulement, la tasse qu’elle soulevait lui échappa des mains.
L’étranger, c’était un jeune Français, après avoir fait un mouvement comme pour s’enfuir, s’enhardit, s’approcha d’elle et, la pourpre au visage, la lèvre balbutiante, soit l’effet d’une trop vive émotion, soit excès de prudence à cause de la négresse, il s’enquit simplement auprès de Baïla du chemin qui pouvait le conduire à la ville.
Il s’exprimait fort bien en langue turque. Cependant celle-ci ne put croire avoir bien compris. Quoi ! l’étranger, trompant la surveillance des gardiens, aurait franchi la double enceinte des jardins qui l’enfermaient ! il aurait bravé la mort, et tout cela pour lui demander son chemin !
Revenue au sentiment de sa situation, elle se leva d’un air irrité, tira de sa ceinture un petit poignard garni de diamants, un bijou plutôt qu’une arme offensive ou défensive, et lui fit impérieusement signe de s’éloigner.
Le jeune homme recula devant elle avec un maintien contrit, embarrassé, mais sans cesser d’attacher, d’une manière toute particulière, ses yeux sur la belle esclave. Il semblait ne pouvoir les détacher du tableau qui venait de frapper ses regards ; enfin, encore indécis et balbutiant de confuses paroles, il franchissait le portique des palmiers, quand la négresse s’éveilla tout à coup.
A la vue d’une silhouette d’homme qui s’allongeait dans l’enceinte, elle bondit sur elle-même en poussant un cri d’effroi.
— Qu’avez-vous donc, Mariam ? lui dit Baïla en se plaçant devant la négresse, sans doute par un sentiment de miséricorde envers l’imprudent.
— Mais cette ombre… ne la voyez-vous pas ? C’est celle d’un homme !
— D’un bostangi : quel autre oserait se montrer ici ?
— Mais les bostangis eux-mêmes s’en garderaient ! le maître ne leur a-t-il pas interdit l’entrée de ces jardins lorsque nous y sommes… lorsque vous y êtes ? Un homme est venu, vous dis-je ; j’ai vu l’ombre !
— Eh ! de quelle ombre parlez-vous ? Tenez, regardez.
Et Baïla s’effaça de devant la négresse.
— J’ai vu ! répéta la négresse.
— L’ombre d’un arbre ; oui, c’est possible.
— Les arbres ne courent pas, et celle-là semblait courir.
— Vous avez rêvé, ma bonne Mariam.
Et Baïla lui soutint si bien que personne n’était venu, qu’elle n’avait rien vu, sinon en songe, que Mariam, par soumission, feignit de le croire, et toutes deux se disposèrent à regagner leur logis.
Elles étaient à mi-route, lorsque, au détour d’une allée, la négresse poussa un nouveau cri, et, désignant du doigt un individu qui se sauvait à toutes jambes :
— Ai-je rêvé cette fois ? dit-elle.
Et elle allait appeler à l’aide, au secours, quand l’odalisque, lui mettant la main sur la bouche, lui ordonna de se taire. Mariam était dévouée corps et âme à sa maîtresse, elle obéit.
Rentrée dans son appartement, Baïla réfléchit à son aventure. Les aventures sont rares dans la vie du harem. Celle-là l’intriguait grandement et l’eût même inquiétée si elle n’avait eu d’autres soucis en tête.
Les soucis à leur tour vinrent occuper sa pensée.
En y songeant, elle se dépita, elle s’emporta, elle froissa les riches étoffes qui se trouvaient sous sa main. Elle pleura même, bien plus de colère que de douleur.
Depuis la veille, Baïla doutait de sa beauté ; elle était jalouse ; depuis la veille, Baïla maudissait l’existence à laquelle elle était condamnée, et regrettait les jours de sa première jeunesse.
Pour éloigner de son esprit l’idée incessante qui la tourmentait, elle essaya de remonter dans son passé. Elle y trouva, non des consolations, mais une distraction, du moins.
Le passé d’une jeune fille de dix-sept ans n’est le plus souvent que le paradis de la mémoire, un Éden radieux peuplé des doux souvenirs de la famille, et parfois d’un premier amour. Il n’en était pas ainsi de Baïla. Sa famille lui était restée indifférente, et son premier amour lui avait été imposé.
Née en Mingrélie, d’un père ivrogne et d’une mère avare, ceux-ci, la trouvant jolie de visage et bien proportionnée de corps, l’avaient, presque dès le berceau, destinée aux plaisirs du sultan.
Malgré les défenses de la Russie, aujourd’hui protectrice de cette partie du Caucase, c’est toujours là que vise l’ambition des familles mingréliennes.
L’éducation de la jeune fille avait été en rapport avec l’état qu’on lui réservait. Elle avait appris à danser, à chanter, à s’accompagner du psaltérion ; quant au reste, il n’en avait jamais été question.
Quoique ses parents professassent extérieurement un des cultes chrétiens, on s’était bien gardé de chercher à développer en elle le moindre instinct religieux. A quoi bon ? la morale du Christ ne pouvait lui donner que de fausses idées et devenait tout à fait inutile dans la carrière brillante qu’on prétendait ouvrir devant elle.
Mais si la belle enfant n’éveille autour d’elle que des sentiments de spéculation, si elle n’est aux yeux de ses proches qu’une marchandise précieuse, elle profite du moins, par avance, du bénéfice qu’elle doit rapporter.
Tandis que ses frères s’occupent sans relâche de la culture des vignes, de la récolte des vins et du miel, que sa sœur, belle aussi, mais un peu boiteuse, est condamnée à seconder sa mère dans les soins du ménage, la seule Baïla vit dans une douce indolence. Peut-on laisser en contact avec de sales fourneaux ses mains blanches et délicates, risquer de voir se briser contre de massives poteries ses ongles si bien taillés, ou permettre aux cailloux de la route de déformer ses jolis pieds ? Non, c’eût été risquer de la détériorer et de lui ôter de sa valeur.
Aussi, dans la masure paternelle, où tout le monde se meut et travaille, seule, étendue à l’ombre, n’ayant d’autre occupation que le chant et la danse, elle passe sa vie à voir couler devant elle les flots de l’Inéour, ou à regarder, avec une admiration naïve, croître et se développer sa beauté, la richesse de toute sa famille.
Pour les autres, la table commune se couvre de mets grossiers ; à elle, à elle seule sont réservés les plus délicats produits de la pêche ou de la chasse. Pour elle, ses frères se chargent de recueillir avec soin les bulbes friandes de ces orchidées qui, réduites en farine, composent ce merveilleux salep, à la fois cosmétique intérieur et substance alimentaire, dont les femmes de l’Orient se servent pour aider au développement de leur embonpoint et donner à leur peau une coloration d’un blanc rosé.
Si l’on avait à se mettre en route, Baïla, en chemise de soie, voyageait à dos de mulet, tandis que le reste de la famille, vêtue de grosse toile ou de serge, l’escortait à pied, veillant sur elle avec une constante sollicitude.
Certes, un étranger les rencontrant sur son chemin et témoin de tous ces soins et démonstrations, devait croire que c’était là une fille adorée, protégée contre le destin par les plus tendres affections !
Cependant, si son père s’approchait d’elle, c’était le plus souvent pour lui pincer le nez, qu’elle avait alors un peu trop évasé, et sa mère, comme caresse habituelle, se contentait de lui tirailler les paupières du côté des tempes, afin de donner à ses yeux la forme amande.
Quelquefois le mari, pris soudainement d’enthousiasme, après avoir vu Baïla faire montre de ses grâces en dansant le soir aux étoiles, disait à voix basse à sa femme :
— Par saint Dimétri ! je crois que l’enfant nous rapportera un jour de quoi meubler à tout jamais notre cellier de rack et de tafia !
Et un sourire de béatitude éclairait passagèrement sa face bourgeonnée.
— Si nous avions le malheur de la perdre avant le temps, répondait sa digne compagne, c’est dix mille bonnes piastres que le bon Dieu nous volerait !
Et elle essuyait une larme d’attendrissement.
Baïla venait d’avoir treize ans, quand une barque qui suivait le courant de l’Inéour s’arrêta à quelque distance de la chaumière du Mingrélien. Un homme, coiffé d’un turban, en descendit. C’était un pourvoyeur de harems, alors en tournée de ce côté.
— Vendez-vous du miel ? dit-il au maître de la chaumière, qu’il trouva sur le seuil de sa porte.
— J’en recueille du blanc et du rouge.
— En pourrais-je goûter ?
L’honnête Mingrélien lui en apporta un échantillon de chaque couleur.
— J’en voudrais voir d’une autre sorte, dit l’homme au turban, avec un coup d’œil significatif.
— Entrez alors, répondit le père de Baïla.
Et tandis que l’étranger franchissait le seuil de sa maison, courant au logement occupé par sa femme :
— Alerte ! lui dit-il, voici les noces de ta fille qui se préparent ; le marchand s’est présenté ; il est en bas ; habille-la et descends avec elle.
A la vue de Baïla, le marchand ne put retenir une exclamation admirative ; puis, presque aussitôt, par manœuvre commerciale, il hocha la tête, en feignant de l’examiner avec plus d’attention.
Pendant cette inspection, la rougeur couvrait le front de la jeune fille ; le père et la mère, cherchant à lire la pensée secrète du marchand dans ses yeux et sur son visage, gardaient un silence émotionné, priant tout bas leur saint patron pour la réussite de l’affaire.
L’homme au turban, changeant d’allure, et comme s’il n’était venu en effet que pour s’approvisionner de miel, s’empara de l’un des deux échantillons déposés sur une table, et, après l’avoir effleuré du doigt, il le dégusta.
— Ce miel est blanc et d’assez bel aspect, j’en conviens ; mais il manque de saveur. Combien la grande mesure ?
— Douze mille ! se hâta de crier la mère.
— Douze mille paras ?
— Douze mille piastres !
Le marchand haussa les épaules.
— Vous le garderez pour votre usage, bonne femme.
Puis il se leva et se dirigea vers la porte.
La femme fit signe au mari de ne point le retenir.
En effet, comme elle l’avait prévu, il s’arrêta avant de toucher au seuil, et se retournant vers le maître de la maison :
— Frère en Dieu, lui dit-il, je me suis reposé chez vous ; en échange de votre hospitalité, je vous dois un bon avis. Vous avez des enfants ?
— J’ai deux filles.
— Eh bien ! veillez sur elles, car les Lesghis sont dernièrement descendus de leurs montagnes et en ont enlevé un grand nombre dans le Guriel et la Géorgie.
— Qu’ils viennent ! répondit le Mingrélien ; j’ai trois fils et quatre fusils.
Le marchand fit encore un mouvement de fausse sortie ; puis, après avoir jeté un regard rapide sur Baïla, il leva sa main droite, en tenant ses cinq doigts écartés.
Baïla, rouge de honte, lui lança un regard de mépris et prit une attitude de reine insultée.
En faveur du regard et de l’attitude, auxquels il trouva sans doute quelque saveur, le marchand leva en plus un doigt de sa main gauche.
Le Mingrélien montra ses dix doigts, ce qui lui valut un coup d’œil courroucé de sa ménagère, qui murmura :
— C’est trop tôt !
— Le miel est cher dans votre canton, dit l’homme au turban ; je prévois qu’il me faudra, contre mon gré, en acheter aux Lesghis. Adieu, et qu’Allah vous assiste !
— On peut ne rien vendre d’un côté et ne rien acheter de l’autre, sans pour cela se tourner le dos si vite, reprit le père. Reposez-vous encore ; la rame a dû vous fatiguer les mains.
— C’est pour cela, sans doute, qu’il a tant de peine à les ouvrir, grommela la ménagère.
— Puisque vous le permettez, dit le marchand, j’attendrai ici que le soleil ait perdu un peu de sa force.
— Ne puis-je vous offrir autre chose que de l’ombre ? Je sais que les fils du prophète évitent de boire et de manger sous le toit d’un chrétien ; mais, à défaut de nourriture, vous y pouvez prendre un plaisir permis. Puisque ma fille se trouve là encore, elle va chanter pour vous distraire.
Baïla chanta en s’accompagnant du psaltérion.
L’homme au turban, assis sur ses talons, les bras croisés sur ses genoux, la tête appuyée sur ses bras, l’écouta avec une profonde et immobile attention, et quand elle eut fini, pour témoigner de sa satisfaction, il se contenta de lever silencieusement un doigt de plus.
Baïla, au son des castagnettes d’ivoire et des grelots d’argent, exécuta alors une danse expressive, voluptueusement mimée, à la manière des bayadères de l’Inde et des almés de l’Orient, mais avec plus de retenue cependant.
Forcé de regarder cette fois, l’homme au turban ne fut plus maître de déguiser l’impression ressentie par lui devant tant de grâce, de souplesse et d’agilité, et, dans un élan irréfléchi d’enthousiasme, il leva deux doigts d’un seul coup.
On était près de s’entendre.
Du reste, dans ce marché mystérieux, ce langage figuré, ces enchères muettes n’avaient d’autres motifs que de mettre les parties contractantes à même de pouvoir, devant les autorités russes, jurer, en cas de besoin, par le Christ ou par Mahomet, qu’il n’avait été question entre elles que d’une vente de miel, de fourrures ou de peaux de castor.
Après qu’on eut encore bataillé quelque temps de part et d’autre, la mère reçut enfin les dix mille piastres dans son tablier, et disparut aussitôt pour aller enfouir son trésor dans quelque cachette, sans s’inquiéter autrement de savoir si elle reverrait sa fille.
Elle partie, le marchand avisa du coin de l’œil la sœur aînée de Baïla, qui avait assisté au débat, tout en pétrissant la pâte dans une huche.
— Et celle-ci, dit-il, ne l’emmènerai-je pas aussi ?
La sœur aînée, flattée dans son amour-propre, fit la révérence.
— Elle boite, dit le père.
— Oh ! oh ! fit l’autre ; n’importe, voyons.
On parlementa de nouveau, et le Mingrélien, profitant de l’absence de sa femme, finit par céder sa seconde fille, moyennant six fusils anglais, une forte provision de poudre et de plomb, de la viande boucanée, et deux tonnes de rack. Tandis qu’il était en train, il eût volontiers vendu sa femme, encore d’assez belle conservation ; mais l’usage, d’accord cette fois avec le nouveau code russe, ne le permettait pas.
Les deux hommes venaient de se toucher dans la main, comme conclusion de ce nouveau marché, quand la mère rentra. Elle poussa d’abord des cris affreux en songeant que tous les soins du ménage allaient désormais retomber sur elle. Le marchand parvint à la calmer avec un collier de pierres fausses et quelques bijoux de cuivre doré.
Le lendemain, les deux sœurs mingréliennes arrivaient dans un petit port de la mer Noire, où elles ne devaient pas tarder à s’embarquer pour Trébizonde.
Un mois après, l’homme au turban, atteint tout à coup du désir de prendre femme pour lui, après en avoir tant fourni aux autres, épousait la sœur aînée, qui l’avait séduit par sa manière de pétrir la pâte.
Tels furent les souvenirs de famille qui s’éveillèrent d’abord dans l’esprit de la jeune odalisque, retirée, seule, boudeuse et jalouse, dans son appartement.
Elle évoqua ensuite les images de cette autre part de sa vie où l’amour devait prendre un rôle. Elle se revit à Trébizonde, dans la maison de son acquéreur, devenu son beau-frère. Là, entourée, ainsi que ses compagnes de captivité, d’égards et de bons soins, sous une surveillance minutieuse, sans être sévère, elle avait passé une année durant laquelle elle avait appris la langue turque et l’art de la toilette, tout en se perfectionnant dans le chant et la danse.
L’année écoulée, le beau-frère de Baïla s’était embarqué avec elle et plusieurs de ses compagnes, pour Constantinople.
Un beau matin, il avait fait vêtir de blanc sa gracieuse cargaison ; les cheveux avaient été lissés et parfumés et, après avoir longé les murs du Vieux-Sérail, traversé quelques rues étroites et tortueuses, marchand et marchandise s’installaient dans une chambre du bazar des esclaves.
Les idées, en Europe, sont généralement fort erronées relativement à la vente des femmes en Orient. Nos connaissances à ce sujet s’appuient essentiellement sur ce que nous en avons vu dans nos théâtres et dans quelques tableaux de genre. Mais les auteurs dramatiques et les peintres, jaloux avant tout d’arriver au pittoresque, se soucient souvent fort peu de l’exactitude.
Ceux-ci, pour ne pas diviser leur tableau en compartiments, à la manière des architectes, nous ont montré une grande salle commune où des hommes et des femmes, tous jeunes, tous beaux, demi-nus, divisés par groupes, passent sous l’inspection des premiers venus. Les promeneurs circulent à travers les galeries ; de gros Turcs, bien écrasés par leur turban, bien emmitouflés dans leur robe de cachemire, dans leur cafetan de soie, dans leurs fourrures, fument tranquillement assis dans leur coin, comme au café : il m’est arrivé même de voir dans une de ces esquisses un peu fantasques un lévrier fluet, au museau pointu, ou un bel épagneul, à la queue ondoyante, figurer là, en accessoire, comme au palais des rois, dans les grandes compositions de Rubens ou de Van-Dyck ; mais en Turquie les chiens n’ont leurs entrées nulle part.
Ceux-là, les auteurs dramatiques, poëtes ou chorégraphes, ont établi hardiment leur marché sur la place publique, devant tout un peuple de choristes, avec des chameaux de carton, pour ajouter à la couleur locale. Il est vrai que, grâce aux convenances de la scène, le costume des belles esclaves à vendre a été renforcé. A l’Opéra les acheteurs de femmes sont forcés de se contenter d’un examen très-superficiel.
Un bazar de ce genre est en réalité beaucoup moins abordable que ces messieurs auraient pu nous le faire croire. Divisé en chambres particulières, les femmes de toute couleur et de tout âge, surtout celles dont la jeunesse et la beauté rehaussent le prix, y sont parquées presque solitairement, sous la garde de leurs vendeurs. Pour pénétrer dans le sanctuaire, il faut d’abord être musulman et offrir des garanties, soit par sa position, soit par sa fortune ; car il n’est pas permis au premier curieux qui se présente de venir voir et marchander.
Baïla et ses compagnes venaient donc, dans une des salles du grand bazar de Constantinople, de prendre place sur une estrade. Chacune d’elles, désireuse d’aller régner sur le cœur de quelque puissant dignitaire de l’empire, essayait de la pose la plus favorable pour faire ressortir ses attraits, se disposait à s’armer de toutes ses grâces naturelles ou acquises, quand un petit vieillard, au turban maigre et délabré, en cafetan sans broderies, sans fourrures, passé de mode comme son maître, s’introduisit presque furtivement dans la chambre.
C’était un Arménien renégat qui avait fait sa fortune en administrant les biens d’un ancien vizir dont il était le trésorier ou khasnadar.
Tant qu’il avait été au service de celui-ci, notre homme s’était bien gardé de laisser entrevoir ses richesses, et la maîtresse femme, épousée par lui avant son apostasie, n’avait jamais souffert qu’il lui donnât une rivale.
Par un double coup du sort, sa femme était morte, en même temps que son vizir, disgracié, partait pour l’exil.
Redevenu libre des deux côtés, l’Arménien ne craignait plus de mettre au jour son or et sa convoitise amoureuse, qu’il avait si bien tenus cachés, l’un et l’autre, pendant trente ans.
Quoiqu’il fût un peu tard, il avait résolu de recommencer sa jeunesse, de vivre pour le plaisir et de s’organiser un harem. Aussi, en ce moment, se frottant les mains, la figure allumée, ses deux petits yeux gris flamboyant comme des escarboucles, il rôdait autour de l’estrade comme un renard à jeun autour d’un poulailler.
A sa vue, les belles jeunes filles avaient frémi. En rêvant d’amour, chacune d’elles sans doute avait vu dans son heureux possesseur un beau jeune homme, au front large, au port majestueux, à la barbe noire et luisante ; et le ci-devant khasnadar du vizir semblait n’avoir même jamais dû posséder aucun de ces heureux dons de nature.
Peu soucieuses d’un tel chaland, au lieu de leur doux sourire, de leurs gracieuses poses méditées, elles prenaient à qui mieux mieux un air refrogné et maussade, quand le petit vieillard s’arrêta devant Baïla, qui aussitôt devint tremblante et se sentit prise d’une violente envie de pleurer.
Néanmoins, elle fut forcée de se lever, de marcher, et malgré toute la mauvaise grâce qu’elle y put mettre, le khasnadar la trouva charmante. Il s’approcha d’elle, il regarda ses pieds, ses mains, il inspecta ses dents, puis ensuite, prenant le marchand à part :
— Ton prix ? lui dit-il.
— Vingt mille piastres !
Le khasnadar fit un bond en arrière ; ses lèvres se crispèrent comme celles d’un babouin qui vient de mordre dans un citron aigre. Il recommença à tourner autour de l’estrade ; il examina, l’un après l’autre, tous ces beaux fruits de la Géorgie et de la Circassie, étalés à ses regards ; puis, de nouveau, il s’arrêta devant Baïla.
Celle-ci, feignant de croire qu’il voulait encore lui visiter la bouche, tira la langue et lui fit la grimace.
Cette démonstration n’attiédit en rien les feux du client. Il se rapprocha du marchand, et quand ils eurent chuchoté quelque temps, assis, les jambes croisées, celui-ci se leva en disant :
— Par l’ange Gabriel ! j’avais bien promis cependant à ma femme, dont c’est la propre sœur, de ne la céder qu’à vingt mille, pour l’honneur de la famille.
Baïla, à qui l’on remit son voile sur la figure, comprit que le marché était conclu, et, cessant de se contenir, éclata en sanglots.
Aussitôt, la porte de la salle est poussée brusquement. Un homme, à la haute stature, au regard impérieux, entre et va droit vers la désolée ; il relève le voile, ce voile qui peut cacher ses pleurs, mais non amortir ses cris.
— Combien cette esclave ? demande-t-il.
— Elle est à moi, dit le khasnadar.
— Combien ? répète l’autre.
— Mais je suis l’acquéreur, et non le marchand, reprend le petit vieillard en se dressant sur la pointe de ses pieds, pour essayer de se grandir à la taille de son interlocuteur.
Celui-ci le toisa du haut en bas d’un air de mépris.
— Je viens d’en faire l’acquisition au prix de dix-neuf mille piastres.
— Vingt mille ! objecta le vendeur.
— J’en offre vingt-cinq, dit le dernier venu en rejetant aussitôt le voile sur la figure de Baïla.
Le marchand s’inclina ; le khasnadar, pâle de colère, se contint cependant, car il avait déjà reconnu dans son concurrent Ali-ben-Ali, surnommé Djezzar, pacha de Sivas.
C’est ainsi que la jeune fille, après avoir été, en premier lieu, vendue par son père, le fut une seconde fois par son beau-frère.
Djezzar-Pacha, qu’un léger démêlé avec le divan avait momentanément appelé dans la capitale de l’empire, emmena sa belle esclave dans sa résidence ordinaire, et tout d’abord elle occupa la première place dans son cœur.
La joie qu’elle ressentit de se voir élevée au-dessus de toutes ses rivales ne tint pas seulement à une pensée d’orgueil : elle croyait aimer Djezzar.
Quoiqu’il ne fût plus de la première jeunesse, et que la sévérité de son aspect inspirât parfois à Baïla un sentiment plutôt de terreur que d’amour, dès le premier regard qu’elle avait jeté sur lui au bazar de Constantinople, la comparaison qu’elle avait eue à faire entre lui et le vieux khasnadar avait été si bien à son avantage qu’elle l’avait trouvé jeune et beau. Depuis, il s’est montré si généreux, si fortement épris, il s’est plié à ses caprices, à ses fantaisies, avec une si tendre indulgence, que, fermant l’oreille aux bruits qui courent autour d’elle, elle le croit bon et patient.
Cependant, si elle est la première dans l’amour du pacha, elle n’est pas la seule ; Djezzar ne se pique pas d’une inaltérable fidélité. Aujourd’hui même, une fille d’Amassia est entrée dans son harem, et les femmes d’Amassia passent pour être les plus belles de toute la Turquie. Qui sait si le sceptre de la beauté ne va pas bientôt changer de mains ! Une autre ne peut-elle inspirer à Djezzar un amour plus violent encore que celui que lui a fait éprouver Baïla ?
Telles étaient les idées qui préoccupaient si tristement la jeune odalisque, lorsque tantôt, se promenant dans les jardins, elle jetait à la dérobée des regards jaloux vers ces bâtiments, à grillages dorés, qui renfermaient sa nouvelle rivale.
Maintenant, son cœur s’est raffermi, son esprit s’éclaire de plus douces lueurs. Le tableau de sa vie entière, qui vient de repasser devant elle, ne lui démontre-t-il pas que sa beauté doit être incomparable, puisque, après avoir apporté l’aisance dans la maison de son père, elle avait été pour son beau-frère l’objet d’une spéculation qui avait dépassé son espérance même ? Au bazar des femmes, deux acheteurs s’étaient seuls présentés, et tous deux, malgré le choix qui leur était offert, s’étaient disputé sa possession.
Mais ce qui, plus que tout le reste, lui paraît devoir prouver sa puissance, c’est l’audace de ce jeune Franc qui, pour la voir, franchit, au risque de sa vie, l’enceinte redoutée du palais de Djezzar ; qui, en la voyant, se trouble d’admiration au point d’en perdre la raison ; qui, après l’avoir vue, veut la revoir encore, et, de nouveau, se place audacieusement sur son passage.
Ah ! comment n’a-t-il pas craint que la mort ne fût le prix de sa témérité ? Il ne l’a pas craint parce qu’il l’aime, et que c’est ainsi qu’aiment les Français. N’a-t-on pas vu le plus célèbre d’entre eux, Napoléon, leur sultan, à la tête d’une armée, conquérir l’Égypte pour y chercher une belle femme dont un rêve envoyé par Dieu lui avait révélé le pays et la beauté[1] ? C’est par un rêve peut-être aussi que le jeune Français a eu la révélation des charmes de Baïla ! Peut-être l’avait-il déjà aperçue lors de son séjour à Trébizonde, ou de son passage à Constantinople ! N’importe ! c’est à lui qu’elle doit de se sentir forte et rassurée aujourd’hui.
[1] Cette croyance est encore fort répandue parmi le peuple, en Arabie, en Égypte et en Turquie.
Que Djezzar prodigue ses passagères amours d’une nuit à la fille d’Amassia ! demain il reviendra à la Mingrélienne.
Et Baïla s’endormit en songeant au jeune Français.
Éprouvait-elle déjà pour lui un de ces amours inexplicables qui parfois naissent spontanément dans le cœur des recluses ? Nullement : avec son costume étriqué, son menton imberbe, elle l’avait trouvé fort peu séduisant, et ce n’est point par son éloquence qu’il avait pu la charmer ; mais elle croyait lui devoir de la reconnaissance. D’ailleurs, peut-être voulait-elle essayer de se venger de Djezzar, même durant son sommeil.
Le lendemain, de grand matin, toujours suivie de Mariam, Baïla parcourait de nouveau les jardins, sous prétexte de faire disparaître les traces de l’inconnu, s’il en avait laissé. Le vent et la nuit les avaient fait disparaître sur ces sentiers recouverts de sable fin.
Néanmoins, en se rapprochant de la rivière Rouge, elle retrouva la marque d’une botte fraîchement imprimée sur la terre d’une plate-bande. Le pied était petit, étroit et la forme en était gracieuse.
Baïla hésita à en effacer l’empreinte.
Pourquoi ?
Décidément l’étranger lui parlait au cœur ?
Non ! caprice de femme, et, parmi les femmes, les odalisques sont peut-être plus énigmatiques encore que les autres.
Après avoir entrepris cette nouvelle excursion à cette fin d’effacer toute trace du passage du Franc, elle se sentait possédée de la tentation de respecter la seule qui fût restée de lui.
Cette empreinte, que n’avaient pu laisser les bostangis, avec leurs larges sandales à semelles de bois, et que le pied du pacha eût débordée à grande marge, qui, par conséquent, devait révéler la tentative de la veille, elle voulait la conserver… Qui sait ! peut-être son imagination, surexcitée par ses idées de reconnaissance, à la vue de cette forme élégante, imprimée sur le sol, donnait-elle un démenti à ses yeux, en revêtant l’étranger d’un charme que, dans son premier mouvement de frayeur, elle n’avait pas su reconnaître d’abord ; peut-être, aveuglée par le dépit, Baïla désirait-elle que Djezzar vît cette marque dénonciatrice, pour que sa jalousie s’en alarmât, et qu’il souffrît aussi, lui, dans son orgueil et dans son amour !
La vieille négresse lui fit observer que, dans le cas où l’inconnu serait assez téméraire pour revenir encore, le pacha, ses soupçons une fois éveillés, le ferait saisir infailliblement, ce qui ne pourrait que les compromettre toutes deux.
La Mingrélienne céda alors. Mais, par un nouveau caprice de son esprit, elle ne voulut pas souffrir que Mariam remuât la terre à cette place. Elle se contenta d’apposer à plusieurs reprises son pied délicat et menu sur l’empreinte de celui de l’étranger ; et cette double trace resta longtemps ainsi, protégée qu’elle était contre les regards par le feuillage surabondant et penché d’un azalea pontique.
Cette sorte d’arbuste croît en grand nombre sur les versants du Caucase, et Baïla, enfant, l’avait vu fleurir dans son pays natal. Elle se prit d’affection pour ce petit espace qui lui parlait de sa patrie et de son second et mystérieux amant. Sa patrie, elle l’avait quittée sans nul regret ; ce jeune Français, ce giaour, il n’avait d’abord été pour elle qu’une surprise, une apparition, un rêve, et maintenant son cœur blessé demande un aliment à ce double souvenir.
Pendant tout un mois, ses promenades se dirigent de ce côté ; c’est là qu’elle vient rêver de son pays et de l’étranger ; de l’étranger surtout !
L’aime-t-elle enfin cette fois ? Qui pourrait le dire ? Qui oserait donner le nom d’amour à ces lueurs trompeuses nées dans le cerveau d’une jeune fille de la fermentation des idées, comme les feux follets de celle de la terre ; à ces fantômes d’un instant dont se peuplent les solitudes livrées à la vie contemplative ?
En Europe, les religieuses, quoique vivant sous un régime bien différent, reportent toutes les tendresses passionnées de leur âme vers Dieu ; chacune d’elles cependant trouve encore moyen d’en ménager une portion pour quelque sainte image de son choix, pour quelque relique cachée, qui n’appartient qu’à elle ; elle lui adresse ses prières secrètes, elle la parfume d’un encens qu’elle détourne du grand autel : c’est son culte à part.
En Orient, d’autres cloîtrées, les odalisques, n’ont de culte que l’amour, et dans les élans de cet amour, elles ne doivent aussi se prosterner que devant un seul ; mais là, comme ailleurs, l’idole se cache dans l’ombre du temple ; on a ses fétiches, on a ses rêves, ses amours frauduleuses, ses amours de tête, comme on dit. C’est peut-être un besoin de la nature humaine de donner ainsi un contrepoids à ses penchants les plus décidés pour maintenir l’âme en équilibre ; de protester tout bas contre ce qu’on adore tout haut, d’opposer une ombre à la réalité.
Il est vrai qu’en fait d’amants, quelquefois l’ombre prend un corps et la réalité se vaporise.
Quoi qu’il en soit, Djezzar était revenu à Baïla, et celle-ci, plus sûre désormais de sa puissance, lui avait fait expier par ses bizarreries, par ses exigences, sa dernière infidélité. On s’émerveillait, dans le harem, de voir le pacha de Sivas, devant qui tout tremblait, plier devant cette jolie esclave si frêle, si blanche, si délicate, qu’il eût pu briser d’un geste ou d’un souffle.
Le bruit en retentit même dans la ville et l’on s’y disait tout bas que si Baïla le voulait, Djezzar se ferait juif.
C’était cependant un terrible homme qu’Ali-ben-Ali, surnommé Djezzar, c’est-à-dire le Boucher. D’abord icoglan au sérail de Constantinople, quoique élevé par Mahmoud, il n’avait participé en rien aux améliorations civilisatrices que celui-ci avait tenté de faire pénétrer dans son empire. Le décret de Gulhané l’avait de même trouvé récalcitrant devant toute réforme. Assuré dans le divan d’une protection qu’il savait reconnaître, il conservait en lui le type pur des anciens pachas, dont ses prédécesseurs et homonymes, Ali de Janina et Djezzar d’Acre, avaient été les parangons.
Il semblait surtout redoubler de barbarie depuis qu’un vent philanthropique, venu d’Europe, essayait de souffler la tolérance sur son pays.
S’adjugeant à lui seul le double métier de juge et de bourreau, grâce à sa justice expéditive, les arrêts émanés de son tribunal étaient aussitôt exécutés que rendus ; quelquefois même, le supplice précédait le jugement.
On citait de lui mille traits qui tendaient à prouver clairement qu’en Turquie, Djezzar était resté de l’ancien régime.
Un aga avait prévariqué. Le pacha, ne pouvant alors s’occuper par lui-même du châtiment du coupable, en ami de la prompte et bonne justice, avait ordonné à un jeune effendi, son secrétaire, de se transporter immédiatement au domicile du prévaricateur, et de lui arracher un œil. Le jeune homme hésitant et s’excusant sur son inexpérience : Approche, lui avait dit Djezzar ; et quand le pauvre effendi s’était approché, le pacha, avec une dextérité merveilleuse, lui plongeant brusquement le doigt dans un des coins de la paupière, lui avait fait saillir le globe de l’œil hors de l’orbite, puis, par un rapide mouvement de torsion, et au moyen de l’ongle, l’opération s’était trouvée faite.
— Esclave, tu sais comment t’y prendre, maintenant obéis ! lui avait-il dit ensuite.
Et la pauvre victime, à peine pansée et toute saignante, avait été contrainte, sous peine de la vie, d’aller faire subir à l’aga le supplice qu’elle venait de subir elle-même.
Nul n’excellait comme lui à faire sauter une tête d’un revers de yatagan. Il est vrai que nul autant que lui n’en avait la pratique.
On parlait à Sivas d’un trait d’adresse dans ce genre qui lui avait fait le plus grand honneur.
Deux paysans arabes, fellahs, accusés d’un meurtre, lui ayant été amenés, et chacun d’eux rejetant le crime sur l’autre, Djezzar s’était trouvé un moment en perplexité. Il était possible qu’un des deux fût innocent. Manquant de lumières à cet égard, et n’étant guère d’humeur à attendre pour s’en procurer, il imagina un moyen ingénieux et prompt de s’en remettre au jugement de Dieu.
Sur son ordre, les deux accusés sont attachés dos à dos, par le corps et par les épaules ; il tire son sabre : la tête qui va tomber doit être celle du coupable.
Voyant la mort si prête, les deux misérables luttent entre eux à qui évitera de se trouver sous la main de l’exécuteur ; ils tournent, ils pivotent, chacun essayant de placer son compagnon du côté où le coup doit porter. Djezzar prit quelque temps plaisir à la manœuvre ; puis enfin, après avoir prononcé trois fois le nom d’Allah, il fit décrire un large cercle à sa lame damassée, et les deux têtes volèrent du même coup.
Malgré sa gravité habituelle, le pacha ne put s’empêcher de rire de ce résultat inattendu ; il en rit à gorge déployée, ce qui ne lui était peut-être jamais arrivé de sa vie, et à ses bruyants éclats de rire se mêlèrent les soupirs rauques et haletants d’un lion enfermé dans une pièce voisine, et qu’alléchait l’odeur du sang.
Ce lion, c’était le favori du maître. Depuis longtemps, l’usage parmi les pachas de Sivas, comme parmi d’autres pachas de l’Asie, voulait qu’ils se montrassent accompagnés d’un lion dans toutes les occasions solennelles. Galib, prédécesseur de Djezzar et grand partisan de la réforme, en avait eu un monstrueux, qu’il nourrissait spécialement de janissaires ; le bruit courait que le fanatique Djezzar aiguillonnait de temps en temps l’appétit du sien par de la chair chrétienne.
Eh bien ! cet homme farouche, qui professait le métier de bourreau, qui ne riait qu’aux têtes coupées, qui, selon les dires publics, jetait de la chair humaine à son lion Haïder, il connaissait l’amour ; non sans doute l’amour galant, musqué, l’amour de boudoir ; mais doué d’un tempérament énergique et voluptueux, il passait au milieu de son harem tout le temps que lui laissaient les affaires, et, en Orient, quelle que soit la complication des événements, l’administration, surtout sous un maître pareil, est réduite à une telle simplicité que les loisirs ne manquent jamais.
Djezzar pouvait dire avec Orosmane :
Zaïre, c’est-à-dire Baïla, l’attendait à la sortie de son conseil. Surtout dans son palais d’été de Kizil-Ermak, la rivière Rouge, il passait la plus grande partie de la journée étendu sur des coussins aux pieds de sa belle esclave, fumant les roses de Taif et d’Andrinople, mêlées au tabac de Malatia ou de Latakié, y glissant parfois une feuille de haschich, un grain d’opium ou même d’arsenic, pour s’exalter l’imagination.
Parfois, Baïla fumait dans le houka, et comme ils étaient là tous deux, plongés dans cet assoupissement plein de rêves, causé par les sucs du chanvre de l’Inde et du pavot d’Aboutig, l’un s’ouvrant par avance le séjour des houris célestes, l’autre revoyant peut-être son audacieux étranger, il arrivait qu’Haïder, le lion du maître, rentrant ses ongles, venait familièrement s’allonger auprès d’eux.
Baïla s’appuyait alors nonchalamment du coude sur le terrible animal à l’ondoyante crinière, tandis que le pacha laissait tomber nonchalamment sa tête sur les genoux de l’odalisque. Et c’était encore un tableau à contempler que celui de cette gracieuse jeune femme, vêtue de gaze, reposant doucement entre ces deux bêtes féroces.
Elle ne redoutait ni l’une ni l’autre. Le lion, comme l’homme, était dompté. Tous deux aujourd’hui obéissaient à sa voix, à son regard.
Dans les premiers temps, malgré la passion violente de Djezzar, Baïla avait pu douter de la durée de sa puissance, surtout en songeant à la favorite qui l’avait précédée.
Cette favorite, après un règne de trois ans, ayant osé insister en sollicitant la grâce d’un bostangi, condamné à la mutilation de la main, pour avoir pêché frauduleusement, la nuit, dans les viviers du pacha, celui-ci, dans un mouvement de vivacité, avait coupé le nez de sa belle Aysché, et, peu soucieux ensuite de la garder dans cet état, il avait complété le châtiment du bostangi infidèle et de l’esclave récalcitrante en les mariant l’un à l’autre. Un champ, situé aux bords de la ville, leur avait été donné comme dot.
Aujourd’hui, Aysché vendait elle-même ses légumes au marché, sur la place du Méïdan, où elle était connue sous le nom de Bournou-sez (Sans-Nez).
Cet exemple de l’instabilité du pouvoir des favorites avait cessé d’inquiéter Baïla depuis que le chrétien lui avait révélé à elle-même le secret de ses forces. D’ailleurs, lors de l’événement, Aysché n’était plus jeune, et tout donnait lieu de penser que sa beauté décroissante avait plus que tout autre motif excité la colère du maître.
Baïla avait dix-sept ans, une tête géorgienne sur un corps circassien, une voix de sirène, des pieds de nymphe ; qu’avait-elle à craindre ? Sa volonté était devenue celle du pacha. Tout entier à son amour cimenté par l’habitude, celui-ci semblait ne songer à ses autres odalisques que lorsque la Mingrélienne, par caprice ou par méchante humeur, se mettait en révolte ouverte contre ses désirs. Alors, devant la rebelle, Djezzar ordonnait à un esclave de porter à la beauté qu’il désignait une pièce d’étoffe qui, dans la coutume orientale, annonce la visite prochaine du maître, et que, dans notre façon de traduire les mœurs turques, nous avons amoindrie par cette locution, devenue française, de jeter le mouchoir.
Naguère encore, à l’idée de cette infidélité qui allait lui être faite, Baïla se dépitait, boudait dans un coin d’un air revêche ; sa jolie bouche, relevée aux extrémités de l’arc, murmurait des plaintes et des menaces inintelligibles ; ses beaux yeux noirs, aux longs cils vibrants, se fermaient à moitié, et, la tête basse, les prunelles rejetées à l’angle de la paupière, elle prolongeait en dessous sur l’esclave, sur le maître, et même sur la brillante pièce d’étoffe, un regard plein de colère et de jalousie. Là se bornait son audace.
Aujourd’hui, quand Djezzar, pour se venger d’elle, se met en velléité d’inconstance, Baïla se jette sur l’étoffe et sur l’esclave, déchire l’une, griffe l’autre, et si l’omnipotent pacha poursuit sa vengeance jusqu’au bout, il arrive souvent, le lendemain, que pour prix de leur double soumission, l’esclave, sous le premier prétexte venu, reçoit la bastonnade, et la favorite d’un jour, chassée honteusement, trop heureuse de ne pas laisser, comme Aysché, son nez au seuil du palais, est envoyée au bazar pour devenir la propriété du plus offrant et dernier enchérisseur.
Tel avait été dernièrement le sort de la belle fille d’Amassia.
Fière de l’empire exercé par elle sur son maître, Baïla s’enivrait du triomphe de sa vanité. Au milieu de ces fumées, le souvenir de l’étranger, du giaour, sans s’effacer entièrement, ne lui arrivait plus qu’à de longs intervalles.
Depuis toute une semaine, elle était restée enfermée, sans descendre dans les jardins, lorsqu’un jour que Djezzar était allé lever quelques impôts, tout en chassant au faucon, reprenant ses anciennes promenades, elle se trouva, sans trop y songer, devant l’azaléa pontique.
— Qu’était devenu ce jeune Franc ? Habitait-il encore le pachalik de Sivas ? Nourrissait-il le projet d’une seconde tentative, ainsi qu’avait semblé le prévoir Mariam ? Sans doute il était parti ; il avait rejoint son pays, ce singulier pays de France, où, dit-on, les femmes ont le pas sur les hommes ; elle ne le verrait plus ; tant mieux ! Il était capable de trop oser pour elle comme pour lui.
Comme elle était dans ces réflexions, un rugissement d’Haïder se fit entendre du dehors ; il annonçait le retour du pacha. Celui-ci l’avait fait traîner à sa suite pour se donner le plaisir, chemin faisant, de le lancer sur quelque chacal. Elle se disposait à rentrer dans ses appartements pour s’y trouver à l’arrivée de Djezzar, lorsqu’un coup de feu retentit, et une sourde rumeur s’éleva du côté de la rivière Rouge.
Baïla tressaillit, sans pouvoir se rendre compte du motif de son émotion.
— Avez-vous fait bonne chasse ? dit-elle à Djezzar quand ils se retrouvèrent seuls.
— Pas mauvaise, répondit celui-ci ; mon faucon a pris trois faisans, et moi j’ai tué un chien.
Baïla n’osa l’interroger sur le sens douteux que ce mot pouvait avoir dans la bouche d’un musulman aussi orthodoxe que l’était Ali-Ben-Ali.
Le soir, quand Mariam vint rejoindre sa maîtresse, après avoir hésité dans la confidence qu’elle avait à lui faire, après dix exclamations préparatoires, elle la mit au courant de l’événement du jour.
Comme le pacha revenait vers le palais, et que son escorte de chasse longeait le Kizil-Ermak, vers l’endroit même où il sert de seconde enceinte à la résidence du maître, Haïder, qu’un esclave tenait en laisse, s’était arrêté obstinément devant un buisson, rugissant sourdement, ce qui avait attiré l’attention de Djezzar.
Le buisson battu par les gens de la suite, un homme s’en était échappé, fuyant avec rapidité vers la rivière qu’il avait tenté de traverser à la nage ; mais avant qu’il eût pu atteindre l’autre rive, le pacha, saisissant un fusil des mains d’un de ses cavaliers delhi-bachs, avait visé le fuyard avec une telle sûreté d’œil et de main, que, frappé à la tête, le malheureux avait disparu aussitôt, entraîné par le courant. Cet homme était un chrétien, mais un chrétien d’Asie, comme en témoignait suffisamment son bonnet kastan de mousseline bleue, lisérée clair. D’ailleurs, au dire du pacha, le cri d’Haïder eût pu suffire à dénoncer à quel culte il appartenait.
— Quoi qu’il en soit de son pays et de sa religion, dit Mariam en terminant son récit, il est mort, mort sans qu’on ait pu deviner quel motif l’avait conduit à se cacher de ce côté, aux abords mêmes du palais.
— Aux abords des jardins, interrompit alors Baïla, qui avait écouté le récit de sa vieille négresse sans l’interrompre un seul instant, et même sans paraître grandement s’en émouvoir. C’est par les jardins, reprit-elle, qu’il voulait pénétrer, comme il avait fait déjà.
Mariam la regarda avec surprise.
— Oui, poursuivit la Mingrélienne, cet homme qu’ils ont tué, c’est lui, c’est ce jeune Franc qui sans doute s’était travesti pour ne pas trop attirer l’attention sur lui, par son costume d’Européen.
Mariam garda le silence.
— N’est-ce pas là aussi ta pensée ?
Après quelques paroles à peine articulées :
— Qui peut le savoir ? dit la négresse.
— Toi, reprit Baïla ; je parierais que tu en sais plus que tu ne m’en as raconté.
— J’avoue, ajouta Mariam après une derrière hésitation, qu’un des delhi-bachs, témoin de l’affaire, a répété devant moi que le fugitif lui avait semblé avoir le visage d’une grande blancheur pour un Asiatique.
— Tu vois bien, Mariam, dit nonchalamment Baïla, tout en caressant l’éventail de plumes qu’elle tenait à la main.
— S’il en est ainsi, reprit la négresse, je plains le sort du pauvre jeune chrétien ; mais du moins nous voilà hors de danger et je pourrai dormir maintenant ; car depuis sa double apparition dans le jardin, je n’ai fermé l’œil qu’à moitié. Je craignais toujours une imprudence de sa part… ou de la vôtre !
— Peureuse !
Et Mariam aida Baïla à disposer sa toilette de nuit.
Au petit jour, la Mingrélienne quitta sa couche solitaire ; car Djezzar s’était reposé, seul aussi, de son côté, des fatigues de la chasse ; elle alla réveiller sa négresse et toutes deux descendirent au jardin. Baïla donnait pour prétexte à sa promenade le besoin de respirer l’air frais du matin.
Elle se dirigea d’abord vers le kiosque, puis vers le plateau sur lequel elle s’était assise naguère ; elle jeta un coup d’œil autour d’elle, sur les massifs de fleurs et d’arbustes, sur le petit bassin de marbre cipolin, et son regard s’arrêta quelque temps attentif sur les deux palmiers, comme si, entre leurs colonnes, sous leur verte ogive, quelqu’un devait se montrer encore.
Puis alors, elle marcha vers l’endroit où l’azaléa couvrait de son ombre et de ses fleurs la dernière trace de l’étranger ; elle brisa une de ses branches, l’effeuilla, la rompit en deux, mit les fragments en croix, au moyen d’un cordon emprunté à la pelisse qui la couvrait ; puis cette croix, elle l’implanta sur l’empreinte déjà aux trois quarts effacée.
Tout cela fut fait par elle sans affectation de sentiment, d’un air calme et presque dégagé.
A la vue de cette croix, Mariam, née chrétienne, en Abyssinie, où le culte catholique est généralement suivi, se signa, après avoir toutefois jeté un regard d’inspection autour d’elle. Baïla se contenta de pousser un soupir, soupir de l’enfant qui voit finir un jeu dont il s’est doucement préoccupé durant quelques instants ; ensuite, elle regagna le pavillon isolé où étaient situés ses appartements, le front incliné et pensif ; mais songeant peut-être à tout autre chose qu’à l’étranger.
Cependant, à partir de ce moment, maussade et fantasque avec Djezzar, elle n’eut plus ni de ces caresses si douces, ni de ces chants mélodieux, ni de ces danses enivrantes qu’accompagnait le bruit cliquetant des castagnettes, et qui semblaient faire s’ouvrir pour lui les portes du septième ciel. Elle finit par l’irriter si bien par ses redoublements de caprices, de bizarreries et de refus, qu’il la quitta une fois haletant de fureur, et resta trois jours entiers sans vouloir entendre parler d’elle.
Vers le milieu du troisième jour, on vint lui dire que, dans l’appartement de la favorite, on entendait s’élever un bruit terrible, des cris de femme mêlés à des rugissements de lion.
Djezzar y envoya, mais ne voulut pas y aller lui-même.
Quand on accourut au secours de la Mingrélienne, on la trouva enfermée seule avec Haïder. Le riche tapis du Khorassan, qui garnissait le plancher de sa chambre, était déchiré en lambeaux, par places, et tout parsemé de débris de baguettes de cerisier.
Ces lambeaux et ces débris indiquaient les endroits où la lutte s’était renouvelée entre l’odalisque et le lion.
Après l’avoir attiré dans son pavillon, Baïla lui avait fermé toute retraite, et, sans souci de ce qui pouvait résulter pour elle, armée d’un léger faisceau de narguilés, elle en était venue à le frapper à coups redoublés, renouvelant résolûment chaque baguette qui se brisait sur le corps de son dangereux adversaire.
Celui-ci, habitué à obéir à cette voix qui le gourmandait, à se courber sous ce bras qui le frappait, sans songer à se défendre, bondissait d’un bout à l’autre de la chambre, emportant à chaque bond, sous ses ongles crispés, un lambeau du tapis ; mais enfin, à bout de patience et de longanimité, irrité par la douleur, rugissant, pantelant, couché à moitié sur sa croupe et sur son dos, levant une de ses pattes monstrueuses, il détendait sa griffe tranchante et devenait menaçant à son tour, quand tout à coup entrèrent les bostangis et les estafiers du pacha, munis d’épieux.
La porte ouverte, le lion s’enfuit honteusement, non devant les nouveaux venus, mais devant la Mingrélienne, qui le pourchassait encore de son dernier rameau de cerisier.
Le soir de ce même jour où Baïla avait excité contre elle les colères royales de son lion, ce terrible animal, brisé, dégradé par la domesticité, vint, comme le chien le mieux appris, confus et repentant, ramper aux pieds de sa maîtresse en implorant son pardon.
Dès le jour suivant, il en fut de même de Djezzar. La favorite le vit se rapprocher d’elle, humble et les mains pleines de présents.
La lutte de Baïla contre Haïder, dont on lui avait rendu compte, l’avait rempli d’une singulière admiration pour celle-ci.
Baïla reçut ses deux vaincus avec une dignité froide qui pouvait passer pour un reste de rigueur.
C’est que sa double victoire la trouve indifférente. Elle a épuisé toutes les émotions qu’il lui était donné de connaître ; elle a si bien éloigné ses rivales, que le triomphe ne chatouille même plus sa vanité ; les esclaves qui l’entourent lui sont si bien soumis, qu’elle n’a plus de joie au commandement. Le pacha est dompté, dompté jusqu’à la faiblesse, jusqu’à la lâcheté ; chacun, même le lion, subit la puissance de la favorite, et d’un accord tellement unanime, que dans ce harem, où tout se prosterne devant elle, où tout court au-devant de sa volonté, de son caprice, il n’est plus qu’un seul ennemi qu’elle ne puisse vaincre ; c’est l’ennui ! Celui-là menaçait de grandir d’heure en heure, et de se fortifier de la faiblesse des autres.
Le pacha se rendait le jour même à la ville ; Baïla consentit à l’accompagner, et après avoir séjourné peu de temps à Sivas, à peine de retour au palais de Kizil-Ermak, elle se montra toute différente de ce qu’elle était à son départ ; la gaieté, la vivacité lui étaient revenues ; le rire aux lèvres, la joie aux yeux, elle avait retrouvé ses chants les plus doux, comme ses danses les plus gracieuses. Elle fut charmante pour Djezzar, et même pour Haïder. On eût dit qu’elle s’était spontanément métamorphosée en route.
La belle humeur de la favorite se communiquant au pacha, et, par lui, gagnant de proche en proche, tout fut en fête au palais ce soir-là.
De cette joie générale, Baïla seule avait le secret.
Enfermée dans son palanquin, à la suite du maître, comme elle longeait, avec l’escorte, un des faubourgs de Sivas pour retourner vers la rivière Rouge, et qu’elle prenait plaisir à voir les habitants, turcs ou chrétiens, fuir pêle-mêle, en désordre, se cacher ou se prosterner à l’aspect du pacha, elle en avait remarqué un qui, resté debout et immobile, semblait ne participer en rien aux diverses émotions de la foule.
Baïla s’étonne d’abord que les gardes du cortége, les cawas, ne le forcent pas à prendre une posture plus humble ; elle l’examine avec plus d’attention et tressaille. Il porte le costume franc et, autant qu’elle en peut juger à travers son double voile et les mousselines semées d’étoiles d’or du palanquin, ses traits sont ceux de l’inconnu.
Par un mouvement plus rapide que la pensée, voiles, rideaux, tout se soulève en même temps ; c’est lui ! leurs deux regards se rencontrent. L’étranger se trouble, sans doute ébloui de nouveau par l’éclat resplendissant de tant de beauté ; puis, avec une expression pleine d’amour, il lève ses yeux au ciel, place une main sur son cœur : bientôt, dans cette main, il agite, en manière de signal, un petit objet brillant, doré, sur lequel le soleil jette un éclair, mais que Baïla ne peut reconnaître, car déjà ses rideaux sont retombés.
Cette scène imprudente, audacieuse, passée au milieu de la foule, n’eut cependant pas de témoin ; tous les spectateurs étaient en fuite ou le front contre terre.
Durant le reste de la route, Baïla crut avoir rêvé. Quoi ! cet étranger, il n’était pas mort ! il n’avait pas été dénoncé par Haïder et tué par Djezzar ! Elle a donc été injuste et cruelle envers ceux-ci ? Elle leur devait une réparation. Peut-être le Franc avait-il été seulement blessé ? D’une blessure bien légère alors, puisqu’elle ne l’a pas empêché de se trouver sur son passage tout à l’heure. Pourquoi légère ? n’était-il pas capable, pour la voir, d’endurer la douleur, lui qui ne craignait pas de tout braver pour arriver jusqu’à elle ? Mais quel objet a-t-il donc fait briller à ses yeux, la main sur son cœur et le regard au ciel ? Sans doute un présent qu’il voulait lui faire, qu’il espérait pouvoir jeter dans son palanquin comme souvenir. Elle avait trop tôt laissé retomber ses mousselines étoilées d’or. Ou plutôt n’est-ce pas quelque bijou à elle, quelque joyau détaché de sa parure et trouvé par lui au pied du platane ou dans les allées du jardin ? Oui, et il le conserve comme une relique précieuse, comme un amulette préservateur, qu’il garde sur son cœur, car c’est de là qu’il l’a tiré, c’est là qu’elle l’a vu le replacer après son transport d’amour.
Elle se demande ensuite ce que peut être parmi les Francs ce jeune homme resté debout, dans une attitude si fière, sur le passage du pacha, et que cependant les cawas ont semblé respecter. Oh ! bien des secrets lui restent encore à pénétrer. N’importe ! quels que soient le rang, le pouvoir de ce mystérieux inconnu, elle est pour lui l’objet d’un amour frénétique, elle n’en peut douter ; sa vanité s’en glorifie, et, faisant, pour la seconde fois, entrer dans ses rêves un souvenir de l’Égypte et de Napoléon, elle en vient à se dire que si jamais son inconnu commandait une armée dans le pays de France, les Français pourraient bien, un beau jour, envahir le pachalik de Sivas.
Jusqu’alors, pour se soustraire aux influences narcotiques de la vie monotone du harem, Baïla avait eu recours à ses fantaisies de toute espèce, à ses caprices mille fois renaissants, à ses luttes, à ses bouderies, à ses révoltes, à ses tyrannies contre son maître, contre son lion, contre ses esclaves ; maintenant, son caractère semble se modifier : elle a repris près de Djezzar son humeur égale et indolente des premiers temps ; elle tourmente moins sa bonne Mariam et ses autres femmes de service ; son goût pour la parure semble même s’être amoindri : au lieu de quatre toilettes par jour, elle n’en fait plus que trois ; elle est devenue grave, elle réfléchit, elle pense ; elle pense au giaour ; elle réfléchit au singulier enchaînement de circonstances qui, depuis quelques mois, malgré elle, par fatalité, est venu mêler ce jeune homme à toutes ses préoccupations, à tous les événements de sa vie de recluse.
Sans recourir au moyen dangereux d’une feuille de haschich glissée dans son narguilé, ou d’un grain d’arsenic fondu dans une dose de thériaque, maintenant son imagination sait créer pour elle un monde charmant et nouveau. Elle poursuit follement ses rêves vaniteux de la conquête du Sivas. Elle se voit transportée dans une autre contrée du globe, à Paris, où chacun librement peut venir admirer sa beauté, naguère la propriété d’un seul. Recevoir les hommages de tous, faire battre mille cœurs à la fois, tout en réservant le sien à l’objet aimé, ah ! n’est-ce pas pour une femme la gloire et le bonheur sur la terre ?
Mais ce rêve ne pouvait-il donc se réaliser sans l’intervention d’une armée ?
Cette réalisation de sa chimère, Baïla l’attendit quelque temps, puis quand elle cessa d’y croire, l’ennui, le terrible ennui revint la saisir. Une sorte de langueur maladive l’accabla. Elle chercha une cause à sa souffrance, et cette cause, elle ne voulut la voir que dans les murs du harem, qui pesaient sur elle et l’étouffaient.
Le sultan Mahmoud, dans les derniers temps de sa vie, avait permis à ses femmes de franchir les portes du sérail, bien escortées et surveillées toutefois ; depuis lui, de jeunes dignitaires de la Sublime Porte, partisans déclarés du nouvel ordre de choses, avaient à leur tour essayé de cet usage. Baïla le savait, elle résolut de conquérir pour elle cette douce liberté.
Au premier mot qu’elle en dit au pacha, celui-ci, la regardant avec des yeux fauves et flamboyants, jura par Mahomet et les quatre califes, c’était son serment redoutable, que si toute autre de ses femmes lui eût fait une demande semblable, sa tête aurait déjà sauté sous un coup de yatagan.
Baïla se garda d’en parler de nouveau ; mais le refus du maître donna au désir dont elle était possédée une intensité dévorante. Elle aussi jura, non par les quatre califes, mais par son vouloir de femme, d’arriver à son but, quelque chemin qu’il lui fallût prendre, quelque péril qu’il lui fallût braver.
L’idée seule de cette nouvelle lutte qui s’engageait suffit pour la guérir à moitié de sa langueur.
Quel était-il, ce but ? Elle eut d’abord à s’examiner en elle-même pour bien le définir.
Du haut des terrasses du palais d’hiver, elle avait déjà parcouru des yeux une partie des monuments de la ville ; elle avait visité la citadelle, le caravansérai, la mosquée, à la suite du pacha. Ce n’était donc point là ce qui lui faisait aspirer après ce fantôme de liberté.
Restaient les bazars ; mais ce qu’ils contenaient de précieux ou de curieux en brocart, velours, pierreries, or ciselé, le maître ne s’empressait-il pas de le faire apporter au harem pour qu’elle eût à voir et même à choisir ? De ce côté encore la privation se faisait peu sentir pour elle.
Les bateleurs, les jongleurs, les musiciens de la Perse et du Kurdistan, tout nain difforme, tout objet curieux qui traversait le pachalik, sur un mot d’elle avait son entrée au palais.
Elle arriva à cette conclusion logique, c’est que si elle avait désiré pouvoir visiter et parcourir Sivas, c’était dans l’espoir d’y retrouver son inconnu, de surprendre enfin la clef des mystères qui l’environnaient ; et cet inconnu était certainement la seule des curiosités de la ville que Djezzar refuserait de faire venir à son palais pour le divertissement de sa favorite.
Mais une autre ne pouvait-elle aller à la découverte pour Baïla ? Elle songea aussitôt à Mariam.
Celle-ci, chargée en partie des achats et des approvisionnements du harem ; dispensée, par son emploi, par son âge, par sa couleur, par sa laideur naturelle, du cérémonial ordinaire, parcourait librement les rues et les marchés. Baïla connaissait son dévouement à sa personne, et, refusât-elle de la servir dans ses recherches, elle savait que la vieille négresse ne la trahirait pas. Elle lui en parla donc.
Prise d’un tremblement subit,
— Par le saint Christ ! s’écria l’Abyssine, ah ! ne répétez pas cette parole, chère maîtresse ; résistez à la tentation, étouffez-la dans votre cœur ; c’est une inspiration du mauvais esprit !… ou un effet de la Providence, peut-être, une volonté d’en haut ! ajouta-t-elle en murmurant à voix basse, et comme s’apostrophant elle-même.
— Tu n’as rien à craindre, Mariam ; de quel crime seras-tu coupable pour avoir essayé de prendre quelques renseignements sur cet étranger ? Ne sait-on pas que les vieilles femmes sont curieuses ?
— Oh ! les jeunes ne le sont pas moins, reprit Mariam en jetant sur elle un regard de reproche, et leur curiosité entraîne à plus de périls. Notre sainte mère Ève était jeune quand…
— Ainsi, tu refuses de me servir ?
— Pour cette fois… ne l’exigez pas, n’insistez pas ; je puis faiblir ; j’ai déjà eu tant à lutter d’un autre côté !
— Comment ?
— Ce jeune Franc !… il est né pour votre perte et pour la mienne… Mais non… Si vous saviez !…
— Tu le connais donc ? tu l’as donc revu ?
— Ai-je parlé de cela ? Par l’ange noir ! il n’en est rien, j’espère.
— A l’instant même tu viens de te trahir ; tu l’as vu !
— Ah ! chère maîtresse, ne me perdez pas ! s’écria la vieille esclave toute palpitante d’effroi. Oui, je l’ai vu… pour mon malheur !
— Eh bien ! qui est-il ? Qui le retient à Sivas ? Que veut-il ? Qu’espère-t-il ? Quels sont ses projets ?
— Est-ce à moi de vous les faire connaître ? Au nom du Dieu des chrétiens, qui a été le vôtre et qui est encore le mien, cessez de m’interroger. Si notre maître venait seulement à découvrir que ce jeune homme a pénétré ici, dans les jardins, que je le savais, que je me suis tue, ah ! il me ferait hacher menu et jeter aux poissons du grand bassin !
— Mais il ne le saura point ! Tu n’as rien à craindre, te dis-je ; ne suis-je pas là pour te protéger ?
— Mais vous, qui vous protégera ?
— Que t’importe ? Ainsi, cet étranger, tu le connais ? Et tu ne m’avais rien dit ! Tu l’as donc rencontré ?
— Sans doute ; il l’a bien fallu, quoiqu’il eût préféré encore se rencontrer avec… une autre.
— Cette autre, qui donc est-elle ?
— Vous !
— Moi ! s’écria Baïla, dont le pourpre colora subitement le visage, comme si elle ne s’attendait point à cette réponse, qu’elle avait sciemment provoquée afin d’entraîner forcément Mariam dans la voie des confidences. Et que peut-il me vouloir ?
— Oh ! ce qu’il veut, répondit la vieille négresse, de nouveau en proie à son émotion première, ce qu’il veut !… Dieu me garde d’en parler ! Seul il pourrait vous le dire ; mais ce serait la mort pour nous trois, peut-être !
Baïla garda un instant le silence.
— Il a donc espéré me revoir encore ? demanda-t-elle ensuite.
— Si on doit l’en croire, il donnerait mille fois sa vie pour la réalisation de cette espérance… et de l’autre !
— De quelle autre s’agit-il donc ?
— C’est son secret, ce n’est pas le mien… J’en ai trop dit déjà !
Elles furent interrompues. Mariam se retira à la hâte, et bientôt Baïla resta seule avec ce serpent de la curiosité qui lui rongeait le cœur.
Peu de temps après, durant la nuit, tandis que le pacha était dans la ville de Tocate, où les soins de son administration devaient le retenir plusieurs jours, un homme fut amené furtivement dans les jardins de la rivière Rouge. Un bostangi avait trouvé moyen de l’y introduire dans une caisse de fleurs.
Ce bostangi, gagné par de riches présents, le conduisit, par des routes alors désertes, jusqu’au pavillon occupé par la favorite.
Baïla était au bain lorsque sa négresse abyssine parut et lui fit un signe.
A ce signe, la belle odalisque, prétextant d’un besoin de repos, congédia ses femmes de service, après avoir toutefois fait natter ses cheveux et s’être soigneusement fait parfumer le corps par elles.
Ses esclaves éloignées, aidée de Mariam, elle se rhabilla, mais tellement à la hâte que sa ceinture de cachemire, négligemment nouée, retenait à peine sa robe à moitié entr’ouverte ; et son long voile, répandu autour d’elle, cachait seul les trésors de ses épaules et de sa poitrine.
En se rendant vers la salle où l’attendait le visiteur mystérieux, elle s’arrêta. La respiration lui manquait ; un tremblement nerveux agitait ses membres délicats et courait en frissons sur sa peau, moite encore d’eau de rose et d’essence de santal. Portant la main à son cœur, comme pour en contenir les battements précipités,
— J’ai peur ! murmura-t-elle.
— Que craignez-vous maintenant ? dit en la soutenant sous les bras Mariam, dont le courage, comme par un jeu de bascule, semblait s’être affermi, exalté, tandis que défaillait celui de sa maîtresse : le pacha est loin ; tout dort autour de nous ; ce Franc que vous avez désiré recevoir et que vous allez entendre, il a franchi, sans éveiller les soupçons, les portes du palais. Il vous attend. Il n’a pas tremblé pour venir, lui ; les moments sont précieux ; il les compte avec impatience ; allons le rejoindre.
— J’ai peur ! répéta Baïla résistant à l’impulsion que voulait lui donner la vieille esclave.
Et tout en frissonnant, le corps courbé, allangui, le sourire aux lèvres, les yeux à demi fermés, elle semblait savourer avec délice l’effroi ressenti par elle ; comme ces malades, saturés de breuvages fades et sucrés, se plaisent momentanément aux âpres amertumes de l’absinthe.
C’était une émotion, enfin, et pour la recluse du harem, toute émotion devenait précieuse.
Non sans avoir promené un dernier regard sur l’habile et voluptueux désordre de sa toilette, elle souleva enfin la portière de ce salon où l’attendait l’inconnu.
A la faible lumière que projetaient deux bougies de senteur, placées sur un guéridon, elle vit l’étranger debout, une main au coude, l’autre au front, dans une posture méditative.
Au frôlement de sa robe, au léger bruissement de ses pas, il releva la tête, croisa ses mains avec une sorte de transport extatique, et ses yeux, levés vers le plafond doré, resplendirent si vifs, qu’il sembla à la Mingrélienne que la lumière en était doublée autour d’elle.
Quand Mariam a disparu pour mieux veiller sur eux, quand Baïla se trouve seule, seule avec son inconnu, avec l’amant de ses rêves, tout à coup rejetant son voile en arrière, elle se montre à lui dans tout l’éclat de sa beauté géorgienne.
Un instant, elle jouit de son trouble, de sa surprise ; puis, allant s’asseoir à l’angle d’un sofa, elle l’invite, par un signe, à venir prendre place à son côté.
Mais l’étranger est resté immobile ; son seul mouvement a été de se couvrir les yeux, comme si ce qu’il venait d’entrevoir l’eût soudainement ébloui.
Après avoir doucement savouré, dans son orgueil, l’effet stupéfiant produit par sa beauté, Baïla réitère son geste.
Cette fois, le Français, avec un reste d’embarras et d’hésitation cependant, se dirige vers le sofa, et, se courbant presque jusqu’à terre devant elle, les yeux baissés, il saisit l’extrémité du long voile de l’odalisque, et l’en recouvre tout entière, en détournant la tête.
Ce mouvement n’avait pas laissé que de surprendre étrangement Baïla ; mais peut-être, se disait-elle, sont-ce là les préliminaires de l’amour chez les Francs.
— Écoutez-moi, lui dit alors le jeune homme d’une voix émue, en prenant place à son côté ; écoutez-moi avec attention, madame ; le moment présent peut devenir, pour vous comme pour moi, le commencement d’une ère nouvelle de gloire et de salut.
Elle ne le comprenait point ; elle se rapprocha de lui.
— Vous êtes née chrétienne, madame, continua-t-il ; la Mingrélie est votre patrie.
Baïla crut un instant qu’il venait lui-même de l’ancienne Colchide, qu’il y avait vu sa famille ; et dans le vol rapide de ses pensées, elle fit remonter l’amour du jeune homme, non plus seulement à une époque récente, mais à ce temps où elle n’était encore que la propriété de son père. Les souvenirs du pays natal lui revenant plus doux, en s’unissant à l’idée d’un amour d’enfance, de nouveau elle se rapprocha de lui et le regarda curieusement, espérant retrouver sur sa figure des traits anciennement gravés dans sa mémoire.
— Êtes-vous donc un ami de mes frères ? lui demanda-t-elle.
Dans ce moment d’expansion, la Mingrélienne effleura de sa main celle de l’étranger. Celui-ci tressaillit, se releva aussitôt en faisant le signe de la croix, et d’une voix pleine d’onction et de solennité :
— Oui, madame, je suis l’ami de vos frères, de vos frères les chrétiens, aujourd’hui foulés aux pieds d’un despote cruel, mais qui par vous peut s’adoucir. Le terrible Dâher, maître d’une partie de la Syrie et de la Palestine, après avoir pris pour ministre un chrétien, Ibrahim-Sabbar, devint le protecteur des disciples de Jésus-Christ. N’exercez-vous pas sur votre maître un pouvoir plus grand que celui qu’Ibrahim avait sur le sien, vous, madame, à qui, dit-on, les lions mêmes ne résistent pas ? Dieu s’est servi d’Esther pour toucher le cœur d’Assuérus ; il vous a, comme elle, marquée de son sceau pour concourir à la délivrance de son peuple. La foi me l’a révélé. Grâce à vous, le pacha de Sivas, Ali-ben-Ali, le boucher, le bourreau, ne tournera plus sa rage que contre les ennemis de l’Église ; la clarté divine, descendue de la croix du Calvaire, a su parfois pénétrer jusque dans les cœurs les plus endurcis…
— Misérable ! s’écria Baïla, revenue enfin de la stupeur qu’elle avait éprouvée en entendant ce discours inattendu ; qu’es-tu venu faire ici ?
— Vous apprendre à pleurer sur votre vie passée, vous aider à vous laver de vos souillures, vous sauver, et sauver avec vous et par vous nos frères les chrétiens du Sivas !
— Va-t’en, apôtre du démon ; retire-toi, insolent ! répète la belle odalisque en s’enveloppant alors d’elle-même dans ses voiles, en se cachant de son mieux aux regards du profane ; va-t’en, et sois maudit !
— Non, vous ne me chasserez pas ainsi, disait le jeune enthousiaste ; vous m’entendrez ! Dieu, qui m’a inspiré l’idée de la sainte mission que j’accomplis en ce moment, va changer votre cœur ; il le peut, il le fera !
— Ton Dieu n’est pas le mien, impie ! va-t’en.
— Ah ! ne blasphémez pas contre le Dieu de vos pères, ne mentez pas ainsi aux saintes croyances qui, peut-être, même à votre insu, sont restées dans votre cœur. N’est-ce pas vous qui, dans un coin retiré de vos jardins, avez dressé la plus humble des croix, sans doute pour y venir prier en secret ?
Ce mot, ce souvenir du rameau d’azaléa qui faisait passer soudainement dans la mémoire de la jeune odalisque toutes les chimères de son amour fantastique, toutes les espérances, toutes les illusions qui s’étaient groupées pour elle autour d’une seule idée ; le dépit de voir ainsi s’effacer tous ses rêves ; l’effrayante pensée du péril qu’elle a recherché, qu’elle a bravé, qui la menace encore en ce moment même, et le tout pour arriver à une pareille déception, pour trouver un apôtre dans l’amant qu’elle attendait, troublèrent à ce point ses esprits que sa voix, s’élevant par degrés, sembla devoir aller jusqu’au delà de son pavillon éveiller les esclaves qui dormaient.
Pour essayer de la calmer, le geste suppliant, l’étranger fit un pas vers elle :
— N’approche pas ! lui cria l’odalisque.
Et se levant, frémissante, elle appela Mariam. Elle se disposait à sortir en faisant retentir encore ses imprécations, quand la portière, brusquement soulevée, le pacha parut tout à coup entouré de soldats et portant à sa ceinture un arsenal complet d’armes de toutes sortes.
Soit que la colère de la Mingrélienne fût arrivée à son paroxysme, soit que le sentiment de la conservation s’éveillât impérieux en elle et la rendît impitoyable :
— Tuez-le ! tuez-le !
Et du doigt, elle désignait le malheureux Français aux vengeances du pacha.
Le jeune homme arrêta un instant sur Baïla un regard triste et miséricordieux qui la fit tressaillir, puis il tendit la tête.
Un soldat leva son sabre ; Djezzar détourna le coup.
— Non, dit-il ; il ne faut pas qu’il meure si vite.
Et, promenant tour à tour sa prunelle investigatrice sur les deux soupçonnés, il murmura d’une voix cadencée cette phrase affreusement poétique :
— Son sang ne doit pas jaillir tout à coup, comme l’eau de la fontaine, mais couler lentement, comme celle de la source qui tombe goutte à goutte du rocher.
En Orient, la poésie se retrouve partout.
Ensuite, il dit quelques mots à l’oreille d’un esclave maugrebin placé près de lui, puis on emmena le chrétien.
Resté seul avec Baïla, Djezzar laissa d’abord rugir toutes ses passions jalouses ; mais avec lui, la favorite n’avait à redouter qu’une explication commençant par un coup de poignard.
Dès qu’elle le vit débuter simplement par des menaces et des emportements, elle cessa de craindre pour sa vie.
Prenant une attitude de surprise, une physionomie révoltée, tout en tâchant pourtant de se maintenir aussi jolie que possible, elle essaya de tirer parti de tous ses avantages, et de faire valoir avec le Turc cette toilette pleine d’abandon, coquettement disposée pour le chrétien.
Djezzar, qui, ce jour même, était revenu de Tocate à Sivas, avait été instruit dans cette dernière ville des projets du Français pour pénétrer dans l’intérieur du harem ; mais il manquait de preuves sur la complicité de sa belle esclave. Baïla s’en aperçut. Ces preuves, celui qui aurait pu les donner, il expirait sans doute en ce moment. N’avait-elle pas d’ailleurs à se prévaloir de ses imprécations contre le giaour et de son mouvement de terreur et de fuite, dont le pacha lui-même avait été témoin ?
Aussi celui-ci sembla-t-il bientôt se laisser convaincre, et, les rôles intervertis, ce fut le maître qui, humble et suppliant, implorait tout bas son pardon.
A l’innocence de la Mingrélienne il préparait cependant de terribles épreuves !
Déjà, s’irritant d’avoir été soupçonnée, Baïla élevait de plus en plus la voix.
— Écoute ! dit le pacha, lui imposant silence du geste et semblant lui-même prêter l’oreille à un certain mouvement qui se manifestait du dehors.
Elle écouta et n’entendit rien, qu’un bruit sourd, confus, monotone et régulier, comme celui des vanneurs ou des batteurs en grange.
— Qu’est-ce donc ? demanda-t-elle.
— Rien… rien encore, répondit-il.
Tous deux demeurèrent ainsi quelque temps attentifs ; le même bruit se répéta, mais sans s’accroître.
Djezzar se dépita, et cédant à son impatience, il frappa dans ses mains.
— Mes ordres ne sont-ils donc pas exécutés ? demanda-t-il à l’esclave maugrebin qui se présenta.
— Ils le sont, fils d’Ali ; mais en vain, contre ce chrétien, nous avons employé les cordelettes armées de plomb et les lanières de cuir d’hippopotame ; en vain nous avons humecté, saupoudré ses plaies béantes de piment et de jus de limon ; il n’a pas poussé un cri, pas un soupir.
— Que fait-il donc ? hurla le pacha.
— Il prie, répondit l’esclave.
— N’a-t-il rien révélé ?
— Rien, fils d’Ali.
— Si mes châtiments n’ont pu lui délier la langue, ma clémence en viendra à bout peut-être, dit Djezzar avec un sourire sinistre. Qu’on me l’amène, et qu’Haïder vienne avec lui. Par Allah ! je saurai le faire parler, moi !
Quand le maugrebin se fut éloigné, Djezzar redevint près de Baïla l’homme du harem, l’efféminé, le voluptueux Djezzar ; il lui fit reprendre place au sofa, et lui-même, étendu à ses pieds, fumant le narguilé, préoccupé, en apparence seulement, de voir la fumée de sa pipe persane s’échapper d’un côté en flocons nuageux, remonter de l’autre en s’épurant dans un flacon de cristal plein d’eau parfumée, il attendit, dans une posture indolente, l’arrivée de son captif.
Ce captif on le nommait Ferdinand Lasserre. Né à Paris, dans une bonne famille de la vieille bourgeoisie, d’un caractère enclin à la rêverie, à l’exaltation, il n’avait pu, orphelin dès le berceau, donner à sa sensibilité un cours naturel. Malgré son éducation tout universitaire, la pensée religieuse avait germé et s’était développée en lui. A défaut de ces tendres affections qu’il ignorait, les saintes et ardentes croyances avaient comblé les vides de son âme.
Il occupait un petit emploi au ministère des affaires étrangères, lorsque, un jour, à la suite d’un sermon de l’abbé Lacordaire, la résolution lui était venue de se faire prêtre.
Le seul parent qui lui restât, son oncle, récemment nommé au consulat d’une des villes importantes de l’Asie Mineure, ne trouva rien alors de plus à propos que de l’emmener avec lui, en qualité d’élève consul. Il espérait le distraire de ses pieuses abstractions, le faire renoncer à ses projets, et même le conquérir au doute, à la vue de toutes ces sectes de chrétiens schismatiques qui peuplent l’Orient.
L’oncle était philosophe.
Mais dans le cœur du néophyte la foi se ranima plus vive, au contraire, en approchant de ces lieux saints où les vérités évangéliques avaient étendu leurs premiers rameaux et porté leurs fruits les plus savoureux. Pour lui, les sommets du Taurus s’illuminaient des clartés du Thabor et du Sinaï. Plus que jamais affermi dans sa vocation première, sous son costume de diplomate, il vêtit le cilice et se promit, puisque l’occasion s’offrait à lui, d’accomplir, en dépit de son parent et dans le secret de sa pensée chrétienne, un noviciat signalé par des travaux apostoliques.
Après s’être perfectionné par la pratique dans la langue turque et l’arabe vulgaire, Ferdinand Lasserre se mit à visiter à Sivas et dans les environs les sectateurs des différentes églises dissidentes : arméniens, grecs, maronites, nestoriens, eutychéens et même les catholiques latins, séparés de Rome seulement par le mariage de leurs prêtres. Il allait vers eux pour opérer des conversions ; il en revenait plus effrayé encore de leur misère que de leur ignorance, et, véritable apôtre, il y retournait moins pour les prêcher que pour les secourir.
Monté sur un léger batelet qu’il avait appris à manœuvrer à la manière orientale, avec la rame au gouvernail, il suivait un jour le cours de la rivière Rouge, et rêvant le désert, un ermitage dans quelque thébaïde, il se créait dans l’avenir un bonheur ascétique trempé d’eau claire, lorsque la rame se rompit entre ses mains. Sa barque, en échouant, le jeta sur un petit pan de terrain, en delta, placé comme une île entre le Kizil-Ermak et un fossé régulièrement creusé.
Ferdinand n’était pas nageur habile ; mais, malgré la gravité ordinaire de ses pensées, il était bon sauteur ; il mesura tour à tour de l’œil la rivière et le fossé, et, la question décidée en faveur de ce dernier, il le franchit d’un bond. Le fossé derrière lui, il aperçut un petit mur que lui avait masqué un épais buisson de nopals et d’abricotiers sauvages. Rebondir de l’autre côté pour regagner son delta, c’était risquer de se rompre le cou, car cette fois l’espace lui manquait pour prendre un élan, et, dût-il réussir, il se retrouvait encore devant la rivière infranchissable.
Dans cette position, fort embarrassé de son rôle, et ne se doutant guère qu’il avoisinait de si près les jardins d’été du pacha, il aperçut une porte basse, cintrée, pratiquée dans le petit mur ; il la poussa machinalement, et, à sa grande joie, elle s’ouvrit devant lui.
Il existe autour de Sivas, et surtout sur les bords de la rivière, des enclos où des cultivateurs, chrétiens pour la plupart, font venir, à grand renfort d’eau, les légumes qui servent aux approvisionnements des marchés de la ville, et ces poncires énormes, ces pastèques savoureuses, ces dattes et ces pistaches, dignes de rivaliser avec celles d’Alep et de Damas. Ferdinand crut être arrivé devant une de ces exploitations appartenant à des chrétiens. La négligence apportée dans la fermeture des portes l’affermit dans son idée ; il entra.
Alors, pour la première fois, il se trouva face à face avec Baïla, nonchalamment assise sous le platane.
Plus surpris que charmé à la vue de la gracieuse odalisque bariolée de rouge et de noir, effrayé de la rencontre, il ne sut que balbutier quelques paroles en rapport avec le désir véhément qu’il avait d’échapper sain et sauf à cette périlleuse bonne fortune qu’il n’était pas venu chercher. Égaré ensuite dans les dédales du jardin, il se retrouva devant Baïla et sa négresse ; enfin, regagnant non sans peine la petite porte encore ouverte, il s’épouvantait de nouveau de ce double obstacle du fossé et de la rivière qui s’opposait à sa fuite, quand au milieu des vapeurs du soir il vit un homme s’avancer mystérieusement vers le delta, en traversant le Kizil-Ermak à un endroit guéable, que Ferdinand ne soupçonnait pas.
Cet homme, bostangi chez le pacha, volait les fruits de son maître pour aller les vendre à la ville. C’est lui qui avait laissé tout contre la petite porte cintrée, laquelle ne servait d’ordinaire qu’à l’entretien des fossés. Après avoir, ce jour-là, à son insu, indiqué à Ferdinand le moyen de sortir d’embarras, c’est lui encore, c’est ce voleur de fruits qui, plus tard, enfermé par Baïla entre la crainte d’une dénonciation et l’espoir d’une récompense, devait introduire le Français dans les jardins et jusque dans le pavillon de la favorite.
Parvenu au delta, le bostangi tira de dessous un amas de ronces pendantes une longue planche dont il se servit pour franchir le fossé ; il la déposa ensuite derrière le massif de nopals et d’abricotiers sauvages, où justement Ferdinand se tenait caché.
Dans ce concours de circonstances inespérées qui venaient coopérer à sa délivrance, celui-ci vit un miracle du ciel. Cette planche devenait une arche de salut pour lui ; il s’en servit à son tour, et grâce au gué de la rivière, que le bostangi venait de lui révéler, après s’être égaré quelque temps dans des sentiers inconnus, après avoir lutté de nouveau contre le Kizil-Ermak, qui, comme un serpent à la poursuite de sa proie, se retrouvait partout sur sa route et semblait vouloir l’envelopper de ses détours et de ses replis, il échappa enfin à tous les dangers de sa malencontreuse promenade.
Rentré à Sivas, dans la maison du consulat, il eut à se féliciter doublement d’y être arrivé sain et sauf, quand il apprit que ces jardins où il s’était si follement aventuré n’étaient rien moins que ceux de Djezzar-Pacha.
Mais cette femme qu’il y avait vue, qui pouvait-elle être ?
Quand il songeait à sa rencontre avec l’odalisque, il croyait maintenant avoir rêvé, ou qu’une vision l’avait abusé.
Elle réapparaissait à son esprit sous une forme multiple. Il la revoyait semblable à une bacchante, sa coupe à la main, indolemment accroupie sur sa peau de tigre ; puis, comme une péri, comme une ondine, se montrant à lui à travers les reflets dorés du soleil et les arcs-en-ciel du petit bassin de marbre ; puis enfin, dans sa troisième transformation, debout, sévère, irritée, lui ordonnant la fuite, et le menaçant du poignard.
Toutefois, son imagination chaste et calme ne prêtait nul charme à cette triplicité de formes. Il se demandait, au contraire, si cette vision ne lui avait pas présenté un emblème de tous les vices réunis ? L’ivresse, la luxure, la paresse, la colère ! Il trouvait moyen de compléter les sept péchés capitaux.
Dans ces jardins maudits, habités par le persécuteur des chrétiens, n’était-ce pas le démon lui-même qui s’était fait voir à lui ?
Ainsi, tandis que Baïla faisait de lui un être à part, un être merveilleux, dont elle honorait la trace, une idole à laquelle elle rendait un culte d’amour, lui, il s’entretenait pieusement dans la sainte horreur de son souvenir.
Ce démon cependant, cet effroyable assemblage des sept péchés capitaux, il allait tout tenter pour l’approcher encore.
Ferdinand Lasserre, depuis qu’il séjournait près de son oncle, dans cette province de l’Anti-Taurus, s’était peu préoccupé de ce qui se passait dans l’intérieur du harem de Djezzar. Ses pensées étaient ailleurs ; mais après sa visite involontaire dans les jardins, il prêta plus curieusement l’oreille aux discours qui se tenaient sur le pacha. Il apprit que celui-ci, entièrement abandonné à ses penchants voluptueux, subissait l’empire d’une favorite mingrélienne. Bientôt, sans qu’il pût se douter de la part qu’il avait eue lui-même à l’accroissement de cette domination de la belle esclave, il entendit répéter partout autour de lui que, si elle en avait la ferme volonté, Baïla ferait un juif de son maître Ali-ben-Ali.
— Pourquoi pas un chrétien ? se dit-il.
Dès ce jour, toutes ses pensées se sont concentrées en une seule : Elle est chrétienne, et elle peut tout sur Djezzar !
Oh ! combien sa divine mission s’agrandit à ses propres yeux ! Quel triomphe pour lui, pour la religion, pour tous les malheureux chrétiens de Sivas, si cette pensée se réalise ! Sans doute, l’exécution d’un projet pareil est hors de toute probabilité ; mais la foi raisonne-t-elle ? Ne parvînt-il qu’à arrêter les persécutions qui pèsent sur ses frères de toutes les sectes, et qui en poussent quelques-uns à l’abjuration, n’est-ce pas un assez grand résultat ? A ce résultat comment arriver ?
Le premier pas qu’il fait dans sa nouvelle voie est déjà un triomphe.
Il a confié son dessein, ses radieuses espérances, à un vieux prêtre, son confesseur, et son confesseur se trouve être en même temps celui de Mariam ; car Mariam, catholique zélée, n’a jamais cessé de pratiquer, mystérieusement toutefois, les préceptes de sa religion.
Arriver à la négresse abyssine par le saint homme, à la favorite par la négresse, au pacha par la favorite, telle est la marche à suivre que se trace d’avance notre jeune enthousiaste.
Régénérer et faire refleurir le christianisme dans cette portion du monde asiatique, telle est la mission sublime dont il se croit chargé par Dieu lui-même.
Le vieux confesseur refusa d’abord de s’associer à ces dangereuses tentatives. Vaincu enfin par ses instances, il le mit en relation avec l’Abyssine, mais c’est à quoi se réduisit son rôle. Usé par la persécution, devenu craintif et prudent, le vieillard tenait à la vie, qui lui échappait. Il avait coutume de dire que l’Église conquérante ne doit compter que sur ses fraîches recrues, plus ardentes que les autres, et que le martyre ne convient bien qu’à la jeunesse.
C’est par Mariam alors que Ferdinand apprit que cette favorite, venue de la Mingrélie, et sur laquelle il avait fondé toutes ses espérances chrétiennes, n’était autre que la démoniaque odalisque rencontrée par lui dans les jardins de Kizil-Ermak.
A quelque temps de là, la nouvelle ayant circulé que Baïla, à la suite de Djezzar, avait traversé la ville dans son palanquin et devait la traverser encore pour retourner vers le palais d’été, il s’était placé sur son passage. Mariam, quoique ébranlée par ses ardentes et pieuses sollicitations, n’avait point encore parlé de lui à sa maîtresse ; mais il crut voir la preuve du contraire dans le mouvement de la jeune femme vers lui, et ce fut dans cette conviction qu’il tira de sa poitrine et fit briller à ses yeux ce bijou, qui n’était autre qu’une petite croix dorée qu’avait portée sa mère, et qui ne le quittait jamais.
On sait comment tourna l’exécution de cette sainte et audacieuse entreprise, dont Ferdinand Lasserre, à cette heure, vient de subir les premières et terribles conséquences, et prévoit le dénoûment.
Quand, après son supplice préparatoire, les mains solidement liées derrière le dos, il fut ramené devant le pacha, celui-ci était encore étendu sur ses coussins ; sa tête, et le bras qui soutenait le narguilé, reposaient sur les genoux de la Mingrélienne, et son lion, Haïder, allongé sur ses pattes, le museau contre terre, les yeux à demi fermés, était couché près de lui.
Sur un geste du maître, les esclaves se retirèrent. La scène qui allait suivre ne voulait pas de témoins.
Le pacha, la Mingrélienne, le chrétien et le lion demeurèrent seuls.
Baïla avait senti disparaître sa confiance. Une seule révélation du prisonnier pouvait être pour elle un arrêt de mort ; et, cachant sa pâleur sous les plis redoublés de son voile, le cœur palpitant, elle attendit le résultat de l’interrogatoire, en attachant son regard plein d’anxiété sur le captif.
— Quoi ! j’aurais risqué de mourir pour entendre un sermon de ce triste prêcheur ! se disait-elle ; que ne l’ont-ils tué quand j’en ai donné l’ordre ! ou que n’a-t-il succombé sous le fouet des cawas !
Cependant, en le voyant le corps sillonné de stigmates bleuâtres, la chair gonflée et saignante, se tenir là, dans cette salle, comme s’il n’en était pas sorti pour être livré aux bourreaux, comme il y était avant l’arrivée du pacha, avec son même maintien, avec son même regard timide, qu’il n’osait lever vers elle, elle se sentait émue de quelque pitié.
— Chrétien, dit le pacha, quel motif t’amena dans ce lieu ?
— Son salut, répondit le captif en tournant un instant ses yeux vers le sofa occupé par l’odalisque ; et les reportant sur Djezzar : Le tien peut-être, ajouta-t-il.
— Quoi ! chien fils de chien que tu es, tu pensais faire de moi un vil Nazaréen, et pour me convertir à la secte de maudits, tu profitais du temps de mon absence ?
— J’ai dit la vérité, répondit le jeune homme, aussi vrai que Jésus-Christ est le rédempteur du monde !
— Tu mens ! cria le pacha, aussi vrai qu’il n’y a pas d’autre Dieu que Dieu et que Mahomet est son prophète.
Après ce mouvement, il sembla faire un effort pour s’interrompre dans sa colère, il se replaça plus à l’aise entre les genoux de sa favorite, passa sa main, en signe de caresse, sur la crinière de son lion, et quand il eut aspiré deux ou trois bouffées de son latakié :
— Voyons, sois sincère, reprit-il, et n’aggrave pas ton crime. Tu sais bien que d’un musulman on ne fait point un chrétien, comme d’un chrétien on ne peut faire un juif. La loi de Moïse a préparé celle de Jésus ; celle de Jésus n’était que le second échelon de celle de Mahomet ; dans cette route-là on ne redescend pas ; on monte.
— J’espérais du moins, dit le captif, te rendre plus favorable à mes frères…
— Sont-ce donc là tes frères, toutes ces bandes de chacals qui se mordent entre eux, toutes ces races d’infidèles qui oublient leur propre loi ? De quoi se plaignent-ils ? De quelques-uns j’ai fait de bons chrétiens par le martyre ; de quelques autres de bons musulmans, par la persuasion. D’ailleurs, es-tu donc un de leurs prêtres ? Non ! loin de là ! Tu n’es qu’un de ces frivoles Européens qui viennent essayer de propager parmi nous leurs usages impies ; laisse de côté la ruse et le mensonge : tu as entendu parler de la beauté de cette esclave (il tourna la tête vers Baïla), et, au prix de ta vie, tu as voulu en saturer tes yeux ? N’est-ce point cela ?
Le jeune homme fit un signe négatif ; le pacha n’en tint nul compte et poursuivit :
— Eh bien, es-tu satisfait ? Tu dois l’être ; car tu l’as vue. Vos femmes d’Europe sont-elles à ce point à dédaigner qu’il vous faille venir chez nous pour nous ravir les nôtres ? Jusqu’à ce jour, vous n’avez eu de convoitise que pour nos chevaux. Comment as-tu trouvé moyen de correspondre avec elle ? Quel a été ton guide ? De quelle façon t’a-t-elle d’abord accueilli ?
Semblable au tigre qui, de l’œil et de l’oreille, épie le moindre cri, le moindre mouvement de la proie qu’il veut saisir, Djezzar guettait une parole d’aveu, un signe dénonciateur de la part de l’interrogé.
Il ne l’obtint pas de ce côté ; mais il sentit, sous lui, frissonner les genoux de Baïla.
— Chrétien, reprit-il, je te le répète, sois sincère ; dis-moi quel espoir tu avais conçu ; dis-moi qui t’a introduit dans ces lieux ; nomme tes complices, et, quelle que soit ta faute, je mettrai dans l’autre balance ta jeunesse, ton titre consulaire, quoique ta présence ici la nuit, au milieu de mon harem, me donne le droit de l’oublier. Mais je te tiendrai compte de ce que tu as déjà enduré, et, comme Allah, je serai miséricordieux. Parle ; je t’écoute.
Il aspira de nouveau la fumée odorante du narguilé et sembla attendre une réponse ; mais le captif gardait toujours son silence et son immobilité.
— Parle, chrétien ; parle, il est temps ; à ce prix seul, tu peux racheter ta vie… en abjurant ton idolâtrie, bien entendu.
A ce dernier mot, le jeune homme releva la tête ; une noble rougeur lui monta au visage :
— Dénoncer et apostasier ! s’écria-t-il ; voilà ta clémence, pacha ! Tes bourreaux ont-ils donc oublié de te dire qui je suis ? Toi-même, qui m’as honoré ici du titre de chrétien, tu ignores donc quels devoirs ce titre impose ? Pour plonger deux fois leur âme dans une souillure ineffaçable, crois-tu que les disciples du Christ tiennent tant à cette vie mortelle ?
Et son œil étincelait, et toute sa physionomie avait pris un caractère de beauté sublime.
— C’est entendu, dit Djezzar, contrastant alors, par son apparente impassibilité, avec l’exaltation du jeune Français ; tu veux mourir, et tu mourras ; mais sais-tu bien quelle fin je te réserve ?
— Quelle qu’elle soit, je suis prêt, dit le captif.
— Ainsi, de cette vie mortelle, tu ne regretteras rien ?
Et le pacha suivait attentivement son regard, qu’il croyait devoir se porter vers Baïla.
— Rien, répondit le jeune homme, les yeux baissés, sinon de n’être point, à mes derniers moments, assisté par un saint prêtre de ma religion.
Djezzar sembla réfléchir ; puis un sourire contracta légèrement ses lèvres :
— Si tes désirs ne vont pas au delà, dit-il, ils peuvent être exaucés.
A son appel, le maugrebin reparut.
Quelques minutes après, un vieillard au front chauve, à la longue barbe blanche, aux traits amaigris, se présenta. En présence du pacha, il fut pris tout à coup d’un tremblement, comme s’il eût cru sa dernière heure arrivée.
C’était un pauvre religieux maronite envoyé récemment par le patriarche du mont Liban pour remplacer le supérieur du couvent de Perkinik qui venait de mourir. Le jour même, en traversant ce village catholique des environs de Sivas, le pacha avait voulu frapper d’une avanie son misérable couvent, où trois moines, couverts de haillons, vivaient du travail de leurs mains, au milieu d’une population aussi misérable qu’eux. Ne pouvant leur extorquer l’argent qu’ils n’avaient pas, Djezzar venait d’emmener avec lui leur supérieur, pour le garder en otage jusqu’à ce que la somme exigée par lui fût payée.
— Kafer, lui dit-il, tu as refusé d’acquitter les impôts du miri et du karadj.
— Les chrétiens du Liban en sont exemptés depuis les capitulations du saint roi Louis, répondit le malheureux dont la voix trahissait la violente émotion ; le vice-roi Mehemet-Ali nous en tenait dispensés.
— A l’enfer le vieux chacal !
— Mais les sultans eux-mêmes ont reconnu cette loi, Altesse.
— Il n’y a d’autre loi ici que ma volonté ! lui cria le pacha.
— Que puis-je faire pour désarmer ta rigueur ? balbutia le vieillard en attachant son regard terrifié sur le lion couché auprès de Djezzar, et dont il se croyait déjà la pâture. Je ne possède rien au monde, sinon la vie, que tu puisses me prendre.
— Ainsi ferai-je, si tu ne m’obéis sur-le-champ !
— Mais pour acquitter cet impôt…
— Par le Coran, qui te parle encore d’un impôt ? Du karadj et du miri, je vous tiens quittes, toi et les tiens, quittes à jamais, et tu es libre, et tu sortiras d’ici emportant plus de piastres que je ne t’en demandais ; mais avant de nous séparer, tu vas appeler les malédictions de ton Dieu sur ce chien que voilà.
Alors s’adressant à son autre captif :
— Oui, tu vas mourir, et mourir maudit par un prêtre de ta religion, Ynch Allah ! Parleras-tu maintenant ?
Avec une héroïque résignation, pour toute réponse, Ferdinand Lasserre s’agenouille et courbe sa tête, dévouée à la fois au sabre et à l’anathème, quand il entend le vieux cénobite du Liban, levant ses mains décharnées sur son front, lui dire d’une voix attendrie :
— Si vous êtes chrétien, je vous bénis, mon fils !
Cette sainte parole à peine prononcée, le vieillard tombait à la renverse, frappé d’un coup de feu ; Baïla, avec un mouvement d’horreur, se rejetait en arrière ; et le pacha, avec sa même impassibilité, remettait son pistolet dans sa ceinture.
Soudain, il interrompit ce mouvement pour retenir par la crinière son lion qui, animé par la vue du sang, s’élançait avec un rugissement vers le corps du Maronite.
— Qu’on emporte cette charogne, dit Djezzar au maugrebin, et qu’on nous laisse !
Le cadavre emporté, le maugrebin sorti, revenant au lion qui, la gueule entr’ouverte, les lèvres crispées et pantelantes, poussait de rauques soupirs et dardait ses regards étincelants vers cette proie qu’on lui enlevait :
— Holà ! dit-il en le flattant du geste et de la voix, holà ! patience, Haïder, ta part te sera bientôt faite ; tu ne perdras pas à l’échange.
Il reprit alors sa position première ; et tandis que le lion, retenu par lui, continuait de rugir sourdement, les yeux tournés vers une large tache de sang restée sur le tapis, s’adressant à Baïla, sans paraître se douter des émotions de terreur dont était agitée sa belle esclave :
— Oui, à nous trois le giaour ! chacun sa part ! A moi sa tête, au lion son corps, et à toi, ma rose de l’Inéour, ma fidèle, à toi son cœur ! Ce cœur, ne te l’a-t-il pas donné ? Eh bien ! va le prendre !
Baïla, indécise, troublée d’horreur, ne savait quel sens attacher à ces mots.
— Va le prendre, répéta Djezzar ; tiens, regarde, impuissant à se défendre, ne semble-t-il pas te l’offrir de lui-même ? Va, mon âme, et si ton poignard ne suffit pas à l’œuvre, sers-toi du mien.
L’odalisque se pencha vers lui :
— Tu te joues de moi, Ali, n’est-il pas vrai ? lui murmura-t-elle à l’oreille.
— Ne m’entends-tu pas, ou ne veux-tu pas me comprendre ? répondit-il d’une voix formidable. Que cet homme meure, qu’il meure de ta main, sur-le-champ, sinon je te croirai sa complice, et ta tête tombera avant la sienne, je te le jure par Mahomet et les quatre califes !
N’ayant plus qu’à choisir entre donner la mort ou la recevoir, Baïla sentit un froid glacial dans ses veines ; son front se couvrit d’une pâleur livide.
— Tu hésites ? dit le pacha.
Elle porta une main tremblante à son poignard.
— Prends le mien, reprit-il.
La main de Baïla retomba sur l’épaule de Djezzar et y resta quelque temps comme paralysée ; ses yeux troublés se levèrent furtivement vers le jeune Français, ce matin encore l’objet de ses rêves d’amour ; vers ce jeune martyr, qui d’un mot pouvait la perdre, et qui allait mourir, mourir par elle, pour n’avoir pas voulu le prononcer, ce mot !
— Obéiras-tu ! dit le bourreau avec un geste de rage impatiente.
La main de Baïla descendit seulement de l’épaule de Djezzar, et s’égara, furetante, parmi les armes qui formaient un arsenal à sa ceinture.
— Tu trembles ? tu ne veux donc pas ? tu l’aimes donc ? lui cria-t-il enfin.
— Oui, je l’aime ! répondit la Mingrélienne. Et, bondissant tout à coup, elle enfonça la lame du yatagan en pleine poitrine du pacha.
Quoique frappé à mort, il fit encore un mouvement pour saisir son dernier pistolet ; mais, sur un geste de Baïla, le lion Haïder, excité de nouveau à la vue du sang qui jaillissait, se ruant sur son maître, se fit sa part.
Tandis que Ferdinand Lasserre, épouvanté du double meurtre, fermait les yeux, en roidissant d’horreur ses bras garrottés, la Mingrélienne, douée tout à coup d’une incroyable présence d’esprit, rassembla à la hâte, dans un coin de la salle, les légers meubles et les étoffes qui s’y trouvaient ; elle y mit le feu, et saisissant par ses liens le jeune Français plus mort que vif, elle l’entraîna vers une issue secrète qui conduisait au logis de la négresse abyssine.
Le palais de Kizil-Ermak, de construction turque, c’est-à-dire bâti en bois, fut presque entièrement consumé.
Le lendemain, sur le méidan de Sivas, les colporteurs de nouvelles s’évertuaient à définir les causes de ce grand événement. Les uns se bornaient à dire que le pacha avait été étranglé par son lion et que, dans la lutte des deux bêtes féroces, une torche renversée avait été la cause de l’incendie.
Les autres, raisonnant d’après les us de l’ancien régime ottoman, et se prétendant mieux informés, racontaient qu’un homme, portant l’habit d’un Franc, après avoir assez longtemps séjourné dans la ville, afin d’écarter les soupçons sur le but de sa mission secrète, s’était introduit auprès du pacha et jusque dans son harem ; lorsque celui-ci avait ordonné à ses esclaves de le décapiter, le prétendu Franc, qui n’était autre que le capidgi-béchi du sultan, l’exécuteur de ses arrêts de mort, avait montré son kat-chérif, et la tête seule de Djezzar était tombée. Le feu avait pris au palais au milieu du désordre, et le capidgi-béchi, profitant du grand concours de peuple attiré par l’incendie, s’était échappé sous un nouveau déguisement.
Vingt versions circulèrent encore, qui, presque toutes, furent répétées alors par les journaux d’Europe.
Tandis qu’à Sivas, à Rocate, et dans les autres villes du pachalik, on se perdait ainsi dans des explications plus ou moins vraisemblables, Baïla et Ferdinand, qui, en effet, avaient trouvé moyen de s’enfuir du palais, grâce au désordre, à la foule et à leur travestissement, se tinrent d’abord cachés dans les montagnes situées au sud de Sivas, où des brigands curdes les prirent sous leur protection sans trop les rançonner ; puis ils trouvèrent un abri dans un couvent, puis vingt autres dans les cavernes ou sous les ombrages des bois d’Avanes, toujours en remontant les bords de la rivière Rouge.
Entrés enfin dans les États du schah de Perse, ils étaient revenus en France à la suite de la dernière ambassade.
De toutes ces cachettes, Ferdinand Lasserre sortit non sans y avoir quelque peu perdu de son ardeur de prosélytisme.
A travers les montagnes et les vallées, le jour et la nuit, il avait voyagé, portant la tentation en croupe. Baïla était réellement devenue pour lui le démon qu’il avait rêvé.
Avec la belle Mingrélienne, sa libératrice et la compagne de sa fuite, marchant du même pas dans les mêmes sentiers, dormant sous les mêmes abris, soigné, pansé par elle, il lui avait été difficile d’empêcher son cœur de battre sous d’autres inspirations que celles de l’amour divin. Ferdinand avait vingt-cinq ans, et la reconnaissance a tant d’empire sur une âme généreuse !
Néanmoins, dans les premiers jours de leur fuite en commun, il était parvenu à convertir sa schismatique compagne, facile à persuader, par indifférence en matière de religion ; mais bientôt, dit-on, elle l’avait converti à son tour. Ce qu’il y a de positif, c’est que le jeune homme ne revint pas seul en France ; son passe-port, quand il le fit viser à Marseille, portait : M. Ferdinand Lasserre, élève consul, voyageant avec sa sœur.
Mon ami, l’illustre voyageur, m’avait déjà livré tous les documents de l’histoire que je viens de mettre en œuvre ; mais ma curiosité n’était pas encore pleinement satisfaite. Je voulais connaître le sort des deux amants à leur arrivée en France. Je le pressai de questions à ce sujet, et d’abord très-inutilement.
Nous venions de déjeuner, en plein air, sur la pelouse du Butard, et mon botaniste, dans une exaltation difficile à décrire, n’était alors préoccupé que d’une trouvaille qu’il venait de faire sous la table même qui nous avait servi pour notre repas. C’était une petite plante à feuilles velues et lancéolées, aux fleurs d’un jaune pâle, marquées d’une tache violette à la base de chacun de leurs cinq pétales.
— Cistus guttatus ! Helianthemum guttatum ! s’écriait-il avec des élans de surprise, des cris, des gestes impossibles à traduire pour quiconque n’a pas la botanique au cœur. Je croyais qu’il n’existait que dans les montagnes de l’Anti-Taurus, d’où j’en ai rapporté si précieusement un échantillon unique ! C’était ma plus belle conquête végétale, et voilà que je le retrouve ici, au Butard, à Luciennes, banlieue de Paris, sous la table d’un cabaret ! Est-ce que ça devrait être ? Le Taurus et le Butard en rivalité de productions ! c’est à s’y perdre ! Fiez-vous donc à l’Asie Mineure !
— Mais, de l’Asie Mineure, lui dis-je alors en l’interrompant avec ténacité, avec obstination, vous m’avez rapporté une histoire dont les héros m’intéressent vivement. Veuillez, je vous prie, me donner de leurs nouvelles.
— Ils se portent parfaitement bien, merci, me répondit-il.
— Je ne vous demande pas des nouvelles de leur santé, mais de leur sort.
— Ah ! ce qu’ils sont devenus ? oui, je comprends.
Puis, me regardant d’un air moqueur, et poussant un éclat de rire :
— Eh ! mais, reprit-il, pour peu qu’ils aient, comme nous, l’habitude de causer beaucoup en mangeant, ils achèvent de déjeuner ici près.
— Comment ! quoi ! m’écriai-je, ces gens de la fontaine au Prêtre ?
— Justement. Vous voyez bien que vous n’aviez pas deviné. Mon prétendu confiseur, le soi-disant garçon limonadier, n’est autre que mon ami Ferdinand Lasserre, notre martyr chrétien ; et sa compagne, par vous si légèrement qualifiée de grisette ou de comtesse sans préjugés, c’est Baïla, l’ex-favorite de Djezzar, pacha de Sivas ; Baïla la Mingrélienne, la rose de l’Inéour, la colombe aux serres d’épervier !
Après m’avoir administré cette moquerie, bien méritée sans doute, mon ami se décida enfin à me donner, en résumé, le complément de ma nouvelle.
— Arrivés à Paris, dit-il, des événements d’une nature beaucoup plus vulgaire que ceux qui avaient signalé leur séjour au Sivas vinrent encore éprouver le jeune Français et la Mingrélienne : l’argent leur manqua. Les bijoux, présents de Djezzar, que l’odalisque avait emportés dans sa fuite, étaient faux pour la plupart. On ne peut plus se fier même aux pachas ! Ferdinand dut prendre un état lucratif avant tout. Il entra à l’imprimerie royale, comme prote, pour les ouvrages orientaux. Cette ressource ne suffisant pas encore aux besoins du ménage, Baïla chercha à s’utiliser de son côté. N’ayant jamais manié une aiguille, elle ne pouvait se faire ni couturière, ni brodeuse, ni femme de chambre, ni demoiselle de compagnie : elle a une voix charmante, et défierait, au besoin, en gazouillis et en gargouillis, toutes les cantatrices italiennes, françaises ou autres ; mais ne possédant aucune des langues de l’Europe, elle ne pouvait chanter que des mouals arabes ou des gazels turcs. Par bonheur, elle est danseuse aussi, et la danse est une langue qui se parle et se comprend dans tous les pays. Elle figure aujourd’hui dans le corps des ballets de l’Opéra, où elle se fait remarquer par sa légèreté, sa douceur et sa modestie.
Comme mon illustre voyageur achevait ce récit, nous vîmes revenir, bras dessus bras dessous, vers le Butard, Ferdinand Lasserre et sa jolie compagne. Mieux renseigné cette fois, j’admirai en toute conscience la rare beauté de la Mingrélienne et l’incroyable et gracieuse souplesse de sa taille.
Quant au ci-devant élève consul, pour la vérification d’un des détails de cette histoire, mon regard se porta aussitôt curieusement vers ses extrémités inférieures, afin d’apprécier la forme et la dimension de ses pieds.
Je les trouvai fort ordinaires.
Sans doute il avait confié à Baïla les rapports d’amitié existant entre lui et mon compagnon, car lorsque nous nous croisâmes de nouveau, elle fit à celui-ci un petit signe de la main en disant : Bojour, mochu !
— Salem-alai-k ! lui répondit mon illustre voyageur.
Moi, je saluai profondément.
FIN DE L’ESCLAVE DU PACHA.
Marly-le-Roi, juillet 1844.
— Lorsque sonnera l’heure éternelle de la résurrection, croyez-vous que nous devions nous retrouver tous avec la forme que nous aurons eue au dernier instant de notre vie ?
— C’est là un point contesté, et qui le sera encore longtemps sans doute. Il faut convenir que si les choses doivent se passer ainsi, ces âmes mélancoliques et tendres, qui désirent quitter leur enveloppe terrestre avant que les riches draperies de pourpre de la jeunesse, les joyaux de la beauté en aient été déchirés, arrachés par les doigts crochus du temps, ne font pas, à tout prendre, un vœu déraisonnable.
— Certes ! le sentiment raisonne d’ordinaire plus juste qu’on ne pense, me répondit mon interlocuteur, qui n’était autre que le compagnon de ma dernière course au Butard[2].
[2] Voir ci-dessus l’Esclave du Pacha.
Cette fois, nous venions d’herboriser en pleine forêt de Marly. Surpris par une averse, nous nous étions réfugiés dans une de ces cabanes de bûcherons, aux murailles de rondins, à la toiture de fagots et de genêts, où nous philosophions, faute de mieux, pour prendre patience, en attendant la fin du mauvais temps.
— Les peintres qui, par avance, ont voulu nous représenter le jugement dernier, ont seuls donné cours à tant de fausses idées sur le sujet qui nous occupe, reprit-il. Selon moi, messieurs de la peinture et de la sculpture se sont rendus coupables d’un délit du même genre à l’égard du génie, lorsqu’ils se sont chargés de le faire comparaître, non devant le tribunal de Dieu, mais devant celui de la postérité. Où ont-ils été s’imaginer de toujours traduire nos grands hommes en vieillards, sous prétexte que leur vie a été de longue durée ? Ceux-ci n’ont-ils pas été jeunes aussi ? N’est-ce pas alors un anachronisme que de nous représenter nos artistes inspirés, nos grands poëtes, à une époque où la poésie et l’inspiration n’existaient plus en eux ? Leur jeunesse, ou du moins leur verte maturité, leur temps de sève et de production ne les retracent-ils pas mieux à notre esprit que leur moment de décadence et de caducité ? Pourquoi toujours le soleil à son déclin ? Pourquoi une ruine, là où nous devrions voir un palais ? Vous nous devez un tableau d’histoire et vous vous acquittez avec un portrait de famille ; un portrait de famille, rien de plus, car à la famille seule il importe de voir se reproduire sur la toile les individus tels que le souvenir les rappelle ; la postérité ne se souvient que des œuvres.
— C’est justement en songeant à des tableaux de famille que m’est venue l’idée de ce grand jour de la résurrection, dont je vous entretenais tout à l’heure.
— Je ne saisis guère l’analogie, me répondit mon interlocuteur.
— Considérée non sous le point de vue de l’art, mais sous son côté pittoresque, une collection de ce genre, surtout avec son texte explicatif, est seule capable cependant de nous donner un avant-goût de l’étrange spectacle qui, selon quelques-uns, nous attend dans la vallée de Josaphat. Nous entrons dans une longue galerie ; regardez, examinez avec moi. Je serai le cicerone. Cette fillette qui joue avec son bichon, enrubané comme elle ; cette jeune et jolie femme qui regarde avec tendresse son perroquet perché sur son doigt ; toutes ces fraîches beautés suspendues autour de vous, ce sont les aïeules ou les bisaïeules de ces honnêtes vieillards à moustaches grises. Cet octogénaire de fraîche date, coiffé à la Titus, a près de lui son père, mort à vingt-quatre ans ; de l’autre côté, son grand-oncle, décédé au berceau. C’est un pêle-mêle d’âges, de temps, un logogriphe chronologique à ne s’y pas reconnaître ; enfin, c’est une scène de la résurrection, s’il faut ajouter foi à un système que, pour notre part, nous repoussons de toutes nos forces. Nous n’aurons tous qu’un même âge dans le ciel.
— Très-bien ! J’admets maintenant la relation d’idées entre votre bizarre collection de tableaux et le spectacle que devrait, selon quelques-uns, présenter le jugement dernier ; mais dans cette forêt, où, depuis que, sous cet abri champêtre, nous sommes tapis comme deux braconniers ou deux garde-vents, pas une figure humaine n’a passé devant nous, par quelle échelle intellectuelle votre pensée s’est-elle trouvée subitement transportée au milieu d’un musée de famille ?
— Voyez-vous cette touffe de bluets, jetée au bord de la route, ajoutai-je ; eh bien, voilà le premier échelon qui m’a permis de franchir en deux bonds la distance qui sépare la forêt de Marly de la vallée de Josaphat.
— Oui, me dit mon ami le voyageur après un moment de réflexion, il en est souvent ainsi ; malgré nous, à notre insu, nos souvenirs sont emportés de l’est à l’ouest, du nord au sud par l’oiseau qui passe, par une modulation qui se fait entendre au loin. Nous autres, dont les regards se tournent toujours avec tant d’amour vers ce vaste manteau de verdure, si richement brodé, qui couvre le sein de la terre, les fleurs doivent forcément jouer un grand rôle dans la transition de nos idées. Je n’ouvre jamais mon herbier sans le trouver rempli de souvenirs et d’anecdotes de tous les temps et de tous les pays.
— J’irai le feuilleter un jour avec vous.
— Volontiers ; mais d’abord dites-moi comment vos bluets vous ont, d’un premier bond, introduit au milieu d’une collection de tableaux ?
— En m’adressant cette question, vous ne croyez pas être indiscret, lui répondis-je, et cependant, vous me demandez là l’histoire de mon premier amour.
— Vraiment ! Enchanté de l’indiscrétion. Le premier amour peut toujours se raconter : il est, d’ordinaire, empreint de tant de pureté…
— Surtout celui-là ; ce fut une passion si follement idéale !… si complétement impossible !…
— Vous redoublez ma curiosité.
— Je vais la satisfaire, et en peu de mots. Ce que je vous ai dit précédemment me conduit, par une pente toute naturelle, à vous raconter comment, sous le toit d’une vieille mansarde, j’ai fait la connaissance de ma grand’tante.
— Il ne s’agit pas ici de votre grand’tante, mais de votre premier amour.
— Justement.
« A l’étage le plus élevé de la maison de mon père, il y avait une vaste chambre, garnie d’un assez bon nombre de ces portraits de famille dont on regarderait l’abandon comme un sacrilége, la destruction comme un crime, mais qu’on exile respectueusement dans le coin le plus reculé du logis, car ce sont, en général, d’horribles croûtes d’un aspect fort disgracieux.
« Par bonheur, ceux-ci se trouvaient si bien encrassés et tellement recouverts de poussière et de toiles d’araignées, qu’il n’était pas facile à la critique de s’exercer à leurs dépens. D’ailleurs, la critique montait rarement dans les mansardes.
« Mais moi, enfant, je m’y établissais volontiers ; je m’y sentais à l’aise, j’y pouvais impunément être espiègle et tapageur.
« Un jour, il me prit fantaisie de laver la tête de tous mes grands parents, dont à peine on pouvait distinguer le sexe à travers leur triple voile. Je parvins assez heureusement à en débarbouiller quelques-uns, et n’eus alors rien de plus pressé que de faire, au moyen d’un morceau de craie et d’une plume trempée dans l’encre, des moustaches à ces dames et des cornettes à ces messieurs. Comme j’étais à lessiver un de ces vieux portraits, il m’arriva de voir, sous l’éponge, apparaître de jolies petites joues, de beaux yeux clairs qui me regardaient d’un air de connaissance, une petite bouche charmante qui me souriait avec une grâce toute particulière. C’était une belle enfant, de treize à quatorze ans, d’un air timide et doux. Ses longs cheveux blonds, couronnés de bluets, encadraient le plus charmant visage… »
— Ah ! nous voici arrivés aux bluets ! interrompit mon ami. Désormais je ne rencontrerai plus la centaurea cyanus sans songer à vos amours. Continuez.
— Mais j’ai presque fini.
— Allons donc !
Je poursuivis :
« Ce portrait de jeune fille, je me sentais de la joie au cœur rien qu’à le contempler ; et plus je le contemplais, plus il me semblait avoir déjà vu ces petites joues-là sur la figure de quelqu’un ; ce front si pur ne m’était pas inconnu ; ces jolis yeux clairs, d’un vert gai, comme on dit, je les avais déjà rencontrés quelque part. A celle-là je ne fis point de moustaches.
« J’avais plusieurs jeunes parentes alors, fort gentilles, fort espiègles ; j’en vins à me rappeler que chacune d’elles possédait un de ces traits qui m’affriandaient si fort, mais aucune n’en présentait l’ensemble, aucune n’était aussi charmante que cette peinture, que cette belle enfant à la couronne de bluets. Était-ce donc une autre petite cousine que je ne connaissais pas encore ? N’importe ; en attendant que la connaissance fût faite, comme elle me regardait toujours avec son même sourire, je me pris d’affection pour elle ; je l’aimai. »
— Quoi ! cette image ?
— Oui, je l’avais descendue de son clou, placée commodément sur une vieille chaise dépaillée, afin qu’elle se trouvât plus à ma portée. Je l’associais à mes jeux, je lui parlais, je me répondais pour elle ; nous nous entendions très-bien, quand un jour, jour néfaste ! ma mère nous surprit ensemble dans la mansarde.
— Que s’ensuivit-il ?
— Une révélation terrible. Ma mère, tout en se retenant de rire à la vue des moustaches et des cornettes, après m’avoir vivement sermonné sur ma peinture impie, m’apprit que la jeune fille, la compagne de mes jeux, mon premier amour enfin, c’était sa grand’tante à elle, ma très-grand’tante à moi !
— Ah ! grand Dieu ! votre amour dut être tué du coup ? Tout amour sans espoir ne dure guère.
— Sans doute. Depuis, quand je revis ces traits qui m’avaient tant charmé, je les trouvai changés entièrement. Dans le regard de ma grand’tante, dans son sourire, auparavant si gracieux, j’entrevis quelque chose d’ironique et de narquois. Elle s’était moquée de moi évidemment. Avec cette niaiserie naïve de l’enfance, je supputai l’âge qu’elle aurait eu, si elle avait été vivante encore. J’en fus effrayé.
— Je le crois bien… Elle était morte à soixante ans, sans doute ; pour une grand’tante, c’est bien le moins, et il y avait peut-être plus de cinquante ans de cela !
— Aussi je me la figurais alors plus que centenaire, courbée en deux, la tête branlante, la bouche démeublée, le menton poilu, les yeux éteints, la paupière écarlate, assise dans un grand fauteuil, et grommelant quelques mots inintelligibles. Tous ces portraits de vieilles que j’avais moustachées, je me persuadais que c’était encore elle à des époques plus ou moins rapprochées, et je n’osais aller aux renseignements ; et quand on parlait devant moi d’une grand’tante quelconque, je rougissais de honte, comme si je les avais aimées toutes !
— Et à quel âge, en effet, était morte la pauvre vieille ?
— A seize ans.
— Plaît-il ?
— C’est ce que j’appris seulement quelques années plus tard. A cette époque, le temps des vacances venu, je quittai le collége pour aller passer tout un mois chez ma grand’mère, dans l’ancien Valois, sur la lisière de la Picardie. Ma grand’mère devait avoir connu ma grand’tante. Il me vint en pensée de demander des nouvelles de celle-ci à celle-là. Mon aïeule aimait à conter ; elle avait une mémoire prodigieuse ; au lieu de simples renseignements, j’eus une histoire complète que j’écrivis alors avec tous ses détails, et ma grand’tante fut alors le sujet de mon premier ouvrage, comme elle avait été l’objet de mon premier amour.
— Parbleu ! contez-moi ça… la chose vaut d’être connue.
— C’est une histoire bien simple et bien naïve, un drame purement villageois.
— Allez toujours. J’aime assez les histoires villageoises ; elles deviennent rares par le temps qui court. D’ailleurs, la pluie redouble ; nous n’avons rien de mieux à faire pour le moment.
Je commençai sur-le-champ mon récit.
Ma grand’tante Adèle avait passé sa vie dans les lieux mêmes où je me trouvais, à Béthizy, dans cette belle vallée suspendue aux flancs de la forêt de Compiègne, paysage ravissant, digne de la Suisse, auquel rien ne manque, ni les sites pittoresques, ni les souvenirs historiques, ni les ruines, ni les eaux, ni les ombrages. Cette tour de Saint-Adrien, de forme ovale, qui couronne le sommet de la colline, c’est ce qui reste du manoir royal de Philippe le Bel ; escaladez-en les hauteurs, à vos pieds est le château de la Douye, peut-être un débris, une grange aujourd’hui ; mais alors le père de ma grand’tante l’habitait avec elle, et le vieux bâtiment, réduit aux proportions d’une maison ordinaire, ainsi que ces anciens nobles ruinés qui s’obstinent à garder un titre qu’ils ne peuvent plus soutenir, restait château en dépit de l’apparence et s’appuyait encore, comme un vieux frère d’armes, sur les restes de l’ancien palais du roi Jean ; car le Valois conserve de tous côtés les traces de cette race de rois qui lui avaient emprunté son nom.
Là, servant de route principale au pays et remontant vers la forêt pour gagner les plaines du Soissonnais, voici la chaussée de Brunehaut, grande voie romaine, réparée par cette terrible reine, dont peut-être dans l’ancien Valois seulement le nom n’éveille pas un sentiment d’horreur ; bien au contraire, car la chaussée de Brunehaut a été métamorphosée en Chaussée des Pruneaux.
Plus loin, c’est le Champ dolent, le champ des plaintes et des gémissements. C’est là qu’un lieutenant de Philippe-Auguste tailla en pièces une armée anglaise, ce qui valut au village de Géroménil, qui en est proche, sa dénomination plus récente de Saint-Sauveur. Aujourd’hui, de vastes chènevières croissent sur toutes ces tombes, ignorées de celui même qui les bouleverse du soc de sa charrue. A droite, du côté de Saint-Wast, sont d’autres tombes aussi, les merveilleuses pierres druidiques de Rhuys, hantées nuitamment par les loups-garous.
Détournant vos yeux de ces grandes batailles si vite oubliées, de ces palais royaux si promptement renversés, reportez-les sur ce bel horizon de verdure que dessine autour de vous la forêt, sur ces maisons blanches à volets verts, sur ces terrasses, sur ces chaumières formant ceinture autour de la colline de Saint-Adrien : c’est Béthizy. Suivez du regard ces lignes d’argent qui coupent les prairies ; ce sont les ruisseaux de Boneuil, des Buttes et de Néry, tous trois allant rejoindre la jolie rivière d’Autonne, qui elle-même, après avoir empli les grands étangs de Pontdron et du Berval, va se jeter dans l’Oise, au-dessus de Verberie.
Ces lieux, depuis mon enfance, sont restés purs, charmants, animés, dans un coin réservé de ma mémoire, et quand je m’y transporte en idée, le souvenir et l’imagination aidant, je les revois non-seulement tels que je les ai connus, mais aussi tels que les récits de ma grand’mère me les ont fait connaître, tels qu’ils étaient au milieu du siècle dernier, du temps de ma grand’tante.
Élevée au couvent des dames de Crépy, grâce à l’instruction des bonnes religieuses, ma grand’tante y avait puisé de saintes et fermes croyances ; mais dans les entretiens de ses jeunes compagnes, elle avait acquis, en plus, une crédulité à peine imaginable. Il n’était question parmi celles-ci que de revenants et de sorciers, de divinations par les cartes ou par les dés. Les bonnes sœurs avaient appris à ma grand’tante à aimer Dieu ; les jeunes filles, à craindre le diable.
Si elle avait vécu de nos jours, Spurzheim eût certainement trouvé en elle l’organe de la merveillosité. Je me rappelle en effet que sur son portrait elle avait, à l’angle de l’œil, un certain renflement signalé par le célèbre phrénologue, et qui donnait à son sourire même un air étonné.
Quand Adèle, c’était son nom, après la mort de sa mère, revint à Béthizy, pour tenir le ménage du survivant, il était curieux de voir cette jeune maîtresse de maison se signer, se troubler, s’interrompre dans un ordre à donner, à la vue du sel renversé, de deux couteaux en croix et autres signes néfastes ; se sauver ou défaillir, quand, la nuit venue, certains bruits se faisaient entendre du dehors. Ne se sentant plus protégée par les murs de son couvent, l’esprit plus impressionnable depuis sa douleur récente, elle ne rêvait que fantômes dans la maison, gobelins et farfadets dans les bois, loups-garous et sorciers dans les champs.
Pour son malheur, ces idées étaient en partie celles des gens avec qui elle avait à vivre.
A Béthizy, on croyait surtout à la bête de la Chambrerie. C’était une espèce de monstre, la transformation hideuse d’un ancien prieur du pays. Chambrerie ou prieuré avaient alors même signification. Ce prieur, épris d’un amour sacrilége pour une jeune religieuse, sa pénitente, avait trouvé moyen de l’attirer chez lui, à force de ruses et de faux prétextes. Bientôt éclairée sur ses projets, la jeune fille s’était sauvée à travers l’église et avait cherché un refuge au pied du maître-autel ; mais jusque-là le monstre l’avait poursuivie. Elle était perdue quand, levant ses yeux éplorés vers l’autel, elle vit Jésus-Christ descendre de sa croix, saisir de ses deux mains ce bois qui avait été l’instrument de son supplice et en décharger un coup si violent sur la tête du prieur que celui-ci tomba mort.
On ne pouvait le mettre en terre sainte ; il fut déposé sous la principale des pierres de Rhuys ; mais par la puissance de Satan, qui régnait de ce côté, il reparut bientôt sous la forme d’un animal immonde. Il se montrait de préférence dans les ruines de la tour de Saint-Adrien, dont il habitait les voûtes souterraines. Il n’en sortait que lorsque quelqu’un du pays devait mourir bientôt. Alors il faisait entendre de sinistres hurlements en signe d’avis, et des cloches invisibles tintaient d’elles-mêmes dans les airs.
Trois jours de suite, la bête de la Chambrerie avait hurlé et les cloches avaient tinté pour la mère d’Adèle ; du moins on le disait ainsi, et la jeune fille crédule n’était que trop disposée à ajouter foi à toutes ces choses surnaturelles. Qui eût pu combattre en elle ces fâcheuses impressions ? Elle avait un frère, son aîné de dix ans ; mais ce frère, marié déjà, occupait un emploi dans une province éloignée ; son père, lieutenant des chasses de la capitainerie de Compiègne, presque toujours hors de chez lui, aussi occupé de ses propres plaisirs que de ceux du roi, la raillait bien quelquefois sur ses folles terreurs et sur l’adhésion donnée par elle à toutes les superstitions populaires ; mais le plus souvent il en riait, sans songer à la détourner, par le raisonnement, de ces dangereuses tendances.
Avec le temps, cependant, ma grand’tante avait senti ses prédispositions au merveilleux s’adoucir, se modifier en partie. Les conseils du curé, le soin qu’il prit de lui imputer à péché ses terreurs superstitieuses, puis enfin l’âge de raison qui venait, car elle touchait à sa quinzième année, tout concourut à la remettre à peu près dans un sens droit ; mais il lui resta toujours quelque chose de ses anciennes appréhensions. Ce quelque chose, c’était une poltronnerie naïve, une timidité d’enfant qui, jointes à la vivacité naturelle de son âge, à l’espèce de réserve et de dignité que lui commandait sa position exceptionnelle de reine du logis, donnaient à son caractère, à ses allures, de certaines bizarreries, de certains contrastes qui n’étaient pas sans charmes.
M. le lieutenant des chasses Dampierre, outre les revenus, exemptions et priviléges de sa charge, possédait quelques arpents de terre dans le pays, et deux moulins sur la rivière d’Autonne. L’individu auquel ces moulins étaient affermés, le nommé Brulard, avait une fille dont Adèle, faute de mieux, faisait sa meilleure amie. Voulait-elle se reposer de ses travaux du ménage ; son père, pour raison d’administration ou autre, entreprenait-il un voyage à Versailles ou à Compiègne, c’est vers Martine, vers le hameau de Glaignes qu’Adèle courait aussitôt pour trouver une compagnie. Heureuse alors de n’avoir plus à commander à personne, elle redevenait une jeune fille vive et rieuse, aimant les jeux, les exercices de son âge, escaladant les échaliers, s’ébaudissant comme il est toujours permis de le faire à quinze ans, mais avec son amie seulement, car à l’aspect du premier visage étranger qui survenait, rentrée aussitôt sous sa carapace de demoiselle, elle baissait les yeux et restait roide comme un piquet, muette comme un poisson, jusqu’au moment où l’heure des ébats sonnait pour elle, c’est-à-dire jusqu’à ce que le visage étranger eût disparu.
Martine Brulard avait quelques années de plus qu’Adèle, des yeux noirs qui ressortaient vifs et brillants sur son teint légèrement mordoré par le soleil ; le nez retroussé, les narines ouvertes, les cheveux crépus, la bouche souriante et les dents blanches et nettes. Avec ses formes franchement accusées et son allure joviale, c’était ce qu’on appelle un beau brin de fille. Toutefois, malgré cette apparence de jovialité, Martine avait les passions ardentes, et, par contre, était susceptible de plus de dissimulation et de jalousie qu’on ne s’y fût attendu de la part d’une personne aussi bien portante.
Un jour, profitant d’une vacance, ma grand’tante était auprès de son amie. Celle-ci, qui aimait à jouer à la petite maman, se plaisait à l’attifer, à lui boucler les cheveux. Assises sur un tronc d’arbre jeté à terre au milieu d’une grande cour de ferme, n’ayant d’autres témoins qu’un vieux chanvrier, endormi sur un tas de javelles, et une bonne vache noire qui, d’un air mélancolique et stupide, les regardait de l’autre côté de l’échalier, les deux jolies filles s’occupaient à tresser en guirlande les bluets qu’elles venaient de cueillir dans les champs. La guirlande faite, Martine en couronna la tête de ma grand’tante, et elle la trouva tellement à son gré ainsi qu’elle en battit des mains et l’embrassa pour la remercier d’être si jolie.
— Savez-vous, mam’zelle Adèle, que les filles du pays feront bien, à l’avance, de s’approvisionner d’amoureux, car, d’ici à deux ans, ils pourraient bien tous courir après vous ?
— Oh ! qui songe à cela ? Je ne suis pas encore en âge d’être mariée ; et d’ailleurs, c’est un soin qui ne regarde que mon père, répond ma grand’tante, du ton d’une fille bien élevée et qui se souvient encore du couvent.
— Mais votre père a d’autres occupations en tête, reprend Martine ; il est plus de son métier de chasser pour le roi que de chasser pour vous. Je le soupçonne plus adroit vis-à-vis des sangliers que des galants ; donc vous ferez bien de ne pas trop compter sur lui, sinon gare à sainte Catherine !
— Eh bien ! le beau malheur ! réplique l’autre en souriant. Sainte Catherine est une bonne sainte et me ferait alors une bienheureuse patronne de plus. On n’en saurait trop avoir. Puis, ajoute-t-elle avec une certaine gaucherie d’innocence, des galants, il faudrait, pour en trouver, chasser bien loin, au moins jusqu’à Senlis ou Compiègne, car dans ce pays-ci il n’y a que… que des sangliers !
— Oh ! dit Martine, il y a peut-être aussi des amoureux ; en cherchant bien… Quelquefois, au moment où on s’y attend le moins, il vous en part un à deux pas. Le tout, c’est de ne pas le manquer.
— Avez-vous cherché, vous, Martine ?
Martine rit aux éclats et ne répond point ; et pourtant, la conversation une fois sur ce sujet, elle se sent tentée, par vanité, de prendre Adèle pour confidente…
C’est que Martine a cherché, elle, et elle a trouvé.
Un fils de bonne famille, un jeune homme nommé Charles Doisy, ou d’Oisy, les renseignements m’ont manqué pour l’apostrophe en plus ou en moins, était venu habiter pendant quelque temps le petit domaine de Champlieu-lez-Béthizy, qui appartenait à son père. Martine, fille unique du meunier-fermier Brulard, qui faisait à la fois le commerce des farines, des chanvres et des bestiaux, pouvait aspirer aux meilleurs partis du pays ; elle vit le jeune homme, il lui plut, et elle ne le manqua pas.
Comme il semblait peu disposé à s’enamourer d’elle, elle lui fit des avances auxquelles il s’empressa de répondre comme il le devait.
Pourtant l’amoureux en question avait une autre passion dans le cœur, passion plus ancienne et plus forte sans doute que celle qu’il éprouvait pour mademoiselle Brulard. Il était fou de peinture. Élève de la Tour, il promettait déjà d’être digne d’un tel maître, lorsque son père, jetant au vent palettes et pinceaux, pour le dérouter sur les arts, sur les artistes et sur toutes les séductions de Paris, l’avait envoyé à Champlieu tomber sous les séductions de la jolie meunière.
Quelques mois après, le jeune homme se sentait saisi d’un nouvel enthousiasme ; il ne s’agissait plus seulement de s’illustrer par les arts, mais par la guerre. L’amour de Martine se trouva saisi entre deux gloires comme la gaufre entre deux fers brûlants, et Charles Doisy, après lui avoir juré une constance éternelle, se rendit à Melun où il s’engagea dans le régiment de hussards commandé par le lieutenant général comte de Berchiny.
Voilà ce que Martine avait bonne envie de conter à sa jeune camarade, mais réfléchissant que déjà, depuis quelque temps, elle n’avait point reçu de nouvelles de Charles Doisy, qu’il pouvait changer d’amours et elle aussi, que sa confidence alors tournerait à sa honte, elle se retint. Une autre idée, non sans quelque rapport avec la première, lui traverse la tête ; elle propose à Adèle de lui faire les cartes, d’interroger à elles deux le sort sur le mariage qui leur est réservé.
Adèle résiste ; trop crédule encore, livrant trop facilement sa confiance à ce genre de prédictions, elle craint de s’engager de nouveau dans cette voie que le curé lui a interdite. Cela peut être un jeu, une manière d’amusement pour Martine ; pour elle, c’est chose sérieuse et blâmable.
— Quoi que vous en disiez, je vais chercher des cartes, reprend obstinément Martine.
— A quoi bon ? dit une voix qui les fit tressaillir toutes deux.
C’était celle du bonhomme qui dormait sur les javelles. Au milieu de leurs causeries et de leurs préoccupations, elles avaient oublié qu’il était là ; aussi, son interruption inattendue leur causa-t-elle d’abord une grande surprise mêlée d’émotion.
— Chut ! fit Martine à sa compagne.
Et se penchant vers elle, lui désignant du doigt le chanvrier, qui dormait toujours ou faisait semblant de dormir :
— Il a raison, au fait, à quoi bon des cartes, puisque nous l’avons là, près de nous ? lui dit-elle tout bas ; c’est le père Hubert, celui que les paysans appellent le Vieux Rouisseur. Je ne crois pas beaucoup à sa science, ajouta-t-elle en prenant un ton d’esprit fort ; mais n’importe ! essayons. Ils disent tous qu’il est sorcier.
A ce mot de sorcier, Adèle tressaillit de nouveau, et tandis qu’elle tenait ses yeux attachés sur le vieillard, qu’elle contemplait avec une curiosité inquiète son front chauve et proéminent, sa tête énorme parsemée de touffes de cheveux d’un blanc verdâtre et comme fichée sur un cou grêle et long :
— Père Hubert, dit Martine en s’adressant au bonhomme, dormez-vous ou veillez-vous ?
— Je dors et je vois, répondit celui-ci, les yeux fermés et sans bouger de place.
— Eh bien ! pourriez-vous nous donner des nouvelles de nos épouseurs futurs ?
— En voici un qui arrive, dit le Vieux-Rouisseur.
— Vraiment, Hubert ? en êtes-vous bien sûr ? Et qui doit-il épouser ?
— Une des deux.
— Mais laquelle ?
Le vieux se tut, et Martine ne put parvenir à lui faire rompre son silence.
— Eh bien ! dit-elle, puisqu’il arrive, et qu’il est destiné à l’une de nous deux, tirons l’amoureux à la courte paille !
Elle prit un brin de chanvre à l’une des javelles, le rompit en deux, cacha dans sa main les fragments inégaux, et ne laissant passer entre ses doigts que deux extrémités absolument pareilles, elle donna à choisir à sa jeune compagne.
Après quelque hésitation, celle-ci, excitée, raillée, poursuivie par Martine, se décida enfin, prit au hasard et tira la longue paille.
— Bravo ! bien joué, bien choisi ! cria la fille du meunier ; elle ne coiffera donc pas sainte Catherine. Voilà le futur trouvé !… Pourvu qu’il vienne !… pourvu qu’il plaise !… que ce ne soit pas un sanglier de Saint-Sauveur ou de Béthizy !… Oh ! pauvre mam’zelle Adèle, il n’y a pas à dire, il faudrait épouser tout de même… c’est le sort qui le veut.
Tandis qu’elle multipliait encore ses interprétations au milieu des éclats de rire, et qu’Adèle, immobile, les joues empourprées, regardait son fétu de paille d’un air tout honteux et contrit, sans savoir si elle devait rire aussi ou s’alarmer, le galop d’un cheval se fit entendre ; à travers un flot de poussière, un uniforme de hussard brilla un instant, et bientôt Charles Doisy entra dans la cour.
Le beau régiment des hussards de Berchiny, changeant de garnison, était, depuis la veille au soir, installé à Compiègne, et notre jeune homme, récemment élevé au grade de maréchal des logis, n’avait eu rien de plus pressé que de venir faire briller ses galons à la ferme des Brulard.
A peine à bas de sa monture, l’œil animé, les bras ouverts à demi, il se dirigea vers Martine. S’apercevant qu’elle n’était pas seule, il fit un double salut et s’arrêta ensuite comme émerveillé à l’aspect de l’autre jeune fille, qu’il n’avait d’abord qu’entrevue.
Adèle avait conservé sa couronne de bluets, sous laquelle ressortaient si bien ses beaux cheveux blonds, bouclés et abondants ; le visage éclairé par un rayon de soleil et mieux encore par ces impressions diverses éveillées en elle, grâce à l’imprudence de Martine, à la prédiction du vieillard, à la présence du jeune homme, levant vers ce dernier un œil timide et curieux à la fois, sans sortir de sa presque immobilité, elle le regardait avec cet air d’extase et d’étonnement dont on accueille celui qu’on attendait sans espoir de le voir arriver. Sur sa physionomie, dans son maintien, dans son geste, il y avait alors plus de grâce, plus de beauté qu’elle n’en avait jamais eu, qu’elle n’en devait jamais avoir peut-être ; car il en est de la beauté des femmes comme du courage des hommes ; elle a ses instants d’exaltation qu’elle emprunte aux grands mouvements de l’âme.
Quand elle eut pu remarquer l’attitude du jeune militaire, et quel regard répondait au sien, elle se troubla, et dans son trouble, elle laissa tomber le petit fétu de paille qu’elle tenait encore à la main.
Elle se baissa pour le ramasser.
Ce mouvement n’échappa point à Martine, déjà irritée de cette distraction qui avait paralysé le premier élan du jeune hussard ; à Martine déjà mécontente d’elle-même, à qui il fâchait d’être venue si mal à propos, par son épreuve de la courte paille, déranger un horoscope qui certainement ne pouvait regarder qu’elle.
La voix glapissante du meunier Brulard qui survint, mit fin à toutes ces émotions, ou du moins les fit rentrer au cœur de chacun de nos personnages. Il avait entendu le galop d’un cheval et accourait prendre connaissance du visiteur.
— Comment, c’est vous, farceur ! dit-il, lorsque, après un moment d’examen, il eut reconnu le jeune homme sous son nouvel uniforme. Est-il faraud ainsi ! Ça lui va bien tout de même, n’est-ce pas, Martine ?
Martine, modeste par mauvaise humeur, baissa les yeux sans répondre ; elle ne put néanmoins se défendre d’un sentiment de joie en entendant le jeune homme annoncer qu’il était de nouveau devenu le voisin de la ferme, puisque son régiment allait rester à Compiègne.
Ce sentiment de joie de Martine, une autre le partagea sans doute.
— Vive le roi ! reprit le fermier-meunier ; ainsi, l’ami, on vous verra de temps en temps, comme par le passé ; vous viendrez encore dessiner notre ferme, notre grange, notre vache, notre moulin, tout croquer, comme vous dites, jusqu’à not’ fille et not’ femme. Mais, à propos de not’ femme, va-t-elle être contente de vous voir ainsi tout galonné ! Entrez donc l’embrasser un peu, vous boirez un coup après ; ça vous donnera l’occasion d’essuyer vos lèvres, si vous êtes dégoûté.
Charles Doisy, en galant militaire, offrit son bras à Martine. Martine refusa de le prendre et s’empara de celui de son père.
Dans ce mouvement de dépit, le jeune homme ne voulut voir qu’une mesure de prudence et de circonspection. Il s’adressa donc à l’autre jeune fille, qui n’osa le refuser, mais se sentit bien honteuse et bien émue en se trouvant ainsi accrochée au bras d’un hussard.
Tout le temps qu’on passa à la ferme, Charles Doisy, placé près d’Adèle, fut avec elle empressé, courtois, galant même, et, vers la brune, lorsqu’elle retourna à Béthizy, il ne manqua pas de lui faire la conduite avec les autres.
Doué d’un caractère loyal et sincère, d’une grande susceptibilité sur tout ce qui touchait à l’honneur, mais non sur ce qui n’avait rapport qu’à l’amour, Charles Doisy, n’ayant rien compris aux jalouses réticences de Martine, ne craignit point, lorsqu’on se fut séparé d’Adèle, de mettre tout d’abord, de lui-même, la conversation sur la grâce toute particulière de la jeune fille. Il l’avait admirée surtout lorsqu’en arrivant à la ferme, il l’avait entrevue, rougissante, palpitante, émotionnée de son arrivée, sous sa couronne de bluets, et il la comparait à une madone, à une nymphe des champs. Il était peintre et s’enthousiasmait facilement.
De même qu’elle s’était repentie d’avoir songé à l’épreuve de la courte paille, Martine éprouva un regret profond d’avoir placé sa couronne de bluets sur la tête blonde de celle qu’elle regardait déjà comme sa rivale ; mais elle savait dissimuler. Elle se garda bien de contredire les éloges prodigués à l’autre ; elle ne laissa plus rien percer, pour ce jour-là, de son mécontentement ; seulement, elle se promit tout bas de parer au danger, et le plus promptement possible.
A la visite suivante que fit Adèle à la ferme, elle fut reçue par Martine avec de grandes démonstrations d’amitié. Elle ne pouvait mieux arriver ; elle allait assister et même prendre part à une pêche d’écrevisses et d’anguilles, ce qui ne pouvait manquer de lui procurer un grand divertissement.
Adèle en sauta de joie ; puis, par réflexion :
— Mais je ne sais pas pêcher, dit-elle.
— C’est bien vite appris, lui fut-il répondu. Il ne s’agit que d’une pêche à la main ; rien n’est plus amusant, vous verrez ; surtout par ce clair soleil et par la chaleur qu’il fait ; on voudrait n’en avoir jamais fini. Mais avant de nous mettre en besogne, il faut d’abord prendre un costume pour la circonstance, vous surtout, mam’zelle ; moi, je n’ai rien à gâter.
Et elle enleva à sa jeune et confiante amie la cornette à rubans rouges qui lui seyait si bien ; elle lui fit quitter sa robe de droguet de soie et sa guimpe de mousseline, qui faisaient si gracieusement valoir sa taille et ses blanches épaules ; elle lui encaissa les pieds dans des sabots, pour les protéger contre les cailloux de la rivière, car il fallait entrer dans l’eau ; puis, comme dernière précaution, elle la cuirassa du haut en bas d’un long tablier de grosse toile, à large bavolet. Adèle riait de son singulier accoutrement ; cependant :
— Vous êtes bien sûre qu’il ne viendra personne ? dit-elle.
— Oh ! non, il est déjà venu ce matin.
La jeune fille rougit d’avoir été si vite et si bien devinée.
— Oui, poursuivit Martine d’un ton d’insouciance, où perçait néanmoins un sentiment d’orgueil mal déguisé, il avait une ordonnance, un message du gouverneur de Compiègne, le duc d’Humières, pour le grand bailli de Crépy, le duc de Gesvres ; il a trouvé que c’était le plus court de traverser la forêt et de passer par la ferme.
Adèle s’imagina que, peut-être, Charles Doisy avait espéré l’y revoir encore ; sa pensée n’alla pas plus loin, et cette pensée suffit à redoubler sa belle humeur.
Les deux amies s’acheminèrent bientôt vers un endroit de la vallée où le ruisseau de Boneuil se jette dans l’Autonne. Jupons à demi levés, jambes nues, elles entrèrent dans le lit peu profond de la petite rivière ; de vertes oseraies leur servaient de rideaux.
Elles demeurèrent là quelque temps à l’œuvre ; Martine, plus brave et plus expérimentée, fouillant hardiment les sourives où se tenaient cachées les écrevisses, Adèle se contentant de les sonder d’une branche de saule, et reculant devant sa proie, quand elle était parvenue à la faire sortir du gîte, toutes deux riant, s’ébattant au milieu de l’eau, surtout Martine, qui, par manière de jeu, en inondait sa compagne, tandis que celle-ci, poussant des cris de joyeuse détresse, osait à peine riposter, dans la crainte de perdre son équilibre.
La pêche aux écrevisses terminée, on procéda à la chasse aux anguilles de roche. Hubert, le Vieux Rouisseur, qui connaissait les bons endroits pour ce genre de trouvaille, comme pour bien d’autres, les avait rejointes, armé d’un pic, et déjà, grâce à lui, des quartiers de grès et de silex avaient été soulevés, mettant à découvert les demeures souterraines des innocents reptiles. Mais cette fois ce n’était pas dans des eaux claires et transparentes qu’il allait falloir s’aventurer, mais dans des flaques de fange et de vase que l’on voyait se mouvoir et se gonfler sous les mouvements multipliés des habitantes du lieu.
Il s’agissait de les saisir avec assez de dextérité des deux doigts et du pouce, pour qu’elles ne pussent échapper en glissant.
Au moment de prendre part à cet autre divertissement, Adèle s’aperçut qu’elle avait peur des anguilles. A peine engagée dans le marais, debout sur un fragment de rocher qui lui servait de piédestal, malgré les exhortations réitérées de Martine, elle refusait d’aller plus avant, lorsque le Vieux Rouisseur qui, les bras croisés, appuyés sur son pic, les avait observées quelque temps l’une et l’autre, passant près d’elle, lui dit tout bas :
— Méfiez-vous ! le cheval est là-bas, mais le cavalier n’est pas loin.
Au même instant, par une feinte maladresse de la fille Brulard, un des larges quartiers de silex, soulevés par Hubert, retombait au milieu de la fange, et inondait la poltronne d’eau boueuse et noirâtre.
Pour faire disparaître les traces de cette affreuse aspersion, Adèle regagna, en toute hâte, la rivière, et comme elle en atteignait le bord, une tête sortit d’entre les osiers, et elle se trouva en face de Charles Doisy, non plus, cette fois, avec les avantages d’une mise coquette et soignée, mais avec son tablier de grosse toile, ses sabots embourbés, ses cheveux humides, déroulés, ruisselants, et le visage marbré, maculé de fange.
Elle eût voulu pouvoir se cacher dans un des gouffres de la rivière, mais la petite rivière d’Autonne n’a jamais eu de gouffres.
La pauvre enfant venait de subir la vengeance d’une rivale, une vengeance de villageoise, et la fille Brulard qui, le matin même, avait donné dans cet endroit rendez-vous au jeune militaire, à son retour de Crépy, avait habilement préparé son coup.
Rentrée chez son père, Adèle se sent le cœur contrit et désespéré. Elle ne peut se consoler de s’être montrée dans un pareil état devant le jeune homme : Quelle opinion doit-il avoir d’elle maintenant ! Elle est loin cependant d’accuser Martine de sa mésaventure, elle s’accuse elle-même. Pourquoi avait-elle pris part à des jeux, à des occupations pareilles, dignes tout au plus d’une servante de ferme ? Cela était-il convenable ? Non, et Dieu l’en a punie ; elle l’avait bien mérité ; mais, à vrai dire, le châtiment surpasse la faute.
Après sa première entrevue avec Charles Doisy, la prédiction du vieillard endormi, le hasard des pailles qui le lui donnaient pour futur époux, avaient occupé ses rêveries de jeune fille ; elle le revoyait encore devant elle, sous son bel uniforme de hussard qui lui allait si bien, dans son attitude de surprise admirative. Puis il s’était occupé d’elle comme jamais homme ne l’avait fait jusqu’alors ; elle, de son côté, s’était sentie, en l’écoutant, heureuse d’un bonheur qu’elle n’aurait su définir, mais que nul autre ne lui avait fait éprouver.
Les choses étant ainsi, était-il donc si déraisonnable de supposer possible l’accomplissement de la prédiction ? Le jeune homme n’est que maréchal de logis, il est vrai, mais sa famille est honorable, et les protections ne lui manqueront point sans doute.
Voilà ce qu’elle pensait, voilà ce qu’elle se disait le matin, le soir et à toutes les heures de la journée ; mais aujourd’hui ses rêves ont pris leur vol pour ne plus revenir, et la prédiction a menti. Il ne pourra jamais l’aimer, et c’est bien naturel ; elle ne retournera plus à la ferme, elle craindrait de l’y rencontrer. Pourrait-il en la revoyant s’empêcher de rire, de se moquer d’elle ? et c’est là une humiliation qu’elle ne se sent pas la force de supporter.
Pendant plus d’une semaine toutes ces mêmes idées ne firent que tourner et se répéter dans sa tête.
Elle n’entendait plus parler de Martine, quand un jour, vers le midi, le meunier Brulard, suivi du Vieux Rouisseur, qui portait un paquet de chanvre, un sac de blé noir et deux chapons gras, se présenta au château de la Douye. Il venait payer au lieutenant des chasses ses redevances, en argent et en nature, pour le loyer des deux moulins. En l’absence de celui-ci il remit l’argent à Adèle.
— Eh bien, lui dit-il, on ne vous voit plus, la belle enfant. Est-ce que nos anguilles vous font toujours peur ?… Faut pas rougir pour ça ; c’est matière à rire et voilà tout ; aussi nous en avons bien ri avant-hier encore, avec ce farceur de Doisy…
— Quoi !
— Ah ! c’est surtout son camarade, un vrai boute-en-train, qu’il nous a amené, et qui a failli en crever, quoi ! Il est vrai que Martine conte ça gentiment.
Adèle se promit bien d’en garder rancune à Martine.
— Enfin, reprit le meunier, ça l’a tant amusé, ce militaire…
— Qui ? interrompit de nouveau la jeune fille, d’une voix altérée : M. Doisy ?
— Eh ! non, son camarade ; histoire de faire enrager le maréchal des logis, vous comprenez bien, parce que, censé, vous ayant déjà rencontrée une fois à la maison, il s’était rendu amoureux de vous à la première vue. Il était revenu une seconde, à votre intention, toujours censé pour vous surprendre au bain, derrière l’oseraie ; voilà comme ils arrangent ça… Il vous avait guettée… c’est peut-être vrai ensuite, et au lieu d’une nymphe, comme il dit, le maréchal des logis a trouvé une pêcheuse d’anguilles sous roche ! C’est Martine qu’a fait le discours comme ça ; elle a tant d’esprit, Martine !
Et le Brulard rit d’un gros rire, brutal comme son esprit, et, tout en riant :
— Oh ! si vous les aviez vus, ça vous aurait-il amusée ! Le maréchal des logis faisait semblant de se fâcher, et l’autre farceur, son camarade, pour mieux le faire endêver, disait qu’il conterait, le soir même, l’histoire au régiment… C’est qu’il en est bien capable ! car c’est un bien bon garçon, tout d’même, qui ne boude pas, un bon vivant, quoi ! On en parle peut-être à Compiègne à l’heure qu’il est de vos anguilles ; pourquoi n’en parlerait-on pas bientôt à la cour, puisqu’on attend le roi ? Oui, mam’zelle, le roi et madame de Pompadour, qui chasse aussi, elle, pas aux anguilles, mais aux lapins, et à bout portant, c’est plus commode. C’est sans doute pour ça que vot’ père est absent ? Il aura été panneauter dans les réserves. Lui en avez-vous parlé de l’histoire des anguilles à vot’ père ? Non ? Vous avez eu tort, car c’est drôle.
Sous prétexte d’ordres à donner, Adèle se leva hors d’elle-même et courut à la cuisine.
Elle y trouva le Rouisseur qui venait d’y déposer les deux chapons. Il était dans un coin, assis sur un escabeau, mangeant, sous le pouce, un morceau de lard et du pain bis que Mariote, la servante du logis, s’était empressée de lui servir. Sa grosse tête, que pouvait à peine soutenir son cou long et mince, reposait sur son épaule, dans une pose de pélican. Lorsque Adèle entra, il souleva sa tête, la balança de droite à gauche, en signe de salut, puis il prit un verre de vin placé devant lui, et l’élevant, comme pour un toast :
— En espérance et patience fait bon vivre, dit-il.
Après avoir vidé son verre d’un trait, il en laissa, une à une, tomber les dernières gouttes dans l’âtre ; ensuite, il sembla réfléchir et, comme s’il se fût reproché de payer son repas seulement par un proverbe, désignant un des chapons qu’il avait apportés :
— V’là le plus gros, dit-il à la cuisinière ; faudra pas tarder à le mettre à la broche.
Et, se tournant vers la jeune maîtresse du logis, clignant de l’œil, mettant un doigt sur sa bouche d’un air mystérieux :
— Car vous aurez une visite aujourd’hui, ajouta-t-il.
Adèle ne se sentait plus en disposition de prêter complaisamment l’oreille aux propos de l’oracle ; d’ailleurs, que lui faisait une visite ? N’en recevait-elle pas tous les jours, à toute heure, pour les affaires de vénerie, quand M. Dampierre n’était pas là prêt à répondre aux arrivants ? Ce n’était point une prédiction bien difficile à voir s’accomplir.
— Not’ demoiselle, lui dit Mariotte, quand Brulard et le Vieux Rouisseur se furent éloignés, il me cuide que pour c’te visite, un chapon tout seul ne fera mie l’affaire.
— Eh ! qui vous a fait croire que nous aurions du monde à dîner ? lui répondit Adèle.
— Qui ? Mais n’avez-vous pas ouï père Hubert, avant qu’il ne se retrahît ?
Il existe un pays dont il est encore aujourd’hui interdit au vulgaire des voyageurs de comprendre le langage. Ce pays, où tout semble extraordinaire, où la terre ne renferme pas un caillou, où les maisons se transportent à bras d’hommes, où l’innocence et la crédulité de l’âge d’or semblent s’être conservées dans toute leur pureté, il ne faut le chercher ni au milieu des archipels de la mer du Sud, ni des atollons des Maldives ; il est situé à quinze lieues de Paris, entre deux bras de l’Oise. C’est le Meux, célèbre seulement par ses fromages, mais qui mériterait de l’être sous bien d’autres rapports.
Mariotte, la servante de M. Dampierre, était du Meux, et mêlait volontiers à la langue commune les expressions naïves de cette vieille langue picarde, comme avait fait son compatriote Jean Froissart, dans un style différent, toutefois.
— Faut croire que c’te visite mangera, reprit-elle, puisque le devineur a parlé de mettre le plus gras à broche ?
— Le devineur ne sait ce qu’il dit !
— Oh ! not’ demoiselle, père Hubert n’est point un bourdeur ; c’est un malin qui oncques ne se trompit jamais sur ce qui doit avenir. Il y a deux ans, à la ducasse de Saint-Martin, il était à boire un souquet avec des compères, chez Moutonnet, le charron, qui vend du vin ; v’là qu’il se met tout de suite à crier : « Aïe ! — Qu’est-ce que c’est ? lui disent les autres. — Aïe ! qu’il répète ; il y a dans ce moment une branche et une jambe qui se cassent. » En effet, entrementes qu’il parlait, à deux lieues de l’endroit où il se trouvait, le fieu de la grande Durande, en allant dénicher des agaces, avait eu une branche qui s’était brisée sous lui tout de même, et en tombant, il s’était cassé, nenni la jambe, mais quasi le bras, dont il restait tout affolé. Vous voyez ben que père Hubert ne se trompe jamais. C’est un vieux qu’en sait, et les Brulard ne l’ignorent point. Sans ça, pourquoi qu’ils le garderaient chez eux, où il ne gagne même son nutriment, n’étant bon qu’à rouir un petit le chanvre ? Mais ils craignent qu’il ne leur soit à nuisance, à eux ou à leurs animaux, qu’il ne leur jette un sort ; et pourquoi qu’il ne le ferait pas, lui qui, à la main, prend les oisias qui volent, lui qui va à la chasse sans rêts, sans fusil et sans furons ? Il sait si bien charmer le gibier, rien qu’avec des mots, que pour le prendre il n’a qu’à ouvrir son bissac ; les lapins viennent à grand’foison, d’eux-mêmes, se bouter dedans, pour sa pourvéance. Moutonnet l’a vu ! Adonc, c’est pour vous dire, not’ demoiselle, que le monde que nous allons avoir à dîner fera chair piteuse si on ne met le chapon à la broche tout d’suite. M’est avis qu’il faudrait encore un petit d’autre chose. Le maître apportera peut-être une darne de venaison ; mais un bon poisson n’aurait pas été mésavenu. Si j’avais su ça au matin, Babet a passé devant notre ménil, venant de Boneuil, et elle avait des murènes, des anguilles, comme vous dites, qui vous auraient fait plaisir à voir, vous qui les aimez, not’ demoiselle.
Adèle jette un regard de colère à sa servante, et, sans lui répondre, elle rentre chez elle, s’y enferme et se met à pleurer de dépit, de douleur. Elle se sent irritée contre tout le monde ; contre ce Brulard, si grossier dans ses plaisanteries ; contre ce chanvrier, la cause première de ses chagrins ; contre sa servante, qui a su sa mésaventure sans doute, et qui prend à tâche de la lui rappeler. Mais c’est surtout à Martine qu’elle en veut : se moquer d’elle ainsi ! faire de Charles Doisy son complice, pour la rendre la fable et la risée de la maison, du village et peut-être de la ville, même de la cour, s’il en faut croire ce vilain meunier !
Comme elle se désole, elle entend la voix de son père ; il est de retour, il la demande.
Essuyant ses yeux à la hâte, pour qu’il ne puisse voir qu’elle a pleuré, elle s’empresse d’aller au-devant de lui, dans un couloir obscur qui précède sa chambre. Sans lui adresser un mot, afin de lui dérober l’émotion de sa voix, elle lui jette aussitôt ses bras au cou, l’embrasse et pousse un cri.
C’est que des moustaches ont effleuré sa joue, et son père n’en porte pas ; c’est qu’un sabre a retenti sur les carreaux du couloir, et son père, pour toute arme, n’a qu’un couteau de chasse. Cependant, c’est bien la voix de son père qu’elle a entendue !
Effrayée, haletante, elle retourne précipitamment dans sa chambre et tombe évanouie sur une chaise.
Quand elle rouvre les yeux, elle voit près d’elle, devant elle, Charles Doisy. Il était seul dans la chambre, seul avec elle ; il lui tenait la main et la contemplait silencieusement, avec un de ces regards expressifs et prolongés où l’âme se glisse tout entière.
Encore pleine du trouble causé par son évanouissement, Adèle croit être abusée par un rêve, elle sourit, et, avec un geste de tête familier, elle répond à ce regard qui semble l’interroger.
Dans ce moment, M. Dampierre rentre avec Mariotte, tout effarée… Il vient d’aller chercher de l’eau fraîche, des sels, du vinaigre.
— Ah ! te voilà revenue à toi, enfin, pauvrette, s’écrie-t-il en la retrouvant les yeux grands ouverts et le sourire sur les lèvres. Pardon, jeune homme, de vous avoir laissé là en guise de garde-malade ; mais, vous savez, il y a des moments où, ma foi, bonsoir au cérémonial ; puis, dans nos villages, voyez-vous, on ne suit guère l’étiquette de Versailles.
Adèle regarde tour à tour, avec stupéfaction, Charles Doisy, son père et Mariotte : elle ne peut comprendre comment, le jeune militaire étant là, Martine n’y est pas aussi. Elle croit toujours rêver.
— Comment te trouves-tu, pauvrette ? reprend le lieutenant des chasses ; bois ce verre d’eau, ça te fera du bien ; c’est le seul cas où l’eau soit bonne à quelque chose ; sans quoi, elle ne convient qu’aux carpes et aux anguilles, n’est-ce pas, camarade ?
Sans s’apercevoir de l’effet que ce terrible mot d’anguille produit sur la malade :
— Tu ne t’attendais pas à la visite qui t’arrive ? poursuit le père.
— Que si fait, not’ maître, interrompt la vieille servante.
— Comment ! vous saviez que je vous ramènerais un beau garçon ?
— Tout d’même !
— Et saviez-vous qu’il partagerait notre dîner ?
— Nous l’savions itou ; l’chapon est jà devant l’fec.
— Bah !… est-ce vrai, Adèle ?
— Oui, mon père.
— Le diable s’en est donc mêlé ? car nous n’avons rencontré âme qui vive depuis que la proposition est faite et acceptée.
— Par ma fi ! père Hubert voit de loin et entend de même, dit Mariotte.
— Quoi ! c’est ce damné rouisseur qui vous a dit…?
— Parbleu ! camarade, vous rappelez-vous, tandis que nous étions à nos panneaux, cette touffe de fougère qui remuait seule au milieu d’une broussaille ? Je croyais à un marcassin ; je parie maintenant que c’est ce vieux chien de braconnier qui était là à tendre ses lacets.
— Père Hubert braconnier ! père Hubert des lacets ! sainte Vierge, ma patronne ! s’écria la servante d’un air de révolte ; lui s’eschiver, se tapir, quand il pourrait comme un oisias chevaucher dans l’air sur une escoube ou sur des émolettes !
— Oui, mais s’il ne voyage pas, comme tu le dis, sur un balai ou sur des pincettes, c’est que probablement il n’a pas encore trouvé le moyen de se rendre invisible et qu’il craint un coup de fusil : c’est pour cela qu’il se cache.
— Jésus !
— Allons, tais-toi, vieille folle ; retourne à ta cuisine, et si tu t’avises encore de parler devant ma fille de pareilles sottises, je te chasse et j’envoie ton vieux braconnier opérer ses miracles devant la table de marbre, à Paris.
Quand ils furent seuls tous trois, Dampierre reprit, en s’adressant à sa fille :
— Ma chère enfant, voici un brave militaire que je te présente. Tu dois le reconnaître, bien qu’il ne t’ait vue encore qu’une seule fois, m’a-t-il dit, chez les Brulard.
Adèle, dans le fond de son âme, remercia le jeune homme d’avoir oublié leur seconde entrevue.
Le lieutenant des chasses poursuivit :
— C’est le fils de mon ancien camarade Doisy de Champlieu, qui nous a quittés depuis vingt ans pour se faire Parisien ; mais le fils nous est revenu, grâce à Dieu, car par lui je puis voir s’accomplir l’un de mes désirs les plus ardents.
Adèle crut qu’il était déjà question de mariage ; elle en ressentit plus de trouble que de joie, et, baissant la tête, elle porta son mouchoir à son visage pour cacher l’étrange émotion qui s’emparait d’elle.
— Comme quelquefois le hasard s’entend à nous bien servir ! continua le père. Le roi nous arrive demain, presque sans s’être fait annoncer ; il s’agit d’une chasse pour la marquise ; j’avais besoin d’aide pour le panneautage ; je m’adresse au lieutenant-colonel, M. de Tolt, et à mon ami le capitaine Pardaillan, qui m’envoient vingt gaillards vigoureux, commandés par le maréchal des logis que voilà ; au nom de Doisy, je dresse l’oreille ; nous nous abordons et je trouve en lui, non-seulement un auxiliaire actif et intelligent pour mes panneaux, mais aussi un peintre habile, qui va satisfaire au désir que je nourris depuis si longtemps, de pouvoir enfin placer ton portrait près de celui de ta mère !
En achevant, M. le lieutenant des chasses tendit la main au jeune homme, qui la lui pressa avec effusion.
Tous deux cependant avaient compté trop vite sur la bonne volonté du modèle.
Quand il s’agit de fixer un jour pour la première séance, Adèle déclara nettement qu’elle ne voulait pas se faire peindre, et, ni les ordres de son père, ni les supplications de l’artiste, ne purent un instant ébranler sa détermination.
Poser devant Charles Doisy, se tenir là, sous son regard, durant des heures entières, elle qui venait de l’embrasser par méprise, elle qui venait de lui sourire en croyant rêver, elle qui pour rien au monde en ce moment n’aurait osé lever les yeux sur lui ! Il lui semblait que sur son visage il devait retrouver encore les macules de fange qu’il y avait vues, et qu’il ne pouvait la représenter qu’ainsi.
L’artiste crut à un caprice de jeune fille ; peut-être entrevit-il la vérité.
Le père attribua les répugnances d’Adèle à quelque prédiction qui lui avait été faite, à quelque fâcheux présage. Sa mère était morte peu de temps après s’être fait peindre.
Nos gens étaient pressés de dîner pour retourner à leurs panneaux.
Adèle, sous prétexte de malaise, n’assista point au repas. En effet, elle était malade. Trop d’émotions diverses l’avaient agitée durant cette journée.
Le lendemain, la chasse de la marquise eut lieu. Un hussard de Berchiny, qui faisait partie de l’escorte d’honneur, fut assez heureux pour retenir le cheval de madame de Pompadour, au moment où celui-ci s’emportait.
Quelques semaines s’écoulèrent sans qu’on entendît parler du maréchal des logis.
Adèle avait eu le temps de se repentir d’avoir ainsi opposé un obstacle à la volonté de son père. Elle se sentait maintenant des dispositions de fille obéissante et soumise ; mais comment revenir sur sa décision précédente, déclarée par elle irrévocable ? M. le lieutenant des chasses semblait en avoir pris son parti et ne lui ouvrait plus la bouche sur ce qui avait été entre eux le motif d’une discussion et même d’une bouderie.
Un matin, comme elle s’habillait, son père lui-même vint l’avertir que le déjeuner l’attendait.
Quoique son service ne le réclamât pas impérieusement ce jour-là, et que l’heure habituelle du premier repas ne fût point encore sonnée, il était d’un appétit, d’une impatience que rien ne semblait motiver. Ne pouvant tenir en place, il allait et venait, piétinant dans la chambre de sa fille, s’asseyant, se levant, gesticulant devant elle, comme si tout le mouvement qu’il se donnait, en pure perte, dût accélérer les préparatifs de sa toilette, et par conséquent l’heure du déjeuner.
Il se mit ensuite en disposition de lui servir d’auxiliaire, de femme de chambre, et la retarda d’autant plus.
Tendait-elle la main vers une épingle, il s’élançait vers la pelote avec une impétuosité si peu calculée qu’il la jetait bas et l’envoyait rouler sous un meuble. Voulait-il se charger de défaire un nœud du lacet, il l’embrouillait de plus belle en voulant aller trop vite. Encore du temps perdu. Ainsi du reste. Adèle ne comprenait rien à cet appétit précoce et violent qui l’avait saisi de si grand matin.
— Mais qu’avez-vous donc, mon père, lui disait-elle, et qui vous presse ainsi ?
— Ce que j’ai ? répondait-il ; tu en parles bien à ton aise ; j’ai… j’ai faim ! Ne devons-nous donc pas déjeuner aujourd’hui ?
— Sept heures viennent à peine de sonner à l’église.
— L’église va mal.
— Eh bien, alors, puisque je suis en retard, commencez sans moi ; je vous rejoindrai bientôt.
— Je déteste manger seul !
Sans laisser à Adèle le temps de nouer son dernier ruban, il la força de descendre, et, quand elle entra avec lui dans la salle à manger, le couvert n’était seulement pas mis.
La jeune fille allait en témoigner son étonnement, lorsqu’elle aperçut devant elle, suspendu à un clou, son portrait ! oui, son portrait, frappant, saisissant de ressemblance.
L’artiste l’avait peinte de mémoire.
Ébahie, charmée, Adèle demeura quelques instants muette de surprise et de bonheur : elle était donc restée dans son souvenir ! Il avait donc bien songé à elle ! C’est telle qu’elle lui était apparue pour la première fois dans la cour de la ferme, qu’il l’avait représentée, avec sa robe d’étoffe claire, son tablier de soie, sa couronne de bluets, au moment où la courte paille le lui donnait pour futur époux !
Elle ne peut résister à toutes les pensées qui, alors, du cerveau lui descendent au cœur :
— Mon père, ah ! que je suis heureuse ! Il ne m’en a donc pas voulu ! Qu’il est bon ce jeune homme ! qu’il est aimable !
Peut-être allait-elle laisser échapper une exclamation plus capable encore d’exprimer ce qu’elle ressentait ; elle se retint à temps :
— Ah ! mon père ! que je vous aime ! dit-elle.
L’exclamation, déviant de sa vraie route, avait été frapper un autre but.
— Eh bien, pauvrette, lui dit le lieutenant des chasses, comme témoignage de ta reconnaissance, il ne te demande que de lui accorder une séance, une seule, pour qu’il puisse perfectionner son travail.
— Dix ! s’il le faut ! s’écrie la jeune fille.
— Alors, entrez, mon officier, dit M. Dampierre en poussant une porte qui de la salle à manger communiquait à un petit salon, où Charles Doisy s’était tenu pendant ce temps.
— Quand je dis mon officier, reprit le lieutenant des chasses, vous ne l’êtes pas encore, mais ça viendra, je l’espère.
— Dieu vous entende ! répondit le jeune homme en tressaillant.
Et, prenant tout à coup un air grave et résolu :
— Oui, il faut que je sois officier, et bientôt ! dit-il.
Le premier mouvement d’Adèle, en apercevant Charles, avait été de courir se réfugier dans un coin de la salle, le front contre la muraille ; mais son trouble ne l’empêcha pas d’entendre les paroles du jeune hussard, et ne pouvant les interpréter que dans ce sens, qu’il ne se croyait pas digne d’elle avant d’avoir conquis le grade d’officier, elle tourna brusquement la tête vers lui et, répondant à sa propre pensée plutôt qu’à celle du jeune homme :
— Oh ! rien ne presse ! dit-elle avec étourderie.
Honteuse ensuite, comme toujours, de ces élans de naïveté qui lui échappaient ainsi malgré elle, elle se rencogna dans son mur et il fallut que son père allât la prendre par la main pour la contraindre à remercier l’artiste au sujet du portrait.
Pour tout remercîment, elle lui fit une révérence.
Pendant le repas néanmoins, elle se montra vive, enjouée, tout à fait de son âge. Le jeune homme, au contraire, resta pensif et presque soucieux. Un observateur expérimenté eût bien vite reconnu qu’il y avait en lui quelque douleur secrète et permanente, logée profondément dans l’âme en dehors des tendres affections ; mais une fois qu’une idée d’amour à germé dans une tête de jeune fille, pour elle tout s’explique par l’amour.
Adèle ne traduisit pas autrement l’air soucieux et rêveur du beau hussard ; il l’aimait : le portrait n’était-il pas là pour le prouver ? et il se chagrinait de ne pouvoir encore demander sa main à son père. Partant de ce principe, plus elle le vit triste, plus elle se sentit heureuse et fière ; plus il resta silencieux, plus elle fut possédée d’une joyeuse loquacité qui lui était peu ordinaire. Charles Doisy finit par se laisser entraîner lui-même par cette belle humeur de la charmante enfant.
Quant à M. Dampierre, après avoir faussement tant parlé de sa faim, il avait fini par se l’exagérer si bien à lui-même, qu’il mangea outre mesure, but de même et fit seul véritablement honneur au repas qu’il avait préparé pour son hôte.
Le déjeuner terminé, Doisy prit les pinceaux et la boîte de couleurs qu’il avait apportés avec lui, et la séance commença, avec une entière bonne volonté, cette fois, de la part du modèle. Comme les peintres doivent toujours un récit quelconque au patient qu’ils tiennent sous leur pinceau, ne fût-ce que pour le tenir en éveil, Doisy se prit lui-même pour sujet de l’histoire qu’il avait à raconter. Il en vint à parler du temps de sa première jeunesse, de sa mère, des jeux de son enfance, et comment il s’était épris de l’art de la peinture, et de son exil à Champlieu. Il eut soin toutefois de passer sous silence les consolations qu’il y avait reçues ; il dit ensuite pourquoi son père voulant le contraindre à entrer en qualité de commis chez un financier, il avait préféré se faire soldat.
En écoutant ces demi-confidences qui semblaient établir entre eux des rapports d’intimité, ma grand’tante avait sur les lèvres ce sourire ineffable que le peintre avait habilement su saisir et qui m’avait tant charmé dans son portrait.
Ce portrait qu’il achevait, c’était celui-là que je devais retrouver un jour dans les mansardes de la maison de mon père.
Mais qu’éprouvait donc auprès d’Adèle Dampierre ce jeune hussard de Berchiny, dont jusque-là les sentiments étaient restés comme dans une sorte d’admiration silencieuse ? Charles Doisy n’avait pu voir Adèle sans s’éprendre de sa beauté, de sa candeur ; tout en elle, jusqu’à son aventure de la pêche aux anguilles, jusqu’à ses spasmes de pudeur ou d’effroi, lui apparaissait, dans son admiration d’artiste, étrange et charmant. Mais elle était encore si jeune ! Comment aurait-il osé lui parler d’amour ? Puis, il aimait aussi Martine… d’une autre façon, oui, mais il l’aimait.
A son âge, est-il sans exemple de se sentir dans le cœur deux cordes vibrantes à la fois ? Bien d’autres, parmi les artistes, parmi les hussards surtout, ont eu des claviers plus complets. Puis encore, il faut bien le dire, Charles Doisy, quoique brave, avait aussi sa faiblesse, son côté de pusillanimité et de poltronnerie. Il avait peur de Martine ! Il tremblait d’avance à l’idée de ses pleurs, de sa jalousie, de son désespoir. Croyant d’autant plus à son amour, qu’elle n’avait rien négligé pour l’en convaincre, il se regardait comme engagé à elle d’honneur, et, chez lui, tout ce qui touchait à l’honneur allait jusqu’à l’exaltation.
De même qu’il admirait la pudique naïveté de l’une, il avait su gré à l’autre de ses avances, de son audace passionnée ; il s’en était bien trouvé, et sa vanité y avait eu son compte. Philosophes, psychologues, chimistes du cœur, vous qui savez de quels éléments se compose l’amour, c’est à vous de nous dire pour quelle dose y entre la vanité.
Si notre jeune maréchal des logis se sentait entraîné vers Adèle par un sentiment plus doux, plus épuré, plus vif peut-être, ses instincts moins éthérés, plus positifs, le reportaient vers Martine. La première avait pour lui le charme de la nouveauté ; la seconde, la force de l’habitude. Il rêvait de Béthizy, mais c’est vers Glaignes qu’il se dirigeait d’ordinaire. Adèle était sa poésie ; Martine, sa réalité. Quand son âme était en joie, celle-ci lui venait la première à la pensée ; quand un sentiment de tristesse et de mélancolie le prenait, c’est l’image de celle-là qui lui apparaissait pour s’associer à ses peines.
Voilà pourquoi, depuis quelques jours, c’est Adèle qui triomphe dans son cœur ; pourquoi, à force de la voir des yeux de l’âme, il a pu se passer d’elle pour faire son portrait ; pourquoi, enfin, contristé, accablé, par une pensée poignante, étrangère à son double amour, à la veille de se séparer de toutes deux, c’est vers Adèle seule qu’il est venu.
La guerre de Hanovre, la guerre de sept ans allait s’ouvrir. En prenant congé de ses nouveaux amis, Charles Doisy, non sans étouffer un soupir, leur annonça que le lendemain il partait pour les bords du Rhin.
— Mais il me semblait que deux escadrons de votre régiment devaient seuls se mettre en route, et que le vôtre restait à Compiègne ? lui dit M. Dampierre. C’est du moins ainsi que me l’a conté Pardaillan, votre capitaine et mon ami.
A ce nom de Pardaillan, le visage du jeune homme se colora subitement.
— J’ai obtenu de quitter ma compagnie, répondit-il, pour passer dans une autre qui part sous les ordres de notre lieutenant-colonel, M. Tolt. Je vous le répète, il faut que je sois officier ou que je me fasse tuer !
Il pressa la main de son hôte et se disposa à faire ses adieux à la jeune fille ; mais elle n’était plus là, et le père, le valet et la servante eurent beau l’appeler, la chercher partout, dans sa chambre, dans le jardin, d’un bout à l’autre du vieux château de la Douye, elle ne reparut point.
Déjà le cavalier avait franchi la vallée d’Autonne ; il atteignait la lisière de la forêt lorsque, jetant un dernier regard vers Béthizy et cette maison qu’il venait de quitter, il vit à une petite fenêtre ogivale, qui faisait saillie dans la partie la plus haute des combles, un mouchoir blanc s’agiter.
Ce qu’il ne vit pas, c’est que ce mouchoir était trempé de larmes.
A quelques mois de là, l’époque de la Saint-Louis venue, la tête de la capitainerie des chasses et celle de la maîtrise des eaux et forêts de Compiègne se transportèrent à Versailles, pour y présenter leurs hommages au roi, à l’occasion de sa fête.
M. Dampierre, espérant distraire sa fille de certains accès de tristesse et de taciturnité qui depuis quelque temps, sans raison apparente, semblaient s’être emparés d’elle, avait jugé à propos de l’emmener avec lui.
Adèle n’avait jamais habité que le couvent des dames de Crépy et le vieux château délabré de la Douye ; son plus grand voyage avait été de l’un à l’autre. Le mouvement d’une ville comme Versailles, le tableau, si nouveau pour elle, de toute cette population de courtisans, chamarrés de plumes, de croix, de rubans, devaient la guérir indubitablement de son ennui. Mais le plus difficile n’était point d’arriver à Versailles ; c’était de pouvoir s’y loger.
La ville regorgeait de monde.
Dans le château, les ministres occupaient des mansardes ; les duchesses, des greniers ; dans les communs, au chenil comme aux écuries, chiens et chevaux s’étaient vus forcés de céder un peu de leur logement aux gens les mieux titrés de France. On tenait à pouvoir dire qu’on avait été hébergé par Sa Majesté.
Au chenil comme au château, on était chez le roi ; mais je pense qu’il était plus facile de dormir dans l’un que dans l’autre.
La ville présentait un spectacle non moins curieux.
Les maisons bourgeoises étaient transformées en auberges, les boutiques en cabarets, les rues en réfectoires. Plus de trente mille honnêtes citoyens y dînaient gravement sur le pouce.
Dans les auberges, on mangeait dans les caves ; on couchait sur les tables et même dessous ; on y dressait des hamacs dans les corridors, et l’on y louait des chaises à la nuit.
Versailles était ce jour-là une ville de cinq cent mille âmes.
Au milieu de la cohue des promeneurs, des flâneurs et des dîneurs, M. le lieutenant des chasses, sa valise sous un bras, sa fille sous l’autre, courait depuis trois heures d’hôtel en hôtel, de porte en porte, ayant refusé d’abord une chambre à deux lits, et ne trouvant même plus un palier à deux chaises.
Suant, harassé, affamé, entrevoyant avec terreur la triste perspective de dormir debout, après avoir dîné aux fumées, il prit une résolution subite et désespérée :
— Pauvrette, dit-il à sa fille avec une poignante ironie, t’amuses-tu bien ici ?
— Oui, mon père, répondit Adèle du ton de parfaite insouciance de l’ennui résigné.
— Comment ! tu t’amuses ? dans cette affreuse ville où on ne peut ni boire, ni manger, ni s’asseoir ?
— Oh ! qu’importe ! on n’a qu’à penser à autre chose.
— A la bonne heure ; mais c’est que je ne puis pas penser à autre chose, moi ! s’écria M. Dampierre en s’arrêtant au milieu de la rue et se posant un instant sur sa valise : je suis éreinté et je meurs de faim !
— Eh bien, dit Adèle, toujours du même ton, entrons quelque part, mon père ; reposons-nous et dînons.
— Entrons quelque part ! répéta le père avec stupéfaction. Quoi ! tu ne t’es pas aperçue que, depuis trois heures, nous sommes entrés partout, et que nulle part il n’y a pour vous ni repos, ni dîner ?
— Comment faire alors ? reprit la jeune fille avec sa même quiétude apparente.
— Oh ! j’avais bien trouvé un moyen, moyen bien simple, et qui nous aurait tirés d’affaire, mais tu t’amuses… Je serais désolé d’interrompre ton plaisir.
— De quoi s’agissait-il donc ?
— De sonner le retour du côté de Béthizy.
— Quel bonheur !
— Hein ? Quel bonheur ! dis-tu ?… quand il s’agit de partir… Tu ne t’amuses donc pas, alors ?… Cherchez donc à faire plaisir à votre fille !… Mettez-vous en frais pour cela !… grommela le lieutenant des chasses, perdant à son tour le souvenir de ses phrases précédentes. Au surplus, reprit-il bientôt, vu les circonstances, il n’y a pas de mal.
Il fit part alors à Adèle du plan qu’il venait de former.
D’instant en instant, la foule se montrant de plus en plus compacte à Versailles, et nul ne devant encore songer au départ, il serait facile de se procurer une voiture, ne fût-ce que jusqu’à Saint-Denis. Une fois là, le père et la fille dîneraient tout à l’aise, dormiraient de même, chacun dans sa chambre, et, après un long repos réparateur, le lendemain, on songerait à se procurer un autre véhicule pour regagner le château de la Douye. Sans doute M. Dampierre ne pourrait, comme il était de son désir et même de son devoir, aller faire la révérence à Sa Majesté, au sujet de la Saint-Louis ; mais peut-être bien le roi, distrait par les mille préoccupations de ce grand jour, ne s’apercevrait-il pas qu’il manquât à la fête. Au surplus, on prétexterait de quelque indisposition subite d’Adèle, ou de l’indispensabilité administrative du lieutenant des chasses à Béthizy ; bref, ce n’était là qu’un danger éventuel, et auquel on pouvait facilement parer avec un peu d’adresse, tandis qu’en restant à Versailles, il y avait un péril réel, imminent, flagrant, se présentant à la fois sous trois faces, comme le chien Cerbère aboyant et mordant de ses trois gueules ; ce triple péril, c’était celui dont il était menacé par la privation d’abri, de sommeil et de nourriture.
Les choses ainsi convenues, M. Dampierre, à demi soulagé et restauré, rien que par la certitude de voir bientôt finir son supplice, se remit en route, à travers la foule, fouillant de droite à gauche les larges rues de Versailles, cherchant avec la même ardeur, et sans plus de succès, une voiture pour en partir, comme il avait cherché son logement pour y séjourner.
Tous les coches étaient retenus à l’avance, tous les fiacres étaient en route : M. Dampierre se dépitait de plus belle, lorsque, dans la cour d’une maison de maigre apparence, il découvrit une petite voiture, dételée, à trois places, espèce de carriole de campagne, qu’un seul cheval pouvait facilement traîner.
Comme il l’inspecte, le propriétaire ou le conducteur de la carriole se présente :
— Elle est à vous, bourgeois, et à votre compagnie, jusqu’à demain matin, si vous voulez.
— Je n’en ai besoin que pour quelques heures. Je vais à Saint-Denis.
— Ah ! le bourgeois va à Saint-Denis ?… Très-bien.
— Ton prix ?
— Une pistole. Ça vaut ça, n’est-ce pas ?
— Non ; un écu de six livres, si tu veux.
— Six livres ! Mais on peut tenir six personnes là dedans ! s’écria le voiturier.
— Comment, il n’y a que trois places !
— Eh bien ? en se relayant.
M. Dampierre était trop pressé pour chercher à comprendre. Il consentit à la pistole, et durant un long quart d’heure, pestant, jurant, il attendit qu’on attelât. Ne voyant rien venir, ni le cheval, ni le cocher, il cria si fort que ce dernier accourut tout ébahi et en se frottant les yeux, car il venait de dormir.
— Quoi ! vous n’êtes pas encore installés ? dit-il.
— Mais le cheval ! interrompit M. Dampierre.
— Quel cheval ? répondit l’autre.
— Pour la voiture !…
— Pour la voiture, nos conventions sont faites, reprit le cocher d’un ton plein de modération et de courtoisie ; ne confondons pas. Mais est-ce que le bourgeois désirerait être conduit par moi à Saint-Denis ?
— Parbleu… voilà un effronté drôle !
— Alors, monsieur, entrez dans la voiture ; reposez-vous-y, faites-vous-y servir, si vous voulez et si vous pouvez ; demain, quand mon cheval ne sera plus sur le flanc, nous pourrons causer de l’autre affaire.
— Comment demain !… comment de l’autre affaire ! s’écria le lieutenant des chasses, qui commençait à tourner à l’exaspération ; mais alors, misérable, sur quoi avons-nous donc fait marché d’une pistole, et qu’est-ce que ta voiture sans ton cheval ?
— Aujourd’hui, monsieur, dans les circonstances présentes, répliqua le cocher versaillais d’un air plein de dignité, ma voiture, sans mon cheval, est tout simplement un appartement à louer.
M. Dampierre lui tourna le dos. Il était temps de se reposer néanmoins, car les forces d’Adèle commençaient à l’abandonner entièrement. Le père chercha d’espace en espace, sur les bancs des boulevards, une place vacante ; il ne la trouva pas. Les fossés creusés le long des arbres étaient eux-mêmes envahis. Il regretta alors d’avoir trop légèrement renoncé au voiturin ; il y retourna ; l’appartement était loué.
O bonheur ! à travers la poussière et la cohue, il aperçoit une chaise vide, dans l’angle d’une petite place ; il traverse la foule, non sans peine ; et il y installe enfin sa fille.
Cette chaise était la sellette sur laquelle un célèbre prestidigitateur, arracheur de dents de son métier, faisait asseoir ses victimes.
Adèle ne lui échappa qu’avec peine.
M. le lieutenant des chasses ne savait plus à quel saint s’adresser, à quelle ressource avoir recours ; comme son gosier, son imagination était à sec ; étouffé par la chaleur, aveuglé par la poussière, il se sentait sans force pour lutter contre le courant de la foule qui le tiraillait, qui l’entraînait, tantôt du côté de sa valise, tantôt du côté de sa fille.
Dans cet état fiévreux, intolérable, qui le torture, il est porté, par un flot de promeneurs, jusque sur une esplanade couverte où s’élèvent des bascules, des balançoires et autres mécaniques divertissantes, accompagnement obligé de tous les plaisirs populaires. Les regards de M. Dampierre, dirigés sur un jeu de bague, tombent sur deux chevaux de bois sans cavaliers. Où les autres voient un jeu, lui, il voit un repos, un siége, une halte à faire. Il enlève Adèle de terre, l’installe sur le premier cheval, s’empare lui-même du second, met sa valise devant lui, et voilà le père et la fille tournant, tournant encore : le père, furieux, maudissant Versailles, ses habitants et ses fêtes, et promenant des yeux irrités autour de lui ; la fille, le front baissé, l’attitude pensive, autant que peut le permettre sa position équestre, se livrant aux préoccupations qui lui sont devenues habituelles depuis quelques mois. Tous deux, l’un, avec son teint légèrement pâli, l’autre avec son front animé et ses yeux flamboyants, semblaient représenter la Colère et la Douleur, prenant part aux divertissements publics donnés à Versailles, en 1757, en l’honneur de la fête du roi de France, Louis XV, dit le Bien-Aimé.
Tout en tournant, tout en maugréant, M. Dampierre se demandait à lui-même ce que, lui et sa fille, à vingt lieues de leur pays, dans cette Babylone maudite, où ils n’avaient pas un ami, pas un asile, allaient devenir, lorsqu’il leur faudrait descendre de leur monture de bois, quand il entendit un cri partir auprès de lui, et son nom fut prononcé.
Il vira la tête, il chercha du regard vers l’endroit d’où la voix s’était fait entendre ; mais, forcé de suivre le mouvement de la machine qui l’emportait, il fut aussitôt contraint de tourner le dos à son interpellateur.
Le tour accompli, il chercha rapidement parmi toutes les figures que la foule, incessamment accrue, étalait à ses regards, pour savoir de quelle bouche son nom venait de sortir de nouveau ; mais encore une fois le même mouvement l’emporta au triple galop de son cheval de bois.
A force de tourner, de s’irriter, ses yeux se troublèrent, le vertige s’empara de lui ; peut-être sa diète trop prolongée y fut-elle pour quelque chose. Il ne vit plus dans toute cette multitude qu’une seule figure grimaçante et grotesque qui riait en le narguant ; il n’entendit plus qu’un bruit confus de mille voix, se réunissant toutes en un seul chœur pour répéter son nom, en le lui envoyant comme une moquerie. Il voulut descendre, il voulut s’arrêter. Son cheval de bois avait pris le mors aux dents et s’élançait dans sa route circulaire avec plus de rapidité que jamais. C’est qu’une de ces bandes de gamins qu’on retrouve dans toutes les fêtes publiques, et qui cherchent toujours à prendre leur part dans les plaisirs des autres, était venue en aide à l’homme chargé de faire mouvoir et tourner la machine. L’élan donné à la mécanique pivotante était triplé, décuplé. Les spectateurs ne voyaient plus passer devant eux qu’une ligne confuse de figures effarées, qui, après avoir semblé courir l’une après l’autre, réunies enfin, formaient ensemble comme une ronde diabolique ; et des cris, des rires, des hourras s’échappaient du sein de la foule.
M. le lieutenant des chasses perdit tout à fait la tête et il allait se jeter résolûment à bas de sa monture, lorsque le mouvement se ralentit enfin ; retenue par une main vigoureuse, la machine s’arrêta presque subitement et, dans son libérateur, M. Dampierre reconnut son ami Pardaillan, l’ex-capitaine de Charles Doisy.
M. de Pardaillan ne faisait plus partie des hussards de Berchiny. Chargé par le ministre de diriger l’organisation d’un nouveau régiment de cavalerie, où il espérait bientôt figurer comme major, il occupait à Versailles la maison de son frère, alors en voyage. Cette maison, il l’occupait seul.
Après s’être fait, tant bien que mal, expliquer par son ami Dampierre par quelle bizarre fantaisie il venait de trouver un lieutenant des chasses de Sa Majesté courant comme un échappé de collége, à franc étrier, sur un cheval de bois, instruit des mésaventures du père et de la fille, il leur proposa de devenir ses hôtes, et sans un sublime effort d’imagination, on peut deviner que l’offre fut acceptée avec empressement et reconnaissance.
En arrivant chez le capitaine, M. Dampierre se débotta, mangea un morceau et but trois coups de suite. Adèle, après avoir pris un bain, se coucha et dormit quelques heures.
Durant le souper, les deux amis, heureux de s’être retrouvés et de vivre en commun, comme d’une même famille, causèrent de guerre, de chasse, des affaires de l’Église et de celles du parlement. Adèle, qui n’avait pas un mot à placer dans une pareille conversation, profita des préoccupations des causeurs pour retourner toute seule à Béthizy, et elle y était déjà lorsqu’un nom prononcé la jeta brusquement hors de sa rêverie.
— Parbleu ! disait son père au capitaine, tu as dû entretenir des relations avec ton ancien régiment ?
— Quelques-unes… Eh bien ?
— Donne-moi donc des nouvelles, si tu en as, d’un nommé Charles Doisy, ton maréchal des logis… Est-il mort ? Est-il vivant ?
— Il est vivant, je l’espère, répondit M. de Pardaillan.
— Tant mieux ! c’est un brave et joli garçon, un gaillard qui a bonne envie d’avancer.
— Et il avancera, ou j’y perdrai mon nom !
— Comment ? Plaît-il ?
— Rien… rien… je m’intéresse à lui ; voilà tout.
M. de Pardaillan avait mis dans ses réponses un ton de réticence, une animation concentrée qui n’avaient point échappé à la jeune fille.
La conversation roulant sur un pareil sujet, elle trouva moyen de s’y glisser petit à petit, sournoisement, et s’adressant enfin au vieux militaire :
— Vous pensez donc, capitaine, qu’il pourra bientôt être nommé officier ? dit-elle.
— Si l’affaire ne dépendait que de moi, il le serait déjà, ma belle enfant, et ce ne serait que justice.
A partir de ce moment, la jeune fille prit le capitaine en affection.
Celui-ci continua, en se retournant vers Dampierre :
— M. Tolt, son lieutenant-colonel, avec qui je suis en correspondance, me tient au courant. Doisy s’est déjà distingué dans plusieurs rencontres. Dernièrement encore, à Hastembeck, il a concouru à la prise d’une batterie anglaise, et s’est assez brillamment conduit pour que M. de Chevert, qui s’y connaît, l’ait remarqué.
— Quel bonheur ! s’écria la naïve enfant, qui, pour la première fois de sa vie sans doute, venait, avec un vif intérêt, de prêter l’oreille à un récit de guerre.
Honteuse ensuite de son exclamation, elle rougit, étendit sa serviette devant ses yeux, comme si elle se disposait à la plier ; puis, l’instant d’après, sous prétexte d’admirer de plus près un magnifique chat angora ou de jouer avec lui, elle quitta la table subitement.
Le capitaine l’examina dans tous ses mouvements avec une certaine attention ; après quoi, il se retourna vers le père, en lui adressant un geste interrogatif.
— Oh ! dit celui-ci d’un ton insoucieux et avec un mouvement d’épaules, non ; mais il a fait son portrait.
Il ne voyait pas plus loin.
On soupait de bonne heure à cette époque ; cependant, la nuit venue, Adèle, presque inaperçue dans un coin de la chambre, à moitié cachée sous les rideaux d’une fenêtre, le chat endormi sur ses genoux, se tenait immobile et le caressait de la main, en songeant à tout autre chose. Les deux amis, se croyant seuls, prolongeaient le dessert, en achevant les bouteilles entamées, ou en entamant les bouteilles pleines.
Ils en étaient à la discipline militaire, à l’obéissance passive, aux caprices des supérieurs si souvent injustes, et faisant du bon plaisir tout ainsi que Sa Majesté.
— Tes soldats n’ont jamais dû avoir cela à te reprocher, à toi, Pardaillan ? dit Dampierre.
En effet, le capitaine, militaire instruit et probe, sévère mais consciencieux, avait eu de tout temps une incontestable réputation d’équité. Cependant, devant l’apostrophe élogieuse de son ami, il hocha la tête, et après avoir réfléchi un instant en regardant son verre, que l’autre venait de remplir jusqu’aux bords :
— Écoute, Dampierre ; convenir de ses torts devant tout le monde, les confesser hautement et inutilement, en jurant de n’y retomber plus, ça peut être un beau moment dans la vie d’un moine, mais dans celle d’un militaire, ce serait un acte de couardise, et voilà ce que jamais on n’obtiendrait de moi.
— Parbleu !
— Mais, poursuivit le capitaine, quand déjà depuis longtemps on s’est reproché ses torts à soi-même, les confier à un ami, qui n’en exige pas l’aveu, c’est simplement demander un bon conseil, ou chercher une consolation, n’est-ce pas ?
— Parbleu ! Mais, où en veux-tu venir avec ta préface ?
— J’en veux venir, Dampierre, à te dire, à toi, entre quatre yeux, que, malgré la trop bonne opinion que tu as conçue de moi, j’ai là sur la conscience le souvenir d’une injustice qui, quoique involontaire, me pèse comme le remords d’une lâche action.
— Allons donc !… Toi ? Je parierais, mon pauvre ami, que tu prends des cochons d’Inde pour des sangliers.
— Tu vas en juger, reprit le capitaine. Tu te souviens de la dernière chasse où tu me demandas des hommes de bonne volonté pour l’aider à tendre tes toiles ?
— Très-bien ; que même tu m’envoyas le maréchal des logis…
— Justement ! Eh bien, mon vieux camarade, à cette chasse, le cheval de la marquise s’emporta, à ce qu’il paraît. Un de mes hommes sauta à la bride et le retint. C’est un exploit qui ne se met guère sur un état de service, mais qui cependant, parfois, compte mieux qu’un autre. En rentrant au château, madame de Pompadour, qui avait eu peur, qui peut-être aussi voulait se rendre intéressante, parla beaucoup des dangers qu’elle avait courus. Pour lui être agréable, le roi, dès le lendemain, en quittant Compiègne, chargea le comte de Berchiny d’acquitter la dette de la marquise envers son libérateur inconnu. Sur l’ordre du chef, j’assemblai mes hommes qui avaient fait partie de l’escorte de chasse, et, à haute voix, après un appel de clairon, je leur demandai lequel d’entre eux s’était signalé dans cette occasion, moins encore par son courage que par sa courtoisie envers une jolie femme. Il y eut d’abord un silence assez prolongé ; puis enfin, un soldat sortit des rangs et dit : « C’est moi ! » Nul ne le contredisant, notre colonel le nomma sur-le-champ cornette, lui fit avancer une année de solde, et lui paya son équipement. C’était un peu bien beau pour un simple hussard ; mais, tu comprends, il s’agissait de la marquise !
— Parbleu ! si je comprends, dit le lieutenant des chasses en tendant son verre pour trinquer avec son ami, le hussard avait sauvé l’État, qui risquait de périr ce jour-là par une chute de cheval, comme toi tu m’as sauvé aujourd’hui en sautant courageusement à la crinière de mon coursier de bois qui m’emportait. A ta santé et à celle du hussard !
— A sa pendaison, au double traître ! s’écria Pardaillan, dont les yeux et le geste s’animèrent soudainement. Il n’avait rien sauvé du tout ! Le vrai sauveur, c’était le maréchal des logis, ce jeune Doisy dont nous parlions tout à l’heure.
— Bah ! Mais alors pourquoi n’a-t-il rien dit, lorsque, à haute voix…?
— Il était retenu ailleurs par le service, et je ne remarquai pas son absence.
— Ah ! diable ! c’est fâcheux ! ça lui allait si bien à lui qui a de l’ambition ! il était officier d’emblée !
En ce moment, le rideau de la fenêtre s’agita sans que nos deux amis y prissent garde. L’un était absorbé par ce qu’il lui restait à dire, l’autre par ce qu’il lui restait à boire.
— Au bout du compte, reprit Dampierre, je ne vois pas dans tout cela que tu aies la moindre chose à te reprocher.
— Si ce n’était que ça !
— Qu’est-ce donc encore ?… Verse.
— J’appris bientôt, continua Pardaillan, que le maréchal des logis s’était vanté tout bas à quelques amis d’avoir été seul l’écuyer de la marquise. Je le fis venir chez moi et lui demandai ses preuves. Il dédaigna de les donner, déclarant se soucier fort peu d’arriver par cette voie. Cette réponse était fière et noble ; mais pour le quart d’heure j’y vis tout autre chose que de la fierté et de la noblesse, et je le renvoyai assez rudement.
— Et bien tu as fait !… Comment… d’arriver par cette voie ! mais madame la marquise de Pompadour est… une très-jolie femme !
— Laisse là ton verre, Dampierre, et écoute-moi… J’eus grand tort au contraire.
— Certainement…
— J’aurais dû deviner sur la noble figure du jeune homme que seul il disait vrai.
— Tu l’aurais dû.
— Loin de là, apprenant qu’il ne perdait pas une occasion de railler le nouveau porte-étendard, je m’en irritai. Je ne voulus voir dans cette conduite qu’un acte de déloyauté, un manquement à la discipline, et, un jour, devant toute la compagnie, je l’apostrophai avec une violence que je me reprocherais encore aujourd’hui, eût-il été coupable. Le coup d’œil révolté qu’il me jeta alors ne faisant que redoubler mon irritation, je m’oubliai tout à fait, je fis un mouvement pour lui arracher ses aiguillettes ; par bonheur, je me contentai de l’envoyer au cachot et de le suspendre de ses fonctions.
— Pauvre garçon ! A sa santé, dit le lieutenant des chasses, qui commençait à s’attendrir sensiblement.
— Dès le jour suivant, reprit le capitaine, le duc de Gesvres, qui m’honore de quelque bienveillance et qui, en qualité de gouverneur de l’Ile-de-France, avait dû se trouver au nombre des chasseurs, m’éclairait sur la vérité. Il avait vu, de ses yeux vu, le fait en question. Le jeune homme qui s’était élancé à la bride du cheval était un maréchal des logis et non un simple cavalier. Alors, seulement, je me rappelai l’absence de Doisy au moment de l’interpellation adressée à ses camarades, le silence qui s’était fait d’abord dans les rangs. Bref, tout me fut connu. Je ne pouvais faire amende honorable à un de mes hommes.
— Tu ne le pouvais pas, Pardaillan.
— A moins de donner ma démission sur-le-champ.
— Oui…
— Cependant, grâce à mon oubli, à mon emportement, à ma fatale méprise, un garçon estimable, non-seulement était privé d’une faveur royale, mais encore désigné à ses camarades, à ses chefs, comme un imposteur, un fanfaron. Il pouvait être arrêté court dans la carrière librement choisie par lui. Je n’hésitai pas alors, Dampierre.
— Tu as bien fait, mon ami ; bois donc.
— Je me dévouai, corps et âme, à la réparation du mal dont j’étais cause. J’allai trouver notre lieutenant-colonel, M. Tolt. Je lui confiai tout, à lui, mon chef, comme aujourd’hui je me confie à toi, mon ami. A nous deux, nous décidâmes de ce qu’il convenait de faire pour le jeune homme.
— Ah !… voyons.
— D’abord, le changer d’escadron, pour que mon incartade pesât moins sur lui.
— Bien !
— Cela fait, l’envoyer sur le Rhin, et le mettre à même de s’y distinguer, puisqu’il ne voulait parvenir que par la bonne voie.
— Très-bien !
— Mais ce n’est pas tout.
— Parfait !
— Déjà M. Tolt m’avait écrit de là-bas qu’il l’avait désigné au ministre pour l’avancement, et je n’entendais parler de rien. Je me résolus à mettre aussi les fers au feu de mon côté. Sans la faveur, vois-tu, on ne fait rien de bon dans ce pays-ci.
— C’est clair ; la graine d’épinards ne pousse bien qu’à Versailles.
— Eh bien, pour y venir, à Versailles, pour me rapprocher de la cour, j’acceptai cette besogne d’organisation que j’avais d’abord refusée… Oui, je n’avais pas voulu quitter mon régiment ; notre régiment, c’est notre famille, à nous autres. Que te dirai-je, mon ami ? moi qui n’ai jamais rien demandé en mon nom, depuis deux mois je me suis fait quémandeur, pied-plat, courtisan ! J’intrigue à droite, à gauche, pour trouver des protecteurs à mon protégé. J’ai des placets plein ma poche ; toujours le même. J’en ai semé dans tous les ministères et dans toutes les antichambres ; rien n’a fait jusqu’à présent. Je m’étais d’abord adressé au roi ; mais le roi ne se mêle de rien, et il est inabordable pour nous autres. Plus tard, j’ai visé à la favorite. Il était bien naturel qu’elle m’aidât à réparer une injustice dont elle est la première cause. Déjà, j’avais obtenu une audience d’elle ; je croyais l’affaire terminée ; au diable ! sa fille est morte. La marquise est devenue invisible comme le roi ! Sans me décourager, j’ai tenté un troisième assaut. Cette fois, j’ai tourné la citadelle ; je suis entré par les cuisines.
— Gourmand !
— Tu comprends ?
— Parbleu ! répondit le lieutenant des chasses en remplissant de nouveau son verre. C’est-à-dire… je comprends… Non… va toujours. A ta réussite !
— Allons, Dampierre, lui dit le capitaine en s’interrompant, tu bois trop !
— Laisse donc ! ces petits vins des environs de Paris, ça ne fait que trotter sur la langue…
— Mais tu ne sais donc plus ce que tu dis ? Tu ne sens donc plus ce que tu bois, malheureux ? c’est du roussillon qu’on nous a donné !
— Ah ! bah ! tu crois ?
— Mon frère n’en a pas d’autre dans sa cave.
Dampierre ouvrit de grands yeux, prit gravement son verre, après avoir d’un signe de la main rassuré son ami ; puis, il huma une petite gorge, s’en gargarisa la bouche, et d’un air convaincu :
— C’est vrai ; tu as raison, dit-il. Je n’y avais pas goûté.
Alors, il replaça sur la table son verre à peine entamé et le distança, par réflexion, de toute la longueur de son bras ; repoussa de même sa bouteille, s’essuya les lèvres de sa serviette, en faisant suivre sa pantomime de ces mots remarquables :
— Je déteste les vins du Midi. Continue.
— J’entrai donc par les cuisines, reprit Pardaillan ; c’est-à-dire, ne pouvant m’adresser aux maîtres, je m’adressai aux valets, aux écuyers de bouche, au garde-vaisselle, aux tourneurs de broches, aux porteurs de chaises, aux falotiers, aux pâtissiers, aux femmes de chambre, aux filles de service, que sais-je ! Qu’est-ce qui te fait rire ?
— Moi ?… Va toujours ; je pensais à la singulière figure que je devais avoir sur ce cheval de bois.
— Oh ! tu peux rire de moi, Dampierre, et de mes moyens d’intrigue. Cependant, grâce à mes nouveaux auxiliaires, un de mes placets fut déposé sur la toilette de la favorite, un autre dans sa voiture, un troisième trouva moyen de se glisser même dans un pâté ; mais jusqu’à présent, soit que le placet de la toilette ait servi à faire des papillotes, que celui de la voiture ait allumé la pipe du palefrenier, et que le pâté n’ait été ouvert qu’à l’office, j’ai compromis inutilement mes moustaches grises et ma croix de Saint-Louis avec toute cette engeance. N’importe ! notre ami sera officier, j’en réponds, poursuivit le brave capitaine, et je compte bien ne pas m’arrêter là dans la réparation de mes torts. Je sais que le père du jeune homme a fait de mauvaises affaires dans les entreprises ; moi, je n’ai pas d’enfants ; j’ai quelque fortune…
— Ah ! que c’est bien ! murmura une petite voix tout émue.
— Qu’est-ce que tu fais ici ? cria le lieutenant des chasses à sa fille, qu’il aperçut derrière le fauteuil du capitaine, les yeux en larmes et les mains jointes.
— Ce que je fais, mon père ?… Mais… j’écoute.
— Tu viens donc d’entrer à la sourdine ?
— Je ne suis pas sortie.
— Voyez-vous, la fille d’Ève ! Eh bien ! si tu as écouté, poursuivit le père en essayant de prendre devant son ami le grand ton d’autorité dont il faisait rarement usage, tu as dû entendre que le récit du capitaine était entièrement confidentiel.
— Oui, mon père ; j’ai entendu… confidentiel… pour nous deux… puisque j’étais là.
— Elle a raison, dit Pardaillan. Allons, ma belle enfant, c’est moi qui ai des excuses à vous faire d’avoir tenu table si longtemps, sans songer que vous êtes venue à Versailles pour voir tout autre chose que deux vieux amis qui bavardent sans raison et qui boivent sans soif.
— Ah ! que vous êtes bon !… oui, vous êtes bon, murmura la jeune fille. J’ai eu raison d’écouter, n’est-il pas vrai ? puisque cela fait que je vous aime de tout mon cœur !
Et, par un mouvement rapide, elle s’empara d’une des mains du capitaine, et la baisa avant que celui-ci eût songé à la retirer.
— Que faites-vous, chère enfant ? dit le capitaine ému lui-même.
Et, se retournant vers Adèle, il resta un instant stupéfait du caractère étrange et passionné que venait de revêtir sa beauté. Ce simple coup d’œil lui suffit pour lire entièrement dans le cœur de la jeune fille. Ces ennuis, ces souffrances inexplicables, qu’au bout de plusieurs mois un père n’avait pu encore deviner, il les comprit sur-le-champ, et, se courbant vers elle :
— Je tiens plus que jamais à ce qu’il soit heureux ! lui dit-il tout bas.
Élevant ensuite la voix :
— Vous n’êtes plus fatiguée, je l’espère, reprit-il, et vous ne gardez pas rancune à notre Versailles de vos mésaventures de la matinée ? Allons, ma belle enfant, faites un bout de toilette, si bon vous semble ; votre père va passer son bel uniforme, et tous trois nous irons au parc, voir les illuminations, et même faire un tour dans la grande galerie du château, où j’ai mes entrées.
Pendant que ces paroles s’échangeaient entre son ami et sa fille, Dampierre, resté à table, avait avisé du coin de l’œil le verre, presque plein, envoyé par lui si injustement en exil. Il l’en faisait revenir peu à peu, et quand Pardaillan acheva sa péroraison, la paix était faite entre le vin de Roussillon et le lieutenant des chasses de la capitainerie de Compiègne.
Au moment de partir, Dampierre se sentit la tête lourde et embarrassée. Il jugea prudent de rester au logis ; mais ne voulant pas priver sa fille du spectacle féerique des illuminations, il la confia en toute sécurité à la protection du noble capitaine.
D’autres événements d’une nature plus étrange étaient réservés à ma grand’tante durant son court séjour à Versailles, et devaient décider de son sort comme de celui de M. de Pardaillan.
Adèle et son guide se promenaient dans le parc, admirant ou expliquant tout, les eaux, les rocailles, les tritons et les grands seigneurs, quand le capitaine, à la clarté de la lune et des lampions, crut entrevoir, au milieu de la foule, un gros homme qui semblait s’adresser à lui par des signes multipliés.
Il s’approcha. C’était un cocher de madame de Pompadour.
M. de Pardaillan apprit par lui que la marquise, en l’honneur de la fête du roi, rompant son deuil, devait se montrer le soir même dans la grande galerie.
Le renseignement était bon, mais il fallait le rendre profitable.
Se diriger aussitôt de ce côté, quitter le parc pour le château, se faire jour, avec sa jeune compagne, à travers des essaims de courtisans qui déjà encombraient le grand escalier, fut pour le capitaine l’affaire d’un instant.
A peine entré, il voit un mouvement, un remous de la foule, s’opérer vers une extrémité de la galerie ; elle est là sans doute.
M. de Pardaillan, en dépit de l’étiquette de cour, se sent homme à lui parler de son affaire, de Doisy, du brevet d’officier, et sur-le-champ. Il fait quelques pas pour la rejoindre ; mais il songe à la jeune fille qui lui tient le bras et qu’il lui va falloir traîner après lui à la remorque. Peut-il en sa compagnie aborder la royale courtisane ? mettre ainsi face à face l’innocence et la candeur d’une part, la corruption et l’adultère de l’autre ? Non. Cette fois, il s’agit de l’étiquette de l’honneur, et celle-là le capitaine la connaît et la respecte.
Par une manœuvre habile, évitant le fossé sans se détourner du but, il installe Adèle sur un bout de banquette, en priant poliment deux dames d’apparence respectable qui se trouvent là, de veiller sur elle ; puis, tranquille sur son arrière-garde, il marche en avant.
Les dames respectables, qui n’étaient pas assez vieilles encore pour être sans prétentions, ne tardent pas à s’apercevoir des inconvénients de ce qu’on leur a donné à garder. Elles n’accrochent plus un regard ni une salutation. Tous les hommes qui passent admirent les traits délicats de la jeune fille, son teint frais et ses cheveux abondants ; elles ne sont plus inspectées qu’après coup, à la légère, et perdent évidemment à la comparaison.
Les femmes qui jettent les yeux de ce côté s’étonnent à la vue d’Adèle, de son canezou à la vieille mode de l’année dernière, de ses cheveux sans poudre, de sa robe sans cerceaux, de ses manches courtes, sans satin et sans dentelles, ornées seulement d’une rosette pleureuse.
Comment cette créature se trouve-t-elle là, sous la garde de la vicomtesse de B*** et de la baronne K*** ? On flaire la province : on critique, on médit, et, pour humilier la vicomtesse :
— Mademoiselle est votre parente ?
— Pas du tout ! je ne connais même point cette petite.
Et jetant, en guise d’adieu, un regard de dédain sur la pauvre enfant, les deux dames respectables se hâtent de renoncer à un voisinage si dangereux, et dont leur vanité souffrait doublement.
Deux mousquetaires prennent leur place.
Par bonheur pour Adèle, ils ne sont pas de la bonne espèce. Communs et bêtes, eux-mêmes provinciaux, encore encrassés, ils ne savent adresser à la jeune fille que des balourdises incapables sans doute de la séduire, mais suffisantes pour l’effrayer.
Un autre leur succède. C’est un jeune homme au costume élégant, mais débraillé ; aux allures hardies et conquérantes, mais dégingandées, et dont les grands airs de cour ne laissent pas que de sentir quelque peu le tripot et le brelan.
— Vous êtes seule, ma charmante ? dit-il à Adèle.
— Non, monsieur, répond-elle en balbutiant, comme pour invoquer l’appui de son protecteur absent ; je suis venue avec le capitaine Pardaillan, qui m’a laissée… parce que…
— C’est justement lui qui m’envoie, pour vous tenir compagnie, ma toute belle. Comment vous nomme-t-on ?
— Adèle Dampierre, répond ingénument la pauvre fille.
— C’est ça… Diable ! beau nom ! Et M. votre père appartient au château ?
— Il est lieutenant des chasses, monsieur.
— C’est ce que je voulais dire. Diable ! belle position. Eh bien, charmante Adèle, je vous ai reconnue rien qu’à vos cheveux. Je vous déclare, foi de chevalier d’Annezay, que depuis feu la reine Bérénice, jamais chevelure plus délicieusement plantureuse que la vôtre n’a paru à une cour quelconque, et que vous avez bien fait de ne pas l’enfariner, quoi qu’en puissent dire les jalouses. Je comprends seulement d’aujourd’hui que le costume de notre mère Ève pouvait bien être plus convenable qu’on ne le suppose méchamment. Ah ! les beaux cheveux ! J’en dirais probablement autant de vos yeux, s’ils daignaient un tantinet se tourner de mon côté. Pardaillan me les a vantés.
A ce nom, invoqué là sous un motif si singulier, Adèle releva la tête involontairement, et la vue du chevalier, loin de l’intimider d’abord, la rassura au contraire. Le désordre de sa toilette, la pâleur maladive de son teint, lui inspirèrent une sorte de commisération pour le pauvre jeune homme. Elle le crut souffrant, et cette idée suffit à lui donner confiance.
Enhardi par les apparences, le chevalier hausse d’un ton sa parole comme son regard. Il se rapproche d’Adèle qui, devenue plus clairvoyante, afin d’éviter son approche, son contact, s’éloigne à mesure qu’il avance, et, dans son trouble, dans son émotion, recule au delà même des limites de sa banquette, et tombe.
On fait rumeur autour d’elle, on la relève.
— Un verre d’eau !
— Au buffet ! disent quelques voix.
Un gros monsieur se présente ; il lui offre son bras. Encore tout ahurie, honteuse de sa position, de son isolement, de sa chute, la tête baissée, les oreilles écarlates, pour se dérober aux regards qui la bombardent de tous côtés, Adèle prend le bras du gros monsieur qui, charitablement, se dispose à la conduire hors de la galerie, car elle a besoin d’air ; à la faire monter dans sa voiture, car elle peut à peine se soutenir ; à la mener enfin à sa petite maison, car elle a besoin sans doute d’un abri.
Pendant ce mouvement, le chevalier d’Annezay avait disparu, car le gros monsieur, l’un des hommes les plus respectables de la finance, était son créancier en chef.
Le matin, mademoiselle Dampierre s’était trouvée au milieu d’une cohue de badauds, de bourgeois et de manants ; elle avait failli y être étouffée, y mourir de fatigue et de faim. Le soir, au milieu de cette foule aristocratique, dorée, titrée, blasonnée, de femmes élégantes et d’hommes comme il faut, elle a lieu de s’épouvanter bien davantage.
Dans ce moment, par un coup de la Providence, la foule s’ouvre en deux ; tous les promeneurs s’arrêtent, tous les hommes se courbent, toutes les femmes font la révérence. C’est madame de Pompadour qui passe, entourée d’un brillant état-major de courtisans, parmi lesquels Adèle n’en distingue qu’un seul, l’ami de son père, le brave capitaine Pardaillan.
Sans se donner le temps de remercier le gros monsieur de ses bonnes intentions, elle s’élance dans cette route qui vient de s’élargir devant elle et se dirige vers son premier guide.
Le capitaine avait résolûment abordé la marquise à chacune de ses stations. Il lui avait adressé ses compliments, essayant de leur faire servir d’enveloppe à sa grande affaire, celle du brevet d’officier, qu’il trouvait moyen de glisser à travers ses lieux communs de politesse. La marquise lui avait souri, lui avait répondu, mais vaguement, sans lui prêter autrement attention, sans le reconnaître, sans le comprendre, à peu près comme Dampierre avec son vin de Roussillon.
Un peu découragé, M. de Pardaillan se laissait déborder dans l’escorte ; il perdait du terrain, quand madame de Pompadour poussa tout à coup un cri perçant.
L’exclamation de madame de Pompadour était pour le capitaine une occasion qui se présentait de se rapprocher d’elle. Il le tentait, lorsqu’il se sentit arrêté dans son élan.
Adèle venait de le rejoindre.
En compagnie de la naïve jeune fille, le moyen de retourner vers la favorite ? Il n’y songeait plus et se disposait à s’éloigner, ajournant encore ses espérances au lendemain, quand le cercle des courtisans, faisant un mouvement de recul, tourbillonna de son côté. Il entendit prononcer son nom, et vit aussitôt madame de Pompadour, qui venait de faire subitement volte-face, lui adresser un geste en l’interpellant :
— Eh bien ! M. de Pardaillan, lui disait-elle, qu’êtes-vous devenu ? N’avons-nous pas à causer encore ?
On s’écarta d’eux aussitôt, on leur fit place, tout en s’étonnant de voir la royale tutrice, la gouvernante maîtresse, porter l’esprit des affaires jusque dans des réunions de fête.
Adèle, le capitaine et la marquise formèrent un centre autour duquel le reste gravita respectueusement à distance.
Celle-ci reprit alors :
— Je me rappelle parfaitement ce dont il s’agit, monsieur : ne vous ai-je pas même à ce sujet accordé une audience ? C’est pour les cadres d’un nouveau régiment de cavalerie que le roi vous a chargé de former, n’est-il pas vrai ?
Et tandis qu’elle parlait, et tandis que le pauvre capitaine, fort embarrassé de sa position entre ces deux femmes si dissemblables, tentait de faire mieux comprendre le vrai motif de ses incessantes sollicitations, la marquise, sans lui prêter plus d’attention qu’auparavant, tenait ses yeux fixement arrachés sur la jeune fille, palpitante sous son regard ; et, à plusieurs reprises, elle murmurait avec un accent plein d’émotion :
— Mon Dieu ! mon Dieu !
Le capitaine, étonné du vif intérêt qu’elle semblait prendre à ses explications, commençait à s’embrouiller dans ses phrases, lorsque l’interrompant :
— C’est bien, c’est bien, monsieur, lui dit-elle ; faites-moi une note sur tout cela.
Et désignant Adèle :
— Cette enfant me l’apportera demain à mon lever.
Adèle et le capitaine firent un soubresaut.
— Je le désire ; je veux la voir encore, reprit la marquise. Vous l’accompagnerez si bon vous semble, M. de Pardaillan. Adieu, ma mignonne.
Un seul mot prononcé à l’une des portes de la grande galerie de Versailles venait d’imprimer une nouvelle secousse à la foule.
On avait annoncé Le roi !
La marquise se hâta d’aller au-devant de Louis XV.
— Eh bien, était-ce beau ? demanda le lieutenant des chasses, quand sa fille et son ami rentrèrent au logis.
— Superbe ! répondit le capitaine en se jetant sur un siége, d’un air de mauvaise humeur.
Et il raconta ce qui s’était passé relativement à la marquise.
— Tu vois, ajouta-t-il d’un ton ironique, qu’il ne tient plus qu’à nous d’obtenir, dès demain, la nomination de notre jeune homme.
— C’est fait alors, dit Dampierre.
— C’est plus loin de se faire que jamais, répliqua l’autre. N’as-tu donc pas entendu que la marquise veut revoir ta fille ? que c’est ta fille qui, cette fois, doit présenter le placet ?
— Mais je ne refuse pas ! interrompit Adèle, quoique certainement on soit bien mal à son aise au milieu de tout ce beau monde-là.
— Votre bon vouloir ne suffit pas, mon enfant, dit Pardaillan ; votre père refuse pour vous.
— Moi, pas du tout ! exclama à son tour Dampierre, que le vin de Roussillon dominait encore et rendait plus accommodant. Ça sera drôle, ma fille ira voir madame de Pompadour, tandis que j’irai faire ma visite au roi !… Pourvu que le roi n’ait pas entendu parler de la figure que j’avais sur ce cheval de bois… il serait capable de me rire au nez… Bah !
Le capitaine le regarda fixement, et se tournant vers la jeune fille :
— Savez-vous, Adèle, ce que c’est que madame de Pompadour ?
— Dame !… c’est une marquise.
— C’est… c’est une vilaine femme !
— Tu n’es plus connaisseur, mon vieux, dit Dampierre. Jolie femme ! jolie femme ! au contraire.
Et il se mit à rire aux éclats.
Le capitaine haussa les épaules, et s’adressant de nouveau à la jeune fille :
— Il faut que vous compreniez bien, mon enfant, l’importance de cette visite qu’on attend de vous. La marquise… n’est pas une femme comme une autre ; la marquise n’est une grande dame que par contrebande, que… comment vous dirai-je ?… C’est la maîtresse du roi, enfin !
— Ah ! fit Adèle d’un air indécis.
Puis, après un moment de silence :
— Je ne comprends pas bien, dit-elle. Est-ce que le roi a encore des maîtresses, à son âge ?
— Mais à quarante-sept ans on n’est pas…
— Elle croit qu’il s’agit d’une maîtresse de clavecin ! cria Dampierre en riant plus fort : vous avez bien fait de revenir ; vous m’amusez ; je m’ennuyais tout seul.
— Non, mon enfant, reprit Pardaillan avec gravité ; ce n’est pas une maîtresse de clavecin, c’est… c’est… l’amoureuse du roi ! et le roi est marié, et elle aussi ! Comprenez-vous maintenant ?
La pauvre villageoise baissa les yeux et sa rougeur répondit pour elle.
Cependant relevant bientôt le front d’un air mutiné :
— Si c’est une méchante femme, comme vous le dites, pourquoi courez-vous donc toujours après elle ?
— Bien répondu !
Et Dampierre se roula sur son fauteuil.
— Permettez, mon enfant, dit le capitaine. Distinguons : moi, je ne suis pas une jeune fille.
— Je le sais bien.
— Parbleu !… Vous m’amusez de plus en plus !… Oh ! que vous avez donc bien fait de revenir !
— Je vais à elle, comme tout le monde, pour les affaires de l’État, puisque c’est elle qui gouverne ! J’y vais, non pour moi, mais pour un autre, et, puisque vous avez entendu ma confidence à votre père, je puis le répéter ; j’y vais pour lui faire réparer une injustice, dont elle est la cause première.
Adèle sembla réfléchir, puis, d’un ton de résolution :
— Eh bien ! c’est pour cela aussi que j’irai ! Refuserez-vous de m’associer à votre bonne action ?
— Elle a raison, dit le père en s’attendrissant tout à coup. Bien, pauvrette ! C’est très-touchant, ce qu’elle dit là. Viens m’embrasser. Il ne s’agit pas ici de faire la bégueule, mais d’être utile à ce brave garçon qui lui a fait son portrait, et pour rien !… Ce sera le payement de sa peinture. Au bout du compte, la marquise ne la mangera pas !… Oh ! si c’était le roi… Un instant, sire ; de ce côté, nous ne voulons pas diriger vos chasses, et encore moins fournir le gibier. D’ailleurs, ne seras-tu pas là, Pardaillan ?
— Sans doute ! mon père a raison ; que puis-je craindre ? Notre voyage à Versailles aura du moins été utile à… quelqu’un.
— A la bonne heure ! dit le capitaine. Moi, j’avais cru devoir vous avertir ; mais si tous deux vous êtes d’accord, je ne demande pas mieux. Vive le roi ! mon maréchal des logis sera officier ! A demain donc, mon enfant.
Le lendemain, vêtue de blanc comme une première communiante, Adèle fut conduite vers la partie du château où se trouvaient les appartements de la favorite.
A chaque salon qu’elle traversait, elle était forcée de s’arrêter, tant elle se sentait défaillante. Durant une longue nuit sans sommeil, elle avait réfléchi aux paroles de M. de Pardaillan. Un instinct d’amour lui en avait fait comprendre la portée. Que pouvait-elle avoir à démêler avec une femme pareille ? Cette femme, pourquoi, la veille, l’avait-elle regardée avec tant d’attention ? Pourquoi avait-elle voulu la revoir encore ? Elle ne trouvait de réponse à aucune de ces questions ; et le mystère qui environnait cette visite la lui rendait encore plus redoutable.
Son amour pour Charles Doisy fut plus fort que le reste. Il fallait qu’il fût officier. Pour lui, comme pour elle, s’armant de courage, elle parvint à vaincre sa timidité native, et à maîtriser les révoltes de sa pudeur.
Quand le capitaine et sa jeune amie furent introduits auprès de la toute-puissante marquise, celle-ci était à sa toilette.
Une de ses femmes, après avoir lavé ses cheveux dans de l’eau parfumée, les couvrait de poudre à la maréchale ; une autre étalait sur les meubles des robes de soie, de dentelle ou de brocart, pour qu’elle eût à choisir ; une troisième essayait la coiffure du jour sur une tête à poupée, pour qu’elle pût juger de l’effet, et l’ornementait de fleurs ou de plumes, selon que le coup d’œil de sa maîtresse approuvait ou rejetait.
A gauche de la toilette se tenait assis un beau jeune ecclésiastique, en manteau court, en bas violets, portant un rabat en point de Venise, et des joyaux à chacun de ses doigts. C’était un évêque, récemment nommé. Il tenait à la main une petite pelote de velours, toute couverte d’épingles d’or, et la présentait alternativement, soit à la dame, soit à la suivante.
Vers la droite, on voyait, debout, un homme à la haute prestance, décoré de plusieurs ordres et portant en sautoir, par-dessus sa veste richement brodée, le large cordon du Saint-Esprit. C’était le ministre de la guerre qui venait consulter et prendre des ordres.
La marquise, tout en se mirant, tout en s’épinglant, tout en jetant des regards négatifs ou approbatifs vers la tête à poupée ou vers les robes accumulées devant elle, échangeait avec l’évêque et le ministre des paroles tour à tour graves ou enjouées, quand les noms de mademoiselle Dampierre et du capitaine de Pardaillan lui furent articulés bas à l’oreille ; elle tressaillit, se leva, et d’un geste, fit signe à l’évêque et au ministre de s’éloigner.
Ceux-ci, après un salut profond, se retirèrent dans un petit salon attenant au cabinet de la marquise, et là ils attendirent qu’il lui plût de les rappeler.
A peine avaient-ils disparu que madame de Pompadour, se retournant brusquement, s’élança vers Adèle, la prit dans ses bras, la baisa au front, et la contemplant dans une sorte d’extase douloureuse : Ma fille ! s’écria-t-elle.
A cette exclamation, dont elle ne peut comprendre le sens, la pauvre enfant, déjà jetée hors d’elle-même par toutes ses émotions précédentes, subitement atteinte d’une de ces faiblesses nerveuses auxquelles elle est sujette, s’évanouit entre les bras qui sont ouverts pour elle.
Les femmes s’empressent ; le capitaine, désespéré et qui la croit déjà morte, aide à la déposer sur un sofa, pousse des soupirs haletants, frappe du pied, laisse même échapper quelques jurons, se souvenant à peine du lieu où il est, et ne cesse de lui prodiguer ses soins que lorsqu’il s’agit de couper les lacets de son corsage.
Il se retire alors discrètement, sans cesser toutefois de maugréer entre ses dents, dans un coin de l’appartement, bouleversé par ce qu’il vient de voir et d’entendre, et ne sachant plus ni ce qu’il doit penser ni pourquoi il est venu.
Presque inanimée, la jeune fille était étendue sur le sofa ; ses yeux restaient fermés ; ses cheveux, déroulés, retombaient en désordre sur sa poitrine, pâle comme son front.
— Oh ! laissez-la un instant ainsi, supplia la marquise ; c’est ainsi que pour la dernière fois j’ai vu mon Alexandrine, à qui elle ressemble tant !
Et elle éclata en sanglots.
Par son ordre, on va chercher une couronne de roses blanches, précieusement déposée dans un coffre de deuil, dans un coffre qui renferme les seules choses qui lui restent de sa fille : de blonds cheveux, des fleurs fanées, un mouchoir trempé de ses larmes et teint de son sang.
Madame de Pompadour n’était plus la belle et omnipotente favorite ; alors, c’était une pauvre femme à qui il n’était permis d’être mère qu’en cachette ; une femme qui, à force d’adresse, de beauté et d’ambition, avait fait son esclave d’un roi ; mais à cet esclave, elle devait des sourires et de la belle humeur. Devant lui, comme devant les autres, il lui fallait cacher ses larmes, étouffer ses douleurs, contenir ses élans de maternité. Ne devait-elle pas rester belle pour plaire au maître ? Ne devait-elle pas plaire au maître pour gouverner l’État ? Pourquoi aurait-elle pleuré sa fille ? Ce n’était point celle de Louis XV ; c’était celle de M. d’Étioles… Qu’importait au roi !
Quand on eut déposé entre ses mains la couronne de roses, elle la plaça sur la tête d’Adèle, comme, quelques semaines auparavant, elle l’avait placée sur la tête de son Alexandrine.
Ç’avait été une volonté de la mourante.
Elle se reprit alors à contempler de nouveau cette étrangère, qui lui rappelait de si doux et de si poignants souvenirs. Ses larmes coulèrent avec plus d’abondance, et, par cet élan sympathique qui rapproche toutes les conditions devant une pensée de mort, ses femmes s’agenouillèrent et pleurèrent avec elle.
Adèle revenait à la vie ; ses sens commençaient à sortir de leur anéantissement passager, et un seul bruit, celui des sanglots, venait frapper son oreille. Les idées pleines de confusion encore, elle ouvrit les yeux. Des femmes inconnues étaient là, à genoux, se lamentant. Elle essaya de se lever et retomba aussitôt en poussant un cri.
Elle venait de voir dans une glace une jeune fille, le teint livide, avec une couronne et des vêtements blancs comme un linceul. Cette jeune fille avait ses traits ; était-ce donc son spectre qui venait de lui apparaître ?
Et elle entendait autour d’elle des voix gémir et répéter : Pauvre enfant ! — Pauvre enfant ! — Mourir si jeune ! — Si belle ! — Pourquoi l’avez-vous rappelée à vous, mon Dieu !
Adèle referma les yeux, et de ses paupières deux larmes jaillirent.
Elle se pleurait elle-même.
Revenue tout à fait de son évanouissement, rendue au sentiment de sa position réelle, elle ne put cependant se défendre d’une terreur secrète, en songeant à son fantôme qu’elle avait vu.
C’était une des idées superstitieuses le plus généralement accréditées alors, que celle-là qui établissait que quelques jours avant de mourir de mort violente ou inattendue, votre propre image vous apparaissait, pâle, désolée, comme un messager fatal envoyé de l’autre monde.
La marquise prodigua de nouveau ses caresses à Adèle ; elle l’interrogea avec bonté sur sa famille, sur son pays, sur ses espérances de fortune. Adèle ne put articuler un mot. Ce fut le capitaine qui se chargea de répondre pour elle.
Au moment de la quitter, madame de Pompadour lui glissa au doigt une bague d’un grand prix. La jeune fille s’en aperçut à peine, et le remercîment n’arriva que jusqu’au bord de ses lèvres.
Perdant la mémoire du puissant motif qui lui avait fait risquer son aventureuse démarche, elle saluait pour prendre congé, quand M. de Pardaillan, entravant sa sortie, se hâta de lui dire :
— Et le placet ?
A ce mot, Adèle recouvre tout à la fois la mémoire et la parole :
— Oui !… ah ! de grâce, madame, s’écrie-t-elle, soyez bonne pour lui ! Il l’a si bien mérité !… D’ailleurs, il vous a sauvé la vie, peut-être, car c’est lui, lui seul, madame, qui a retenu le cheval !…
— De qui et de quoi s’agit-il donc ? demanda la marquise en souriant de cette animation subite, dont elle n’eut pas de peine à démêler la cause première.
Le capitaine expliqua tout et présenta la note.
Après l’avoir parcourue :
— Notre intéressant libérateur n’aura pas perdu pour attendre, dit la marquise de l’air le plus gracieux.
Elle sonna et fit mander le ministre de la guerre, qui se trouvait justement sous sa main.
— M. de Paulmy, lui dit-elle, vous devez avoir quelque lieutenance de cavalerie à votre disposition ?
— Et à la vôtre, madame, répondit le galant ministre en s’inclinant.
— Eh bien ! donc, faites droit à ce placet, et sur-le-champ. Nous vous en saurons gré, notre cousin.
Dampierre et sa fille retournèrent bientôt à Béthizy, enchantés de la façon dont avait tourné la visite à madame de Pompadour.
Depuis deux jours, ils étaient de retour de leur voyage à Versailles, lorsque Martine Brulard, qui depuis longtemps n’avait pas mis les pieds au château de la Douye, y arriva.
Martine avait des chagrins ; ses yeux rouges et son air effaré le disaient assez.
Dès qu’elle se trouva seule avec Adèle, elle éclata.
Son père venait d’apprendre par un des hussards de Berchiny que Charles Doisy, après s’être signalé au combat de Hamelen, y avait reçu une blessure grave… mortelle sans doute.
A ce coup de foudre inattendu, à cette nouvelle qui menaçait de renverser toutes ses espérances de bonheur, Adèle poussa un cri et se jeta dans les bras de Martine en fondant en larmes.
Martine, qui était venue chercher des consolations et peut-être faire montre de sa douleur, se trouva vivement blessée en voyant mademoiselle Dampierre plus affectée qu’elle-même, et elle la quitta, persuadée que plus que jamais elle avait en elle une rivale et non plus une amie.
Adèle, de jour en jour, devenait plus triste et plus abattue ; elle passait des heures entières devant son portrait, peint par Charles Doisy.
Un matin, le lieutenant des chasses reçut une lettre cachetée de noir. Il déjeunait en tête-à-tête avec sa fille lorsque cette lettre lui fut remise par Mariotte.
Dès qu’Adèle vit le cachet de deuil, sa pensée se reporta naturellement vers Charles Doisy, mortellement blessé au combat de Hamelen, au dire de Martine ; faisant un effort pour vaincre la violence de ses émotions, elle se disposait à interroger son père ; mais en voyant l’agitation subite, la stupéfaction douloureuse qui venait de s’emparer de celui-ci au milieu de sa lecture, son cœur se comprima et les paroles expirèrent glacées sur ses lèvres…
— Qu’est-ce donc ? de quoi s’agit-il ? murmura-t-elle enfin ; mais d’une voix si faible, tellement éteinte, que M. Dampierre devina l’interrogation plutôt au regard qu’à la voix.
— Rien… ce n’est rien, dit-il en se levant de table brusquement et en laissant là son repas à peine commencé.
Chez un homme tel que lui, parfait appréciateur des plaisirs sensuels, et dont les petits événements malencontreux de la vie n’avaient jamais eu le pouvoir de troubler le robuste appétit, cette fuite de table, ce mouvement d’abnégation eût suffi seul pour annoncer un grand malheur.
— C’est un ordre… oui, reprit-il d’un ton grave et solennel, qui n’était guère dans ses habitudes, un ordre !… auquel je dois obéir, et sur-le-champ.
Il appela son valet, lui ordonna de seller son cheval, et lui adressa diverses recommandations qui devaient suffisamment faire pressentir qu’il ne rentrerait pas de quelques jours.
Adèle resta muette, le regarda avec des yeux effarés ; mais elle ne lui fit point une seule objection.
Tandis qu’il était monté à sa chambre, pour quelques préparatifs indispensables, Adèle résolut de l’y rejoindre. Arrivée devant la porte, elle n’osa entrer ; elle ne le put pas. De même que ses lèvres étaient restées muettes, ses jambes demeuraient immobiles. Qu’allait-elle dire à son père ? L’interroger sur le sort de Charles ?
Elle eut peur de la réponse qu’il pouvait lui faire. Elle eut peur du coup qu’elle pouvait recevoir !
Et comme elle se tenait là, indécise, perplexe, mais ne pouvant cependant supporter ce doute qui la torturait, elle entendit son père marcher à grands pas en poussant de longs soupirs, et le mot, mort ! mort ! articulé avec un profond accent de douleur, vint frapper son oreille.
— Qui donc est mort ? s’écria-t-elle en se précipitant dans la chambre et en recouvrant tout à la fois le mouvement et la parole : M. Charles ?…
La main de M. Dampierre descendit rapidement sur la bouche d’Adèle.
— Que ce nom ne soit plus prononcé entre nous, pauvrette, lui dit-il. Oublions-le ; si, comme moi, tu te ressentais quelque amitié pour lui, efface-la de ta mémoire ; qu’il n’en soit plus question ! Entends-tu ? Jamais ! jamais !
Il prit sa fille entre ses bras, lui baisa les yeux, la recommanda aux soins de Mariotte, monta à cheval et partit.
Maintenant, par une de ces bizarreries si fréquentes au milieu de nos douleurs, car nos douleurs comme nos joies sont capricieuses et fantasques, Adèle cherche à rentrer dans son doute. Un cachet noir apposé sur une lettre a suffi pour lui faire croire à la mort de Charles, et quand le cri échappé à son père, cette phrase sur Doisy, qui ne peut avoir pour elle qu’un sens positif, quand tout enfin a semblé concourir à justifier ses pressentiments, à la confirmer dans sa croyance, cette croyance, elle la repousse.
A son âge, on voit l’espérance pénétrer jusque dans la tombe des morts.
— Lorsque j’ai rapporté à mon père le propos de Martine relativement à la blessure de Charles, se dit-elle, à peine s’il a paru y prêter attention. Pourquoi se serait-il ainsi troublé aujourd’hui devant un résultat qu’il devait prévoir ? Puis, en quoi cela pouvait-il l’obliger à s’éloigner d’ici, et pour plusieurs jours ? Cependant il m’a dit de l’oublier… « Mort ! mort ! » s’est-il écrié. Qui donc est mort, si ce n’est lui ? Oh ! la lettre, cette lettre seule pourrait me dire toute la vérité !
Cette lettre, elle la cherche, pensant que, dans sa précipitation, son père a peut-être négligé de la garder et de l’emporter avec lui ; mais elle ne la trouve pas.
Elle songe alors à Mariotte ; peut-être aussi son père, au moment du départ, quand il est descendu seul de sa chambre, n’a-t-il pas craint de s’expliquer devant sa vieille servante. Alors elle interroge la Picarde, laissant éclater devant elle ses craintes et même sa douleur.
— Écoutez, not’ demoiselle, lui dit Mariotte, faut pas ainsi s’entretenir en grand’crémeur sans raison ni bon sens. Si ce garçon est guari de sa navrure, n’y a plus de danger ; alors, tenez-vous coie ; s’il est défunt, n’y a plus de remède ; à quoi bon larmoyer ? Ne devons-nous mie chacun itou en faire autant ? Vous duit-il tout savoir au certain, pour vous désoler tout de suite et vous consoler plus vite ? A la bonne heure ! on peut amoyenner la chose. Cil qui peut vous en dire long n’est pas loin ; c’est père Hubert, le rouisseur : il est appert en art magique, le vieux madré ! vez-le.
Adèle refuse d’arriver à la certitude avec l’aide du sorcier.
Puisant momentanément des forces dans l’excès même de son désespoir, elle se rend d’elle-même, à pied, à la ferme des Brulard ; elle court risque d’y rencontrer le Vieux Rouisseur, sans doute, mais ce n’est pas lui qu’elle y va chercher ; c’est Martine, et ce fut Martine seule qu’elle y trouva.
La fille du meunier chantait alors à tue-tête, de l’air le plus joyeux du monde.
La voix d’Orphée, malgré tout ce qu’on en raconte, ne manifesta jamais sa puissance d’une façon plus merveilleuse que ne le fit en ce moment la voix fausse et discordante de Martine ; jamais les symphonies d’Haydn ou de Beethoven, les accords les plus enivrants de Mozart, d’Auber et de Rossini, ne retentirent aux oreilles d’un mélomane fanatique avec autant de charme qu’Adèle en trouva au vieil air, si impitoyablement écorché alors par la fille Brulard ; Byron et Lamartine, dans leurs plus grands jours d’inspiration et de lyrisme, n’ont jamais laissé tomber des strophes d’un plus formidable effet que celui produit par ces vers si simples :
Le reste à l’avenant.
Adèle, palpitante, s’était arrêtée sur le seuil de la chambre occupée par Martine, comme le matin de ce même jour elle s’était tenue anxieuse, indécise, bouleversée par de rudes angoisses, à cette porte qui la séparait de son père et de la missive au cachet noir ; mais combien son émotion est différente maintenant ! L’oreille tendue, les mains jointes, les yeux au ciel, elle écoute dans une sorte de ravissement extatique ce chant trivial, comme elle eût écouté les cantiques des anges ou la voix du Christ au tombeau de Lazare, et en l’écoutant elle se sent renaître ; le sang lui remonte aux joues, au front et lui bat au cœur par flots plus doux et plus réguliers ; son regard se ranime sous une expression radieuse d’espoir et même de bonheur.
Pour Adèle, la voix de Martine vient de ressusciter un mort.
Se précipitant dans la chambre :
— Il est donc sauvé ! s’écrie-t-elle.
— Ah ! vous m’avez fait peur ! dit, avec un soubresaut, Martine, qui ne s’attendait pas à cette visite. Qui donc est sauvé ?
— Mais lui !
— Qui, lui ?
— M. Doisy !
— M. Doisy ? hein ?… plaît-il ?… pourquoi sauvé ? reprit la fille du meunier, dans un trouble évident.
— Il n’est pas mort, du moins, poursuivit Adèle.
— Mort, lui ?… qui donc a pu vous dire…
— Mais vous-même, d’abord ;… oui, vous, Martine ; ne m’avez-vous pas parlé d’une blessure mortelle reçue par lui dans la ville d’Hamelen ?
— Ah !… oui, oui… Pardon ! c’est que je pensais à tout autre chose, répondit l’autre en se remettant de son trouble momentané.
Et, d’un air plus calme, elle ajouta :
— Au fait, après ce qui lui est arrivé, il pourrait bien n’être plus de ce monde… je l’ai même entendu dire, et, pour votre gouverne, mam’zelle, vous ferez bien de le croire ainsi, voire même de le répéter au besoin.
Adèle la regarda d’un air stupéfait, puis, tombant sur une chaise :
— Et vous chantiez, Martine !
— Pourquoi pas ? Faut-il donc toujours être en pâmoison ? Ça ne me va pas, à moi. D’ailleurs, je suis contente aujourd’hui : je vais me marier. Oui, mam’zelle, et bientôt je l’espère ; mon père y consent ; il ne s’agit plus que de patienter un peu ; car nous nous marions, nous autres ! ajouta-t-elle en se redressant de toute la hauteur de sa fausse vertu.
Depuis sa dernière visite au château de la Douye, la fille Brulard en avait beaucoup appris sur le compte de mademoiselle Dampierre et sur son séjour à Versailles. Aussi reprit-elle d’un ton d’arrogance et de dédain :
— Vous ne m’aviez pas raconté, ma mie, à quelle occasion le roi vous avait fait présent d’un diamant de si grand prix. Pourquoi donc ne me l’avoir pas montré ? Croyez-vous que j’en aurais été jalouse ?… Oh ! nous autres, simples filles de la campagne, nous nous contentons de moins, ça coûte trop cher.
— Comment, le roi ! dit Adèle, frappée de stupeur ; le roi ! je ne l’ai même pas vu.
— Je le souhaite pour vous, ma chère ; mais alors, qui donc vous aurait remis ce joyau ?
— Mais… madame la marquise.
— Ah ! la Pompadour ? Au fait, reprit Martine avec une ironie grossière qu’elle croyait devoir être piquante, on se convient, on se rapproche, selon les goûts qu’on a. Vous voyez le beau monde, à ce qu’il paraît, à présent ? Je pourrai bien le voir un jour aussi ; mais à d’autres conditions… qui sait ?… Mon mari peut devenir…
Elle se retint tout à coup et se prit à chanter comme si elle était encore seule.
Le meunier Brulard survint, et, avec sa brutale franchise, il renchérit encore sur les propos de sa fille.
— Retourne à ton rouet, près de ta mère ; hors d’ici, Martine ! il ne te convient pas de causer plus longtemps avec les belles demoiselles de château. Tiens-toi à ta place ; chacun à la sienne !
Et se retournant vers la nouvelle venue, restée interdite devant ce double accueil :
— Je ne vous prierai pas d’entrer chez ma femme, reprit-il ; mais j’espère avoir le plaisir, je ne dis pas l’honneur, de vous revoir, quand j’irai porter mes redevances à votre digne homme de père.
Le meunier et sa fille s’éloignèrent ; Adèle resta seule.
Raillée, insultée, chassée, sans avoir pu même appeler la plus faible lueur sur le doute qui la tuait, elle sentit sa raison près de s’égarer au milieu du chaos de ses pensées douloureuses. Certes, elle avait déjà connu le malheur, puisqu’elle avait perdu sa mère ; mais de tous les étonnements pleins d’amertume que le mauvais destin pouvait encore lui tenir en réserve, celui de se voir méprisée, méprisée moralement, était le plus grand, le plus inattendu de tous. Elle n’ignorait pas combien de formes différentes le malheur peut revêtir pour arriver à nous, mais jamais elle n’eût soupçonné devoir le rencontrer sous celle du mépris.
A ses émotions, à ses tressaillements de pudeur, si un sentiment réel de honte pénible s’était mêlé jamais, ç’avait été surtout dans cette matinée où la rusée Martine l’avait réduite à se montrer aux yeux du jeune soldat tout inondée de la bourbe des marais. Aujourd’hui, ce n’est plus son vêtement d’emprunt, son tablier de grosse toile que la fille Brulard éclabousse d’une fange impure, c’est sur l’enveloppe même de son âme, sur sa robe virginale, sur son manteau de chasteté qu’elle jette à pleines mains les immondices corrosives de la calomnie.
— Mon Dieu ! si Charles n’a pas cessé de vivre, faut-il que ce bruit fatal arrive jusqu’à lui ? Doit-il donc, lui aussi, mépriser la pauvre enfant qui n’eut dans sa vie qu’un instant d’audace et de résolution et à son profit ? Mais non, ma crainte est vaine ; près de lui, on ne peut rien contre moi, car Charles n’existe plus sans doute !
Et elle n’échappe ainsi à une douleur que pour tomber sous une douleur plus grande.
Dans le désordre, dans l’agitation de son esprit, sa pensée se retourne dans son cœur comme un glaive à deux tranchants.
S’il vivait cependant, s’il devait vivre encore assez pour entendre une voix lui dire à l’oreille : Ton Adèle a cessé d’être une honnête fille ; tu voulais t’élever pour être digne d’elle, et elle était indigne de toi ! Ah ! s’il vivait, ne fût-ce que pour quelques jours, eh bien ! elle se sentirait la force d’aller le rejoindre pour s’agenouiller devant son lit de douleur et le consoler par sa justification. Quoique la calomnie vole d’une aile rapide, elle arriverait à temps pour lui crier : Charles, je suis innocente ! Ce que j’ai fait, je l’ai fait pour vous et en restant digne de vous ! J’en prends à témoin celui dont je n’ai que secondé les vues généreuses, cet homme devenu pour vous un bienfaiteur, un second père, votre ancien capitaine, l’ami de mon père, M. de Pardaillan enfin, dont l’honneur vous répondra du mien ! Cette démarche, elle oserait la tenter ! Elle l’oserait, car sous la double commotion qu’elle vient de ressentir, elle aussi s’est transformée ; une incroyable énergie semble vouloir prendre la place de ses habitudes timides et craintives. Oui, elle va rentrer au logis de son père, lui tout dire, lui tout avouer ; qu’il l’accompagne, et elle part !… Mais son père… son père, c’est lui qui est parti… parti, en emportant cette lettre fatale qui l’instruisait de la mort de Charles !
Sous le poids accablant de cette double et désolante pensée de mort et de déshonneur, elle s’éloignait de l’habitation du meunier, marchant devant elle au hasard, quand, arrivée sur les bords de la rivière d’Autonne, elle aperçut un homme enfoncé dans l’eau à mi-corps.
Cet homme, elle le reconnut bientôt au dandinement de sa tête, à ses cheveux vert pâle, distribués par touffes sur un front chauve, le tout offrant assez fidèlement l’image de ces fins gazons de bois, décolorés à l’arrière-saison, et qui, parfois, plaqués sur des pierres de forme arrondie, semblent couvrir des têtes fossiles d’une chevelure végétale.
Distraite, effrayée même par cette rencontre inattendue, Adèle ne vit pas une femme dont la jupe de futaine et le haut bonnet à la picarde disparurent derrière une haie, aussitôt qu’elle se montra.
Le Vieux Rouisseur paraissait alors occupé à déplacer ses gerbes placées au fond de son routoir[3].
[3] Les routoirs sont ces flaques d’eau généralement produites par les infiltrations des rivières, et dans lesquelles on met rouir le chanvre.
Celui du père Hubert était séparé de l’Autonne seulement par le chemin que suivait la jeune fille. Elle ne put donc éviter de passer près de lui, mais elle le fit les yeux baissés, le visage tourné vers la rivière, autant pour cacher son trouble qu’à cause de l’espèce de terreur dont elle ne pouvait se défendre à l’aspect du vieillard.
Songeant cependant aux derniers conseils de Mariotte, elle ralentit sa marche, sans l’interrompre toutefois.
Déjà, elle était au delà du routoir, lorsque s’aventurant à jeter un regard furtif derrière elle, elle vit le sorcier, les bras croisés, la tête ballante, qui la suivait de l’œil, d’un air d’intérêt et de compassion.
Elle hésitait encore quand elle l’entendit murmurer des paroles confuses, au milieu desquelles son nom seul ressortait distinct.
Revenant aussitôt sur ses pas :
— Vous m’avez appelée, père Hubert ? dit-elle ; pardon de ne vous avoir pas vu d’abord.
— Oh ! que vous m’aviez bien vu, mam’zelle ! à preuve qu’ensuite vous avez détourné la tête pour essayer de me dérober l’air de votre figure. Mais avais-je besoin de vous voir de face pour deviner la réception qu’ils vous ont faite, au moulin ?
— Quoi ! vous savez, père Hubert ?…
— Beau mérite ! je les connais si bien, que je les entends d’ici jastoiser sur vous. Vous auriez évité ça, mam’zelle, si vous aviez suivi de prime le conseil de vot’ servante.
— Quoi ! vous savez aussi…
— Oh ! je sais… je sais, reprit le bonhomme en lui jetant un regard en dessous, qu’il y a ben des choses que vous ne savez pas et que vous voudriez ben savoir ; n’est-il pas vrai ?
— Oui, oui ; bien vrai ! s’écria la jeune fille.
— Pourquoi n’êtes-vous pas venue plus tôt ? Vous n’avez donc plus confiance dans le Vieux Rouisseur ?
Adèle baissa la tête.
— Les échos du pays répètent de vilaines choses, mam’zelle ; mais les échos ont ça de bon qu’ils ne répètent que ce qu’ils entendent dire ; ils n’y ajoutent rien. De ce côté, ils valent mieux que les hommes. Vous désireriez leur faire changer de ton, dites ?
— Que m’importe ! si celui devant qui surtout j’aimerais à me justifier n’existe plus.
— Ah ! fit le Rouisseur, vous pensez à la lettre de ce matin ?
Adèle ouvrit des yeux stupéfaits. Puis, joignant convulsivement ses mains d’un air d’impérieuse supplication :
— Vous qui savez tant de choses, existe-t-il ? le reverrai-je ? s’écria-t-elle.
— Attendez, et écoutez ! répondit le vieillard d’un ton d’étrange solennité ; surtout, retenez bien ce que je vas dire, car les paroles que je prononce à l’emblée et sous le souffle du MAITRE, à peine si mon oreille les entend et si ma pauvre mémoire les garde. Il en est d’elles quasi comme de mes vieux rêves de l’an passé… Écoutez !
Sans sortir de son routoir, il plongea alors profondément ses bras sous l’eau, en marmottant des mots inintelligibles dans un jargon cabalistique ; puis, des javelles submergées, il retira trois brins de chanvre, et, l’un après l’autre, du bout de l’ongle, il les dépouilla de leur enveloppe.
— L’écorce quitte la chènevotte, murmura le sorcier en attachant de temps en temps sur la jeune fille ses petits yeux fauves et perçants : bien des choses s’éclairciront. La chènevotte est rayée, et la raie du mitan est majeure !… tous ceux qui doivent mourir ne sont pas encore morts.
Rassemblant alors les lambeaux humides et grêles de l’écorce du chanvre, il les mâcha à plusieurs reprises, comme pour en étudier la saveur.
Personne n’ignore quelle est la puissance narcotique et vertigineuse du chanvre. C’est avec cette plante que les Orientaux composent cette terrible liqueur du bang, dont les effets, supérieurs même à ceux de l’opium, leur ouvrent des mondes imaginaires ou les jettent dans des exaltations prophétiques.
Peut-être la feinte ne jouait-elle pas seule un rôle dans la sorcellerie du père Hubert ; peut-être les émanations de la plante, les opérations du rouissage, auxquelles il se livrait, agissaient-elles sur son cerveau en dehors de ses pensées volontaires ; peut-être enfin était-il plus sorcier qu’il ne le croyait lui-même.
Quoi qu’il en soit, après avoir quelque temps savouré la liqueur âcre et caustique contenue dans les lambeaux enlevés par lui à la chènevotte, il les pressa entre ses doigts, tira à lui, et les fit crier à son oreille, écoutant avec grande attention le bruit aigre et grinçant qui s’en échappait.
Entre le chanvre et le chanvrier paraissaient exister en ce moment les rapports communs d’une langue mystérieuse et surnaturelle.
Adèle se tenait toujours devant lui, les mains jointes, et dans une attitude pleine de perplexité et de foi, car la parole du vieillard, le timbre bizarre de sa voix, son regard obsesseur, le mouvement régulier de sa tête, la nuit qui venait, et jusqu’à la vue de l’eau, tout contribuait à la frapper de ce vertige superstitieux dont elle n’avait jamais été bien guérie.
Le Vieux Rouisseur s’arrêta dans sa consultation, et comme se parlant à lui-même, en paraissant répondre à une des exigences de son singulier interlocuteur :
— Oh ! oh !… dit-il, l’osera-t-elle ?
— Tout ce qu’il sera en mon pouvoir d’entreprendre, je l’oserai, père Hubert. Parlez !
— Eh bien ! reprit le vieillard, écoutez donc ! Un fétu de paille vous a tout d’abord fait songer pour la première fois au beau jeune garçon qui vous occupe si tristement à l’heure présente.
— C’est la vérité, répondit Adèle.
— Ces trois autres fétus qui se trouvent là, si vous faites ce qu’ils ordonnent, pourront bien parfaire l’œuvre du premier.
— Qu’ordonnent-ils ? dit la consulteuse, qui tremblait de tout son corps.
— Cette nuit même… cette nuit, vous entendez, acheminez-vous par la Cavée aux Anglais vers la tour Saint-Adrien.
Adèle fit un mouvement.
— Rendez-vous-y seule, sans falot ni lanterne, quand tout dormira autour de vous ; soyez sans crainte. On n’est jamais si seule qu’on le croit.
— Ensuite ? dit Adèle.
— Ensuite, gravissez la montagne, et ne vous arrêtez qu’à la place où se trouvait naguère la chapelle de Sainte-Geneviève ; vous la reconnaîtrez bien aux marches de pierre qui s’y trouvent encore au milieu des ruines.
— Ensuite ? répéta Adèle.
— Ensuite, si, là, vous priez Dieu pour les blessés, les blessés guériront.
— Mais il est mort ! s’écria-t-elle.
— Priez, vous dis-je ; priez, et, votre prière faite, levez les yeux et regardez bien… Surtout, ne répétez jamais que vous avez vu aujourd’hui le père Hubert, et que vous lui avez parlé.
Il laissa tomber au milieu du routoir les trois brins de chanvre qu’il tenait encore à la main, puis il ajouta :
— Maintenant, ne m’interrogez plus ; je ne saurais vous répondre : allez !
— Mon Dieu ! serait-il possible ? Cette lettre ne contenait donc point la vérité ? Mais, s’il est blessé, mourant, là-bas, si loin de ceux qui s’intéressent à lui, qui donc prend soin de lui ?… dites ?
Et elle tendait vers lui ses mains suppliantes.
— Puis-je croire que mes prières suffiront à le sauver ? Répondez… Ah ! répondez, par grâce !
Le Vieux Rouisseur s’était remis tranquillement à transposer ses gerbes ; il ne lui répondit point, sinon d’un ton dur et colère :
— Passez vot’ chemin, jeune fille, et cessez de troubler dans sa besogne un pauv’ vieillard qui ne sait ce que vous lui voulez !
En rentrant au château de la Douye, mademoiselle Dampierre fut prise d’une fièvre violente, et dut se mettre au lit.
Mariotte envoya à Verberie chercher le médecin. Celui-ci commanda la diète, le repos absolu, et promit de revenir le lendemain. Mariotte voulut veiller sa maîtresse, et malgré ses défenses expresses, elle s’obstina à rester dans sa chambre pour y passer la nuit. Adèle finit par l’y souffrir.
— Au fait, se disait-elle, puis-je penser à aller seule, ainsi, dans l’obscurité, parcourir ces ruines où nul, dans le pays, n’ose s’aventurer ? ces ruines où un danger vous menace à chaque pas, dit-on, et où la bête de la Chambrerie erre dans les ténèbres ? En aurais-je la force ? Dans l’état où je me trouve, comment y songer ?
Le soir venu, accablée par la fatigue et par la fièvre, elle s’endormit. Mariotte en fit autant de son côté.
Onze heures sonnaient à la paroisse de Saint-Martin de Béthizy quand la jeune malade s’éveilla.
Un rêve venait de la transporter au fond du Hanovre et de lui montrer Charles Doisy sur un grabat, étendu, privé de soins, de secours, et attendant la mort au milieu d’un isolement affreux.
Se jetant aussitôt hors du lit, elle s’habilla silencieusement, à la hâte, en prenant toutes sortes de précautions pour ne point interrompre le sommeil de Mariotte.
— Si le père Hubert avait raison ! se dit-elle ; si mes prières pouvaient le sauver ! Dans le doute même, pourquoi hésiterais-je ?
Vêtue à peine, marchant pieds nus, pour ne pas faire de bruit, elle gagna l’escalier, et parvenue à la porte de sortie, là seulement elle chaussa ses souliers, qu’elle avait jusqu’alors tenus à la main.
La nuit était froide, le terrain inégal, raboteux ; elle voyait clair à peine, car des nuages couvraient le ciel ; mais la fièvre la soutenait, comme auparavant le désespoir.
Elle ne devait emprunter de forces, ce jour-là, qu’à ses souffrances physiques ou morales, à son amour aussi.
En traversant le village, elle ne rencontra personne. A cette heure, les habitants des deux Béthizy dormaient tous paisiblement. Aucune lumière ne brillait aux fenêtres, comme pas une étoile ne scintillait dans le ciel. Tout en s’applaudissant de sa solitude, elle s’en effraya. Sa raison vint à son secours.
— De quoi puis-je avoir peur ? je ne vois rien, pas même mon ombre, et j’entends à peine le bruit de mes pas.
Une chauve-souris décrivit ses spirales au-dessus de sa tête, et le cri du choucas s’éleva du côté de la forêt. Les évolutions comme les cris de ces hôtes des nuits lui étaient familiers ; cependant elle tressaillit involontairement ; mais elle poursuivit son chemin.
Au bout de quelques pas, soit réalité, soit un effet de la fièvre, elle crut entendre des hurlements lugubres… Une cloche tintait dans le lointain.
— Ce sont les clameurs, ce sont les cloches invisibles du Prieur maudit ! pensa-t-elle. Qui donc est en danger de mort ?… Moi, peut-être !
Non sans peine, elle reprit courage et continua d’avancer.
Parvenue à la Cavée aux Anglais, elle vit, dans de grises vapeurs, se dessiner devant elle la montagne, la tour, les ruines de Saint-Adrien. Elle les avait vues mille fois le jour et sans aucune sorte d’émotion pénible ; mais à cette heure de la nuit et sous l’empire des idées qui s’emparaient d’elle à ce moment, les choses lui paraissaient tout autres. La montagne semblait vaciller sur sa base ; on eût cru que de nouvelles assises étaient venues s’ajouter à celles de la tour qui paraissait grandir et dont les créneaux s’éclairaient par instants d’une lueur étrange. Les pans de ruines eux-mêmes, restés debout dans toute leur hauteur, se mouvaient, se rapprochaient, se penchaient l’un vers l’autre, comme autant de spectres funèbres qui auraient tenu conseil.
Adèle s’arrêta indécise, et peut-être allait-elle rétrograder si cette pensée ne s’était fait jour dans son esprit, au milieu de ses hallucinations : Quoi ! quand il s’agit de lui sauver la vie, car le Rouisseur l’a dit : « Priez et les blessés guériront, » je ne pourrais vaincre un sentiment d’effroi, lorsque pour lui, à Versailles, j’ai su triompher même d’un sentiment de pudeur ! Il m’en a coûté cher déjà ; mais qu’il vive et il sera mon juge, après Dieu.
De cet instant, une métamorphose complète s’opéra en elle ; ses forces purent faiblir, mais sa résolution lui demeura inébranlable au cœur, et l’enfer armé n’eût pas suffi à lui barrer le passage.
La nuit s’épaississait de plus en plus ; à peine si le sentier qu’elle suivait était perceptible. Le vent, qui s’était élevé, se déchirant aux angles des ruines, faisait entendre des sifflements aigus, auxquels se mêlaient ces étranges hurlements qui déjà l’avaient alarmée.
Elle marcha cependant ; mais un tremblement convulsif la prit.
Bientôt, près d’elle, elle sentit quelque chose haleter, fureter, et deux yeux ardents brillèrent dans l’obscurité. Elle tomba à genoux sur les cailloux du sentier. Les deux yeux étincelants semblèrent aussitôt s’être implantés en terre devant elle, comme de vivantes escarboucles, et un gémissement plaintif arriva à son oreille, en même temps qu’une chaude vapeur d’haleine lui passa sur la figure. Puis, la vision disparut.
Elle se releva et marcha encore ; mais sa poitrine était comprimée, ses artères battaient avec violence et il lui semblait que c’était dans son cœur même que résonnait alors le tintement sinistre de la cloche invisible.
La tour qu’elle avait perdue de vue, tandis qu’elle gravissait les pentes inférieures de la montagne, reparut enfin à ses yeux ; mais la vieille enceinte semblait avoir changé de place. Elle l’avait laissée à sa gauche, elle la retrouvait à sa droite. La courageuse enfant coupait le terrain en diagonale pour y arriver par un chemin plus direct, quand, derrière un monticule, s’éleva soudainement une apparition sous forme féminine. Sa robe blanche flottait au vent ; elle élevait les bras, en faisant entendre comme un appel étouffé.
Cette seconde vision disparut comme l’autre.
Au même instant, comme Adèle s’approchait d’une haie qui semblait se mouvoir et s’entr’ouvrir, le vent de la nuit prit une voix pour lui crier à l’oreille ces mots nettement articulés : Retournez ! retournez !
Elle n’en tint compte et continua de marcher ; mais une sueur glacée lui tombait du front, et ses dents entre-choquées lui faisaient ajouter un nouveau bruit à tous ces bruits aigus, plaintifs, stridents, qui l’entouraient.
Elle aperçut enfin, à la lueur d’une faible éclaircie, les marches de pierre, brisées, disjointes, couvertes de mousse et de byssus, qui, avec un fragment de muraille couronné d’une lucarne en ogive, composaient les seuls débris de l’ancienne chapelle de Sainte-Geneviève.
Touchant au but, fortifiée par l’importance et les périls mêmes de sa mission, Adèle sentit s’évanouir toutes les terreurs auxquelles elle avait été en proie et dont elle avait triomphé. Se faisant de son amour et de ses croyances un abri contre toutes les puissances malfaisantes du démon, tout entière à l’acte solennel qu’elle était venue accomplir dans ce lieu terrible, elle s’agenouilla sur ces pierres bouleversées avec le même recueillement qu’elle eût porté devant le maître-autel de Saint-Martin de Béthizy.
Après avoir fait le signe de la croix, joignant les mains :
— Mon Dieu ! mon Dieu ! s’écria-t-elle, et vous, bonne sainte Geneviève, soyez-moi en aide ; s’il n’est que mourant, faites qu’il vive ! Quoiqu’il soit bien loin de son pays et des siens, faites que je le revoie !
Ensuite, courbant son front jusqu’à terre, elle acheva mentalement son oraison.
Quand elle releva les yeux, non sans surprise, elle vit l’ogive de ce pan de muraille qui lui faisait face, s’éclairer soudainement d’une lueur qui ne pouvait descendre du ciel. Cette fenêtre de l’ancienne chapelle avoisinait la tour, dont la base se trouvait à son niveau.
A cette clarté qui venait de faire sortir de ses ténèbres le plateau du vieil édifice féodal, Adèle vit s’élever, comme de dessous terre, une apparition bien autrement saisissante que toutes celles qu’elle avait vues rôder ou se dresser devant elle durant cette nuit prestigieuse. Un jeune homme, au teint pâle, les cheveux en désordre et portant le bras en écharpe, se montra. Le court manteau qui le recouvrait, rejeté en arrière, laissait voir les restes d’un costume militaire, d’un uniforme de hussard.
C’était Charles Doisy, ou c’était son fantôme.
Muette de stupeur, les bras tendus vers lui, Adèle se redresse palpitante, épiant ses mouvements, interprétant sa pâleur et lui adressant de la tête de légers signes affectueux qu’il ne pouvait voir, car elle restait dans l’ombre. Tout à l’heure, elle était plongée dans les transes de la terreur et du désespoir ; maintenant toute son énergie se concentrait pour retenir un délire de joie et de bonheur qui s’emparait d’elle :
— Je le vois ! se disait-elle à elle-même, mais si je vais à lui, si je l’appelle, peut-être son ombre va-t-elle s’évanouir.
Dans ce moment, le jeune homme, après avoir semblé écouter attentivement un bruit du dehors, ramassa une lanterne placée à l’entrée du souterrain dont il venait de sortir, et il s’en aida comme pour éclairer une des rampes du vieux château.
— Il vient ! il vient ! murmura Adèle.
Mais Charles, sans bouger à peine de place, fit alors un geste de surprise, échangea à voix basse plutôt des signaux que des paroles avec quelqu’un qui paraissait gravir de l’autre côté un des versants de la tour, puis :
— Est-ce donc toi, chère Martine ? dit-il.
— Eh ! sans doute, c’est moi ! répondit une voix haletante. Je n’y tenais plus ! j’ai voulu venir aujourd’hui moi-même, mon Charlot, pour t’apporter une bonne nouvelle.
Et Martine, tout essoufflée, se jeta dans les bras du jeune homme.
Ils furent interrompus dans leurs embrassements par un cri déchirant parti d’entre les débris de la vieille chapelle…
Blessé, en effet, mais légèrement, dans l’affaire d’Hamelen, Charles Doisy avait reçu de son lieutenant-colonel le conseil et l’autorisation d’aller lui-même plaider sa cause auprès du ministre.
Arrivé à Versailles le lendemain même du jour où Dampierre et sa fille en étaient sortis, il se présente dans les bureaux, pour y réclamer son état de service. Le commis auquel il s’adresse se hâte de lui annoncer qu’il vient d’être nommé lieutenant dans le régiment d’Anjou et lui montre la lettre signée par M. de Paulmy.
Le jeune homme pousse un cri de joie ; son front, jusqu’alors resté soucieux, s’éclaira vif et animé, et, redressant fièrement la tête, il se rendit aussitôt chez le capitaine de Pardaillan.
M. de Pardaillan travaillait avec quelques officiers de son futur régiment et avait fait défendre sa porte, lorsque son domestique vint lui dire qu’un jeune militaire insistait vivement pour pénétrer jusqu’à lui, malgré la consigne.
Au nom de Charles Doisy, il ne douta pas qu’une indiscrétion n’eût été commise et que son ex-maréchal des logis ne vînt le remercier de sa récente nomination. Il ordonna qu’on le laissât entrer.
— Je viens, capitaine, lui dit Charles, le prenant dès l’abord sur le ton le plus élevé et n’adressant son salut militaire qu’aux officiers, vous annoncer que je suis enfin lieutenant.
— J’en suis ravi, mon brave, répondit M. de Pardaillan, d’autant que je sais à n’en pas douter que cette distinction est méritée.
— Ravi ? répéta le jeune homme, la tête haute et d’un ton de sarcasme ; j’en doute, monsieur ; car si j’ai tenu si fort à cette distinction, méritée, ainsi que vous voulez bien le reconnaître, ce n’a été, avant tout, que pour avoir le droit de vous demander raison de votre conduite lâche et déloyale à mon égard.
Les témoins de cette scène firent un mouvement pour intervenir ; le capitaine les retint d’un geste, et leur dit ensuite :
— Veuillez nous laisser seuls.
— Restez, messieurs, reprit Charles Doisy ; restez pour pouvoir attester devant tous, s’il en est besoin, que je suis venu ici pour demander raison à M. le capitaine de Pardaillan de l’insulte qu’il m’a faite, de l’injustice calculée dont il m’a rendu victime ; restez ! car, contre toute probabilité, s’il refuse de me rendre satisfaction, il faut que devant vous je lui arrache ses insignes d’officier, comme il a voulu me dégrader de ceux que je portais, plus noblement peut-être qu’il ne porte les siens !
Le capitaine se couvrit les yeux de ses deux mains avec un geste désespéré.
S’il se fût trouvé seul lors de l’arrivée de Charles Doisy, peut-être ne lui eut-il pas laissé le temps de s’engager dans cette route fatale ; peut-être même, la terrible phrase achevée, il eût été assez généreux pour oublier l’outrage et forcer par un seul mot son insulteur à lui demander pardon. Mais une explication n’était plus possible, ou ne l’était du moins qu’après l’affaire vidée.
— Vos armes, monsieur ? lui dit-il.
— L’épée.
— Le lieu ?
— L’Étoile de Satory.
— L’heure ?
— Le temps de trouver un témoin.
— Allez donc le chercher, monsieur ! Vous serez le mien, Blangy, dit le capitaine en s’adressant à l’un des officiers.
Doisy ne connaissait personne dans Versailles. Pour son témoin, il dut donc se contenter du premier venu ou du plus tôt trouvé.
En longeant les boulevards, il aperçoit, à travers les vitres d’un café, un jeune beau fils qui s’ébat tout seul devant un bol de punch, et semble prendre un grand plaisir à le faire flamber. Il entre, et le touchant légèrement du doigt :
— Pardon, monsieur, lui dit-il, j’aurais un service à vous demander. Pourriez-vous sortir un instant ?
— Du tout, mon cher, répond l’autre en le toisant du haut en bas. Si je sors, mon punch va s’éteindre. Ne savez-vous parler sans prendre l’air ?
Dès les premiers mots, l’homme au punch vit de quoi il s’agissait.
— Très-bien, dit-il, je suis à vous, mais asseyez-vous, et pour gagner du temps aidez-moi à vider ce bol ; il est payé, je ne puis le perdre. Ici, où j’ai l’honneur d’être connu, les drôles me font toujours payer d’avance. Allons donc ! pas de cérémonie ! vous m’en payerez un autre quand nous reviendrons… si vous revenez. Holà ! oh ! garçon, un verre !
Ce flambeur de punch était le chevalier d’Annezay, fils de bonne maison, deux fois chassé de son régiment pour cause d’indiscipline, perdu de dettes et de débauches, mais qui, protégé par la maîtresse du prince de Soubise, fréquentait les antichambres de Versailles et devait faire son chemin. C’était lui qui, quelques jours auparavant, avait accosté mademoiselle Dampierre dans la grande galerie du château.
— Voyons, mon gentilhomme, dit-il à Doisy, quand celui-ci eut enfin consenti à s’asseoir. D’abord, à qui ai-je affaire ?
— Je suis officier, monsieur.
— Très-bien, c’est que vous n’en portez pas l’uniforme. Et vous vous battez ?…
— A l’épée, monsieur.
— C’est donc pour cela que je ne vous vois qu’un sabre ?
— Je vais pourvoir à l’arme qui me manque.
— On ne peut mieux ! Mais ce duel, c’est donc pour demain ?
— A l’instant, monsieur.
— Diable ! et vous ne vous étiez précautionné ni d’une arme, ni d’un témoin ? Eh bien ! mon jeune ami, vous avez eu la main heureuse en me rencontrant ; mon temps est libre, j’ai dix épées à votre service et je loge dans cette maison même. Il n’y aura pas une minute perdue !
Le bol achevé rapidement, ils montèrent chez d’Annezay.
— Maintenant, tout en menant les choses vivement, ne précipitons rien, dit le chevalier. Il s’agit de savoir quel genre d’épée nous convient. J’en ai pour toutes les circonstances. Est-ce à un frère, à un mari que nous avons affaire ? Dans ce cas, l’épée moyenne, plate, courtoise, est la plus convenable. Il est toujours de mauvais goût de tuer ces messieurs-là. Consolons les veuves, ventre de biche ! mais n’en faisons pas. Elles sont parfois assez simples pour nous en garder rancune.
— Il ne s’agit nullement de femmes dans cette affaire, monsieur.
— Tant mieux. Ça laisse le jeu plus franc. Une autre question. Nous battons-nous avec un ami ou avec un ennemi ? Pardon ! je ne voudrais pas être indiscret !… il ne s’agit toujours ici que du choix de l’arme. Quel que soit votre adversaire, je suis votre homme, s’agît-il de mon propre frère… Je suis cadet.
— C’est avec mon ancien capitaine que je me bats, monsieur.
— Tudieu ! la longue épée alors, la colichemarde pour ces distributeurs d’arrêts forcés ! Au diable tous les capitaines ! On n’en saurait trop mettre à la réforme ; je sollicite un emploi. Il faut des vacances. Vous êtes Berchiny, mon gentilhomme. J’aimerais assez ce régiment-là ; le costume est galant. Voulez-vous vous essayer la main, très-cher ? j’ai un joli coup d’arrêt en dessus à vous indiquer, il est vif et peu connu.
— Nous sommes pressés, monsieur.
— Oui ? Voici votre épée. En route !
On fit avancer un fiacre ; ils y montèrent et se dirigèrent vers l’Étoile de Satory.
Chemin faisant :
— Eh ! dites donc, camarade, à propos, j’oubliais… J’ai un ami qui est Berchiny aussi… un grand ami, le vicomte d’Arsac… Un instant ; celui-là, je n’en dois pas hériter ; au contraire, je n’en jouis qu’en viager. Il me paye à dîner et je lui gagne son argent au lansquenet ! Ce n’est pas avec lui que vous vous battez, n’est-ce pas ?
— Je suis confus, chevalier, de n’avoir pas débuté par vous dire le nom de mon adversaire, je le devais…
— Mais non !
— Il ne fait même plus partie du régiment de Berchiny…
— Tant pis ! Mais qu’importe !
— C’est le capitaine de Pardaillan.
— Pardaillan ! s’écria d’Annezay, Pardaillan qui a refusé de m’admettre dans le régiment en œuf qu’il est en train de couver ! Ah ! le rufien ! Je suis désolé de ne pas vous avoir appris mon coup d’arrêt en dessus. J’aurais été ravi d’en voir l’essai sur la peau de ce drôle qui m’a mis à l’écart ; oui, et malgré la recommandation du duc de Soubise, soi-disant parce que je suis joueur, ivrogne, bretteur, toutes choses, du reste, parfaitement vraies, mais qui ne le regardent en rien, il me semble. Il paraît que c’est de vestales qu’il va composer son régiment de cavalerie. Des vestales qu’il recrute d’abord pour le Parc aux Cerfs ! Comme ça lui va, au Pardaillan, de parler de mœurs !
— Pourquoi non ? Quelle que soit la gravité des reproches que j’aie à lui faire, c’est un homme d’honneur, répondit Charles Doisy, qui commençait à prendre son témoin en dégoût, et qui, déjà touchant à la vengeance, ne s’y sentait peut-être plus poussé par la même ardeur.
— Un homme d’honneur ! Turlututu ! A d’autres, mon gentilhomme ! Vous arrivez de loin, à ce qu’il me paraît.
Puis, partant d’un éclat de rire :
— Il est vrai qu’en fait d’honneur, le capitaine doit en avoir, puisqu’il en vend.
— Plaît-il ?
— Oui, mon très-cher, il vend le sien et celui des autres… celui des jeunes filles surtout. Ah ! le vilain métier ! Il vaut mieux vendre que prendre, dit le proverbe. Ici, le proverbe a menti.
Et il se mit à chanter ce noël tout nouveau alors :
Doisy regarda le chanteur.
— Que voulez-vous faire entendre par là ? lui dit-il.
— Vous ne comprenez pas encore ? Décidément, vous revenez de très-loin.
— Je reviens de l’armée.
— C’est donc cela !
— Mais quel rapport peut-il y avoir entre M. de Pardaillan et…
— Quel rapport ? Écoutez le second couplet.
Et il reprit :
— C’est là une étrange calomnie ! dit Charles. Le capitaine a pu être pour moi injuste et cruel ; mais une faute, une erreur peut-être, n’entache pas toute une vie. Comment admettre chez lui des vices pareils à ceux que vous lui supposez ? il vient à peine de quitter son régiment où il était estimé… et…
— Mais vous n’avez donc pas entendu mon second couplet ? Je vais le recommencer…
— Moi, je vous répète, monsieur, que je ne puis le croire.
— Allons, bon ! au lieu de se battre avec lui, il va se battre pour lui, et avec moi !
— Eh ! monsieur !…
— A vos souhaits, jeune homme. Je ne refuse pas de faire plus ample connaissance avec vous, mais n’embrouillons rien, je vous prie. Si nous nous battons, et que je sois tué, vous n’aurez plus de témoin ; puis, entre nous, si c’est à moi que vous avez d’abord affaire, je vous prêterai une autre épée, plus courtoise. Je ne me soucie pas de me trouver en regard de ma colichemarde.
— Assez sur ce sujet, et trêve de railleries, je vous prie ! répliqua Doisy d’un ton brusque, et en se rencognant dans le fond du fiacre, comme décidé à terminer là l’entretien.
— Non pas ! dit le chevalier en se récriant ; car d’un autre côté, si vous vous battez avec le Paillardant, il peut d’un coup de broche vous envoyer dans l’autre monde, ce qui serait très-désagréable pour moi.
— Comment, pour vous ?
— Sans doute ! Je ne veux pas que vous mouriez dans l’impénitence finale et en regardant le fils de mon père comme un conteur de bourdes. Je tiens à vous prouver ce que vingt autres pourraient vous attester avec moi au besoin, c’est-à-dire que, à la Saint-Louis dernière, pour ne pas remonter à plus de trois jours, le capitaine, en pleine galerie du château, a présenté publiquement, à la marquise, une jeune provinciale, une fille sauvage de la forêt de Compiègne, laquelle le roi avait déjà remarquée dans une de ses chasses ; que ledit Pardaillan, ami du père, après avoir eu l’art de l’attirer chez lui avec sa fille, a grisé le bonhomme, pour arriver plus facilement à ses fins ; que la marquise, qui aime mieux avoir vingt rivales sans importance qu’une seule capable de l’inquiéter, ayant trouvé la petite fort jolie, mais d’apparence peu redoutable, a voulu elle-même la présenter au roi, comme bouquet de fête ; qu’en effet, elle lui a, dès le lendemain de grand matin, facilité une entrevue avec Sa Majesté ; enfin, que le capitaine a accompagné lui-même jusque dans le boudoir de la marquise la jolie victime, qui en est sortie pâle, défaite, les yeux rouges, et portant au doigt un brillant de la valeur de plus de trois mille écus ! Ce que j’avance là, ventre de biche ! j’en suis sûr ! moi-même je m’étais mis sur la piste de la poulette, qui n’avait pas l’abord difficile, ma foi ; j’ai failli imprudemment chasser sur les réserves du roi ; j’étais dans la grande galerie lors de la première présentation ; lors de la seconde, je me trouvais de même dans l’antichambre de la marquise ; le vicomte de Charlieu, le colonel de Bar y étaient avec moi. Ce sont eux qui ont fait le noël en question ; bref, ce que j’ai dit, je l’ai vu, de visu, testis oculatus ! Savez-vous le latin, camarade ?
— Et le nom de cette jeune fille, le nom de son père, monsieur ? demanda Charles d’une voix altérée et tremblante.
— Elle me l’a dit elle-même ; Jean-Pierre, je crois.
— Dampierre ?
— C’est ça ! un lieutenant des chasses.
— Adèle ? s’écria le jeune homme avec déchirement.
— Ah ! il vous faut jusqu’au nom de baptême ? Mais qu’avez-vous donc, l’ami ? demanda d’Annezay, s’interrompant en voyant l’altération subite qu’avait éprouvée la figure de son compagnon.
— J’ai… j’ai…, répondit celui-ci en balbutiant, que je ne puis croire encore…
Ébranlé par l’air de conviction du chevalier, mais ne pouvant s’expliquer le séjour de mademoiselle Dampierre à Versailles, son introduction chez la marquise ; au souvenir de tant d’innocence se débattant encore dans ses propres incertitudes, il allait ajouter : « Vous avez rêvé ou vous avez menti ! » lorsque le fiacre s’arrêta à l’Étoile de Satory.
Le capitaine et son témoin étaient déjà sur le terrain.
Les préliminaires du duel ne furent pas longs ; les deux adversaires ne s’adressèrent point un mot, et les témoins n’eurent qu’à choisir la place et à tirer au sort l’avantage de la position.
Après une lutte de quelques minutes, Charles Doisy fut atteint à l’épaule, là même où était en train de se cicatriser sa blessure récente du combat d’Hamelen.
— Botte de pied ferme, en flanconade… petit jeu ! murmura d’Annezay.
Quoique la blessure fût sans gravité aucune, M. de Blangy, le témoin du capitaine, s’interposa alors entre les combattants, et s’adressant au jeune homme :
— Croyez-vous votre honneur satisfait, monsieur ? lui dit-il.
— Oui, dit Charles, si M. de Pardaillan consent à répondre avec franchise et loyauté à quelques-unes de mes questions.
Se tournant alors vers celui-ci :
— Est-il vrai, monsieur, que mademoiselle Dampierre soit venue dernièrement à Versailles ?
— Elle y était encore hier, répondit le capitaine.
— Est-il vrai qu’elle ait logé chez vous ?
— Avec son père, oui.
— Est-il vrai que, sous votre seule protection, elle ait été conduite chez madame la marquise de Pompadour ?
Le capitaine fronça le sourcil, hésita à répondre, puis enfin :
— Ceci demanderait une explication que je ne puis donner en ce moment, dit-il.
— Mais… vous ne niez pas le fait ?
— Non.
— En garde ! misérable ! cria Charles en se ruant sur lui.
Au bout de quelques instants, M. de Pardaillan reçut l’épée de son adversaire en pleine poitrine.
— Joli coupé dégagé, en tierce ! dit d’Annezay, qui semblait assister là comme le prévôt dans une salle d’armes, simplement pour juger les coups.
Cependant, lorsqu’il vit le capitaine rouler des yeux hagards, chanceler, puis tomber à la renverse, en rendant le sang par la bouche, il se précipita vers lui avec les autres pour lui prêter assistance.
Tout secours était inutile ; il avait été frappé au cœur.
Charles allait s’éloigner, lorsque M. de Blangy s’avança vers lui :
— Monsieur, lui dit-il en plaçant une main sur sa poitrine, pour essayer de maîtriser sa violente émotion, dans la prévision de ce qui pouvait, de ce qui devait arriver, mon ami (et il jeta un regard douloureux vers le cadavre), mon généreux ami, reprit-il, m’a chargé de vous faire observer que, quoique nommé lieutenant de cavalerie, n’ayant pas encore reçu votre brevet signé du roi, vous avez contrevenu aux lois disciplinaires, qui ne vous reconnaissent pas encore le grade d’officier. Il m’a fait promettre, monsieur, que je vous engagerais à songer à votre sûreté, que je vous y aiderais même, si vous pensiez avoir besoin de mes services.
— Ah ! ventre de biche ! fit d’Annezay, j’aurais dû deviner ça ! Un lieutenant en costume de maréchal des logis ! Mais, bast ! venez chez moi, camarade ; vous n’y serez relancé que par mes créanciers.
Il fit monter dans le fiacre le malheureux vainqueur, qui semblait n’avoir plus la conscience de lui-même.
Écrasé par les événements de ce jour, Doisy, en rentrant dans le logement de d’Annezay, tomba sur une chaise, tandis que celui-ci criait à travers les escaliers :
— Garçon ! un second bol de punch ; c’est le camarade qui paye !
L’asile offert par d’Annezay au malheureux meurtrier ne pouvait le protéger longtemps. Non-seulement on y avait à craindre la visite des créanciers, mais encore celle de tous les mauvais sujets de la ville, qui, trois fois par semaine, le transformaient en un tripot de jeu.
Charles Doisy, réfléchissant bientôt sur le danger de sa situation, s’était à son tour prudemment éloigné de Versailles, pour se rendre à Glaignes auprès de son ami le meunier. Ne voulant pas l’abandonner avant de l’avoir installé lui-même dans sa nouvelle retraite, le chevalier lui fit escorte pendant la route, et jusqu’à la ferme des Brulard, où il ne dédaigna pas de séjourner vingt-quatre heures.
C’est par lui, par lui seul, que Martine avait été si bien mise au courant des prétendues aventures de mademoiselle Dampierre à Versailles. Le chevalier lui avait même appris le terrible noël, témoignage rimé du déshonneur de la pauvre Adèle, et que celle-ci avait entendu sortir avec un si grand ravissement de la bouche de sa rivale.
Après le départ de d’Annezay, Brulard, ne croyant pas Charles Doisy assez en sûreté dans sa ferme, lui ouvrait un refuge plus impénétrable dans les caveaux Saint-Adrien, où le père Hubert, qu’on s’était vu forcé de mettre dans la confidence, lui portait ses provisions chaque nuit.
Les choses en étaient là, et Charles n’avait plus d’autre habitation que les souterrains de la vieille tour, et chacun faisait du mystère à la ferme de Glaignes, lorsque la lettre au cachet noir arriva au château de la Douye.
Par cette lettre, M. de Blangy, l’ami et le témoin du capitaine de Pardaillan, instruisait M. Dampierre de l’issue fatale du duel de l’Étoile de Satory, et le priait de recueillir les papiers du défunt et de mettre ordre à ses affaires, le frère de M. de Pardaillan, alors en voyage, n’ayant laissé à personne le secret de la route tenue par lui.
Dans le secrétaire du capitaine, M. Dampierre trouva un testament olographe remontant à un mois de date et par lequel celui-ci laissait une part de ses biens à Charles Doisy.
Maintenant, revenons à la montagne Saint-Adrien, au moment où un cri lamentable parti d’entre les ruines de la chapelle vint interrompre Charles et Martine au milieu de leurs embrassements.
La fille Brulard s’était épouvantée d’abord. Rendue à son sang-froid habituel, elle se hâta d’éteindre la lanterne dont la clarté pouvait la trahir, et de retenir d’une main vigoureuse le jeune militaire dont le premier mouvement avait été de s’élancer vers l’endroit d’où ce cri s’était fait entendre.
Après avoir habitué leurs yeux à l’obscurité presque totale qui les entourait, ils crurent voir un homme chargé d’un fardeau s’éloigner à grands pas à travers les sentiers, creusés en ravins, qui conduisaient vers Béthizy. Peut-être ne l’eussent-ils pas reconnu, malgré sa conformation singulière et ses dandinements de tête en façon de battant d’horloge, si le chien de la ferme, venu à la suite de Martine, ne s’était mis à le suivre en sautant et gambadant autour de lui.
— Voilà mes deux compagnons de route, l’homme et le chien, qui me faussent compagnie, dit Martine. Oui, c’est le père Hubert… bien sûr… qui se sauve en traînant je ne sais quoi. C’est lui sans doute qui vient de pousser ce cri de Mélusine qui m’a tant fait peur. Je ne sais vraiment de quelle mouche le vieux sorcier a été piqué aujourd’hui, mais il a d’abord semblé faire les plus grandes difficultés pour me laisser venir ici cette nuit avec lui ; puis, à mi-route, il a disparu tout à coup, et je ne l’ai plus revu. Sans autre protecteur que Pyrame, il m’a fallu arriver jusqu’à toi, mon Charlot, et non sans peine et non sans peur, je t’assure ; mais j’y tenais, je me l’étais mis en tête. Je voulais t’annoncer moi-même notre grande victoire. Oui, mon officier, j’ai tout dit ce matin à mon père, en lui cachant, bien entendu, ce qu’il fallait lui cacher ; mais je lui ai dit que tu m’aimes et que tu ne désires rien tant que de m’épouser. Ai-je menti, hein ? Il m’a d’abord jeté au nez des si, des mais, disant que tu n’as pas le sou ; par bonheur, ma mère s’est mise de mon bord, et il consent enfin ! Eh bien, M. le lieutenant, cela valait-il la peine de venir moi-même ? Que ton affaire s’arrange là-bas, à Versailles, et en avant l’église ! nous serons mari et femme !
Charles se trouva heureux alors que Martine eût éteint la lanterne ; elle ne put voir sur ses traits l’impression qu’il reçut à l’annonce de cette grande nouvelle dont la fille Brulard avait, dans la journée, failli faire la confidence à mademoiselle Dampierre elle-même.
De son côté, reculant devant l’idée de trahir ouvertement le secret de ses maîtres, le Vieux Rouisseur, lorsque Adèle s’était présentée devant son routoir, avait cependant conçu le projet de l’éclairer, mais sans se compromettre.
Pris d’un tendre intérêt pour elle et pour le fugitif, n’estimant Martine qu’à sa propre valeur, ayant entrevu, avec cette sagacité rustique qu’il mettait si souvent à contribution dans son état de sorcier, que Charles, qui parlait mariage aujourd’hui, ne l’avait fait que dans une idée de dépit jaloux contre mademoiselle Dampierre, il avait espéré pouvoir réunir les deux jeunes gens dans une rencontre nocturne sur la montagne.
Une explication entre eux devait, selon lui, bien changer les physionomies au moulin de Glaignes, comme au château de la Douye.
Par la présence de Martine, les choses s’étaient passées bien autrement qu’il n’avait pu le prévoir.
Après avoir tenté vainement de paralyser lui-même son œuvre, en se plaçant sur le chemin de la jeune fille et en l’engageant à retourner sur ses pas, il n’était arrivé à la chapelle de Sainte-Geneviève que pour recevoir Adèle dans ses bras et la rapporter chez elle à moitié inanimée.
Pendant quelques jours, la pauvre enfant se débattit encore sous les redoublements de la fièvre, mais d’heure en heure la maladie poursuivait ses ravages ; la maladie de l’âme plutôt que celle du corps ; car elle ne mourait point sous l’influence d’une de ces désorganisations dont la médecine peut assigner la cause physique ; elle mourait d’une déception du cœur, elle mourait d’une parole d’amour adressée à une autre.
Depuis qu’elle s’était mise au lit, elle n’avait pas articulé un mot ; à peine si elle avait ouvert les yeux dans la crainte qu’on y pût lire sa pensée, sa pensée incurable.
A son père, accouru en toute hâte de Versailles et qui se tenait sans cesse à son chevet, elle souriait parfois ; mais, quoi qu’il fît, il n’en pouvait obtenir une parole ni même un geste, ce qui le plongeait dans le désespoir ; car cette immobilité, ce silence, n’était-ce pas déjà l’image d’une mort anticipée ?
Un matin, Adèle se redressa d’elle-même sur son oreiller et demanda qu’on lui apportât son portrait.
Quand il fut placé devant elle, ses yeux, en le contemplant, reprirent un éclat inaccoutumé, et elle pria Mariotte de lui arranger et de lui lisser ses cheveux. La pauvre malade voulait se refaire belle.
Elle avait parlé, elle s’était mouvée, le soin de sa personne, le goût de la toilette étaient revenus, et ce changement inattendu remplissait de surprise et de joie ceux-là qui l’entouraient, son père, sa vieille servante et jusqu’au médecin, qui voyait dans cette crise des pronostics du plus favorable augure.
Le peintre avait naguère essayé de composer une image ressemblant au modèle, et il avait réussi ; aujourd’hui le modèle voulait ressembler au portrait, et la réussite était bien plus difficile.
La vivacité des couleurs et la beauté des formes créées par l’artiste, ont une durée que Dieu lui-même n’a pas su donner à son plus parfait ouvrage. Les nuances roses et carminées, vivantes encore sur la toile, n’existaient plus sur le visage de la jeune fille. Peu de jours avaient suffi pour effacer cette brillante palette que la jeunesse et la beauté elles-mêmes ne possèdent pas toujours, et qui ne se ravive que sous la protection des deux anges gardiens du corps et de l’âme, la santé et le bonheur.
Les traits amaigris d’Adèle, ses lèvres décolorées, son teint crayeux n’étaient plus que le pâle simulacre de ce qu’ils avaient été autrefois. Cependant, elle voulait se ressembler encore, et quand Mariotte eut convenablement disposé ses cheveux, dont les reflets dorés semblaient encore s’être ternis comme le reste, quand elle l’eut parée de son mieux et telle à peu près que le peintre l’avait représentée, la malade pria qu’on allât cueillir des bluets pour lui en tresser une couronne.
Dès qu’elle l’eut entre les mains, elle la contempla silencieusement pendant quelques instants ; puis, ses yeux s’humectèrent. Elle-même se la plaça sur la tête, et elle demanda un miroir.
La vieille servante allait obéir, mais d’un geste M. Dampierre la retint.
— Vous avez raison, dit Adèle en accompagnant ces paroles adressées à son père d’un de ses ineffables sourires : à quoi bon ! cette image seule a gardé des traces de moi-même.
Puis, après une nouvelle contemplation :
— Enlevez ce portrait, dit-elle ; il me fait mal.
Soit que déjà sa vue se fût altérée, ou qu’elle eût fait un prisme menteur de ses larmes, sur la toile, peinte par Doisy, elle avait cru voir la couronne de bluets se changer en une couronne de roses blanches. Son portrait alors ressemblait à ce spectre d’elle-même qui lui était apparu chez madame de Pompadour.
— Nous nous ressemblons enfin ! avait-elle murmuré… Mais, ce n’est plus à moi, ni à lui que je dois songer, c’est à Dieu, à Dieu seul !
Sortant de son sein un médaillon qui ne l’avait jamais quittée, car il renfermait des cheveux de sa mère, elle l’ouvrit et en retira un petit fétu de paille qu’elle jeta loin d’elle, en détournant les yeux.
Ensuite, elle baisa la mèche de cheveux :
— Console-toi, bonne mère, dit-elle, nous allons nous revoir, puisque… puisque je vais mourir…
— Non, non, tu ne mourras pas ! s’écria son père en sanglotant.
Et il tomba à genoux près d’elle, prit ses mains dans les siennes et les baigna de larmes.
— Chut ! entendez-vous, reprit Adèle en écoutant attentivement un bruit qui venait du dehors : entendez-vous les cloches ?
En effet, un son de cloches se faisait entendre.
— Ce sont celles du Prieur maudit, sans doute ? Elles sonnent pour moi comme elles ont sonné pour ma mère, reprit-elle.
— Calme-toi ; non, ce n’est pas la mort de mon enfant qu’elles annoncent, dit M. Dampierre. Ces cloches sont celles de l’église.
— Comme elles sonnent longtemps et à grand bruit ! Qu’annoncent-elles donc ?
Cette fois ce fut Mariotte qui fit un signe au père. Il se tut.
— Je devine ! dit Adèle. Un mariage !…
Elle retomba sur son oreiller, plus pâle que de sa précédente pâleur…
— Mon père, murmura-t-elle, faites venir un prêtre… mon confesseur… Ayez hâte… bientôt il ne serait plus temps !
M. Dampierre et Mariotte, tous deux agenouillés près du lit, tous deux le visage en larmes, échangèrent entre eux un regard abattu ; mais aucun ne fit un mouvement, semblables par leur attitude, leur mutisme et leur immobilité, à ces statues de pierre ou de marbre qui prient et pleurent sur les marches des mausolées.
— Faites venir un prêtre ! répéta la mourante avec une sorte d’impatience désespérée, un prêtre !… hâtez-vous !…
Puis, après un moment de silence :
— Mais non, vous avez raison encore, ajouta-t-elle d’une voix presque éteinte ; il ne pourrait venir en ce moment. Mon Dieu ! à cause de lui, je ne reverrai donc pas ma mère ! à cause de lui, dois-je donc renoncer même à mon salut éternel ?
Mariotte sortit.
Un long temps s’écoula avant qu’elle fût de retour ; mais elle ne revint pas seule.
Le curé de Béthizy l’accompagnait.
De cette même main qui venait de bénir l’union de Charles et de Martine, le bon prêtre ferma les yeux d’Adèle.
— Parbleu ! vous choisissez bien votre instant pour me conter des histoires pareilles ! Par les temps de pluie, je suis sensible en diable ! me dit mon ami.
Car il ne faut pas oublier que c’est au beau milieu de la forêt de Marly et sous l’abri d’une hutte de bûcherons, que je prenais plaisir à me remémorer ce petit drame de famille, n’ayant pour auditeur et interlocuteur que mon philosophe botaniste, dont j’ai eu soin toutefois, dans l’intérêt du récit, de supprimer les fréquentes interruptions.
— Mais, permettez…, me dit-il ; les romanciers ont eu de tout temps le droit irrécusable de n’avoir pas le sens commun, et c’est un glorieux privilége qu’ils exploitent encore amplement aujourd’hui ; cependant quand on affiche la prétention de conter des histoires vraies, on doit, avant tout, se mettre en garde contre l’objection. Comment votre Charles Doisy, dont je me soucie fort peu, du reste, a-t-il pu se marier lorsqu’il avait encore suspendu sur sa tête l’un de ces articles du code militaire qui ne contiennent rien moins que douze balles de plomb ?
— Madame de Pompadour, qui l’avait tout à fait pris sous sa protection, lui répondis-je, venait de lui faire parvenir sa grâce, en l’accompagnant d’un riche cadeau pour sa future qu’elle ne doutait pas devoir être cette blonde jeune fille à laquelle elle s’était si vivement intéressée. Charles profita de l’amnistie ; Martine du présent de noces, consentant facilement, malgré ses principes sévères de vertu, à devenir l’obligée de la Pompadour.
A quelque temps de là, Charles demanda audience à la favorite, pour la remercier de l’avoir dispensé de paraître devant un conseil de guerre. Il ignorait complétement qu’elle eût fait autre chose pour lui. Ce fut alors, et par la marquise elle-même, qu’il apprit par quels moyens et par quelles instances persévérantes Adèle et M. de Pardaillan étaient parvenus à lui faire accorder ce brevet, qu’il croyait n’avoir dû qu’à son propre mérite.
Il sortit de cette entrevue bouleversé, à moitié fou ; le même jour, il alla trouver M. de Blangy, se fit tout raconter en détail par lui, et, le lendemain, il donna sa démission d’officier de cavalerie. Quant au testament, il va sans dire qu’il n’en voulut pas entendre parler.
— A la bonne heure ; ceci me raccommode un peu avec lui.
— Cette démission, vous le pensez bien, déconcerta fort toutes les vanités des Brulard, père, mère et fille, et ne laissa pas que de changer en lune rousse la lune de miel du nouveau ménage. Mais Charles avait au fond du cœur d’autres chagrins plus poignants que ceux que pouvait lui faire subir sa femme. Ses chagrins ressemblaient à des remords. Ce vieillard, cette jeune fille, qui s’étaient avec tant de dévouement réunis dans une seule et même pensée, pour son avancement, pour sa fortune, comme pour son bonheur, il les avait tués tous deux ; tous deux il les avait frappés au cœur.
Parfois, se dérobant aux ennuis du foyer domestique, il venait évoquer le souvenir d’Adèle auprès de sa nièce, ma grand’mère. C’est à lui que celle-ci avait dû les principaux détails de cette histoire, détails sur lesquels il ne craignait pas de revenir sans cesse, comme acte d’expiation. Ma grand’mère était la seule à qui il osât en parler, toutefois en arrière de sa femme, dont il redoutait les emportements.
— Vécut-il longtemps ainsi ?
— Oui, il parvint à un âge très-avancé.
— Et votre grand’tante, m’avez-vous dit, était morte à seize ans ! Vive Dieu ! je serais curieux de savoir, s’écria mon voyageur, quelle figure feront nos deux amoureux en se rencontrant dans la vallée de Josaphat.
FIN.