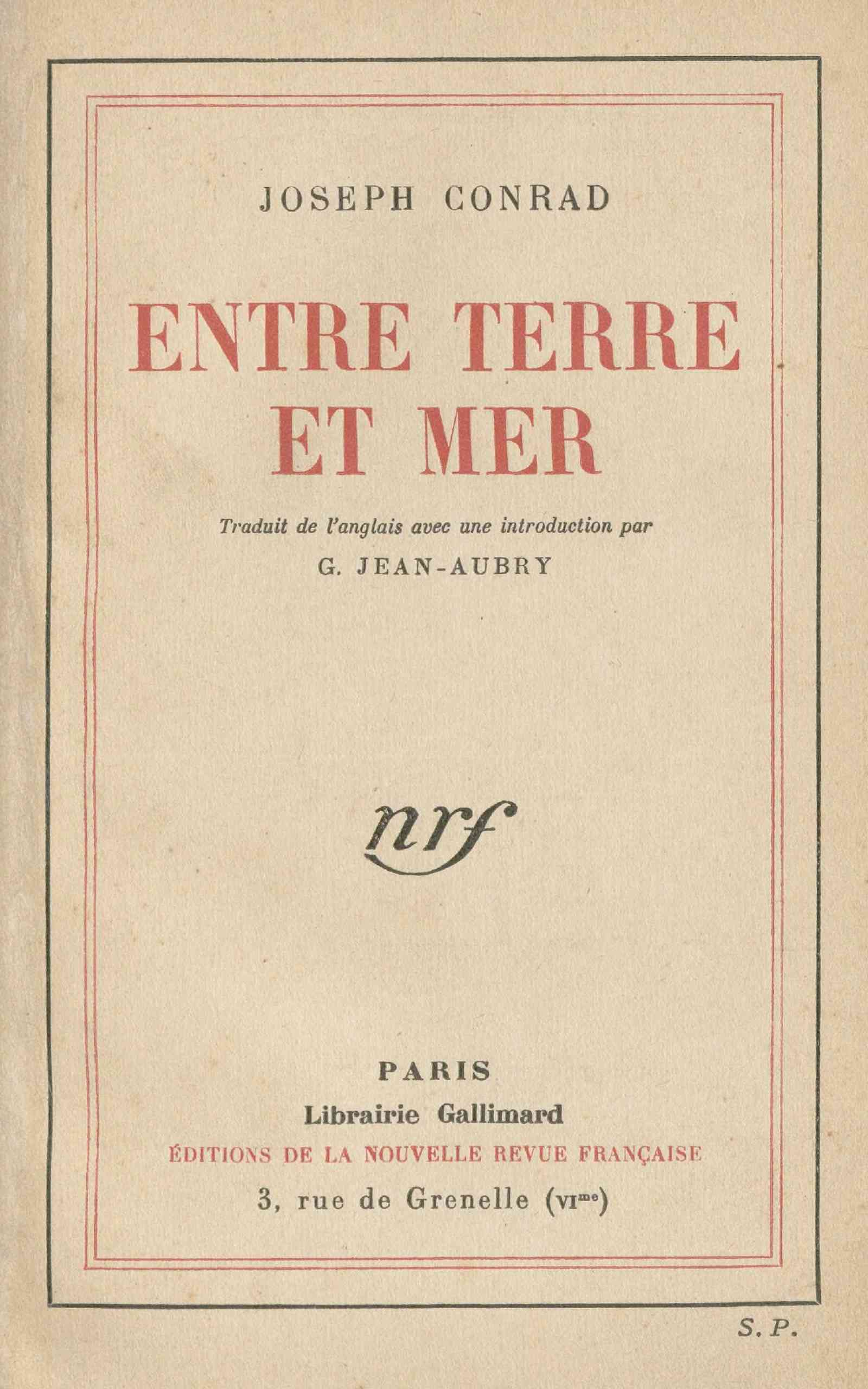
Title: Entre terre et mer
Author: Joseph Conrad
Translator: G. Jean-Aubry
Release date: November 10, 2025 [eBook #77214]
Language: French
Original publication: Paris: Gallimard, 1929
Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)
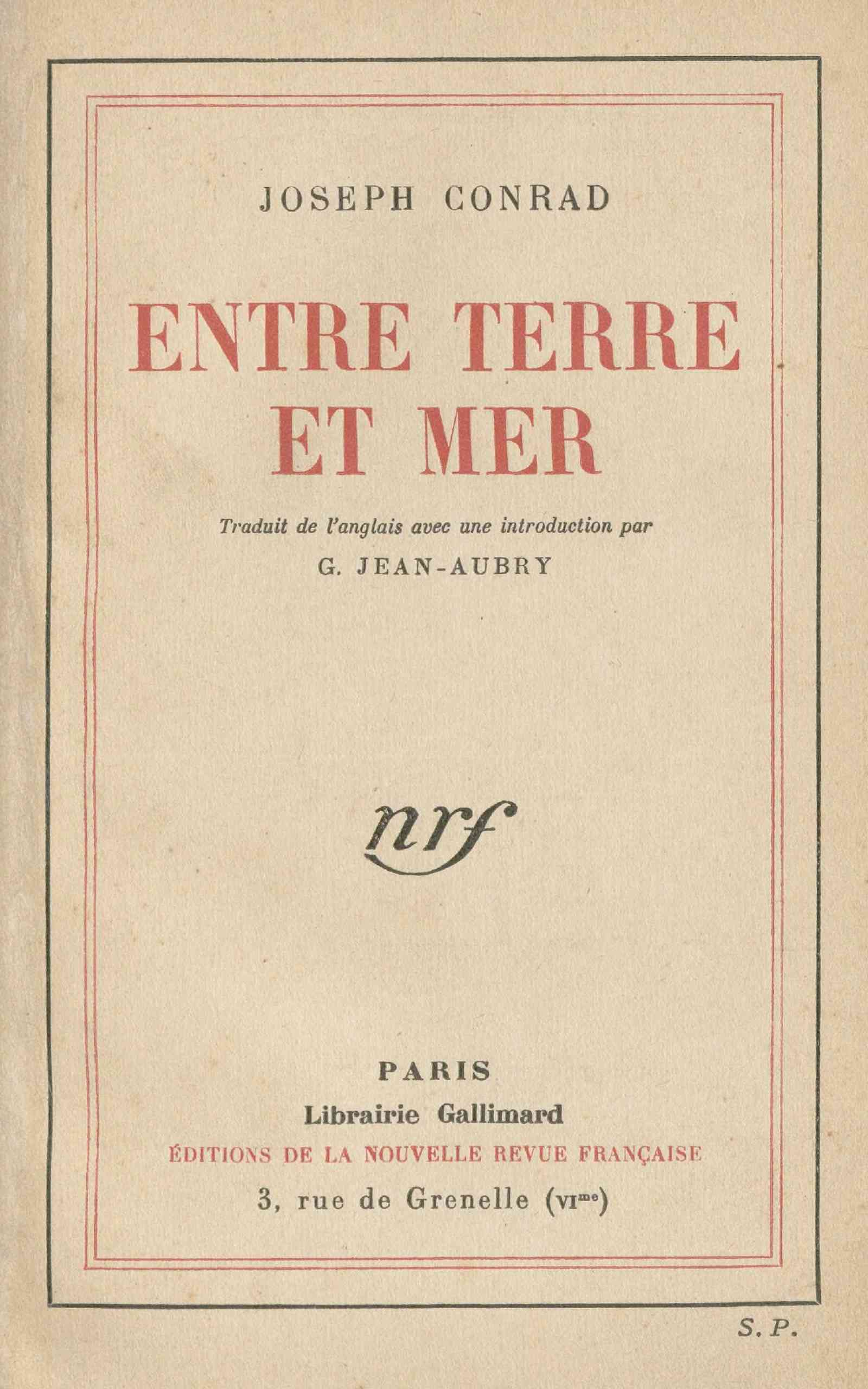
JOSEPH CONRAD
Traduit de l’anglais avec une introduction par
G. JEAN-AUBRY
PARIS
Librairie Gallimard
ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
3, rue de Grenelle (VIme)
ŒUVRES COMPLÈTES DE JOSEPH CONRAD
Traduites de l’anglais sous la direction
D’ANDRÉ GIDE ET G. JEAN-AUBRY
EN PRÉPARATION
L’édition originale de cet ouvrage a été tirée à HUIT CENT CINQUANTE-SEPT exemplaires et comprend : cent neuf exemplaires réimposés dans le format in-quarto tellière, sur papier vergé Lafuma-Navarre au filigrane nrf, dont neuf hors commerce marqués de A à I, et cent destinés aux Bibliophiles de la Nouvelle Revue Française, numérotés de I à C, sept cent quarante-sept exemplaires in-octavo couronne sur papier vélin pur fil Lafuma-Navarre dont dix-sept hors commerce marqués de a à q, sept cents destinés aux Amis de l’Édition originale numérotés de 1 à 700, et trente exemplaires d’auteur, hors commerce, numérotés de 701 à 730.
Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation
réservés pour tous les pays, y compris la Russie.
Copyright by librairie Gallimard, 1929.
A
MARCEL THIÉBAUT,
PIERRE FRÉDÉRIX
et
MARGUERITE BERTHOLON
sont respectivement dédiés
ces trois contes
mis en français
par leur ami
G. J.-A.
Dans l’isolement de sa petite maison d’Aldington, au cœur du comté de Kent, Joseph Conrad, vers le milieu de l’année 1909, était, depuis dix-huit mois, occupé à la composition d’un roman qui, par sa nature même, exigeait un plus grand effort qu’aucun autre pour que fussent maintenues cette impartialité et cette générosité de vues qui sont les caractères essentiels de l’œuvre conradien. Ce roman, qui portait alors le titre provisoire de « Razumow », devait s’appeler « Sous les Yeux d’Occident ». Polonais, dont la jeunesse avait profondément souffert de la tyrannie russe, il lui était plus malaisé qu’à un autre de peindre les personnages et les scènes de ce roman sans s’abandonner à quelque secrète et légitime rancune : il y parvint au prix d’une épuisante tension de son esprit. Quelques mois plus tard il devait écrire à son ami John Galsworthy : « Il y a deux ans que je n’ai vu un tableau, entendu une note de musique, eu un véritable moment de détente dans une conversation. »
Il n’avait interrompu cet accablant labeur, quelques heures par semaine, que pour noter avec facilité, — à l’intention d’une revue qu’un ami venait de fonder, — quelques-uns de ses souvenirs d’enfance et de jeunesse[1]. Il en avait tout justement écrit les dernières pages, le 19 juillet 1909, lorsque la poste lui apporta ce même jour une lettre de six grandes pages, tracée d’une écriture fort lisible et régulière, et signée Carlos M. Marris.
[1] Ils formèrent par le suite le volume dont la traduction française a paru sous le titre de : « Des Souvenirs ».
Ce correspondant inconnu lui exprimait d’abord, en son nom propre et au nom de camarades de la marine à voile, leur admiration et leur gratitude pour cet incomparable recueil d’impressions maritimes et de savoir marin : Le Miroir de la Mer. « Mon exemplaire, disait ce correspondant, a circulé de Timor Dali jusqu’à Pak Nam, et de Manille à Sourabaya, de même, d’ailleurs, que les récits relatifs à Lingard et que Typhon, lord Jim, Jeunesse. Cet homme n’ignorait pas les personnages mêmes et les lieux dont Conrad avait fait les protagonistes et le décor de ses romans de Malaisie : il avait, disait-il, recueilli des faits nouveaux de la bouche même de Joshua Lingard, le neveu de ce fameux Lingard dont les exploits avaient fait longuement rêver l’auteur de la Folie Almayer.
« J’ai navigué avec Joshua Lingard, sur le Rajah Laut », disait encore cette lettre. « Jim Lingard est toujours à Béran, et sa vie est exactement celle que vous avez décrite pour Almayer sur la rivière Pantai. Presque tous ces gens sont morts à présent… Je crois bien qu’il est impossible de voir maintenant une seule voile carrée depuis le Yang Tsé jusqu’à Batavia : les beaux jours de la navigation à voile et des ports remplis de voiliers, à Bangkok, Singapour, Sourabaya, sont passés. Excepté les quelques praus Bugis qui, de temps à autre, font la traversée de Sourabaya à Singapour, on ne voit plus que des vapeurs. »
Au cours de sa lettre, cet inconnu lui donnait encore sur sa propre vie des détails circonstanciés. Elle s’était passée presque toute entière dans les parages de cet Archipel malais que Conrad avait parcouru à peu près de bout en bout. Ce Carlos Marris l’avait longtemps sillonné comme capitaine de petits voiliers qui faisaient le commerce dans ces îles et fort souvent la contrebande de guerre. Il avait été, — comme un des personnages de Conrad, — engagé dans mainte aventure, soit pour aider quelque rajah, soit pour dépister les autorités hollandaises. La marine se transformant à cette époque, il s’était résigné à commander des vapeurs, des caboteurs entre Penang ou Singapour et les îles de la Malaisie. Il avait même, parmi ces navires, commandé le « Vidar », ce vapeur dont Joseph Conrad avait été autrefois le second pendant six mois et sur lequel il avait fait la connaissance du fameux et déplorable Almayer, héros de son premier livre et initiateur de sa carrière littéraire.
Cette lettre propre à réveiller bien des souvenirs à peine assoupis chez l’ancien marin devenu romancier ne lui parvenait pourtant pas de l’autre bout du monde : mais d’Angleterre : de Cookley, en Worcestershire, où ce capitaine Marris était venu se reposer chez des parents après un excès de fatigue et une attaque d’hémiplégie. Originaire de la Nouvelle-Zélande, et ayant établi son foyer à Kedah, il avait hâte d’y retourner et d’y retrouver sa femme indigène, Zahara, princesse de Patani et leur petite fille de huit ans. « Remarquez, écrivait-il encore à Conrad, la ressemblance entre Almayer à Bulungan et moi à Patani. J’ai vécu vingt-deux ans loin d’Europe et d’Angleterre, et je suis ici dégoûté du climat, de la langue, des coutumes ; j’aspire à retourner dans la jungle. » Et il émaille cette lettre anglaise de vers et de proverbes malais : il parle de la petite plantation de cocotiers et de caoutchouc qu’il possède à Kedah.
« J’espère beaucoup, disait-il en terminant sa lettre, que vous nous donnerez d’autres récits d’Extrême-Orient et de nouveaux romans sur « Rajah Laut »[2] et sur le bon vieux temps de 1870 à 1880. Si vous désirez d’autres renseignements sur les coutumes et les mers d’Extrême-Orient, je crois que je pourrais vous les fournir : peu de gens connaissent mieux que moi la vie indigène de cette partie du monde. J’espère bien dans trois mois reprendre la navigation en Extrême-Orient… Avant de quitter l’Angleterre, j’aimerais bien vous rencontrer et avoir une heure de conversation avec vous. La semaine prochaine, je dois aller voir des parents de Lingard. »
[2] C’était le nom donné par les Malais à Tom Lingard.
Joseph Conrad, en 1909, n’était plus tout à fait un inconnu, mais sa réputation ne commençait qu’à peine à franchir ce cercle restreint d’admirateurs qui ne s’était guère accru depuis ses débuts en 1895. Il avait assurément déjà reçu des lettres flatteuses, encourageantes, intéressantes, de lecteurs, d’écrivains, de marins ; mais celle-ci devait lui causer un particulier étonnement.
Depuis plus de vingt ans qu’il avait cessé de parcourir l’Archipel malais, c’était la première fois qu’une voix en ramenait vers lui non seulement les images familières, mais la pensée même de gens qu’il avait crus à jamais disparus de ce monde. Il était si persuadé qu’ils n’entendraient jamais parler de ses livres qu’il n’avait pas hésité à leur conserver dans ses romans ou dans ses contes leurs noms et leurs apparences véritables. Almayer, Lingard, Babalatchi, Abdullah… Cette lettre inattendue semblait un appel de ces fantômes.
Lorsqu’il écrivait « Sous les Yeux d’Occident » ou « Des Souvenirs », Joseph Conrad, pendant les mois précédents, n’avait cessé de plonger dans les lointains arcanes de son étrange passé, passé incompréhensible et mystérieux pour son entourage anglais, douloureux le plus souvent pour lui-même. Et soudain le hasard ramenait vers lui, colorées d’une vie nouvelle, les images d’un passé moins ancien, riche de tous les feux d’une jeunesse dont les reflets l’échauffaient encore.
Conrad ne laissa pas sans réponse cet appel de l’Orient : il n’a pas été possible de retrouver cette réponse, mais le capitaine Carlos Marris y fait allusion dans une seconde lettre que nous avons eue entre les mains, et dans laquelle, exprimant de nouveau son désir de rencontrer le romancier, il ajoutait : « Dites-moi si je puis vous envoyer d’Extrême-Orient quoi que ce soit qui vous rappellerait les lieux et les gens que vous avez connus, ou si je puis transmettre quelque message à de vieux amis de là-bas, je serais trop heureux de vous être de quelque utilité. »
A la suite de cette lettre, dans les premiers jours de septembre, Carlos Marris rendit visite à Conrad. Quelques mois plus tard, en janvier 1910, il lui écrivit encore une lettre de Poulo Tikus, Poulo Penang ; puis ce fut tout ; ce messager du passé était rentré dans la nuit.
Mais l’impression que Conrad ressentit de cette visite ne devait pas, ne pouvait pas être de courte durée : nous en avons un témoignage direct dans ce passage d’une lettre qu’il adressait peu de temps après à un ami :
« J’ai eu la visite d’un homme qui arrive de Malaisie, ç’a été comme la résurrection de nombreux morts, — morts pour moi du moins, car bon nombre d’entre eux vivent encore là-bas et lisent même mes livres, et se sont demandé qui diable avait bien pu venir prendre des notes dans leurs parages. Mon visiteur m’a dit que c’est Joshua Lingard qui a mis le doigt dessus : « Ce doit être ce garçon qui était à bord du Vidar comme second de Craig. » C’est bien moi assurément. Et ce qu’il y a de mieux, c’est que tous ces gens-là d’il y a vingt-deux ans, ont une bonne opinion du chroniqueur de leurs vies et de leurs aventures. On leur donnera encore quelques-unes des histoires qu’ils aiment »[3].
[3] G. Jean-Aubry. « Joseph Conrad : Life and Letters » t. II, p. 103. Lettre à J.-B. Pinker.
Cette visite du capitaine Carlos M. Marris est la cause première du recueil dont nous publions aujourd’hui la traduction et Conrad tint à préciser lui-même son rôle en dédiant ce volume à ce visiteur d’un jour.
Cette période de sa vie dont lui avaient été rappelés ainsi les lieux et l’atmosphère, n’était assurément pas sortie de sa mémoire : elle remontait à quelque vingt ans, c’était celle des derniers mois de l’année 1887, des premiers de l’année suivante : c’était l’époque où, comme second du vapeur Vidar, naviguant entre Singapour et la côte orientale de Bornéo, il avait rencontré Almayer : pendant ces mois-là il avait connu Willems, Abdullah, Babalatchi, Lakamba, Jim Lingard : c’était aussi l’époque, où résignant brusquement son poste de second à bord de ce vapeur, il avait, par le pur effet du hasard, obtenu son premier commandement, cet Otago à bord duquel il devait durant dix-huit mois, sillonner l’Océan Indien, de Bangkok en Australie et d’Australie à l’île Maurice.
Tous les éléments personnels qui entrent dans la composition des trois contes réunis sous le titre de « Entre Terre et Mer » datent de cette époque. Le premier reproduit avec exactitude une aventure authentique : le second combine des circonstances particulières de la vie de Conrad avec un fait essentiel qui lui est entièrement extérieur : le troisième enfin recrée, dans un décor qui lui était familier, une tragédie qu’il n’a connue que par ouï-dire.
L’impression produite par la visite du capitaine Marris avait été si vive que Joseph Conrad n’attendit même pas d’avoir terminé « Sous les Yeux d’Occident » et que, deux mois avant l’achèvement de ce roman, il écrivit en une dizaine de jours, au début de décembre 1909, le premier en date de ces trois contes, le second de ce recueil, « The Secret Sharer » (« le Compagnon Secret »).
Le 14 décembre, il écrivait à Edward Garnett : « Je viens de terminer un conte de douze mille mots en dix jours. Ce n’est pas si mal. Il me fallait mettre Razumow de côté un moment, quoique je ne pensais pas que cela dût prendre dix jours. Faire quelque chose de facile m’a donné confiance. »
Il devait paraître l’année suivante dans les numéros d’août et de septembre du Harper’s Magazine de New-York.
Le début du « Compagnon Secret » s’inspire directement de circonstances précises de la vie de Conrad, circonstances survenues à l’endroit même où il place son récit, c’est-à-dire à la sortie de Bangkok, au débouché du Ménam sur le golfe de Siam. Il s’y était trouvé lui-même au début de 1888. A peine avait-il, à Singapour, renoncé à son poste de second du « Vidar », il s’était vu subitement investi du commandement d’une barque britannique dont le capitaine venait de mourir à la mer. Il n’avait eu que le temps de se rendre de Singapour à Bangkok à bord d’un paquebot, de surveiller le chargement de son nouveau navire, et de descendre la rivière. C’était son premier commandement ; mais à la joie de voir, à trente ans, couronnée sa plus vive ambition, se mêlait le malaise de se sentir plus isolé, plus étranger que jamais. Il ne savait rien de ses officiers, ni de ses hommes, ni de son navire.
Conrad a fait, dans la « Ligne d’Ombre », le récit très précis des premières semaines de ce commandement et des circonstances particulièrement troublantes qui s’y trouvèrent associées. Dans le « Compagnon Secret », il a amalgamé les éléments d’une situation personnelle à une aventure d’autrui. Le fait qui forme le fond même de ce récit, c’est-à-dire l’aventure d’un officier qui a tué un homme d’équipage et se sauve à la nage, était arrivé, — comme Conrad le dit dans sa « Note de l’Auteur », — à bord du « Cutty Sark », vers 1880. Les éléments personnels du récit, ce sont le sentiment d’étrangeté du capitaine vis-à-vis de son équipage et de son navire, et la disposition particulière de la chambre de ce même capitaine. Ces deux éléments sont empruntés directement aux expériences de l’auteur, à bord de l’Otago.
Le sentiment intérieur du récit n’est pas entièrement isolé dans l’œuvre de Conrad, et, quoique d’un développement plus limité, le « Compagnon Secret » peut se rattacher par plusieurs points au grand roman qu’est « Lord Jim ». Ils ont en commun l’idée d’une faute commise sous le coup d’une impulsion et d’un homme qui s’enfonce dans l’inconnu pour se racheter. Lorsque l’on sait, par maint exemple, ce que signifient dans l’œuvre de Conrad les similitudes de noms, on ne peut pas penser que ce soit par hasard qu’il ait donné au héros de ce conte le nom de Leggatt qui n’est pas éloigné de celui de Jim Lingard, et qu’il ait fait de l’un et de l’autre un fils de pasteur et un ancien élève de l’école maritime de Conway. Ce n’est point non plus simple hasard probablement si le navire à bord duquel le « compagnon secret » était officier s’appelle « Sephora », comme un navire dont il est question au chapitre XIII de « Lord Jim ».
Dans toute la correspondance de Conrad qui est venue entre mes mains, je n’ai trouvé, au sujet du « Compagnon Secret », que cette allusion, postérieure de quatre années à la composition du conte, dans une lettre adressée en 1913 à John Galsworthy :
« Je ne puis vous dire quel plaisir m’a fait ce que vous m’écrivez du « Compagnon Secret », et particulièrement du nageur. Je n’ai lu que très peu de comptes rendus, — trois ou quatre en tout : mais dans l’un d’eux on l’appelle une sombre brute ou quelque chose de la sorte. Qui sont donc ces gens qui écrivent dans les journaux ? D’où sortent ces gens-là. J’en ai été littéralement ahuri, car, à la vérité, je voulais en faire ce que vous, vous avez immédiatement vu qu’il était. Et du moment que vous l’avez vu, je me sens réconforté et bien payé de la peine que j’ai prise à sa création, car ce n’était pas une tâche facile. Il était extrêmement malaisé de le maintenir en accord avec le type d’un être qu’a modelé dans une certaine mesure son existence maritime, et qui se trouve en outre affecté, comme il doit l’être, par sa situation. »
Dans une lettre du 17 mai 1910 à ce même ami, Conrad disait : « Je vais me mettre demain à un conte, si le diable le permet. Ce doit être comique, dans un cadre nautique, et le sujet est une affaire de pommes de terre. Comme titre : « Un Sourire de la Fortune. » Puisse ce titre être d’un bon présage ! Seulement, je ne crois guère aux présages. »
Il habitait alors encore à Aldington où l’avait retenu la maladie qui semblait n’avoir attendu pour s’emparer de lui que le moment même, au début de l’année, où il aurait terminé « Sous les Yeux d’Occident ». Conrad, que son extrême nervosité faisait aisément prendre en aversion les maisons où il habitait, ne voulut plus demeurer dans celle-là et, dans les derniers jours de juin, il alla s’installer à Capel House, cette maison d’Orlestone, près d’Ashford (Kent) où il devait passer les huit années suivantes qui devaient être particulièrement favorables à son travail. Il y apportait les premiers feuillets du « Sourire de la Fortune ».
A peine fut-il dans cette nouvelle maison qu’il trouva mauvais ce qu’il avait écrit dans l’autre, et durant les mois de juillet et d’août 1910, il reprit et acheva entièrement ce conte auquel il avait pensé un moment à donner comme titre « A Deal in potatoes » (Une affaire de pommes de terre), et qui parut sous son titre définitif « A Smile of Fortune » dans le London Magazine en février 1911.
Bien que dans sa « Note de l’Auteur » Conrad semble refuser à « Un Sourire de la Fortune », le caractère d’une aventure vécue et personnelle, il faut admettre comme exacte la note qui accompagnait la description du manuscrit de ce même conte lorsqu’il passa en vente à New-York en 1924, du vivant de l’auteur ; cette note disait : « Un Sourire de la Fortune » est basé, en ce qui concerne l’histoire des pommes de terre, sur un incident arrivé à l’auteur, à l’île Maurice, lorsqu’il commandait un navire qui y faisait son chargement. » C’est bien, en effet, l’île Maurice, chère à P.-J. Toulet et qu’il nous a rendue plus chère, que Conrad désigne ici par cette périphrase « la Perle de l’Océan ».
Il suffit de comparer ce récit avec la Ligne d’Ombre et avec le Compagnon Secret pour reconnaître dans le second du navire une seule et même personne, ce Burns, le second de l’Otago. C’est bien à bord de l’Otago que Conrad, après avoir ramené son navire de Bangkok à Adélaïde en Australie, en repartit au début d’août 1888 pour aller prendre un chargement de sucre à l’île Maurice où il resta du début d’octobre au 18 novembre.
C’est également au retour de ce voyage que, pour des raisons qui semblent bien être celles qu’il prête au capitaine dans « Un Sourire de la Fortune », il renonça à son commandement et rentra en Europe, ainsi que l’indique la lettre de ses armateurs, datée du 2 avril 1889 que j’ai eue entre les mains.
Pour ma part, je crois à l’entière authenticité de l’aventure rapportée dans « Un Sourire de la Fortune », et cela à cause d’une question assez étrange que Conrad lui-même me posa un jour que nous parlions de ce récit et où, faisant allusion à la scène où Jacobus survient inopinément sur la véranda, le romancier me demanda : « Croyez-vous qu’il l’ait vu ? » Et comme je lui avouais que je ne pouvais en décider et comme je lui demandais ce qu’il en pensait lui-même : « Je ne l’ai jamais su », me déclara-t-il, donnant ainsi à l’aventure un caractère d’expérience personnelle que j’avais déjà soupçonné et que la précision des détails ne fait que confirmer.
Le manuscrit de Freya des Sept-Iles porte très précisément de la main de Conrad l’indication du temps qu’il prit à l’écrire, 26 décembre 1910 — 28 février 1911. Il fut publié d’abord dans le numéro d’avril 1912 du Metropolitan Magazine, de New-York.
La source de Freya nous est indiquée dans la lettre que Joseph Conrad écrivit, le 4 août 1911, à son ami Edward Garnett : « C’est l’histoire du Costa-Rica qui ne remontait pas à plus de cinq ans lorsque j’étais à Singapour. L’homme s’appelait Sutton. Il est mort exactement de cette façon… Il était sur le point de rentrer au pays pour épouser une jeune fille (dont il parlait à qui voulait l’entendre) qu’il voulait ramener dans l’archipel, lorsque son navire fut jeté sur un récif par le commandant d’une canonnière hollandaise qu’il avait offensée d’une façon quelconque. Il hanta le rivage à Macassar pendant des mois et y est enterré dans le fort.
Il y a seulement dix-huit mois, Charles Marris, patron et armateur de l’Araby Maid, qui fait le cabotage dans les îles, me rendit visite à Aldington. Il était venu en Angleterre pour voir les siens qui ont une ferme en Somerset. Il m’a dit : « Nous lisons, tous, vos livres là-bas ! » Nous avons eu une longue conversation sur les gens et les choses de l’Archipel. Vous devriez, m’a-t-il dit, écrire l’histoire du Costa-Rica. Il y en a encore beaucoup parmi nous qui se rappellent Sutton. » Et je lui ai dit que je le ferais avant peu. C’est ainsi que « Freya » fut écrit. Mais naturellement les faits ne sont rien à moins qu’on ne les rende croyables. »
Dans cette même lettre Conrad dit encore que ce conte vient d’être refusé par la revue de New-York, le « Century », qui avait émis la prétention de demander à l’auteur de refaire à son récit une fin heureuse pour ménager la sensibilité de ses lecteurs. Et Conrad achevait en disant à Edward Garnett : « Quant à faire en sorte que mon histoire finisse bien, j’aimerais mieux voir tous les magazines américains et tous les éditeurs américains au diable plutôt que de me mettre à cette tâche ; je n’en ai jamais eu la moindre envie. »
La strophe qui figure comme épigraphe à l’ensemble du recueil fut écrite par Arthur Symons, immédiatement après avoir lu le manuscrit de « Freya » que l’auteur lui avait communiqué.
G. Jean-Aubry.
Londres 1929.
Le seul lien qui existe entre ces trois contes est, pour ainsi dire, géographique, car le lieu de leur action, qu’il s’agisse de la terre ou de la mer, se trouve dans la même région du monde qui est celle de l’Océan Indien, avec ses prolongements au nord de l’Équateur jusqu’au Golfe de Siam. Pour ce qui est du temps, ces contes appartiennent à la période qui suivit la publication de ce roman au titre étrange : Sous les Yeux d’Occident, et, en ce qui concerne la vie même de leur auteur, la publication du recueil de ces trois contes marqua un changement définitif dans le sort réservé à ses créations. On ne saurait nier, en effet, que Sous les Yeux d’Occident ne rencontra guère la faveur du public, tandis que Hasard qui suivit Entre terre et mer, fut accueilli dès son apparition par un concours plus nombreux de lecteurs que je n’en avais connu jusque-là.
Ce recueil de trois contes reçut, lui aussi, un accueil favorable aussi bien public que privé, et fort propre à satisfaire un éditeur. Ce petit succès vint à point pour tonifier un état physique fort affaibli. Ce recueil pourrait, en effet, s’appeler le livre d’un convalescent, au moins pour ses trois quarts, car le Compagnon Secret fut écrit bien avant les deux autres. A la vérité les souvenirs que je conserve de « Sous les Yeux d’Occident » se trouvent associés à ceux d’une grave maladie qui semble avoir attendu, comme un tigre au détour d’un sentier dans la jungle, pour se jeter sur moi, à peine écrits les derniers mots. Le souvenir d’une maladie ressemble assez à celui d’un cauchemar. Au sortir de là, dans un assez grand état de faiblesse, j’eus l’inspiration de diriger mes pas chancelants vers l’Océan Indien, ce qui constituait assurément un changement complet d’atmosphère et de décor avec le lac de Genève. Entrepris si languissamment et d’une main si incertaine qu’il fallut en jeter au panier la première vingtaine de ses pages, Un Sourire de la Fortune, — celui des trois Contes qui est le plus étroitement associé avec l’Océan Indien, — a fini par devenir ce que verra le lecteur. Je dirai simplement à ma décharge que j’en ai reçu des compliments fort inattendus et de gens qui m’étaient complètement inconnus, entre autres du directeur d’un magazine populaire qui le publia tout entier dans un de ses numéros. Qui oserait dire, après cela, que ce changement d’air ne m’a pas parfaitement réussi ?
Les origines du second récit : Le Compagnon Secret sont fort différentes. Il fut écrit bien avant les deux autres et publié, si je ne me trompe, dans le Harper’s Magazine durant les premiers mois de 1911, ou peut-être les derniers : ma mémoire sur ce point est hasardeuse. J’étais depuis fort longtemps en possession du fait qui en forme la base. C’était, à vrai dire, une possession commune à toute la flotte des navires marchands qui naviguaient aux Indes, en Chine et en Australie, une grande compagnie dont les derniers jours ont coïncidé avec les premières années de mon service au long cours. Le fait lui-même s’était produit à bord d’un des membres les plus distingués de cette compagnie, le Cutty Sark, qui appartenait à M. Willis, un armateur bien connu en son temps, l’un de ceux (la terre est maintenant sur eux) qui tenaient à assister en personne au départ de leurs navires pour ces lointains rivages où ils allaient porter avec dignité le pavillon fort estimé de leur armateur. Je suis heureux de n’être pas venu trop tard pour entrevoir encore M. Willis, par un matin pluvieux, assistant du haut du môle du nouveau Dock Sud, au départ d’un de ses grands voiliers pour une campagne de Chine ; silhouette imposante d’un homme coiffé d’un invariable chapeau blanc bien connu dans tout le port de Londres et qui attendait que son navire eût évité pour descendre la Tamise avant de lui adresser, de sa grosse main gantée, un dernier salut fort digne. Il se pourrait que c’eût été le Cutty Sark lui-même, quoique certainement pas lors de ce malencontreux voyage. Je ne connais pas la date de l’événement sur lequel est basé mon conte : cet événement se répandit et fut même relaté dans les journaux vers 1885, quoique j’en eusse entendu parler auparavant, en petit comité, parmi les officiers de la grande flotte des navires lainiers sur lesquels j’ai servi mes premières années de long cours.
Cet événement vint au jour dans des circonstances assez dramatiques, si je m’en souviens bien, mais qui n’ont rien à faire avec mon récit. Dans la partie spécialement maritime de mon œuvre, ce conte peut figurer comme un de mes « calmes ». Car si une classification par sujets semble légitime, j’ai fait deux « tempêtes », le Nègre du Narcisse et Typhon, et deux « calmes », celui-ci et la Ligne d’Ombre, un livre qui appartient à une époque ultérieure.
En dépit de leur forme autobiographique, les deux contes que je viens de nommer ne sont pas le résultat d’une expérience personnelle. Leur qualité, si tant est qu’ils en aient, repose sur quelque chose de plus large sinon d’aussi précis : sur le caractère, la vision et le sentiment même des vingt premières années indépendantes de ma vie. Et l’on peut en dire autant de « Freya des Sept-Iles. »
J’ai été grandement critiqué pour avoir écrit ce conte : on m’a reproché sa cruauté, à la fois dans des articles et dans des lettres privées. Je m’en rappelle une qui me fut adressée par un correspondant d’Amérique animé d’une furieuse colère. Au milieu d’un torrent d’imprécations, il me déclarait que je n’avais pas le droit d’écrire une aussi abominable histoire qui, me disait-il, avait gratuitement et intolérablement blessé ses sentiments. C’était une lettre fort intéressante. Impressionnante même. Je l’ai gardée quelques jours dans ma poche. Avais-je le droit ? La sincérité de sa colère m’imposait. Avais-je ce droit ? Avais-je réellement péché comme il le disait, ou bien était-ce extravagance de sa part ? Il me semblait pourtant distinguer quelque méthode dans sa fureur… Je composai dans ma tête une réponse violente, une réponse où j’argumentais avec calme, une réponse empreinte d’un hautain détachement : mais en fin de compte je n’en écrivis aucune et j’en ai oublié la forme. La lettre même de ce lecteur révolté s’est égarée, et rien ne subsiste d’autre que les pages de ce conte que je ne puis ni ne veux me rappeler.
Je suis heureux tout de même de penser que les deux femmes de ce livre : Alice, la victime maussade et passive de son destin, et Freya, si active, si individuelle, si déterminée à être la maîtresse du sien, ont dû susciter des sympathies, car de tous mes livres de contes, c’est celui qui a rencontré le plus de lecteurs dès son apparition.
J. C.
1920
Je n’avais cessé, depuis le lever du jour, de regarder vers l’avant. Le navire glissait doucement sur l’eau calme. Après soixante jours de mer, j’avais hâte de faire mon atterrissage : une île fertile et fort belle des Tropiques. Ses habitants les plus enthousiastes se plaisent à la surnommer « la Perle de l’Océan ». Appelons-la donc « la Perle ». C’est un excellent nom. Une perle qui distille beaucoup de douceur sur le monde.
Ce n’est qu’une façon de vous dire qu’on y cultive la meilleure espèce de canne à sucre. Toute la population de la Perle ne vit que de cela et pour cela. Le sucre est — si l’on peut ainsi dire — son pain quotidien. Et j’y venais chercher un chargement de sucre avec l’espoir d’une bonne récolte et d’un fret avantageux.
Mon second, M. Burns, reconnut la terre le premier : et je fus bientôt saisi d’admiration devant cette apparition bleue, en forme de pointe, presque transparente sur la clarté du ciel : simple émanation, corps astral d’une île qui s’élevait pour m’accueillir de loin. C’est un phénomène assez rare que d’apercevoir ainsi la Perle à soixante milles en mer. Et je me demandais à moitié sérieusement si c’était de bon augure, et si ce que j’allais trouver dans cette île serait aussi heureusement exceptionnel que cette magnifique vision de rêve, que si peu de marins ont eu le privilège de contempler.
Mais d’importunes préoccupations d’affaires ne tardèrent pas à venir interrompre ma satisfaction d’avoir atteint le terme d’un voyage. Je souhaitais réussir et je désirais, en outre, faire honneur à la latitude flatteuse que m’avaient laissée mes armateurs dont les instructions étaient contenues dans cette noble et simple phrase : « Nous nous en remettons entièrement à vous pour tirer le meilleur parti possible du navire… » Le monde entier m’étant ainsi donné comme champ d’action, mes capacités ne me paraissaient pas beaucoup plus grosses que la tête d’une épingle.
Cependant le vent tomba et M. Burns se lança dans des considérations assez désobligeantes sur ma malechance habituelle. Je crois volontiers que c’était par dévouement pour moi que son humeur critique se manifestait ainsi à tout propos. Mais je dois dire que si, une fois, à la mer, je n’avais pas eu à le tirer d’une maladie fort grave, je n’aurais certainement pas supporté son genre d’humeur. Après l’avoir arraché aux griffes de la mort, c’eût été vraiment absurde de se priver des services d’un aussi bon officier : mais j’avais parfois une furieuse envie de le voir débarquer de son propre mouvement.
Nous n’approchâmes de la terre que fort tard et il nous fallut mouiller en dehors du port jusqu’au lendemain matin. La nuit fut on ne peut plus désagréable et nous ne pûmes prendre aucun repos. Dans cette rade qui nous était également inconnue à tous deux, Burns et moi, nous passâmes presque tout notre temps sur le pont. Des nuages dégringolaient du haut des pentes de basalte à l’abri desquelles nous nous tenions. La brise qui fraîchissait faisait grincer notre mâture avec des interludes de tristes gémissements. Je fis à Burns la remarque que nous avions eu de la chance de rallier le mouillage avant qu’il ne fît noir. Nous aurions eu une mauvaise nuit à passer s’il nous avait fallu rester au large sous voiles.
Mais mon second ne démordait pas de son attitude.
— « Vous appelez cela de la chance, capitaine ! Oui ! notre chance habituelle ! Une chance à remercier Dieu que ça ne soit pas pire. »
Il grommela ainsi toute la nuit, tandis que je faisais appel à toute ma philosophie. Ce fut vraiment exaspérant, fatigant, interminable que d’avoir à rester ainsi au mouillage trop près de cette côte sombre. L’eau houleuse faisait entendre des grognements sourds autour du navire. Par moments une rafale sauvage, jaillissant d’un ravin au haut de la falaise, tirait de notre gréement une note rauque et plaintive comme le gémissement d’une âme abandonnée.
A sept heures et demie du matin, une fois le navire enfin rentré, et amarré à une certaine distance du quai, mon fond de philosophie se trouvait à peu près épuisé. Je me hâtais de m’habiller dans ma chambre quand le steward entra, un de mes vêtements sur le bras.
Affamé, éreinté, épuisé, et, de plus, la tête engagée dans une chemise blanche trop amidonnée contre laquelle je me débattais, je le priai d’un ton maussade « d’activer ce petit déjeuner ». Je voulais aller à terre aussi tôt que possible.
— « Bien, capitaine. Ce sera prêt à huit heures, capitaine. Il y a un monsieur qui attend pour vous parler, capitaine. »
Cette annonce fut curieusement accueillie. Je tirai violemment la chemise sur ma tête et émergeai de là en le regardant fixement.
— « A cette heure-ci ! » — m’écriai-je. — « Qui est-ce ? Qu’est-ce qu’il veut ? »
Quand on arrive de la mer on a à s’adapter aux conditions d’une existence complètement dénuée de relations. Chaque petit événement prend d’abord l’importance particulière de la nouveauté. Ce visiteur matinal me surprenait grandement : mais mon steward n’avait aucune raison d’avoir l’air si particulièrement ahuri.
— « Vous ne lui avez pas demandé son nom ? » — lui dis-je d’un ton ferme.
— « Il s’appelle Jacobus, je crois », — marmotta-t-il d’un air embarrassé.
— « Monsieur Jacobus ! » — m’écriai-je, au comble de l’étonnement, en changeant soudain de sentiment. — « Pourquoi ne l’avoir pas dit tout de suite ? »
Le steward s’était déjà esquivé. Un instant, j’avais aperçu, par l’entre-bâillement de la porte, un homme grand et fort, debout dans le carré, près de la table sur laquelle la nappe était déjà mise : une nappe « pour le port », immaculée et d’un blanc étincelant. Tout était pour le mieux.
Du ton le plus aimable je lui criai à travers la porte que j’étais en train de m’habiller et que je serais à lui dans un moment. J’entendis le visiteur me répondre d’une voix tranquille et un peu sourde de ne pas me bousculer. Tout son temps était à ma disposition. Il espérait seulement que je voudrais bien lui faire donner une tasse de café.
— « Je crains que vous n’ayez un bien piètre déjeuner », — lui criai-je en m’excusant. — « Nous avons été soixante jours à la mer, vous savez. »
Je l’entendis rire légèrement et me répondre : « Ça ira très bien, capitaine. » Tout cela, ses paroles, son intonation, l’attitude de l’homme entrevu dans le carré, avait un caractère inattendu, quelque chose d’amical, d’encourageant. Ma surprise n’en était pas moindre. Quelle était la raison de cette visite ? Était-ce là le signe de quelque noir dessein dirigé contre mon innocence commerciale ?
Ah ! ces intérêts commerciaux, — qui venaient gâter la plus belle vie qui fût au monde. Pourquoi faut-il que la mer serve au commerce, — et aussi à la guerre ? Pourquoi se livrer sur mer au massacre et au trafic, y poursuivre des buts égoïstes sans grande importance après tout ? Combien il eût été préférable de n’avoir qu’à naviguer tout simplement, avec par-ci par-là un port et un morceau de terre, juste de quoi se dégourdir les jambes, acheter quelques livres et changer un peu l’ordinaire de ses repas. Mais, puisque je vivais dans un monde plus ou moins homicide et désespérément mercantile, mon devoir était évidemment de m’en accommoder de mon mieux. La lettre de mes armateurs me laissait le soin, comme je l’ai dit, de tirer le meilleur parti possible du navire, à mon gré. Mais elle contenait encore un post-scriptum ainsi conçu :
« Sans vouloir entraver en rien votre liberté d’action, nous écrivons par le prochain courrier à quelques-uns de nos correspondants de là-bas qui peuvent vous être de quelque utilité. Nous désirerions particulièrement que vous rendiez visite à M. Jacobus, un négociant et affréteur fort important. Si vous pouvez vous entendre avec lui, il vous trouvera certainement un emploi profitable du navire. »
Nous entendre ! Et cet important personnage était précisément à bord et me demandait de lui offrir une tasse de café ! Comme la vie n’est pas un conte de fée, l’improbabilité de cet événement me choquait presque. Avais-je découvert un coin enchanté de la terre, où de riches marchands se précipitent pour déjeuner à bord des navires avant même que ceux-ci ne soient amarrés ? Était-ce là de la magie blanche ou seulement quelque malice commerciale ? En fin de compte, j’en arrivai (tout en nouant ma cravate) à supposer que je n’avais pas dû bien entendre le nom. J’avais assez fréquemment pensé au notable M. Jacobus durant le voyage et mon oreille avait dû être abusée par quelque similitude de son… Le steward avait peut-être dit Antrobus ou peut-être Jackson.
Mais lorsqu’au sortir de ma chambre je demandai : « Monsieur Jacobus ? » je fus accueilli par un « Parfaitement » qu’accompagna un aimable sourire. Il ne semblait pas se prévaloir extrêmement du fait qu’il était M. Jacobus. Je distinguai un visage assez fort et pâle, une tête légèrement chauve au sommet, des favoris rares et d’une couleur indéterminée, des paupières lourdes. Les lèvres épaisses et lisses semblaient, au repos, collées l’une à l’autre. Le sourire était vague. C’était un homme pesant et paisible. Je lui présentai mes deux officiers qui venaient de descendre pour déjeuner : mais je ne pouvais comprendre pourquoi l’attitude silencieuse de M. Burns trahissait une indignation contenue.
Comme nous prenions place autour de la table, les mots entrecoupés d’une altercation qui avait lieu à l’entrée du panneau parvinrent à mon oreille. Quelqu’un d’étranger au navire voulait apparemment descendre me parler et le steward s’y opposait.
— « On ne peut pas le voir. »
— « Pourquoi pas ? »
— « Le capitaine est en train de déjeuner, je vous dis. Il va aller à terre dans un moment et vous pourrez lui parler sur le pont. »
— « Ça n’est pas juste. Vous laissez… »
— « Je n’y suis pour rien. »
— « Comment, vous n’y êtes pour rien ? Tout le monde doit être sur le même pied. Vous laissez cet homme… »
Le reste m’échappa. La personne ayant été évincée, le steward descendit. Je ne peux pas dire qu’il était rouge d’excitation, — c’était un mulâtre, — mais il semblait fort agité. Après avoir posé les plats sur la table, il alla se placer près du buffet avec cet air singulier d’indifférence qu’il avait coutume de prendre lorsqu’il avait fait quelque mauvais coup et craignait de se faire attraper. L’expression de mépris qui se peignit sur le visage de M. Burns en promenant son regard du steward jusqu’à moi était réellement extraordinaire. Je ne pouvais imaginer quelle mouche avait encore piqué mon second.
Le capitaine gardant le silence, personne ne parlait, comme c’est l’usage à bord. Et si je ne disais rien, c’est tout simplement que la splendeur du festin m’avait rendu muet d’étonnement. Je m’attendais à l’habituel petit déjeuner du bord et je voyais étalé devant nous un véritable débordement de victuailles venues de terre : des œufs, des saucisses, du beurre qui visiblement ne sortait pas d’une boîte de conserve danoise, des côtelettes et même un plat de pommes de terre. Il y avait trois semaines que je n’avais vu une pomme de terre réelle, vivante. Je les contemplai avec intérêt et M. Jacobus se révéla comme un homme doué de sympathies humaines et domestiques, et qui savait même lire dans les pensées.
— « Essayez-les, capitaine, — me dit-il à mi-voix, d’un ton encourageant et amical. — Elles sont excellentes. »
— « Elles en ont l’air, — lui répondis-je. — Cela vient de l’île, je suppose ? »
— « Oh ! non, c’est importé. Celles qui poussent ici coûtent trop cher. » — L’insignifiance de cette question me choquait. Était-ce là vraiment un sujet de conversation pour un riche et notable négociant ? Je trouvai charmantes sa simplicité et son aisance : mais de quoi parler, après soixante et un jours de mer, à un homme qui surgit ainsi inopinément, et qui vient d’une petite ville dont on ne sait rien, dans une île qu’on n’a jamais vue ? Que pouvaient bien être (en dehors du sucre) les intérêts de cette petite motte de terre, ses propos, ses sujets de conversation ? Le mettre immédiatement sur le terrain des affaires eût été presque inconvenant, ou même pire : maladroit. Tout ce que je pouvais faire pour le moment, c’était de rester sur le même terrain.
— « Est-ce que les victuailles sont généralement chères ici ? » — demandai-je, non sans rougir à part moi de l’inanité de mes paroles.
— « Je ne dirai pas cela », — répondit-il placidement, avec cet air de ménager son souffle que lui donnait cette façon contenue qu’il avait de parler.
Il ne sembla pas vouloir être plus explicite, quoiqu’il n’éludât aucunement le sujet. Tout en regardant la table avec un complet esprit d’abstinence (ce fut en vain que je voulus lui faire prendre quelque chose), il aborda des détails d’approvisionnement. « On importait le bœuf généralement de Madagascar : le mouton, cela va sans dire, était rare et d’un prix assez élevé, mais la bonne viande de chèvre… »
— « Ce sont des côtelettes de chèvre ? » — m’écriai-je en désignant l’un des plats.
Le steward, qui avait pris près du buffet une pose sentimentale, sursauta :
— « Seigneur ! non, capitaine ! c’est du vrai mouton ! »
M. Burns continuait à déjeuner avec une visible impatience, comme s’il eût été outré de se voir associé à une monstrueuse sottise, s’excusa en marmottant et remonta sur le pont. Peu après, le lieutenant, avec sa figure rouge et lisse, disparut à son tour. Pourvu d’un appétit de collégien et après deux mois de navigation, il n’était pas sans apprécier ce repas généreux. Mais moi pas. Cela vous avait un goût d’extravagance. Tout de même, avoir pu faire jaillir tout cela si rapidement était remarquable et j’en fis mes compliments au steward d’un ton quelque peu inquiétant. Il eut un sourire désapprobateur et, d’une façon dont je ne sus que penser. Je vis ses petits yeux noirs cligner d’une façon significative dans la direction de notre hôte.
Celui-ci demanda à mi-voix une autre tasse de café, et grignota ascétiquement un morceau de biscuit de mer. Je ne crois pas qu’en fin de compte il en avala plus de la valeur d’un doigt : mais, pendant ce temps, il me fit un rapport complet sur la récolte de sucre, les différentes maisons de commerce de l’île, l’état des frets. Cette conversation était tout émaillée d’indications sur les différentes personnalités et qui allaient jusqu’à des avertissements voilés, mais son visage pâle et charnu demeurait immuable, sans le moindre rayonnement, comme si sa propre voix lui eût été étrangère. Vous pouvez bien penser que j’ouvrais les oreilles toutes grandes. Chaque mot m’était précieux. Mes idées sur la valeur des amitiés commerciales s’en trouvaient favorablement modifiées. Il me donna les noms de tous les navires disponibles, m’indiqua leur tonnage et le nom de leurs capitaines : — ce qui était encore des renseignements commerciaux, — après quoi, il condescendit à me mettre au courant des potins du port. La Hilda avait, on ne sait comment perdu sa figure de proue dans le golfe de Bengale et son capitaine en était grandement affecté. Le navire et lui avaient été associés depuis des années et le vieil homme s’imaginait que cet étrange événement était le signe précurseur de sa propre et prochaine dissolution. La Stella avait essuyé du très gros temps au large du Cap, avait eu son pont balayé et son second emporté par un paquet de mer. Et quelques heures avant d’atteindre le port le bébé était mort. Ce pauvre capitaine H… et sa femme étaient terriblement désemparés. S’ils avaient pu seulement l’amener vivant jusqu’au port, on aurait probablement pu le sauver : mais le vent avait molli pendant à peu près toute la dernière semaine, rien qu’une légère brise et… on allait enterrer l’enfant cet après-midi. Il pensait que j’assisterais…
— « Vous croyez que je dois y aller ? » — lui demandai-je avec appréhension.
Il le pensait, certainement. On apprécierait cela beaucoup. Tous les capitaines des navires dans le port devaient y assister. Cette pauvre madame H… était tout à fait prostrée. Un rude coup aussi pour H…
— « Et vous, capitaine, je suppose que vous n’êtes pas marié ? »
— « Non, je ne suis pas marié, — lui dis-je. — Ni marié, ni même fiancé. »
Mentalement j’en rendis grâce aux dieux : et tandis qu’il souriait d’un air rêveur, je lui exprimai mes remerciements pour sa visite et les renseignements si intéressants qu’il avait eu l’obligeance de me fournir. Mais je ne soufflai mot de l’étonnement que j’en ressentais.
— « Il va sans dire que je me serais fait un devoir de vous rendre visite dans un jour ou deux », — lui dis-je en terminant.
Il souleva visiblement les cils pour me regarder, mais n’en parut pas pour cela moins somnolent qu’auparavant.
— « Conformément aux instructions de mes armateurs, — expliquai-je. — Vous avez reçu leur lettre, n’est-ce pas ? »
A ce moment, il avait également levé les sourcils, mais sans manifester aucune émotion particulière. Je fus au contraire frappé de le voir demeurer parfaitement imperturbable.
— « Oh ! vous devez parler de mon frère. »
Ce fut alors à moi de faire : « Oh ! » Mais j’espère que rien de plus qu’un étonnement poli ne parut dans ma voix lorsque je lui demandai à quoi alors je devais le plaisir… Il cherchait tranquillement quelque chose dans une poche intérieure de son veston.
— « Mon frère est très différent. Mais je suis bien connu dans cette partie du monde. Vous avez probablement entendu…
Je pris la carte qu’il me tendait. Une solide carte commerciale, s’il en fut. Alfred Jacobus, — l’autre s’appelait Ernest, — approvisionneur de navires. Viandes salées et fraîches, huiles, peinture, cordages, voiles, etc. Ravitaillement de navires au port, conditions modérées…
— « Je n’ai jamais entendu parler de vous », — fis-je brusquement.
Son assurance sourde ne l’abandonna pas.
— « Vous serez tout à fait satisfait », — murmura-t-il doucement.
Je n’en fus pas radouci. J’avais l’impression d’avoir été circonvenu en quelque sorte. Pourtant je m’étais trompé moi-même, — s’il y avait là tromperie. Mais cette extraordinaire audace de s’inviter à prendre le petit déjeuner était suffisante pour tromper n’importe qui. Et je pensai tout d’un coup : Eh quoi ! cet homme a fourni lui-même toutes ces victuailles afin de faire une affaire.
— « Vous avez dû vous lever diablement de bonne heure ce matin », — lui dis-je.
Il admit avec simplicité qu’il était sur le quai dès avant six heures à attendre l’entrée de mon navire. J’eus l’impression qu’il serait maintenant impossible de m’en débarrasser.
— « Si vous pensez que nous allons vivre sur ce pied-là », — lui dis-je en jetant sur la table un regard irrité, — « vous vous trompez considérablement. »
— « C’est parfait, capitaine. Je comprends très bien. »
Rien ne pouvait troubler sa placidité. J’étais assez mécontent, mais je ne pouvais pourtant pas me jeter sur lui. Il m’avait donné tant de renseignements utiles, — et puis c’était le propre frère de ce riche négociant. Tout cela était assez étrange.
Je me levai et lui déclarai sèchement que je devais aller à terre. Il mit aussitôt son canot à ma disposition pour le temps que je resterais dans le port.
— « Je vous ferai un prix », — reprit-il d’un ton monotone. — « J’ai un homme toute la journée près de l’escalier. Vous n’avez qu’à le siffler quand vous aurez besoin du canot. »
Et, s’effaçant à chaque porte pour me laisser passer le premier, il m’emmena en somme sous sa garde. Comme nous traversions le pont arrière, je vis s’avancer deux individus mal vêtus qui, dans un silence triste, m’offrirent des cartes commerciales que je pris sans rien dire sous le regard pesant de mon compagnon. Une bien inutile et lamentable cérémonie. C’étaient les commis des autres approvisionneurs de navires : et lui, placide, derrière moi, ignora leur existence.
Nous nous séparâmes sur le quai après qu’il m’eût, d’un ton tranquille, exprimé l’espoir de me voir souvent « au magasin ». Il y avait là un fumoir pour les capitaines, avec des journaux et une boîte « d’assez bons cigares ». Je le quittai sans cérémonie.
Mes consignataires me firent un accueil chaleureusement commercial ; mais, d’après eux, l’état des frets n’était pas à beaucoup près aussi favorable que la conversation de ce Jacobus me l’avait laissé entendre. Je me sentis naturellement porté à donner créance à sa version, de préférence. Tout en refermant derrière moi la porte de leur cabinet, je pensai : « Hum ! Un ramassis de mensonges. Diplomatie commerciale. C’est à quoi un homme qui arrive de la mer doit s’attendre. Ils voudraient affréter le navire au-dessous du cours. »
Dans la grande pièce où s’alignaient de nombreux pupitres, le chef de bureau, un homme grand, maigre et complètement rasé, vêtu d’un costume blanc immaculé et dont la tête noire, luisante et tondue de près prenait des reflets argentés, se leva de sa place et m’arrêta avec affabilité. Tout ce qu’on pourrait faire pour moi, on serait trop heureux. Reviendrais-je dans l’après-midi ? Quoi ? J’allais à un enterrement ? Ah ! oui, ce pauvre capitaine H…
Sa figure s’allongea un moment avec un air de sympathie, puis, écartant de ce monde prosaïque le bébé tombé malade au cours d’une tempête et qui était mort d’un calme prolongé à la mer, il me demanda en souriant de toutes ses dents, d’un sourire qui eût ressemblé à celui d’un requin (si les requins avaient de fausses dents), si j’avais fait des arrangements pour le temps que le navire serait dans le port.
— « Oui, avec Jacobus », — répondis-je d’un air dégagé. — « C’est, si j’ai bien compris, le frère de M. Ernest Jacobus pour lequel j’ai une introduction de mes armateurs. »
Je n’étais pas fâché de lui montrer que je n’étais pas livré pieds et poings liés au bon vouloir de sa maison. Je le vis pincer ses lèvres minces d’un air de doute.
— « Quoi ! » — m’écriai-je, — « ce n’est pas son frère ? »
— « Oh ! si… Ils ne se sont pas adressé la parole depuis dix-huit ans », — ajouta-t-il avec solennité au bout d’un moment.
— « Vraiment. Et pourquoi se sont-ils donc querellés ? »
— « Oh ! rien ! Rien qui vaille qu’on en parle », — déclara-t-il avec hauteur. — « Il a une assez grosse affaire. C’est le meilleur approvisionneur d’ici sans aucun doute. Au point de vue commercial il n’y a rien à dire ; mais, tout de même, le caractère personnel a aussi quelque importance, n’est-ce pas ? Bonjour, capitaine. »
Il retourna à son bureau en minaudant. Il m’amusait. Il avait l’air d’une vieille demoiselle, une vieille demoiselle commerciale, offusquée de quelque inconvenance. Était-ce une inconvenance commerciale ? Une inconvenance commerciale est une question sérieuse, car cela touche à la poche. Ou bien n’était-ce qu’un puriste en matière de conduite qui désapprouvait que Jacobus tînt lui-même l’emploi de commis ? Cela manquait certainement de dignité. Je me demandais ce que devait en penser son frère le négociant. Mais autant de pays, autant de mœurs. Dans une communauté aussi isolée et aussi exclusivement commerciale, les valeurs sociales ont une échelle qui leur est propre.
Je me serais bien volontiers dispensé de cette pénible occasion de faire immédiatement connaissance, ne fût-ce que de vue, avec mes collègues, les autres capitaines. Je me rendis pourtant au cimetière. Nous formions un groupe assez considérable de gens nu-tête et vêtus de noir. Je remarquai que, de notre compagnie, ceux qui s’approchaient le plus du type, déjà désuet alors, du vieux loup de mer, se montraient le plus émus, — peut-être parce qu’ils avaient moins de « manières » que ceux de la nouvelle génération. Le vieux loup de mer, une fois sorti de son élément naturel, était un animal simple et sentimental. J’en remarquai un, — il me faisait face de l’autre côté de la fosse, — qui pleurait à chaudes larmes. Elles ruisselaient sur son visage hâlé comme des gouttes de pluie sur un vieux mur rugueux. J’appris par la suite qu’on le considérait comme la terreur des marins, un homme dur ; qu’il n’avait jamais eu ni femme ni enfant ; et qu’ayant depuis sa plus tendre jeunesse navigué au long cours, il ne connaissait guère les femmes et les enfants que de vue.
Peut-être versait-il ces abondantes larmes sur les occasions qu’il avait perdues, peut-être était-ce par simple désir de paternité et par une étrange jalousie à l’égard d’un chagrin qu’il ne lui serait jamais donné de connaître. L’homme, — et même l’homme de mer, — est un capricieux animal, créature et victime d’occasions perdues. Mais, à le voir, j’eus honte de mon insensibilité. Je n’avais pas de larmes.
J’écoutai avec un détachement affreusement critique ce service que j’avais eu à lire moi-même, une ou deux fois, pour des hommes morts à la mer. Ces mots d’espérance et de défi, ces mots ailés, si exaltants dans la libre immensité du ciel et de la mer, semblaient tomber avec ennui sur cette petite tombe. A quoi servait de demander à la Mort où était son aiguillon, devant ce petit trou noir creusé dans la terre ? Et mes pensées m’échappaient complètement vers des sujets ayant trait à la vie, — des sujets sans grande élévation d’ailleurs, — navires, frets, affaires. L’instabilité de ses émotions donne à l’homme une déplorable ressemblance avec le singe. J’étais dégoûté de mes pensées, — et je pensais : Trouverai-je bientôt un affrétement ? Le temps, c’est de l’argent… Ce Jacobus allait-il me mettre vraiment en main une bonne affaire ?… Il faudrait aller le voir dans un jour ou deux.
Qu’on n’aille pas s’imaginer que je poursuivais ces pensées avec quelque précision. C’étaient elles qui me poursuivaient plutôt : vagues, confuses, inquiètes, honteuses. Leur opiniâtreté était endurcie, abominable, presque révoltante. Et c’était la présence de cet opiniâtre approvisionneur qui les avait mises en branle. Il était là, l’air triste, parmi notre petit groupe d’hommes venus de la mer, et sa présence m’irritait, car, en me faisant penser à son frère le négociant, elle m’avait rendu furieux contre moi-même. J’avais, cela va sans dire, conservé quelque décence. C’était seulement l’esprit qui…
La cérémonie prit fin. Le pauvre père, — un homme de quarante ans avec de gros favoris noirs et une pathétique estafilade sur son menton rasé de frais, — nous remercia tous en ravalant ses larmes. Mais je ne sais comment, soit parce que je m’attardai à la porte du cimetière en hésitant sur le chemin à prendre pour revenir, soit parce que j’étais le plus jeune, ou parce qu’il attribuait mon état d’esprit à des sentiments plus nobles et mieux appropriés, ou tout simplement parce que je lui étais plus étranger encore que les autres capitaines, il me distingua parmi eux. Tout en marchant à ma hauteur, il me renouvela ses remerciements, que j’écoutai dans un silence morne, en proie aux reproches de ma conscience. Soudain il passa son bras sous le mien, et de l’autre fit un geste dans la direction d’un grand et gros homme qui s’en allait tout seul, dans un flottement de vêtements gris.
— « C’est un brave homme, vraiment un brave homme », — déclara-t-il en ravalant un sanglot, — « ce Jacobus. »
Et il me raconta à voix basse que Jacobus avait été le premier à venir à bord de son navire dès leur arrivée, et qu’ayant appris leur malheur, il s’était chargé de tout, s’était offert à régler toutes les formalités habituelles, à porter à terre les papiers du navire, à faire tous les arrangements pour l’enterrement…
— « Un brave homme. J’étais complètement assommé par ce coup. Il y avait dix jours que je veillais ma femme jour et nuit. Sans aide. Et imaginez ! Le pauvre petit est mort juste le jour où nous avons reconnu la terre. Comment ai-je pu rentrer le navire, Dieu seul le sait ! Je ne voyais rien, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas… On vous a dit, peut-être, que nous avons perdu notre second, passé par-dessus bord pendant le voyage ? Je n’avais personne pour me remplacer. Et la pauvre femme à demi folle en bas toute seule avec le… Mon Dieu ! Ce n’est pas permis. »
Nous marchâmes côte à côte en silence. Je ne savais comment prendre congé de lui. Sur le quai il lâcha mon bras et frappa du poing violemment dans la paume de son autre main.
— « Non, ça n’est pas permis ! — s’écria-t-il de nouveau. — Ne vous mariez jamais à moins d’avoir pu d’abord envoyer promener la mer… Ça n’est pas permis ! »
Je n’avais pas la moindre intention « d’envoyer promener la mer » et, quand il me quitta pour remonter à bord de son navire, j’avais la conviction que je ne me marierais jamais. Tandis que j’attendais près de l’escalier l’homme du canot de Jacobus, parti je ne sais où, je fus rejoint par le capitaine de la Hilda, une ombrelle de soie à la main et les pointes aiguës de son archaïque faux-col à la Gladstone encadrant son petit visage basané et complètement rasé qui était extraordinairement frais pour son âge, d’un modelé parfait et tout illuminé par des yeux extrêmement clairs. Ses cheveux blancs abondants, luisants comme du verre filé, bouclaient légèrement sous le bord de son vieux panama de très belle qualité qu’entourait un large ruban noir. L’aspect de ce petit vieillard vif et net avait quelque chose d’étrangement angélique et de juvénile tout ensemble.
Il m’accosta, comme s’il m’avait vu tous les jours de sa vie depuis ma plus tendre enfance, en me faisant une remarque plaisante sur l’aspect d’une grosse négresse assise sur un escabeau au bord du quai. Il me déclara ensuite aimablement que j’avais un bien joli navire.
Je lui retournai son compliment en lui déclarant aussitôt :
— « Pas si joli que la Hilda. »
Je vis immédiatement s’abaisser les coins de sa bouche sensible, au dessin net.
— « Oh ! mon cher. Je peux à peine en supporter la vue maintenant. Savais-je, me demanda-t-il anxieusement, qu’il avait perdu le buste de son navire : une femme à tunique bleue bordée d’or, dont le visage n’était peut-être pas joli, joli, mais dont les bras blancs d’un très beau dessin étaient étendus comme si elle nageait ? Le savais-je ? Qui aurait pu s’attendre à pareille chose ?… Et après vingt ans, encore ! »
Personne à l’entendre n’aurait pu croire que la femme en question était en bois : sa voix tremblante, son agitation donnaient à ses plaintes quelque chose d’absurdement risible… Elle avait disparu une nuit, une belle nuit claire, par très légère houle, dans le golfe du Bengale. Disparue sans le moindre clapotement : personne à bord n’avait pu dire comment, où, ni à quelle heure, après vingt ans, en octobre dernier… Avais-je jamais entendu parler d’une chose pareille ?…
Je l’assurai avec sympathie que je n’avais jamais rien entendu de pareil et il prit un air très attristé. Ce n’était pas bon signe, il en était sûr. Il y avait là quelque chose qui ressemblait à un présage. Mais quand je lui eus déclaré que sûrement il pourrait se procurer un autre buste de femme, je me vis fort justement reprendre de ma légèreté. Le petit vieux se mit à rougir violemment sous son teint basané comme si je lui avais proposé quelque chose d’inconvenant. On pouvait bien, me dit-il, trouver des rechanges pour des mâts ou un gouvernail perdu, n’importe quelle pièce vitale du navire : mais à quoi servirait de mettre un nouveau buste ? Quelle satisfaction ? Il était facile de voir que je n’avais jamais eu une figure de proue comme compagne pendant vingt ans à la mer.
— « Un nouveau buste ! » — s’écria-t-il avec une ardente indignation. — « Ma foi ! Il y aura vingt-huit ans au mois de mai prochain que je suis veuf, autant penser à prendre une nouvelle femme. Vous pouvez faire la paire avec ce Jacobus… »
Il m’amusait vraiment.
— « Qu’est-ce que Jacobus a encore fait ? Est-ce qu’il veut que vous vous mariiez, Capitaine ? » — lui demandai-je avec déférence. Mais il était lancé maintenant et il grimaça avec fureur :
— « Vous procurer, pour sûr ! C’est un homme à vous procurer n’importe quoi à son prix. Je n’étais pas amarré depuis une heure qu’il était déjà à mon bord pour me proposer de me vendre une figure de proue qu’il avait par hasard dans son entrepôt. Il m’a fait faire cette proposition par Smith, mon second. « Mr. Smith, lui ai-je dit, vous ne me connaissez pas encore mieux que cela ? J’ai l’air de quelqu’un à ramasser une figure de proue au rebut ? Et cela après tant d’années ! Vous avez une façon de parler, vous autres jeunes gens… »
J’affectai un vif remords et comme je descendais dans l’embarcation, je lui dis tranquillement :
— « Ma foi ! je ne vois rien d’autre à faire que d’y mettre quelque fioriture de proue, peut-être. Vous savez, un vague ornement sculpté, joliment doré. »
Il avait l’air tout d’un coup très abattu après cette explosion.
— « Oui. Un ornement. Peut-être bien. Jacobus m’a aussi suggéré cela. Il n’est jamais embarrassé quand il s’agit d’extorquer un peu d’argent à un marin. Il me ferait payer cette sculpture les yeux de la tête. Une guibre dorée, vous voulez dire, hein ? Pour vous, bien sûr, ça ferait l’affaire. Vous autres jeunes gens, vous me paraissez n’avoir pas le moindre sentiment des convenances. »
De son bras droit, il fit un geste convulsif.
— « Tant pis. Cela ou autre chose ça ne fait pas grande différence. Je laisserais tout aussi bien ce vieux bâtiment courir le monde rien qu’avec un taille-mer », — s’écria-t-il tristement. Et comme l’embarcation s’éloignait de l’escalier, il éleva la voix au bord du quai avec une animosité assez comique.
— « Pour sûr ! Ne serait-ce que pour narguer ce marchand de figures de proue, ce vampire ! Je connais cet endroit-ci depuis longtemps, ne l’oubliez pas. Venez donc me voir à mon bord un de ces jours ! »
Ma première soirée dans le port, je la passai paisiblement dans mon carré : et j’étais fort heureux à la pensée de pouvoir encore tenir à distance pendant quelques heures cette vie de terre qui me semblait si mesquinement complexe, si discordante et si remplie de figures nouvelles en débarquant de la mer. Il était toutefois écrit que j’entendrais encore parler de Jacobus avant de m’endormir.
M. Burns était allé à terre après le dîner pour « jeter un coup d’œil », comme il disait. Comme il faisait parfaitement nuit quand il m’annonça son intention, je ne lui demandai pas ce qu’il pensait voir. Vers minuit environ, j’étais en train de lire dans le salon, lorsque j’entendis marcher avec précaution dans le couloir et je l’appelai par son nom.
Burns entra, la canne et le chapeau à la main ; cet accoutrement de terrien lui donnait un aspect incroyablement vulgaire ; il avait un air enjoué et je ne sais quel clignement d’œil bizarre. Comme je le priai de s’asseoir, il posa sa canne et son chapeau sur la table et, après avoir parlé un moment des affaires du navire, il me dit :
— « J’en ai entendu de belles sur cet approvisionneur qui vous a si bien estampé, capitaine. »
Je lui fis observer, en me tenant à quatre, qu’il avait une singulière façon de s’exprimer. Mais il se contenta de hocher la tête dédaigneusement. C’était un fameux tour, ma foi : s’amener à bord d’un navire inconnu avec tout ce qu’il faut pour le petit déjeuner de l’équipage dans deux paniers et s’inviter soi-même tranquillement à la table du capitaine ! Il n’avait jamais entendu raconter de sa vie quelque chose d’aussi malin et d’aussi impudent.
Je me pris à défendre la méthode inaccoutumée de Jacobus.
— « C’est le frère d’un des plus riches négociants de l’endroit. »
— « Son frère aîné ne lui a pas adressé la parole depuis dix-huit ou vingt ans », — déclara-t-il triomphalement. — « Voilà ce qui en est. »
— « Je sais parfaitement ce qui en est », — interrompis-je avec hauteur.
— « Vraiment, capitaine ? Hum ! » — Son esprit n’en demeura pas moins attaché aux principes de la concurrence commerciale. — « Je n’aime pas qu’on abuse de votre bienveillance, capitaine. Il a graissé la patte à votre steward avec un billet de cinq roupies pour le laisser venir à bord, ou peut-être même de dix. Qu’est-ce que ça peut bien lui faire ? Il mettra cela et plus sur la note. »
— « C’est le genre d’histoires que vous avez entendu raconter à terre ? » — lui demandai-je.
Il m’assura qu’il avait assez de bon sens pour avoir compris cela tout seul. Non : ce qu’il avait entendu raconter à terre, c’est qu’aucune personne respectable ne fréquentait Jacobus. Il habitait une grande maison ancienne dans une rue paisible, avec un grand jardin. Après m’avoir dit cela, M. Burns prit un air mystérieux…
— « Il paraît qu’il y tient enfermée une jeune fille… »
— « Je suppose que vous avez entendu raconter tous ces potins dans un endroit des plus respectables ? » — lui lançai-je d’un ton sarcastique.
Le trait porta, car M. Burns, comme la plupart des gens désagréables, était lui-même très susceptible. Il demeura comme frappé de stupeur, la bouche ouverte, tout prêt à me fournir un nouveau renseignement, mais je ne lui en laissai pas le temps.
— « Et puis, après tout, que voulez-vous que tout cela me fasse ? » — lui dis-je, en passant dans ma chambre.
Et c’était en somme assez naturel à dire. Pourtant cela ne me laissait pas indifférent. Je reconnais qu’il est parfaitement absurde de s’inquiéter de la moralité d’un approvisionneur de navires, même appartenant à une aussi bonne famille : mais sa personnalité avait imprimé sa marque sur ma première journée passée dans ce port, de la façon que vous savez.
Après ce premier exploit, Jacobus ne se montra aucunement importun. Chaque matin de bonne heure, il faisait, en canot, la tournée des navires qu’il approvisionnait et, à l’occasion, il prenait le petit déjeuner à bord avec le capitaine.
Ayant découvert que cette pratique était généralement acceptée, je le saluai familièrement un matin, lorsqu’en sortant de ma chambre, je le trouvai au carré. En jetant un coup d’œil sur la table, je vis que son couvert était déjà mis. Il était resté debout à attendre mon arrivée, pesant et placide, en tenant dans sa grosse main une fort belle gerbe de fleurs. Il me les offrit avec un léger sourire somnolent. Elles venaient de son jardin : il avait un vieux jardin très beau : il les avait cueillies lui-même ce matin avant d’aller à ses affaires ; il pensait que cela me ferait plaisir… Il se retourna :
— « Steward, dit-il, donnez-moi donc de l’eau dans un grand pot, s’il vous plaît. »
Tout en prenant ma place à table, je lui déclarai en plaisantant que j’avais l’impression d’être une jolie femme, et qu’il ne devait pas s’étonner de me voir rougir. Mais il était en train d’arranger sur le buffet ce tribut floral.
— « Mettez-le devant l’assiette du capitaine, steward, s’il vous plaît. »
Cette demande fut faite d’une voix sourde, comme toujours.
Le cadeau était si en vue que je ne pus faire moins que de l’élever jusqu’à mon nez, et tout en s’asseyant sans bruit il déclara doucement qu’à son avis des fleurs amélioraient grandement l’aspect du carré d’un navire. Il se demandait pourquoi je n’avais pas une étagère tout autour de la claire-voie de façon à pouvoir emporter à la mer des fleurs en pots. Il avait un très bon ouvrier qui ne prendrait pas plus d’une journée pour installer une étagère de ce genre et il pourrait me procurer deux ou trois douzaines de bonnes plantes…
Le bout de ses gros doigts ronds reposait tranquillement sur le bord de la table de chaque côté de sa tasse de café. Son visage demeurait impassible. M. Burns se souriait malicieusement à lui-même. Je déclarai que je n’avais pas la moindre intention de transformer ma claire-voie en serre, uniquement pour faire de la table de mon carré un dépotoir de matière végétale morte ou moisie.
— « Faire pousser de très belles fleurs », — insista-t-il en levant les yeux en l’air, — « cela ne donne aucun mal, véritablement. »
— « Si, si. Beaucoup de mal », — répliquai-je. — « Un beau jour un imbécile vous laisse la claire-voie ouverte par une brise fraîche, les fleurs attrapent de l’eau salée, et elles crèvent toutes en une semaine. »
M. Burns m’approuva d’un grognement méprisant. Jacobus abandonna passivement ce sujet. Au bout d’un moment, il décolla ses grosses lèvres pour me demander si j’avais déjà vu son frère. Je lui répondis brusquement :
— « Non. Pas encore. »
— « Il est très différent », — déclara-t-il d’un air rêveur, et il se leva. Ses mouvements étaient particulièrement silencieux. « Bien ! merci, capitaine. Si quelque chose n’est pas à votre convenance, veuillez le dire au steward. Je suppose que vous offrirez un dîner aux employés de bureau. »
— « Et pour quoi faire ? » — m’écriai-je avec quelque animation. — « Si je faisais des affaires régulièrement avec ce port, je comprendrais, mais étranger comme je le suis !… Il y a des chances pour que je ne revienne pas ici pendant des années. Je ne vois pas pourquoi je… Vous voulez dire que c’est l’habitude ? »
— « On s’attendra à cela d’un homme comme vous », — murmura-t-il tranquillement. — « Huit des principaux employés, le directeur, cela fait neuf, vous trois, cela fait douze. Si vous dites à votre steward de me prévenir la veille… »
— « On s’attendra à cela de moi ! Et pourquoi donc ? Est-ce parce que j’ai l’air particulièrement de bonne composition, ou quoi ? »
Il me sembla que son immobilité avait soudainement pris un air plus digne, que son caractère imperturbable avait un air dangereux.
— « Nous avons tout le temps d’y penser », — lui dis-je en manière de conclusion avec un geste qui essayait de le renvoyer. Mais avant de partir il tint à m’exprimer son regret de n’avoir pas encore eu le plaisir de me voir au « magasin » pour échantillonner les cigares dont il m’avait parlé. Il en avait un lot de six mille dont il pouvait disposer, à très bon marché.
— « Je crois que cela vaudrait la peine que vous en preniez », — ajouta-t-il avec un sourire mélancolique et il sortit du carré.
M. Burns donna un violent coup de poing sur la table.
— « A-t-on jamais vu pareille impudence ? Il s’est mis dans la tête de vous soutirer quelque chose d’une façon ou d’une autre, capitaine. »
Aussitôt me sentant disposé à prendre la défense de Jacobus, je remarquai philosophiquement que c’était cela les affaires, probablement. Mais mon absurde second, tout en marmottant des phrases sans suite comme : « Je ne peux pas supporter… Rappelez-vous ce que je vous dis !… » et ainsi de suite, sortit précipitamment du carré. Si je ne l’avais pas soigné durant cette fièvre qui l’avait mis à deux doigts de la mort, je n’aurais certainement pas supporté un seul jour de pareilles manières.
Jacobus m’ayant fait souvenir de son frère le riche négociant, je décidai de faire cette visite d’affaires, sur-le-champ. J’en savais alors un peu plus long sur lui. Il était l’un des membres du Conseil municipal, et il y donnait du fil à retordre aux autorités. Il exerçait une influence considérable sur l’opinion publique. Nombre de gens lui devaient de l’argent. C’était un gros importateur de toutes sortes de marchandises. Entre autres, il détenait pratiquement tout le stock de sacs pour le sucre. Cela je ne le sus que plus tard. L’impression générale que j’en eus fut qu’il s’agissait d’une notabilité locale. Il était célibataire et une fois par semaine on jouait aux cartes chez lui dans la maison qu’il avait en dehors de la ville : on y rencontrait les gens les plus en vue de la colonie.
Ma surprise n’en fut donc que plus grande à découvrir son bureau dans un endroit assez misérable, loin du quartier des affaires, parmi des taudis. Guidé par un écriteau noir à lettres blanches, je grimpai un étroit escalier de bois et j’entrai dans une pièce dont le plancher était jonché de morceaux de papier d’emballage et de bouchons de paille. Le long d’un des murs étaient empilées des caisses qui semblaient être des caisses de vin. Un jeune mulâtre efflanqué, couvert d’encre, au teint jaunâtre et au long cou et qui, dans l’ensemble, avait l’air d’un poulet malade, se leva d’un escabeau derrière un pupitre de bois blanc et me regarda comme si la frayeur l’eût rendu muet. J’eus quelque peine à le persuader de m’annoncer, sans pouvoir parvenir à comprendre la nature de son objection. Il s’y décida à la fin avec une répugnance indicible qui cessa de me paraître mystérieuse quand j’entendis qu’on l’accueillait avec force jurons et avec des grognements sauvages, qu’on le frappait et qu’on le jetait finalement dehors sans autre forme de procès, car il repassa la porte la tête la première avec un hurlement étouffé.
Dire que j’en fus stupéfait, ne rendrait pas la chose. J’en demeurai immobile, comme un homme perdu dans un rêve. Portant les deux mains à cette partie de sa frêle anatomie qui avait reçu le choc, le pauvre diable me dit simplement :
— « Voulez-vous entrer, je vous prie. »
La lamentable maîtrise de soi dont il faisait preuve était admirable ; mais je n’en croyais vraiment pas mes yeux. Une vague notion que j’avais déjà vu ce garçon-là quelque part, — ce qui était évidemment impossible, — ajoutait encore quelque étrangeté à une scène capable de vous faire douter de vos sens. Je jetai un regard anxieux autour de moi comme un somnambule qui s’éveille.
— « Dites-moi », — m’écriai-je, — « je ne me trompe pas, n’est-ce pas ? C’est bien ici le bureau de M. Jacobus ? »
Le garçon me regarda avec une expression douloureuse, — et qui m’était pourtant familière. Une voix dans la pièce voisine grognait agressivement :
— « Entrez, entrez, puisque vous êtes là… Je ne savais pas. »
Je traversai la pièce comme on s’approche du repaire d’un animal sauvage inconnu : avec intrépidité mais avec quelque émotion. Aucun animal sauvage toutefois ne pourrait jamais susciter l’indignation : le pouvoir de la faire naître n’appartient qu’à la brute humaine. Et mon indignation était vive, ce qui ne m’empêcha pas d’être immédiatement frappé par l’extraordinaire ressemblance des deux frères.
Celui-ci était brun au lieu d’être blond comme l’autre ; mais il était de la même taille. Il avait enlevé sa veste et son gilet ; et visiblement il avait dû somnoler dans le rocking-chair qui se trouvait dans un coin, du côté opposé à la fenêtre. Au-dessus de la masse imposante de la chemise blanche chiffonnée aux trois boutons de diamant, son visage rond semblait basané. Il était moite : la moustache pendante, ébouriffée. Il poussa du pied vers moi une chaise cannée.
— « Asseyez-vous. »
J’y jetai un vague coup d’œil, puis tournant vers lui un regard indigné, je lui déclarai d’un ton précis et incisif que j’étais venu le voir pour me conformer au désir de mes armateurs.
— « Ah ! oui ! Bon ! Je n’avais pas compris ce que cet imbécile me racontait… Mais tant pis ! Cela apprendra à cet idiot à me déranger à ce moment de la journée », — ajouta-t-il, en m’adressant une grimace empreinte d’un cynisme sauvage.
Je tirai ma montre. Il était plus de trois heures, — l’heure du plein travail dans les bureaux du port. Il se mit à hurler impérieusement :
— « Asseyez-vous, capitaine. »
Je répondis à cette gracieuse invitation en lui déclarant tranquillement :
— « Je peux très bien écouter sans m’asseoir tout ce que vous avez à me dire. »
Il poussa une interjection véhémente et me considéra un moment avec des yeux ronds et une expression furibonde. On eût dit un gigantesque matou qui vous aurait soudain lancé à la tête : « Voyez-vous ça… Pour qui vous prenez-vous ? Qu’est-ce que vous êtes venu faire ici ? Si vous ne voulez pas vous asseoir et parler affaires, allez au Diable. »
— « Je ne le connais pas personnellement », — répondis-je. — « Mais après ceci, je lui rendrais bien volontiers visite. Ce serait agréable de rencontrer un gentleman. »
Il me suivit, tout en grognant derrière mon dos :
— « Quelle impudence ! J’ai bien envie d’écrire à vos armateurs ce que je pense de vous. »
Je me retournai et le regardai un moment.
— « Voilà qui m’est parfaitement égal. Pour ma part je vous assure que je ne prendrai même pas la peine de leur parler de vous. »
Il ne dépassa pas la porte de son bureau tandis que je traversais l’antichambre jonchée de paille et de papier. Je crois qu’il en demeura quelque peu abasourdi.
— « Je te casserai les reins », — se mit-il à hurler tout à coup au misérable mulâtre, — « si tu oses jamais me déranger avant trois heures et demie pour qui que ce soit. Tu entends ? Pour qui que ce soit ? Que le diable emporte ces capitaines », — ajouta-t-il dans un grognement en baissant la voix.
Le frêle gamin, tremblant comme la feuille, fit entendre un gémissement. Je m’arrêtai net et donnai un conseil à ce martyr. Il me fut inspiré par la vue d’un marteau (servant à ouvrir les caisses de vin, je suppose) qui traînait à terre.
— « Si j’étais de toi, mon garçon, je mettrais ça dans ma manche la prochaine fois que j’entrerais dans son bureau et à la première occasion je lui… »
Qu’y avait-il donc qui m’était si familier dans cette face jaune du gamin ? Retranché derrière ce pupitre de bois blanc, il ne levait pas les yeux. Ses lourds cils baissés me donnèrent soudain le mot de l’énigme. Il ressemblait, — oui, ces grosses lèvres collées, — il ressemblait aux frères Jacobus. Il leur ressemblait à tous les deux, au riche négociant et à l’entreprenant approvisionneur (qui se ressemblaient) ; il leur ressemblait autant qu’un maigre mulâtre à peau jaunâtre peut ressembler à un blanc gros et grand, et d’un certain âge. C’était son teint exotique et la fragilité de sa structure qui m’avaient à ce point abusé. Je distinguais maintenant en lui à n’en pas douter le caractère Jacobus, affaibli, atténué, dilué pour ainsi dire, et je crus bon de ne pas achever mon discours. Je me proposais de lui dire : « Casse-lui donc la tête à cette brute. » J’avais encore l’impression que la chose était parfaitement raisonnable. Mais ce n’était pas une petite responsabilité que de conseiller à quelqu’un de commettre un parricide, si grand que pût être l’affront.
« Sacrés bougres de capitaines ! »
Je ne prêtai aucune attention à ce qu’on grommelait derrière mon dos ; mais, vexé et irrité, il me faut reconnaître que je frappai la porte derrière moi sans aucune espèce de retenue.
On ne s’étonnera probablement pas si je dis que cette entrevue me donna une meilleure idée de l’autre Jacobus. Et ce fut avec le sentiment d’un partisan, en quelque sorte, que quelques jours plus tard j’allai le voir à son « magasin ». De la rue on accédait par une grande porte cochère à cette maison de commerce, longue, profonde comme une caverne, dont l’extrémité était obscure et qui regorgeait de toute espèce de marchandises. J’aperçus, tout au fond, mon Jacobus, en bras de chemise, qui s’activait parmi ses employés. La pièce réservée aux capitaines était petite, voûtée, dallée et les fenêtres en étaient garnies de lourds barreaux de fer, ce qui lui donnait l’aspect d’un ancien donjon adapté à des fins hospitalières. Deux ou trois bouteilles engageantes et quelques verres étincelants entouraient de leur groupe brillant un grand pichet de faïence rouge au centre d’une table jonchée de journaux de tous les coins du monde. Un inconnu fort distingué, vêtu d’un élégant complet gris à carreaux, qui était assis là les jambes croisées, posa brusquement sur la table le journal qu’il lisait et me fit un salut.
Je devinai en lui le capitaine d’un vapeur. On ne parvenait pas à connaître ces gens-là. Ils arrivaient et repartaient trop rapidement et leurs navires étaient toujours mouillés trop loin, à l’entrée même du port. Ils avaient une vie toute différente de la nôtre. Il bâilla légèrement.
— « Triste trou, n’est-ce pas ? »
Je compris qu’il voulait parler de la ville.
— « Vous trouvez ? » murmurai-je.
— « Pas vous ? Je pars demain, Dieu merci. »
C’était un homme fort bien élevé, aimable et supérieur. Je le vis tirer à lui la boîte de cigares, prendre dans sa poche un grand étui et se mettre à le remplir méthodiquement. Nos regards se rencontrèrent, il cligna de l’œil comme un simple mortel et m’invita à imiter son exemple.
— « Ils sont très fumables. »
Je secouai la tête.
— « Je ne pars pas demain. »
— « Et alors ? Croyez-vous que j’abuse de l’hospitalité du vieux Jacobus ? Mon Dieu ! C’est compté sur la note, naturellement. Il vous fait des comptes d’apothicaire. Il ne perd pas la tête ! Que voulez-vous, ce sont les affaires… »
Je remarquai qu’une ombre passa sur son expression satisfaite, une sorte d’hésitation momentanée, en refermant son étui. Mais en fin de compte il le mit d’un air dégagé dans sa poche. Une voix tranquille se fit entendre sur le seuil de la porte.
— « Vous avez parfaitement raison, capitaine. »
Le gros et silencieux Jacobus s’avança dans la pièce. Sa tranquillité dans la circonstance alla jusqu’à la cordialité. Il avait remis sa veste avant de venir nous retrouver et il s’assit sur la chaise que venait de quitter le capitaine du vapeur qui, m’ayant fait un nouveau salut, sortit avec un rire bref qui me choqua. Il régnait dans la pièce un profond silence. Avec son air somnolent Jacobus semblait dormir les yeux ouverts. Et pourtant j’avais l’impression qu’il m’examinait attentivement de ses yeux lourds. Dans l’énorme caverne que formait le magasin quelqu’un se mit à clouer une caisse habilement : tap-tap, tap, tap, tap… Deux autres experts, l’un d’une voix lente et nasale, l’autre d’une voix aigre et perçante, commencèrent à collationner une facture :
— « Une demi glène d’aussière de manille de trois pouces. »
— « Bon. »
— « Six maillons assortis. »
— « Bon ! »
— « Six boîtes de potages, trois de pâtés, deux d’asperges, quinze livres de tabac, cabine. »
— « Bon ! »
— « C’est pour le capitaine qui était là justement », — murmura l’immuable Jacobus. — « Ces commandes des vapeurs sont bien petites. Ils prennent ce dont ils ont besoin le long de leur route. Cet homme-là sera à Samarang en moins de quinze jours. De très petites commandes. »
On continuait à appeler les articles dans le magasin : un extraordinaire méli-mélo d’objets variés, pinceaux, boîtes de sauces…, etc., etc. « Trois sacs de pommes de terre de première qualité », — continuait à lire la voix nasillarde.
Jacobus là-dessus sursauta comme un homme endormi qu’on secoue et il sembla s’agiter un peu. A l’ordre qu’il lança dans le magasin un métis souriant, aux boucles huilées, une plume derrière l’oreille, apporta un échantillon de six pommes de terre qu’il aligna sur la table.
Invité à en admirer la beauté, je leur jetai un regard froid et hostile. Jacobus, avec calme, me proposa d’en commander dix ou quinze tonnes, — tonnes ! Je n’en pouvais croire mes oreilles. Mon équipage n’en aurait pas consommé autant en une année : et les pommes de terre (excusez cette remarque d’ordre pratique) sont une marchandise extrêmement périssable. Je pensais que c’était là une plaisanterie ; ou que peut-être il cherchait à découvrir si j’étais un parfait idiot. Mais son intention n’était pas aussi simple. Je compris qu’il pensait que je les achèterais pour mon compte.
— « Je vous proposais une affaire, capitaine. Je ne vous en demanderais pas un gros prix. »
Je lui répondis que je ne faisais pas d’affaires. J’ajoutai même d’un ton lugubre que je ne savais que trop comment finissent généralement ces sortes de spéculations.
Il soupira et croisa les mains sur son estomac avec une résignation exemplaire. J’admirai la placidité de son impudence. Puis s’éveillant soudain à demi :
— « Vous ne voulez pas essayer un cigare, capitaine ? »
— « Non, merci. Je ne fume pas le cigare. »
— « Pour une fois ! » — s’écria-t-il, avec patience.
Un silence mélancolique succéda à ces paroles. On sait combien il arrive parfois qu’une personne révèle une profondeur et une pénétration insoupçonnées : c’est-à-dire, en d’autres termes, qu’on l’entend tout d’un coup dire quelque chose d’inattendu. Je ne m’attendais guère à entendre Jacobus dire :
— « Cet homme qui vient de sortir a raison. Vous pouvez en prendre un, capitaine. Ici tout est une question d’affaires. »
Je me sentis un peu honteux. En me rappelant son horrible frère je le trouvais parfaitement convenable. Ce fut avec un peu de remords que je déclarai n’avoir aucune objection à accepter son hospitalité.
Une minute ne s’était pas écoulée que je vis où cette déclaration me menait. Comme s’il changeait de sujet, Jacobus m’apprit que sa maison d’habitation n’était pas à plus de dix minutes de marche. Elle avait un très beau jardin enclos de mur. Vraiment remarquable. Il fallait que je vienne voir cela un de ces jours.
Il semblait être très amateur de jardins. J’en étais moi-même grand amateur : mais je n’entendais pas que mes remords me menassent aussi loin qu’aux parterres de Jacobus, si beaux qu’ils pussent être. Il ajouta d’un ton de simplicité parfaite :
— « Il n’y a là que ma fille. »
Il est difficile de mettre chaque chose à sa place exacte et il me faut revenir ici sur un fait qui s’était passé une semaine ou deux auparavant. Le médecin du Service de Santé était venu à bord soigner un de mes hommes et naturellement je l’avais fait entrer dans ma chambre. Le capitaine d’un voilier avec lequel je m’étais lié se trouvait là et dans la conversation, je ne sais comment, on prononça le nom de Jacobus. Le capitaine en question le prononça sans le moindre respect, si je ne me trompe. Je ne me rappelle pas maintenant ce que j’étais sur le point de dire, quand le docteur, — homme fort agréable, cultivé et assez sûr de lui, — m’arrêta en déclarant d’un ton aigre :
— « Ah ! vous parlez de mon respectable beau-papa ! »
Naturellement cette sortie nous fit nous taire. Mais je me rappelai cet épisode, et à ce moment, pour dire quelque chose sans me compromettre, je demandai d’un ton de surprise polie :
— « Votre fille mariée habite avec vous, monsieur Jacobus ? »
Il remua tranquillement sa grosse main de droite à gauche.
— « Non ! C’est une autre de mes filles », — déclara-t-il, pesamment, et d’une voix contenue, comme d’habitude. « Elle… » Il parut chercher dans son esprit une phrase descriptive. Mais mon espoir fut déçu. Il articula seulement sa définition stéréotypée :
— « Elle est tout à fait différente. »
— « Vraiment… A propos, Jacobus, j’ai rendu visite à votre frère, l’autre jour. Je ne vous ferai pas un grand compliment si je vous dis que je l’ai trouvé très différent de vous. »
Il eut l’air de réfléchir profondément, puis il fit cette remarque bizarre :
— « C’est un homme qui a des habitudes régulières. »
Peut-être voulait-il faire ainsi allusion à son habitude de faire la sieste très tard : mais je marmottai « Sacrées habitudes en tout cas », ou quelque chose de ce genre, et je sortis brusquement du magasin.
L’algarade que j’avais eue avec Jacobus le négociant fut bientôt connue. Deux ou trois de mes relations y firent des allusions voilées. Peut-être le petit mulâtre avait-il parlé. Je dois avouer que les gens avaient l’air assez scandalisés, mais non pas de la brutalité de Jacobus. Un homme que je connaissais me reprocha même ma vivacité.
Je lui fis le récit complet de ma visite, sans oublier de mentionner la significative ressemblance du pauvre petit mulâtre et de son bourreau. Il n’en fut pas surpris. Sans doute, sans doute. Et puis après ? Il m’assura d’un ton jovial qu’il y en avait pas mal dans ce cas-là. L’aîné des Jacobus avait toujours été célibataire. Un célibataire tout à fait respectable. Il n’y avait jamais eu de scandale de ce côté-là. Sa vie avait été on ne peut plus régulière. Cela n’avait pu offusquer personne.
Je répliquai que j’avais été pour ma part extrêmement offusqué. Mon interlocuteur ouvrit de grands yeux. Pourquoi ? Parce qu’un mulâtre recevait quelques coups. En voilà une affaire, par exemple ? Je ne savais pas à quel point ces métis étaient insolents et sournois. En fait il semblait penser que M. Jacobus était bien bon d’employer ce garçon-là : c’était une sorte d’aimable faiblesse assez pardonnable.
L’homme avec qui je parlais appartenait à une des vieilles familles françaises, descendant des anciens colons : toutes nobles, toutes appauvries et qui mènent une vie étroite, triste et digne. Les hommes, en règle générale, occupent des postes subalternes dans des administrations ou dans des maisons de commerce. Les jeunes filles sont presque toujours jolies, ignorantes du monde, aimables, agréables et généralement bilingues : elles babillent innocemment aussi bien en français qu’en anglais. Le vide de leur existence passe l’imagination.
J’avais pu entrer dans deux ou trois de ces maisons parce que quelques années auparavant, me trouvant à Bombay, j’avais eu l’occasion de rendre service à un jeune garçon sympathique et désœuvré qui s’y trouvait échoué, ne sachant guère que faire de lui-même ni même comment regagner son île. Ç’avait été une affaire de deux cents roupies à peu près, mais à son arrivée la famille avait tenu à me témoigner sa gratitude en m’admettant dans son intimité. Ma connaissance du français facilitait grandement la chose. Dans l’entre-temps ils avaient fait en sorte de marier le garçon à une femme qui avait à peu près le double de son âge, relativement riche : seule profession qui lui convînt réellement. Mais ce n’était pas le paradis. La première fois que je rendis visite à ce couple, elle remarqua une petite tache de graisse sur le pantalon du pauvre diable et lui fit une virulente scène de reproches si pleine de passion que j’en demeurai aussi terrifié que si j’assistais à une tragédie de Racine. Il va sans dire qu’il ne fut jamais question de l’argent que je lui avais avancé : mais ses sœurs, mademoiselle Angèle et mademoiselle Marie, et les tantes de l’une et l’autre famille, qui parlaient un français archaïque d’avant la Révolution, et une armée de parents éloignés, m’adoptèrent sur-le-champ comme ami, d’une façon presque embarrassante.
C’est avec le frère aîné (il était employé dans le bureau de mes consignataires) que j’avais cette conversation au sujet de Jacobus le négociant. Il regrettait mon attitude et hocha la tête d’un air entendu. Un homme influent. On ne savait jamais si on n’aurait pas besoin de lui. J’exprimai mon immense préférence pour l’autre. Sur quoi mon ami prit un air grave.
— « Pourquoi diable me faites-vous cette tête-là ? » — lui dis-je avec quelque impatience. — « Il m’a demandé d’aller voir son jardin et j’ai bien envie d’y aller un de ces jours. »
— « Ne faites pas cela », — me dit-il avec un tel sérieux que j’éclatai de rire : mais il continua à me regarder sans sourire.
C’était à la vérité une tout à fait autre affaire. La conscience publique de l’île avait été à un certain moment grandement troublée par mon Jacobus. Les deux frères avaient été longtemps associés sans aucun nuage, lorsqu’un cirque ambulant survenant dans l’île, mon Jacobus s’était soudainement amouraché d’une des écuyères. Ce qui rendait la chose plus grave, c’est qu’il était marié. Il n’avait même pas eu le bon goût de cacher sa passion. Elle avait dû être forte, à la vérité, pour entraîner ainsi un homme aussi placide. Son attitude avait été absolument scandaleuse. Il avait suivi cette femme au Cap et il avait apparemment voyagé à la suite de cet absurde cirque dans d’autres parties du monde et dans une position tout à fait dégradante. La femme n’avait pas tardé à ne plus se soucier de lui et l’avait traité comme le dernier des derniers. Les récits les plus extraordinaires de sa dégradation morale étaient parvenus jusque dans l’île à cette époque. Il n’avait pas assez de volonté pour se délivrer…
L’image grotesque d’un gros approvisionneur de navires, très entreprenant, enchaîné par une passion des plus profanes, m’enchantait : et j’écoutai bouche bée cette histoire vieille comme le monde, cette histoire qui avait fait le sujet de légendes, de fables morales, de poèmes, mais qui s’accordait on ne peut plus comiquement avec la personnalité en question. Quelle étrange victime pour les dieux !
Par la suite, sa femme abandonnée était morte. Son frère avait pris soin de sa fille qu’il maria aussi avantageusement qu’il le put dans la circonstance.
— « Oh ! La femme du médecin ! » — m’écriai-je.
— « Vous savez cela ? Oui. Un garçon très capable. Il avait besoin d’un peu d’aide dans la vie et il y avait pas mal d’argent du côté de la mère de la jeune fille, sans compter les espérances. Bien entendu, ils ne le connaissent pas », — ajouta-t-il. — « Le docteur le salue dans la rue, je crois, mais il évite de lui parler quand ils se rencontrent à bord d’un navire, comme cela arrive parfois. »
Je remarquai que c’était là maintenant de l’histoire ancienne.
Mon ami en convint. Mais c’était bien la faute de Jacobus si on ne l’avait jamais oubliée ni pardonnée. Il était revenu un beau jour. Mais comment ? Pas le moins du monde dans un esprit de contrition qui eût pu lui concilier ses concitoyens scandalisés. Il était revenu en traînant avec lui un enfant, — une fille…
— « Il m’a parlé d’une fille qui habite avec lui », — déclarai-je fort intéressé.
— « C’est certainement la fille de l’écuyère », — reprit mon ami. — « Il se peut que ce soit sa fille à lui : je suis prêt à l’admettre. En fait je n’ai aucun doute… »
Mais il ne comprenait pas pourquoi il l’avait amenée ainsi dans une respectable communauté pour perpétuer le souvenir d’un scandale. Et ce n’était pas là le pire. Il se passa quelque chose de plus lamentable encore, bientôt après. L’écuyère arriva un beau matin. Elle débarqua d’un paquebot…
— « Quoi ? Ici ? Pour réclamer son enfant probablement », — suggérai-je.
— « Non pas. »
Mon amical informateur se montra des plus méprisants.
— « Imaginez une furie peinte et hagarde. On l’avait expédiée du Mozambique, où quelqu’un avait payé son passage jusqu’ici. Elle avait une blessure interne, un coup de pied de cheval : elle n’avait pas un sou vaillant en débarquant : je ne crois pas qu’elle ait même demandé à voir l’enfant. En tout cas, pas avant son dernier jour. Jacobus lui loua un bungalow pour y mourir. Il fit demander deux sœurs de l’hôpital pour la soigner pendant ces quelques mois. S’il ne l’a pas épousée in extremis, comme ces bonnes sœurs essayaient de l’en persuader, c’est qu’elle ne voulut pas en entendre parler. Comme disaient les religieuses : « Cette femme est morte impénitente ». On a raconté qu’elle a mis Jacobus à la porte de sa chambre en poussant son dernier soupir. C’est peut-être la véritable raison pour laquelle il ne s’est pas mis en deuil lui-même : il a seulement mis l’enfant en noir. Quand elle était petite on la voyait parfois passer dans la rue escortée d’une négresse, mais depuis qu’elle a eu l’âge de relever les cheveux je ne crois pas qu’on l’ait jamais vue mettre un pied hors de ce jardin. Elle doit avoir maintenant dix-huit ans. »
Ainsi parla mon ami, en y ajoutant même quelques détails : il ne pensait pas, par exemple, que la jeune fille eût jamais parlé à trois personnes de la bonne société dans l’île : une extrême pauvreté avait amené une parente âgée des frères Jacobus à accepter la place de gouvernante de l’enfant. Quant aux affaires de Jacobus (ce qui certainement ennuya son frère), ç’avait été de sa part un choix des plus sages. Elles ne le mettaient en rapport qu’avec des étrangers de passage : tandis que tout autre genre d’affaires eût risqué d’amener toutes sortes de froissements avec les gens de son milieu. Cet homme ne manquait pas d’un certain tact, — mais il était naturellement sans vergogne. Car pourquoi diable gardait-il cette enfant avec lui ? C’était extrêmement pénible pour tout le monde.
Je pensais soudain (et avec un profond dégoût) à l’autre Jacobus et je ne pus m’empêcher de dire avec une feinte douceur :
— « Je suppose que s’il l’employait, par exemple, comme marmiton et qu’il lui tirât de temps à autre les cheveux ou les oreilles, la position serait plus régulière, — moins choquante pour la classe respectable à laquelle il appartient. »
Il était assez intelligent pour saisir mon intention, et il haussa impatiemment les épaules.
— « Vous ne comprenez pas. D’abord, ce n’est pas une mulâtresse. Et un scandale est un scandale. Il faut donner aux gens une chance d’oublier. J’ose dire qu’il eût mieux valu pour elle devenir marmiton ou quelque chose de ce genre. Naturellement il essaie de gagner de l’argent par tous les moyens ; mais dans une affaire de ce genre, il n’en gagnera pas assez pour qu’on lui fasse des avances. »
Quand mon ami m’eut quitté, j’eus l’impression que Jacobus et sa fille vivaient comme un couple de parias sur une île déserte : la fille réfugiée dans la maison comme si c’eût été une caverne creusée dans une falaise, et Jacobus allant chercher leur pâture à tous deux sur la grève, — exactement comme deux naufragés qui espèrent toujours qu’on viendra à leur rescousse, ne fût-ce que pour les remettre en contact avec le reste de l’humanité.
Mais la réalité physique de Jacobus ne s’accordait guère avec cette vue romanesque. Quand il lui arrivait de venir à bord, il sirotait placidement sa tasse de café, me demandait si j’étais satisfait, — et j’écoutais à peine les racontars du port qu’il laissait tomber lentement de ses lèvres, presque à voix basse. J’avais alors des ennuis qui m’occupaient. Mon navire affrété, et alors que je ne songeais qu’à réussir à faire rapidement mon voyage de retour, j’avais soudain découvert qu’il y avait pénurie complète de sacs. Une catastrophe ! Le stock d’une sorte spéciale qu’on appelle des vacoas, paraissait entièrement épuisé. J’attendais avant peu une consignation, — elle était en route, mais entre temps le chargement de mon navire se trouva arrêté. J’avais de quoi me faire du mauvais sang. Mes consignataires, qui m’avaient reçu avec tant de chaleur à mon arrivée, maintenant qu’ils étaient devenus mes affréteurs écoutaient mes doléances avec une froide politesse. Leur fondé de pouvoirs, cet homme maigre à allure de vieille demoiselle, qui poussait la pruderie au point de ne pas aimer même parler de l’impur Jacobus, me donna l’exact point de vue commercial de la situation.
— « Mon cher capitaine », — il rétractait ses joues racornies dans un sourire condescendant de requin, — « nous n’étions pas moralement obligés de vous prévenir de cette pénurie possible avant que vous ne signiez la charte-partie. C’était à vous de vous prémunir contre l’éventualité d’un retard, — à strictement parler. Mais il va sans dire que nous n’en saurions aucunement profiter. Ce n’est réellement de la faute de personne. Nous-mêmes ayant été pris à l’improviste », déclara-t-il pour terminer, d’un air affecté, en mentant évidemment.
Ce sermon, je l’avoue, m’avait donné soif. Une colère rentrée produit généralement cet effet, et comme j’errais sans trop savoir où aller, le grand pichet de faïence rouge de la salle des capitaines au « magasin » de Jacobus me revint à l’esprit.
Je fis tout juste un salut aux personnes que je trouvai là, je versai une bonne douche froide sur mon indignation, puis une autre, et assez déprimé, je demeurai plongé dans des réflexions peu réjouissantes. Les autres lisaient, parlaient, fumaient, échangeaient au-dessus de ma tête des plaisanteries dénuées de toute subtilité. Mais on ne troubla pas ma méditation. Et ce fut sans adresser la parole à personne que je me levai et sortis, juste pour être inopinément accosté, au milieu de tout le remue-ménage du magasin, par Jacobus le paria.
— « Enchanté de vous voir, capitaine. Quoi ? Vous partez ? Vous n’avez pas très bonne mine depuis quelques jours, il me semble. Surmené, hein ? »
Il était en bras de chemise et ses propos ne sortaient pas du genre habituel d’une conversation d’affaires, mais j’y sentis quelque chose d’humain. C’était de l’aménité commerciale, mais je n’en avais guère rencontré. Je crois vraiment (à en juger par le regard lourd qu’il dirigea sur une certaine étagère) qu’il allait me conseiller l’achat d’une bouteille de tonique Clarkson qu’il avait en magasin, lorsqu’une impulsion me fit lui dire :
— « J’ai des ennuis avec mon chargement. »
Parfaitement éveillé sous ce gros masque endormi aux lèvres collées, il comprit immédiatement de quoi il retournait, et il secoua la tête d’un air si compatissant que je soulageai mon exaspération en m’écriant :
— « Il doit sûrement y avoir onze cents sacs dans la colonie. Il suffirait de les chercher. »
Là-dessus, il hocha de nouveau légèrement sa grosse tête et parmi le bruit et l’animation du magasin je l’entendis murmurer tranquillement :
— « Bien sûr. Mais ceux qui possèdent une réserve de ces sacs ne voudront pas les vendre. Ils en ont besoin eux-mêmes de cette grandeur. »
— « C’est exactement ce que me disent mes consignataires. Il est impossible d’en acheter. Bah ! Ils ne veulent pas. Cela les arrange de retenir mon navire. Mais si je pouvais découvrir les sacs, je me chargerais bien… Écoutez, Jacobus ! Vous êtes, vous, l’homme à avoir cela dans votre manche. »
Il protesta en secouant pesamment sa grosse tête. Je restais devant lui ne sachant que faire, sous le regard de ces yeux lourds que voilait une expression semblable à celle d’un homme qui vient de traverser une crise désespérée. Lorsque soudain, il murmura :
— « Il est impossible de parler tranquillement ici. J’ai beaucoup à faire. Mais si vous pouviez aller m’attendre chez moi. Ce n’est pas même à dix minutes d’ici. Ah ! c’est vrai, vous ne connaissez pas le chemin. »
Il demanda sa veste et s’offrit à me conduire lui-même. Il lui faudrait retourner immédiatement à son magasin pour terminer ses affaires : après quoi il pourrait parler avec moi tranquillement de cette affaire de sacs. Ce programme me fut murmuré à travers des lèvres à peine disjointes, presque immobiles : il gardait fixé sur moi son lourd regard placide, le regard d’un homme las, — mais j’avais l’impression qu’il était tout de même pénétrant. Je me demandais ce qu’il pouvait bien essayer de découvrir en moi et je demeurais silencieux, indécis.
— « Je vous demanderai de m’attendre chez moi jusqu’à ce que nous puissions parler de tout cela à tête reposée. Cela vous va ? »
— « Bien sûr ! » — m’écriai-je.
— « Mais je ne peux pas vous promettre… »
— « Bien entendu », — répondis-je, « je n’attends pas une promesse. »
— « Je veux dire que je ne peux même pas vous promettre de faire la démarche à laquelle je pense. Il faut d’abord voir… hum ! »
— « Fort bien. On verra. Je vous attendrai tout le temps que vous voudrez. Que voulez-vous que je fasse d’autre dans ce diable de port ? »
Avant même que j’eusse prononcé ces derniers mots nous nous étions mis en route d’un pas tranquille. Nous tournâmes deux encoignures et nous nous engageâmes dans une rue complètement déserte, qui avait un air de chemin de campagne, et où l’herbe poussait entre les pavés. La maison s’étendait en bordure de la rue : elle n’avait qu’un seul étage au-dessus d’un sous-sol surélevé en pierres brutes, de telle sorte que nos têtes n’atteignaient pas le niveau des fenêtres en longeant la maison. Les jalousies étaient toutes étroitement baissées, comme des paupières, et la maison semblait profondément endormie par cet après-midi ensoleillé. L’entrée se trouvait sur le côté, dans une allée encore plus herbue que la rue : une petite porte, simplement fermée au loquet.
En s’excusant de passer devant moi pour me montrer le chemin, Jacobus me précéda dans un couloir obscur et me fit traverser une pièce parquetée qui me parut être la salle à manger. Elle était éclairée par trois portes vitrées grand’ouvertes sur une véranda ou plutôt une loggia dont les arches de brique couraient tout le long de la maison du côté du jardin. C’était vraiment un jardin magnifique : des pelouses admirablement tenues, avec d’éclatantes plates-bandes au premier plan, s’étendaient autour d’un bassin d’eau sombre qu’encerclait une margelle de marbre ; et au fond, le feuillage d’arbres d’essences très diverses masquait les toits des maisons voisines. On se serait cru à cent lieues de la ville. C’était une solitude aux splendides couleurs, assoupie dans un chaud et voluptueux silence. Là où les ombres immobiles s’allongeaient sur les plates-bandes et dans les recoins ombreux, les couleurs de ces massifs de fleurs avaient une extraordinaire magnificence. Je m’arrêtai, saisi d’admiration. Jacobus me prit doucement par le bras au-dessus du coude, et me fit me tourner vers la gauche.
Je n’avais pas encore remarqué la jeune fille. Elle occupait un fauteuil d’osier, bas et profond, et telle que je la vis, exactement de profil, elle avait l’air d’un personnage de tapisserie, et aussi parfaitement immobile. Jacobus me lâcha le bras.
— « Voici Alice », — annonça-t-il tranquillement : et sa façon de parler à mi-voix donnait à ces paroles un tel caractère de communication confidentielle que je m’imaginai hochant la tête d’un air entendu et murmurant : « Je vois, je vois… » Il va sans dire que je n’en fis rien : nous restions côte-à-côte à regarder la jeune fille. Elle ne bougea pas pendant un moment, et continua à regarder droit devant elle, comme si elle contemplait la vision d’une cavalcade traversant le jardin dans la profonde et éclatante richesse de la lumière et la splendeur des fleurs.
Sortant enfin de sa rêverie, elle regarda autour d’elle et au-dessus d’elle. Si je ne l’avais pas d’abord remarquée, je suis certain que, de son côté, elle n’avait pas eu la moindre notion de ma présence avant de me voir à côté de son père. Le rapide mouvement de ses longs cils, la façon dont ce regard languide, soudain agrandi, prit une soudaine fixité, ne laissait aucun doute à cet égard.
Un semblant de crainte parut dans sa surprise ; un éclair de colère lui succéda. Jacobus, après avoir prononcé mon nom à voix assez haute, me dit :
— « Faites comme chez vous, capitaine, je n’en aurai pas pour longtemps. » — Et il sortit rapidement.
Avant même d’avoir eu le temps de faire un salut je me trouvai seul avec cette jeune fille, — que personne de la ville, homme ni femme, je m’en souvins soudainement, n’avait vue depuis qu’elle avait eu l’âge de relever les cheveux. On eut dit, d’ailleurs, qu’on ne les avait pas touchés depuis cette époque lointaine : ils formaient une masse de boucles noires, étincelantes, relevées sur le sommet de la tête, et de longues mèches en désordre encadraient son clair visage : une masse si fournie, si forte que rien que de la regarder, on avait la sensation d’un poids sur la tête et l’impression d’un désordre magnifiquement volontaire. Elle se pencha en avant, en se serrant contre ses jambes croisées ; elle était drapée dans une étoffe ambrée dont la minceur révélait son jeune corps souple, ramassé dans ce siège bas comme si elle allait bondir. Je remarquai un ou deux petits frémissements qui donnaient l’impression qu’elle prenait son élan. Ils firent place à l’immobilité la plus absolue.
Une fois que j’eus réprimé l’absurde impulsion de courir après Jacobus (car moi aussi, j’avais été surpris) je m’emparai d’une chaise, la plaçai assez près de la jeune fille, m’y assis délibérément et me mis à parler du jardin, sans prêter la moindre attention à ce que je disais, mais en prenant une intonation caressante comme lorsqu’on parle à un animal sauvage effarouché et que l’on veut calmer. Je n’étais même pas sûr qu’elle me comprenait. Elle ne leva pas son visage et n’essaya même pas de regarder de mon côté. Je continuais à parler, uniquement pour l’empêcher de s’enfuir. Je remarquai encore un de ces frémissements réprimés qui me fit retenir mon souffle.
J’eus à la fin l’impression que ce qui l’empêchait peut-être de s’enfuir d’un seul bond nerveux, c’était l’insuffisance de son costume. Le fauteuil d’osier était assurément la chose la plus substantielle qui la couvrît. Ce qu’elle pouvait bien avoir sous cette draperie jaunâtre et flottante devait être du genre le plus aérien. On ne pouvait pas ne pas s’en rendre compte. C’était évident. J’en fus même d’abord un peu gêné : mais un esprit délivré de préjugés étroits a bientôt fait de vaincre une semblable gêne. Je ne me détournai pas d’Alice. Je continuai à lui parler avec une insinuante douceur : et en me rappelant que, très vraisemblablement, jamais un étranger ne lui avait adressé la parole, je sentais s’affermir mon assurance. Je ne sais vraiment pas pourquoi il s’y glissa même un peu d’émotion. Mais il en fut ainsi. Et au moment même où j’en prenais conscience, un léger cri mit brusquement fin au flux de ma conversation mondaine.
Cette exclamation n’avait pas été poussée par la jeune fille. Elle provenait de quelqu’un derrière moi et cela me fit brusquement tourner la tête. L’apparition que j’entrevis sur le seuil de la porte ne pouvait être, je le compris aussitôt, que la parente âgée de Jacobus, la dame de compagnie, la gouvernante. Tandis qu’elle demeurait immobile comme si la foudre l’eût frappée, je me levai et lui fis un salut.
Les dames de la maison Jacobus passaient évidemment leurs journées très légèrement vêtues. Cette vieille femme dont le visage ressemblait à un énorme citron ridé, avec de petits yeux et un chignon de cheveux gris, était vêtue d’une robe faite d’une étoffe soyeuse et légère, d’un gris-brun. Elle lui tombait du cou jusqu’aux pieds avec la simplicité d’une chemise de nuit sans aucun ornement. Cela lui donnait un aspect parfaitement cylindrique.
— « Comment êtes-vous entré ici ? » s’écria-t-elle.
Avant d’avoir pu articuler un mot je la vis disparaître et j’entendis aussitôt à l’autre bout de la maison la rumeur de protestations aiguës. Personne évidemment ne pouvait lui dire comment j’étais venu. Un moment après, escortée de deux négresses qui poussaient de grands cris, elle reparut sur le seuil de la porte, et me demanda avec fureur :
— « Qu’est-ce que vous venez faire ici ? »
Je me tournai vers la jeune fille. Elle s’était redressée et avait posé les mains sur les bras du fauteuil. Je demandai avec fureur :
— « Je pense, mademoiselle Alice, que vous n’allez pas les laisser me jeter dans la rue. »
Ses magnifiques yeux noirs, allongés, se posèrent sur moi avec une expression indéfinissable puis, d’une voix rauque et méprisante, elle laissa tomber en manière d’explication :
— « C’est papa. »
Je fis un nouveau salut à la vieille dame.
Elle se retourna pour renvoyer ses noires confidentes, puis m’examinant étrangement, un œil presque entièrement fermé et la figure toute tirée de ce côté comme si elle était en proie au mal de dents, elle s’avança sous la véranda, s’assit sur un rocking-chair à quelque distance et prit sur une table de quoi tricoter. Avant de commencer elle plongea une des aiguilles dans son chignon gris et se mit à le fourrager vigoureusement.
Cette sorte de chemise de nuit collait à ses formes grasses. Elle portait des bas de coton blanc et des pantoufles de velours marron. Ses pieds et ses chevilles étaient plus que visibles sur la barre d’appui. Elle se balançait lentement tout en tricotant. J’avais repris mon siège et demeurais immobile, car je me défiais de cette vieille femme. N’allait-elle pas m’ordonner de partir ? Elle me paraissait capable de toutes les insolences. Elle renifla à une ou deux reprises tout en tricotant avec fureur. Tout à coup elle lança à la jeune fille cette question :
— « Qu’est-ce qui lui prend, à ton père, maintenant ? »
La jeune fille haussa les épaules au point que tout son corps ondula sous cette étoffe lâche : et de cette voix étrangement rauque et qui n’était pourtant pas sans charme, comme ces vins un peu âcres qu’on boit avec plaisir :
— « C’est un capitaine. Laisse-moi tranquille. Veux-tu ? »
Le rocking-chair se balança plus rapidement, et la vieille voix aigre siffla :
— « Toi et ton père vous pouvez faire la paire. Il ne reculerait devant rien, on le sait. Mais je ne m’attendais pas à cela. »
J’eus l’impression qu’il fallait intervenir et je fis remarquer modestement, mais fermement, que c’était pour des affaires. J’avais à parler avec M. Jacobus.
Elle s’écria d’un ton ironique : — « Pauvre innocent. » Puis changeant de ton. — « La boutique est faite pour les affaires. Pourquoi n’allez-vous pas parler avec lui à la boutique ? »
L’allure furieuse de ses doigts et de ses aiguilles à tricoter me faisaient tourner la tête : et avec une indignation glapissante :
— « Rester là à regarder cette fille ; c’est ça que vous appelez des affaires ? »
— « Non », — lui dis-je avec la plus extrême douceur. — « J’appelle cela un plaisir, un plaisir fort inattendu. Et à moins que mademoiselle Alice n’objecte… »
Je me tournai à demi vers elle. Elle me lança d’un ton de colère méprisante : « Ça m’est égal ! » et appuyant son coude sur ses genoux elle se prit le menton dans la main, — le menton des Jacobus à n’en pas douter. Et ces cils lourds, ce regard noir irrité me rappelaient aussi Jacobus, — le riche négociant, l’homme respectable. C’était le même dessin des sourcils, rigide et inquiétant. Oui ! Je retrouvais en elle une ressemblance avec les deux frères. Et je fus surpris de découvrir tout à coup qu’après tout ces Jacobus étaient plutôt de beaux hommes.
— « Eh bien ! alors, je vais vous regarder jusqu’à ce que vous vous décidiez à sourire », — lui dis-je.
De nouveau, avec plus de mépris encore :
— « Ça m’est égal », — me dit-elle.
La vieille femme intervint brusquement d’un ton aigre.
— « Ce garçon est d’une impudence. Et toi aussi ! Ça m’est égal !… Va-t’en au moins mettre quelque chose sur toi. Rester dans une pareille tenue devant cette espèce de marin. »
Le soleil était sur le point d’abandonner la Perle de l’Océan pour d’autres mers, pour d’autres terres. Ce jardin enclos où s’amassaient les ombres était éclatant de couleur comme si les fleurs eussent répandu la lumière qu’elles avaient absorbée pendant la journée. L’étonnante vieille femme devint plus explicite. Elle conseilla à la jeune fille d’aller mettre un corset et un jupon, avec une absence de réserve qui m’humilia. N’avais-je pas vraiment plus d’importance qu’un mannequin ? La jeune fille cria :
— « Non ! »
Ce n’était pas la réponse entêtée d’un enfant : elle avait comme un accent de désespoir. Visiblement mon intrusion avait rompu l’équilibre de leurs relations habituelles. La vieille femme se remit à tricoter avec fureur, les yeux rivés sur son ouvrage.
— « Tu es bien la fille de ton père ! Et cela parle d’entrer au couvent. Se laisser regarder comme cela par n’importe qui. »
— « Ça suffit ! »
— « Dévergondée ! »
— « Vieille sorcière ! » — articula distinctement la jeune fille, sans modifier en rien sa pose méditative, le menton dans la main, et le regard perdu au loin par delà du jardin.
C’était comme la querelle du pot de terre et du pot de fer. La vieille bondit hors de son siège, jeta violemment son ouvrage, et non sans laisser voir parfaitement ses grosses jambes sous cette étrange robe collante, s’avança vers la jeune fille, qui ne fit pas le moindre geste. J’éprouvais une sorte de trépidation lorsqu’épouvantée, sembla-t-il, par cette insouciante attitude, la vieille parente de Jacobus se tourna brusquement vers moi.
Elle était armée, je le voyais, d’une aiguille à tricoter, et comme elle levait la main je crus qu’elle allait me la lancer comme un dard. Mais elle se contenta de s’en gratter la tête tout en m’examinant d’assez près, un œil à demi fermé et la figure tordue par une grimace bizarre.
— « Mon garçon », — me dit-elle à brûle-pourpoint, — « est-ce que vous attendez quelque chose de bon de tout cela ? »
— « Je l’espère, mademoiselle Jacobus. » — Je m’efforçais de parler du ton tranquille d’un visiteur. — « Voyez-vous, je suis ici parce que je cherche des sacs. »
— « Des sacs ! Voyez-vous cela. Croyez-vous que je ne vous ai pas vu faire le joli cœur devant cette détestable fille ? »
— « Tu voudrais me voir dans la tombe », — déclara d’une voix rauque la jeune fille immobile.
— « Dans la tombe ! Eh bien, et moi ? Qui suis enterrée vivante ici pour les beaux yeux d’une enfant dotée d’un aussi charmant père », — s’écria-t-elle, et se tournant vers moi : — « Vous êtes de ces gens avec qui il fait des affaires. Eh bien ! pourquoi ne nous laissez-vous pas tranquilles, mon garçon ? »
Ce « ne nous laissez-vous pas tranquilles » fut dit sur un ton ! il était fait d’une insolente familiarité, d’un accent de supériorité et de mépris. Je devais l’entendre à plus d’une reprise par la suite, car on n’aurait qu’une imparfaite connaissance de la nature humaine si l’on supposait que ce fut ma dernière visite dans cette maison, — où aucune personne respectable m’avait mis le pied depuis tant d’années. Non, l’on s’abuserait si l’on pensait qu’une telle réception m’avait fait à tout jamais battre en retraite. Je n’allais tout de même pas reculer devant une vieille femme grotesque et insolente.
Et puis il y avait ces indispensables sacs. Ce premier soir Jacobus me retint à dîner, après m’avoir dit, loyalement, qu’il n’était pas sûr de pouvoir faire quelque chose pour moi. Il avait beaucoup réfléchi à la question. C’était trop difficile, à son avis… Mais il se montra plutôt laconique.
Nous n’étions que trois à table. La jeune fille, par des : « Je ne veux pas », « Non » et « Ça m’est égal » avait résolument affirmé son intention de ne pas venir à table, de ne pas dîner, de ne pas bouger de la véranda. La vieille parente s’agitait dans ses pantoufles et sifflotait d’indignation, Jacobus la dominait de toute sa taille et murmurait placidement dans sa gorge : je gardais mes distances, lançant de temps à autre d’un ton amusé quelques mots qui me valurent, sous le couvert de la nuit, de recevoir secrètement un coup dans les côtes, était-ce du coude de la vieille ou peut-être de son poing ? Je retins un cri. Tout ce temps la jeune fille ne condescendit même pas à lever la tête pour nous regarder. Cela peut paraître enfantin, — et pourtant cette bouderie à la fois pétrifiée et pétulante avait quelque chose d’obscurément tragique.
Nous nous mîmes donc à dîner à la lueur d’un certain nombre de bougies cependant qu’elle restait dehors, accroupie, à regarder dans le noir comme si sa mauvaise humeur s’alimentait de l’air alourdi de parfums qu’on respirait dans cet admirable jardin.
Avant de prendre congé, je prévins Jacobus que je viendrais le lendemain savoir s’il y avait du nouveau au sujet des sacs. Il hocha légèrement la tête.
— « Je vais hanter votre maison chaque jour jusqu’à ce que vous ayez abouti. Vous n’allez pas cesser de me trouver ici. »
Il esquissa un vague et mélancolique sourire qui ne disjoignit même pas ses grosses lèvres.
— « Fort bien, capitaine. »
Puis m’accompagnant jusqu’à la porte, il murmura avec une gravité paisible cette recommandation : « Faites absolument comme chez vous. » Et il ajouta qu’il y aurait toujours « une assiette de soupe ». Ce ne fut qu’une fois arrivé au quai, après avoir traversé les rues mal éclairées, que je me rappelai que j’avais été invité à dîner ce même soir dans la famille S… Quoique assez ennuyé de cet oubli (je ne savais pas trop comment je m’excuserais) je ne pouvais m’empêcher de penser que j’y avais gagné une soirée plus divertissante. Et puis, les affaires, ces sacrées affaires !
Dans un nègre pieds-nus qui me dépassa en courant et dégringola les marches de l’escalier je reconnus l’homme du canot de Jacobus qui avait dû dîner à la cuisine. Et lorsque j’escaladai mon échelle son habituel « Bonsoi missi » eut un accent plus cordial qu’auparavant.
Je tins parole à Jacobus. Je hantai sa maison. Il me trouvait régulièrement là l’après-midi, lorsqu’il s’échappait un moment du « magasin ». Le son de ma voix, tandis que je parlais à Alice, l’accueillait dès son arrivée : et quand il revenait le soir, pour de bon, il y avait tout à parier qu’il m’entendrait encore parler sous la véranda. Je lui faisais un signe de tête : il s’asseyait doucement et lourdement et assistait avec une sorte d’anxieuse approbation à mes efforts pour faire sourire sa fille.
Je l’appelais souvent « Alice » devant lui : quelquefois je l’appelais Mademoiselle Ça m’est égal et je m’épuisais à parler à tort et à travers, sans jamais réussir à la faire se départir de cette attitude maussade et tragique. Il y avait des moments où j’avais bien envie de l’envoyer à tous les diables et de l’agonir de sottises. Et je crois bien que si je l’eus fait, Jacobus n’eut même pas remué le petit doigt. Une sorte d’entente obscure et intime semblait s’être faite entre nous.
Je dois dire que la jeune fille traitait son père exactement comme moi.
Et comment aurait-il pu en être autrement ? Elle me traitait comme elle traitait son père. Elle n’avait jamais vu aucun visiteur. Elle n’avait aucune idée de la façon dont les gens se comportent. J’appartenais à cette classe inférieure avec laquelle son père faisait des affaires sur le port. Je n’avais aucune importance. Son père non plus. Les seules personnes convenables au monde étaient les gens de l’île, qui ne voulaient pas avoir de rapports avec lui parce qu’il avait fait quelque chose de mal. Ce devait être ainsi que mademoiselle Jacobus lui avait expliqué leur isolement. Car il fallait bien lui dire quelque chose ! Et je suis convaincu que Jacobus avait approuvé cette version. Je dois dire que la vieille femme en usait avec verve. Cela devenait sur ses lèvres une explication universelle, une allusion universelle, un reproche universel.
Un jour Jacobus rentra de bonne heure et me faisant signe de venir le retrouver dans la salle à manger, il s’essuya de front d’un geste las et m’apprit qu’il avait réussi à dénicher un stock de sacs.
— « C’est bien quatorze cents qu’il vous en faut, n’est-ce pas, capitaine ? »
— « Oui, oui ! » — répondis-je avec empressement.
Il ne montrait aucune agitation. Il me parut même plus las que jamais.
— « Eh bien ! capitaine, vous n’avez qu’à dire à vos gens qu’ils peuvent les prendre chez mon frère. »
Comme, à ces mots, je demeurai bouche bée, il ajouta placidement son habituelle formule :
— « Vous trouverez tout en règle, capitaine. »
— « Vous avez parlé de cela à votre frère ? (J’en étais véritablement abasourdi). Et pour moi ? Il doit bien savoir que mon navire est le seul retenu ici par manque de sacs. Comment diable… »
De nouveau il s’essuya le front. Je remarquai qu’il était habillé avec un soin particulier, il portait des vêtements que je ne lui avais jamais vus jusqu’alors. Il évita mon regard.
— « Vous avez entendu raconter, naturellement… C’est vrai !… Lui… moi… Certainement nous… depuis des années… (Sa voix n’était plus qu’un murmure somnolent). J’avais à lui parler de quelque chose, quelque chose que… »
Ce murmure cessa. Il ne devait pas me dire de quoi il était question. Et ça m’était égal. J’avais hâte de transmettre la nouvelle à mes affréteurs, je revins précipitamment vers la véranda pour y prendre mon chapeau.
Ma précipitation fit que la jeune fille tourna lentement les yeux dans ma direction et que même la vieille demoiselle en cessa de tricoter. Je m’arrêtai un moment pour m’écrier :
— « Votre père est un homme étonnant, mademoiselle Ça m’est égal. Voilà ce qu’il est. »
Elle accueillit cette démonstration avec un étonnement méprisant. Jacobus, avec une familiarité inaccoutumée, me saisit par le bras au moment où je traversais en courant la salle à manger et marmotta pesamment l’offre d’« une assiette de soupe » dans la soirée. Je lui répondis distraitement :
— « Hein ? Quoi ? Oh ! merci. Certainement ! Avec plaisir », — et je m’esquivai. Dîner avec lui ? Bien sûr. La plus élémentaire gratitude…
Mais quelques heures plus tard, dans la rue pavée et silencieuse qu’envahissait le crépuscule, je compris que ce n’était pas la simple gratitude qui ramenait mes pas vers cette maison au vieux jardin, où depuis des années aucun autre invité n’avait dîné. La simple gratitude ne vous ronge pas intérieurement de cette façon-là. La faim peut-être ; mais la nourriture de Jacobus ne m’inspirait pas une faim particulière.
Ce soir-là, aussi, la jeune fille refusa de venir à table.
Mon exaspération croissait. La vieille me lançait des regards malicieux.
— « Dites-moi », — fis-je tout à coup à Jacobus, — « mettez un peu de poulet et de la salade sur cette assiette. »
Il obéit sans lever les yeux. J’emportai l’assiette, avec un couteau, une fourchette et une serviette sur la véranda. Le jardin n’était plus qu’une masse confuse de reliefs, comme un cimetière de fleurs envahi par l’obscurité : et, on eût dit, à la voir sur sa chaise, qu’elle se lamentait sur l’extinction de la lumière et de la couleur. Des bouffées de parfum passaient comme les âmes embaumées et vagabondes de cette multitude de fleurs disparues. Je lui parlai d’un ton joyeux, persuasif, tendre : je lui parlai à mi-voix. On aurait dit de loin l’insistance d’un amoureux. Lorsque je m’interrompis pour attendre sa réponse, il n’y eut qu’un profond silence. C’était comme si l’on eût offert de la nourriture à une statue.
— « Je n’ai rien pu avaler à la pensée que vous étiez là à mourir de faim dans l’obscurité. C’est vraiment cruel de se montrer aussi entêtée. Pensez un peu à mes souffrances. »
— « Ça m’est égal ! »
J’avais envie de me livrer à quelque violence, de la secouer, de la battre peut-être.
— « Votre absurde attitude », — lui dis-je, — « fera que je ne reviendrai plus. »
— « Qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse ? »
— « Cela vous fait plaisir ! »
— « Ce n’est pas vrai », grogna-t-elle.
Je laissai tomber ma main sur son épaule et si elle avait eu le moindre mouvement de recul, je crois vraiment que je l’aurais secouée ; mais elle ne fit pas le moindre mouvement et cette immobilité désarma ma colère.
— « Si ! Sans quoi je ne vous trouverais pas tous les jours sur la véranda. Pourquoi êtes-vous ici, alors ? Il y a bien d’autres pièces dans la maison. Vous pourriez rester dans votre chambre, — si vous ne vouliez pas me voir. Mais ça vous fait plaisir. Vous le savez bien. »
Je la sentis frissonner légèrement sous ma main et relâchai mon étreinte comme si cet indice d’animation dans son corps m’eût effrayé. L’air embaumé du jardin nous enveloppait d’une vague chaude comme un soupir voluptueux et parfumé.
— « Allez les retrouver », — murmura-t-elle, d’un ton presque attendri.
En rentrant dans la salle à manger, je vis Jacobus baisser les yeux. Je jetai l’assiette sur la table. Devant cette manifestation de ma mauvaise humeur, il murmura je ne sais quelle excuse, et je me tournai brusquement vers lui comme s’il était responsable vis-à-vis de moi de ces « abominables excentricités », je crois bien que c’est l’expression dont je me servis.
— « Mais je dois dire que c’est surtout mademoiselle Jacobus, ici présente, qui est responsable de ces détestables manières », — ajoutai-je avec hauteur.
Elle répliqua aussitôt de cette façon insolente qui lui était habituelle :
— « Hein ? Et pourquoi ne nous laissez-vous pas tranquilles, mon garçon ? »
Je fus surpris de son audace en présence de Jacobus. Mais comment aurait-il pu l’en empêcher ? Il avait trop besoin d’elle. Il leva un moment un regard lourd et somnolent, puis, de nouveau, baissa les yeux. Elle insista avec autorité :
— « Vous n’avez pas encore fini votre affaire tous les deux ? Si, eh bien ! alors… »
Elle avait toute l’impudence des Jacobus, cette vieille femme. La masse de ses cheveux gris était partagée par une raie sur le côté comme un homme, et elle fit le geste d’y fourrer sa fourchette, comme elle faisait de son aiguille à tricoter, mais elle se retint. Ses petits yeux noirs brillaient de fureur. Avec un air menaçant, je me tournai vers mon hôte assis au bout de la table :
— « Eh bien ! qu’en dites-vous, Jacobus ? Dois-je en conclure que nous n’avons plus qu’à nous séparer pour tout de bon ? »
Je dus attendre un moment. Quand la réponse vint, elle fut assez inattendue, et faite dans un esprit tout autre que ne l’avait été la question.
— « Je crois, pour ma part, que nous devrions faire une affaire avec ces pommes de terre, capitaine. Vous verrez que… »
Je l’interrompis.
— « Je vous ai déjà dit que je ne fais pas d’affaires ! »
Sa large poitrine s’abaissa dans un soupir silencieux.
— « Réfléchissez-y, capitaine », — murmura-t-il, avec une tranquille ténacité.
J’éclatai de rire, en me rappelant comment il s’était cramponné à cette écuyère de cirque, — la profondeur de la passion sous cette placide enveloppe, même des coups de cravache (à ce que disait la légende), n’avaient jamais pu lui donner l’aspect d’une tempête. C’était la passion d’un poisson, si l’on pouvait jamais imaginer un poisson passionné.
Ce soir-là j’éprouvai plus clairement que jamais cette habituelle sensation de malaise que me donnait cette maison mise au ban des gens « convenables ». Je refusai de rester à fumer après dîner et quand je mis ma main dans la paume grasse de Jacobus, je me dis que c’était certainement la dernière fois sous son toit. Je n’en pressai pas moins cordialement son énorme patte. Ne m’avait-il pas tiré d’un mauvais pas ? Aux quelques paroles de remerciement que j’étais tenu de lui adresser et que je lui adressai avec plaisir, il me répondit en pinçant les lèvres dans un mélancolique sourire.
— « Je pense que tout ira bien, capitaine », — soupira-t-il pesamment.
— « Que voulez-vous dire ? » — demandai-je, alarmé. — « Est-ce que votre frère peut encore… »
— « Oh ! non », — me dit-il d’un ton rassurant. — « C’est… C’est un homme de parole, capitaine. »
En m’éloignant de cette porte, et en m’efforçant de croire que c’était la dernière fois, je n’étais pas satisfait de moi-même. Je sentais bien que je n’étais pas absolument sincère en réfléchissant aux motifs qui faisaient agir Jacobus, et naturellement, le lendemain j’y retournai.
Comme nous sommes faibles, déraisonnables et absurdes ! Avec quelle facilité nous nous laissons entraîner, lorsque notre imagination éveillée nous offre l’attrait irritant d’un désir. Je m’intéressais à la jeune fille d’une façon particulière, séduit que j’étais par l’expression de son visage, par ses silences obstinés, ses rares paroles méprisantes : par la moue perpétuelle de ses lèvres closes, les profondeurs sombres de ce regard fixe qui ne se tournait lentement vers moi comme une insolente provocation que pour se détourner le moment d’après avec une exaspérante indifférence.
Il va sans dire que la nouvelle de mon assiduité s’était répandue par la ville. J’avais remarqué un changement dans la façon d’être de mes relations et même dans les saluts des autres capitaines, lorsque je les rencontrais sur le quai ou dans les bureaux où nous appellent nos affaires. Le fondé de pouvoir à tête de vieille fille me traitait avec une expression distante et pointilleuse et ramenait, pour ainsi dire, ses jupes près de lui de peur de se contaminer. Il me semblait que les nègres eux-mêmes sur les quais se retournaient pour me regarder passer : et quant au « Bonsoi, missi » de l’homme du canot de Jacobus, quand il me ramenait à mon bord, il avait un accent familier, confidentiel, comme si nous eussions été de mèche dans quelque fâcheuse aventure.
Je croisai dans la rue mon ami S… l’aîné, et de l’autre trottoir il me fit un salut de la main qu’accompagna un sourire ironique. Le plus jeune frère, celui qu’on avait marié à la vieille mégère, s’autorisant d’une amitié plus ancienne et comme s’il payait une dette de gratitude, prit la liberté de me donner un conseil.
— « Le choix de vos amis vous fait du tort, mon cher », — me dit-il avec une enfantine gravité.
Comme je savais que l’entrevue des frères Jacobus avait suscité de nombreux commentaires d’un bout à l’autre de la Perle sucrée de l’Océan, je voulus savoir ce que l’on me reprochait.
— « J’ai été l’occasion d’une démarche qui peut amener une réconciliation infiniment souhaitable du point de vue des convenances, ne croyez-vous pas ? »
— « Assurément, si cette fille était casée, cela faciliterait certainement… » déclara-t-il d’un air sagace, puis, avec quelque inconséquence, il me donna une légère tape au bas de mon gilet. — « Vieux sacripant ! » — s’écria-t-il d’un ton jovial, — « vous vous préoccupez des convenances. Mais vous feriez mieux de vous occuper de vous, vous savez, avec un personnage comme Jacobus qui n’a pas de réputation à perdre. »
Il avait recouvré toute la gravité d’un citoyen respectable et c’est d’un ton de regret qu’il ajouta :
— « Toutes les femmes, dans notre famille, sont absolument scandalisées. »
Mais, dès alors, j’avais cessé de rendre visite à la famille S… et à la famille D… Les vieilles dames me faisaient de telles figures quand je me montrais, et la multitude des jeunes parentes me recevait avec une si grande variété d’expressions : étonnement, terreur, moquerie (sauf mademoiselle Marie qui me parlait et me regardait avec une douloureuse compassion comme si j’avais été malade) que je n’eus aucune difficulté à cesser de les voir. J’aurais donné toute la société de la ville pour le plaisir d’être assis près de la fille de Jacobus, hargneuse et superbe et à peine vêtue de cette draperie couleur d’ambre qui laissait entrevoir sa gorge. A voir ses mèches en désordre de chaque côté de son visage, on eût dit qu’elle venait de sauter hors de son lit dans la panique d’un incendie.
Elle restait appuyée sur son coude à regarder vaguement devant elle. Pourquoi restait-elle à écouter mon absurde conversation ? Et non seulement cela ; mais pourquoi se poudrait-elle la figure en prévision de mon arrivée ? Il me semblait que c’était là ce qui correspondait pour elle à faire toilette et, dans son désordre, le signe d’un grand effort pour se rendre plus belle.
Mais je pouvais m’être trompé. Il se pouvait bien qu’elle eût l’habitude quotidienne de se poudrer et que sa présence sous la véranda ne fût que le signe d’une indifférence assez complète pour ne prêter aucune attention à ma présence. En tout cas, cela revenait au même pour moi.
J’aimais à contempler la lenteur avec laquelle elle changeait d’attitude, à considérer les poses immobiles que prenaient les gracieuses lignes de son corps, à observer le regard mystérieux de ses splendides yeux noirs, allongés, mi-clos et qui contemplaient le vide. Elle avait l’air d’une créature ensorcelée avec un front de déesse couronné par la magnifique chevelure en désordre d’une bohémienne. Il n’était pas jusqu’à son indifférence qui ne fût séduisante. Je me sentais de plus en plus attaché à elle par le lien d’un irréalisable désir, car j’avais toute ma tête à moi. Et je m’habituais au malaise moral que me communiquait la somnolente attention de Jacobus, tranquille et pourtant si expressive ; comme s’il avait existé un pacte tacite entre nous. Je m’habituais à l’insolence de la vieille femme : « Est-ce que vous n’allez pas nous laisser en paix, mon cher monsieur ? » à ses reproches, à sa gronderie impudente et sinistre. Elle était bien de la famille Jacobus, il n’y avait pas d’erreur.
Une fois loin de la jeune fille, je me traitais de tous les noms. Quelle folie était-ce là ! Je me le demandais. Il me semblait être l’esclave de quelque habitude dépravée. Et je retournais la voir, la tête claire, le cœur assurément libre, sans le moindre sentiment de pitié pour cette fille de paria (elle l’était plus que n’importe quel naufragé sur une île déserte), mais comme séduit par une promesse extraordinaire. On ne pouvait rien imaginer d’aussi peu justifié. Le souvenir du soupir tremblant qu’elle avait poussé lorsque j’avais saisi son épaule d’une main tout en tenant de l’autre cette assiette de poulet suffisait à me faire abandonner toutes mes bonnes résolutions.
Son insultant mutisme avait par moments de quoi vous faire grincer des dents. Lorsqu’elle se décidait à ouvrir la bouche, ce n’était que pour se montrer abominablement désagréable envers l’associé de ce réprouvé qu’était son père, et l’approbation pleine et entière de sa vieille parente lui parvenait sous la forme de petits gloussements insupportables. Sans compter que ces remarques, toujours faites sur le ton du plus parfait mépris, étaient singulièrement dénuées d’intérêt.
Comment aurait-il pu en être autrement ! Cette vieille demoiselle Jacobus, grasse et impudente, dans sa robe grise, ne lui avait jamais enseigné les bonnes manières. Les bonnes manières, je suppose, ne sont pas nécessaires aux parias de naissance. Aucune maison d’éducation n’avait voulu l’accepter comme élève, par égard pour les convenances, j’imagine. Et Jacobus n’avait pas eu les moyens de l’envoyer ailleurs. Comment l’aurait-il pu ? Aux soins de qui ? Où cela ? Il n’avait pas lui-même l’esprit assez aventureux pour songer à aller s’installer ailleurs. Sa passion avait bien pu lui faire parcourir, à la suite d’un cirque, des rivages étranges, mais, une fois la tempête passée, il était revenu sans aucun doute, dans cette ville où, quoiqu’il ne fût plus qu’une épave sociale, il n’en demeurait pas moins un Jacobus, — une des plus vieilles familles de l’île, plus vieille même que les familles françaises. Il avait dû y avoir un Jacobus à la mort du dernier plésiosaure. La jeune fille n’avait rien appris, elle n’avait jamais entendu une conversation générale, elle ne savait rien, elle n’avait entendu parler de rien. Assurément elle savait lire : mais tout ce qu’elle trouvait en fait de lecture c’était les journaux destinés à cette salle des capitaines, au « magasin ». Jacobus avait l’habitude, de temps à autre, de les emporter chez lui, tout maculés et déchirés.
Et l’esprit de la jeune fille n’y pouvait guère saisir que les comptes rendus de la police et les relations des crimes ; elle s’était fait du monde civilisé l’idée d’une suite de meurtres, d’enlèvements, de vols, de rixes et de toutes sortes de violences désespérées. L’Angleterre et la France, Paris et Londres (les deux seules villes dont elle semblait avoir entendu parler) lui paraissaient les abîmes d’abomination, tout dégouttants de sang, et qui faisaient contraste avec sa petite île où de petits larcins étaient le type des délits courants, avec, de temps à autre, un crime plus sensationnel, — et uniquement parmi les coolies qui venaient travailler aux plantations de cannes à sucre ou parmi les nègres de la ville. Mais en Europe ces choses-là se passaient toujours dans une population de blancs où, comme l’affirmait cette impudente aristocrate qu’était la vieille mademoiselle Jacobus, les marins errants, les associés de son précieux papa, étaient les derniers des derniers.
Il était impossible de lui donner le moindre sentiment des proportions. Je suppose qu’elle se figurait que l’Angleterre était de la taille de la Perle de l’Océan, que le sang y fumait d’un bout à l’autre et que ce n’était partout que maisons dévalisées. On ne pouvait arriver à lui faire comprendre que ces horreurs dont elle repaissait son imagination se perdaient dans la masse d’une vie ordonnée, comme des gouttes de sang dans l’océan. Elle dirigeait un moment vers moi le regard incompréhensif de ses longs yeux et elle détournait sans rien dire son visage poudré et méprisant. Elle ne prenait même pas la peine de hausser les épaules.
A cette époque les paquets de journaux apportés par le dernier courrier étaient remplis d’une série de crimes commis dans l’East end de Londres, il y avait eu une histoire sensationnelle d’enlèvement en France et un bel exemple de vol à main armée en Australie. Un après-midi, comme je traversais la salle à manger, j’entendis mademoiselle Jacobus dire d’un ton aigre et avec une acrimonie particulièrement acide : « Je me demande ce que votre cher père peut bien comploter avec cet individu. C’est un genre d’homme à vous enlever et à vous couper la gorge pour vous voler. »
La moitié de la longueur de la véranda séparait leurs deux chaises. Je sortis de la pièce et vins avec fureur m’asseoir entre elles.
— « Oui, c’est ce que nous faisons des jeunes filles en Europe », — me mis-je à déclarer du ton le plus tranquille.
Mademoiselle Jacobus fut, je croîs, assez déconcertée par ma soudaine apparition. Je me tournai vers elle avec une froide férocité :
— « Quant aux vieilles femmes désagréables, on les étrangle d’abord tranquillement, puis on les coupe en petits morceaux qu’on disperse, un morceau ici, un morceau là. Ils disparaissent… »
Je n’irai pas jusqu’à dire que je réussis à la terrifier. Mais elle fut troublée par ma truculence, d’autant plus que je lui avais toujours parlé avec une politesse qu’elle ne méritait pas. Ses mains grasses occupées à tricoter tombèrent lentement sur ses genoux. Elle n’ouvrit pas la bouche tandis que je la regardais fixement avec une sévère détermination. Puis comme, en fin de compte, je détournai le regard, elle posa doucement son ouvrage et, sans le moindre bruit, battit en retraite. En fait, elle disparut.
Mais je ne pensai pas à elle. Je regardais la jeune fille. C’est pour cela que je venais chaque jour : troublé, honteux, avide, trouvant dans ma présence à ses côtés une sensation unique que je savourais avec terreur, avec un certain mépris de moi-même et un plaisir profond, comme s’il se fût agi d’un vice secret qui ne devait finir qu’avec moi, comme l’habitude de quelque drogue qui ruine et qui dégrade celui qui y est asservi.
Je la contemplais, depuis le sommet de sa tête ébouriffée en suivant la ligne gracieuse de l’épaule, la courbe de la hanche, la forme drapée de la longue jambe, jusqu’à sa mince cheville qui émergeait d’un volant sale et déchiré, jusqu’à la pointe d’une mule bleue à haut talon, toute éculée, ballante à son joli pied qui s’agitait légèrement, avec des mouvements vifs et nerveux, comme si ma présence l’eût impatientée. Et dans le parfum de ces massifs de fleurs il me semblait respirer son charme spécial et inexplicable, le parfum entêtant de la captive éternellement irritée de ce jardin.
Je contemplais son menton arrondi, — le menton des Jacobus, — les lèvres charnues et rouges, et boudeuses dans ce visage poudré, le ferme modelé de la joue, les grains blancs dans les sourcils sombres : les longs yeux, mince éclat d’un blanc liquide et d’un noir intense et immobile, avec leur regard si vide de pensée, et si absorbé dans leur fixité qu’elle semblait contempler sa propre image solitaire dans quelque miroir lointain que les arbres dérobaient à ma vue.
Et soudain, sans me regarder, avec l’air d’une personne qui se parle à elle-même, elle me demanda, de cette voix légèrement à la fois rauque et douce et toujours irritée :
— « Pourquoi continuez-vous à venir ici ? »
— « Pourquoi je continue à venir ici ? » — répétai-je, pris de court.
Je n’aurais pas pu le lui dire. Je n’aurais même pas pu me dire à moi-même avec sincérité ce que je venais faire.
— « A quoi sert de me poser une question pareille ? »
— « Rien ne sert à rien », — déclara-t-elle d’un ton méprisant à l’espace vide, le menton dans la main, cette main qu’elle n’avait jamais tendue à aucun homme, que personne n’avait jamais serrée, — car je n’avais touché son épaule qu’une fois, — cette main généreuse, fine et un peu masculine. Je connaissais parfaitement la forme particulièrement adroite, — large à la base, effilée aux doigts, — de cette main à laquelle le monde n’offrait aucune prise. Je fis semblant de plaisanter.
— « Non ! Mais réellement ça vous intéresse de le savoir ? »
Elle haussa indolemment ses magnifiques épaules dont la draperie mince glissa légèrement.
— « Oh ! Ça m’est égal, ça m’est égal ! »
Quelque chose couvait, sous ces airs de lassitude. Elle m’exaspérait par cette provocante nonchalance, par quelque chose d’évasif et une sorte de défi dans sa forme même que je cherchais à saisir. Je lui dis brusquement :
— « Pourquoi ? Vous croyez donc que je vais vous dire la vérité ? »
Elle me lança un long regard de côté et elle murmura, en remuant ses lèvres boudeuses :
— « Je pense que vous n’oseriez pas. »
— « Vous vous imaginez que j’ai peur de vous ? Par exemple… Oui, c’est possible, après tout, que je ne sache pas exactement ce que je viens faire ici. Disons, avec mademoiselle Jacobus, que ce n’est pour rien de bon. Vous semblez croire les choses affreuses qu’elle dit, quoique vous vous disputiez toutes deux de temps à autre. »
Elle s’écria avec vivacité :
— « A qui d’autre puis-je me fier ? »
— « Je ne sais pas », — me vis-je forcé d’avouer, en découvrant soudain à quelle impuissance et à quelle solitude morale elle était condamnée par le verdict d’une respectable communauté. — « Vous pouvez vous fier à moi, si vous voulez. »
Elle fit un léger mouvement et me demanda aussitôt, en faisant un effort comme si elle tentait une expérience :
— « Quelle sorte d’affaire y a-t-il entre vous et papa ? »
— « Vous ne savez pas la nature des affaires de votre père ? Allons donc !… Il vend des fournitures pour les navires. »
Elle prit sa pose rigide, toujours blottie dans le fauteuil :
— « Ce n’est pas cela. Qu’est-ce qui vous fait venir ici, dans cette maison ? »
— « Et en supposant que ce soit vous ? Vous n’appelleriez pas cela une affaire ? N’est-ce pas ? Parlons d’autre chose. A quoi bon ? Mon navire est prêt à appareiller après-demain. »
Je l’entendis murmurer distinctement et avec une sorte d’effroi le mot « déjà », et, se levant brusquement, elle alla vers la petite table et se versa un verre d’eau. Elle avait marché à pas rapides et en balançant indolemment tout son jeune corps et ses hanches ; lorsqu’elle passa près de moi j’éprouvai, avec une force décuplée, le charme de cette sensation particulière et prometteuse que j’avais pris l’habitude de rechercher près d’elle. Je pensai avec une soudaine épouvante que c’en était fini ; qu’un jour encore et je ne viendrais plus sous cette véranda, m’asseoir sur cette chaise et savourer avec une sorte de perversité le mépris qui se dégageait de ses attitudes indolentes, m’abreuver à ses regards à la fois provocants et dédaigneux et écouter les remarques brusques et insolentes qu’elle faisait d’une voix rauque et séduisante. Comme si ma nature intime avait subi l’action de quelque poison moral, j’éprouvai une abjecte terreur de reprendre la mer.
Il me fallut exercer sur moi un contrôle soudain, comme on freine, pour m’empêcher de faire un bond, de marcher à grandes enjambées, de crier, de gesticuler, de lui faire une scène. Et pourquoi ? A quel sujet ? Je n’en avais pas la moindre idée. J’avais simplement envie de soulager ma violence ; je me renversai dans mon fauteuil, en essayant de laisser paraître un sourire sur mes lèvres ; ce sourire à demi indulgent, à demi ironique qui me servait de bouclier contre les traits de son mépris et les sorties insolentes de la vieille demoiselle.
Elle but cette eau d’un trait, avec l’avidité d’une soif dévorante, et se laissa tomber sur la chaise la plus proche, comme si elle eût été absolument accablée. Son attitude, comme certaines intonations de sa voix, avait quelque chose de masculin : les genoux écartés sous l’ample draperie, les mains jointes et pendantes, le corps penché en avant, la tête basse. Je contemplai la lourde masse noire de ses cheveux emmêlés. Elle était énorme, et couronnait de toute sa gloire écrasante et désordonnée sa tête penchée. Des mèches échappées tombaient toutes droites. Et soudain je vis que la jeune fille tremblait de la tête aux pieds, comme si ce verre d’eau froide l’avait glacée jusqu’aux os.
— « Qu’y a-t-il ? » — lui dis-je, effrayé, mais sans manifester aucune sympathie.
Elle secoua sa tête courbée et accablée et s’écria, d’une voix étouffée, mais avec une inflexion montante :
— « Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! »
Je me levai et m’approchai d’elle avec une étrange anxiété. Mon regard tomba sur son cou rond et robuste, puis je me baissai suffisamment pour parvenir à entrevoir son visage. Et je commençai à trembler un peu moi-même.
— « Que diable avez-vous à perdre la tête à ce point, « Mademoiselle ça m’est égal ? »
Elle se rejeta violemment en arrière, la tête renversée sur le dossier du fauteuil. Et maintenant c’était sa gorge lisse, ronde, palpitante qui s’offrait à mon regard embarrassé. Ses yeux étaient presque fermés et ne laissaient voir au-dessous des paupières qu’une horrible lueur blanche, comme si elle eût été morte.
— « Qu’est-ce qui vous arrive ? » — lui demandai-je avec effroi, — « qu’est-ce qui vous fait peur à ce point ? »
Elle se reprit, gardant les yeux étonnamment grands ouverts. L’après-midi tropical allongeait les ombres sur la terre chaude et lasse, séjour d’obscurs désirs, d’extravagants espoirs et d’inimaginables terreurs.
— « Ça m’est égal ! »
Puis, après avoir repris haleine, elle parla avec une si extraordinaire rapidité que c’est à peine si je pus distinguer ces mots surprenants :
— « Car si vous m’enfermiez dans un endroit désert, aussi uni que la paume de ma main, je pourrais encore m’étrangler avec mes cheveux. »
Un moment, n’en croyant pas mes oreilles, je laissai pénétrer en moi cette inconcevable déclaration. Il n’est guère possible de deviner les pensées insensées qui traversent l’esprit d’autrui. Quelles monstrueuses idées de violence pouvaient bien habiter sous le front bas de cette jeune fille qui avait appris à considérer son père comme un homme « capable de tout », et à y voir plutôt une infortune qu’une honte ; une chose évidemment qu’on devait craindre bien plutôt qu’on ne devait en rougir ; la honte, à vrai dire, lui semblait aussi étrangère que quoi que ce fût au monde, mais son ignorance prêtait à son ressentiment et à sa crainte une forme enfantine et violente.
Elle parlait assurément sans savoir la valeur des mots. Que pouvait-elle savoir de la mort, elle qui ne savait rien de la vie ! C’était simplement en me prouvant que quelque odieuse appréhension la mettait hors d’elle-même, que cet extraordinaire discours m’avait touché, m’avait fait éprouver non pas de la pitié, mais un étonnement fasciné, horrifié. Je n’imaginais pas quelle notion elle avait du danger qu’elle pouvait courir. Un enlèvement peut-être. C’était tout à fait possible, étant donné le genre de conversation de cette horrible vieille femme. Peut-être pensait-elle qu’on pouvait l’emporter, pieds et poings liés, bâillonnée même. A ce soupçon, je me sentis comme si la porte d’un four s’était ouverte devant moi.
— « Ma parole ! » — m’écriai-je — « vous finirez par devenir folle, si vous écoutez ce que votre abominable vieille tante… »
J’observai son expression hagarde, ses lèvres tremblantes. Ses joues semblaient s’être affaissées. Mais comment moi, l’associé de ce père discrédité, moi, « le dernier des derniers » de cette criminelle Europe, pouvais-je bien parvenir à la rassurer, je n’en avais pas la moindre idée. Elle était exaspérante.
— « Dieu du Ciel ! De quoi me croyez-vous donc capable ? »
— « Je ne sais pas. »
Son menton tremblait certainement et elle me regardait avec une extrême attention. Je me rapprochai de son fauteuil.
— « Je ne vous ferai rien. Je vous le promets. Cela vous suffit-il ? Comprenez-vous ? Je ne ferai rien du tout, entendez-vous ? Et après-demain je serai parti. »
Qu’aurais-je pu lui dire d’autre ? Elle sembla boire mes paroles avec l’avidité assoiffée avec laquelle elle avait vidé le verre d’eau, et elle murmura d’une voix tremblante, avec cette émouvante intonation que j’avais entendue une fois déjà sur ses lèvres et qui me fit tressaillir de la même émotion :
— « Je vous crois. Mais, et papa… »
— « Qu’il aille au diable ! » Mon émotion se trahit par mon intonation brutale : — « J’en ai assez de votre papa ! Etes-vous assez stupide pour vous imaginer qu’il me fait peur ? Il ne peut pas me faire faire n’importe quoi ! »
Tout cela me paraissait bien faible au prix de son ignorance. Mais je dois reconnaître que « l’accent de la sincérité » a, comme l’on dit, une puissance réellement irrésistible. L’effet passa mes espérances, et même ma conception. A voir le changement qui se produisit chez la jeune fille, on eût cru assister à un miracle, — la détente graduelle mais rapide de son regard tendu, de ses muscles raidis, de chaque fibre de son corps. Ce regard noir et fixe dans lequel j’avais, plus d’une fois, lu une expression tragique, auquel j’avais trouvé une sombre séduction, était maintenant parfaitement vide, vide de toute espèce de conscience et semblait n’avoir plus même le sentiment de ma présence : il était devenu un peu somnolent, à la façon des Jacobus.
Mais comme l’homme est un animal pervers, au lieu de me réjouir de mon complet succès, je le considérai avec des yeux ébahis et indignés. Ce changement évident avait quelque chose de cynique, la véritable impudence des Jacobus. J’avais l’impression de m’être laissé rouler dans une affaire assez compliquée où j’étais entré contre mon gré. Oui, roulé sans le moindre égard pour les formes les plus élémentaires de la décence.
D’un mouvement aisé et indolent, et d’une indolence souple et féline, elle se leva de son fauteuil avec une indifférence si provocante à mon égard que, de rage, je ne bougeai pas de l’endroit où je me trouvais, à moins d’un pas d’elle. Tranquille et sans hâte, avec l’aisance d’une personne qui est seule dans une pièce, elle étira ses bras magnifiques, les poings serrés, tout le corps tendu, la tête un peu rejetée en arrière, s’abandonnant dédaigneusement à ce sentiment de soulagement, rendant leur liberté à ses membres après tous ces moments passés dans des attitudes accroupies et immobiles, lorsqu’elle était à la fois si furieuse et si effrayée.
Et tout cela avec une suprême indifférence, incroyable, offensante, exaspérante, comme le serait l’ingratitude doublée d’une trahison.
J’aurais dû peut-être en être flatté ; mais, au contraire, ma colère s’en accrut ; et le mouvement qu’elle fit pour passer près de moi comme si je n’eusse été qu’un poteau ou un meuble, ce mouvement indifférent la fit éclater.
Je ne dirai pas que je ne savais pas ce que je faisais, mais, certainement, la froide réflexion n’eut rien à voir avec le fait qu’un moment plus tard j’avais mes deux bras passés autour de sa taille. Ce fut un acte impulsif, comme on s’accroche à quelque chose qui tombe où qui vous échappe ; il n’avait aucune hypocrite gentillesse. Elle n’eut pas le temps de prononcer un mot et le premier baiser que je lui plantai sur les lèvres était si furieux que ç’aurait pu être une morsure.
Elle ne résista pas, et il va sans dire que je ne me contentai pas d’un seul. Elle me laissa faire, non pas comme si elle eût été inanimée, — je la sentais tout près de moi, jeune, pleine de vigueur et de vie, créature robuste et désirable, — mais comme si elle ne s’en fût pas souciée le moins du monde, tant elle était absolument sûre de ce que je pouvais faire ou ne pas faire.
Avec nos visages rapprochés l’un de l’autre dans cette tempête de caresses données au hasard, ses larges yeux noirs grands ouverts plongeaient dans les miens sans qu’elle parût éprouver ni colère, ni plaisir, ni la moindre émotion. Dans ce ferme regard qui semblait contempler impersonnellement ma folie, je pus découvrir une légère surprise peut-être, — mais rien de plus. Je couvrais son visage de baisers et il semblait n’y avoir pas de raisons pour que cela ne durât pas toujours.
Cette pensée me traversa l’esprit et j’étais sur le point de m’interrompre lorsque, tout à coup, elle se mit à se débattre avec une violence soudaine qui la libéra presque, qui raviva mon exaspération contre elle et m’inspira un désir furieux de ne plus jamais la lâcher. Je resserrai mon étreinte juste à temps en murmurant : « Non, vous ne vous en irez pas », comme s’il se fût agi de mon ennemi mortel. De son côté, elle ne prononça pas une parole. Les mains sur ma poitrine, elle poussait de toutes ses forces sans réussir à rompre le cercle de mes bras. Si ce n’est qu’elle paraissait maintenant parfaitement éveillée, ses yeux ne me révélaient rien. Rencontrer son regard noir et fixe, c’était regarder dans un puits profond et je fus pris complètement à l’improviste par son changement de tactique. Au lieu d’essayer de séparer mes mains, elle se colla contre moi et avec un mouvement onduleux, comme celui d’un serpent, elle se baissa, plongea rapidement et m’échappa doucement. Tout cela fut fait en un clin d’œil ; je la vis ramasser le bout de sa draperie et courir sans grâce à la porte de la véranda. Elle semblait boiter un peu, — puis elle disparut ; la porte se referma derrière elle si doucement que je ne pus pas croire qu’elle était complètement fermée. J’avais un soupçon que son œil noir, à l’entre-bâillement de la porte, observait ce que j’allais faire. Je ne pouvais décider si je devais montrer le poing dans cette direction ou bien envoyer un baiser.
L’un ou l’autre eût parfaitement correspondu à mes sentiments. Je considérai la porte, indécis, mais en fin de compte, je ne fis ni l’un ni l’autre. L’avertissement d’un sixième sens, — le sens de la culpabilité peut-être, ce sens qui agit toujours trop tard, hélas ! — me fit regarder autour de moi ; et je compris immédiatement que ce tumultueux épisode pouvait se terminer d’une façon assez déplorablement animée. J’aperçus Jacobus debout, à la porte de la salle à manger. Depuis combien de temps y était-il, il était impossible de le deviner ; et en me rappelant la lutte que j’avais dû soutenir contre la jeune fille, je pensai qu’il avait dû en être, d’un bout à l’autre, le témoin muet. Mais cette supposition semblait presque incroyable. Peut-être cette impénétrable jeune fille l’avait-elle entendu arriver et s’était-elle enfuie à temps.
Il s’avança sur la véranda, de son allure habituelle, les yeux lourds, les lèvres collées. La ressemblance de la jeune fille et de cet homme me surprenait… Ces longs yeux égyptiens, ce front bas de déesse stupide, elle les avait trouvés dans la sciure du cirque ; mais tout le reste, le dessin et le modelé du visage, le menton arrondi, les lèvres mêmes, tout cela c’était Jacobus, un Jacobus affiné, achevé, plus expressif.
Sa grosse main s’abattit sur une chaise légère (il y en avait là plusieurs) dont il saisit avec force le dossier et j’entrevis que tout cela pouvait très bien finir par une tête cassée. Ma mortification était extrême. Le scandale serait affreux : c’était inévitable. Mais comment agir pour me satisfaire moi-même, je n’en savais rien. Je me tenais sur mes gardes, et à tout hasard, lui fis face. Il n’y avait rien d’autre à faire. J’étais certain d’une chose, c’était que si effrontée que pût être mon attitude elle n’égalerait jamais la caractéristique impudence de Jacobus.
Il me fit son même sourire mélancolique et englué, et s’assit. Je m’en sentis soulagé. La perspective de passer des baisers aux coups n’avait rien de particulièrement attrayant en soi. Peut-être, — peut-être n’avait-il rien vu ? Il avait son air habituel, mais il ne m’avait jusqu’alors jamais trouvé seul sur la véranda. S’il y avait fait allusion, s’il m’avait demandé : « Où est Alice ? » ou quelque chose de ce genre, j’aurais pu juger de son intonation. Il ne m’en donnait pas l’occasion. La seule particularité qui me frappa, c’était qu’il n’avait pas encore levé les yeux vers moi. « Il sait », me dis-je avec conviction. Et le mépris que je ressentais pour lui soulagea le dégoût que j’avais de moi-même.
— « Vous rentrez de bonne heure », — remarquai-je.
— « Les affaires sont très calmes : on n’a rien fait au magasin aujourd’hui », m’expliqua-t-il d’un air abattu.
— « Dites-moi, vous savez, je pars », — lui dis-je, avec le sentiment que c’était peut-être la meilleure chose à faire.
— « Oui », — murmura-t-il. — « Après-demain. »
Ce n’était pas ce que je voulais dire ; mais comme il persistait à regarder par terre, je suivis la direction de son regard. Dans le silence absolu de la maison, nous restâmes les yeux fixés sur la mule que la jeune fille avait perdue dans sa fuite. Nous la regardions. Elle était là, le talon en l’air.
Au bout d’un moment qui me parut très long, Jacobus pencha sa chaise en avant, se baissa le bras étendu et ramassa l’objet. Cela avait l’air d’une chose bien fragile dans ses grosses et grasses mains. Ce n’était pas vraiment une pantoufle, mais une mule bleue en chevreau glacé, en assez mauvais état. Elle avait une barrette qui s’attachait sur le cou-de-pied, mais la jeune fille se contentait d’entrer les pieds sans l’attacher, de sa façon nonchalante. Jacobus releva les yeux, du soulier jusqu’à moi.
— « Asseyez-vous, capitaine », — dit-il enfin à mi-voix.
Comme si la vue de la mule eût renouvelé pour moi ce sortilège, je renonçai soudain à l’idée de quitter la maison séance tenante. C’était devenu impossible. Je m’assis, sans cesser de fixer cet objet fascinant. Jacobus tournait et retournait le soulier de sa fille dans sa grosse patte comme s’il étudiait la façon dont la chose était faite ; puis tout en regardant à l’intérieur, d’un air absorbé :
— « Je suis ravi de vous avoir trouvé ici, capitaine », — me dit-il.
Je répondis par une sorte de grognement, en le regardant à la dérobée. Puis j’ajoutai :
— « Vous ne me verrez plus longtemps maintenant. »
Il restait toujours plongé dans l’intérieur de ce soulier sur lequel mes regards demeuraient également fixés.
— « Avez-vous repensé à cette affaire de pommes de terre dont je vous ai parlé l’autre jour ? »
— « Non, pas le moins du monde », répondis-je sèchement. D’un geste grave de commandement de la main qui tenait ce soulier fatal, il arrêta le mouvement que je faisais pour me lever. Je restai assis et le regardai fixement.
— « Vous savez bien que je ne fais pas d’affaires. »
— « Il le faut, capitaine. Il le faut. »
Je me mis à réfléchir. Si je quittais cette maison maintenant, je ne reverrais plus la jeune fille. Et j’avais l’impression qu’il me fallait la revoir une fois encore, ne fût-ce qu’un instant. C’était un besoin, irraisonné, irrésistible. Non, je ne voulais pas m’en aller. Je voulais rester pour éprouver une fois encore cette étrange et provocante sensation, ce désir vague dont l’habitude m’avait fait, — moi, était-ce possible ? — appréhender de reprendre la mer.
— « Monsieur Jacobus », — articulai-je lentement, — « estimez-vous réellement que, tout compte fait, tout bien considéré, — je dis : tout, vous comprenez bien ? — ce serait une chose profitable pour moi que de faire des affaires, par exemple, avec vous ? »
J’attendis un moment. Il continua à regarder le soulier qu’il serrait maintenant par le milieu, la pointe éculée et le haut talon dépassant de chaque côté son poing pesant.
— « Ce sera pour le mieux », — dit-il en me regardant enfin bien en face.
— « En êtes-vous sûr ? »
— « Vous trouverez tout parfaitement en règle, capitaine. »
Il avait prononcé ses phrases habituelles, de sa voix placide et contenue comme toujours, et il soutenait mon regard inquisiteur avec ce même air somnolent, sans même cligner des yeux.
— « Eh bien ! alors, faisons une affaire », — lui dis-je en lui tournant le dos. — « Je vois que vous y tenez. »
Je ne désirais aucunement un scandale, mais je trouvais que les convenances extérieures s’achètent parfois trop cher ; j’englobais Jacobus, moi-même et toute la population de l’île dans le même dégoût, comme si nous avions été associés dans une ignoble transaction. Et le souvenir de la vision que j’avais eue en mer, cette vision diaphane et bleue de la Perle de l’Océan à soixante milles de là ; cette claire et impalpable merveille évoquée, semblait-il, par l’art de quelque pure magie me devenait également un objet d’horreur. Était-ce là cette fortune que cette vaporeuse et exceptionnelle apparition recélait pour moi dans son cœur insensible, sous l’apparence d’un beau rêve et de la brume ? Était-ce donc là ma chance ?
— « Je crois », — entendis-je soudain Jacobus dire, après ce qui me parut le silence d’une abjecte méditation. — « Je crois que vous pourriez très bien en prendre trente tonnes. C’est à peu près ce qu’il y en a. »
— « Vraiment ? C’est ce qu’il y en a ! Je veux bien croire que ce serait très bien, mais je n’ai pas assez d’argent pour cela. »
Je ne l’avais jamais vu si agité.
— « Non ! » — s’écria-t-il avec ce que je pris pour l’accent d’une sardonique menace. — « Quel dommage ! » — Il s’arrêta, puis, inexorable : — « Combien avez-vous, capitaine ? » — me demanda-t-il avec une terrible franchise.
Ce fut à moi de le regarder bien en face. Et, ce faisant, je lui indiquai la somme dont je pouvais disposer. Je vis qu’il était déçu. Il réfléchit assez longtemps, le regard perdu dans un calcul, avant de revenir à lui et de me faire, d’un ton pensif, cette proposition rapace :
— « Vous pourriez tirer un peu plus sur vos affréteurs… Ce serait sûrement facile, capitaine. »
— « Non, je ne le pourrais pas », — répliquai-je brusquement, — « j’ai touché ma solde jusqu’à aujourd’hui, et, d’ailleurs, les comptes du navire sont arrêtés. »
Je me sentais devenir furieux.
— « Et je vais vous dire », — repris-je, — « même si je le pouvais je ne le ferais pas. » Et perdant alors toute mesure, j’ajoutai :
— « Vous êtes un petit peu trop Jacobus, monsieur Jacobus. »
Le ton par lui-même était suffisamment insultant, mais il ne se départit pas de son calme ; il eut seulement l’air un peu embarrassé, jusqu’à ce que quelque chose semblât être venu l’éclairer, mais cette lueur inaccoutumée dans ses yeux se dissipa instantanément. En tant que Jacobus, et sur son sol natal, ce qu’un simple capitaine pouvait bien dire ne pouvait le toucher, lui le paria. En tant qu’approvisionneur il pouvait tout supporter. Tout ce que je pus distinguer dans son marmonnement, ce fut un vague « tout à fait correct », encore que rien au fond ne pût être plus insignement faux, — à mon point de vue, du moins. Mais je me rappelais (je ne l’avais pas oublié), qu’il fallait que je visse la jeune fille. Je ne voulais pas m’en aller. Je voulais rester dans la maison jusqu’à ce que je l’eusse vue encore une fois.
— « Écoutez ! » — lui dis-je pour finir. — « Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais prendre autant de vos sacrées pommes de terre que je peux en acheter avec mon argent, à condition que vous irez immédiatement au hangar les faire charger sur le chaland et les envoyer directement le long de mon bord. Prenez avec vous la facture et un reçu signé. Voici la clef de mon bureau. Donnez-la à Burns. Il vous réglera. »
Il se leva de sa chaise avant même que j’eusse fini de parler, mais il refusa de prendre la clef. Burns n’y consentirait jamais. Lui-même ne tenait pas à la lui demander.
— « Eh bien, alors », — lui dis-je, en le regardant d’un air méprisant, — « il n’y a rien d’autre à faire, monsieur Jacobus, que d’aller m’attendre à bord jusqu’à ce que je vienne régler la chose avec vous. »
— « Parfaitement, capitaine. J’y vais immédiatement. »
Il semblait ne savoir que faire du soulier de la jeune fille qu’il tenait toujours dans son poing. A la fin, tout en me jetant un regard triste, il le posa sur la chaise qu’il venait de quitter.
— « Et vous, capitaine ? Vous ne venez pas aussi, juste pour voir… »
— « Ne vous occupez pas de moi. Je m’arrangerai bien. »
Il resta un moment perplexe, comme s’il essayait de comprendre, puis il articula pesamment : « Certainement, certainement, capitaine », ce qui semblait le résultat d’une pensée soudaine. Sa large poitrine se souleva. Était-ce un soupir ? En sortant pour aller activer le chargement de ses pommes de terre, il ne se retourna pas vers moi.
J’attendis que le bruit de ses pas, dans la salle à manger, se fût dissipé ; j’attendis même encore un peu. Alors me retournant vers la porte éloignée, je criai à travers la véranda :
— « Alice ! »
Rien ne me répondit, pas le moindre bruit derrière la porte. On eût dit que la maison de Jacobus était déserte. Je n’appelai pas de nouveau. J’éprouvai tout à coup un grand découragement. Je me sentais l’esprit exténué, le moral abattu. Je me retournai vers le jardin et m’accoudant à la balustrade basse, je me pris la tête dans les mains.
Le soir se refermait sur moi. Les ombres s’allongeaient, s’approfondissaient, se fondaient en un lac de pénombre où les plates-bandes étincelaient comme des cendres chaudes ; il m’arrivait des bouffées d’un lourd parfum, comme si le crépuscule de cet hémisphère eût été le demi-jour d’un temple, et le jardin, un énorme encensoir balancé devant l’autel des étoiles. Les couleurs se faisaient plus sombres, perdaient leur éclat une à une.
Un très léger bruit me fit tourner la tête, et je vis la jeune fille, grande et svelte, s’avancer en boitillant, d’un mouvement flottant et inégal, jusqu’à ce que sa forme confuse disparût dans le fauteuil bas et profond. Et je ne sais pourquoi ni comment j’eus l’impression qu’elle venait trop tard. Elle aurait dû apparaître lorsque je l’avais appelée. Elle aurait dû… On eût dit que nous avions manqué une occasion suprême.
Je me levai et vins m’asseoir près d’elle, presque en face de son fauteuil. D’une voix toujours maussade, elle m’interpella aussitôt :
— « Vous êtes encore ici. »
Et moi, d’une voix grave :
— « Vous voilà enfin revenue. »
— « Je suis venue chercher mon soulier, avant qu’on apporte les lumières. »
C’était ce même murmure rauque, séduisant, contenu, mal assuré, mais le tremblement de cette voix grave ne me communiquait plus aucun tressaillement. Je distinguais seulement l’ovale de son visage, sa gorge découverte, l’éclair blanc et allongé de ses yeux. Elle était vraiment mystérieuse. Ses mains reposaient sur les bras du fauteuil. Mais qu’était devenue cette sensation étrange et provocante qui ressemblait au parfum de sa jeunesse en fleur ?
— « J’ai votre soulier », — lui dis-je tranquillement. Elle ne répondit rien et je repris : — « Vous feriez mieux de me donner votre pied pour que je vous le mette. »
Elle ne fit aucun mouvement. Je me baissai et en tâtonnant cherchai son pied sous le volant de la draperie. Elle ne le retira pas et je lui mis ce soulier, attachant la barrette. C’était un pied inerte. Je le reposai doucement par terre.
— « Si vous boutonniez la barrette, vous ne perdriez pas votre soulier, mademoiselle « Ça-m’est-égal », — lui dis-je en essayant de plaisanter. J’avais plutôt envie de déplorer l’illusion perdue d’un vague désir, la conviction soudaine de ne pouvoir jamais retrouver près d’elle cette sensation étrange, à la fois mauvaise et tendre, qui avait communiqué son âcre senteur à tant de jours, qui avait donné à cette jeune fille un aspect tragique et prometteur, pitoyable et provocant. Tout cela avait disparu.
— « C’est votre père qui l’a ramassé », — lui dis-je, pensant qu’il valait mieux qu’elle le sût.
— « Je n’ai pas peur de papa, — tout seul », — déclara-t-elle dédaigneusement.
— « Ah ! C’est seulement lorsqu’il est avec ses déplorables complices, ces étrangers, « la lie de l’Europe », comme dit votre charmante tante ou grand’tante, des gens comme moi, par exemple, que vous… »
— « Je n’ai pas peur de vous », — me lança-t-elle.
— « C’est parce que vous ne savez pas que maintenant je fais des affaires avec votre père. Oui, je fais, en somme, exactement ce qu’il veut. Je n’ai pas tenu la promesse que je vous avais faite, voilà le genre d’homme que je suis. Et maintenant, — vous n’avez pas peur ? Si vous croyez ce que cette excellente vieille dame, aimable et sincère veut bien vous dire, vous devriez avoir peur. »
Ce fut d’une voix qui modula avec une douceur inattendue, qu’elle affirma :
— « Non. Je n’ai pas peur. » — Elle hésita… — « Pas maintenant. »
— « Vous avez raison. C’est tout à fait inutile. Je ne vous reverrai pas avant de prendre la mer. » — Je me levai et restai près de son fauteuil. — « Mais je vous reverrai souvent dans ce vieux jardin, je vous verrai passer sous ces arbres là-bas, entre ces magnifiques plates-bandes. Vous devez aimer ce jardin… »
— « Je n’aime rien. »
J’entendis vibrer dans son intonation maussade un faible écho de cette note tragique qui m’avait paru si provocante. Mais il me laissa insensible car j’avais la conviction soudaine et accablante du néant absolu de toutes choses sous le ciel.
— « Adieu, Alice », — lui dis-je.
Elle ne répondit pas, elle ne bougea pas. Me contenter de lui prendre la main, de la serrer, et de m’en aller me semblait impossible, presque inconvenant. Je me baissai lentement et pressai mes lèvres contre son front lisse. Ce fut alors que je compris clairement, avec une sorte de terreur, le complet détachement où j’étais de cette créature infortunée. Et comme je m’abandonnais à cette cruelle révélation, je sentis le léger toucher de ses bras qui tombaient languissamment sur mon cou et je reçus un baiser rapide, maladroit, qui manqua mes lèvres. Non ! Elle n’avait pas peur ; mais je n’étais plus ému. Ses bras glissèrent lentement de mon cou, elle ne prononça pas une parole, le fauteuil d’osier craqua légèrement ; seul, le sentiment de ma dignité m’empêcha de fuir tête baissée cette abominable révélation.
Je traversai lentement la salle à manger. Elle écoute le bruit de mes pas, pensais-je, elle ne peut pas faire autrement ; elle va m’entendre ouvrir et fermer cette porte. Et je la refermai derrière moi aussi doucement que si j’eusse été un voleur emportant son butin mal acquis. Pendant cet acte furtif, j’éprouvai ma dernière émotion dans cette maison, à la pensée d’avoir laissé cette jeune fille là, dans l’obscurité, avec sa lourde chevelure et ses yeux vides, sombres comme la nuit, le regard fixe, dans ce jardin entouré de murs, silencieux et chaud, odorant du parfum des fleurs prisonnières qui disparaissaient, comme elle, dans un monde envahi par les ténèbres.
Les rues campagnardes, étroites et mal éclairées, qui m’étaient familières et qui menaient au port, étaient extrêmement tranquilles. Je sentais dans mon cœur que plus l’on s’aventure, mieux l’on comprend combien tout dans notre vie est banal, bref et vide ; que c’est en cherchant l’inconnu dans nos sensations que nous découvrons combien nos tentatives sont médiocres et combien vite elles sont déçues ! L’homme du canot de Jacobus attendait à l’escalier du quai avec un air d’empressement inaccoutumé. Il accosta mon bord, mais ne m’adressa pas son habituel « Bonsoi missi » et au lieu de pousser immédiatement, il resta près de l’échelle.
J’étais à cent lieues de penser à des questions commerciales, lorsque dans la pénombre du pont arrière, M. Burns se précipita positivement sur moi, dans un tel état d’agitation qu’il en bégayait. Il avait arpenté le pont comme un fou pendant des heures, en attendant mon retour. Juste avant le coucher du soleil un chaland chargé de pommes de terre était venu se ranger le long du bord, avec ce gros approvisionneur lui-même, juché sur le haut de la pile des sacs. Il était maintenant installé au carré. Qu’est-ce que tout cela pouvait bien vouloir dire ? Sûrement je n’avais pas…
— « Si, monsieur Burns », — lui dis-je en l’interrompant.
Il commençait à faire des gestes de désespoir : j’y mis bon ordre en lui donnant la clef de mon bureau et en le priant, sur un ton qui n’admettait pas de réplique, de descendre, de payer la note de M. Jacobus et de le renvoyer.
— « Je ne veux pas le voir », — déclarai-je nettement, en montant l’échelle de la dunette.
Je me sentais extrêmement las. En me laissant tomber sur le siège de la claire-voie je regardai machinalement les lumières du quai et la masse noire de la montagne au sud du port. Je n’entendis même pas Jacobus quitter mon bord en emportant dans sa poche jusqu’à la dernière pièce de mon argent liquide. Je n’entendis rien jusqu’à ce qu’à la fin M. Burns, incapable de se contenir davantage, vînt m’assassiner de ses lamentations aigres et ridicules sur ma faiblesse et mon extrême bienveillance.
— « Assurément il y a plus de place qu’il n’en faut dans la cale arrière, mais il est certain que ça va pourrir là-dedans. Vraiment, je n’ai jamais entendu… dix-sept tonnes ! Je suppose que je dois faire charger cela demain matin à la première heure. »
— « Je suppose que c’est ce que vous avez à faire. A moins que vous ne vouliez les jeter par-dessus bord. Mais je crains que vous ne le puissiez pas. Ça me serait fort égal, mais il est défendu de jeter des détritus dans le port, vous savez. »
— « C’est certainement ce que vous avez dit de plus exact depuis longtemps, capitaine : des détritus. C’est exactement ce que je pense que c’est. Près de quatre-vingts bons souverains d’or disparus ; votre tiroir nettoyé de fond en comble, capitaine. Du diable si je comprends. »
Comme il était impossible de jeter une lumière véritable sur cette transaction commerciale, j’abandonnai Burns à ses lamentations et à l’impression que j’étais un incurable imbécile. Le lendemain je n’allai pas à terre. Pour une excellente raison. Je n’avais pas d’argent pour aller à terre, — non, pas même de quoi acheter une cigarette. Jacobus avait tout raflé. Mais ce n’était pas la seule raison. La Perle de l’Océan m’était, en quelques heures, devenue odieuse. Et je ne désirais rencontrer personne. Ma réputation avait eu à souffrir. Je me savais l’objet de commentaires peu charitables et sarcastiques.
Le lendemain matin à la pointe du jour, juste comme nous avions largué nos amarres de l’arrière et que le remorqueur nous déhalait d’entre les bouées, j’aperçus Jacobus debout dans son canot. Le nègre tirait de toutes ses forces ; plusieurs paniers de provisions pour les navires étaient arrimés entre les bancs. Le père d’Alice faisait sa tournée matinale. Sa contenance était tranquille et amicale. Il éleva le bras et cria quelque chose avec une grande cordialité. Mais il avait une de ces voix qui ne portent pas ; tout ce que je pus vaguement entendre ou plutôt deviner, ce furent les mots « la prochaine fois » et « tout à fait en règle » ; et c’est uniquement de ces derniers mots que je fus certain. Je levai le bras à regret pour toute réponse, et je me détournai. Cette familiarité m’était, en somme, assez désagréable. N’avais-je pas réglé mes comptes une fois pour toutes avec lui au prix de cette affaire de pommes de terre ?
Comme je ne veux rapporter ici qu’une aventure arrivée dans un port, je ne parlerai pas de notre voyage. Je fus assez satisfait de me retrouver à la mer, mais sans éprouver le contentement des vieux jours. Jusque-là, je n’avais pas eu de souvenir à emporter avec moi, je partageais l’heureuse insouciance des marins, cette insouciance naturelle et invincible qui ressemble à l’innocence, dans la mesure où elle interdit de s’examiner soi-même. Maintenant, malgré tout, je me souvenais de cette jeune fille. Pendant les tout premiers jours je ne cessai de m’interroger sur la nature des faits et des sensations qui se rattachaient à sa personne et à ma conduite.
Et je dois dire aussi que les embarras intolérables que fit M. Burns avec ses pommes de terre ne furent pas de nature à me faire oublier le rôle que j’avais joué. Il n’y voyait qu’une transaction purement commerciale, d’un genre particulièrement absurde, et son dévouement, — en admettant que ce fût du dévouement et non pas de la simple malveillance, comme j’en arrivai à le considérer bientôt, — lui inspira un zèle extrême à réduire ma perte autant que cela se pouvait. Oh, oui ! il prit furieusement soin de ces abominables pommes de terre.
Interminablement on vit un palan au-dessus de l’écoutille arrière, et interminablement le quart sur le pont fut occupé à retirer, étaler, ramasser, remettre en sacs, et réarrimer une partie de ce lot de pommes de terre. Mon affaire ainsi que ses associations les plus lointaines, aussi bien mentales que visuelles, ce jardin en fleurs et embaumé, la jeune fille avec son mépris provocant et la tragique solitude de cette créature abandonnée sans espoir, dansèrent interminablement devant mes yeux, pendant des milliers de milles à la mer. Et par le raffinement d’une ironie satanique, cela s’accompagnait d’une odeur affreuse. Des bouffées de pommes de terre pourries me poursuivaient sur la dunette ; elles se mêlaient à mes pensées, à ma nourriture, elles empoisonnaient jusqu’à mes rêves, elles formaient au navire une atmosphère de corruption.
Je reprochai à M. Burns le soin excessif qu’il en prenait. J’aurais volontiers fait condamner le panneau et les aurais laissées pourrir sous le pont.
Cela n’eût peut-être pas été sans inconvénient. Ces horribles émanations auraient pu imprégner le chargement de sucre. Elles semblaient capables d’imprégner jusqu’aux ferrures. En outre, M. Burns en fit une question personnelle. Il m’assura qu’il savait comment s’y prendre avec un chargement de pommes de terre à la mer, — il avait été dans le métier depuis l’enfance, disait-il. Il voulait diminuer ma perte dans la mesure du possible. Pris entre son dévouement, — ce devait être du dévouement, — et sa vanité, je n’osai positivement pas lui donner l’ordre de jeter par-dessus bord mon entreprise commerciale. Je crois qu’il aurait bel et bien refusé d’obéir à mon ordre légitime ; il eût pu s’ensuivre une situation comique et sans précédent, que je ne me sentais pas capable de supporter. Je bénis la venue du mauvais temps comme jamais marin ne l’a fait. Lorsque enfin je mis en panne pour embarquer le pilote devant la pointe de Port-Philippe, le panneau arrière n’avait pas été ouvert depuis plus d’une semaine et j’aurais volontiers cru qu’il n’y avait jamais eu à bord quelque chose qui ressemblât à une pomme de terre.
C’était par un jour abominablement gris et balayé de grandes rafales de vent et de pluie ; le pilote, un garçon jovial, bavardait tout en manœuvrant ; il ruisselait de la tête aux pieds et plus l’averse fouettait, plus il semblait satisfait de lui-même et de ce qui l’entourait. Il frottait ses mains ruisselantes avec une satisfaction, qui, étant donné que je venais d’endurer cela pendant des jours et des nuits, me semblait inconcevable chez une créature non aquatique.
— « Vous avez l’air d’aimer être trempé, pilote », — lui dis-je.
Il avait un lopin de terre autour de sa maison dans la banlieue et c’était à son jardin qu’il pensait. Au mot « jardin », que je n’avais pas entendu prononcer depuis bien des jours, j’entrevis des couleurs éclatantes, des fleurs aux parfums délicats, la silhouette d’une jeune fille blottie dans un fauteuil. Oui, c’était une émotion précise qui venait rompre la paix que j’avais trouvée dans l’inquiétude constante de mes responsabilités pendant les dangers d’une semaine de gros temps. La colonie, m’expliqua le pilote, avait souffert d’une sécheresse sans précédent. C’était la première goutte d’eau qu’ils avaient eue depuis sept mois ; les récoltes étaient perdues. Et, sans avoir l’air d’y toucher, mais avec un visible intérêt, il me demanda si, par hasard, je ne pourrais pas disposer de quelques pommes de terre.
Des pommes de terre ! J’avais fait en sorte de les oublier. Je me sentis en un instant plongé jusqu’au cou dans la corruption. M. Burns me faisait des signes dans le dos du pilote.
Finalement, il en obtint une tonne qu’il paya dix livres. C’était le double de ce que j’en avais donné à Jacobus. L’esprit de lucre s’éveilla en moi. Ce soir même, avant d’aller me coucher, je vis la chaloupe de la Douane accoster. Tandis que ses subalternes posaient les scellés sur les soutes à provisions, l’officier de service me prit à part, confidentiellement :
— « Dites-moi, capitaine, vous n’auriez pas par hasard des pommes de terre à vendre ? »
Il y avait, de toute évidence, disette de pommes de terre dans le pays. Je lui en fis donner une tonne pour douze livres et il partit enchanté. Je vis en rêve cette nuit-là un monceau d’or en forme de tombeau sous lequel était ensevelie une jeune femme et je m’éveillai, le cœur endurci par la rapacité. Comme je rendais visite à mon courtier maritime, celui-ci, une fois nos affaires réglées, remonta ses lunettes sur son front et me dit :
— « Je me demandais, capitaine, si, venant de la Perle de l’Océan, vous n’auriez pas par hasard des pommes de terre à vendre. »
Je lui répondis négligemment : — « Oh ! si, je pourrais en disposer d’une tonne. Quinze livres. »
Il se récria ; mais après avoir étudié un moment mon visage, il accepta mes conditions, non sans faire une légère grimace. Ces gens semblaient ne pouvoir vivre sans pommes de terre. Ce n’était pas comme moi. Je ne voulais revoir une pomme de terre de toute ma vie ; mais le démon du lucre s’était emparé de moi. Comment la nouvelle se répandit-elle, je n’en sais rien ; mais, en regagnant mon bord, assez tard, je trouvai un petit groupe de gens à allure de marchands de primeurs près du pont-milieu, tandis que M. Burns arpentait fièrement le gaillard d’arrière, tout en jetant sur eux des regards triomphants. Ils étaient venus pour acheter des pommes de terre.
— « Ces gens-là ont attendu en plein soleil depuis des heures », — me glissa Burns fort agité. — « Ils ont mis à sec le baril d’eau douce. Ne gâchez pas votre chance, capitaine. Vous êtes trop généreux. »
Je jetai mon dévolu sur un homme aux grosses jambes et sur un autre qui avait l’œil poché, afin de négocier avec eux : simplement parce qu’ils étaient plus faciles à distinguer du reste.
— « Vous avez l’argent sur vous ? » — demandai-je, avant de les emmener dans ma cabine.
— « Oui, capitaine », — me répondirent-ils d’une seule voix, en tapotant leurs poches. Leur air de tranquille détermination n’était pas pour me déplaire. Bien avant la fin de la journée, toutes les pommes de terre étaient vendues à environ le triple du prix que je les avais payées. M. Burns, enfiévré, exultant, se félicitait du soin judicieux qu’il avait pris de mon entreprise commerciale, mais il insinuait assez clairement que j’aurais pu en tirer davantage. Cette nuit-là je ne dormis pas très bien. Je pensai à Jacobus, par à-coups, entre des rêves où l’on voyait des parias en proie à la famine sur une île déserte couverte de fleurs. Ce fut extrêmement désagréable. Au matin, assez las, peu dispos, je me mis à écrire une longue lettre à mes armateurs, pour leur exposer un plan soigneusement étudié qui consistait à employer le navire en Extrême-Orient et dans les mers de Chine pendant les deux années suivantes. J’y passai la journée et je me sentis plus en paix, une fois que je l’eus terminé.
Leur réponse me parvint sans retard. Mon projet les avait beaucoup intéressés : mais, considérant qu’en dépit de la fâcheuse difficulté qui s’était présentée au sujet des sacs, (et contre laquelle ils pensaient que je pourrais me prémunir à l’avenir) le voyage avait laissé un bénéfice très convenable, ils croyaient qu’il valait mieux continuer à affecter le navire au commerce de sucre, — du moins pour le moment. Je tournai la page et lus ce qui suit :
Nous avons reçu une lettre de notre bon ami M. Jacobus. Nous sommes heureux de voir que vous avez pu vous entendre avec lui : car, sans parler de l’aide qu’il vous a donnée dans cette malencontreuse affaire de sacs, il nous écrit qu’au cas où, en vous hâtant, vous pourriez amener le navire de bonne heure dans la saison, il serait disposé à vous donner un bon taux de fret. Nous ne doutons pas que vos efforts, etc…, etc…
Je laissai tomber la lettre et demeurai quelque temps immobile. Puis j’écrivis ma réponse (qui était courte) et j’allai à terre pour la mettre moi-même à la poste. Mais je passai devant une boîte aux lettres, puis une autre, si bien qu’à la fin je me trouvai montant Collins Street, avec la lettre toujours dans ma poche, contre mon cœur. Collins Street, à quatre heures de l’après-midi, n’est pas précisément un désert ; mais je ne m’étais jamais senti plus isolé du reste de l’humanité qu’en arpentant ce jour-là cette rue encombrée, tandis que je luttais désespérément avec mes pensées et que je me sentais déjà vaincu.
Il vint un moment où la terrible ténacité de Jacobus, l’homme d’une seule passion et d’une seule idée, me sembla presque héroïque. Il ne m’avait pas abandonné. Il était allé revoir son odieux frère. Et puis il me parut odieux lui-même. Était-ce dans son propre intérêt, ou dans celui de la pauvre fille ? Et à cette dernière supposition, le souvenir du baiser qui avait manqué mes lèvres m’épouvanta ; car quoi qu’il eût vu, ou deviné, ou risqué, il ne devait rien en savoir. A moins que sa fille ne le lui eût dit. Comment pourrais-je retourner là-bas ranimer de mon souffle froid cette fatale étincelle ? Non, non, ce baiser inattendu devait se payer à son prix.
A la première boîte que je rencontrai, je m’arrêtai et, plongeant dans la poche intérieure de ma veste, j’en tirai la lettre, — c’était vraiment comme si je m’arrachais le cœur, — et je la laissai tomber dans l’ouverture de la boîte. Je revins alors directement à bord.
Je me demandais quelle sorte de rêves je pourrais faire pendant la nuit ; mais en fait, je ne pus fermer l’œil. Au petit déjeuner, j’informai M. Burns que j’avais résigné mon commandement. Il en laissa tomber sa fourchette et son couteau.
— « Est-ce possible, capitaine ! Moi qui pensais que vous aimiez le navire. »
— « En effet, Burns », — lui dis-je. — « Mais le fait est que l’océan Indien et tout ce qui s’y trouve a perdu son charme pour moi. Je rentre en Europe comme passager par le canal de Suez. »
— « Tout ce qui s’y trouve », — répéta-t-il d’un air furieux. — « Je n’ai jamais entendu parler de cette façon. Et, à vous dire vrai, capitaine, tout le temps que nous avons été ensemble, je ne vous ai jamais bien compris. Qu’est-ce qu’un océan a de plus qu’un autre ? Du charme ! »
Il m’était réellement dévoué, je crois. Il se consola toutefois quand je lui eus dit que je l’avais recommandé pour prendre ma succession.
— « En tout cas », — remarqua-t-il, — « on dira ce qu’on voudra, ce Jacobus vous a rendu service. Je dois reconnaître que cette affaire de pommes de terre a été extrêmement bonne. Si seulement vous aviez… »
— « Oui, Burns », — l’interrompis-je, — « c’est vraiment un sourire de la fortune. »
Mais je ne pouvais pas lui dire que ce sourire-là me chassait de ce navire que j’avais appris à aimer. Et tandis que je restais là, le cœur gros, à l’idée de cette séparation, devant tous mes plans ruinés, mon modeste avenir compromis, — car ce commandement était comme le pied à l’étrier pour un jeune homme, — il abandonna complètement, pour la première fois, son attitude critique.
— « Une fameuse chance ! » — dit-il.
A ma droite, des rangées de piquets semblaient un mystérieux réseau de palissades de bambou à demi submergées, divisant d’incompréhensible façon le domaine des poissons tropicaux, et donnant par son aspect délabré l’impression d’avoir été à jamais abandonné par quelque tribu nomade de pêcheurs partie désormais à l’autre bout de l’océan, car, à perte de vue, on ne distinguait aucune habitation. A ma gauche, un groupe d’îlots dénudés, pareils à des murailles, des tours, des fortins en ruines, plongeait ses fondations dans une mer bleue qui paraissait solide, tant elle était immobile et stable sur toute son étendue : la traînée de lumière même que projetait le soleil couchant étincelait doucement, sans ce scintillement qui décèle à la surface de l’eau d’imperceptibles rides. Et en tournant la tête pour jeter un dernier coup d’œil au remorqueur qui venait de nous laisser mouillé en dehors de la barre, je vis la ligne droite du rivage plat s’ajuster à la mer immobile, bord à bord, avec une absolue perfection, pour former comme un grand parquet parfaitement uni, à moitié brun, à moitié bleu, sous le dôme énorme du ciel. Faisant pendant au groupe insignifiant des îlots sur la mer, deux petits bouquets d’arbres, de chaque côté de l’unique défaut de cette impeccable jointure, indiquaient l’embouchure du Menam, que nous venions de quitter, à la première étape de notre voyage de retour ; et loin sur la plaine de l’intérieur, masse plus grande et plus haute, le bosquet qui entoure la grande pagode de Paknam était l’unique objet sur lequel le regard pouvait interrompre la vaine exploration de ce monotone horizon. Çà et là des lueurs pareilles à des morceaux d’argent éparpillés marquaient les détours de la grande rivière : et sur le plus rapproché d’entre eux, juste au delà de la barre, le remorqueur, s’enfonçant droit dans l’intérieur, se perdit à ma vue, coque, cheminée, et mâture, comme si l’impassible terre l’avait avalé sans effort, sans secousse. Mon œil suivit son léger nuage de fumée au-dessus de la plaine, selon les méandres paresseux du fleuve, toujours plus faible et plus lointain, jusqu’à ce qu’il se perdît enfin derrière le monticule en forme de mitre de la grande pagode. Alors je me trouvai seul avec mon navire mouillé à l’entrée du golfe de Siam.
Il flottait au point de départ d’un long voyage ; immobile au milieu d’une immense immobilité, l’ombre de sa mâture s’allongeait vers l’est au soleil couchant. J’étais seul alors sur le pont. Aucun bruit ne se faisait entendre à bord, rien ne bougeait autour de nous, rien ne vivait, pas une pirogue sur l’eau, pas un oiseau dans l’air, pas un nuage au ciel. En ce moment où le monde semblait retenir son souffle, on eût dit qu’au seuil d’une longue traversée nous mesurions nos forces pour une longue et pénible entreprise, ayant tous deux à accomplir notre tâche loin de tout regard humain, avec le ciel et la mer pour seuls spectateurs et seuls juges.
Le scintillement de l’air avait dû gêner la vue, car ce fut seulement au moment du coucher du soleil que mon regard errant découvrit, au delà du sommet du principal îlot de ce petit archipel, quelque chose qui vint détruire la solennité de cette parfaite solitude. Le flot des ténèbres déferlait rapidement : et, avec une soudaineté toute tropicale, je vis un essaim d’étoiles surgir au-dessus de la terre assombrie, tandis que je m’attardais encore, la main posée sur la lisse de mon navire comme sur l’épaule d’un ami éprouvé. Mais à sentir cette multitude de corps célestes vous regarder fixement se dissipait pour tout de bon le réconfort d’une paisible communion avec lui. Et en même temps j’entendis des bruits gênants, des voix, des pas ; le steward s’activait sur le pont, esprit organisateur et affairé : une sonnette tinta impétueusement sous la dunette…
Je trouvai mes deux officiers qui m’attendaient près de la table servie, dans le carré éclairé. Nous nous assîmes aussitôt, et tout en servant le second, je lui dis :
— « Savez-vous qu’il y a un navire mouillé dans les îles ? J’ai vu la pointe de ses mâts au-dessus de leur crête au coucher du soleil. »
Il leva vivement son visage simple qu’encombraient des favoris terriblement touffus et se mit à pousser ses exclamations habituelles :
— « Dieu me pardonne ! capitaine. Est-ce possible ? »
Mon lieutenant était un jeune homme aux joues rondes, silencieux, sérieux pour son âge, à ce qu’il me semblait ; mais comme nos regards se croisèrent, je surpris sur ses lèvres un léger tremblement. J’abaissai aussitôt mon regard. Je ne pouvais décemment pas encourager la raillerie à mon bord. Il faut dire aussi que je ne connaissais guère mes officiers. A la suite de certains événements qui n’ont d’intérêt que pour moi, j’avais été désigné à ce commandement une quinzaine seulement auparavant. Je ne connaissais guère mieux le reste de l’équipage. Tous ces gens avaient servi ensemble depuis quelque dix-huit mois, et ainsi j’avais, seul, la situation d’un étranger au bord. Je mentionne ce fait parce qu’il est de quelque importance pour ce qui va suivre. Mais je me sentais surtout étranger au navire, et pour tout dire, quelque peu étranger à moi-même. Étant le plus jeune à bord (à l’exception du lieutenant) et n’ayant pas encore subi l’épreuve d’une situation qui comportât une complète responsabilité, je ne mettais pas en question la capacité des autres. Ils n’avaient qu’à être à la hauteur de leur tâche : mais je me demandais jusqu’à quel point je prouverais ma fidélité à cet idéal de sa propre personnalité que chacun de nous édifie à part soi et pour son propre usage.
Sur ces entrefaites, le second, avec ses yeux ronds et ses effrayants favoris qui paraissaient collaborer à tout ce qu’il disait, se mit à faire toute une théorie sur la présence de ce navire à l’ancre. Le trait dominant de son caractère était de tout prendre en sérieuse considération. Il avait une tournure d’esprit méticuleuse. Ainsi qu’il le disait, il « aimait à se rendre compte » de tout ce qui se présentait à lui, y compris un malheureux scorpion qu’il avait trouvé dans sa chambre une semaine auparavant. Le pourquoi et le comment de ce scorpion, comment il était venu à bord et avait choisi sa chambre plutôt que la cambuse (endroit obscur et qui aurait dû mieux faire l’affaire d’un scorpion), et comment il avait bien pu s’y prendre pour se noyer dans l’encrier de son pupitre, l’avaient tracassé infiniment. La présence du navire dans les îles était beaucoup plus explicable, et juste au moment où nous nous levions de table il se prononça : « C’était, à n’en point douter, un navire récemment arrivé d’Europe. Il avait probablement un trop fort tirant d’eau pour franchir la barre autrement qu’au plein des grandes marées. C’est pourquoi il était entré attendre quelques jours dans ce port naturel, plutôt que de rester dans une rade ouverte. »
— « C’est juste », confirma soudain le lieutenant de sa voix un peu rauque, « il cale plus de vingt pieds. C’est un navire de Liverpool, la Séphora, avec une cargaison de charbon. Cent vingt-trois jours de Cardiff. »
Nous le regardâmes avec étonnement.
— « C’est le patron du remorqueur qui me l’a dit quand il est venu à bord prendre vos lettres, capitaine », expliqua le jeune homme. « Il compte lui faire remonter la rivière après-demain. »
Après nous avoir ainsi accablés de l’étendue de ses connaissances, il s’esquiva du carré. Le second remarqua avec regret qu’il « ne pouvait se rendre compte des manières de ce garçon ». Il se demandait ce qui l’avait empêché de tout nous dire sur-le-champ.
Comme il était sur le point de sortir, je le retins. Les deux derniers jours, l’équipage avait eu beaucoup de travail, et très peu de sommeil la nuit précédente. Je sentis avec ennui que moi, — un étranger, — je faisais là quelque chose d’insolite en donnant l’ordre de faire coucher l’équipage sans avoir établi de quart. Je me proposais de prendre le quart moi-même jusqu’à une heure du matin environ. Je me ferais alors relever par le lieutenant.
— « Il appellera le cuisinier et le steward à quatre heures », ajoutai-je : « on frappera à votre porte plus tard. Bien entendu, au plus léger indice de vent, il faudrait faire monter l’équipage sur le pont pour appareiller immédiatement.
Il dissimula son étonnement :
— « Très bien, capitaine. »
Une fois sorti du carré, il passa sa tête à la porte du lieutenant pour lui faire part de l’incroyable fantaisie que j’avais de prendre sur moi cinq heures de veille. J’entendis l’autre élever la voix sur un ton d’incrédulité : « Comment ? le capitaine lui-même ? » Encore quelques murmures : une porte claqua, puis une autre. Un moment après, je montai sur le pont.
Ce sentiment d’être un étranger, qui m’avait ôté le sommeil m’avait inspiré cette consigne anormale, comme si de ces heures solitaires de la nuit j’eusse attendu la connaissance d’un navire dont je ne savais rien, d’un équipage dont je ne savais guère plus. Amarré à quai, encombré, comme tout navire au port, d’un tas de choses disparates, envahi de gens qui ne lui appartenaient pas, c’est à peine si jusqu’ici je l’avais vraiment vu. Maintenant qu’il était prêt à prendre la mer, toute l’étendue de son pont me paraissait bien belle sous les étoiles. Bien belle, spacieuse pour sa taille, et fort engageante. Je descendis l’échelle de la dunette et me mis à arpenter le passavant, cependant que mon esprit me dépeignait la future traversée de l’archipel Malais, la descente de l’océan Indien, la remontée de l’Atlantique. Toutes les phases de ce voyage m’étaient assez familières, tous ses caractères, toutes les alternatives qui devaient vraisemblablement se présenter à moi en haute mer, — tout… sauf la responsabilité nouvelle du commandement. Mais je me réconfortai en pensant avec raison que ce navire était comme les autres navires, ses hommes comme les autres hommes, et que la mer ne me réservait probablement pas de surprises spéciales expressément créées pour ma déconvenue.
Parvenu à cette conclusion rassurante, l’envie me vint de fumer un cigare et je descendis en chercher un dans ma cabine. En bas tout était silencieux. Tout le monde, sur l’arrière, était profondément endormi. Je ressortis sur le pont-arrière, agréablement à mon aise dans mon pyjama, par cette chaude nuit sans souffle, pieds nus, un cigare allumé aux lèvres, et en m’avançant je me trouvai tête à tête avec le profond silence qui régnait à l’avant du navire. En passant devant le poste d’équipage, je n’entendis que le soupir profond, confiant, d’un dormeur. Et soudain j’éprouvai avec plaisir la grande sécurité de la mer en comparaison des agitations de la terre ; je me félicitai du choix que j’avais fait de cette existence dénuée de tentations, dépourvue de problèmes troublants et à laquelle l’absolue franchise de ses exigences et la simplicité de son but confère une beauté morale essentielle.
Le feu de mouillage dans le gréement brûlait d’une flamme nette, paisible et comme symbolique, confiante et claire dans l’ombre mystérieuse de la nuit. Poursuivant mon chemin en passant de l’autre bord du navire, je remarquai que l’échelle de pilote, mise en dehors sans aucun doute pour le patron du remorqueur quand il était venu chercher nos lettres, n’avait pas été rentrée comme elle aurait dû l’être. Cela me contraria, car la ponctualité dans les détails est l’âme même de la discipline. Je réfléchis alors que j’avais moi-même péremptoirement exempté de service mes officiers et, de ma propre initiative, empêché de régler le quart au mouillage comme d’habitude. Je me demandai s’il était sage de jamais intervenir dans la routine des services, fût-ce avec la meilleure intention du monde. Cette décision risquait de me faire paraître bizarre. Dieu seul sait de quelle manière ce second aux absurdes favoris « se rendrait compte » de ma conduite, et ce que le navire tout entier penserait de cette irrégularité de la part de son nouveau capitaine. J’en ressentis un peu d’irritation contre moi-même.
Non pas par remords assurément, mais machinalement pour ainsi dire, je me mis à rentrer l’échelle moi-même. Une échelle de corde de cette sorte est une chose légère qu’on rentre facilement, mais l’effort vigoureux que je fis et qui aurait dû l’amener main sur main ne me causa qu’un choc en retour tout à fait inattendu. Que diable était-ce ? Je fus tellement abasourdi de la lourdeur de l’échelle que j’en demeurai immobile, essayant de « me rendre compte », comme si j’eusse été cet idiot de second. A la fin, naturellement, je mis la tête en dehors.
Le flanc du navire mettait une bande d’ombre opaque sur la faible lueur de la mer vitreuse. Mais je distinguai tout de suite quelque chose d’allongé et de pâle qui flottait contre l’échelle. Avant même que j’eusse pu former une conjecture, un léger éclair phosphorescent qui sembla émaner soudain du corps nu d’un homme passa sur l’eau endormie, comme se joue, fugitif et silencieux, un éclair d’été dans un ciel nocturne. La révélation d’une paire de pieds, de longues jambes, d’un large dos livide, immergé jusqu’au cou dans une lueur verdâtre, cadavérique, me coupa la respiration. Une main, à fleur d’eau, demeurait accrochée au dernier barreau de l’échelle. Je le voyais complet, moins la tête. Un cadavre décapité ! Le cigare tomba de ma bouche béante, avec un léger « floc » et un court crépitement parfaitement perceptible dans ce silence absolu de toutes choses sous les cieux. C’est cela, je suppose, qui lui fit lever la tête, ovale terne et pâle dans l’ombre du flanc du navire. Mais alors même, c’est tout au plus si je pouvais distinguer la forme de sa tête aux cheveux noirs. C’en fut assez toutefois pour dissiper la sensation horrible, qui m’avait glacé le cœur. Le moment des vaines exclamations était passé lui aussi. Je grimpai sur le mât de rechange et me penchai par-dessus bord autant que je le pus, pour rapprocher mes yeux de ce mystère flottant.
Accroché à l’échelle, ainsi qu’un nageur au repos, le scintillement de la mer jouait autour de ses membres à chaque mouvement, et il y apparaissait glabre, argenté, semblable à un poisson. Il demeurait également aussi muet qu’un poisson. Il n’essayait pas non plus de sortir de l’eau. Il était inconcevable qu’il ne tentât pas de monter à bord, et étrangement troublant de soupçonner qu’il n’en avait peut-être pas envie. Mes premières paroles me furent précisément dictées par cette incertitude.
— « Qu’y a-t-il ? » demandai-je de mon ton habituel en me penchant vers ce visage qui faisait exactement face au mien.
— « Une crampe ! », répondit-il, du même ton. Puis, avec une légère anxiété :
« Dites-moi, c’est inutile d’appeler quelqu’un. »
— « Je n’en avais pas l’intention », lui répondis-je.
— « Êtes-vous seul sur le pont ? »
— « Oui. »
J’eus vaguement l’impression qu’il était sur le point de lâcher l’échelle pour s’éloigner à la nage aussi mystérieusement qu’il était venu. Mais, pour le moment, cet être qui semblait avoir surgi du fond de la mer (c’était assurément la terre la plus proche du navire) s’inquiéta seulement de savoir l’heure. Je la lui dis. Et, là-dessus, il risqua cette question :
— « Votre capitaine est couché, je suppose ? »
— « Je suis sûr que non », lui répondis-je.
Il parut faire effort sur lui-même, car j’entendis quelque chose comme le sourd, l’amer murmure du doute : « A quoi bon ? » Les paroles qui suivirent furent prononcées avec une certaine hésitation :
— « Dites-moi, mon garçon. Pourriez-vous lui demander de venir sans déranger personne ? »
Je pensai qu’il était temps de me faire connaître.
— « C’est moi, le capitaine. »
J’entendis un « Par exemple ! » chuchoté au ras de l’eau. Des remous phosphorescents étincelaient tout autour de ses membres ; de son autre main il saisit l’échelle.
— « Je m’appelle Leggatt. »
La voix était calme, résolue. Une bonne voix. Le sang-froid de cet homme s’était, pour ainsi dire, répandu en moi-même. Ce fut très posément que je fis cette remarque :
— « Vous devez être bon nageur. »
— « Oui. Je suis à l’eau, en somme, depuis neuf heures. La question pour moi maintenant est de savoir si je vais lâcher cette échelle et continuer à nager jusqu’à ce que je coule d’épuisement, ou bien… si je vais monter ici. »
Je sentis que ce n’était pas là une vulgaire expression de désespoir, mais l’alternative réelle qui s’offrait à une âme forte. J’aurais pu en déduire qu’il était jeune : car, en vérité, il n’y a que les jeunes gens pour avoir à envisager des situations aussi nettes. Mais à ce moment-là ce fut pure intuition de ma part. Un mystérieux courant s’était déjà établi entre nous deux, en face de cette mer tropicale, silencieuse et sombre. J’étais jeune, moi aussi ; assez jeune pour ne pas me perdre en commentaires. L’homme se mit soudain à grimper à l’échelle, et je m’éloignai rapidement du bastingage pour aller lui chercher un vêtement.
Avant d’entrer dans le carré, je m’arrêtai dans le couloir au pied de la descente pour prêter l’oreille. Un faible ronflement me parvint à travers la porte close de la chambre de mon second. La porte du lieutenant était au crochet, mais l’obscurité au dedans était absolument muette. Lui aussi il était jeune et dormait comme une souche. Restait le steward, mais vraisemblablement il ne se réveillerait pas avant qu’on l’appelât. Je rapportai un pyjama de ma chambre, et une fois revenu sur le pont, je vis l’homme nu de la mer assis sur le grand panneau, faible lueur blanche dans l’obscurité, les coudes aux genoux, et la tête dans les mains. Il eut vite fait de couvrir son corps mouillé d’un pyjama, du même modèle à rayure grise que celui que je portais, et il me suivit comme mon double sur la dunette.
— « Qu’est-ce qui est arrivé ? » demandai-je d’une voix étouffée, en prenant une des lampes allumées de l’habitacle et en l’élevant à la hauteur de son visage.
— « Une vilaine affaire. »
Il avait des traits assez réguliers, une bouche bien formée ; des yeux clairs sous des sourcils foncés, assez épais : un front carré et uni, des joues imberbes, une petite moustache brune et un menton rond bien modelé. Son expression concentrée, méditative, à la clarté de la lampe que je lui projetai dans la figure, était celle que pourrait avoir un homme qui réfléchit profondément, dans une parfaite solitude. Mon pyjama était juste à sa taille. Un garçon bien planté de vingt-cinq ans tout au plus. Du bout de ses dents blanches et régulières, il se mordit la lèvre inférieure.
— « Eh bien ! » dis-je, en remettant la lampe dans l’habitacle.
La chaude, la lourde nuit tropicale se referma de nouveau sur sa tête.
— « Il y a un navire là-bas », murmura-t-il.
— « Oui, je sais. La Séphora. Vous saviez que nous étions ici ? »
— « Pas la moindre idée. Je suis son second. » Il se reprit : « Je devrais dire : j’étais. »
— « Ah ! quelque difficulté ? »
— « Oui. Une difficulté, dites-vous ? J’ai tué un homme. »
— « Que voulez-vous dire ? Maintenant ? »
— « Non, pendant la traversée. Il y a des semaines, par 39° sud. Quand je dis un homme… »
— « Un accès de colère ? » insinuai-je, confidentiellement.
La tête sombre, brune, comme la mienne, parut se secouer imperceptiblement au-dessus du gris fantomal de mon pyjama. Il me semblait, dans la nuit, me trouver en face de ma propre image reflétée dans les profondeurs d’un sombre et immense miroir.
— « Jolie histoire pour un ancien élève de Conway », murmura mon double, distinctement.
— « Vous avez été à Conway ? »
— « Oui », dit-il avec une sorte de saisissement. Puis lentement : « Vous aussi, peut-être ? »
C’était le cas ; mais étant plus âgé de deux ans, j’avais quitté l’école avant son arrivée. Après un rapide échange de dates, un silence tomba, et je pensai soudain à mon absurde second aux terrifiants favoris et à son genre d’esprit, à ses « Dieu me pardonne, est-ce possible ? » Mon double me fournit un aperçu de ses pensées en disant :
— « Mon père est pasteur dans le Norfolk. Vous me voyez devant un juge et des jurés sous cette accusation ? Pour moi, je n’en vois pas la nécessité. Il y a des gens qu’un ange venu du ciel… Et je ne suis pas de ceux-là. C’était une de ces créatures qui sont tout le temps à remâcher une sotte espèce de méchanceté. De pauvres diables qui ne devraient même pas être au monde. Il ne voulait pas faire sa besogne et empêchait les autres de faire la leur. Mais à quoi bon parler de tout cela ! Vous connaissez aussi bien que moi cette espèce de mauvaise gale. »
Il en appelait à moi comme si nos expériences eussent été aussi identiques que nos vêtements. Et je savais assez bien, en effet, le danger que représentent des natures de ce genre contre lesquelles on n’a à la mer aucun moyen de répression légale. Et je savais aussi très bien que mon double, en face de moi, n’était pas une brute homicide. Je ne pensais même pas à lui demander des détails, et il me raconta l’histoire en phrases brusques, décousues. Il ne m’en fallait pas davantage. Je vis tout cela se passer comme si je me trouvais à l’intérieur de cet autre pyjama.
— « C’est arrivé pendant que nous établissions une misaine, à la nuit tombante. Avec des ris. Vous voyez d’ici le temps qu’il faisait. La seule voile qui nous restait pour tenir le bâtiment en route. Ainsi vous pouvez juger à quoi cela avait ressemblé pendant des jours. Manœuvre difficile. C’est à l’écoute qu’il se mit à me faire des histoires. J’étais à bout de nerfs avec ce temps terrifiant qui semblait ne devoir jamais finir. Terrifiant, je vous assure, et un navire lourdement chargé. Je crois bien que le type lui-même était à moitié fou de trac. Ce n’était pas précisément le moment des reproches polis, je me suis retourné et je l’ai assommé comme un bœuf. Le voilà qui se relève et vient sur moi. Nous nous étreignons au moment où une lame effroyable s’amenait sur le navire. Tous les hommes la virent venir et se réfugièrent dans les haubans, mais je le tenais à la gorge et je me mis à le secouer comme un rat : les autres, au-dessus, hurlaient : « Attention ! attention ! » Et puis un craquement comme si le ciel m’était tombé sur la tête. Il paraît que, pendant plus de dix minutes, il fut presque impossible de distinguer de notre navire autre chose que les trois mâts, un peu du gaillard d’avant et de la dunette à fleur d’eau, courant désespérément dans une nappe d’écume. Ce fut par miracle qu’on nous retrouva collés ensemble derrière les bittes d’avant. Il paraît que je ne plaisantais pas, car je le tenais encore à la gorge quand on nous ramassa. Il avait la figure toute noire. Ça leur fit perdre complètement la tête. Ils nous traînèrent à l’arrière ensemble agrippés comme nous l’étions, en criant : « Au meurtre ! » comme un tas de fous, et ils se précipitèrent dans le carré. Et le navire fuyait devant le temps, sans cesse à deux doigts de couler : chaque minute la dernière de sa vie, sur une mer à vous faire blanchir les cheveux rien qu’à la regarder. Il paraît que le capitaine aussi s’est mis à délirer comme le reste. Cet homme n’avait pas fermé l’œil pendant plus d’une semaine, et de voir cela lui tomber sur le dos au plus fort d’un furieux coup de vent l’avait mis hors de lui. Je m’étonne qu’ils ne m’aient pas jeté par-dessus bord après m’avoir arraché des doigts la carcasse de leur précieux camarade. Ils eurent, m’a-t-on dit, du mal à nous séparer. Histoire suffisamment féroce pour faire lever les bras au ciel à un vieux juge et à un respectable jury. La première chose que j’ai entendue quand je suis revenu à moi, ç’a été le hurlement affolant de cet interminable ouragan, et par là-dessus la voix du capitaine qui, accroché au bord de ma couchette, écarquillant les yeux du fond de son suroit, me disait :
— « Monsieur Leggatt, vous avez tué un homme ! Vous ne pouvez plus remplir les fonctions de second à bord de ce navire. »
Le soin qu’il prenait de maîtriser sa voix lui donnait une intonation monotone. Il s’arcbouta d’une main sur le bord de la claire-voie, et durant tout ce temps ne fit pas le moindre mouvement, autant que je pus m’en rendre compte.
— « Charmante histoire pour un five o’clock ! » conclut-il du même ton.
L’une de mes mains aussi s’appuyait sur la claire-voie ; moi non plus je ne fis pas le moindre mouvement, autant que je pus m’en rendre compte. Nous étions à moins d’un pas l’un de l’autre. Il me vint à l’idée que si par hasard le vieux « Dieu me pardonne, est-ce possible ! » passait la tête par le capot de sa chambre et nous apercevait, il croirait voir double, ou s’imaginerait tomber dans une scène de sorcellerie ; l’étrange capitaine en conciliabule, près de la barre, avec son propre fantôme gris. Je songeai à empêcher à tout prix que rien de pareil n’arrivât. J’entendis l’autre qui répétait à mi-voix :
— « Mon père est pasteur d’une paroisse dans le Norfolk. »
Évidemment il avait oublié qu’il m’avait déjà fait part de ce fait important. En vérité, une charmante histoire !
— « Vous feriez mieux de vous faufiler dans ma cabine à présent », lui dis-je.
J’avançai avec précaution. Mon double suivit mes mouvements ; nos pieds nus ne faisaient aucun bruit ; je le fis entrer, fermai la porte avec soin, et, après avoir appelé le lieutenant, je remontai sur le pont attendre ma relève.
— « Pas grand signe de vent encore », lui fis-je remarquer quand il s’approcha.
— « Non, capitaine. En effet », acquiesça-t-il, d’un air endormi, et d’une voix rauque, avec tout juste assez de déférence, sans plus, et en réprimant à peine un bâillement.
— « Bon. C’est tout ce à quoi vous avez à veiller. Vous avec reçu vos instructions. »
— « Oui, capitaine. »
Je fis un tour ou deux sur la dunette et avant de descendre je le vis s’installer face à l’avant, le coude passé dans les enfléchures des haubans d’artimon. En bas le faible ronflement du second continuait paisiblement. La lampe du carré brûlait au-dessus de la table sur laquelle était posé un vase de fleurs, une aimable attention du fournisseur, les dernières fleurs que nous verrions pendant les trois mois, — au grand minimum, — qui allaient suivre. Deux régimes de bananes se balançaient symétriquement au plafond de chaque côté de l’entourage du gouvernail. Rien ne semblait changé à bord, si ce n’est que deux pyjamas du capitaine étaient simultanément en usage, l’un immobile dans le carré, l’autre parfaitement tranquille dans ma chambre.
Il faut que j’explique ici que ma chambre avait la forme d’un L majuscule, la porte étant dans l’angle et s’ouvrant sur la partie courte de la lettre. Un canapé se trouvait à gauche, le lit à droite ; mon bureau et la boîte des montres faisaient face à la porte. Mais quiconque l’ouvrait, à moins d’avancer tout droit en entrant, ne pouvait voir ce que j’appelle la partie longue de la lettre. Elle contenait quelques armoires surmontées d’une petite bibliothèque, et quelques vêtements, une grosse veste ou deux, des casquettes, un ciré et autres objets de ce genre, y étaient accrochés à des patères. Il y avait à l’extrémité de cette partie une porte qui ouvrait sur ma salle de bains à laquelle on avait également accès du carré ; mais on ne se servait pas de ce passage.
Le mystérieux nouveau venu avait découvert les avantages de cette disposition particulière. En entrant dans ma chambre, vivement éclairée par une grosse lampe ventrue qui se balançait au-dessus de mon bureau, je ne le vis d’abord nulle part jusqu’à ce qu’il sortît tranquillement de derrière les habits pendus dans le renfoncement.
— « J’ai entendu quelqu’un aller et venir et je me suis fourré là aussitôt », murmura-t-il.
Je parlais, moi aussi, à voix basse :
— « Personne n’entre ici sans frapper et demander la permission. »
Il hocha la tête. Son visage était maigre et le hâle commençait à disparaître comme s’il avait été malade. Ce n’était pas étonnant. Il avait été, — j’allais l’apprendre, — aux arrêts dans sa cabine pendant près de sept semaines. Mais ses yeux ni ses traits n’avaient rien de maladif. Il ne me ressemblait pas vraiment ; pourtant, penchés comme nous étions, au-dessus de mon lit, chuchotant côte à côte, nos têtes brunes rapprochées et le dos à la porte, quiconque eût été assez audacieux pour l’ouvrir à la dérobée aurait vu son indiscrétion payée du privilège d’apercevoir un double capitaine fort occupé à converser à voix basse avec son autre lui-même.
— « Mais tout ça ne me dit pas comment vous êtes parvenu à vous agripper à notre échelle », lui demandai-je, dans un de ces murmures à peine perceptibles que nous échangions, après qu’il m’eût donné encore quelques détails sur ce qui s’était passé à bord de la Séphora, une fois le mauvais temps passé.
— « Quand nous fûmes en vue de la pointe de Java, j’avais eu le temps de réfléchir plus d’une fois à tout cela. J’avais passé six semaines à ne rien faire d’autre, avec seulement une heure environ chaque soir, pour faire un tour sur le pont. »
Il chuchotait, les bras croisés sur le bois de ma couchette, les yeux rivés sur le hublot ouvert. Et je pouvais parfaitement imaginer sa façon de réfléchir : une opération obstinée, sinon constante : chose dont j’aurais été moi-même parfaitement incapable.
— « Je jugeai qu’il ferait nuit avant que nous n’approchions la terre », continua-t-il, si bas que je devais faire effort pour l’entendre, quelque près que nous fussions l’un de l’autre, presque épaule contre épaule. « Aussi demandai-je à parler au capitaine. Il prenait toujours un air très dégoûté quand il lui arrivait de me voir, comme s’il ne pouvait me regarder en face. Cette misaine, voyez-vous, avait sauvé le navire. Il avait trop de tirant d’eau pour pouvoir fuir à sec de toile. Et c’est moi qui avais fait en sorte de l’établir pour lui. Quoi qu’il en soit, il vint. Quand je l’eus dans ma cabine, — il se tenait près de la porte et me regardait comme si j’avais déjà la corde au cou, — je lui demandai sans préambule de laisser la porte de ma cabine non verrouillée le soir, quand le navire franchirait le détroit de la Sonde. La côte de Java se trouverait à moins de deux ou trois milles au large d’Angier-Point. Je n’en demandais pas davantage. J’ai eu un prix de natation à ma seconde année de Conway. »
— « Je le crois sans peine », murmurai-je.
— « Dieu seul sait pourquoi ils m’enfermaient à clef tous les soirs. A voir l’expression de leurs figures, on aurait dit que j’étais capable d’étrangler des gens la nuit. Suis-je donc une brute homicide ? En ai-je l’air ? Ma foi, si j’avais été de cette sorte il ne se serait pas risqué ainsi dans ma cabine. Vous me direz que j’aurais pu le bousculer et déguerpir, — il faisait déjà nuit. Eh bien, non ! Et pour la même raison, la pensée ne me serait pas venue d’essayer d’enfoncer la porte. Le tapage les aurait fait se jeter sur moi, et je n’avais pas envie de me fourrer dans une bagarre. Il aurait pu y avoir quelqu’un d’autre de tué, car je ne me serais pas échappé pour me faire coffrer de nouveau. J’en avais assez. Il refusa, l’air plus dégoûté que jamais. Il avait peur de ses hommes, et aussi de son vieux lieutenant qui avait navigué avec lui depuis des années, un vieux farceur à tête grise, et son steward aussi avait été avec lui, le diable sait depuis quand, dix-sept ans ou plus, une sorte de vagabond dogmatique qui me haïssait comme la peste, précisément parce que j’étais le second. On n’a jamais vu un second faire plus d’un voyage sur la Séphora, vous savez. Ces deux vieux copains faisaient la loi à bord. Le diable seul peut savoir ce dont le capitaine n’avait pas peur (tous ses nerfs avaient été ébranlés à la fois dans cette infernale tempête), des dangers, de la justice, de sa femme, peut-être. Oh ! oui, elle est à bord aussi. Quoique je ne pense pas qu’elle aurait rien eu à dire. Elle eût été seulement trop heureuse de me voir débarrasser le navire d’une façon ou d’une autre. « Le signe de Caïn », voyez-vous. J’étais prêt à m’en aller errer sur la terre, et c’était chèrement payé pour un Abel de cette espèce. En tout cas, il ne voulut rien entendre : — « La chose doit suivre son cours. Je représente la loi ici. » Il tremblait comme la feuille. — « Alors, vous ne voulez pas ? » — « Non. » — « Eh bien, j’espère que vous pourrez dormir par là-dessus », lui dis-je, et je lui tournai le dos. — « Je m’étonne que vous, vous le puissiez ! » cria-t-il, et il verrouilla la porte.
« Eh bien, après cela, je ne dormis plus. Pas très bien. Il y a trois semaines de cela. Nous avions traversé très lentement la mer de Java : dix jours de dérive dans les parages de Carimata. Quand nous mouillâmes ici, ils pensèrent, je suppose, que tout était réglé. La terre la plus proche (à cinq milles) est la destination du navire ; le consul m’enverrait chercher bientôt, et il n’y avait aucune raison d’aller se sauver sur les îlots qui sont là. Je ne suppose pas qu’on y puisse trouver une goutte d’eau. Je ne sais comment cela s’est fait ; mais ce soir, le steward, après m’avoir apporté mon souper, est sorti pour me le laisser manger et n’a pas verrouillé la porte. J’ai tout mangé. Quand j’ai eu fini, je suis sorti sur le pont. Je n’avais aucune intention, que je sache. Prendre un peu l’air. C’était tout ce qu’il me fallait, je crois. Mais il m’est venu une tentation soudaine. J’ai ôté mes savates et me suis jeté à l’eau avant de m’y être véritablement décidé. Quelqu’un a entendu le plongeon. Ç’a été un affreux vacarme. « Il s’est sauvé ! Amenez les embarcations ! Il veut se suicider ! Non, il nage ! » Assurément, je nageais. Ce n’est pas si facile pour un nageur comme moi de se noyer volontairement. J’abordai sur l’îlot le plus proche avant que le canot n’eût quitté le bord. J’entendais leurs avirons dans l’obscurité, leurs cris, etc. Mais peu après ils y renoncèrent. Tout s’apaisa, et le mouillage devint silencieux comme la mort. Je m’assis sur une pierre et me mis à réfléchir. Sans aucun doute ils se mettraient à ma recherche au petit jour. Il n’y avait pas moyen de se cacher sur ces choses rocheuses, et, d’ailleurs, à quoi bon ? Mais maintenant que j’étais délivré de ce navire, je n’allais pas y retourner. Aussi un moment après je me déshabillai, je fis un paquet de mes vêtements avec une pierre au milieu, et je le jetai en eau profonde de l’autre côté de cet îlot. Ce suicide-là me suffisait. Qu’ils aillent penser ce qu’ils veulent, je ne tenais pas à me noyer. Mon intention était de nager jusqu’à ce que je coule, ce qui n’est pas la même chose. Je gagnai un autre de ces îlots, et ce fut de celui-là que je découvris votre feu de mouillage. De quoi me donner une direction. J’avançai aisément, et en chemin j’abordai un rocher plat qui émergeait d’un pied ou deux. En plein jour, vous pourriez sûrement le distinguer d’ici, à la jumelle. Je grimpai dessus et me reposai un instant. Puis je me remis en route. Ce dernier trajet a dû être de plus d’un mille. »
Son murmure s’affaiblissait de plus en plus, et pendant tout ce temps il fixait le hublot par lequel on n’apercevait pas même une étoile. Je ne l’avais pas interrompu. Il y avait dans son récit, à moins que ce ne fût en lui-même, quelque chose qui rendait tout commentaire impossible ; une façon de sentir, une qualité, à laquelle je ne puis trouver de nom. Et quand il eut fini, tout ce que je trouvai à dire fut :
— « Ainsi vous avez nagé vers notre feu. »
— « Oui, droit dessus. C’était pour moi un but. Je ne pouvais pas voir d’étoiles basses, la côte les masquait, et je ne distinguais pas la terre non plus. L’eau était aussi lisse que du verre. On aurait cru nager dans une sacrée citerne de mille pieds de profondeur, sans rien nulle part à quoi s’accrocher ; mais ce qui ne me disait rien, c’était l’idée de tourner en rond comme un bœuf affolé avant de tout lâcher ; et comme je n’entendais pas m’en retourner… Non ! Me voyez-vous traîné là-bas, tout nu, arraché d’un de ces îlots, par la peau du cou et me débattant comme une bête sauvage ? Il y aurait eu quelqu’un de tué, pour sûr, et j’en avais eu assez. Je poursuivis donc. C’est alors que votre échelle… »
— « Pourquoi n’avez-vous pas hélé le navire ? » demandai-je, en élevant un peu la voix.
Il me toucha légèrement l’épaule. Des pas nonchalants venaient de s’arrêter juste au-dessus de nos têtes. Le lieutenant avait passé de l’autre bord de la dunette et avait dû se pencher au-dessus de la lisse.
— « Pourrait-il nous entendre parler, dites ? » me souffla mon double à l’oreille, anxieusement.
Son anxiété fut une réponse, et suffisante, à la question que je lui avais posée. Réponse où tenait toute la difficulté de la situation. Je fermai le hublot posément, par mesure de précaution. Un mot à voix plus haute aurait pu s’entendre.
— « Qui est-ce ? » murmura-t-il alors.
— « C’est mon lieutenant. Mais il m’est presque aussi étranger qu’à vous. »
Et je lui parlai un peu de moi. J’avais été nommé au commandement de ce navire alors que je n’attendais rien de la sorte, à peine quinze jours auparavant. Je ne connaissais ni le navire, ni l’équipage. Je n’avais pas eu le temps dans le port de faire connaissance avec les choses et les hommes. Quant aux hommes, tout ce qu’ils savaient, c’était que j’étais chargé de ramener le navire à son port d’attache. « Pour le reste, je suis presque autant un étranger à bord que vous », lui dis-je. Et à ce moment-là, j’en avais extrêmement conscience. Je sentais qu’il suffirait de peu de chose pour me rendre suspect à l’équipage.
Entre temps, il s’était retourné, et tous deux, les deux étrangers à bord, nous nous faisions face en une attitude identique.
— « Votre échelle…! » murmura-t-il, après un silence. « Qui diable aurait pensé trouver une échelle en dehors, la nuit, sur un navire à l’ancre à cet endroit. J’éprouvais à ce moment même une très désagréable défaillance. Après la vie que j’ai menée durant neuf semaines, n’importe qui eût perdu son entraînement. Je me sentais incapable de nager même jusqu’à la sauvegarde du gouvernail. Et voilà justement qu’il y avait une échelle à quoi s’accrocher ! Après l’avoir saisie, je me suis dit : « A quoi bon ! » En voyant la tête d’un homme qui regardait par-dessus bord, je pensai m’éloigner à la nage aussitôt et le laisser crier, dans quelque idiome que ce fût. Je ne trouvais pas d’inconvénient à être vu. Cela… cela me plaisait. Et puis, vous m’avez parlé si tranquillement, — comme si vous m’aviez attendu, — ça m’a fait rester un peu plus longtemps. J’avais été terriblement seul, je ne veux pas dire pendant que je nageais. J’étais content de parler un peu à quelqu’un qui n’appartînt pas à la Séphora. Quant à demander le capitaine, ce fut une simple impulsion. Cela ne pouvait servir à rien, tout le monde à bord me sachant là, et les autres prêts à venir me chercher au matin. Je ne sais pas…, j’avais besoin d’être vu, de parler à quelqu’un, avant de continuer. Je ne sais pas ce que j’aurais dit… « Belle nuit, n’est-ce pas ? » ou quelque chose de ce genre. »
— « Pensez-vous qu’ils seront ici bientôt ? » demandai-je avec quelque incrédulité.
— « C’est probable », dit-il faiblement.
Il eut tout d’un coup l’air extrêmement hagard. Sa tête roulait sur ses épaules.
— « Hum ! Nous allons voir. En attendant, mettez-vous dans ma couchette, murmurai-je. Vous faut-il un coup de main ? Là !… »
C’était une couchette assez haute avec des tiroirs au-dessous. Cet étonnant nageur eut besoin de l’aide que je lui donnai en lui prenant la jambe. Il tomba sur la couchette, roula sur le dos et de son avant-bras se couvrit les yeux. Et ainsi, le visage à demi caché, il devait présenter exactement la même apparence que moi. Je contemplai un moment cet autre moi-même, avant de refermer soigneusement les deux rideaux de serge verte qui glissaient sur une tringle de cuivre. Je songeai un moment à les épingler pour plus de sûreté, mais je m’assis sur le canapé, et, une fois là, je ne me sentis pas le courage de me lever pour chercher une épingle. Je le ferais un peu plus tard. Je me sentais extrêmement fatigué, d’une façon particulièrement profonde, par cette contrainte, par l’effort que je faisais pour parler bas et par toute cette agitation furtive. Il était maintenant à peu près trois heures, et j’étais debout depuis neuf heures, mais je n’avais pas sommeil ; je n’aurais pas pu m’endormir. Je restais assis là à bout de forces, l’œil fixé sur les rideaux, essayant d’échapper à la sensation confuse d’être à deux endroits à la fois et tourmenté par d’exaspérants coups secs qui semblaient résonner dans ma tête. Ce me fut un soulagement de découvrir soudain que ce n’était pas du tout dans ma tête, mais à la porte. Avant d’avoir pu reprendre mes sens, le mot « entrez » était sorti de ma bouche, et le steward entrait avec un plateau, m’apportant mon café du matin. J’avais dormi, après tout, et j’eus si peur que je m’écriai : « Par ici, je suis ici, steward », comme s’il eût été à des lieues. Il posa le plateau sur la table auprès du canapé, et seulement alors, dit très tranquillement :
— « Je vois bien que vous êtes ici, capitaine. »
Je sentis qu’il me jetait un regard pénétrant, mais je n’osais pas à ce moment le regarder en face. Il dut se demander pourquoi j’avais tiré les rideaux de mon lit avant d’aller dormir sur le canapé. Il sortit, laissant la porte au crochet, comme d’habitude.
J’entendis l’équipage laver le pont au-dessus de ma tête. Je savais qu’on m’aurait prévenu aussitôt s’il y avait eu le moindre vent. Calme plat, pensai-je, et j’en fus doublement contrarié. Vraiment, je me sentais double, plus que jamais. Le steward reparut soudain à la porte. Je sautai à bas du canapé si promptement qu’il eut un mouvement de recul.
— « Qu’est-ce que vous voulez ? »
— « Fermer votre hublot, capitaine, on lave le pont. »
— « Il est fermé », dis-je en rougissant.
— « Bien, Capitaine. » Mais il ne bougeait pas de la porte et il répondit à mon regard d’une façon extraordinaire, équivoque, pendant un moment. Puis ses yeux vacillèrent : il changea d’expression, et d’une voix étrangement douce, presque caressante :
— « Puis-je entrer pour enlever la tasse vide, capitaine ? »
— « Bien sûr ! »
Je lui tournai le dos jusqu’à ce qu’il fût parti. Alors je décrochai et fermai la porte et poussai même le verrou. Cela ne pouvait pas continuer ainsi bien longtemps. En outre, dans cette chambre il faisait chaud comme dans un four. Je donnai un coup d’œil à mon double et vis qu’il n’avait pas bougé, il avait encore le bras sur les yeux ; mais sa poitrine se soulevait, ses cheveux étaient mouillés, son menton était moite de sueur. Par-dessus lui j’atteignis et ouvris le hublot.
— « Il faut que je me montre sur le pont », me dis-je.
Bien entendu, en principe, je pouvais faire ce que bon me semblait, sans que personne pût me contredire dans tout le cercle de l’horizon ; mais quant à fermer à clef la porte de ma chambre et à en enlever la clef, cela je ne l’osais pas. A peine sorti du capot de l’échelle, j’aperçus mes deux officiers, le lieutenant nu-pieds, le second dans de longues bottes de caoutchouc ensemble à l’aplomb de la dunette, et à mi-chemin de la descente, le steward qui leur parlait avec animation. Il m’aperçut, fit le plongeon : le lieutenant courut sur le pont, en criant un ordre quelconque ; le second vint à ma rencontre, la main à sa casquette.
Il y avait dans ses yeux une sorte de curiosité qui me déplut. Je ne sais si le steward leur avait dit seulement que j’étais « drôle », ou bien réellement ivre, mais je voyais bien que l’homme tenait à m’examiner de près. Je le regardai venir, avec un sourire qui, lorsqu’il fut à portée, fit son effet et sembla glacer jusqu’à ses favoris. Je ne lui laissai pas le temps d’ouvrir la bouche.
— « Faites brasser carré en envoyant les hommes aux bras et balancines avant le déjeuner. »
C’était le premier ordre précis que je donnais à bord de ce navire ; et je demeurai sur le pont pour le voir exécuter, qui plus est. J’avais éprouvé le besoin de m’affirmer sans perdre de temps. Du coup, le blanc-bec narquois en baissa d’un cran ou deux, et je saisis également l’occasion de regarder bien en face chaque homme de l’équipage, quand ils défilèrent devant moi pour aller aux bras de l’arrière. Sans pouvoir rien prendre moi-même, je présidai le petit déjeuner avec une dignité tellement glaciale que les deux officiers ne furent que trop heureux de s’esquiver du carré dès que la décence le leur permit ; et, sans cesse, le double travail de mon esprit me tourmentait à me rendre fou. Je ne cessais de surveiller mon moi, cet autre moi-même secret qui dépendait de mes actions autant que ma propre personne, et qui dormait là dans ce lit, derrière cette porte qui me faisait face, tandis que j’étais assis au bout de cette table. C’était tout à fait comme d’être fou, mais c’était pire, parce que c’était consciemment.
Il me fallut le secouer une bonne minute, mais, quand à la fin il ouvrit les yeux, ce fut en pleine possession de lui-même, avec un regard interrogateur.
— « Tout va bien jusqu’ici », chuchotai-je. « Maintenant, il faut que vous disparaissiez dans la salle de bain. »
C’est ce qu’il fit, silencieux comme un fantôme. Je sonnai le steward et, le regardant en face, je lui enjoignis de faire ma chambre pendant que je prendrais mon bain : « Et faites vite. » Mon ton n’admettait aucune réplique, il répondit : « Oui, capitaine ! » et courut chercher son seau et ses balais. Je pris un bain et fis presque toute ma toilette en agitant l’eau à dessein et en sifflotant pour l’édification du steward, pendant que le compagnon secret de ma vie se tenait raide comme un pieu dans ce petit espace ; ses joues semblaient très creuses au grand jour, et ses paupières demeuraient baissées sous la ligne nette et sombre de ses sourcils froncés.
Quand je le laissai là pour regagner ma chambre, le steward achevait son nettoyage. J’envoyai chercher le second et j’engageai une conversation insignifiante : comme pour me jouer du caractère terrible de ses favoris, mais à la vérité pour lui donner l’occasion de bien examiner ma chambre. Alors, enfin, je pus, la conscience tranquille, fermer la porte et faire rentrer mon double dans la partie en retrait. Il n’y avait rien d’autre à faire. Il n’eut qu’à rester tranquillement assis sur un petit pliant, à demi dissimulé par les lourds vêtements suspendus là. Nous écoutâmes le steward entrer dans la salle de bains par le salon, y remplir les carafes, frotter la baignoire, remettre les choses en ordre, épousseter, battre, frotter, ressortir dans le salon, tourner la clef, pousser le loquet. Tel était mon plan pour rendre invisible mon second moi. On ne pouvait rien combiner de mieux en la circonstance. Et nous demeurâmes là, moi, à mon pupitre, prêt à paraître occupé avec quelques papiers, et lui derrière moi, hors de vue de la porte. La prudence commandait de ne pas parler durant le jour, et je n’aurais pu supporter cette étrange et énervante sensation de me chuchoter à moi-même. De temps à autre, en regardant par-dessus mon épaule, je le voyais dans le fond, assis tout raide sur le pliant, les pieds joints, les bras croisés, le menton sur la poitrine, parfaitement immobile. N’importe qui l’eût pris pour moi.
J’en étais fasciné moi-même. A chaque instant, je ne pouvais me retenir de jeter un coup d’œil par-dessus mon épaule. J’étais en train de le regarder, lorsqu’une voix derrière la porte appela :
— « Pardon, capitaine ! »
— « Qu’y a-t-il ? » Mes yeux demeuraient fixés sur lui, et quand la voix du dehors annonça : « Il y a un canot qui vient vers nous, capitaine », je le vis tressaillir, — c’était son premier mouvement depuis des heures. Mais il ne releva pas la tête.
— « Bon ! Mettez l’échelle en dehors. »
J’hésitai. Fallait-il lui glisser un mot ? Mais lequel ? Son immobilité semblait impassible. Que lui aurais-je dit qu’il ne sût déjà ?… En fin de compte, je montai sur le pont.
Le commandant de la Séphora portait autour de la figure un maigre collier de barbe rousse, et il avait le teint assorti aux poils de cette couleur et aussi une nuance particulière d’yeux d’un bleu brouillé. Ce n’était pas exactement un personnage impressionnant ; il avait les épaules hautes, une taille moyenne, une jambe légèrement plus courbe que l’autre. Il me serra la main en regardant vaguement autour de lui. Un entêtement morne me parut être son principal caractère. Je me comportai avec une politesse qui parut le déconcerter. Peut-être était-il timide. Il marmottait comme s’il eût eu honte de ce qu’il avait à dire ; il se nomma (c’était quelque chose comme Archbold, mais à tant d’années de distance, je n’en suis pas bien sûr), donna le nom de son navire et quelques autres détails de ce genre, à la façon d’un criminel qui se résout à un aveu pénible. Il avait eu un temps terrible pendant la traversée…, terrible…, terrible…, et sa femme à bord, en outre.
Nous étions alors assis dans le carré, et le steward apporta un plateau avec une bouteille et des verres. « Merci, non ! » Il ne prenait jamais d’alcool. Il prendrait volontiers un peu d’eau. Il en but deux verres. Il y avait de quoi vous donner soif. Sans arrêt depuis le point du jour, il n’avait fait qu’explorer les flots aux abords de son navire.
— « Pour quoi faire ?… Pour le plaisir ? » demandai-je avec un air poliment intéressé.
— « Non, soupira-t-il. Un devoir pénible. »
Comme il persistait dans son marmottement et que je tenais à ce que mon double n’en perdît pas un mot, j’eus l’idée de l’informer qu’à mon grand regret il me fallait avouer que j’étais un peu dur d’oreille.
— « Quoi ! un jeune homme comme vous ! » fit-il en hochant la tête, tout en gardant fixés sur moi ses yeux d’un bleu terne dénués d’expression. « Comment cela vous est-il venu, une maladie ? » demanda-t-il sans la moindre sympathie et comme s’il pensait que, s’il en était ainsi, je ne l’avais pas volé.
— « Oui, une maladie », acquiesçai-je d’un ton enjoué qui parut le choquer. Mais j’avais atteint mon but, car force lui fut d’élever la voix pour me débiter son histoire. Il ne vaut pas la peine de rapporter ici la version qu’il en donna. Plus de deux mois s’étaient écoulés depuis cet événement, et il y avait tellement pensé qu’il semblait en avoir complètement perdu le sentiment clair, bien qu’il en eût conservé une impression profonde.
— « Que diriez-vous si pareille chose arrivait à bord de votre navire ? Voilà quinze ans que je commande la Séphora. Je suis un capitaine bien connu. »
Il souffrait profondément, et peut-être aurais-je sympathisé avec lui si j’avais pu détacher ma vision intérieure du compagnon insoupçonné qui partageait ma chambre comme s’il eût été un second moi-même. Il était là de l’autre côté de la cloison, à un ou deux mètres, pas plus, tandis que nous nous tenions dans le carré. Je regardais poliment le capitaine Archbold (si tel était son nom), mais c’était l’autre que je voyais, dans son pyjama gris, assis sur un tabouret, les pieds joints, les bras croisés, et je savais que chacun des mots que nous échangions tombait dans les oreilles de sa tête brune penchée sur sa poitrine.
— « J’ai maintenant, comme gamin et comme homme, trente-sept ans de service à la mer, et à ma connaissance pareille chose n’est jamais arrivée à bord d’un navire anglais. Et il a fallu que cela arrivât sur le mien ! Et ma femme à bord, en outre ! »
Je l’écoutais à peine.
— « Ne pensez-vous pas », demandai-je, « que le coup de mer qui, m’avez-vous dit, embarqua juste alors, ait pu tuer l’homme en question ? J’ai vu le seul poids d’une lame vous tuer net un homme, simplement en lui brisant le cou. »
— « Seigneur ! » s’écria-t-il gravement, en fixant sur moi ses yeux bleus. « Une lame ! un homme tué par une lame n’a jamais ressemblé à cela. »
Il eut l’air positivement scandalisé de mon idée. Et comme je le considérais, sans m’attendre à rien d’original de sa part, il avança la tête tout contre la mienne et me tira la langue si soudainement que je ne pus m’empêcher de faire un mouvement de recul.
Après avoir, de cette manière imagée, eu raison de mon calme, il hocha la tête d’un air entendu. Il m’assura que si j’avais pu voir la chose, je ne l’oublierais de ma vie. Le temps était trop mauvais pour pouvoir faire au cadavre de convenables funérailles. Aussi, le lendemain, au point du jour, on le transporta sur la dunette, après lui avoir couvert la figure d’un bout de pavillon ; on lut une brève prière et puis, tel qu’il était, dans son suroit et ses longues bottes, on l’envoya à la mer parmi ces trombes d’eau qui semblaient à tout instant devoir engloutir le navire lui-même et les êtres terrifiés qui le montaient.
— « Cette misaine vous a sauvé », lui lançai-je.
— « Grâce à Dieu, en vérité », s’écria-t-il avec ferveur. « C’est bien grâce à une miséricorde spéciale, je le crois fermement, si elle a pu supporter ces coups de vent pendant la tempête. »
— « C’est le fait d’avoir établi cette misaine qui… », commençai-je.
— « La main même de Dieu, dans cette affaire », interrompit-il. « Il ne fallait rien de moins. Je ne vous cacherai pas que j’ai à peine osé donner l’ordre. Il semblait impossible de toucher à quoi que ce fût sans perdre la voile, et alors c’en était fait de notre dernier espoir. »
Il était encore sous le coup de la terreur de cette tempête. Je le laissai continuer un peu, puis, négligemment, comme pour revenir à un sujet de moindre importance, je lui dis :
— « Vous aviez hâte de remettre votre second aux autorités à terre, je pense ? »
— « Ma foi, oui ! A la justice. » Son obscure ténacité sur ce point avait quelque chose en soi d’incompréhensible, d’un peu horrible, quelque chose, pour ainsi dire, de mystique, sans parler du désir qu’il pouvait avoir de n’être pas soupçonné « de tolérer des procédés de la sorte ». Trente-sept vertueuses années de mer dont plus de vingt de commandement sans reproche, et les quinze dernières à bord de la Séphora, semblaient lui avoir créé d’impitoyables obligations.
— « Et vous savez », poursuivit-il, en tâtonnant avec quelque confusion parmi ses sentiments, « ce n’est pas moi qui avais engagé ce garçon-là. Sa famille avait des intérêts chez mes armateurs. J’ai eu en quelque sorte la main forcée. Il avait l’air très bien, très comme il faut, et tout ça ! Mais, voyez-vous, il ne m’est jamais revenu tout de même. Je suis un homme simple. Ce n’était pas exactement le genre de second qu’il faut à bord d’un navire comme la Séphora. »
Je m’étais tellement identifié en pensées avec celui qui partageait secrètement ma cabine que j’eus l’impression qu’on me donnait personnellement à entendre que moi non plus je n’étais pas de la sorte qu’il eût fallu à un navire comme la Séphora. Je n’avais pas le moindre doute à cet égard.
— « Pas du tout le genre. Vous comprenez ? » reprit-il en me regardant fixement.
J’y répondis par un sourire aimable. Il sembla un moment perplexe.
— « Je suppose que je dois faire un rapport de suicide. »
— « Vous dites ? »
— « Suicide ! C’est là ce que je devrai écrire à mes armateurs, aussitôt dans le port. »
— « A moins que vous ne vous arrangiez pour le retrouver d’ici à demain », déclarai-je froidement… « Je veux dire, vivant. »
Il grommela quelque chose que je ne pus saisir et je tendis l’oreille vers lui d’un air intrigué. Il cria littéralement :
— « La terre…, je veux dire la terre ferme est au moins à sept milles de mon mouillage. »
— « A peu près. »
Mon absence d’agitation, de curiosité, de surprise, de toute espèce d’intérêt visible, commença à éveiller sa méfiance. Mais sauf l’heureuse affectation de surdité, je n’avais aucunement essayé de feindre. Je m’étais senti complètement incapable de jouer l’ignorance complète et par suite j’avais peur de m’y risquer. Il est certain aussi qu’il n’était pas venu sans quelques soupçons et qu’il considérait ma politesse comme un phénomène quelque peu étrange. Et pourtant, de quelle autre façon aurais-je pu le recevoir ? Pas cordialement, c’était impossible pour des raisons psychologiques que je n’ai pas besoin d’exposer ici. Mon unique objet était d’éviter ses questions. En rechignant ? Oui, mais la mauvaise humeur eût pu provoquer de sa part une question directe. Par ce qu’elle avait pour lui d’insolite et par sa nature même, une minutieuse courtoisie était la meilleure façon de le contenir. Restait le danger de le voir forcer brusquement mes défenses. Je n’aurais pu, je pense, lui opposer un mensonge direct, également pour des raisons psychologiques (et non morales). S’il avait seulement pu savoir combien j’avais peur qu’il ne mît à l’épreuve le sentiment que j’avais de mon identité avec l’autre ! Mais, assez étrangement (je n’y pensai qu’ensuite), je crois qu’il ne fut pas peu décontenancé par le revers de cette étrange situation, par un je ne sais quoi en moi qui lui rappelait l’homme qu’il cherchait, et lui suggéra que j’avais une mystérieuse similitude avec ce garçon pour lequel il n’avait eu du premier jour que méfiance et aversion.
Quoi qu’il en soit, le silence ne dura guère. Il prit un autre biais.
— « J’estime que nous n’avons guère fait plus de deux milles à l’aviron jusqu’à votre bord. Pas plus. »
— « Encore est-ce bien assez par cette affreuse chaleur », lui dis-je.
Une autre pause pleine de méfiance s’ensuivit. La nécessité, dit-on, est la mère de l’invention, mais la peur aussi n’est pas sans fournir d’ingénieuses inspirations. Et j’avais peur qu’il ne me demandât à brûle-pourpoint des nouvelles de mon double.
— « Gentil petit carré, n’est-ce pas ! » lui fis-je observer, comme si je remarquais pour la première fois la façon dont ses regards allaient d’une porte à l’autre. « Et fort bien aménagé aussi. Ici, par exemple », continuai-je en atteignant négligemment la porte par-dessus le dossier de ma chaise et en l’ouvrant toute grande, « j’ai ma salle de bain. »
Il eut un mouvement de curiosité, mais il y jeta à peine un coup d’œil. Je me levai, fermai la porte de la salle de bain, et l’invitai à faire l’inspection comme si j’étais très fier de l’agencement de mon navire. Il lui fallut se lever et faire la visite, mais il s’en acquitta sans aucun enthousiasme.
— « Maintenant venez voir ma chambre », déclarai-je de la voix la plus forte que j’osai prendre, en traversant le carré vers tribord à pas volontairement pesants.
Il entra derrière moi et regarda autour de lui. Mon intelligent double s’était éclipsé. Je jouai mon rôle.
— « C’est bien aménagé, n’est-ce pas ? »
— « Très bien, très conf… » Il n’acheva pas et sortit brusquement comme pour échapper à quelque ruse maléfique de ma part. Mais je ne voulais pas le lâcher comme cela. Il m’avait fait trop peur pour que je n’eusse pas envie de me venger : je sentis que je le tenais et j’entendais le faire « marcher » jusqu’au bout. Mon insistance polie devait contenir quelque chose de menaçant, car il accéda immédiatement. Et je ne lui fis grâce d’aucun détail : chambre du second, office, soute à provisions, soute à voiles qui se trouvait aussi sous la dunette, il dut tout inspecter. Quand, à la fin, il sortit sur le pont, il poussa un long soupir découragé et marmotta lugubrement qu’il lui fallait vraiment regagner son navire. Je priai mon second qui nous avait rejoints de faire armer le canot du capitaine.
L’homme aux favoris lança un coup du sifflet qu’il portait toujours suspendu à son cou et cria : « Armez le canot de la Séphora ! » Mon double, en bas, dans la cabine, avait dû entendre et ne pouvait certainement pas se sentir plus soulagé que moi. Quatre hommes sortirent en courant du poste d’équipage et embarquèrent, tandis que les miens, paraissant également sur le pont, se rangèrent devant la lisse. J’escortai mon visiteur jusqu’à la coupée, cérémonieusement : un peu trop peut-être. C’était un tenace animal. A la coupée même il hésita, persévérant consciencieusement dans son idée, de façon presque heureuse :
— « Dites-moi !… vous… vous ne pensez pas que… »
J’interrompis en élevant la voix :
— « Certainement pas… Enchanté ! Au revoir ! »
Je me doutais de ce qu’il voulait dire et n’y échappai tout juste que par le privilège d’être dur d’oreille. Il était trop abattu pour insister, mais mon second, proche témoin de cette séparation, sembla quelque peu mystifié et sa figure prit une expression songeuse. Comme je ne tenais pas à paraître vouloir éviter toute communication avec mes officiers, je lui donnai l’occasion de me parler :
— « Ça a l’air d’un très brave homme. L’équipage de son canot a raconté à nos hommes une histoire bien extraordinaire, si ce que m’a dit le steward est vrai… Je suppose que ce capitaine vous l’a racontée ? »
— « Oui, le capitaine m’a raconté une histoire. »
— « Une très horrible affaire, n’est-il pas vrai, capitaine ? »
— « En effet ! »
— « Cela dépasse toutes ces histoires de meurtres qu’on nous a racontées de navires américains. »
— « Je ne pense pas qu’elle les dépasse. Je ne pense même pas qu’elle leur ressemble le moins du monde. »
— « Dieu me pardonne, vraiment ! Mais, bien sûr, je ne connais pas du tout les navires américains. Aussi ne saurais-je aller à l’encontre de vos dires. Pour moi, c’est assez horrible… Mais le plus étrange est que ces gens de la Séphora semblaient avoir quelque idée que l’homme était caché à bord, ici. Vraiment ils le croyaient. Avez-vous jamais entendu chose pareille ? »
— « Absurde, n’est-ce pas ? »
Nous arpentions le pont : aucun homme d’équipage n’était visible (c’était dimanche), et le second reprit :
— « Ils ont même eu une querelle à ce propos. Les nôtres se jugeaient offensés : « Comme si nous hébergerions pareille espèce ! dirent-ils. Avez-vous envie de regarder dans la soute à charbon ? » Une vraie querelle. Mais à la fin ils ont fait la paix. Je suppose qu’il s’est noyé. Et vous, capitaine ? »
— « Je ne suppose rien du tout. »
— « Vous avez des doutes là-dessus, capitaine ? »
— « Pas le moindre. »
Je le quittai brusquement. Je sentis que je faisais une mauvaise impression, mais, avec mon double en bas, cela m’était très pénible d’être sur le pont. Et il m’était presque aussi pénible d’être en bas. Une situation tout à fait épuisante, somme toute. Tout de même je me sentais moins tiraillé lorsque j’étais avec lui. Il n’y avait personne dans tout le navire à mettre dans la confidence. Depuis que les hommes avaient appris son histoire, il eût été impossible de le faire passer pour quelqu’un d’autre, et une découverte accidentelle était maintenant plus à craindre que jamais…
Le steward étant occupé à mettre le couvert pour le déjeuner, nous ne pûmes parler que du regard lorsque je fus descendu. Plus avant dans la journée, nous nous essayâmes prudemment à chuchoter. Le calme du dimanche sur le navire était contre nous ; la tranquillité de l’air et de l’eau était contre nous ; les éléments, les hommes étaient contre nous, tout était contre nous dans notre secrète association, le temps lui-même, car cela ne pouvait durer éternellement. La confiance dans la Providence même n’était pas, je suppose, possible à ce coupable. Avouerai-je que cette pensée me décourageait beaucoup ? Et quant au chapitre des accidents qui tient tant de place dans le livre du succès, mon seul espoir était qu’il fût clos. Car à quel accident favorable pouvait-on bien s’attendre ?
— « Avez-vous tout entendu ? » furent mes premières paroles dès que nous eûmes repris notre position côte à côte, appuyés sur le rebord de la couchette.
Il avait entendu. La preuve en était dans l’ardeur de son chuchotement :
— « L’homme vous a dit qu’il avait à peine osé donner l’ordre ? »
Je compris que cela se rapportait à cette secourable misaine.
— « Oui. Il avait peur qu’elle ne fût enlevée en l’établissant. »
— « Je vous assure qu’il n’a jamais donné l’ordre. Il a peut-être cru le faire, mais il ne l’a jamais fait. Il se tenait là avec moi sur la dunette après avoir vu partir le grand hunier et il pleurnichait sur ce dernier espoir, il pleurnichait positivement, et rien d’autre, et la nuit venait ! Voir son capitaine se laisser aller ainsi par un temps pareil, il y avait de quoi vous mettre hors de vous. Cela m’a mis dans une espèce de fureur. Alors j’ai pris la chose sur moi, et je l’ai quitté sur le point d’éclater, et… Mais à quoi bon raconter tout cela ! Vous savez ce que c’est, vous !… Pensez-vous que, si je n’avais pas été passablement féroce avec eux, j’aurais pu obtenir quoi que ce fût des hommes ? Oh ! non ! le maître d’équipage, peut-être ? Peut-être ! Ce n’était pas de la grosse mer, c’était une mer démontée ! Je suppose que la fin du monde sera quelque chose dans ce genre-là, et un homme peut regarder venir cela le cœur ferme une bonne fois et que c’en soit fini, mais pour l’affronter jour après jour… Je ne blâme personne. Je ne valais pas beaucoup mieux que le reste. Seulement, j’étais officier sur ce vieux charbonnier et ainsi… »
— « Je comprends parfaitement », lui murmurai-je à l’oreille en toute sincérité.
Il était hors d’haleine à force de chuchoter, je l’entendais haleter légèrement. Tout cela était fort simple ; la même force nerveuse qui avait fourni à vingt-quatre hommes une chance, pour le moins, de sauver leurs vies, avait, par une sorte de choc en retour, brisé une indigne existence révoltée.
Mais je n’eus pas le temps de peser les mérites de l’affaire… des pas dans le carré, un coup à la porte : « Il y a assez de vent pour appareiller, capitaine. » C’était un nouveau poids sur mes pensées et même sur mes sentiments.
— « Appelez tout le monde sur le pont », criai-je à travers la porte. « Je monte tout de suite. »
J’allais donc faire connaissance avec mon navire. Avant de quitter ma chambre, nos yeux se rencontrèrent, les yeux des deux seuls étrangers à bord. Je lui montrai la partie en retrait où le petit pliant l’attendait, et je mis le doigt sur mes lèvres. Il fit un geste, assez vague, un peu mystérieux, qu’accompagna un faible sourire, comme un sourire de regret.
Ce n’est pas ici le lieu de s’étendre sur les impressions d’un homme qui sent pour la première fois un navire se mouvoir sous ses pieds au commandement de sa voix. Dans mon cas, elles n’étaient pas sans mélange. Je n’étais pas tout à fait seul avec mes responsabilités ; il y avait cet étranger dans ma chambre. Ou plutôt je n’étais pas complètement et entièrement avec mon navire. J’étais en partie absent. Ce sentiment intime d’être à deux endroits à la fois m’affectait physiquement comme si l’atmosphère du secret m’avait pénétré jusqu’à l’âme. Moins d’une heure après que le navire eut commencé à bouger, ayant à demander au second (il se tenait à mon côté) de prendre un relèvement de la Pagode, je me surpris à me pencher à son oreille. Je dis : je me surpris ; mais j’en fis assez pour qu’il en fût plus qu’étonné. Je ne puis décrire la chose autrement qu’en disant qu’il fit un écart. Il ne se départit plus désormais d’une attitude grave, préoccupée, comme s’il était au fait d’un renseignement inquiétant. Un peu plus tard je m’écartai de la lisse pour donner un coup d’œil au compas, et je le fis de façon si furtive que le timonier le remarqua : je ne pus faire autrement que de constater que ses yeux devinrent extrêmement ronds. Ce n’étaient que des riens, encore qu’il soit assez fâcheux pour un capitaine d’être soupçonné d’excentricité. Mais j’étais plus gravement atteint. Il est pour un marin certaines paroles, certains gestes qui doivent, dans des circonstances données, venir aussi naturellement, aussi instinctivement que le clignement d’un œil menacé. Tel ordre doit jaillir de ses lèvres, sans qu’il y pense ; tel geste doit se faire, pour ainsi dire, sans réflexion. Or toute spontanéité m’avait abandonné. Je devais faire un effort de volonté pour me ramener (de la chambre) aux obligations du moment. Je sentis que je donnais l’impression d’être un commandant irrésolu à ces gens qui m’observaient d’un œil plus ou moins critique.
Et il y avait, en outre, les alarmes. Le second jour, par exemple, en quittant le pont l’après-midi (j’avais les pieds nus dans des pantoufles de paille), je m’arrêtai à la porte ouverte de l’office et appelai le steward. Il faisait je ne sais quoi, le dos tourné. Au son de ma voix, il sursauta et en même temps cassa une tasse.
— « Qu’est-ce que vous avez, bon Dieu ? » m’écriai-je étonné.
Il avait l’air ahuri :
— « Je vous demande pardon, capitaine. J’étais persuadé que vous étiez dans votre chambre. »
— « Vous voyez bien que je n’y étais pas. »
— « Non, capitaine. Mais j’aurais juré que je vous y avais entendu remuer il n’y a qu’un instant. C’est très extraordinaire !… Faites excuse, capitaine ! »
Je m’éloignai en frissonnant. J’étais tellement identifié à mon double que je ne mentionnai même pas le fait au cours des rares et craintifs chuchotements que nous échangeâmes. Je suppose qu’il avait fait quelque léger bruit. C’eût été un miracle que cela n’arrivât pas à un moment ou l’autre. Et cependant, malgré son air hagard, il semblait toujours parfaitement maître de lui, plus que calme, presque invulnérable. Sur mon conseil il se tenait presque constamment dans la salle de bain, qui, à tout prendre, était l’endroit le plus sûr. Il ne pouvait y avoir réellement l’ombre d’une excuse pour que quelqu’un voulût y pénétrer une fois que le steward l’avait mise en ordre. C’était un endroit fort exigu. Quelquefois mon double s’y étendait par terre, les jambes repliées, la tête appuyée sur un de ses bras, et dans son pyjama gris, avec ses cheveux noirs coupés ras il avait l’air d’un patient et impassible forçat. La nuit, je le faisais passer sur ma couchette, et nous chuchotions, tandis que le bruit des pas réguliers de l’officier de quart passait et repassait au-dessus de nos têtes. Ce furent des moments infiniment tristes. Par bonheur, quelques boîtes de conserves fines se trouvaient dans un placard de ma chambre ; du pain sec je pouvais toujours m’en procurer ; ainsi vécut-il de poulet sauté, de pâté de foie gras, d’asperges, d’huîtres cuites, de sardines, de toutes sortes de fausses friandises abominables que je tirais des boîtes. Mon café du matin, c’était toujours lui qui le buvait, et c’était tout ce que j’osais faire pour lui à cet égard.
Chaque jour il fallait faire cette horrible manœuvre pour arriver à ce que ma chambre, puis la salle de bain fussent faites comme d’habitude. J’en vins à haïr la vue du steward, à abhorrer la voix de cet homme inoffensif. Je sentais que c’était lui qui amènerait la catastrophe de la découverte. Cela était suspendu comme une épée au-dessus de nos têtes.
Le quatrième jour, je crois (nous tirions des bords sur la côte orientale du golfe de Siam, par légère brise et mer calme), le quatrième jour, dis-je, de cette misérable jonglerie avec l’inévitable, comme nous étions à table pour le dîner, cet homme, dont le moindre mouvement m’épouvantait, remonta en hâte sur le pont, après avoir posé les plats. Ceci ne pouvait être dangereux. Il revint aussitôt, et je compris alors qu’il s’était rappelé que j’avais laissé une veste à sécher sur la lisse, après avoir reçu une averse qui avait passé sur le navire dans la journée. Assis au haut bout de la table, je me sentis terrifié à la vue de ce vêtement à son bras. Naturellement il se dirigeait vers ma porte. Il n’y avait pas de temps à perdre.
— « Steward ! » lui criai-je. Mes nerfs étaient si ébranlés que je ne pouvais maîtriser ma voix, ni cacher mon trouble. C’est cette sorte de chose qui amenait mon second aux redoutables favoris à se taper le front avec l’index. Je l’avais surpris à faire ce geste tandis que, sur le pont, il causait d’un air confidentiel avec le charpentier. J’étais trop loin pour avoir pu saisir le moindre mot, mais je ne doutai point que cette pantomime se rapportât à leur étrange capitaine.
— « Oui, capitaine », dit en se retournant vers moi d’un air résigné le pâle steward. C’était cette manière affolante de s’entendre crier après, de se voir repris sans rime ni raison, envoyé promener de ma chambre, rappelé tout à coup, arraché à son office pour d’incompréhensibles commissions, qui était la cause de son expression de plus en plus malheureuse.
— « Où allez-vous avec ce vêtement ? »
— « Dans votre chambre, capitaine. »
— « Va-t-il pleuvoir encore ? »
— « Je ne sais pas, capitaine. Faut-il remonter voir ? »
— « Non, pas la peine ! »
J’avais atteint mon but, car naturellement mon autre moi-même là-dedans avait dû tout entendre. Pendant cet intermède mes deux officiers n’avaient pas levé le nez de leurs assiettes respectives, mais la lèvre de ce damné blanc-bec de lieutenant tremblait visiblement.
Je m’attendais à ce que le steward accrochât ma veste et ressortit aussitôt. Il resta très longtemps ; je dominai toutefois suffisamment ma nervosité pour ne pas l’interpeller. Soudain je me rendis compte (on pouvait aisément l’entendre) que cet homme, pour une raison quelconque, ouvrait la porte de la salle de bain. C’était la fin ! L’endroit était littéralement grand comme un mouchoir de poche. La voix me manqua et je restai pétrifié. Je m’attendais à entendre un cri de surprise et de terreur et je fis un mouvement, mais sans avoir la force de me mettre debout. Tout demeurait silencieux. Mon double avait-il pris le pauvre diable à la gorge ? Je ne sais ce que j’aurais fait l’instant d’après, si je n’avais vu le steward ressortir de la chambre, refermer la porte et rester immobile près du buffet.
« Sauvé ! pensai-je. Mais non ! Perdu. Parti ! Il était parti ! »
Je posai mon couteau et ma fourchette et me renversai sur ma chaise. La tête me tournait. Au bout d’un moment, quand je fus suffisamment remis pour pouvoir parler d’une voix ferme, je donnai à mon second des instructions pour virer de bord à huit heures.
— « Je ne monterai pas sur le pont », continuai-je. « Je crois que je vais me coucher et, à moins que le vent ne change, qu’on ne me dérange pas avant minuit. Je me sens un peu indisposé. »
— « Vous paraissiez vraiment assez souffrant, il y a un moment », remarqua le second, sans paraître y prendre grand intérêt.
Ils sortirent tous les deux, et je restai les yeux fixés sur le steward qui desservait. On ne pouvait rien lire sur son visage. Mais pourquoi évitait-il mon regard, je me le demandais ; je pensai alors que j’aimerais entendre le son de sa voix.
— « Steward ! »
— « Capitaine », dit-il en sursautant comme à l’ordinaire.
— « Où avez-vous accroché cette veste ? »
— « Dans la salle de bain, capitaine. » Et du même ton anxieux :
— « Elle n’est pas encore tout à fait sèche. »
Je restai assis un moment dans le carré. Mon double avait-il disparu comme il était venu ? Mais de sa venue il y avait une explication, tandis que sa disparition ne pouvait s’expliquer… J’entrai lentement dans ma chambre obscure, je fermai la porte, allumai la lampe, et pendant quelque temps n’osai me retourner. Quand je m’y décidai, à la fin, je le vis qui se tenait tout droit dans l’étroit recoin. Je ne dirai pas que j’en eus un choc, mais un doute irrésistible sur son existence matérielle me traversa l’esprit. Se peut-il, me demandai-je, qu’il soit invisible à d’autres yeux que les miens ? C’était comme si j’étais hanté. Immobile, l’air grave, il leva les deux mains légèrement vers moi, en un geste qui signifiait clairement : « Ciel ! nous l’avons échappé belle ! » Vraiment, échappé belle ! Je pense que j’étais arrivé insensiblement aussi près de la folie que celui qui n’en a pas réellement franchi les bornes. Ce geste me retint, pour ainsi dire.
Mon second, l’homme aux terrifiants favoris, était en train de faire virer de bord. Dans le moment de profond silence qui succéda à celui où l’équipage se rendit à son poste de manœuvre, j’entendis sur la dunette sa voix qui s’élevait : « La barre dessous toute » et le cri distant de l’ordre répété sur le pont. Les voiles, par cette légère brise, ne faisaient entendre qu’un faible battement. Il cessa. Le navire venait lentement dans le vent, je retins ma respiration dans le calme renouvelé de l’attente ; on eût dit qu’il n’y avait pas une âme sur le pont. Le cri soudain : « Changez derrière ! » rompit le charme, et au milieu des cris bruyants et du piétinement, qui retentissaient au-dessus de nos têtes, nous reprîmes tous deux notre position habituelle le long de ma couchette.
Il n’attendit pas ma question.
— « Je l’ai entendu qui fourgonnait ici et je n’ai eu que le temps de m’accroupir dans la baignoire », me dit-il à voix basse. « L’homme n’a fait qu’entr’ouvrir la porte et passer le bras pour accrocher le vêtement. Tout de même !… »
— « Je n’avais pas pensé à cela », lui répondis-je, encore plus épouvanté de l’avoir échappé de si peu, et m’émerveillant de ce je ne sais quoi d’inflexible dans son caractère qui le tirait d’affaire si à propos. Son chuchotement ne trahissait aucune agitation. Si quelqu’un devait perdre la tête, ce ne serait certainement pas lui. Il était sain d’esprit. Et il m’en donna une nouvelle preuve lorsqu’il se remit à me parler à voix basse :
— « Ça ne vaudrait rien pour moi de ressusciter. »
C’était ce qu’un revenant eût pu dire, mais ce à quoi il faisait allusion, c’était, — admise par lui à contrecœur, — la théorie du suicide adoptée par son capitaine. Cela servirait évidemment ses projets, si j’avais compris le moins du monde le point de vue qui semblait gouverner l’inaltérable but de ses actions.
— « Vous m’abandonnerez dès que vous pourrez approcher une de ces îles désertes le long de la côte du Cambodge », poursuivit-il.
— « Vous abandonner sur une île déserte ! Nous ne vivons pas un roman d’aventures », protestai-je.
Sa réponse dédaigneuse m’arrêta :
— « Évidemment non. Il n’y a pas le moindre roman d’aventures dans tout ceci. Mais il n’y a rien d’autre à faire. Je ne vous en demande pas davantage. Vous ne supposez pas que j’aie peur de ce qu’ils peuvent me faire ? Prison, potence, ou quoi que ce soit. Mais je ne me vois pas d’ici revenant expliquer de semblables choses à un vieux bonhomme à perruque, et à douze respectables commerçants, hein ? Comment peuvent-ils savoir si je suis coupable ou non ? Ou même de quoi je suis coupable ? Çà, c’est mon affaire ! Que dit la Bible ? « Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Fort bien. Je suis errant et vagabond sur la terre maintenant. Et je vais m’en aller à la nuit comme je suis venu. »
— « Impossible », murmurai-je. « Vous ne pouvez pas faire cela. »
— « Je ne peux pas ?… Pas tout nu comme une âme au jour du Jugement dernier. Je vais m’approprier votre pyjama. Ce n’est pas encore le jour du Jugement dernier et… vous avez parfaitement compris, n’est-ce pas ? »
J’eus soudain honte de moi-même. Je puis dire vraiment que j’avais compris, et mon hésitation à laisser cet homme quitter mon bord à la nage était pure sentimentalité, une sorte de lâcheté.
— « Cela ne peut plus se faire avant la nuit prochaine », murmurai-je. « Le navire a le cap au large, et le vent peut nous manquer. »
— « Du moment que je sais que vous me comprenez », murmura-t-il. « Mais naturellement, vous comprenez. C’est une grande satisfaction que d’avoir trouvé quelqu’un qui me comprenne. On dirait que vous vous êtes trouvé là à point nommé. »
Et toujours à voix basse, comme si, tous deux, chaque fois que nous échangions des paroles, nous n’avions à nous dire que des choses que le monde n’était pas digne d’entendre, il ajouta :
— « C’est véritablement merveilleux ! »
Nous restions côte à côte, conversant de cette façon secrète — parfois silencieux, ou n’échangeant guère qu’un ou deux murmures à de longs intervalles. Et il ne cessait de regarder fixement par le hublot. De temps à autre, le souffle du vent passait sur nos visages. On aurait pu croire que le navire était amarré dans un bassin, tant il glissait d’aplomb et sans murmure sur l’eau silencieuse, envahie par l’ombre, comme sur un océan fantôme.
A minuit je montai sur le pont et, à la grande surprise de mon second, je fis changer les amures. Ses terribles favoris voltigeaient autour de moi comme une critique silencieuse. Je ne l’aurais certainement pas fait s’il s’était agi seulement de sortir aussi rapidement que possible de ce golfe endormi. Je crois bien qu’il déclara au lieutenant que c’était un grand manque de jugement de ma part. L’autre se contenta de bâiller. Cet intolérable blanc-bec se traînait d’une façon si endormie et se prélassait contre la lisse si nonchalamment, si incorrectement, que je fus obligé de le reprendre vivement :
— « Vous n’êtes pas encore bien réveillé ? »
— « Si, capitaine, je suis réveillé. »
— « Eh bien ! alors, faites-moi le plaisir de vous tenir comme si vous l’étiez. Et ouvrez l’œil. S’il y a du courant, nous devons approcher des îles bien avant le jour. »
La côte orientale du Golfe est frangée d’îles, les unes isolées, d’autres en groupes. Sur le fond bleu de cette côte élevée, elles semblent flotter sur des flaques argentées d’eau calme : arides et grises, ou vert foncé et rondes comme des bosquets toujours verts, les plus grandes, longues d’un mille ou deux, montrant la ligne de leur crête, des saillies de rochers gris sous un humide manteau de feuillage entremêlé. Inconnues du trafic, du voyage et presque de la géographie, le genre de vie qu’elles recèlent est demeuré secret. Il doit y avoir des villages, — des colonies de pêcheurs tout au moins, — sur les plus grandes d’entre elles, et les communications avec le monde y sont vraisemblablement entretenues par des embarcations indigènes. Mais toute cette matinée-là, comme nous avancions vers elles, éventés par la plus faible des brises, je ne vis pas l’ombre d’un homme ni d’un canot dans le champ de la longue-vue que je tenais braquée sur l’archipel.
A midi, je ne donnais pas l’ordre de changer la route, et les favoris du second manifestèrent plus d’inquiétude encore et parurent s’offrir d’eux-mêmes, hors de propos, à mon attention. Je finis par lui dire :
— « Je vais continuer droit sur la terre. Tout près, aussi près que je puis passer.
Un regard d’extrême surprise donna une expression de férocité même à ses yeux, et un moment il sembla vraiment terrible.
— « Nous ne gagnons rien à nous tenir au milieu du golfe, repris-je négligemment. Je vais chercher la brise de terre ce soir. »
— « Dieu me pardonne ! Vraiment, capitaine, par une nuit noire, au milieu de ces îlots, récifs et bancs de sable ? »
— « Ma foi ! Si les brises de terre sont régulières sur cette côte, il faut bien s’en approcher pour les trouver, n’est-ce pas ? »
— « Dieu me pardonne ! » s’écria-t-il de nouveau, à voix basse.
Tout l’après-midi, il conserva un air rêveur, contemplatif, qui chez lui trahissait la perplexité. Après dîner, je regagnai ma chambre comme si j’entendais y prendre quelque repos. Là nous penchâmes nos deux têtes brunes au-dessus d’une carte à demi déroulée sur ma couchette.
— « Voilà ! » dis-je. « Il faut que ce soit Koh-Ring. Je n’ai cessé de regarder l’île depuis le lever du soleil. Il y a là deux collines et une pointe basse. Ce doit être habité. Et sur la côte, en face de l’île, il semble y avoir l’embouchure d’une assez grande rivière, avec une ville, sans doute, pas bien loin de là. C’est ce que je vois de mieux pour vous. »
— « Bon. Va pour Koh-Ring. »
Il considéra attentivement la carte, comme s’il examinait, de très haut, chances et distances, et s’il suivait des yeux sa propre silhouette avançant sur l’espace blanc qui représentait la Cochinchine, puis dépassant cette feuille de papier et se perdant dans des régions inconnues sur la carte. On eût dit que le navire avait deux capitaines pour lui tracer sa route. Je m’étais tellement énervé et fatigué à monter et à descendre que je n’avais pas eu le courage de m’habiller ce jour-là. J’avais conservé mon pyjama, des pantoufles de paille et un chapeau mou. La chaleur lourde du golfe était accablante, et l’équipage était habitué à me voir aller et venir dans ce léger appareil.
— « On va parer la pointe sud, avec ce cap-là », lui chuchotai-je à l’oreille. « Dieu seul sait quand, toutefois ; mais certainement après que la nuit sera venue. Je vais l’approcher à un demi-mille, autant que je pourrai en juger dans le noir… »
— « Soyez prudent », murmura-t-il, et je compris soudain que tout mon avenir, l’unique avenir qui m’était possible risquait d’être irréparablement compromis par quelque maladresse, au cours de mon premier commandement.
Je ne pus rester davantage dans ma chambre. Je le fis disparaître et gagnai la dunette. Cet odieux blanc-bec était de quart. J’arpentai la dunette tout en réfléchissant, puis je lui fis signe de s’approcher.
— « Envoyez-moi deux hommes ouvrir les deux sabords arrière », lui dis-je très doucement.
Soit simple impudence, soit étonnement d’un ordre si incompréhensible, il s’oublia au point de dire :
— « Ouvrir les sabords ; mais pour quoi faire, capitaine ? »
— « La seule raison dont vous ayez à vous inquiéter est que je vous dis de le faire ! Faites-les ouvrir tout grand et convenablement amarrés. »
Il rougit et s’éloigna, mais il fit, je crois, quelque remarque gouailleuse au charpentier sur l’intelligent système qui consistait à aérer le pont d’un navire. Je sais en tout cas qu’il passa la tête dans la cabine du second pour l’en informer, car les favoris sortirent sur le pont comme par enchantement et me considérèrent furtivement d’en bas, — en quête de quelque signe de démence ou d’ivresse, je suppose.
Un peu avant le souper, me sentant plus agité que jamais, je rejoignis, un instant, mon double. Et je fus surpris de le trouver si tranquille, — comme s’il y avait là quelque chose d’inhumain, contre nature.
Je développai mon plan en chuchotant précipitamment :
— « Je me tiendrai aussi près que je l’oserai avant de virer de bord. Tout à l’heure, je trouverai le moyen de vous faire passer d’ici dans la soute à voiles qui communique avec l’avant-carré. La soute a également une ouverture, une sorte de panneau rectangulaire pour retirer les voiles, qui donne droit sur le pont et qui n’est jamais fermé par beau temps, de façon à pouvoir aérer les voiles. Quand le navire aura perdu son erre en virant de bord, et que tout le monde sera à l’arrière aux grands bras, vous aurez la voie libre pour vous échapper et quitter le bord par un des sabords ouverts. Je les ai fait ouvrir tous les deux. Servez-vous d’un bout de filin pour vous affaler à l’eau afin d’éviter le bruit, vous comprenez ? Cela pourrait s’entendre et amener des complications. »
Il resta un instant silencieux, puis murmura :
— « Je comprends. »
— « Je ne serai pas là pour vous voir partir », commençai-je avec effort. « Pour le reste… J’espère seulement que j’ai compris aussi. »
— « Vous avez compris. Du commencement jusqu’à la fin. » Et pour la première fois on eût dit qu’il y avait quelque hésitation, comme une contrainte, dans sa voix. Il me saisit par le bras, mais la cloche du dîner me fit tressaillir. Lui, pas ; il relâcha seulement son étreinte.
Après le souper, je ne redescendis que bien après huit heures. La brise légère et régulière était chargée de rosée, et les voiles mouillées, assombries par l’humidité, retenaient tout ce qu’il y avait en elles de force propulsive. La nuit, claire et étoilée, scintillait sur un fond noir, et les taches opaques qui passaient lentement devant les étoiles basses étaient des îles qui semblaient glisser. Au-dessus du bossoir babord il y en avait une grande, plus éloignée, imposante par le grand morceau de ciel que son ombre éclipsait.
En ouvrant la porte, je vis de dos mon autre moi-même qui examinait une carte. Il était sorti de son recoin et se tenait debout près de la table.
— « Il fait maintenant assez sombre ? » chuchotai-je.
Il recula et s’adossa à ma couchette, avec un regard tranquille. Je m’assis sur le canapé. Nous n’avions rien à nous dire. Au-dessus de nos têtes, l’officier de quart allait et venait. Puis je l’entendis marcher rapidement. Je savais ce que cela voulait dire ; il allait descendre l’échelle du carré. Tout à coup sa voix se fit entendre de l’autre côté de ma porte.
— « Nous approchons un peu vite, capitaine. La terre semble assez près. »
— « Très bien », répondis-je. « Je serai sur le pont dans un instant. » J’attendis qu’il eût quitté le carré, puis je me levai. Mon double fit un mouvement. L’heure était venue d’échanger nos derniers murmures, car aucun d’entre nous ne devait jamais entendre la voix naturelle de l’autre.
— « Écoutez ! » — j’ouvris un tiroir et en sortis trois souverains. — « Prenez toujours ça. J’en ai six et je vous aurais volontiers donné le tout si je ne devais garder un peu d’argent pour acheter des fruits et des légumes pour l’équipage à des barques indigènes, en traversant le détroit de la Sonde.
Il fit de la tête un geste de refus.
— « Prenez », insistai-je, en chuchotant, « on ne sait jamais ce qui… »
Il sourit et d’un air significatif tapota l’unique poche du pyjama. Ce n’était pas sûr, assurément. Mais je sortis un vieux mouchoir de soie que j’avais, et, nouant les trois pièces d’or dans un coin, je le pressai de les prendre. Il en fut touché, je pense, car il le prit à la fin et le noua rapidement autour de sa taille, à même la peau.
Nos yeux se croisèrent, plusieurs secondes s’écoulèrent, jusqu’au moment où nos regards, toujours attachés l’un à l’autre, j’étendis le bras pour éteindre la lampe. Puis je traversai le carré, laissant la porte de ma chambre grande ouverte :
— « Steward ! »
Il s’attardait à l’office, dans l’excès de son zèle, à frotter un huilier de métal, dernière occupation avant d’aller se coucher. Comme je craignais de réveiller le second dont la chambre était en face, je lui parlai à voix basse.
Il regarda autour de lui d’un air anxieux.
— « Capitaine ! »
— « Pourriez-vous m’avoir un peu d’eau chaude à la cuisine ? »
— « Je crains, capitaine, que le fourneau ne soit éteint depuis quelque temps déjà. »
— « Allez voir. »
Il bondit dans l’échelle.
— « Maintenant ! » murmurai-je dans le carré, trop haut peut-être, mais j’avais peur de ne pouvoir émettre un son.
Il fut à mes côtés aussitôt : le capitaine et son double se glissèrent le long de l’escalier, à travers un petit passage obscur… une porte à glissière. Nous étions dans la soute, grimpant à quatre pattes sur les voiles. Une idée soudaine me frappa : je me vis errant nu-pieds, nu-tête, avec le soleil tapant dur sur ma caboche noire. J’arrachai mon chapeau et m’efforçai hâtivement, dans l’obscurité de le lui enfoncer sur la tête. Il m’évitait et me repoussait en silence. Je me demande ce qu’il pensait que je lui voulais, avant qu’il eût compris et qu’il cessât soudain de s’y opposer. Nos mains s’unirent à tâtons, s’attardèrent une seconde dans une forte, immobile étreinte. Aucun de nous ne prononça la moindre parole quand elles se séparèrent.
J’attendais tranquillement à la porte de l’office quand le steward revint.
— « Je suis désolé, capitaine, la bouilloire est presque froide. Faut-il allumer la lampe à alcool ? »
— « Ce n’est pas la peine. »
Je sortis lentement sur le pont. C’était maintenant une question de conscience pour moi que de raser la terre aussi près que possible, car il lui faudrait plonger aussitôt que le navire serait debout au vent. Il le fallait ! Il ne pouvait plus reculer. Au bout d’un moment, je m’en allai sous le vent pour voir, et la surprise de distinguer la terre si près me prit à la gorge. En toute autre circonstance, je n’aurais pas persisté une minute de plus. Le lieutenant m’avait suivi avec anxiété.
Je continuai à regarder jusqu’à ce que je me sentisse en état de maîtriser ma voix.
— « Nous pourrons passer au vent », fis-je alors d’une voix tranquille.
— « Vous allez essayer cela, capitaine ? » balbutia-t-il d’un air incrédule.
Je ne prêtai aucune attention à lui et élevai la voix juste assez pour me faire entendre du timonier.
— « Gouvernez bon plein ! »
— « Bien, capitaine. »
La brise éventait ma joue, les voiles dormaient, l’univers était silencieux. L’effort que je faisais pour surveiller l’indistincte et sombre élévation de la terre qui devenait plus grande et plus épaisse était presque trop grand pour mes nerfs. J’avais fermé les yeux, car il fallait que le navire passât encore plus près. Il le fallait. Le silence était intolérable. Étions-nous immobiles ?
Quand je rouvris les yeux, la vue de la terre me fit tressauter le cœur. La haute pointe noire, au sud de Koh-Ring, semblait suspendue juste au-dessus du navire comme un fragment de la nuit éternelle. De cette masse de ténèbres ne jaillissaient ni la moindre lueur, ni le moindre son. Elle glissait vers nous irrésistiblement et semblait pourtant déjà à portée de la main. Je vis les formes vagues des hommes de quart groupées au passavant et qui regardaient dans un silence terrifié.
— « Allez-vous continuer, capitaine ? » demanda une voix mal assurée près de moi.
J’ignorai cette voix. Il me fallait continuer.
— « Tenez les voiles pleines. Ne cassez pas l’erre, n’est-ce pas ? » dis-je d’un ton d’avertissement.
— « Je ne distingue pas très bien les voiles », me répondit le timonier d’une voix étrange, chevrotante.
Étions-nous assez près ? Le navire était déjà, je ne dirai pas, dans l’ombre de la terre mais comme englouti dans son obscurité, trop engagé pour en sortir, échappé de mes mains également.
— « Appelez le second », dis-je au blanc-bec qui se tenait près de moi, dans un silence de mort. « Et appelez tout l’équipage sur le pont. »
Ma voix résonna avec une force qui venait de la répercussion de la terre. Plusieurs voix crièrent à la fois :
— « Nous sommes tous sut le pont, capitaine. »
Puis le silence reprit, avec la grande ombre qui glissait, plus proche, nous dominant de plus haut, sans un son, sans une lumière. Un tel silence s’était appesanti sur le navire qu’il eût pu être la barque des morts flottant lentement aux portes même de l’Érèbe.
— « Mon Dieu ! Où sommes-nous ? »
C’était le second qui gémissait à mes côtés. Il était atterré et, l’on eût dit, privé de l’appui moral de ses favoris. Il se frappa les mains et d’un air désespéré s’écria :
— « Nous sommes perdus. »
— « Silence », fis-je sévèrement.
Il baissa le ton, mais je vis dans l’ombre son geste de désespoir.
— « Qu’est-ce que nous faisons ? »
— « Nous cherchons le vent de terre. »
On eût dit qu’il allait s’arracher les cheveux et, perdant toute retenue, il m’apostropha :
— « Le navire n’en sortira jamais. Vous l’avez voulu, capitaine ! Je savais bien que ça finirait comme cela. Jamais le navire ne passera au vent, et vous êtes trop près maintenant pour virer de bord. Il dérivera sur la terre avant d’abattre. O mon Dieu ! »
Je lui saisis le bras au moment où il allait le lever pour frapper sa malheureuse tête et le lui secouai violemment.
— « On peut dire qu’il est déjà échoué », se lamenta-t-il, en essayant de m’échapper.
— « Ah ! vraiment ?… Tenez bon plein, timonier ! »
— « Bien, capitaine », cria le timonier d’un ton d’enfant effrayé.
Je n’avais pas lâché le bras du second et continuai de le secouer.
— « Pare à virer, entendez-vous ? Vous, allez devant ! — (secousse) — et restez-y ! — (secousse) — et pas d’enfantillage — (secousse) — et veillez à ce que ces écoutes de focs soient promptement larguées ! — (secousse, secousse, secousse.) — »
Et pendant ce temps je n’osais regarder vers la terre de crainte que le cœur ne vînt à me manquer. Je relâchai mon étreinte à la fin, et il prit la fuite comme si la mort était à ses trousses.
Je me demande ce que mon double là-bas, dans la soute à voiles, pensait de toute cette agitation. Il pouvait tout entendre, et peut-être pouvait-il comprendre pourquoi, pour l’acquit de ma conscience, il avait fallu tenir aussi près que cela : pas moins. Mon premier ordre : « La barre dessous, toute », se répercuta sinistrement sous l’ombre dominante de Koh-Ring, comme si je l’avais crié dans le ravin d’une montagne. Puis, je guettai la terre attentivement. Sur cette eau calme et par cette légère brise il était impossible de sentir le navire loffer. Non. Je ne pouvais rien sentir. Et mon second moi-même s’apprêtait maintenant à se glisser sur le pont et à s’affaler par-dessus bord ! Peut-être était-il déjà parti ?
La grande masse noire qui planait juste sur la tête des mâts se mit à pivoter silencieusement. Et maintenant j’avais oublié le compagnon secret prêt à partir et me rappelai seulement que j’étais totalement étranger aux qualités de ce navire. Non, je ne le connaissais pas. Allait-il me trahir ? Le manœuvrais-je comme il le fallait ?
Je donnai l’ordre : « Changez derrière », puis j’attendis. Il avait peut-être perdu toute son erre, et sa destinée même était dans la balance ; la masse noire de Koh-Ring était comme la porte de la nuit éternelle dominant sa dunette. Qu’allait-il faire à présent ? Avait-il encore de l’erre ? Je me penchai en dehors, rapidement, et sur l’eau obscurcie je ne pus rien voir qu’un faible éclat phosphorescent qui révélait la surface lisse et assoupie de la mer. Il était impossible de le dire, et je n’avais pas encore appris à avoir mon navire en main. Allait-il de l’avant ? Ce qu’il me fallait, c’était quelque chose de facile à voir, un bout de papier blanc que j’aurais jeté par-dessus bord pour me repérer. Je n’avais rien sur moi. Descendre en hâte chercher quelque chose, je n’osais. Je n’en avais pas le temps. Tout à coup mon regard tendu, anxieux, distingua un objet blanc qui flottait à moins d’un mètre du bord, blanc sur l’eau noire. Une lueur phosphorescente passa dessous. Qu’était-ce ?… Je reconnus mon propre chapeau. Il devait lui être tombé de la tête… et il ne s’en était pas soucié. Maintenant j’avais ce qu’il me fallait, le repère qui me sauvait. Mais j’accordai à peine une pensée fugitive à cet autre moi-même, qui avait maintenant quitté le bord pour s’en aller à jamais loin de toute figure amie, fugitif et vagabond sur la terre, sans qu’une marque de malédiction imprimée sur son front pût retenir une main meurtrière… trop fier pour s’expliquer.
Et je fixai le chapeau, témoignage de ma soudaine pitié pour sa faible chair. Mon intention avait été d’abriter sa tête errante contre les dangers du soleil. Et à présent, voilà qu’il nous sauvait, en me fournissant un repère contre l’ignorance où j’étais de mon navire. Ah ! Je m’aperçus que la tache blanche dérivait sur l’avant, me faisant ainsi comprendre à temps que le navire culait.
— « Changez la barre », dis-je à voix basse au matelot qui se tenait immobile comme une statue.
Les yeux de l’homme brillèrent étrangement à la lumière de l’habitacle quand il se jeta de l’autre côté de la roue et la fit tourner rapidement.
Je me dirigeai vers l’avant de la dunette. Sur le pont enseveli d’ombre, les hommes se tenaient aux bras de devant, attendant mes ordres. Les étoiles, là-haut, semblèrent glisser de droite à gauche. La tranquillité du monde était si profonde que j’entendis deux hommes échanger cette remarque à voix basse : « L’abatée est faite » sur un ton d’intense soulagement.
— « Changez devant. »
Les vergues tournèrent avec un grand bruit, parmi des cris joyeux. On entendit les effrayants favoris donner les ordres nécessaires. Déjà le navire avait pris de l’erre en avant. Et j’étais seul avec lui. Rien, personne au monde ne pouvait à présent s’interposer entre nous et venir assombrir d’un doute notre connaissance silencieuse et notre affection muette, la parfaite communion d’un marin avec son premier commandement.
En me dirigeant vers l’arrière, j’eus juste le temps de distinguer sur le bord de l’obscurité projetée par une masse noire qui se dressait comme l’entrée même de l’Érèbe, — oui, j’eus le temps de saisir la fugitive lueur du chapeau blanc, laissé derrière nous pour marquer l’endroit où celui qui avait partagé secrètement ma cabine et mes pensées, comme s’il eût été un second moi-même, avait pris la mer pour son expiation : homme libre, fier nageur s’élançant vers une nouvelle destinée.
Un jour, — voilà maintenant bien des années, — je reçus une bonne et interminable lettre d’un de mes vieux camarades, qui avait bourlingué comme moi et de mon temps en Extrême-Orient. Il y était encore, mais s’y était établi, et avait maintenant un certain âge ; je me le figurais devenu corpulent et ayant pris des habitudes domestiques : soumis en un mot au sort qui nous est commun à tous, sauf à ceux qui, spécialement chéris des Dieux, attrapent dans leur jeune âge un bon coup de tête. La lettre était parsemée de « vous rappelez-vous ? » ; succession de regards d’envie jetés sur le passé. Et entre autres choses, il me disait : « Vous devez sûrement vous rappeler le vieux Nelson. »
Si je me rappelais le vieux Nelson ! Certainement ! Et d’abord, il ne s’appelait pas Nelson. Les Anglais dans l’Archipel malais l’appelaient Nelson pour la commodité, je suppose, et il n’avait jamais protesté. C’eût été pur pédantisme. La véritable forme de son nom était Nielsen. Il était arrivé en Extrême-Orient bien avant l’installation des câbles télégraphiques, avait été employé par des maisons anglaises, avait épousé une Anglaise, avait été des nôtres pendant des années, faisant le commerce et naviguant à travers tout l’Archipel, dans toutes les directions, en long, en large, transversalement, perpendiculairement, en diagonale, en demi-cercles, en zigzags, en huit, et cela pendant des années et des années.
Il n’était coins ni recoins de ces eaux tropicales où la nature entreprenante du vieux Nelson (ou Nielsen) ne l’eût fait pénétrer, on ne peut plus pacifiquement. Ses parcours, si on les avait tracés, auraient couvert la carte de l’Archipel comme une toile d’araignée, — d’un bout à l’autre, à la seule exception des Philippines. Il se tenait toujours à distance de ces parages, à cause de la singulière terreur que lui inspiraient les Espagnols, ou plus exactement les autorités espagnoles. Ce qu’il imaginait qu’elles pouvaient bien lui faire, il est impossible de le dire. Peut-être avait-il lu à un moment de sa vie, des histoires du temps de l’Inquisition.
Il appréhendait en général ce qu’il appelait « les autorités » : pas les autorités anglaises en qui il avait confiance et qu’il respectait ; mais les deux autres qui se rencontraient dans cette partie du monde. Les Hollandais ne lui inspiraient pas la même terreur que les Espagnols, mais il s’en méfiait encore davantage. Il s’en méfiait énormément. Les Hollandais étaient, à son avis, capables de « jouer n’importe quel mauvais tour » à un homme qui avait la malchance de leur déplaire. Ils avaient bien des lois et des règlements, mais ils les appliquaient sans aucun esprit de justice. C’était vraiment pathétique de voir la circonspection qu’il apportait dans ses relations avec les fonctionnaires, surtout quand on savait que ce même homme était allé se promener dans un village de cannibales de la Nouvelle Guinée, avec la plus calme intrépidité, (et notez pourtant qu’il avait été toute sa vie assez bien en chair et qu’il constituait, si je puis ainsi dire, un morceau appétissant) et tout cela pour une affaire qui, en fin de compte, ne s’était peut-être pas élevée à plus de cinquante livres.
Si je me rappelais le vieux Nelson ! Parbleu ! A vrai dire aucun de nous ne l’avait connu pendant la période active de sa vie. De notre temps il était déjà « retiré ». Il avait acheté, ou loué, un bout de terre au Sultan d’un groupe d’îlots que l’on appelait les Sept-Iles, pas très loin au nord de Banka. Ç’avait été, je le suppose, une transaction des plus légitimes : mais j’ai toute raison de croire que s’il eût été Anglais, les Hollandais auraient trouvé une raison pour le faire déguerpir sans cérémonie. En cette occurrence, la forme réelle de son nom lui fut de quelque secours. En sa qualité de Danois, et, étant données sa modestie et sa conduite on ne peut plus correcte, on le laissa tranquille. Comme tout son argent était placé dans son exploitation, il avait grand soin d’éviter de se mettre dans son tort, et c’était surtout pour des raisons de prudence de cet ordre qu’il ne voyait pas Jaspar Allen d’un très bon œil. Mais je reviendrai là-dessus plus tard… Certes ! Comment ne pas se rappeler le grand bungalow hospitalier que le vieux Nelson avait fait bâtir sur le penchant d’un promontoire ; je me rappelle la forme corpulente de cet homme, généralement vêtu d’une chemise blanche et d’un pantalon blanc, (il avait l’habitude invétérée de retirer sa veste d’alpaga sous le moindre prétexte), ses yeux bleus tout ronds, sa moustache ébouriffée d’un blanc roussâtre, hérissée comme les piquants d’un porc-épic, et sa façon de s’asseoir brusquement et de s’éventer avec son chapeau. Mais à quoi bon essayer de dissimuler que ce que l’on se rappelait surtout, c’était sa fille, qui, à cette époque, était venue habiter avec lui, et jouait le rôle d’une sorte de Dame-des-Iles.
Freya Nelson (ou Nielsen) était de ces jeunes filles dont on se souvient. L’ovale de son visage était parfait : et à l’intérieur de ce cadre attrayant, la plus heureuse disposition de lignes et de traits, jointe à un teint admirable, vous donnait une impression de santé, de force, et de ce que j’appellerais une inconsciente confiance en soi, la sensation d’une résolution séduisante encore que fantasque. Je ne comparerai pas ses yeux à des violettes, car ils avaient une nuance particulière, moins foncée et d’un éclat plus vif. Elle avait de grands yeux qui vous regardaient franchement quelle que fût son humeur. Je n’ai jamais vu s’abaisser ses longs cils sombres, — je crois pouvoir dire que Jasper Allen les vit ; c’était une personne privilégiée, — mais son expression a certainement dû être alors tout à fait charmante, d’un charme complexe. Il paraît — je tiens ce renseignement de Jasper qui me le révéla dans un accès d’enthousiasme touchant et ridicule, — qu’elle pouvait s’asseoir sur ses cheveux. Je le crois. Je le crois. Il ne m’était pas donné de contempler de pareilles merveilles : je me contentais d’admirer la façon nette et seyante dont sa coiffure laissait voir la jolie forme de sa tête. Et cette chevelure luxuriante avait un tel éclat que lorsque les stores de la véranda étaient baissés et y répandaient une douce pénombre ou bien dans l’ombre du bouquet d’arbres fruitiers près de la maison, on eût dit qu’elle dégageait une lumière dorée.
Elle portait généralement une robe blanche dont la jupe lui tombait au-dessus de la cheville et découvrait des bottines jaunes à lacets. Si on lui voyait une note de couleur quelconque, c’était tout au plus un peu de bleu. Elle ne semblait jamais fatiguée. Je l’ai vue, après avoir longtemps ramé au soleil, débarquer de son canot, sans se montrer aucunement essoufflée et sans être le moins du monde décoiffée. Le matin, quand elle sortait sur la véranda pour jeter un coup d’œil vers l’ouest, du côté de Sumatra, vers la mer, elle avait l’air aussi fraîche et étincelante qu’une goutte de rosée. Mais une goutte de rosée s’évapore, tandis que Freya n’avait rien d’évanescent. Je me rappelle ses bras ronds et musclés aux poignets minces, et les doigts effilés de ses grandes mains adroites.
Je ne sais si elle était vraiment née en mer, mais je sais que jusqu’à l’âge de douze ans elle avait constamment navigué avec ses parents, sur différents navires. Lorsque le vieux Nelson eût perdu sa femme, ce fut pour lui une grave préoccupation que celle de l’avenir de l’enfant. Une excellente dame de Singapour, touchée par son chagrin muet et sa pitoyable perplexité, offrit de se charger de Freya. Cet arrangement dura quelque six ans, pendant lesquels le vieux Nelson (ou Nielsen) se « retira » et alla s’établir sur son île, et il fut décidé (l’excellente dame repartant pour l’Europe) que sa fille viendrait le rejoindre.
La première et la plus importante préparation à cet événement consista pour le vieux Nelson à demander à son agent de Singapour un piano droit de chez Steyn et Ebhart. Je commandais alors un petit vapeur qui faisait le service de l’île, et c’est moi qui eus à le lui transporter, aussi sais-je à quoi m’en tenir sur le piano de Freya. Nous débarquâmes l’énorme caisse non sans difficulté sur un rocher plat parmi des buissons, et nous faillîmes défoncer un de mes canots au cours de cette opération nautique. Puis, avec l’assistance de tous mes hommes, y compris les mécaniciens et les soutiers, au prix d’une inquiète ingéniosité, et à l’aide de rouleaux, de leviers, de palans et de plans inclinés faits de planches savonnées, travaillant en plein soleil comme les anciens Egyptiens à la construction d’une pyramide, nous l’amenâmes jusqu’à la maison et le hissâmes à l’extrémité de la véranda qui regardait vers l’ouest et qui servait de salon au bungalow. Là, une fois la caisse ouverte avec précaution, le magnifique monstre de palissandre apparut enfin. Avec un empressement respectueux nous l’adossâmes au mur et pûmes enfin respirer pour la première fois de la journée. C’était bien certainement le meuble le plus lourd qui se fût jamais trouvé sur cet îlot depuis la création du monde. La sonorité qu’il répandait autour du bungalow (qui formait caisse de résonnance) était véritablement étonnante. Il résonnait doucement au-dessus de la mer. Jasper Allen m’a dit que de bonne heure le matin, sur le pont du Bonito (son brick, un bâtiment aux lignes fines et remarquablement rapide) il pouvait entendre distinctement Freya faire ses gammes. Mais il faut dire que ce garçon prenait toujours son mouillage à une distance absurdement rapprochée de la pointe, et je le lui avais plus d’une fois fait remarquer. Je sais bien que, dans ces parages, la mer est presque uniformément calme et que les Sept-Iles sont, en règle générale, un endroit particulièrement serein et dépourvu de nuages. Tout de même, de temps à autre, un orage d’après-midi sur Banka, ou même un de ces mauvais grains venus de la côte de Sumatra, faisait une sortie soudaine contre ce groupe d’îles et vous l’enveloppait, durant une heure ou deux, de tourbillons et d’une obscurité bleuâtre d’assez sinistre apparence. Tandis que les stores de rotin qu’on avait baissés s’agitaient désespérément au vent et que tout le bungalow tremblait, Freya se mettait alors au piano et jouait quelques farouches pages de Wagner à la lueur aveuglante des éclairs, cependant que la foudre tombait aux alentours, à vous faire dresser les cheveux sur la tête : et Jasper restait figé sur la véranda dans l’adoration de cette souple silhouette qu’il voyait de dos se balancer, de cet éclat miraculeux de sa belle tête, de sa blanche nuque, — cependant que le brick, là-bas à la pointe, tanguait sur sa bosse à moins de cent mètres d’affreux récifs, noirs et luisants.
Et cela, s’il vous plaît, uniquement pour qu’une fois à bord, la nuit, la tête sur l’oreiller, il pût se sentir aussi près que possible de Freya endormie dans le bungalow. Que dites-vous de cela ? Et remarquez que ce brick était le futur foyer, — leur foyer, — le paradis flottant qu’il accommodait peu à peu comme un yacht pour faire en toute béatitude la traversée de la vie avec Freya. Imbécile ! Mais ce garçon passait son temps à courir la chance.
Un jour, je m’en souviens, de la véranda je regardais avec Freya le brick qui approchait de la pointe en venant du nord. Je suppose que Jasper avait aperçu la jeune fille à la lorgnette. Que fait-il ? Au lieu de longer encore les bancs sur un mille et demi pour ensuite tirer un bord vers le mouillage par une manœuvre classique et digne d’un marin, il avise une passe entre deux sales cailloux pointus, met d’un coup la barre dessous et y lance son brick dont toutes les voiles se mirent à ralinguer et à battre au point qu’on pouvait en entendre le bruit de la véranda où nous étions. Je retenais mon souffle entre mes dents, je vous l’avoue, et Freya se mit à jurer. Oui. Elle serra les poings, frappa du pied, son joli pied chaussé de jaune et s’écria : « Bon Dieu ! » Puis tournant vers moi son visage légèrement plus coloré que d’habitude, — oh ! pas beaucoup, — elle ajouta : « Excusez-moi ! j’oubliais que vous étiez là », et elle se mit à rire. Parfaitement. Quand Jasper était en vue, il y avait toute chance pour qu’elle oubliât la présence de n’importe qui. Frappé de cette extravagance je ne pus me retenir de faire appel au sens commun de la jeune fille.
— « Il n’est pas fou ? » lui dis-je avec conviction.
— « C’est un parfait idiot », déclara-t-elle avec chaleur, tandis que ses grands yeux graves me regardaient bien en face et qu’un léger sourire se dessinait sur sa joue.
— « Et cela », lui fis-je remarquer, « juste pour gagner vingt minutes à peu près avant de vous retrouver. »
Nous entendîmes mouiller l’ancre, et elle prit alors une expression résolue et menaçante.
— « Attendez un peu. Je vais lui donner une leçon. »
Elle alla s’enfermer dans sa chambre, me laissant seul sur la véranda avec des instructions. Avant même que les voiles du brick ne fussent serrées, Jasper arriva, montant trois marches à la fois, oubliant de me dire bonjour et regardant avidement à droite et à gauche.
— « Où est Freya ? N’était-elle pas là il y a un instant ? »
Quand je lui eus expliqué qu’il serait privé de la présence de Mademoiselle Freya pendant toute une heure, « uniquement pour lui apprendre », il déclara que c’était moi sûrement qui l’avais poussée à cela et qu’il craignait qu’un de ces jours il ne m’arrivât malheur. Elle et moi nous devenions trop bons amis tous les deux. Après quoi il se jeta sur une chaise et essaya de me parler de son voyage. Mais ce qu’il y avait de singulier, c’est que ce garçon souffrait véritablement. Je pouvais m’en rendre compte. La voix lui manquait et il restait là, muet, à fixer la porte avec la figure d’un homme qui a mal. C’était un fait… Et ce qui fut plus singulier encore, ce fut de voir la jeune fille sortir de sa chambre tranquillement moins de dix minutes après. Alors je partis. Je veux dire que je m’en allai chercher le vieux Nelson (ou Nielsen) sur la véranda de derrière (qui lui était spécialement réservée dans la distribution de cette maison), avec l’intention d’engager la conversation pour l’empêcher de faire, sans le vouloir, irruption là où sa présence n’était pas justement alors désirable.
Il savait que le brick était arrivé, quoiqu’il ne sût pas que Jasper fût déjà avec sa fille. Je suppose qu’il ne pensait pas qu’il eût eu déjà le temps de la rejoindre. Un père naturellement ne pouvait pas penser cela. Il soupçonnait bien Allen d’avoir un faible pour sa fille : les volatiles de l’air et les poissons de la mer, la plupart des trafiquants de l’Archipel et des gens de toutes sortes et de toutes conditions à Singapour savaient à quoi s’en tenir ; mais il n’était pas capable d’apprécier l’intérêt que la jeune fille prenait à ce garçon. Il était persuadé que Freya était beaucoup trop raisonnable pour s’emballer jamais sur quelqu’un, — je veux dire au point d’en perdre la tête. Non : ce n’est pas cela qui le faisait s’asseoir dans sa véranda et se tourmenter tout le temps des visites de Jasper. Ce qui l’inquiétait, c’était les « autorités » hollandaises. Car, en fait, les Hollandais ne voyaient pas d’un bon œil les allées et venues de Jasper, armateur et patron du brick Bonito. Ils le considéraient comme beaucoup trop entreprenant. Je ne sache pas qu’il eût jamais rien fait d’illégal : mais il me semble que son immense activité répugnait à leur caractère pesant et à leurs lentes méthodes. En tout cas, de l’avis du vieux Nelson, le capitaine du Bonito était un très bon marin et un excellent garçon, mais, somme toute, ce n’était pas une relation souhaitable. Quelque peu compromettante, vous comprenez. D’un autre côté, il n’eût pas aimé dire carrément à Jasper de se tenir à distance. Ce pauvre vieux Nelson était lui-même un excellent homme. Je crois qu’il aurait tremblé à l’idée de blesser les sentiments fût-ce même d’un cannibale, à moins d’une violente provocation. Je dis les sentiments, je ne dis pas le corps. Car contre des lances, des couteaux, des haches, des massues ou des flèches, le vieux Nelson s’était montré capable de tenir son rôle. A tout autre égard, il était d’une nature timorée. Aussi, l’air ennuyé, allait-il s’asseoir dans la véranda du fond, et quand les voix de sa fille et de Jasper Allen arrivaient jusqu’à lui, il poussait de sombres soupirs comme un homme extrêmement las.
Il va sans dire que je me moquais de ses craintes, qu’il me confiait, plus ou moins. Il avait une certaine confiance dans mon jugement et un certain respect non pas tant pour mes qualités morales que pour les excellents termes dans lesquels j’étais supposé vivre avec les « autorités » hollandaises. Je savais avec certitude que son plus grand épouvantail, le Gouverneur de Banka, — un charmant homme, irritable mais cordial, un ancien contre-amiral, — avait beaucoup de sympathie pour lui. Cette assurance consolante que je mettais toujours en avant, ranimait un moment le vieux Nelson (ou Nielsen) : mais, en fin de compte, il hochait la tête d’un air de doute, comme pour dire que tout cela était très bien, mais qu’il y avait dans la nature des fonctionnaires hollandais des profondeurs que personne d’autre que lui n’avait jamais sondées. C’était parfaitement absurde.
La fois dont je parle, le vieux Nelson se montra même vraiment tracassé : car tandis que j’essayais de le distraire avec une aventure très amusante et quelque peu scandaleuse qui était arrivée à une de nos connaissances à Saïgon, il s’écria tout à coup :
— « Mais que diable vient-il faire ici ? »
Il n’avait évidemment pas écouté un traître mot de l’anecdote : et cela m’ennuya car elle était vraiment bonne. Je le regardai fixement.
— « Allons, allons ! » m’écriai-je. « Vous ne savez pas ce que Jasper Allen vient faire ici ? »
C’était la première allusion directe que j’eus jamais faite à ce qui se passait véritablement entre Jasper et sa fille. Il prit la chose avec beaucoup de calme.
— « Oh ! Freya est une fille raisonnable ! » murmura-t-il d’un air absent, tout en songeant évidemment aux « autorités ». Non, Freya n’était pas stupide. Il n’avait pas d’inquiétude là-dessus. Il ne s’en préoccupait pas le moins du monde. Ce garçon était simplement une compagnie pour elle : il amusait la jeune fille : rien de plus.
Quand ce brave homme perspicace cessait de grommeler, la paix régnait dans la maison. Les deux autres s’amusaient très tranquillement, et sans aucun doute de tout leur cœur. Quel amusement plus absorbant et moins bruyant auraient-ils pu trouver que de faire des plans d’avenir ? Assis côte-à-côte sur la véranda, ils devaient regarder le brick, qui était en tiers dans cette fascinante aventure. Sans lui il n’y aurait pas eu d’avenir. C’était la fortune et le foyer, et le monde entier ouvert devant eux. Qui donc a osé comparer un navire à une prison ? Qu’on me pende ignominieusement à une vergue, si c’est vrai ! Les voiles blanches de ce bâtiment étaient les blanches ailes de leur ardent amour. Ardent en ce qui concerne Jasper. Freya, étant femme, savait mieux observer les convenances mondaines en cette affaire.
Mais Jasper était transporté, au vrai sens du mot, depuis le jour où, après avoir regardé ensemble le brick pendant un de ces silences décisifs qui seuls peuvent établir une communion parfaite entre des êtres doués de langage, il lui avait offert de partager avec lui la possession de ce trésor. A la vérité, il lui avait offert le brick tout entier. Mais son cœur était alors avec le brick, depuis le jour où il l’avait acheté à Manille à un Péruvien d’un certain âge, sobrement vêtu de noir, énigmatique et sentencieux, qui avait peut-être bien volé ce navire sur la côte orientale de l’Amérique du Sud, d’où il disait être venu au Philippines « pour des raisons de famille ». Ce pour des raisons de famille était vraiment bien. Aucun vrai caballero n’eût osé pousser plus loin l’investigation après une pareille déclaration.
En vérité, Jasper était tout à fait le caballero. Quant au brick lui-même, il était alors tout noir, mystérieux et fort sale : une perle de mer ternie, ou plutôt une œuvre d’art à l’abandon. Car ce devait être un artiste, cet obscur constructeur qui, du bois tropical le plus dur renforcé du cuivre le plus pur, avait tiré les lignes harmonieuses de son corps. Dieu seul sait dans quelle partie du monde on l’avait construit. Jasper lui-même n’avait pu découvrir grand’chose de son histoire dans les propos de son sentencieux et taciturne Péruvien, — si tant est que l’individu fût vraiment un Péruvien et non pas le diable en personne comme Jasper prétendait le croire. Mon opinion est que ce bâtiment était assez vieux pour avoir été l’un des derniers pirates, ou peut-être avoir fait la traite, ou peut-être avoir été de ces fins voiliers d’autrefois qui faisaient le commerce, — à moins que ce ne fût la contrebande, — de l’opium.
En tout cas, ce brick était aussi étanche que le premier jour où on l’avait mis à l’eau, il naviguait comme le diable, se gouvernait comme une embarcation, et, pareil en cela à quelques belles femmes aux vies aventureuses et que l’histoire a rendues célèbres, il semblait avoir reçu le don d’éternelle jeunesse : aussi était-il assez naturel que Jasper Allen le traitât comme un amoureux. Et cela lui rendit tout l’éclat de sa beauté. Il le revêtit de plusieurs robes de la peinture la plus blanche, si habilement, si soigneusement, si artistement, et son équipage de Malais y apporta tant de zèle, que le plus coûteux émail employé par les bijoutiers n’aurait pas eu meilleur air et n’eût pas été plus doux au toucher. Un fin liston doré faisait ressortir son élégante tonture, et bien assis sur l’eau, il éclipsait la belle ligne classique des yachts qui venaient en Extrême-Orient à cette époque. Je dois avouer que je préfère, pour ma part, un liston rouge vif sur une coque blanche. Cela ressort mieux et est beaucoup moins coûteux : et c’est ce que je disais à Jasper. Mais non, rien d’autre que des feuilles d’or de la meilleure qualité ne pouvait convenir, car aucune décoration n’était assez belle pour le futur foyer de Freya.
Ses sentiments pour le brick et pour la jeune fille étaient aussi indissolublement mêlés dans son cœur que peuvent se fondre deux métaux précieux dans un creuset. Et la flamme était plutôt chaude, je vous assure. Elle mettait en lui une agitation dévorante faite d’activité et de désir. Avec son visage trop fin, cette ondulation transversale dans ses cheveux châtains, sa minceur, ses longues jambes, le regard ardent de ses yeux d’acier, ses mouvements brusques, il me faisait penser parfois à une étincelante épée qui sortirait perpétuellement de son fourreau. C’était seulement quand il était près de la jeune fille, quand il pouvait la contempler, que cette attitude particulièrement tendue faisait place à une grave et dévote attention de ses moindres gestes, de ses moindres mots. La maîtrise froide, résolue, avisée, égale de la jeune fille semblait raffermir le cœur de Jasper. Était-ce le pouvoir magique de son visage, de sa voix, de ses regards qui le calmait ainsi ? En tout cas, c’était ce qui avait, il faut le croire, enflammé son imagination, — si l’amour commence par l’imagination. Mais je me sens incapable de discuter de pareils mystères et je m’aperçois que nous avons bien négligé le pauvre vieux Nelson en train de soupirer mélancoliquement sur sa véranda.
Je lui fis remarquer qu’après tout les visites de Jasper n’étaient pas très fréquentes. Lui et son brick travaillaient ferme à travers tout l’Archipel. Mais tout ce que le vieux Nelson voulut dire, et encore comme à regret, ce fut :
« J’espère que Heemskirk n’arrivera pas pendant que le brick est ici. »
Voilà qu’il s’inquiétait à cause d’Heemskirk maintenant ! Heemskirk !… Non vraiment, il y avait de quoi perdre patience…
Car, je vous le demande, qu’était-ce qu’Heemskirk ? Vous comprendrez immédiatement combien craindre Heemskirk était absurde… Assurément, il était assez malveillant de sa nature. On en était convaincu dès qu’on l’entendait rire. Rien ne trahit mieux les dispositions secrètes d’un homme que le timbre de son rire. Mais, que diable ! s’il fallait se mettre martel en tête au moindre mauvais rire, comme un lièvre s’agite au moindre bruit, on n’aurait plus d’autre ressource que la solitude d’un désert ou la réclusion d’un ermitage. Et encore faudrait-il compter avec l’inévitable compagnie du Diable.
Le Diable toutefois est un personnage considérable qui a connu de meilleurs jours et a évolué dans les hautes sphères de la hiérarchie céleste : mais dans la hiérarchie des simples Hollandais de ce monde. Heemskirk, qui n’avait pas dû connaître une jeunesse bien brillante, n’était rien de plus qu’un officier de marine de quarante ans, sans parentés ni capacités notoires. Il commandait le Neptune, une petite canonnière qui patrouillait à travers l’Archipel, pour surveiller les trafiquants. Ce n’était pas là une position particulièrement reluisante. Je vous le dis, rien de plus qu’un lieutenant entre deux âges avec quelque vingt-cinq ans de service et la retraite avant peu ; rien d’autre.
Il ne s’était jamais beaucoup préoccupé de ce qui se passait dans le groupe des Sept-Iles jusqu’au jour où une conversation à Mintok ou à Palembang, je suppose, lui avait révélé qu’une jolie fille y habitait. La curiosité, je le présume, le poussa à venir rôder de ce côté et une fois qu’il eut vu Freya, il prit l’habitude de faire un tour dans les îles chaque fois qu’il se trouvait à une demi-journée de là.
Je ne veux pas dire qu’Heemskirk était un officier typique de la marine hollandaise. J’en ai rencontré assez pour ne pas commettre une pareille erreur. Il avait un large visage rasé ; de grandes joues plates et brunes, un nez mince et recourbé, et une petite bouche aux lèvres rentrées. Ses cheveux noirs étaient parsemés de quelques fils d’argent et ses yeux désagréables étaient presque noirs également. Il avait une façon hargneuse de jeter des regards de côté sans remuer la tête, laquelle tête était attachée à un cou rond et court. Son buste épais, revêtu d’une veste noire à pattes d’épaules dorées, était supporté par une paire de grosses jambes dans un pantalon blanc flottant. Son crâne rond sous la casquette blanche avait l’air extrêmement épais, mais il s’y trouvait assez de cervelle pour s’être aperçu et avoir su prendre malignement avantage de la nervosité du pauvre Nelson en présence de tout ce qui était investi de la moindre parcelle d’autorité.
Heemskirk débarquait à la pointe et, avant de se rendre à la maison, parcourait en silence les moindres recoins de la plantation comme si l’endroit lui eût appartenu. Sur la véranda il prenait la meilleure chaise et restait à déjeuner ou à dîner ; il restait tout simplement, sans même prendre la peine de prononcer une parole quelconque pour s’inviter.
On eût dû vraiment le flanquer à la porte, ne fût-ce que pour ses manières avec Mademoiselle Freya. Si ce n’avait été qu’un sauvage tout nu, avec une lance et des flèches empoisonnées, le vieux Nelson (ou Nielsen) eût certainement sauté dessus avec le seul secours de ses poings. Mais ces pattes d’épaules, — et qui plus est des pattes d’épaules hollandaises, — suffisaient à terrifier le pauvre homme : et il laissait cet individu le traiter avec le plus parfait mépris, dévorer sa fille des yeux et boire le meilleur vin de sa petite cave.
J’en fus témoin et me hasardai une fois à faire une remarque à ce sujet. Le trouble qui parut dans les yeux ronds du vieux Nelson était vraiment pitoyable. Il s’écria d’abord que le lieutenant était un de ses bons amis : un très brave garçon. Je continuai à le regarder fixement, si bien qu’à la fin il flancha, et dut reconnaître qu’en somme, Heemskirk n’était pas très remarquable en apparence, mais que dans le fond, tout de même…
— « Je n’ai jamais rencontré un Hollandais remarquable dans ces parages », interrompis-je. « Ce n’est pas, après tout, ce qui importe, mais ne voyez-vous pas… »
Nelson eut soudain l’air si effrayé de ce que j’allais dire que je n’eus pas le courage de poursuivre. J’allais naturellement lui dire que ce garçon courait après sa fille. C’était exactement la chose. Ce que Heemskirk pouvait bien en espérer ou ce qu’il pensait pouvoir en attendre, je n’en sais rien. Peut-être se croyait-il irrésistible ou bien avait-il pris Freya pour ce qu’elle n’était pas, sur la foi de son allure assurée, libre et spontanée. Mais le fait est qu’il courait après la jeune fille. Nelson pouvait s’en rendre assez bien compte. Seulement il préférait l’ignorer. Il n’avait pas envie qu’on lui en parlât.
— « Tout ce que je désire, c’est de vivre en paix avec les autorités hollandaises », murmura-t-il d’un air honteux.
Il était incurable. Cela m’ennuyait pour lui et je crois vraiment que Mademoiselle Freya en était ennuyée pour son père aussi. Elle se contenait par égard pour lui ; et elle le faisait comme tout ce qu’elle faisait, simplement, sans affectation, et même avec bonne humeur. Et ce n’était pas là un petit effort, car les attentions d’Heemskirk avaient une nuance insolente de dédain assez difficile à supporter. Les Hollandais de cette sorte sont extrêmement hautains avec leurs inférieurs, et cet officier du roi considérait le vieux Nelson et Freya comme tout à fait au-dessous de lui, à tous égards.
Je ne puis dire que cela m’ennuyait pour Freya. Ce n’était pas une jeune fille à prendre quoi que ce fût au tragique. On pouvait sympathiser avec elle, comprendre ses difficultés, mais elle semblait à la hauteur de n’importe quelle situation. C’était plutôt de l’admiration que sa sérénité avisée vous inspirait. Il n’y avait que lorsque Jasper et Heemskirk se trouvaient ensemble au bungalow, comme cela arrivait de temps à autre, qu’elle éprouvait de la contrainte : et, même alors, il n’était pas donné à tout le monde de s’en apercevoir. Mes yeux seuls pouvaient distinguer comme une ombre légère dans le rayonnement de sa personnalité. Une fois je ne pus me retenir de lui en faire mon compliment :
— « Vraiment ! vous êtes étonnante ! »
Elle laissa passer cette remarque avec un vague sourire.
— « La grande affaire est d’empêcher Jasper de devenir impossible », me dit-elle et je pus voir une réelle inquiétude dans les tranquilles profondeurs du regard plein de franchise qu’elle dirigeait droit sur moi. « Vous m’aiderez à le faire rester tranquille, n’est-ce pas ? »
— « Certainement, il faut qu’il se tienne tranquille », répondis-je, comprenant fort bien la nature de son inquiétude. « C’est un tel extravagant, aussi, quand il se monte. »
— « Oui », fit-elle avec douceur : car nous avions l’habitude, en manière de plaisanterie, de parler de Jasper en termes injurieux. « Mais je l’ai un peu apprivoisé. Il est tout à fait gentil maintenant. »
— « Il écraserait Heemskirk comme un cancrelat, tout de même », remarquai-je.
— « Je crois bien ! » murmura-t-elle. « Et cela ne ferait rien de bon », ajouta-t-elle rapidement. « Imaginez dans quel état serait mon pauvre père. En outre, je veux être la maîtresse de ce cher brick et naviguer dans ces parages, et non pas avoir à m’en aller à dix milles d’ici. »
— « Le plus tôt vous serez à bord pour surveiller l’homme et le brick, le mieux ce sera », lui dis-je sérieusement. « Ils ont bien besoin de vous pour les calmer un peu. Je ne crois pas que Jasper devienne jamais raisonnable avant de vous avoir enlevée de cette île. Vous ne le voyez pas quand il est loin de vous, comme cela m’arrive à moi. Il est dans un état d’enivrement perpétuel qui m’effraie presque. »
Elle se mit à sourire, puis reprit un air grave. Il ne lui déplaisait pas d’entendre parler du pouvoir qu’elle exerçait sur lui, et elle avait un certain sentiment de sa responsabilité. Elle me quitta brusquement, car Heemskirk, escorté du vieux Nelson, montait l’escalier de la véranda. Dès que sa tête eut atteint le niveau du parquet, je vis ses mauvais yeux noirs jeter des regards de tous côtés.
— « Où est donc votre fille, Nelson ? » demanda-t-il d’un tel ton qu’on eût dit que toute l’humanité lui appartenait. Puis s’adressant à moi : « La déesse a fui, hein ? »
La Baie de Nelson, — comme nous disions, — était ce jour-là encombrée de navires. Il y avait d’abord mon vapeur, et puis le Neptune un peu plus loin, et le Bonito, ancré comme d’habitude si près du rivage qu’avec un peu d’adresse et de jugement on aurait presque pu de la véranda lancer un chapeau sur sa dunette soigneusement poncée. Ses cuivres étincelaient comme de l’or, toute sa coque blanche avait l’éclat d’une robe de satin. L’inclinaison de ses mâts bien vernis et ses longues vergues brassées au millimètre lui donnaient une très fière allure. Il était vraiment magnifique. Comment s’étonner qu’en possession d’un bâtiment pareil et avec la promesse d’une femme comme Freya, Jasper vécût dans un état d’exaltation perpétuelle, convenable peut-être pour le septième ciel, mais pas exactement fait pour un monde comme le nôtre.
Je fis poliment remarquer à Heemskirk qu’avec trois hôtes dans la maison, Mademoiselle Freya avait sans doute des questions domestiques à régler. Je savais, — à n’en pas douter — , qu’elle était allée retrouver Jasper à une petite clairière au bord de la seule rivière qui se trouvât sur la petite île de Nelson. Le commandant du Neptune me lança un regard de doute, et se mit à son aise, installant sa grosse et cylindrique carcasse dans son rocking-chair et déboutonnant sa veste. Le vieux Nelson s’assit en face de lui, le plus modestement possible, en le regardant anxieusement de ses yeux ronds, tout en s’éventant avec son chapeau. J’essayai de faire la conversation pour passer le temps : ce n’était pas une tâche facile avec un Hollandais morose et amoureux qui ne cessait de jeter des regards de l’une à l’autre porte et ne répondait à vos avances que par un sarcasme ou un grognement.
La soirée se passa pourtant sans incident. Il y a heureusement un degré de béatitude si intense qu’il ne permet plus l’exaltation. Jasper demeura tranquille et ne cessa de contempler Freya en silence. Quand nous regagnâmes nos navires respectifs, je lui offris de remorquer son brick au large le lendemain matin. Je le fis avec intention pour lui permettre de partir le plus tôt possible. Aussi dès l’aigre pointe du jour nous passâmes au long de la canonnière noire et immobile, parfaitement silencieuse à l’embouchure de la baie, qu’on eût dit de verre. Mais, avec une rapidité tropicale, le soleil avait déjà monté de deux fois son diamètre avant que nous n’eussions doublé le récif et que nous ne fussions arrivés par le travers de la pointe. Sur le plus gros rocher j’aperçus Freya debout, tout en blanc, et semblable, avec son casque, à une statue féminine et martiale au visage rose, je pouvais la distinguer fort bien à travers mes jumelles. Elle agitait un mouchoir, et Jasper, courant sur la dunette de son brick blanc à fière allure, y répondit en agitant son chapeau. Peu après nous nous séparâmes ; moi vers le nord, Jasper mettant le cap à l’est avec une légère brise sur la hanche, dans la direction du Banjermassin et de deux autres ports, si je ne me trompe, à ce voyage-là.
Cette paisible occasion fut la dernière où je pus voir ces diverses personnes réunies : le charme frais et délicieusement résolu de Freya, l’innocence aux yeux ronds du vieux Nelson, Jasper, ardent, avec ses longues jambes, sa figure mince, son attitude admirablement contenue, parce qu’il était inconcevablement heureux en présence de Freya : tous trois, grands, blonds, avec des yeux bleus de nuances différentes, et parmi eux cet arrogant Hollandais basané, aux cheveux bruns, plus petit qu’eux de près d’une tête, et tellement plus gros qu’aucun d’eux qu’on eût dit un être capable de se gonfler lui-même, le spécimen grotesque d’une humanité venue d’une autre planète.
Le contraste me frappa tout d’un coup alors que nous nous trouvions tous dans la véranda éclairée au sortir de table. J’en demeurai saisi le reste de la soirée, et l’impression que j’eus alors de quelque chose à la fois de plaisant et de sinistre, je me la rappelle encore aujourd’hui.
Quelques semaines plus tard, comme j’arrivais le matin de bonne heure à Singapour, au retour d’un voyage dans le sud, j’aperçus le brick à l’ancre, harmonieux et splendide comme toujours, avec son air d’avoir été retiré d’une vitrine et posé sur l’eau au moment même.
Il était assez loin en rade, mais je fis route pour entrer et pris mon poste habituel assez près devant la ville. Je n’avais pas achevé mon petit déjeuner qu’un quartier-maître vint me dire que l’embarcation du capitaine Allen se dirigeait vers le bord.
Son élégante yole accosta à toute allure et en deux bonds il avait grimpé notre échelle et me serrait la main d’une nerveuse étreinte, tandis que son regard m’interrogeait avidement, car il supposait que j’avais touché aux Sept-Iles pendant mon voyage. Je pris dans ma poche une petite lettre soigneusement pliée qu’il m’enleva des mains sans cérémonie et qu’il emporta sur le pont pour la lire à son aise. Après lui avoir donné un peu de temps, je l’y rejoignis et le trouvai marchant de long en large : car la nature de ses émotions l’agitait, même aux moments où il était le plus absorbé.
Il me fit de la tête un geste triomphant.
— « Eh bien, mon cher », me dit-il, « maintenant je vais pouvoir compter les jours ! »
Je compris ce qu’il voulait dire. Je savais que les jeunes gens avaient déjà décidé de partir ensemble sans préliminaires officiels. Le vieux Nelson (ou Nielsen) n’aurait jamais accepté d’accorder paisiblement la main de Freya à ce compromettant Jasper. Grands Dieux ! Que diraient d’une telle union les autorités hollandaises ! Cela peut paraître ridicule : mais il n’y a rien au monde d’aussi égoïstement entêté qu’un homme timoré qui craint pour son « petit domaine », comme disait en s’excusant le vieux Nelson. Un cœur qu’une panique particulière a envahi est à l’épreuve de la raison, des sentiments et du ridicule. C’est un caillou.
Jasper était d’avis de faire sa demande tout de même et de prendre ensuite une décision : mais c’était Freya qui avait décidé qu’il valait mieux ne rien dire, attendu que « Papa se ferait du mauvais sang à en perdre la tête ». Il était capable de s’en rendre malade, et alors elle n’aurait pas le cœur de le quitter. On a ici un exemple de la clarté des vues féminines et de la netteté du raisonnement féminin. Et, d’ailleurs, Mademoiselle Freya pouvait lire dans l’âme du « pauvre cher papa » comme une femme lit dans l’âme d’un homme, — comme dans un livre ouvert. Une fois sa fille partie, le vieux Nelson ne se ferait plus de mauvais sang. Il pousserait de grands cris, et se lamenterait interminablement, mais ce n’était pas la même chose. Les véritables agonies de l’indécision, l’angoisse d’un conflit de sentiments lui seraient épargnées. Et comme il était trop simple pour se mettre en fureur, il ne tarderait pas, après une période de lamentation, à se consacrer à « son petit domaine » et à rester en bons termes avec les autorités.
Le temps ferait le reste. Et Freya pensait qu’elle pourrait supporter d’attendre, tout en gouvernant à la fois son foyer à bord de ce joli brick et l’homme qui l’aimait. C’était tout à fait la vie qui convenait à quelqu’un comme elle qui avait appris à marcher sur le pont d’un navire. Elle était l’enfant des navires, l’enfant de la mer si jamais il en fut. Et naturellement elle aimait Jasper et avait confiance en lui : mais il y avait un peu d’anxiété dans son orgueil. C’est très joli et fort romanesque que de posséder à soi une épée bien trempée et résistante, mais savoir si c’est la meilleure arme à opposer aux coups de bâton du Destin, — c’est une autre question.
Elle savait que d’elle et de Jasper, c’était elle qui avait le plus de substance ; épargnez-moi, je vous prie, les plaisanteries faciles, je ne parle pas ici de leurs poids. En son absence elle était un peu anxieuse, et de mon côté, moi qui étais un confident parfaitement sûr, je prenais la liberté de lui murmurer fréquemment : « Le plus tôt sera le mieux. » Mais Mademoiselle Freya avait une forme très particulière d’obstination, et la raison qui lui faisait retarder cette décision était caractéristique : « Pas avant mon vingt-et-unième anniversaire : de façon à ce que les gens soient bien convaincus que je suis assez vieille pour savoir ce que je fais. »
Jasper lui était si soumis qu’il n’avait jamais protesté contre ce décret. Elle était magnifique, quoi qu’elle pût dire ou faire : il n’y avait pas de doute à cet égard. Il était, me semble-t-il, assez subtil pour en être flatté au fond, — quelquefois. Et pour le consoler, il avait son brick qui semblait imprégné de l’esprit de Freya, puisque tout ce qu’il faisait à bord il le faisait toujours avec la suprême sanction de son amour.
— « Oui. Je vais bientôt commencer à compter les jours », répéta-t-il. « Encore onze mois. Il va falloir faire trois voyages pendant ce temps-là. »
— « Prenez garde de ne pas vous créer des ennuis en voulant en faire trop », lui dis-je en matière d’avertissement. Mais ma prudence ne rencontra qu’un rire et un geste d’enthousiasme. « Bah ! Rien, rien ne saurait arriver au brick », s’écria-t-il, comme si la flamme de son cœur pouvait éclairer les nocturnes ténèbres de mers inconnues, et comme si l’image de Freya pouvait être un infaillible phare au milieu des bancs invisibles : comme si les vents avaient à se faire les serviteurs de son avenir, les étoiles à combattre pour lui dans leur course : comme si la magie de sa passion avait le pouvoir de faire flotter un navire sur une goutte de rosée ou de le faire passer par le chas d’une aiguille, — simplement parce que ce navire avait le destin étonnant d’être le serviteur d’un amour assez privilégié pour rendre toutes les routes de la terre, sûres, resplendissantes et faciles.
— « Je suppose », lui dis-je, lorsqu’il eut fini de rire de ma très innocente remarque, « je suppose que vous appareillez aujourd’hui. »
C’était en effet son intention. S’il ne l’avait pas fait à la pointe du jour, c’est uniquement qu’il avait attendu mon arrivée.
— « Et imaginez ce qui m’est arrivé hier », continua-t-il. « Mon second m’a quitté subitement. Impossible autrement. Et comme on ne peut trouver personne en si peu de temps, je m’en vais prendre Schultz avec moi. Le fameux Schultz ! Ça ne vous étonne pas ? Je suis allé déterrer Schultz assez tard hier au soir, et non sans peine. « Je suis votre homme, capitaine », m’a-t-il dit de sa merveilleuse voix, « mais je dois vous dire que je n’ai pratiquement rien à me mettre sur le dos. Il m’a fallu vendre toute ma garde-robe pour avoir de quoi manger d’un jour à l’autre. » Quelle voix il a ! On parle d’émouvoir des pierres ! Mais les gens ont l’air de s’y être habitués. Je ne l’avais jamais vu auparavant, et vraiment les larmes m’en sont venues aux yeux. Heureusement il faisait presque nuit. Je l’ai trouvé tranquillement assis sous un arbre dans une plantation indigène, maigre comme un clou, et je me suis aperçu que tout ce qu’il avait sur lui c’était un vieux gilet de coton et un pyjama en loques. Je lui ai acheté six vêtements blancs et deux paires d’espadrilles. Je ne peux pas partir sans un second. Il me faut quelqu’un. Je vais à terre tout à l’heure pour signer son embarquement, et je le ramènerai avec moi, car je reviens à bord juste pour lever l’ancre. Eh bien ! je suis fou, n’est-ce pas ? Complètement fou, bien sûr ! Allez-y ! Ne vous gênez pas ! J’aime vous voir vous monter contre moi. »
Il s’attendait si évidemment à ce que je lui fisse une scène, que je pris un malin plaisir à exagérer le calme de mon attitude.
— « Ce que l’on peut reprocher de pire à Schultz », commençai-je en me croisant les bras et du ton le plus tranquille, « c’est sa fâcheuse habitude de voler dans les magasins de tous les navires à bord desquels il est. Il le fera. Il n’y a réellement que cela de fâcheux. Je ne peux pas absolument croire l’histoire que raconte le capitaine Robinson d’après laquelle Schultz se serait, à Chantabun, entendu avec des bandits d’une jonque chinoise pour enlever l’ancre du bossoir tribord de la goélette Bohémienne. L’histoire de Robinson est trop ingénieuse. Cette autre histoire des mécaniciens du Nan-Shan découvrant Schultz à minuit, dans la chambre des machines, occupé à enlever à coups de marteau les coussinets pour aller les vendre à terre me paraît plus authentique. A part cette petite faiblesse, je vous accorde que Schultz est un meilleur marin que beaucoup d’autres qui n’ont jamais bu de leur vie, et qu’il n’est peut-être pas pire, moralement, que bien des gens que nous connaissons, vous et moi, et qui n’ont jamais volé pour un sou. Ce n’est pas exactement quelqu’un qu’on puisse souhaiter avoir à son bord, mais puisque vous n’avez pas le choix, il peut faire l’affaire, je crois. L’important, c’est de comprendre sa psychologie. Ne lui donnez pas un sou avant qu’il ait fini. Pas un sou, même s’il vous le demande. Car c’est réglé d’avance : aussitôt que vous lui donnerez de l’argent, il se mettra à voler. Rappelez-vous ce que je vous dis. »
L’incrédulité étonnée de Jasper me fit plaisir à voir.
— « Pas possible ! » s’écria-t-il. « Et pour quoi faire ? Est-ce que vous essayez de me faire marcher, mon vieux ? »
— « Non. Pas le moins du monde. Il faut comprendre la psychologie de Schultz. Ce n’est ni un fainéant ni un gredin. Ce n’est pas un de ces garçons toujours en quête de quelqu’un pour leur payer à boire. Mais qu’il aille à terre avec cinq dollars, ou cinquante, dans sa poche : après le troisième ou quatrième verre il se grise et commence à devenir charitable. Ou bien il s’en va jeter tout son argent par les fenêtres, ou bien le distribuer autour de lui, le donner à qui veut le prendre. Alors l’idée lui vient que la soirée ne fait que commencer, et qu’il faudra encore un bon nombre de verres pour lui et ses amis avant le lendemain matin. D’un pied léger il regagne le navire. Ni ses jambes ni sa tête ne paraissent le moins du monde affectées. Une fois à bord il s’empare simplement de la première chose qui lui paraît faire l’affaire, — la lampe de cabine, une glène de filin, un sac de biscuits, un bidon d’huile, — et vous le convertit en argent comptant sans y réfléchir à deux fois. C’est son procédé. C’est à vous de veiller à ce qu’il ne commence pas. Voilà tout. »
— « Que le diable emporte sa psychologie », murmura Jasper. « Mais un homme avec une voix pareille est fait pour parler aux anges !… Croyez-vous qu’il soit incurable ? »
Je lui répondis que c’était mon opinion. « Personne ne l’a encore poursuivi, mais personne ne veut plus l’employer. Il finira, j’en ai peur, par mourir de faim dans quelque trou. »
— « Eh bien ! » déclara Jasper, « le Bonito ne fait pas d’affaires dans les ports civilisés. Ça lui sera plus facile de se tenir tranquille. »
C’était la vérité. Les opérations du brick se faisaient sur des rivages dénués de civilisation, avec d’obscurs rajahs établis dans des baies à peu près inconnues : avec des établissements indigènes en amont de rivières mystérieuses dont les estuaires sombres et bordés de forêts s’ouvraient, parmi un chapelet de récifs vert clair ou d’éblouissants bancs de sable, sur des détroits solitaires d’une eau bleue, calme et toute scintillante de soleil. Le brick glissait tout blanc, seul, loin des routes habituelles, doublait des caps sombres et menaçants, émergeait, silencieux comme un fantôme, de promontoires qui s’allongeaient tout noirs au clair de lune : ou bien immobile à l’ancre, comme un oiseau de mer endormi, à l’ombre de quelque montagne sans nom, il attendait un signal. On l’entrevoyait soudainement, par des jours de brume ou de grains, prenant dédaigneusement de biais les lames courtes et agressives de la mer de Java : ou bien on l’apercevait loin, loin, petite tache blanche étincelante voltigeant à travers les masses pourpres de nuages d’orage entassés à l’horizon. Parfois, sur les rares routes régulières des navires, où la civilisation dissipe le mystère de la sauvagerie, quand de naïfs passagers réunis le long du bastingage s’écriaient avec intérêt en le désignant du doigt : « Oh ! voici un yacht ! » le capitaine hollandais, avec un coup d’œil hostile, grognait d’un ton méprisant : « Un yacht ! Pensez-vous ! C’est seulement cet Anglais de Jasper. Un portefaix… »
— « Vous dites que c’est un bon marin », reprit Jasper, encore préoccupé de ce désespérant Schultz à la voix si extraordinairement touchante.
— « De premier ordre. Demandez à n’importe qui. Tout à fait excellent, — seulement impossible », lui déclarai-je.
— « Il aura une chance de se réformer à bord du brick », répondit Jasper en riant. « Il n’aura aucune tentation de boire ni de voler là où je vais cette fois. »
Je ne cherchai pas à en savoir davantage sur ce point. En fait, intimes comme nous l’étions, j’avais une idée assez claire du genre de ses transactions.
Mais comme nous allions à terre dans son canot, il me demanda tout à coup : « A propos, savez-vous où est Heemskirk ? »
Je le regardai du coin de l’œil, mais je fus vite rassuré. Ce n’était pas l’amoureux qui m’avait posé cette question, mais le commerçant. Je lui répondis que j’avais entendu dire à Palembang que le Neptune était de service du côté de Florès et de Sumbawa. Tout à fait en dehors de sa route. Il s’en montra ravi.
— « Savez-vous », reprit-il, « que ce garçon-là, quand il est sur la côte de Bornéo, s’amuse à démolir mes balises. J’ai dû en placer quelques-unes pour me faciliter la montée et la descente des rivières. Au début de cette année un commerçant des Célèbes encalminé dans une prau l’a observé. Il l’a vu lancer sa canonnière à toute vapeur sur deux d’entre elles, l’une après l’autre, les mettre en pièces, puis envoyer une embarcation en retirer une troisième que j’ai eu énormément de mal il y a six mois à fixer comme échelle de marée au milieu d’un banc de vase. Avez-vous jamais entendu parler de quelque chose d’aussi exaspérant, hein ? »
— « Il vaut mieux ne pas vous quereller avec ce garçon-là », remarquai-je en passant, bien que cette nouvelle me parût assez fâcheuse. « Cela n’en vaut pas la peine. »
— « Me quereller ? » s’écria Jasper. « Je n’ai pas envie de me quereller. Je n’ai pas envie de toucher un seul cheveu de sa vilaine tête. Mon cher, quand je pense aux vingt et un ans de Freya, le monde entier est mon ami, y compris Heemskirk. C’est tout de même un jeu dégoûtant. »
Nous nous séparâmes brusquement sur le quai, pressés que nous étions l’un et l’autre de régler nos affaires. J’aurais été bien peiné si j’avais pu penser que son rapide serrement de main qu’accompagnèrent les mots « C’est bien long, mon vieux. Bonne chance ! » devait marquer la dernière de nos rencontres.
A son retour à Singapour j’étais loin, et il en était reparti lorsque j’y revins. Il voulait à tout prix faire trois voyages avant les vingt et un ans de Freya. A la baie de Nelson je le manquai aussi de deux jours. Freya et moi nous parlâmes de « cet extravagant », de « ce parfait idiot » avec un infini plaisir et la plus grande sympathie. Elle était radieuse, et se montrait infiniment plus gaie, quoiqu’elle vînt tout justement de se séparer de Jasper. Mais ce devait être leur dernière séparation.
— « Embarquez aussi tôt que possible, Mademoiselle Freya », lui dis-je.
Elle me regarda bien en face ; son visage était un peu coloré, et avec une sorte d’ardeur nouvelle, — peut-être aussi avec un très léger trouble dans sa voix, elle me répondit :
— « Le lendemain même. »
Oui. Le lendemain même de son vingt-et-unième anniversaire. Je fus ravi de cette allusion à un sentiment profond. Il me sembla qu’enfin lui pesait ce délai qu’elle s’était imposé. Je suppose que la récente visite de Jasper y était pour quelque chose.
— « C’est parfait », approuvai-je. « Je serai infiniment plus tranquille quand vous prendrez soin vous-même de cet extravagant. Ne perdez pas une minute. Quant à lui, cela va sans dire, il sera au jour dit, à moins que le ciel ne nous tombe sur la tête. »
— « Oui. A moins que… » répéta-t-elle dans un murmure pensif, en levant les yeux vers ce ciel du soir dépourvu de toute trace de nuage. Nous restâmes un moment silencieux, laissant errer nos regards sur la mer qui semblait mystérieusement calme au crépuscule, comme si elle eût été faite à souhait pour un long, long rêve dans la chaude nuit tropicale. Et la paix qui s’étendait autour de nous semblait sans limites et sans fin.
Puis nous parlâmes de Jasper sur notre ton habituel. Nous le trouvions l’un et l’autre trop téméraire à beaucoup d’égards. Fort heureusement, le brick était à la hauteur de la situation. On pouvait apparemment tout exiger de lui. « C’est un amour de navire », déclara Mademoiselle Freya. Elle et son père avaient passé une après-midi à bord. Jasper leur avait offert le thé. Papa était bourru… Je me représentais le vieux Nelson sous la tente blanche du brick, ruminant tranquillement sa mauvaise humeur tout en s’éventant avec son chapeau. Un père de comédie… Comme nouvelle preuve de l’extravagance de Jasper, j’appris qu’il était désolé de n’avoir pu faire mettre des poignées d’argent massif à toutes les portes des cabines. « Comme si je l’aurais laissé faire », ajouta Mademoiselle Freya avec une plaisante indignation. Incidemment, j’appris aussi que Schultz, ce kleptomane nautique à la voix pathétique, était resté comme second avec l’approbation de Mademoiselle Freya. Jasper avait confié à la dame de ses pensées son intention de réformer la psychologie de ce pauvre diable. Oui, parfaitement. Le monde entier était son ami, parce que le monde entier respirait le même air que Freya.
Je ne sais plus comment j’amenai le nom d’Heemskirk dans la conversation et, à ma grande surprise, je vis Mademoiselle Freya tressaillir. Ses yeux eurent une expression qui ressemblait à de la détresse, cependant qu’elle se mordait la lèvre comme pour s’empêcher de rire. Ah ! oui. Heemskirk s’était trouvé au bungalow en même temps que Jasper, mais il était arrivé un jour après lui. Il était parti le même jour que le brick, mais quelques heures plus tard.
— « Comme cela a dû être ennuyeux pour vous deux », lui dis-je avec sympathie.
Ses yeux me lancèrent un éclair de gaieté effrayée, et tout à coup elle se mit à rire, d’un rire clair : « Ha ! ha ! ha ! »
J’y fis écho de tout cœur, mais pas avec une intonation aussi charmante : « Ha ! ha ! ha ! N’est-il pas grotesque ? Ha ! ha ! ha ! » Et en me rappelant ce qu’avait de comique l’association des yeux ronds et furibonds du vieux Nelson et de ses manières conciliantes envers le lieutenant, je me remis à rire.
— « Il a l’air », bredouillai-je, — « il a l’air, ha ! ha ! ha !… entre vous trois… d’un malheureux cancrelat. Ha ! ha ! ha ! »
Elle eut encore un éclat de rire, courut vers sa chambre, et frappa la porte derrière elle, me laissant profondément interdit. Je cessai de rire immédiatement.
— « Qu’est-ce qui vous fait rire comme cela ? » demanda la voix du vieux Nelson, du milieu de l’escalier.
Il monta, s’assit, souffla, avec un air indiciblement stupide. Mais je n’avais plus envie de rire. Et de quoi diable riions-nous de cette façon-là ? Je me sentis tout à coup extrêmement abattu.
Ma foi ! c’était Freya qui avait commencé. Énervement de jeune fille, pensai-je. Et vraiment il n’y avait pas de quoi s’en étonner.
Je ne répondis pas à la question du vieux Nelson, mais il avait été trop inquiété par la visite de Jasper pour pouvoir penser à autre chose. Il alla jusqu’à me demander si je ne voudrais pas essayer de faire comprendre à Jasper qu’on ne désirait plus le voir aux Sept-Iles. Je lui déclarai que ce n’était pas nécessaire. D’après ce que j’avais pu comprendre dernièrement, j’avais des raisons de penser que Jasper Allen ne le gênerait plus beaucoup à l’avenir.
« Dieu merci ! », s’écria-t-il, et cela avec une telle gravité que je fus sur le point de me remettre à rire, mais il n’en parut pas aussi rassuré que je l’aurais cru. Heemskirk, semble-t-il, avait fait de son mieux pour lui être désagréable. Le lieutenant avait terrifié le vieux Nelson en s’étonnant de ce que le Gouvernement eût pu permettre à un blanc de s’établir à cet endroit. « C’est absolument contraire à nos principes habituels », avait-il remarqué. Il l’avait en outre accusé de n’être rien d’autre qu’un Anglais. Il avait même essayé de lui chercher noise pour n’avoir pas appris le hollandais.
— « Je lui ai dit que j’étais trop vieux pour l’apprendre maintenant », murmura le vieux Nelson (ou Nielsen) d’un air consterné. « Il m’a dit que j’aurais dû l’apprendre depuis longtemps. Que j’avais gagné ma vie dans les possessions hollandaises : que c’était honteux pour moi de ne pas parler hollandais. Il était aussi furieux contre moi que si j’avais été un Chinois. »
Il était évident que l’autre l’avait effroyablement harcelé. Il ne mentionna pas le nombre de bouteilles de son meilleur vin qu’il avait dû sacrifier sur l’autel de la réconciliation. Ç’avait dû être une généreuse libation. Mais le vieux Nelson (ou Nielsen) était naturellement hospitalier. Ce n’est pas cela qui l’affectait et je regrettais seulement que cette vertu s’épanchât au profit du commandant de la canonnière Neptune. Je brûlais d’envie de lui dire que selon toute probabilité il serait également débarrassé des visites d’Heemskirk. Je ne le fis pas par peur (c’était absurde, je l’admets) d’éveiller en lui des soupçons. Comme si avec ce père de comédie parfaitement dénué d’artifice, pareille chose était à craindre !
Ce fut Freya qui, assez étrangement, prononça les derniers mots au sujet d’Heemskirk, et précisément dans ce sens-là. Au dîner, le lieutenant revenait avec persistance dans la conversation du vieux Nelson. A la fin je murmurai à mi-voix : « Au diable le lieutenant ! » Je voyais bien que la jeune fille commençait à s’énerver aussi.
— « Et il n’allait pas bien du tout, — n’est-ce pas, Freya ? » continuait à marmotter le vieux Nelson, « peut-être est-ce ce qui le rendait si hargneux, hein, Freya ? Il avait l’air malade quand il nous a quittés si brusquement. Il doit avoir quelque chose au foie, aussi. »
— « Oh ! il finira bien par s’en remettre », s’écria Freya avec impatience. « Et ne continue donc pas à te faire du mauvais sang pour lui, papa. Vraisemblablement tu ne le reverras pas de si tôt. »
Le regard qu’elle me lança en réponse à mon discret sourire était dénué de toute gaieté. Ses yeux semblaient s’être creusés, sa figure avoir blêmi en deux heures. Nous avions trop ri. Elle était surmenée. Surmenée par l’approche du moment décisif. Après tout, sincère, courageuse, et habituée comme elle l’était à ne compter que sur elle-même, elle avait dû ressentir profondément la force et le poids de sa résolution. La violence même de l’amour qui l’avait entraînée à ce point avait dû être pour elle un grand effort moral, où entrait probablement aussi un peu de remords. Car elle était honnête, — et là, de l’autre côté de la table, le pauvre vieux Nelson (ou Nielsen) la regardait de ses yeux ronds, si pathétiquement comique avec son air farouche qu’il y avait vraiment de quoi toucher le cœur le plus indifférent.
Il se retira de bonne heure dans sa chambre pour se calmer en examinant ses comptes avant de s’endormir. Nous restâmes tous les deux sur la véranda encore une heure environ, mais nous n’échangeâmes que des phrases languissantes sur des sujets sans intérêt, comme si notre longue conversation de la journée sur le seul sujet important eût épuisé notre sensibilité. Il y avait quelque chose pourtant qu’elle eût pu dire à un ami. Mais elle n’en fit rien. Nous nous séparâmes silencieusement. Peut-être se défia-t-elle de mon absence masculine de sens commun, peut-être… O Freya !
Comme je descendais le sentier à pic qui menait au débarcadère, je me trouvai dans l’ombre des rochers et des buissons, face à face avec une silhouette de femme drapée dont l’apparition m’effraya d’abord. Elle avait débouché brusquement d’un rocher, en travers de mon chemin. Mais je compris bien vite que ce ne pouvait être que la femme de chambre de Freya, une métisse Portugaise de Malacca. On apercevait de temps à autre son visage olivâtre et ses dents étincelantes aux abords de la maison. Je l’avais observée de loin quelquefois, assise à l’ombre d’arbres fruitiers, brossant et tressant ses longs cheveux noirs comme le jais. Cela semblait être la principale occupation de ses loisirs. Nous avions souvent échangé des signes de tête et des sourires, et même quelques mots. C’était une jolie fille. Et je l’avais vue une fois faire des grimaces amusantes et expressives derrière le dos d’Heemskirk. J’avais compris (d’après ce que m’avait dit Jasper) qu’elle était dans la confidence, comme une camériste de comédie. Elle devait accompagner Freya sur le chemin irrégulier du mariage et du bonheur. Qu’avait-elle à errer ainsi le soir aux abords de la baie ? — à moins qu’elle n’eût elle-même quelque amour — me demandai-je. Mais je ne voyais personne aux Sept-Iles qui pût, à ma connaissance, faire son affaire. L’idée me vint subitement que c’était moi qu’elle avait attendu ainsi.
Elle hésita, enveloppée de la tête aux pieds, comme une ombre timide. Je m’avançai d’un pas, et ce que j’éprouvai ne regarde personne.
— « Qu’y a-t-il ? » demandai-je à voix basse.
— « Personne ne sait que je suis ici », murmura-t-elle.
— « Et personne ne peut nous voir », murmurai-je en retour.
Le murmure des mots : « J’ai eu si peur », atteignit mon oreille. Juste à ce moment, à quarante pieds au-dessus de nos têtes, de la véranda encore éclairée, nous parvint, inattendue et saisissante, la voix de Freya qui, claire et impérieuse, criait :
— « Antonia. »
Avec une exclamation étouffée, la forme hésitante disparut du sentier. Un buisson frémit près de moi : puis ce fut de nouveau le silence. J’attendis un moment, interdit. Les lumières sur la véranda s’éteignirent. J’attendis encore un instant, puis je repris mon chemin jusqu’au navire, plus étonné que jamais.
Si je me rappelle particulièrement bien les circonstances de cette visite, c’est que ce fut la dernière fois que je vis le bungalow du vieux Nelson. A mon arrivée à Singapour je trouvai des dépêches qui m’obligèrent à débarquer sur-le-champ et à rentrer en Europe sans délai. Je n’eus pas une minute à perdre pour pouvoir attraper le paquebot qui partait le lendemain, mais j’eus tout de même le temps d’écrire deux courtes lettres, l’une à Freya, l’autre à Jasper. Quelque temps après j’écrivis à loisir, cette fois à Allen seul. Je ne reçus aucune réponse. Je me mis à la recherche de son frère, ou plutôt de son demi-frère, un solicitor de la Cité, un petit homme blême et calme qui me considéra attentivement par-dessus ses lunettes. Jasper était le seul enfant du second mariage de son père, opération qui n’avait pas eu l’heur de plaire à la première famille.
— « Vous n’avez pas entendu parler de lui depuis des siècles », répétai-je, fort ennuyé. « Puis-je me permettre de vous demander ce que vous voulez dire par « des siècles » dans cette circonstance ? »
— « Je veux dire que je ne me soucie absolument pas d’entendre parler de lui », répliqua le petit homme de loi devenu soudain grincheux.
Je ne pouvais blâmer Jasper de ne pas perdre son temps à correspondre avec un parent aussi insupportable. Mais pourquoi ne m’écrivait-il pas, — à moi un si bon ami, après tout : un assez bon ami pour trouver à son silence l’excuse de l’oubli naturel à un état d’extrême béatitude. J’attendis avec indulgence : mais rien ne vint. Et l’Orient sembla disparaître de ma vie sans un écho, comme une pierre qui tombe dans un puits.
Je suppose qu’il n’est presque rien qui ne puisse se justifier par des motifs louables. Quoi de plus louable, en principe, que la détermination d’une jeune fille qui entend que « pauvre papa » ne se fasse pas de mauvais sang, et son anxieux désir de mettre à tout prix l’homme de son choix dans l’impossibilité de commettre une imprudence, quelque chose qui puisse compromettre la perspective de leur bonheur ?
Rien ne pouvait être plus tendre ni plus prudent. Il ne faut pas oublier non plus que la nature de la jeune fille la portait à ne se fier qu’à elle-même, et il faut tenir compte du peu de goût qu’ont les femmes en général, — je veux dire les femmes de bon sens, — pour faire des histoires en pareille matière.
Comme on le sait, Heemskirk était arrivé peu de temps après Jasper à la Baie de Nelson. La vue du brick à l’ancre juste au-dessous du bungalow ne pouvait que lui être désagréable. Il ne se précipita pas à terre aussitôt que son ancre eut touché le fond, comme le faisait Jasper. Il resta au contraire à marmotter sur sa dunette : et quand il donna l’ordre d’armer son embarcation, ce fut avec colère. L’existence de Freya, qui soulevait Jasper d’un élan d’enthousiasme béat, était pour Heemskirk une cause de tourment secret, de rêveries exaspérées.
En passant au long du brick il le héla d’un ton rogue et demanda si le patron était à bord. Schultz, élégant et net dans un costume blanc impeccable, se pencha sur la lisse, trouvant la question plutôt divertissante. Son regard amusé plongea dans le canot d’Heemskirk et il répondit avec les plus agréables modulations de sa voix : « Le capitaine Allen est monté à la maison, commandant. » Mais il changea tout à coup d’expression en entendant l’autre grogner en guise de remerciement : « Qu’est-ce qui vous prend de faire des grimaces comme ça, vous ? »
Il vit Heemskirk débarquer et, au lieu de se diriger vers la maison, prendre un sentier qui traversait les plantations.
Le Hollandais dévoré de désir trouva le vieux Nelson (ou Nielsen) aux séchoirs, fort occupé à surveiller la manipulation de sa récolte de tabac qui, quoique petite, était d’une excellente qualité, ce qui le remplissait d’aise. Mais Heemskirk eut bientôt fait de mettre un terme à ce simple bonheur. Il s’assit près du vieil homme, et au moyen d’une conversation fort adroitement calculée, il l’eut bien mis dans un état de nervosité qu’il s’efforçait de dissimuler mais qui le faisait suer à grosses gouttes. C’était une horrible conversation à propos des « autorités » et le vieux Nelson essayait de se défendre. S’il faisait des affaires avec des commerçants anglais, c’est qu’il lui fallait bien vendre sa récolte. Il se montra aussi conciliant qu’il le pouvait et cela ne fit qu’exaspérer davantage Heemskirk qui était en proie à une épuisante passion.
— « Et le pire de tous est cet Allen », s’écria-t-il avec fureur. « Votre cher ami, hein ? Vous avez laissé venir un tas de ces Anglais. On n’aurait jamais dû vous laisser vous installer ici. Jamais. Qu’est-ce qu’il fait ici en ce moment ? »
Le vieux Nelson (ou Nielsen), fort agité, déclara que Jasper Allen n’était aucunement son ami. Pas son ami du tout, pas du tout. Il lui avait acheté trois tonnes de riz pour nourrir ses Malais. Était-ce là une preuve d’amitié ? Heemskirk à la fin éclata et découvrit la pensée qui le rongeait.
— « Oui. Vendre trois tonnes de riz et fleureter pendant trois jours avec votre fille. Je vous parle en ami, Nielsen. Cela ne peut pas durer. On vous tolère ici, seulement. »
Le vieux Nelson en fut suffoqué, mais il se reprit rapidement. Cela ne pouvait pas durer ! Certainement ! Bien sûr que cela ne durerait pas ! Le dernier homme au monde. Mais sa fille ne se souciait aucunement de ce garçon et elle était trop raisonnable pour s’amouracher de qui que ce fût. C’est avec beaucoup de gravité qu’il communiqua à Heemskirk son propre sentiment de sécurité absolue. Et le lieutenant, tout en jetant de droite et de gauche des regards de doute, ne fut que trop heureux de le croire.
— « Vous en savez long là-dessus », grommela-t-il néanmoins.
— « Mais je sais bien à quoi m’en tenir », insista le vieux Nelson, avec un accent de désespoir parce qu’il voulait résister aux doutes qui s’élevaient dans son esprit. « Ma propre fille ! Dans ma maison, et je ne saurais pas ! Allez ! Ce serait une belle plaisanterie, lieutenant ! »
— « Ils ont l’air de s’entendre fort bien ensemble », remarqua Heemskirk aigrement. « Je suppose qu’ils sont ensemble en ce moment », ajouta-t-il, tandis qu’une vive douleur changeait en une étrange grimace le sourire de moquerie qu’il avait esquissé.
Le pauvre Nelson l’arrêta d’un geste. Cette insistance le choquait extrêmement et il commençait même à la trouver absurde.
— « Allons, allons, écoutez, lieutenant, montez donc à la maison prendre un verre de gin-bitter avant de dîner. Faites demander Freya. Il faut que je finisse de faire rentrer ce tabac pour la nuit, mais je viens dans un instant. »
Heemskirk n’était pas insensible à cette proposition. Elle répondait à son secret désir, qui n’était pas toutefois celui de boire. Derrière lui, le vieux Nelson lui cria de se mettre à son aise et qu’il y avait une boîte de cigares dans la véranda.
Le vieux Nelson voulait dire la véranda du côté de l’ouest, celle qui servait de salon à la maison et qui avait de très jolis stores de rotin. La véranda de l’est, qui lui était entièrement réservée, où il soufflait et donnait les autres signes de sa perplexité, était garnie de solides tendelets de toile à voile. Du côté du nord il n’y avait pas, en fait, de véranda. C’était plutôt une sorte de balcon. Il ne communiquait pas avec les deux autres et l’on n’y accédait que par un couloir intérieur. Cela en faisait un endroit retiré qui convenait aux méditations silencieuses d’une jeune fille et aussi aux discours, apparemment dénués de sens, qui, s’ils s’échangent entre un jeune homme et une jeune fille, s’imprègnent d’une diversité de significations transcendantales.
Cette véranda du nord était garnie de plantes grimpantes. Freya, dont la chambre ouvrait de ce côté, l’avait meublée comme un boudoir, avec des chaises cannées et un sopha. Sur ce sopha, Jasper et elle étaient assis aussi près l’un de l’autre que cela se peut en ce monde imparfait où il est aussi impossible à un corps d’être à deux places à la fois qu’à deux corps d’être à une seule place en même temps. Ils avaient passé là tout l’après-midi et je ne puis dire que leur conversation ait été complètement dénuée de sens. Comme elle l’aimait avec une judicieuse inquiétude de le voir se briser le cœur par quelque fâcheuse imprudence, Freya, naturellement, lui parlait avec modération. Quant à lui, autant il était nerveux et brusque quand il était loin d’elle, autant, à sa vue, il était dominé par l’émerveillement de se sentir aimé. Fils d’un père âgé, ayant perdu sa mère de bonne heure, lancé encore très jeune à la mer, il n’avait guère d’expérience en fait de tendresse.
Sur cette véranda retirée, abritée de feuillages, et à cette heure tardive de l’après-midi, il se pencha et, s’emparant des mains de Freya, se mit à les embrasser l’une après l’autre, tandis qu’elle souriait et le regardait faire avec une bienveillante compassion. A ce même moment Heemskirk, venant du nord, s’approchait de la maison.
Antonia veillait de ce côté. Mais elle n’exerçait pas une très bonne surveillance. Le soleil sa couchait ; elle savait que sa jeune maîtresse et le capitaine du Bonito étaient sur le point de se séparer. Elle marchait de long en large dans ce bosquet poussiéreux, une fleur dans les cheveux, en fredonnant à mi-voix, lorsque tout à coup, à deux pas d’elle, elle vit le lieutenant déboucher derrière un arbre. Elle fit un bond de côté comme une biche effrayée, mais Heemskirk, qui avait aussitôt compris ce qu’elle faisait là, s’élança sur elle, la saisit par le bras et lui mettant son autre main sur la bouche :
— « Si tu fais le moindre bruit, je te tords le cou. »
La férocité de cette image terrifia la pauvre fille. Heemskirk avait parfaitement vu sur la véranda la tête dorée de Freya et une autre tête tout auprès. Il n’eut pas de mal à traîner la fille avec lui par un chemin en demi-cercle vers les communs où il l’envoya d’une poussée dans la direction d’un groupe de cabanes de bambous affectées aux serviteurs.
Elle ressemblait fort à la fidèle camériste de la comédie italienne ; mais, terrorisée, elle s’empressa, sans un cri, d’échapper à ce petit homme rondelet, aux yeux noirs et dont la poigne avait la fermeté d’une vis. Toute tremblante, extrêmement effrayée et retenant pourtant une envie de rire, elle le vit entrer dans la maison par derrière.
L’intérieur du bungalow était divisé par deux couloirs qui se croisaient au milieu. Arrivé à cet endroit, en tournant la tête légèrement à gauche, Heemskirk acquit la certitude d’une intimité qui contredisait si complètement les assurances du vieux Nelson qu’il en chancela presque, tandis qu’une bouffée de sang lui montait à la tête. Deux formes blanches qui se détachaient sur la lumière, se tenaient dans une attitude qui ne laissait aucun doute. Freya entourait de ses bras le cou de Jasper. Leurs visages étaient collés l’un contre l’autre, et Heemskirk s’éloigna, tandis qu’un flot de jurons l’étouffait ; une fois dans la véranda de l’ouest, il buta contre une chaise et se laissa tomber sur une autre comme si ses jambes se dérobaient sous lui. Il avait trop longtemps pris l’habitude de s’approprier Freya dans sa pensée. « C’est ainsi que vous entretenez vos visiteurs, vous… » pensa-t-il, si furieux qu’il ne pouvait même pas trouver une épithète assez injurieuse.
Freya se dégagea un peu et écarta sa tête.
— « Quelqu’un est entré », murmura-t-elle. Jasper, qui la tenait étroitement serrée contre lui tout en la regardant, suggéra tranquillement : « Votre père ».
Freya essaya de se dégager tout à fait, mais elle n’avait pas le courage de le repousser vraiment avec les mains.
— « Je crois que c’est Heemskirk ! » murmura-t-elle.
Tout en plongeant dans ses yeux avec un ravissement tranquille, le son de ce nom lui fit esquisser un vague sourire.
— « Cet imbécile s’amuse à démolir mes balises à la sortie de la rivière », murmura-t-il. Il n’attachait pas d’autre importance à l’existence d’Heemskirk : mais Freya se demandait si le lieutenant les avait vus.
— « Laissez-moi, mon petit », déclara-t-elle à voix basse mais résolument. Jasper obéit, et se reculant aussitôt, continua à contempler le visage de Freya sous un autre angle. « Il faut que j’aille voir », se dit-elle avec anxiété.
Elle lui ordonna rapidement d’attendre un peu, puis de passer dans la véranda opposée et d’aller fumer tranquillement un cigare avant de se montrer.
— « Ne restez pas tard ce soir ! » fut sa dernière recommandation avant de le quitter.
Après quoi Freya se dirigea d’un pas rapide et léger vers la véranda qui faisait face à l’ouest. Tout en franchissant la porte elle s’arrangea pour faire retomber les rideaux à l’extrémité du passage, de façon à couvrir la retraite de Jasper. Aussitôt qu’il la vit, Heemskirk se mit brusquement sur pied comme s’il allait se jeter sur elle. Elle s’arrêta et il lui fit un salut exagérément cérémonieux.
Ce salut irrita vivement Freya.
— « Oh ! c’est vous, Monsieur Heemskirk. Comment allez-vous ? »
Sa voix avait son intonation habituelle. Il ne pouvait pas distinguer complètement son visage dans le demi-jour de la véranda. Il n’osait pas se risquer à parler, tant ce qu’il avait vu avait allumé sa rage. Et quand elle eut ajouté avec sérénité : « Papa va venir dans un instant », il lui adressa mentalement d’abominables injures, avant qu’aucun son ne parvînt à franchir ses lèvres contractées.
— « J’ai déjà vu votre père. Nous avons eu une conversation aux séchoirs. Il m’a dit des choses très intéressantes. Oh ! très… »
Freya s’assit. Elle pensait : « Il nous a vus, c’est sûr. » Elle n’en avait pas la moindre honte. Elle appréhendait seulement quelque absurde ou fâcheuse complication. Mais elle ne pouvait concevoir à quel point Heemskirk (dans sa pensée) s’était approprié sa propre personne. Elle essaya de faire la conversation.
— « Vous arrivez de Palembang, je suppose ? »
— « Hein ? Quoi ? Ah ! oui ! J’arrive de Palembang. Ha ! ha ! ah ! Vous savez ce que votre père m’a dit ? Il m’a dit qu’il craignait que vous ne vous ennuyiez ici. »
— « Et je suppose que vous allez en croisière aux îles Moluques », continua Freya qui désirait, si possible, obtenir quelque renseignement utile pour Jasper. En même temps elle était toujours satisfaite de savoir ces deux hommes à quelques centaines de milles l’un de l’autre quand elle ne les avait pas sous les yeux.
Heemskirk grommela d’un air furieux.
— « Oui. Aux Moluques », tout en continuant à regarder cette silhouette à demi distincte. « Votre père trouve que c’est bien calme ici pour vous. Je vous le dis, Mademoiselle Freya. Il n’y a pas sur la terre un endroit si calme qu’une femme n’y puisse trouver une occasion de s’y moquer de quelqu’un. »
Freya pensa : « Je ne vais pas le laisser me provoquer. » Le boy Tamil, qui était le principal serviteur de Nelson, entra, apportant les lumières. Avec force précisions elle lui indiqua où placer les lampes et lui commanda d’apporter le plateau avec le gin et le bitter et de dire à Antonia de venir au bungalow.
— « Il faut que je vous laisse seul un moment, Monsieur Heemskirk », dit-elle.
Et elle alla dans sa chambre changer de robe. Ce qu’elle fit rapidement, car elle voulait revenir sur la véranda avant que son père et le lieutenant ne se retrouvassent ensemble. Elle comptait diriger la conversation de la soirée entre ces deux-là. Mais Antonia, encore tout effrayée, lui montra sur son bras un bleu qui souleva l’indignation de Freya.
— « Il est sorti du buisson et a sauté sur moi comme un tigre », déclara la fille, tout en riant nerveusement avec un regard d’effroi.
— « La brute ! » pensa Freya. « Il avait donc l’intention de nous espionner ». Elle était furieuse, mais le souvenir de cet épais Hollandais dans son pantalon blanc large aux hanches et serré à la cheville, avec ses pattes d’épaules et sa tête noire en boule, la regardant à la lumière des lampes, était à la fois si repoussant et si comique qu’elle ne put réprimer une grimace. Puis l’inquiétude la reprit. Les absurdités de ces trois hommes lui en donnaient de justes raisons : l’impétuosité de Jasper, les craintes de son père, l’engouement d’Heemskirk. Elle ne ressentait que de la tendresse pour les deux premiers, et elle prit le parti de mettre en œuvre toute sa diplomatie féminine. Tout ceci, se dit-elle, va finir une fois pour toutes avant qu’il soit longtemps.
Dans la véranda, Heemskirk, vautré sur une chaise, les jambes allongées et sa casquette blanche sur le ventre, s’abandonnait à une violente fureur, absolument incompréhensible pour une femme comme Freya. Il avait le menton sur la poitrine, ses yeux étaient rivés sur la pointe de ses souliers. Freya l’observa derrière le rideau. Il ne bougeait pas. Il était ridicule. Mais cette immobilité absolue était impressionnante. Elle rebroussa chemin le long du couloir jusqu’à la véranda de l’est, où Jasper était resté assis tranquillement dans l’obscurité, comme on le lui avait demandé, comme un petit garçon bien sage.
Elle siffla : « Pstt ». D’un bond il fut près d’elle.
— « Oui. Qu’y a-t-il ? » murmura-t-il.
— « C’est ce cancrelat », chuchota-t-elle avec hésitation. Sous l’impression de la sinistre immobilité d’Heemskirk, elle avait à moitié résolu de dire à Jasper qu’on les avait vus. Mais elle n’était pas du tout sûre qu’Heemskirk en soufflerait mot à son père, — et en tout cas pas ce soir même. Elle se persuada rapidement que le mieux était de tenir Jasper à l’écart aussi tôt que possible.
— « Qu’est-ce qu’il a fait ? » demanda calmement Jasper à voix basse.
— « Oh ! rien ! rien. Il est là-bas et il a l’air fâché. Mais vous savez comment il passe son temps à ennuyer papa. »
— « Votre père n’est pas du tout raisonnable », déclara Jasper d’un ton sentencieux.
— « Je ne sais pas », dit-elle d’un air de doute. La crainte que les autorités inspiraient au vieux Nelson avait légèrement déteint sur la jeune fille à force de vivre dans cette atmosphère jour après jour. « Je ne sais pas. Papa a peur d’être réduit à la mendicité, comme il dit, sur ses vieux jours. Écoutez, mon petit, il vaut mieux partir demain, en tout cas. »
Jasper avait espéré passer un autre après-midi avec Freya, un après-midi de félicité paisible, avec la jeune fille à son côté et son brick sous les yeux, à se représenter son bonheur prochain. Son silence exprima éloquemment sa déception, et Freya pouvait le comprendre. Elle aussi était déçue. Mais c’était à elle d’être raisonnable.
— « Nous n’aurons pas un moment à nous avec ce cancrelat dans la maison », déclara-t-elle d’une voix précipitée. « Alors à quoi bon rester ? Il ne s’en ira pas tant que le brick sera ici. Vous savez bien qu’il ne s’en ira pas. »
— « Il faudrait le signaler pour sa paresse », murmura Jasper avec un petit rire vexé.
— « Tenez-vous prêt à partir au petit jour », lui recommanda Freya dans un souffle.
Il la retenait comme peut le faire un amoureux. Elle lui faisait ces recommandations sans ardeur, parce qu’il lui en coûtait trop de le repousser. Il lui murmura à l’oreille, en lui passant le bras autour de la taille :
— « La prochaine fois que nous nous retrouverons, la prochaine fois que je vous tiendrai comme ceci, ce sera à bord. Vous et moi, sur le brick… Le monde entier, la vie entière… » Et alors il éclata :
— « Comment puis-je attendre ? J’ai une telle envie de vous enlever, tout de suite. Je voudrais courir avec vous dans mes bras…, jusqu’au bas du sentier…, sans broncher… sans toucher terre… »
Elle était immobile. Elle écoutait vibrer dans sa voix l’accent de la passion. Elle se disait que si elle murmurait « oui », si faiblement que ce fût, si elle y consentait d’un soupir, il le ferait. Il était capable de le faire… Sans toucher terre. Elle ferma les yeux et se prit à sourire dans l’obscurité ; en proie à un délicieux vertige, elle s’abandonna, un moment, dans ses bras. Mais avant qu’il n’eût eu la tentation de resserrer son étreinte, elle s’en était déjà dégagée et, à un pas de lui, elle avait repris possession d’elle-même.
Telle était la fermeté de Freya. Elle fut touchée du profond soupir qui, du visage blanc de Jasper immobile, arriva jusqu’à elle.
— « Vous êtes un fou », lui dit-elle en frissonnant. Puis changeant de ton : « Personne ne pourrait m’enlever. Pas même vous. Je ne suis pas de celles qu’on enlève ». La force de cette affirmation sembla faire osciller un peu sa forme blanche, puis elle se détendit : « Ne vous suffit-il pas de savoir que vous m’avez… que vous m’avez entraînée ? » ajouta-t-elle avec tendresse.
Il murmura un mot caressant et elle poursuivit :
— « Je vous l’ai promis, — je vous ai dit que je viendrai, et je viendrai de mon propre gré. Vous m’attendrez à bord. Je monterai l’échelle, — toute seule ; et je vous rejoindrai sur le pont et je vous dirai : « Me voici. » Et alors, et alors je serai enlevée. Mais ce ne sera pas un homme qui m’enlèvera, ce sera le brick, votre brick, notre brick… Je l’adore. »
Un son inarticulé lui parvint, comme un gémissement de plaisir ou de peine, et elle s’arracha à lui. Il y avait cet autre homme sur l’autre véranda, cet aigre et noir Hollandais qui pouvait tout gâter entre Allen et son père, amener une discussion, des mots fâcheux, peut-être des coups. Quelle horrible situation ! Mais, même en écartant cette affreuse extrémité, elle frissonnait à la pensée de passer encore trois mois avec un pauvre homme absurde, tourmenté, fâché, absorbé. Et quand le jour viendrait, le jour et l’heure, que ferait-elle si son père essayait de la retenir de force, — comme c’était possible, après tout ? Pourrait-elle lutter avec lui corps à corps, véritablement ? Mais c’était surtout des lamentations et des supplications qu’elle avait peur. Pourrait-elle les supporter ? Quelle odieuse, ridicule et cruelle situation ce serait !
— « Mais cela n’arrivera pas. Il ne dira rien », pensait-elle tout en se dirigeant rapidement vers la véranda. Et, voyant qu’Heemskirk n’avait pas bougé, elle s’assit sur une chaise près de la porte et resta les yeux fixés sur lui. Le lieutenant, en dépit de sa fureur, n’avait pas changé d’attitude : sa casquette seulement était tombée et traînait par terre. Il fronça ses épais sourcils noirs, tout en l’observant du coin de l’œil. Et ce regard de côté, ce nez recourbé, toute cette grosse personne mal bâtie, étalée là, semblèrent à Freya si singulièrement comiques, que, si troublée qu’elle fût intérieurement, elle ne put retenir un sourire. Elle fit de son mieux pour donner à ce sourire un caractère conciliant. Elle ne voulait pas provoquer Heemskirk sans nécessité.
Et, à la vue de ce sourire, le lieutenant se sentit mollir. Il ne lui était jamais entré dans l’esprit que son apparence extérieure, celle d’un officier de marine en uniforme, pouvait paraître ridicule à une fille sans importance, — la fille du vieux Nielsen. Le souvenir de ses bras autour du cou de Jasper l’irritait encore et l’excitait. « La coquine ! » pensait-il. « Elle sourit, hein ? C’est ainsi que vous vous amusez. Vous vous moquez de votre père à merveille, n’est-ce pas ? Vous aimez cette sorte de plaisanterie, n’est-ce pas ? Eh bien ! nous verrons… » Il ne changea pas de position, mais sur ses lèvres pincées flotta aussi un sourire, un sourire aigre et de mauvais augure, tandis que son regard se remit à contempler la pointe de ses souliers.
Freya se sentait brûler d’indignation. Elle était radieusement blonde dans la lumière de la lampe, ses belles mains posées l’une sur l’autre… « L’odieuse créature », pensait-elle. Son visage soudain s’empourpra de colère… « Vous avez effrayé ma femme de chambre », lui dit-elle à haute voix. « Qu’est-ce qui vous a pris ? »
Il pensait si profondément à elle que le son de sa voix prononçant ces mots inattendus le troubla extrêmement. Il releva brusquement la tête avec un air si égaré que Freya insista avec impatience :
— « Je veux dire Antonia. Vous lui avez fait un bleu au bras. Qu’est-ce que cela signifie ? »
— « Vous voulez vous quereller avec moi ? » demanda-t-il avec embarras et quelque stupéfaction. Il clignait des yeux comme un hibou. Il avait vraiment l’air ridicule et Freya, comme un sens aigu du ridicule extérieur :
— « Ma foi, non ! Je n’y tiens pas. » Elle ne put se contenir. Elle éclata de rire, un rire clair et nerveux auquel Heemskirk s’associa soudain avec un rude « Ha ! ha ! ha ! »
Un bruit de voix et de pas se fit entendre dans le couloir et Jasper, accompagné de Nelson, entra. Le vieux Nelson lança vers sa fille un regard approbateur, car il aimait qu’on mît le lieutenant de bonne humeur. Et il s’associa à leur gaieté : « Maintenant, lieutenant, allons dîner », dit-il, en se frottant joyeusement les mains. Jasper était allé s’appuyer à la balustrade. Le ciel était rempli d’étoiles et, dans cette nuit de velours bleu, la baie, en contre-bas, était d’un noir plus profond, où les points rougeâtres des feux de mouillage du brick et de la canonnière avaient l’air d’étincelles en suspens. « La prochaine fois que ces feux de mouillage brilleront là en bas, j’attendrai qu’elle vienne sur la dunette me dire : « Me voici », pensait Jasper : et il sentait son cœur se gonfler dans sa poitrine, dilaté par un bonheur si pesant qu’il lui arracha presque un cri. Il n’y avait pas la moindre brise. Aucune feuille au-dessous de lui ne frémissait et la mer même n’était qu’une ombre immobile et muette. Au loin, de pâles éclairs, les éclairs de chaleur des Tropiques, jouaient parmi les étoiles basses, étincelles brusques, vagues, dont la mystérieuse succession semblait les signaux incompréhensibles de quelque distante planète.
Le dîner se passa tranquillement. Freya, calme mais pâle, était placée en face de son père. Heemskirk affecta de ne parler qu’au vieux Nelson. La tenue de Jasper fut exemplaire. Il sut contenir ses regards, plongé dans le sentiment de la présence de Freya, comme on se baigne dans le soleil sans lever les yeux vers le ciel. Et presque aussitôt après le dîner, obéissant aux instructions qu’il avait reçues, il déclara qu’il lui fallait regagner son bord.
Heemskirk ne levait pas les yeux. Enfoncé dans son rocking-chair et tirant sur son cigare, il semblait préparer d’un air morose quelque abominable éclat. C’était du moins l’impression qu’il faisait à Freya. Le vieux Nelson s’empressa de dire : « Je descends avec vous. » Il avait commencé une conversation sur les dangers de la côte de la Nouvelle-Guinée et voulait raconter à Jasper quelques-unes de ses expériences du temps où il y était. Jasper était un si bon public ! Freya fit un mouvement pour les accompagner, mais son père fronça les sourcils, hocha la tête et indiqua d’une manière significative l’immuable Heemskirk qui, les yeux mi-clos, continuait à souffler sa fumée, en avançant les lèvres. Il ne fallait pas laisser le lieutenant seul. Il pourrait s’en offenser, peut-être.
Freya se rendit à ces signes. « Peut-être vaut-il mieux que je reste », pensa-t-elle. Les femmes ne sont pas généralement portées à passer en revue leur conduite, encore moins à la condamner. Les embarrassantes absurdités masculines sont le plus souvent responsables de cet état de choses. Mais, en regardant Heemskirk, Freya éprouva du regret et même quelque remords. Son gros corps au repos donnait la sensation d’un être gavé ; mais en fait il avait fort peu mangé. Il avait beaucoup bu, en revanche. Les lobes charnus de ses vilaines oreilles étaient écarlates. Elles flamboyaient auprès des joues plates et jaunes. Il resta longtemps sans même lever ses cils bruns. Être à la merci d’une pareille créature était vraiment humiliant : et Freya, qui finissait toujours par être franche avec elle-même, pensait avec regret : « Si seulement j’avais tout dit à papa dès le début ! Mais quelle vie impossible ne m’eût-il pas faite ? » Oui : les hommes ont bien des façons d’être absurdes : charmantes, comme Jasper, impraticables, comme son père, odieuses, comme cet être grotesquement vautré dans ce fauteuil. Fallait-il s’expliquer avec lui ? Peut-être n’était-ce pas nécessaire. « Oh ! je ne peux pas lui parler », pensa-t-elle. Et quand Heemskirk, toujours sans la regarder, se mit résolument à écraser sur le plateau à café son cigare à demi fumé, elle prit peur : elle s’avança vers le piano, l’ouvrit brusquement et commença à en frapper les touches avant même de s’être assise.
En un instant la véranda, tout le bungalow de bois dépourvu de tapis et construit sur pilotis, s’emplit de sons bruyants et confus. Mais elle n’en entendait pas moins, elle sentait peser sur le parquet les pas lourds du lieutenant qui allait et venait dans son dos. Il n’était pas absolument ivre, mais il avait assez bu pour que les suggestions d’une imagination excitée pussent lui sembler réalisables et même habiles, remarquablement habiles. Freya, qui le sentait arrêté juste derrière elle, n’en continua pas moins à jouer sans tourner la tête. Elle jouait avec feu un morceau très brillant, mais en entendant sa voix elle se sentit devenir glacée. Ce fut la voix, pas les mots. L’insolente familiarité de l’intonation l’épouvanta à tel point qu’elle ne comprit pas d’abord ce qu’il disait. Il est vrai que son articulation était pâteuse.
— « Je soupçonnais… Je soupçonnais naturellement quelque chose de vos petites histoires. Je ne suis pas un enfant. Mais de soupçonner à voir, — voir, vous entendez bien, — il y a une énorme différence. Une pareille chose… Ma foi ! On n’est pas de bois. Et quand un homme a été tourmenté par une femme comme je l’ai été par vous, Mademoiselle Freya, nuit et jour, cela va sans dire… Mais je suis un homme du monde. Vous devez vous ennuyer ici… Dites-moi, vous n’allez pas bientôt cesser cette musique infernale…? »
Cette dernière phrase fut la seule qu’elle put réellement comprendre. Elle secoua la tête négativement et, au désespoir, mit la pédale forte, mais le son du piano ne parvint pas à couvrir la voix du lieutenant.
— « Seulement, je suis surpris que vous puissiez… Le patron d’un simple bateau de commerce anglais, un garçon quelconque ! Cette tourbe insolente qui infeste les îles ! Je me débarrasserais volontiers de cette engeance ! Tandis que vous avez ici un bon ami, un homme prêt à se mettre à vos pieds, vos jolis pieds, — un officier, un homme de bonne famille. C’est étrange, n’est-ce pas ? mais que voulez-vous ! Vous êtes digne d’un prince ! »
Freya ne tourna même pas la tête. Son visage s’était raidi d’horreur et d’indignation. Cette aventure passait son imagination. Il n’était pas dans son caractère de se lever brusquement et de s’enfuir. Il lui semblait, en outre, que si elle bougeait on ne pouvait savoir ce qui arriverait. Son père allait revenir dans un instant et l’autre serait obligé de partir. Il valait mieux ignorer, — ignorer. Elle continua à jouer fort et correctement, comme si elle eût été seule, comme si Heemskirk n’eût pas existé. Cette façon de faire exaspéra celui-ci.
— « Allez. Vous pouvez tromper votre père », cria-t-il avec colère, « mais vous ne vous moquerez pas de moi. Cessez ce bruit infernal. Freya… Eh ! déesse scandinave de l’Amour. Assez ! vous entendez ? Voilà ce que vous êtes… de l’amour. Mais les dieux païens ne sont que des diables déguisés, et c’est ce que vous êtes, vous aussi : un véritable diable ! Cessez, je vous dis, ou je vous enlève de ce tabouret. »
Debout derrière elle, il la dévorait des yeux : depuis la couronne dorée de sa tête absolument rigide jusqu’à ses talons, la ligne de ses magnifiques épaules, les courbes de sa belle silhouette qui se balançait légèrement devant le clavier. Elle était vêtue d’une robe légère : les manches bordées de dentelle s’arrêtaient aux coudes. Un ruban de satin lui entourait la taille. Dans un accès d’irrésistible témérité il posa ses deux mains sur cette taille, — alors cette exaspérante musique s’arrêta net. Mais si vive qu’elle fût à en éviter le contact (le tabouret se renversa avec fracas) les lèvres d’Heemskirk, visant son cou, posèrent un avide baiser juste derrière son oreille. Un profond silence régna pendant un moment. Puis il se mit à rire doucement.
Il fut quelque peu décontenancé de lui voir un visage blême, immobile et ses grands yeux d’un violet pâle qui le fixaient, pétrifiés. Elle n’avait pas prononcé un seul mot. Elle le regardait, s’appuyant d’une main étendue à l’angle du piano, tandis que, de l’autre, elle frottait machinalement et avec persistance l’endroit que les lèvres d’Heemskirk avaient touché.
— « Qu’y a-t-il ! » dit-il, offensé. « Ça vous étonne ? Écoutez, pas de bêtise. Vous n’allez pas me dire qu’un baiser vous effraye à ce point-là… Je sais à quoi m’en tenir… On ne me fera pas faire le pied de grue. »
Il la regardait en face avec une telle intensité qu’il ne pouvait plus voir distinctement son visage. Autour de lui tout lui semblait embrumé. Il en oublia le tabouret renversé, se prit le pied dedans et buta légèrement, tout en disant d’un ton aimable :
— « Je ne suis pas un idiot, vraiment. Quelques baisers pour commencer… »
Il n’eut pas le temps d’en dire davantage, car sa tête reçut un terrible choc, accompagné d’un bruit pareil à celui d’une explosion. Freya avait allongé son robuste bras avec une telle force que la rencontre de sa paume et de la joue plate du lieutenant le fit à moitié pivoter sur lui-même. Tout en poussant un faible cri rauque, le lieutenant porta ses deux mains au côté gauche de son visage qui avait pris soudain un ton brique. Freya, très droite, ses yeux violets devenus plus sombres, la paume de sa main tremblant encore de ce coup, tandis qu’un sourire retenu montrait légèrement l’éclat de ses dents blanches, entendit le pas lourd et rapide de son père, dans le sentier, en bas de la véranda. Son expression perdit tout caractère agressif et trahit aussitôt une sincère inquiétude. Elle était ennuyée pour son père. Elle se baissa rapidement pour relever le tabouret de piano, comme pour effacer toute trace de ce qui venait de se passer… Mais c’était inutile. Elle avait repris son attitude, une main légèrement posée sur le piano, avant que le vieux Nelson eût atteint le haut des marches.
Pauvre père ! Comme il allait être furieux, et ennuyé ! Et ensuite, que de craintes, que de peine ! Pourquoi n’avait-elle pas été franche avec lui dès le début ? Le regard étonné et innocent de son père l’atteignit au vif. Mais il ne la regardait pas. Il considérait Heemskirk, qui le dos tourné, et les mains à la figure, jurait entre ses dents et (elle le voyait de profil) lui lançait des regards furieux d’un seul œil noir, d’un œil mauvais.
— « Qu’y a-t-il ? » demanda le vieux Nelson, bouleversé.
Elle ne répondit rien. Elle était en train de penser à Jasper sur le pont du brick, regardant vers le bungalow éclairé, et elle eut peur. C’était une bénédiction que l’un d’eux au moins fût à bord, loin de tout cela. Elle souhaitait seulement qu’il pût être à des centaines de milles de là. Et pourtant elle n’était pas certaine de le souhaiter. Si Jasper, à ce moment, avait été mystérieusement poussé à reparaître sur la véranda, elle eût envoyé à tous les diables son entêtement, sa fermeté, sa maîtrise de soi, et elle se fût jetée dans ses bras.
— « Qu’y a-t-il ? Qu’y a-t-il ? » insista le vieux Nelson qui ne soupçonnait rien, mais que ce silence irritait. « Il y a un instant tu jouais un morceau, et… »
Freya, incapable de parler, tant elle appréhendait ce qui allait arriver (et elle était en outre fascinée par cet œil noir) fit un léger signe de tête dans la direction du lieutenant comme pour dire : « Il n’y a qu’à le regarder. »
— « Eh ! quoi ! » s’écria le vieux Nelson. « Je vois. Mon Dieu… »
En même temps il s’était approché prudemment d’Heemskirk qui, éclatant en incohérentes imprécations, tapait du pied. L’indignité du coup, la rage de se voir joué, le ridicule de la scène et l’impossibilité de se venger le rendaient fou au point de lui donner envie de hurler de fureur.
— « Oh ! oh ! oh ! » hurlait-il, en arpentant la véranda tout en trépignant comme s’il voulait à chaque pas faire passer son pied à travers le plancher.
— « Eh quoi, êtes-vous blessé ? » demanda le vieux Nelson ahuri. La vérité éclaira soudain son esprit innocent. « Mon Dieu, mon Dieu ! » s’écria-t-il, illuminé. « Va me chercher du cognac, vite, Freya !… Etes-vous sujet à cela, lieutenant ? Sale affaire, hein ? Je connais cela, je connais cela. J’en devenais fou moi-même tout à coup, autrefois… Et la petite bouteille de laudanum dans le placard à pharmacie aussi, Freya ! Regarde bien… Tu ne vois pas qu’il a mal aux dents ? »
Et quelle autre explication aurait en effet pu se présenter à l’esprit sans malice du pauvre vieux Nelson, en voyant cette joue tenue à deux mains, ces regards furieux, ces trépignements, l’agitation désordonnée de ce corps ? Il eût fallu une pénétration surnaturelle pour en découvrir la véritable cause. Freya n’avait pas bougé. Elle observait le regard noir et sauvagement inquisiteur qu’Heemskirk fixait sur elle. « Ah ! tu voudrais bien être parti ! » se disait-elle. Elle le regardait sans broncher. La tentation de mettre fin à tout sans plus d’ennuis, fut irrésistible. Elle fit à son père un presque imperceptible geste d’assentiment et sortit.
— « Rapporte vite ce cognac », cria le vieux Nelson, comme elle disparaissait dans le couloir.
Heemskirk se soulagea en lançant dans sa direction une bordée d’injures, en hollandais et en anglais. Il divaguait tout son soûl, arpentant la véranda, bousculant les chaises, tandis que le vieux Nelson (ou Nielsen) dont la sympathie était vivement éveillée par ces preuves d’une violente souffrance, s’empressait autour de son cher (et redouté) lieutenant, comme une poule autour de son poussin.
— « Mon Dieu ! mon Dieu ! Ça fait si mal ? Je connais bien ça. Il y avait des fois où j’effrayais ma pauvre femme. Est-ce que ça vous arrive souvent, lieutenant ? »
Heemskirk l’écarta brutalement, en poussant un rire bref comme celui d’un fou. Mais son hôte trébuchant ne le prit pas mal : un homme qu’un violent mal de dents met hors de lui n’est pas responsable.
— « Allez dans ma chambre, lieutenant », lui dit-il avec empressement. « Jetez-vous sur mon lit. Nous vous donnerons quelque chose pour vous soulager dans un instant. »
Il saisit le pauvre patient par le bras et l’entraîna doucement vers le lit sur lequel Heemskirk, dans un nouvel accès de rage, se jeta avec une telle violence qu’il rebondit sur le matelas à la hauteur d’un pied au moins.
— « Eh ! bien, vrai ! » s’écria Nelson atterré. Et sans plus attendre il se précipita pour aller chercher le cognac et le laudanum, fort ennuyé de voir qu’on mettait si peu d’empressement à abréger les tortures de son précieux invité. En fin de compte il rapporta ces choses lui-même.
Une demi-heure plus tard il s’arrêta dans le corridor, surpris d’entendre à plusieurs reprises un bruit faible, d’une nature mystérieuse et qui tenait le milieu entre le rire et les sanglots. Il fronça le sourcil ; puis il se dirigea droit vers la chambre de sa fille et frappa à la porte.
Freya, son pâle visage encadré par ses cheveux blonds qui tombaient sur une robe de chambre bleu foncé, entr’ouvrit la porte.
La pièce n’était que faiblement éclairée. Antonia, pelotonnée dans un coin, se balançait en poussant de faibles gémissements. Le vieux Nelson n’avait pas une grande expérience des diverses sortes de rire féminin, mais il était sûr d’avoir entendu rire.
— « C’est vraiment très peu charitable, très peu charitable », dit-il, d’un air très mécontent. « Je me demande ce qu’un homme qui souffre a de si amusant ? J’aurais cru qu’une femme, — une jeune fille… »
— « Il était si drôle », murmura Freya, dont les yeux étincelaient étrangement dans la demi-obscurité du couloir. « Et puis, tu sais, il ne me plaît pas », ajouta-t-elle, d’une voix hésitante.
— « Drôle ? » répéta le vieux Nelson, stupéfait de découvrir une telle insensibilité dans un être si jeune. « Il ne te plaît pas ! Veux-tu dire que parce qu’il ne te plaît pas, tu…? Pourquoi ? c’est simplement cruel. Tu ne sais pas que c’est une des plus atroces sortes de souffrance. Il y a des chiens qui en sont devenus fous. »
— « Il a certainement l’air d’être devenu fou », reprit Freya avec un effort, comme si elle luttait contre un sentiment caché.
Mais son père était lancé.
— « Et tu sais comment il est. Il remarque tout. C’est un homme à s’offenser au moindre prétexte, — comme tous les Hollandais, — et je tiens à rester en bons termes avec lui. C’est comme cela, ma fille : si le rajah allait faire quelque sottise, — et tu sais comme moi combien il est boudeur et indocile, — si les autorités se mettaient dans la tête que mon influence sur lui n’est pas bonne, tu te trouverais sans un toit sur la tête… »
— « C’est insensé, papa ! » s’écria-t-elle, d’une voix mal assurée, et elle s’aperçut qu’il était en colère, assez en colère pour devenir ironique : oui, le vieux Nelson (ou Nielsen), ironique. Juste un éclair.
— « Bien sûr, si tu as des ressources personnelles, une maison, une plantation que j’ignore… » Mais il était incapable de soutenir longtemps ce ton-là. « Je te dis qu’ils me chasseraient d’ici », murmura-t-il avec force, « sans la moindre compensation, cela va sans dire. Je connais ces Hollandais. Et le lieutenant est un homme à mettre tout en branle. Il a l’oreille des fonctionnaires influents. Je ne voudrais le blesser pour rien au monde, pour rien au monde, — sous quelque prétexte que ce soit. Qu’est-ce que tu dis ?… »
Ce n’avait été qu’une exclamation inarticulée. Si jamais elle avait eu la moindre intention de tout lui dire, elle y avait maintenant renoncé. C’était impossible, à la fois, par égard pour la dignité de son père et pour le repos de son pauvre esprit.
— « Il ne m’intéresse pas beaucoup moi-même », avoua dans un soupir le vieux Nelson. « Il se sent mieux maintenant, reprit-il après un silence. Je lui ai donné mon lit pour la nuit. Je dormirai sur la véranda, dans le hamac. Non, je ne peux pas dire qu’il me plaise beaucoup non plus, mais de là à rire d’un homme parce qu’il devient fou de douleur, il y a une distance. Je suis surpris, Freya. Il a un côté de la figure tout à fait rouge. »
Les épaules de la jeune fille tremblaient convulsivement sous les mains qu’il avait posées paternellement sur elles. La moustache ébouriffée lui balaya le front comme il l’embrassait en lui souhaitant bonne nuit. Elle referma la porte et revint jusqu’au milieu de la pièce avant de se laisser aller à un rire las, sans aucune vivacité.
— « Rouge. Un peu rouge », se répétait-elle. « Je l’espère bien, ma foi. Un peu… »
Ses cils étaient humides. Antonia, dans son coin, gémissait et riait, et l’on ne pouvait dire où finissaient les gémissements et où commençaient les rires.
La maîtresse et la servante s’étaient mutuellement énervées, car Freya, en s’enfuyant dans sa chambre, y avait trouvé Antonia et lui avait tout raconté.
— « Je t’ai vengée, ma fille », s’était-elle écriée.
Et elles s’étaient mises à pleurer de rire et à rire en pleurant, tout en échangeant des recommandations. « Chut, pas si fort ! Reste tranquille ! » disait l’une et « J’ai si peur… Quel méchant homme ! » disait l’autre.
Antonia avait très peur d’Heemskirk. Son aspect lui faisait peur, ses yeux et ses sourcils, sa bouche, son nez et ses jambes. Rien n’était plus rationnel. Elle pensait que c’était un méchant homme parce que, à ses yeux, il en avait l’air. Dans la pénombre de la pièce où ne brûlait qu’une veilleuse à la tête du lit de Freya, la camériste, sortant de son coin, se traîna aux pieds de sa maîtresse, et murmura, suppliante :
— « Il y a le brick. Le capitaine Allen. Courons-y tout de suite, oh ! courons-y ! J’ai si peur ! Courons. Courons ! »
— « Moi ! M’enfuir ! » pensait Freya, sans abaisser son regard sur sa servante terrifiée. « Jamais ! »
Toutes les deux, l’énergique maîtresse, sous la moustiquaire, et la servante terrorisée couchée en rond sur une natte au pied du lit, ne dormirent guère cette nuit-là. Celui qui ne dormit pas du tout, ce fut le lieutenant Heemskirk. Il resta étendu sur le dos, à remâcher sa colère en regardant dans le noir. Des visions flamboyantes et d’humiliantes réflexions se succédaient dans son esprit, y entretenant, y accroissant la colère. Une jolie histoire à raconter ! Il ne fallait absolument pas que cela se sût. Il fallait dévorer cet outrage en silence. Charmante affaire ! Dupé, bafoué et frappé par cette femme, — et probablement dupé aussi par le père. Mais, non ! Nielsen n’était qu’une victime de plus de cette coquine éhontée, de cette impudente, de cette fine mouche, qui riait, embrassait, mentait…
— « Non ; il ne m’a pas dupé », pensait le lieutenant torturé. « Mais je ne serai pas fâché de lui faire payer cela, tout de même, pour être un pareil imbécile… »
Oui, un de ces jours, peut-être. Il avait du moins pris une résolution : celle de sortir de très bonne heure de cette maison. Il ne pensait pas pouvoir se retrouver en face de cette femme sans se mettre hors de lui.
« Enfer et damnation ! Quatre cent mille diables ! Je vais étouffer ici avant qu’il ne fasse jour ! » se disait-il à lui-même, étendu rigide sur le lit de Nelson, en s’efforçant de respirer.
Il se leva à la pointe du jour et se disposa à ouvrir la porte précautionneusement. De faibles bruits dans le couloir l’inquiétèrent, et de l’endroit où il resta caché il vit Freya qui sortait. A cette vue il ne se sentit plus le courage de se glisser par l’entre-bâillement de la porte, mais il pouvait apercevoir par cette petite fente l’extrémité de la véranda. Freya s’était dirigée de ce côté pour voir le brick doubler la pointe. Elle portait sa robe de chambre bleue : elle était pieds nus parce que, n’ayant pu dormir que vers le matin, elle n’avait fait qu’un bond, dans la crainte d’arriver trop tard. Heemskirk ne l’avait jamais vue ainsi, avec ses cheveux qui épousaient doucement la forme de sa tête et formaient une tresse blonde dans son dos, et avec cet air d’extrême jeunesse, cette intensité, cette vie. Il en resta d’abord interdit, puis il se mit à grincer des dents. Il ne pouvait vraiment pas se trouver en face d’elle. Il marmotta un juron et resta immobile derrière la porte.
Elle poussa un long soupir en apercevant le brick qui venait d’appareiller et prit la longue-vue de Nelson qui était suspendue à des crochets, assez haut contre le mur. La large manche de la robe de chambre glissa, découvrant son bras blanc jusqu’à l’épaule. Heemskirk, saisissant brusquement la poignée de la porte comme pour la broyer, se sentit comme un homme ivre qu’on vient de remettre sur ses pieds.
Freya savait qu’il l’observait. Elle l’avait vu. Elle avait vu la porte bouger au moment où elle sortait du couloir. Elle savait qu’il avait les yeux fixés sur elle, et en ressentait une dédaigneuse amertume, un triomphant mépris.
— « Ah ! tu es là ! » pensait-elle, en ajustant la lorgnette : « Eh bien, regarde alors ! »
Les îlots verts semblaient des ombres noires, la mer cendrée était lisse comme du verre, la robe claire de l’aube incolore sur laquelle le brick ne semblait qu’une ombre montrait vers l’orient un ourlet de lumière. Aussitôt que Freya eut distingué Jasper qui sur le pont, dirigeait sa propre lorgnette vers le bungalow, elle laissa retomber la sienne et leva ses deux beaux bras blancs au-dessus de sa tête. Dans cette attitude d’élan suprême, elle demeurait immobile, rayonnante de se savoir l’objet de l’adoration que Jasper adressait à la forme que de là-bas il voyait dans le champ de sa lorgnette ; et réchauffée en même temps par le sentiment de la passion mauvaise, des yeux brûlants de convoitise que l’autre tenait rivés dans son dos. La ferveur de son amour, le caprice de son esprit, et cette mystérieuse connaissance de la nature masculine que les femmes apportent en naissant, faisaient naître en elle cette pensée.
— « Tu regardes, tu le veux, tu le dois. Eh bien ! tu verras quelque chose. »
Elle porta les deux mains à ses lèvres, et elle envoya un baiser par-dessus la mer, comme si elle voulait jeter son cœur avec lui sur le pont du brick. Son visage était rose, ses yeux brillaient. Son geste passionné, mainte fois répété, semblait vouloir envoyer des baisers par centaines, encore et encore, tandis que le soleil qui montait lentement apportait au monde l’enchantement de la couleur, rendait vertes les îles, bleue la mer, et blanc le brick, — d’un blanc éblouissant dans le déploiement de ses voiles, — avec la tache rouge du pavillon britannique comme une langue de feu à la tête du mât. Et, chaque fois, elle murmurait avec plus de chaleur : « Prends ceci, et encore ceci, et encore… » jusqu’à ce que tout à coup elle laissât retomber ses bras. Elle avait vu le pavillon s’abaisser pour lui répondre, et le moment d’après, la pointe lui masqua la coque du navire. Alors elle se détourna de la balustrade, et, passant lentement devant la porte de la chambre de son père, les yeux baissés, et le visage empreint d’une expression énigmatique, elle disparut derrière le rideau.
Mais au lieu d’aller jusqu’au bout du couloir, elle resta là cachée et immobile pour voir ce qui allait se passer. La grande véranda demeura vide un moment. Puis la porte de la chambre du vieux Nelson s’ouvrit tout à coup et elle en vit sortir Heemskirk chancelant. Il avait les cheveux en broussaille, les yeux rouges, et sa figure non rasée semblait très noire. Il lançait des regards furieux à droite et à gauche : il aperçut sa casquette sur une table, s’en empara et se dirigea vers l’escalier, tranquillement, mais d’une démarche étrange, hésitante, comme le dernier effort d’une force défaillante.
Aussitôt que sa tête eut disparu au-dessous du niveau du plancher, Freya sortit de derrière le rideau, les lèvres serrées, et sans montrer la moindre douceur dans ses yeux. Il n’allait pas partir sans payer le prix. Cela jamais, jamais. Elle était toute vibrante, elle avait goûté du sang. Il fallait faire comprendre à Heemskirk qu’elle savait qu’il l’avait épiée : il fallait qu’il sût qu’on l’avait vu s’esquiver l’oreille basse. Mais courir jusqu’à la barrière et crier derrière lui, c’eût été enfantin, déplacé, vulgaire. Et crier quoi ? Quel mot ? Quelle phrase ? Non ; c’était impossible. Alors que faire ? Elle fronçait les sourcils. Elle découvrit le moyen, courut au piano qui toute la nuit était resté ouvert, et le monstre de palissandre se mit à rugir sauvagement. Elle frappa des accords comme si elle tirait des coups de feu dans la direction de ce gros homme vêtu d’un large pantalon blanc et d’un uniforme noir à pattes d’or, et elle le poursuivit avec le même morceau qu’elle avait joué la veille au soir, une œuvre moderne et passionnée où la musique dépeignait l’amour, et qui avait plus d’une fois rivalisé avec les orages sur ce groupe d’îles. Elle en accentuait le rythme avec une malice triomphante, si absorbée dans cette tâche qu’elle ne remarqua pas la présence de son père qui, après avoir passé sur sa chemise de nuit un vieil ulster à carreaux avait couru jusqu’à la véranda pour savoir la raison de cette exécution matinale. Il la regardait avec stupéfaction.
— « Mais qu’y a-t-il ?… Freya ?… » Sa voix était presque étouffée par le son du piano. « Qu’est devenu le lieutenant ? » cria-t-il.
Elle le regarda comme si son âme était perdue dans la musique, avec des yeux absents.
— « Parti. »
— « Quoi ?… Où ? »
Elle secoua légèrement la tête et se mit à jouer plus fort. Le regard innocemment anxieux du vieux Nelson, partant de la porte ouverte de sa chambre, se mit à explorer toute la pièce de fond en comble, comme si le lieutenant eût été quelque chose d’assez petit pour pouvoir ramper par terre ou grimper au mur. Mais un coup de sifflet strident, venu d’en bas, perça le grondement sonore qui sortait du piano en vagues vibrantes. Le lieutenant était déjà en bas de la baie, sifflant son canot pour l’emmener à bord. Et il semblait extrêmement pressé, car il siffla de nouveau presque aussitôt, attendit un moment, et envoya alors un appel long, interminable, aussi pénible à entendre que s’il eût poussé un cri perçant sans reprendre haleine. Freya cessa soudain de jouer.
— « Il a regagné son bord », s’écria le vieux Nelson tout troublé par cet événement. « Qu’est-ce qui l’a fait partir de si bonne heure ? Drôle de garçon ! Diablement susceptible, aussi ! Je ne serais pas surpris que ce fût ta conduite d’hier soir qui l’ait blessé. Je t’ai prévenue, Freya. Tu lui as, pour ainsi dire, ri au nez, pendant qu’il souffrait les tortures de la névralgie. Ce n’est pas une façon de te faire aimer. Tu l’as froissé. »
Les mains de Freya reposaient maintenant immobiles sur le clavier : elle inclina sa belle tête, en proie à un soudain mécontentement, à une lassitude nerveuse, comme si elle venait de traverser une crise épuisante. Le vieux Nelson (ou Nielsen), l’air affligé, roulait des plans politiques dans sa tête chauve.
— « Je crois que je ferais bien d’aller me renseigner à bord, ce matin, à une heure quelconque », déclara-t-il. « Pourquoi ne m’apporte-t-on pas mon thé ? Tu entends, Freya ? Tu m’as vraiment étonné, je dois te le dire. Je ne pensais pas qu’une jeune fille pouvait être aussi peu charitable. Et le lieutenant se croit un de nos amis ! Quoi ? Non ? Toujours est-il qu’il se dit notre ami, et c’est quelque chose pour quelqu’un dans ma position. Certainement ! Oh ! oui, il faut que j’aille à bord. »
— « Vraiment ? » murmura distraitement Freya : puis, à part elle-même, elle ajouta : « Pauvre homme ! »
Pour ce qui est des sept semaines suivantes, tout ce qu’il est nécessaire de dire, c’est, d’abord, que le vieux Nelson (ou Nielsen) ne réussit pas à faire sa visite diplomatique. La canonnière Neptune de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, commandée par un lieutenant fou de rage, appareilla à une heure singulièrement matinale. Quand le père de Freya descendit au rivage, après avoir veillé à ce que sa précieuse récolte de tabac fût convenablement exposée au soleil, la canonnière doublait déjà la pointe. Ce fut une circonstance que le vieux Nelson déplora durant bien des jours.
— « Je ne sais vraiment pas dans quelle disposition d’esprit il est parti », déclarait-il d’un ton lamentable à son impassible fille. Cette impassibilité le stupéfiait. L’indifférence de Freya allait presque jusqu’à l’effrayer.
Il faut rappeler en outre que, ce même jour, la canonnière Neptune, faisant route vers l’est, dépassa le brick Bonito encalminé en vue de Carimata, le cap à l’est lui aussi. Son capitaine, Jasper Allen, se perdant consciemment dans une tendre et absorbante rêverie dont la chère Freya faisait l’objet, ne se leva même pas de sa chaise-longue sur l’arrière, pour jeter un coup d’œil au Neptune qui passa si près que la fumée sortie soudain de sa courte cheminée noire ondula entre les mâts du Bonito, obscurcissant un moment la blancheur ensoleillée de ses voiles consacrées au service de l’amour. Jasper n’avait même pas tourné la tête pour le voir. Mais, Heemskirk, sur la passerelle avait longuement et attentivement examiné le brick, du plus loin qu’il avait pu l’apercevoir, en s’accrochant nerveusement à la rambarde de cuivre devant lui, jusqu’à ce que les deux bâtiments s’étant rapprochés, il perdît toute confiance en lui-même, et allât s’enfermer dans la chambre à cartes, en frappant violemment la porte derrière lui. Les sourcils froncés, la bouche tordue par une sardonique méditation, il demeura là plusieurs heures immobile, — comme une sorte de Prométhée en proie à un désir impie, les entrailles déchirées par le bec et les serres de la passion humiliée.
On ne chasse pas cette sorte de volatile aussi facilement qu’un poulet. Dupé, bafoué, trompé, éconduit, outragé, ridiculisé ; — bec et serres ! Quel sinistre oiseau ! Le lieutenant n’avait pas envie de devenir la risée de l’Archipel, et d’être l’officier de marine qui s’est fait gifler par une jeune fille. Était-il possible qu’elle aimât réellement ce misérable trafiquant ? Il essayait de ne pas penser, — mais pires que des pensées, des impressions définies venaient l’assaillir dans sa retraite. Il la voyait, — vision nette, précise, modelée, colorée, éclairée, — il la voyait tenir par le cou cet individu. Et il fermait les yeux, pour découvrir aussitôt que ce n’était pas là un remède. Un piano se mettait à jouer près de lui, très nettement : et il portait les mains à ses oreilles sans plus de succès. C’était vraiment intolérable, dans cette solitude. Il sortit de la chambre à cartes et se mit à parler de choses et d’autres à l’officier de quart sur la passerelle, mais il entendait toujours l’accompagnement moqueur d’un piano fantôme.
Il faut encore indiquer ici que le lieutenant Heemskirk au lieu de poursuivre sa route dans la direction de Ternate, où on l’attendait, fit un crochet pour relâcher à Macassar, où personne n’escomptait son arrivée. Une fois là, il fournit certaines explications et développa une certaine proposition au gouverneur, ou à quelque autre autorité, et obtint de pouvoir faire ce qu’il jugerait le mieux le cas échéant. C’est pourquoi le Neptune, délaissant absolument Ternate, fit route au nord en longeant la côte montagneuse des Célèbes, puis traversant l’étroite passe, alla se poster, le long d’une côte basse bordée de forêts vierges, inviolées et muettes, sur une mer phosphorescente la nuit, bleu-foncé le jour avec d’étincelantes taches vertes au-dessus de récifs submergés. Pendant des jours on eût pu voir le Neptune croiser lentement en vue de ce sombre rivage, ou stationner avec un air attentif auprès des embouchures argentées de larges estuaires, sous le grand ciel lumineux dont rien ne venait jamais adoucir ni voiler l’éclat et qui inondait la terre de l’éternelle clarté des tropiques, — cette clarté dont l’incessante splendeur oppresse l’âme d’une inexprimable mélancolie plus intime, plus pénétrante, plus profonde, que la grise tristesse des brumes du Nord.
Le brick de commerce Bonito apparut, doublant lentement un promontoire couvert d’une forêt sombre à l’embouchure argentée d’une large rivière. La brise qui lui donnait de l’erre n’aurait pas agité la flamme d’une torche. Il déboucha d’un rideau de feuilles immobiles, mystérieusement silencieux, comme un blanc fantôme, et son imperceptible mouvement lui donnait un air à la fois solennel et furtif. Jasper accoudé aux haubans du grand mât et la tête dans la main, pensait à Freya. Tout au monde la lui rappelait. La beauté de la femme aimée se retrouve dans les beautés de la nature. L’ondulation des collines, les courbes d’une côte, les sinuosités d’une rivière sont moins suaves que les lignes harmonieuses de son corps, et la grâce de sa démarche légère suggère le pouvoir de ces forces occultes qui commandent aux aspects les plus séduisants du monde visible.
Attaché aux choses comme le sont tous les hommes, Jasper aimait son navire, — la maison de ses rêves. Il lui prêtait un peu l’âme de Freya. Son pont était le point d’appui de leur amour. La possession de son brick apaisait sa passion, lui apportait la certitude calmante d’un bonheur déjà conquis.
La pleine lune était déjà haute, parfaite et sereine, elle flottait dans l’air aussi calme et limpide que le regard des yeux de Freya. On n’entendait pas un bruit à bord du brick.
— « Elle sera ici, près de moi, par des soirées semblables », pensait-il avec ravissement.
Et ce fut à ce moment, au milieu de cette paix, de cette sérénité, dans le plein éclat de la lune propice aux amoureux, sur une mer sans une ride, sous un ciel sans nuage, comme si la nature entière avait pris par dérision son aspect le plus clément, que la canonnière Neptune, se détachant de la côte sombre à l’abri de laquelle elle s’était défilée, s’avança pour couper la route au Bonito qui se dirigeait vers la mer.
Aussitôt qu’on eut vu la canonnière sortir de son embuscade, Schultz, l’homme à la voix séduisante, commença à donner les signes d’une singulière agitation. Tout le jour, depuis qu’on avait quitté le village malais situé assez haut sur la rivière, il avait eu un air hagard et avait rempli ses obligations comme un homme qui a quelque chose sur la conscience. Jasper l’avait remarqué, mais le second, se détournant, comme s’il ne voulait pas qu’on le regardât, avait marmotté qu’il avait mal aux dents et un peu de fièvre. Assez violemment sans doute au moment où, dans le dos de son capitaine, il s’était écrié : « Qu’est-ce qu’il peut bien nous vouloir ? » Un homme tout nu exposé à un vent glacé et qui s’efforcerait de ne pas grelotter n’aurait pas eu une intonation plus rauque ni plus hésitante. Mais ce pouvait être la fièvre, — il avait pu prendre froid.
— « Il veut nous ennuyer, tout simplement », répondit Jasper, de fort bonne humeur. « Ce n’est pas la première fois. Nous serons bientôt fixés. »
Et, en effet, les deux bâtiments furent bientôt à portée de voix. Le brick, avec ses lignes harmonieuses et ses voiles blanches, avait l’air d’un sylphe vaporeux dans le clair de lune. La canonnière, basse sur l’eau, trapue, avec ses moignons de mâts dénudés comme des arbres morts, se détachait sur le ciel lumineux de cette nuit resplendissante et projetait une ombre lourde sur la bande d’eau qui séparait les deux navires.
Freya les hantait l’un et l’autre comme un esprit doué du don d’ubiquité et comme si elle eût été l’unique femme au monde. Jasper se rappela la recommandation instante qu’elle lui avait faite de se montrer prudent et circonspect dans tous ses actes et toutes ses paroles, lorsqu’il était loin d’elle. A cette rencontre inattendue, il sentit à son oreille le souffle même de ces recommandations hâtives qui accompagnaient d’ordinaire le dernier instant de leurs réunions, il entendait encore le murmure à demi-plaisant de ces mots : « Et vous savez, mon petit, je ne vous le pardonnerais pas », qu’elle prononçait en lui pressant rapidement le bras, ce à quoi il répondait par un tranquille et confiant sourire. Heemskirk, lui, était hanté d’une toute autre manière. Pour lui il ne s’agissait pas de murmures, mais de visions. Il voyait la jeune fille tenant par le cou un misérable vagabond, ce vagabond, le vagabond qui venait précisément de répondre à son signal. Il la voyait traversant pieds nus une véranda, avec de grands yeux clairs et avides, pour aller regarder un brick, — ce brick. Si encore elle avait crié, si elle l’avait grondé, injurié… Mais non, elle avait simplement triomphé de lui. C’était tout. Éconduit (il le croyait fermement), dupé, trompé, outragé, frappé, ridiculisé… Bec et serres ! Les deux hommes, hantés de façon si différente par Freya des Sept-Iles, n’étaient pas à égalité.
Dans l’immobilité intense, semblable à celle du sommeil, qui s’était appesantie sur les deux bâtiments, dans un monde qui ne semblait être qu’un rêve suave, un canot tiré par des marins javanais traversa la bande d’eau sombre et accosta le brick. Le sous-officier blanc qui le commandait, le canonnier probablement, monta à bord. C’était un petit homme, avec un gros ventre et une voix poussive. Au clair de lune, son visage gras et immobile avait l’air inanimé et il marchait en tenant ses gros bras écartés comme s’il eût été empaillé. Ses petits yeux malins brillaient comme des morceaux de mica. Il pria Jasper, dans un mauvais anglais, de vouloir bien se rendre à bord du Neptune.
Jasper ne s’attendait pas à une demande aussi inaccoutumée. Mais après courte réflexion il décida de ne laisser paraître ni ennui, ni surprise. La rivière d’où il sortait avait été depuis plusieurs années le théâtre d’agitations politiques et il pensait bien que ses visites à cet endroit n’étaient pas vues d’un très bon œil. Mais il ne s’inquiétait guère de déplaire aux autorités, si redoutables aux yeux du vieux Nelson. Il se disposa à quitter le brick, et Schultz le suivit jusqu’à la lisse comme s’il voulait lui dire quelque chose, mais en fin de compte il demeura silencieux. Jasper, en enjambant le bastingage remarqua sa figure pâle. Les yeux de l’homme qui, à bord du brick, avait triomphé des effets de sa psychologie particulière le regardaient avec une expression muette et suppliante.
— « Qu’y a-t-il ? » demanda Jasper.
— « Je me demande comment ça va finir », dit-il de cette belle voix qui avait séduit Freya elle-même. Mais qu’était devenu son timbre charmant ? Ces mots avaient résonné comme le croassement d’un corbeau.
— « Vous êtes malade », assura Jasper.
— « Je voudrais être mort », déclara étrangement Schultz en se parlant à lui-même, sous l’effet d’un trouble mystérieux. Jasper le regarda attentivement, mais ce n’était pas le moment d’étudier l’accès morbide d’un homme en proie à la fièvre. Il n’avait pas absolument l’air de délirer, et pour le moment cela suffisait. Schultz fit un bond en avant.
— « Cet homme vous veut du mal », dit-il désespérément. « Il vous veut du mal, capitaine. Je le sens et je… »
Il suffoqua sous le coup d’une inexplicable émotion.
— « Ça va bien, Schultz. Je me lui en donnerai pas l’occasion », répliqua brusquement Jasper et il s’élança dans le canot.
A bord du Neptune, Heemskirk, debout, les jambes écartées, dans la clarté de la lune, son ombre couleur d’encre s’allongeant en travers du pont, ne fit aucun signe à son approche ; mais à la vue de cet homme il lui sembla que la mer se soulevait dans sa poitrine. Jasper attendait devant lui en silence.
Remis ainsi en contact direct, ils retrouvèrent immédiatement le caractère de leurs rencontres occasionnelles au bungalow de Nelson. Chacun d’eux ignora l’autre : Heemskirk, avec mauvaise humeur, Jasper, avec une parfaite et indifférente tranquillité.
— « Que se passe-t-il sur cette rivière dont vous venez de sortir ? » demanda brusquement le lieutenant.
— « Je ne sais rien de leurs agitations, si c’est de cela que vous voulez parler », répondit Jasper. « J’y ai débarqué un demi chargement de riz pour lequel je n’ai rien demandé et je suis parti. Il n’y a pas d’affaires possibles là-bas en ce moment : mais ils seraient morts de faim d’ici une semaine si je n’étais pas venu. »
— « Intervention ! Intervention anglaise ! Et supposez que ces coquins ne méritent rien de mieux que de mourir de faim, hein ? »
— « Il y a des femmes et des enfants, vous le savez », remarqua Jasper, d’un ton tranquille.
— « Ah ! oui ! Quand un Anglais parle de femmes et d’enfants, on peut être sûr qu’il y a quelque anguille sous roche. Nous examinerons cela. »
Ils parlaient l’un après l’autre, comme de purs esprits, de simples voix dans l’air : car ils se regardaient comme s’il n’y avait rien devant eux, ou, tout au plus, avec l’attention qu’on prête à des objets inanimés. Il y eut un moment de silence. Heemskirk venait de penser tout d’un coup : « Elle va tout lui raconter. Elle va tout lui raconter en riant et en le prenant par le cou. » Et le désir soudain d’anéantir Jasper sur place fut si violent qu’il le priva presque de ses sens. Il en perdit la parole, la vue. Pendant un moment il ne put absolument pas voir Jasper. Mais il l’entendit qui demandait, comme une voix qui fût venue du bout du monde :
— « Dois-je en conclure que le brick est saisi. »
Heemskirk se reprit dans un transport de satisfaction maligne.
— « Parfaitement. Je vais vous remorquer à Macassar. »
— « Les tribunaux décideront de la légalité de tout ceci », reprit Jasper, en voyant que la chose devenait sérieuse, mais sans se départir d’une indifférence affectée.
— « Oh ! oui, les tribunaux ! Certainement. Quant à vous, je vous garde à bord. »
La consternation de Jasper en se voyant séparé de son navire ne se trahit que par une immobilité de pierre. Cela ne dura qu’un instant. Il se retourna et héla le brick. Schultz répondit :
— « Oui, capitaine. »
— « Soyez prêts à prendre une remorque de la canonnière. On nous mène à Macassar. »
— « Grands Dieux ! Et pour quoi faire, capitaine ? » répondit faiblement une voix anxieuse.
— « Par bonté pure, je suppose », cria Jasper ironiquement d’un ton décidé. « Nous aurions pu rester ici encalminés pendant des jours. Et par hospitalité. On m’invite à rester ici, à bord. »
La réponse à ce renseignement fut une violente explosion de détresse. « Eh ! quoi ? Schultz a-t-il perdu tout ressort ? » se demanda Jasper avec inquiétude : et, en proie à un malaise qui lui avait été jusque-là inconnu, il se mit à examiner attentivement son brick. La pensée de se voir séparé de son navire, — pour la première fois depuis leur association, — atteignit dans ses fondements pourtant profonds une force de caractère qui s’abritait d’une apparente insouciance. Pendant ce temps ni Heemskirk ni son ombre n’avaient bougé.
— « Je vais envoyer l’équipage d’un canot et un officier à bord de votre navire », déclara-t-il sans s’adresser à personne en particulier. Jasper, s’arrachant à la contemplation de son brick, se retourna et sans qu’aucune passion, ni même presqu’aucune expression vint colorer sa voix, protesta avec force contre de tels procédés. Ce à quoi il pensait c’était le retard. Il comptait les jours. Macassar était précisément sur sa route : y être remorqué lui faisait gagner du temps. D’un autre côté, il faudrait supporter d’ennuyeuses formalités. Mais l’affaire était vraiment par trop absurde. « Le cancrelat est devenu fou », pensa-t-il. « On va me relâcher immédiatement. Et au cas où on ne le ferait pas, Mesman fournira une caution pour moi. » Mesman était un marchand hollandais avec lequel Jasper faisait beaucoup d’affaires, c’était une personne considérable à Macassar.
— « Vous protestez ? Hein ? » murmura Heemskirk, et il resta un moment immobile, planté sur ses deux jambes écartées, et la tête baissée comme s’il étudiait son ombre comique aux contours nets. Puis il fit un signe au corpulent canonnier, qui se tenait près de lui, immobile, comme un spécimen empaillé d’homme gras, avec son visage inanimé et ses petits yeux étincelants. L’homme s’approcha et se mit au garde à vous.
— « Vous monterez à bord du brick avec un armement de canot. »
— « Ya, mynherr ! »
— « Vous mettrez un de vos hommes à la barre tout le temps », reprit Heemskirk qui donnait ses ordres en anglais, apparemment pour l’édification de Jasper. « Vous entendez ? »
— « Ya, mynherr. »
— « Vous resterez sur le pont tout le temps. »
— « Ya, mynherr. »
Il sembla à Jasper qu’avec le commandement du brick on lui arrachait le cœur de la poitrine. Heemskirk, changeant de ton, demanda :
— « Quelles armes avez-vous à bord ? »
A cette époque tous les navires qui faisaient le commerce dans les mers de Chine étaient autorisés à porter une certaine quantité d’armes pour assurer leur défense.
— « Dix-huit fusils avec leurs baïonnettes qui se trouvaient à bord du navire quand je l’ai acheté. On les a déclarés. »
— « Où sont-ils ? »
— « Cabine avant. Le second a la clef. »
— « Vous en prendrez possession », déclara Heemskirk au canonnier.
— « Ya, mynherr. »
— « Et pour quoi faire ? Qu’est-ce que cela veut dire ? » cria Jasper, puis il se mordit la lèvre. « C’est monstrueux », murmura-t-il.
Heemskirk leva un moment un regard lourd et souffrant.
— « Vous pouvez disposer », fit-il au canonnier. Le gros homme salua et partit.
Pendant les trente heures qui suivirent, ce remorquage fut interrompu une fois. A un signal fait du haut du gaillard d’avant du brick, en agitant un pavillon, la canonnière stoppa. Le spécimen de sous-officier mal empaillé descendit dans son canot et monta à bord du Neptune : et il se précipita dans la cabine de son commandant : l’agitation où le mettait une nouvelle qu’il avait à transmettre se trahissait par le clignement de ses petits yeux. Ils restèrent tous deux enfermés quelque temps, cependant que Jasper appuyé à la lisse essayait de découvrir ce qui avait bien pu se passer d’extraordinaire à bord de son brick. Mais rien de fâcheux ne paraissait être arrivé à bord : il surveilla la sortie du canonnier, et quoiqu’il eût évité de parler à qui que ce fût depuis la fin de son entretien avec Heemskirk, il arrêta l’homme sur le pont pour lui demander comment allait son second.
— « Il ne se sentait pas très bien quand je l’ai quitté », expliqua-t-il.
Le gros sous-officier qui se tenait rigide comme si l’effort à faire pour porter son gros ventre devant lui l’y obligeait, comprit avec difficulté. Ses traits demeurèrent parfaitement impassibles, mais à la fin ses petits yeux clignèrent rapidement.
— « Oh, ya ! Le second. Ya, ya ! Mais, mein Gott, c’est un bien drôle d’homme ! »
Jasper ne put en obtenir davantage, car le Hollandais se précipita dans son canot et retourna à bord du brick. Mais il se consola en pensant que toute cette désagréable et absurde aventure allait bientôt finir. On était en vue de la rade de Macassar. Heemskirk en se rendant sur la passerelle passa près de lui. Pour la première fois le lieutenant regarda Jasper avec une intention marquée : et l’étrange façon dont il roulait les yeux était si drôle, — il y avait longtemps que Jasper et Freya étaient d’accord pour trouver le lieutenant drôle, — elle témoignait un enchantement si extatique, comme s’il savourait un morceau de choix, que Jasper ne put retenir un sourire. Après quoi, il se retourna vers son brick.
Cet objet de sa tendresse qu’animait un peu de l’âme de Freya, ce seul point d’appui de deux vies dans ce vaste monde, cette assurance de sa passion, ce compagnon d’aventure, qui avait le pouvoir de faire que la calme et adorable Freya fût un jour contre sa poitrine et qu’il pût l’emporter jusqu’au bout du monde, le voir, ce magnifique navire qui incarnait son orgueil et son amour, captif, au bout d’une remorque, n’était pas assurément un agréable spectacle. C’était comme un cauchemar ; comme si, par exemple, on eût vu en rêve un oiseau de mer chargé de chaînes.
Mais qu’eût-il pu regarder d’autre ? La beauté de son navire lui montait au cœur avec la puissance d’un sortilège, au point qu’il en oubliait où il était. Et en outre, ce sentiment de supériorité que la certitude d’être aimé donne à un jeune homme, cette illusion d’être mis au-dessus de la fatalité par le tendre regard des yeux d’une femme, l’aidaient, une fois le premier choc passé, à supporter toute cette affaire avec une confiance amusée. Que pouvait-il bien arriver à l’objet d’élection de Freya ?
C’était l’après-midi, le soleil était derrière les deux bâtiments alors qu’ils mirent le cap sur le port. « La plaisanterie du cancrelat va bientôt finir », pensait Jasper sans grande animosité. Comme un marin auquel ces parages étaient familiers il pouvait, d’un simple coup d’œil, comprendre ce qu’on allait faire. « Bon, pensait-il, il va par la Passe de Spermonde. Nous allons doubler le récif de Tamissa dans un instant. » Et il se remit à contempler son brick, cette preuve de son existence matérielle et sentimentale qui, bientôt, serait de nouveau en sa possession. Sur une mer calme comme un lac, une ride profonde ondulait et s’écartait sous son avant, car le puissant Neptune le remorquait à toute allure, comme s’il se fût agi d’un pari. Le canonnier hollandais apparut à l’avant du Bonito et avec lui deux ou trois hommes. Ils regardaient dans la direction de la côte et Jasper se perdit dans son extase amoureuse.
Le son grave du sifflet de la canonnière le fit tressaillir par sa soudaineté. Il regarda lentement autour de lui. Rapide comme l’éclair, il fit un bond et s’élança sur le pont.
— « Vous allez droit sur le récif de Tamissa ! » hurla-t-il.
Du haut de la passerelle, Heemskirk le regarda par-dessus son épaule : deux hommes faisaient tourner rapidement la roue du gouvernail et le Neptune s’écartait déjà rapidement du bord de l’eau pâle qui marquait la place du danger. Ah ! juste à temps ! Jasper se retourna instantanément pour regarder son brick : et avant même qu’il eût compris que, — conformément aux ordres évidemment donnés d’avance au canonnier par Heemskirk, — la remorque avait été larguée au coup de sifflet, avant qu’il eût eu le temps de pousser un cri ou de faire un geste, il vit son brick partir à la dérive et courant sur son erre, dépasser l’arrière de la canonnière. Il suivit le glissement de sa forme harmonieuse avec des yeux agrandis par l’incrédulité, affolés par l’horreur. Des cris à bord du brick lui parvinrent comme un terrible et confus murmure tandis que le sang lui battait aux oreilles et que son navire allait toujours. Il courait droit, déployant toute sa vitesse avec un air de grâce et de vie incomparables. Il courut jusqu’à ce que la surface unie de l’eau qui s’étendait devant lui sembla s’affaisser soudain, comme si elle eût été aspirée : et, avec un tremblement étrange et violent de sa mâture, il stoppa, s’inclina un peu et demeura immobile. Il demeura immobile sur le récif, cependant que le Neptune, faisant un large détour, poursuivait à toute allure par la Passe de Spermonde, le cap sur la ville. Le brick demeurait immobile, parfaitement immobile, dans une attitude fatale et singulière. En un instant la subite mélancolie des choses que la décadence a touchées s’était appesantie sur lui dans le rayonnement du soleil : ce n’était plus qu’une tache dans l’éclat désert de l’espace, avec un air déjà de solitude, et déjà de désolation.
— « Retenez-le », cria une voix de la dunette.
Jasper s’était élancé pour courir à son brick comme un homme se précipite au secours d’une créature vivante et aimée, à deux doigts de la mort. « Retenez-le ! Ne le lâchez pas ! », vociférait le lieutenant du haut de l’échelle tandis que Jasper se débattait comme un fou sans un mot, sa tête seule émergeant au milieu des marins du Neptune qui s’étaient jetés sur lui. « Tenez-le… Je n’ai pas la moindre envie de le voir se noyer. »
Jasper cessa de se débattre.
Un à un ils le lâchèrent : ils s’écartèrent graduellement, en le regardant en silence, le laissant seul au milieu d’un espace vide, comme pour lui donner assez de place pour tomber après cet effort. Il ne chancela même pas. Une demi-heure plus tard, quand le Neptune jeta l’ancre devant la ville, il n’avait pas encore bougé, il n’avait remué ni bras ni jambes. Aussitôt que le bruit de la chaîne de la canonnière eût cessé, Heemskirk descendit lourdement de la passerelle.
— « Appelez un sampan », ordonna-t-il d’un ton sombre, en passant devant la sentinelle à la coupée, et il se dirigea lentement vers l’endroit où Jasper, objet de bien des regards craintifs, se tenait les yeux fixés sur le pont, comme absorbé dans une rêverie.
Heemskirk s’approcha et le regarda pensivement, les doigts sur les lèvres. Il était là, ce vagabond privilégié, le seul homme à qui cette fille infernale pouvait raconter l’histoire ? Mais il ne la trouverait pas drôle. L’histoire du Lieutenant Heemskirk… Non, il m’en rirait pas. Il avait l’air d’un homme qui ne rirait plus jamais de sa vie.
Soudain Jasper leva les yeux. Son regard dénué de toute autre expression que celle de l’égarement, croisa celui d’Heemskirk qui, sombre, l’observait.
— « Échoué », dit-il à voix basse, et d’une voix étouffée. « Échoué », répéta-t-il à voix plus basse encore et comme s’il observait en lui-même la naissance d’une terrible et stupéfiante sensation.
— « Juste à l’étale de haute mer, en marée d’équinoxe », déclara Heemskirk avec une violence triomphante qui éclata et retomba. Il s’arrêta, comme s’il était soudainement las, en fixant sur Jasper son regard arrogant, sur lequel un secret désenchantement, ombre inévitable de toute passion, sembla passer comme un nuage. « Juste à l’étale », répéta-t-il en se redressant farouchement pour ôter de sa tête sa casquette galonnée et faire à la coupée un salut horizontal et dérisoire : « Et maintenant », dit-il, « vous pouvez descendre à terre et aller devant les tribunaux, si vous voulez, sacré Anglais ! »
L’affaire du brick Bonito fit nécessairement sensation à Macassar, la plus jolie et peut-être la plus propre d’aspect de toutes les villes des Iles, mais où les événements sont rares. Le « port », avec sa population spéciale, ne fut pas long à savoir que quelque chose venait de se passer. On avait remarqué loin en mer un vapeur remorquant un voilier, et quand le vapeur arriva seul, laissant l’autre en rade, cela ne manqua pas d’attirer l’attention. Que se passait-il donc ? On ne voyait que sa mâture, — voiles serrées — , à la même place vers le sud. Et le bruit se répandit bientôt, d’un bout à l’autre de la grande rue encombrée, qu’il y avait un navire sur le banc de Tamissa. La foule interprétait correctement les apparences. Quant à leur cause, cela passait sa pénétration, car qui eût pu associer une femme vivant à neuf cent milles de là avec l’échouage d’un navire sur le banc de Tamissa, ou chercher la lointaine filiation de cet événement dans la psychologie d’au moins trois personnes, même alors que l’une d’entre elles, le lieutenant Heemskirk, passait justement à ce moment pour aller faire son rapport ?
Non : les esprits des gens sur le port n’avaient aucune compétence pour ce genre d’investigation, mais des mains nombreuses, des brunes, des jaunes et des blanches, se levèrent pour abriter des yeux qui regardaient vers la mer. La rumeur se répandit rapidement. Des boutiquiers chinois vinrent sur le pas de leurs portes ; plus d’un marchand européen, même, se leva de son bureau pour se mettre à la fenêtre. Après tout, un navire échoué sur le banc de Tamissa, cela n’arrivait pas tous les jours. Et la rumeur prit bientôt une forme plus précise. C’était un caboteur anglais, — détenu préventivement en mer par le Neptune, — Heemskirk le remorquait pour soutenir un procès, lorsque, par un étrange accident…
Plus tard, on apprit le nom du navire. « Eh quoi ! le Bonito ! C’est impossible ! Oui, oui ! le Bonito ! Regardez. On peut le voir d’ici : deux mâts seulement. C’est un brick. On ne pensait pas que cet homme se serait jamais fait pincer. Mais Heemskirk est malin, lui aussi. Il paraît qu’il est aménagé à l’intérieur comme le yacht d’un gentleman. Allen est une espèce de gentleman aussi. Un type extravagant ! »
Dans le bureau de MM. Mesman frères qui se trouvait sur le port, un jeune homme entra rapidement en bredouillant quelques nouveaux détails.
— « Oui, il n’y a pas de doute, c’est le Bonito ! Mais imaginez ce que je viens d’entendre. Ce garçon devait fournir des armes aux gens de cette rivière depuis un ou deux ans. Il paraît qu’il se croyait tout permis et qu’il a eu cette fois l’audace de vendre jusqu’aux fusils du bord. C’est un fait. Les fusils ne sont plus à bord. Quelle impudence ! Seulement, il ignorait la présence d’un de nos navires de guerre sur la côte. Mais ces Anglais ont une telle impudence qu’il croyait peut-être que ça passerait. Nos tribunaux sont la plupart du temps beaucoup trop indulgents pour cette sorte de gens, pour une raison ou une autre. Mais, en tout cas, c’est la fin du fameux Bonito. J’ai entendu dire au bureau du port qu’il s’est échoué juste à l’étale de la marée ; et il est sur lest. Aucune force humaine, paraît-il, ne peut le bouger d’où il est. Je l’espère bien. Ça sera excellent d’avoir le fameux Bonito là comme avertissement pour les autres. »
M. J. Mesman, un Hollandais né aux colonies, aimable vieillard paternel, au beau et calme visage rasé, et dont les cheveux gris bouclaient un peu dans le cou, n’ouvrit pas la bouche pour défendre Jasper et le Bonito. Il se leva brusquement de son siège. Il avait l’air bouleversé. Au cours d’une conversation où ils avaient parlé de questions d’argent, de trafic dans les îles, Jasper lui avait fait des confidences au sujet de Freya : et l’excellent homme qui avait connu autrefois le vieux Nelson et se rappelait même quelque peu Freya, avait été étonné et amusé par ce récit.
— « Oui, oui, oui. Nelson ! Oui, bien sûr. Un très brave homme, très honnête. Et une petite fille à cheveux blonds. Oui. Je me rappelle très bien. Ainsi, elle est devenue une belle jeune fille, si déterminée, si… » Et il s’était mis à rire presque à gorge déployée. « Eh ! bien, quand vous serez parti avec votre future femme, capitaine Allen, il faudra venir ici et on lui fera bon accueil. Une petite fille à cheveux blonds. Je me rappelle. Je me rappelle. »
C’était cela qui avait altéré ses traits à l’annonce du naufrage. Il prit son chapeau.
— « Où allez-vous, Monsieur Mesman ? »
— « Je vais chercher Allen. Il doit être à terre. Est-ce que quelqu’un le sait ? »
Personne dans le bureau ne le savait. Et M. Mesman sortit sur le port pour se renseigner.
L’autre partie de la ville, celle qui avoisine l’église et le fort, tenait ses informations d’une autre source. La première chose qu’on put voir, ce fut Jasper lui-même, marchant précipitamment, comme si on le poursuivait. Et, en fait, un Chinois, — visiblement un patron de sampan, — le suivait à la même allure précipitée. Soudain, comme il passait devant Orange House, Jasper obliqua et y entra, ou plutôt s’y précipita, au grand effroi de Gomez, l’employé de l’hôtel. Mais un Chinois qui se mit à faire du vacarme à la porte attira immédiatement l’attention de Gomez. Il déclara que le blanc qu’il avait amené de la canonnière n’avait pas payé son passage. Il l’avait poursuivi en réclamant son dû tout le long du chemin ; mais le blanc n’avait tenu aucun compte de sa juste réclamation. Gomez donna quelques pièces au coolie et alla rejoindre Jasper qu’il connaissait bien. Il le trouva debout, très raide, près d’une petite table ronde. Quelques hommes assis à l’autre bout de la véranda avaient interrompu leur conversation et le regardaient en silence. Deux joueurs, des queues de billard à la main, étaient sortis à la porte de la salle et le regardaient eux aussi.
En voyant venir Gomez, Jasper porta la main à sa gorge. Gomez remarqua que les vêtements blancs de Jasper étaient salis, puis il regarda sa figure et s’empressa d’aller commander la boisson que Jasper semblait demander.
Où allait-il, quelle était son intention, où s’imaginait-il aller quand une impulsion soudaine ou la vue d’un endroit qui lui était familier l’avait fait entrer à Orange House ? il est impossible de le dire. Il s’appuyait légèrement du bout des doigts à la petite table. Il y avait sur la véranda deux hommes qu’il connaissait fort bien personnellement, mais son regard, égaré comme s’il cherchait un moyen de s’enfuir, passait et repassait devant eux sans montrer aucunement qu’il les reconnaissait. Eux, de leur côté, en le voyant, n’en pouvaient croire leurs yeux. Son visage n’était pas altéré. Au contraire, il était calme. Mais son expression était, pour ainsi dire, méconnaissable. Était-ce vraiment lui ? Ces gens se le demandaient avec appréhension.
Sa tête était remplie d’un chaos d’idées claires. Parfaitement claires. C’était même cette clarté qui rendait terrible l’impossibilité où il était d’en fixer une véritablement. Il se disait, ou il disait à ses idées : « Doucement, doucement ». Un boy chinois parut avec un verre sur un plateau. Il en avala le contenu et sortit précipitamment. Sa disparition dissipa l’étonnement des spectateurs. L’un d’eux se leva et s’élança du côté où la véranda donnait sur l’enfilade de la rue. A ce moment même Jasper, sortant d’Orange House, passait au-dessous de lui dans la rue. Il cria aux autres :
— « C’était bien Allen ! Mais où est donc son brick ? »
Jasper entendit ces mots avec une force extraordinaire. Le ciel même en résonnait, comme s’il lui demandait des comptes : car c’étaient les mots mêmes que Freya emploierait. Question écrasante : elle frappa sa conscience comme un coup de tonnerre et fit tout à coup la nuit dans le chaos de ses pensées tandis qu’il avançait. Il ne ralentit pas son allure. Il fit encore trois pas dans le noir, et puis tomba.
Le bon Mesman dut aller jusqu’à l’hôpital pour le voir. Le docteur parla d’un léger coup de soleil. Rien de grave. Il serait sorti dans trois jours… Il faut reconnaître que le docteur avait raison. Trois jours plus tard, Jasper Allen sortait de l’hôpital et toute la ville put le voir, fort longtemps, — assez longtemps pour qu’il devînt, pour ainsi dire, une des curiosités de la ville, assez longtemps pour qu’on finît par n’y plus faire attention, assez longtemps pour qu’on s’en souvienne encore aujourd’hui dans les îles.
Les conversations sur le « port » et l’apparition de Jasper à Orange House se placent au début de la fameuse affaire du Bonito et en offrent les deux aspects, pratique et psychologique : ce qui regarde le tribunal et ce qui relève de la compassion : ce dernier aspect à la fois terriblement évident et obscur.
Il resta obscur, sachez-le, même pour cet ami qui m’écrivait la lettre dont je parlais tout au début de ce récit. C’était un des employés de M. Mesman et il avait accompagné son patron dans sa recherche de Jasper. Sa lettre me décrivait les deux aspects et quelques épisodes de l’affaire. L’attitude d’Heemskirk fut celle d’un homme qui se félicite de n’avoir pas perdu son propre navire, et c’est tout. Il y avait de la brume sur la côte, c’est ainsi qu’il expliqua qu’il eût pu venir si près du récif de Tamissa. Il avait sauvé son navire, le reste lui importait peu. Quant au gros canonnier, il déposa simplement qu’il avait pensé sur le moment que le mieux à faire était de larguer la remorque, mais il reconnut que la soudaineté du danger l’avait quelque peu troublé.
En fait, il avait agi sur les indications très précises d’Heemskirk, dont il était devenu en quelque sorte l’âme damnée, au cours de plusieurs années de service sous ses ordres en Extrême-Orient. Le plus surprenant dans l’affaire du Bonito, ce fut que le canonnier déclara qu’au moment de prendre possession des armes comme il en avait reçu l’ordre, il avait découvert qu’il n’y avait pas d’armes à bord. Tout ce qu’il avait trouvé dans la cabine-avant, ç’avait été un râtelier vide pour le nombre exact de dix-huit fusils ; quant aux fusils, on n’avait pu en trouver trace. Le second du brick qui avait l’air très malade et semblait agité au point qu’on l’eût pris pour un fou, voulut lui faire croire que le capitaine Allen n’en savait rien, que c’était lui le second, qui très peu de temps auparavant, avait vendu ces fusils pendant la nuit à une certaine personne qui habitait sur la rivière. A l’appui de cette histoire, il avait sorti un sac de dollars d’argent et l’avait supplié de les prendre. Puis, les jetant soudainement sur le pont, il s’était mis à se frapper la tête avec les poings et à jurer abominablement en déclarant qu’il n’était pas digne de vivre.
Le canonnier s’était empressé de rapporter tout cela à son officier.
Ce qu’Heemskirk entendait faire en prenant sur lui de saisir le Bonito, on ne saurait le dire, sinon qu’il voulait causer quelque ennui à l’homme qui avait les faveurs de Freya. Il avait regardé Jasper avec l’envie de terrasser l’homme qui avait connu ces baisers et ces embrassements. La question était : Comment le faire sans se compromettre ? Mais le rapport du canonnier donnait un tour sérieux à l’affaire. Il est vrai qu’Allen avait des amis, — et qui pouvait dire qu’il ne réussirait pas à s’en tirer ? L’idée de conduire sur le récif le brick compromis lui vint en écoutant le gros canonnier dans sa cabine. Il courrait maintenant peu de risques d’être désavoué. Il fallait donner à la chose l’apparence d’un accident.
En débouchant sur le pont il avait contemplé son inconsciente victime en roulant les yeux d’un air si sombre et en pinçant si bizarrement la bouche que Jasper n’avait pu retenir un sourire. Et le lieutenant était monté sur le pont en se disant :
— « Attends un peu : je vais te faire passer le goût de ces baisers. Quand tu entendras plus tard le nom du lieutenant Heemskirk, ce nom-là ne te fera pas sourire, je le jure. Je te tiens. »
Et cette possibilité s’était ainsi présentée sans préméditation, on pourrait presque dire naturellement, comme si les événements s’étaient prêtés d’eux-mêmes aux intentions d’une sinistre passion. Le plan le plus astucieux n’aurait pu mieux servir Heemskirk. Il lui fut donné de goûter une vengeance d’une incroyable, d’une inimaginable perfection, de frapper mortellement au cœur cet homme qu’il détestait et de le voir ensuite aller et venir avec le poignard dans le cœur.
Car tel fut véritablement le sort de Jasper. Il allait et venait, agissait, les yeux las, la figure creuse, en proie à une incessante agitation, avec des mouvements brusques et des gestes violents ; il ne cessait de parler d’une voix délirante et lasse : mais au fond de lui il savait que rien ne lui rendrait jamais son brick, tout comme rien ne saurait cicatriser un cœur transpercé. Son âme, que l’influence résolue de Freya avait maintenue dans le calme, était semblable à une corde immobile mais trop tendue. Le choc l’avait fait vibrer et la corde s’était rompue. Deux ans il avait attendu, dans une confiance enivrée, un jour qui maintenant ne viendrait jamais pour un homme à jamais désarmé par la perte du brick, un homme, lui semblait-il, indigne d’un amour auquel il n’avait plus aucun point d’appui à offrir.
Jour après jour on le vit traverser la ville, suivre la côte et une fois parvenu à la pointe qui faisait face au récif sur lequel son brick était échoué, il restait là à contempler au-delà de l’eau la forme chérie de son navire, jadis le foyer d’un espoir exalté, et qui maintenant, dans son immobilité penchée et désolée, s’élevait au-dessus de la ligne solitaire de l’horizon comme un symbole de désespoir.
L’équipage l’avait abandonné à temps pour sauter dans ses propres embarcations qui avaient été séquestrées par les autorités du port dès qu’elles eurent atteint la ville. Le navire avait été lui aussi séquestré aux fins d’enquête : mais ces mêmes autorités ne prirent pas la peine de mettre un garde à bord. Car, en vérité, qui eût pu le retirer de là ? Rien, si ce n’est un miracle ; rien, si ce n’est les yeux de Jasper rivés pendant des heures sur son navire comme s’il espérait par la seule force du regard l’attirer sur son cœur.
Toute cette histoire, lue dans la longue lettre de mon ami ne fut pas sans m’attrister. Mais le plus stupéfiant, c’était de lire que Schultz, le second, était allé affirmer partout avec un entêtement désespéré que lui seul avait vendu les fusils. « Je les avais volés », déclara-t-il. Naturellement personne ne voulut le croire. Mon ami lui-même ne le croyait pas, quoique lui, bien entendu, admirât un tel dévouement. Mais bien des gens trouvèrent que c’était vraiment trop que de prétendre être un voleur afin de sauver un ami. C’était, d’ailleurs, si évidemment un mensonge que ce n’avait peut-être pas grande importance.
Moi qui, connaissant la psychologie de Schultz, savais combien ce devait être vrai, je dois reconnaître que j’en fus accablé. C’était donc ainsi qu’un destin perfide prenait avantage d’une impulsion généreuse ! Et je me sentis complice de cette perfidie, pour avoir à un certain point encouragé Jasper. Il est vrai que je l’avais prévenu également.
« Cet homme semblait être devenu fou, m’écrivait mon ami. Il est allé voir Mesman avec son histoire. Il lui a raconté que je ne sais quel coquin d’Européen, quelque part sur cette rivière, lui avait fait boire du gin un soir et s’était ensuite moqué de lui parce qu’il n’avait pas d’argent. Alors, tout en protestant qu’il était un honnête homme et qu’il fallait le croire, il nous a déclaré qu’il devenait un voleur quand il buvait un coup de trop ; il nous a raconté qu’il était allé à bord et qu’il avait passé les fusils un à un sans le moindre remords à un canot qui était venu au long du bord cette nuit-là et qu’il avait reçu dix dollars par fusil.
« Le lendemain il était malade de honte et de chagrin, mais il n’avait pas eu le courage d’avouer sa faute à son bienfaiteur. Quand la canonnière avait arrêté le brick, il avait cru mourir en appréhendant les conséquences, et il serait mort volontiers, s’il avait pu faire revenir les fusils au prix de sa propre vie. Il n’avait rien dit à Jasper, espérant qu’on relâcherait le brick immédiatement. Quand il avait vu que l’affaire prenait une autre tournure et que son capitaine était détenu à bord de la canonnière, il avait été sur le point de se suicider de désespoir : il avait pensé qu’il était de son devoir de vivre pour faire connaître la vérité. « Je suis un honnête homme ! Je suis un honnête homme ! », répétait-il d’une voix qui vous faisait venir les larmes aux yeux. « Vous devez me croire quand je vous dis que je suis un voleur, un gredin, un voleur sournois dès que j’ai bu un verre ou deux. Qu’on me conduise là où je pourrai dire la vérité sous la foi du serment. »
« Quand nous l’eûmes enfin convaincu que son histoire ne pourrait être d’aucun secours pour Jasper, — car quel tribunal hollandais ayant mis la main sur un commerçant anglais accepterait jamais pareille explication ? et, en vérité, où, comment, quand, espérait-on trouver les preuves d’un pareil récit ? — il a fait comme s’il allait s’arracher les cheveux, mais, se calmant : « Eh bien, alors, bonsoir, Messieurs », nous a-t-il dit, et il est sorti de la pièce, si accablé qu’on eût dit qu’il ne parviendrait pas à mettre un pied devant l’autre. Le soir même il s’est suicidé en se coupant la gorge dans la maison d’un métis chez lequel il avait habité depuis son débarquement après le naufrage.
Cette gorge même, pensai-je avec un frisson, d’où sortait cette voix tendre, persuasive, mâle et séduisante qui avait éveillé la compassion de Jasper et gagné la sympathie de Freya ! Qui aurait jamais pu penser que telle serait la fin de ce doux et impossible Schultz, avec son habitude de naïve filouterie, si absurdement criante que ceux mêmes qui en avaient été les victimes n’en avaient éprouvé rien de plus qu’une exaspération amusée. Il était vraiment impossible. Il devait en tout cas évidemment avoir une existence difficile, mystérieuse, mais non pas tragique : celle d’un inoffensif habitant en marge de la vie indigène. Il y a des cas où cette ironie du sort que certaines gens se plaisent à découvrir dans la conduite de nos existences, prend l’aspect d’un jeu parfaitement brutal et sauvage.
Je fis aux mânes de Schultz l’hommage d’un hochement de tête et repris la lecture de la lettre de mon ami. Il me racontait comment le brick abandonné sur le récif, une fois pillé par les indigènes des villages de la côte, avait pris peu à peu l’aspect lamentable, gris et fantomatique d’une épave, cependant que Jasper, réduit à n’être plus que l’ombre de lui-même, n’en continuait pas moins à parcourir tout le « port », l’œil horriblement hagard, un sourire immuable sur les lèvres, et à passer ses journées sur un banc de sable solitaire à la contempler avidement, comme s’il s’attendait à voir se lever à bord de cette épave une forme qui lui ferait des signes au-dessus des débris de ses pavois. Les Mesman prenaient soin de lui dans la mesure du possible. L’affaire du Bonito avait été transmise à Batavia, où sans doute elle irait se noyer dans un océan de paperasses officielles. Le cœur me manquait à lire tout cela. Cet officier actif et zélé, le lieutenant Heemskirk, dont l’air important et ennuyé ne s’éclaira pas en recevant l’approbation qui lui fut transmise officieusement pour son action, était parti prendre un poste aux Moluques…
A la fin de cette longue et amicale épître, qui me faisait part des nouvelles de l’île depuis six mois au moins, mon ami écrivait :
« Il y a environ deux mois, le vieux Nelson a débarqué ici, par le paquebot de Java. Il venait voir Mesman, paraît-il. Une visite assez mystérieuse et extraordinairement courte, après avoir fait tout ce voyage. Il n’est resté que quatre jours à Orange House, n’ayant apparemment rien de particulier à faire et il a repris le vapeur qui se rendait à Singapour. Je me rappelle avoir entendu dire à une certaine époque qu’Allen était assez épris de la fille du vieux Nelson, la jeune fille qui avait été élevée par Mrs. Harley et qui était allée habiter avec lui aux Sept-Iles. Sûrement vous vous rappelez le vieux Nelson. »
Si je me rappelais le vieux Nelson ? Certes !
La lettre continuait en m’informant qu’en tout cas le vieux Nelson se souvenait de moi, car, quelque temps après sa courte visite à Macassar, il avait écrit aux Mesman pour demander mon adresse à Londres.
Que le vieux Nelson (ou Nielsen), dont la personnalité était faite d’une profonde indifférence pour tout ce qui l’entourait, souhaitât écrire, ou obtenir un renseignement pour écrire à quelqu’un, il y avait déjà de quoi vous surprendre. Mais que ce quelqu’un fût moi ! J’attendis, non sans impatience, ce qu’allait bien pouvoir me révéler cette intelligence naturellement ignorante, mais mon impatience eut le temps de se dissiper avant que mes yeux ne tombassent sur l’écriture tremblée et pénible du vieux Nelson, sénile et enfantine à la fois, sur une enveloppe qui portait un timbre d’un penny et le cachet du bureau de poste de Notting Hill à Londres. Avant de l’ouvrir je pris le temps de lever les bras au ciel, pour payer à un tel événement le tribut de mon étonnement. Ainsi donc il était venu en Angleterre pour être définitivement Nelson ; à moins qu’il ne rentrât au Danemark pour revenir à son original Nielsen ? Mais le vieux Nelson (ou Nielsen), loin des Tropiques, c’était inconcevable. Et il était à Londres, me demandant de venir le voir.
L’adresse qu’il me donnait était celle d’un boarding-house dans l’un de ces squares de Bayswater, lieux de loisir jadis, aujourd’hui condamnés au travail. On lui avait recommandé cet endroit. J’allai le voir par un de ces jours de janvier à Londres, un de ces jours d’hiver qui réunissent les quatre éléments diaboliques, le froid, l’humidité, la boue et la suie, combinés avec cette particulière atmosphère poisseuse qui colle à l’âme elle-même comme un vêtement sale. Pourtant en approchant de sa maison, je vis dans un éclair, loin derrière l’abominable voile de ces quatre éléments, le fastidieux et splendide scintillement d’une mer bleue avec les Sept-Iles comme des taches infimes flotter devant mes yeux, le toit rouge du bungalow couronnant la plus petite d’entre elles. Cette réminiscence visuelle était profondément troublante. C’est d’une main hésitante que je frappai à la porte.
Le vieux Nelson (ou Nielsen) se leva de la table près de laquelle il était assis devant un vieux portefeuille bourré de papiers. Il enleva ses lunettes avant de me serrer la main. Pendant un moment aucun de nous ne prononça une parole : mais, voyant que je regardais autour de moi, comme si j’eusse attendu quelqu’un, il murmura quelques mots où je distinguai seulement « ma fille » et « Hong-Kong », baissa les yeux et soupira.
Sa moustache, ébouriffée comme jadis, était maintenant toute blanche. Ses vieilles joues étaient rondes, et un peu colorées : assez étrangement, ce qu’il y avait toujours eu d’enfantin dans le contour général de sa physionomie semblait s’être accentué. Comme son écriture, il avait un air à la fois sénile et enfantin. Son âge paraissait sur son front inquiet et inintelligemment ridé et dans ses yeux ronds et innocents qui me parurent fatigués, clignotants et humides : ou bien étaient-ils pleins de larmes ?
Trouver le vieux Nelson parfaitement au courant de quelque chose, ce fut vraiment nouveau pour moi. Une fois la première gêne dissipée, il se mit à parler librement, avec, de temps à autre, le secours d’une question pour le remettre en route lorsqu’il retombait dans son silence, ce qu’il faisait brusquement, les mains croisées sur son gilet dans une attitude qui me rappela la véranda de jadis, où il restait à parler d’un ton tranquille et à dégonfler ses joues, il y avait de cela, me semblait-il alors, bien des jours et des jours. Il parlait d’un ton raisonnable, un peu inquiet.
— « Non, non. Nous n’avons rien su pendant des semaines. Loin des routes régulières comme nous l’étions, c’était tout naturel, n’est-ce pas ? Aucun service de paquebot pour les Sept-Iles. Mais un jour je suis allé à Banka dans mon bateau à voile pour voir s’il y avait des lettres, et j’ai vu un journal hollandais. Mais ç’avait seulement l’air d’une nouvelle maritime : « Le brick Bonito échoué dans la rade de Macassar ». C’était tout. J’ai rapporté le journal et je le lui ai montré. « Je ne le lui pardonnerai jamais », s’est-elle écriée, avec sa disposition d’esprit d’autrefois. « Ma chère enfant, lui ai-je dit, tu es une fille raisonnable. Il n’est si bon marin qui ne puisse perdre un navire. Mais comment te sens-tu ? » Son aspect commençait à m’inquiéter. Elle ne voulait pas entendre parler d’aller à Singapour. Mais une fille aussi raisonnable ne pouvait vraiment pas faire toujours des objections. « Comme vous voudrez, papa », m’a-t-elle dit. Ç’a été toute une affaire. Il fallait attraper un steamer en mer, mais j’ai pu l’emmener tout de même. Là, des docteurs bien entendu. Fièvre. Anémie. On l’a mise au lit. Deux ou trois dames très bonnes pour elle. Naturellement, toute l’histoire ne tarda pas à paraître dans nos journaux. Elle l’a lue d’un bout à l’autre, étendue dans son lit : alors elle m’a rendu le journal en murmurant : « Heemskirk », et elle s’est évanouie. »
Ses yeux clignotèrent pendant assez longtemps, puis se remplirent de larmes.
« Le lendemain », reprit-il sans que sa voix trahît aucune émotion, « elle s’est sentie plus forte et nous avons eu une longue conversation. Elle m’a tout raconté. »
C’est alors que le vieux Nelson, les yeux baissés, me mit au courant de l’épisode d’Heemskirk, tel que Freya le lui avait rapporté, et tout en levant vers moi un regard innocent il reprit d’une façon saccadée :
— « Ma chérie, lui ai-je dit, en somme, tu t’es conduite comme une fille raisonnable. » — « J’ai été atroce, s’est-elle écriée, et il est en train de se briser le cœur là-bas. » Elle était trop raisonnable pour ne pas comprendre qu’elle n’était pas en état de voyager. Mais j’y suis allé. Elle m’a demandé d’y aller. Elle était en bonnes mains. Anémie. Elle se remettait, à ce qu’on m’assurait. »
Il s’arrêta.
— « Vous l’avez vu ? » murmurai-je.
— « Oh ! oui. Je l’ai vu », reprit-il, parlant de cette voix si raisonnable qu’on eût dit qu’il discutait un point. « Je l’ai vu. Je l’ai rencontré. Les yeux renfoncés dans la tête, la peau sur les os ; un squelette dans un vêtement blanc sale. Voilà de quoi il avait l’air. Comment Freya… Mais jamais elle n’a… non, assurément pas. Il était assis, seul être vivant qu’on pût voir sur des milles le long de cette côte, assis sur un bout de bois échoué au bord du rivage. A l’hôpital on lui avait tondu les cheveux et ils n’avaient pas encore repoussé. Il regardait fixement devant lui, le menton dans la main, et il n’y avait rien sur la mer entre lui et le ciel que l’épave du navire. Quand je me suis approché de lui il a hoché légèrement la tête : « Ah ! c’est vous, Monsieur Nelson ? » a-t-il dit, — comme cela.
« Si vous l’aviez vu, vous auriez tout de suite compris combien il était impossible que Freya eût jamais pu aimer cet homme. Oui, oui. Je ne dis pas… Elle avait pu avoir — quelque chose. Elle se sentait seule, vous comprenez. Mais réellement, partir avec lui ! Jamais. Pure folie ! Elle était trop raisonnable… J’ai commencé à faire doucement des reproches à ce garçon. Et peu à peu, il s’est tourné vers moi. « Vous écrire ! A propos de quoi ? Venir la voir ? Avec quoi ? Si j’avais été un homme, je l’aurais emportée, mais elle a fait de moi un enfant, un enfant heureux. Dites-lui que le jour où la seule chose au monde qui m’appartenait a péri sur ce récif, j’ai découvert que je n’avais aucun pouvoir sur elle… Est-ce qu’elle est venue ici avec vous ? » s’est-il écrié, en me fixant soudainement de ses yeux caves. J’ai secoué la tête. Venue avec moi, mon Dieu ! Anémie. — « Ah ! Vous voyez. Allez-vous-en alors, et laissez-moi seul ici avec ce fantôme », m’a-t-il dit, en secouant la tête dans la direction de l’épave de son brick.
« Il était fou. La nuit venait. Je n’avais pas envie de rester plus longtemps tout seul avec cet homme dans cet endroit désert. Je ne lui ai rien dit de la maladie de Freya. Anémie ! A quoi bon ? Il était fou ! Et quelle sorte de mari eût-il fait, en tout cas, pour une fille aussi raisonnable que Freya ? Et puis, je n’aurais même pas pu leur laisser mon petit domaine. Les autorités hollandaises n’auraient pas permis à un Anglais de s’y établir. Je ne l’avais pas encore vendu. Mon homme, Mahmat, le surveillait pour moi. Au bout de quelque temps, je l’ai lâché pour le dixième de sa valeur à un métis hollandais. Mais que voulez-vous ? Cela ne m’intéressait plus. Oui : je suis parti. J’ai attrapé le paquebot de retour. J’ai tout raconté à Freya. « Il est fou, lui ai-je dit ; et, ma chérie, la seule chose qu’il aimait c’était son brick. »
« Peut-être », a-t-elle dit en se parlant à elle-même, le regard perdu au loin, et ses yeux étaient presque aussi creux que ceux de l’autre, « c’est peut-être vrai. Oui. Je ne lui aurais jamais laissé prendre de pouvoir sur moi. »
Le vieux Nelson s’interrompit. Je restais fasciné, et me sentais glacé dans cette pièce où pourtant du feu flambait.
— « Ainsi, vous voyez », reprit-il, « elle ne s’est jamais vraiment souciée de lui. Elle était bien trop raisonnable pour cela. Je l’ai emmenée à Hong-Kong. Changement de climat, à ce qu’ils disaient. Oh ! ces docteurs ! Mon Dieu. C’était l’hiver ! Il y eut dix jours de brouillards froids, de vent et de pluie. Une pneumonie ! Mais écoutez-moi. Nous avons beaucoup parlé ensemble. Le jour et la nuit. Qui avait-elle d’autre ? Elle m’a beaucoup parlé, ma propre fille. Par moments elle souriait légèrement. Elle me regardait et riait un peu… »
Je frissonnais. Il regardait devant lui vaguement, avec une expression enfantine et embarrassée.
— « Elle me disait : « Je n’avais réellement pas l’idée d’être une mauvaise fille, papa. » Et je lui répondais : « Bien sûr, ma chérie. Tu ne pouvais pas avoir cette idée. » Elle reposait tranquillement et reprenait : « Je me demande…? » Et quelquefois elle me disait : « J’ai été vraiment lâche. » Vous savez, les malades disent de ces choses. Et elle a dit aussi : « J’ai été orgueilleuse, entêtée, capricieuse. J’ai cherché ma propre satisfaction. J’étais égoïste ou bien j’avais peur. » … Mais les malades, vous savez, ils disent n’importe quoi. Et une fois, après être restée silencieuse presque toute la journée, elle a dit : « Oui ; peut-être que le jour venu je ne serais pas partie… Peut-être ! Je ne sais pas », s’est-elle écriée. « Tire le rideau, papa. Cache la mer. Elle me reproche ma folie. » Il reprit haleine et s’arrêta.
« Voilà », reprit-il dans un murmure. « Très malade, très malade. Pneumonie. Tout d’un coup. » Il fit du doigt un geste vers le tapis, tandis que la pensée de la pauvre fille, vaincue dans son combat contre l’absurdité de trois hommes et en arrivant à douter d’elle-même, m’étreignit d’une indicible pitié.
« Vous voyez bien vous-même », reprit-il l’air abattu, « elle n’aurait pas pu vraiment… Elle a parlé de vous plusieurs fois… Un bon ami. Un homme raisonnable. Aussi je tenais à vous le dire moi-même, — à ce que vous sachiez la vérité. Un garçon comme cela ! Comment aurait-ce été possible ? Elle se sentait seule. Et peut-être qu’un moment… Rien que… Ce n’aurait jamais pu être une question d’amour pour ma Freya…, une fille si raisonnable… »
— « Mon Dieu ! » m’écriai-je en me levant, indigné. « Mais vous ne voyez donc pas qu’elle en est morte ? »
Il se leva aussi. « Non, non », bégaya-t-il avec une sorte de colère. « Les docteurs. La pneumonie. Très bas. L’inflammation des… Ils m’ont dit… Pneumo… »
Il n’acheva pas le mot. Cela finit dans un sanglot. Il leva les bras dans un geste de désespoir, renonçant à son idée abominable avec un cri étouffé et déchirant :
— « Et moi qui la croyais si raisonnable ! »
FIN
| Introduction | |
| Note de l’Auteur | |
| Un Sourire de la Fortune | |
| Le Compagnon Secret | |
| Freya des Sept-Iles |
ACHEVÉ D’IMPRIMER
LE 25 AVRIL 1929
PAR EMMANUEL GREVIN
A LAGNY-SUR-MARNE
ÉDITIONS DE LA NOUVELLE REVUE FRANÇAISE
(Extrait du Catalogue)
Collection “Vies des Hommes Illustres”
Collection “Les Documents Bleus”