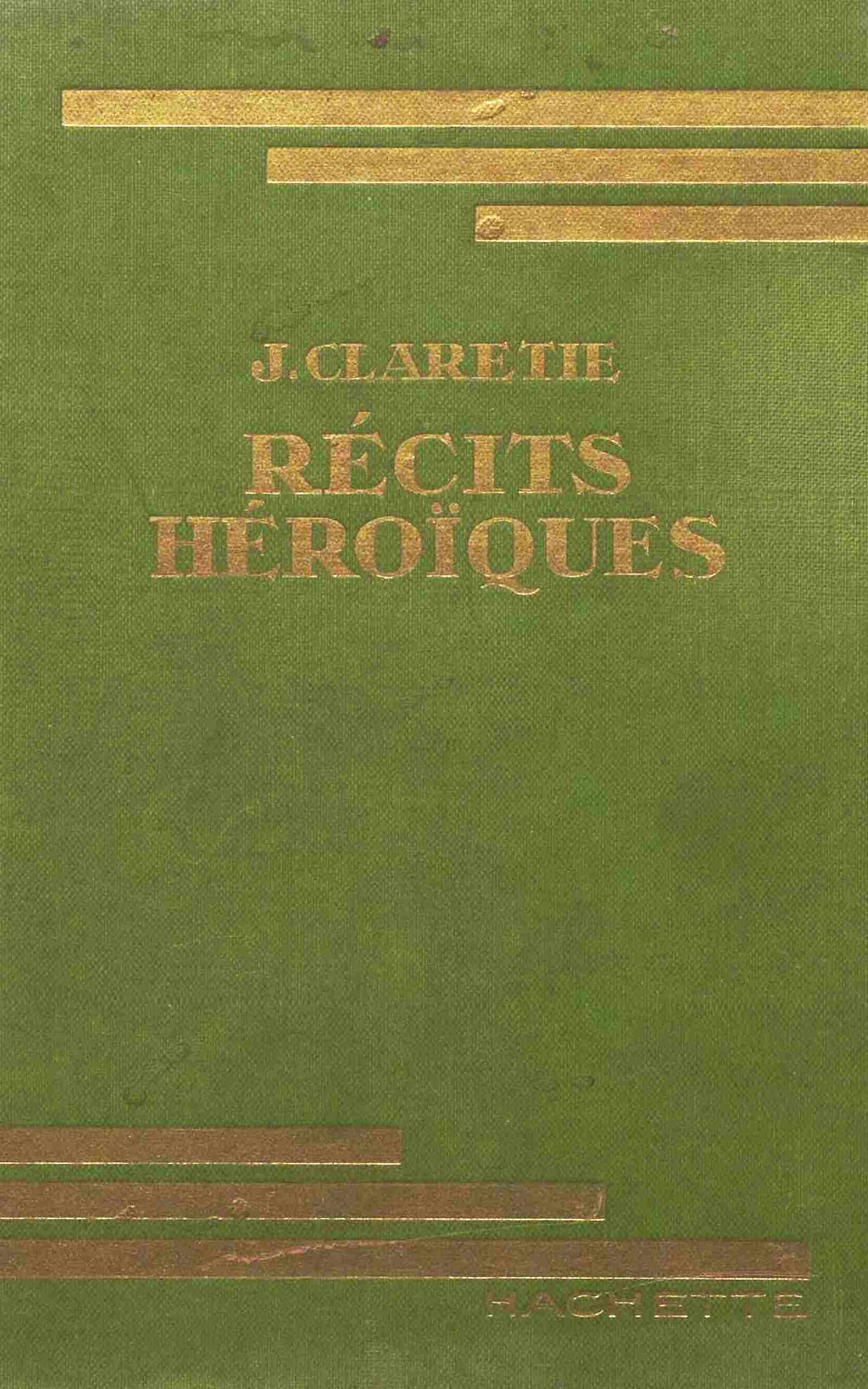
Title: Récits héroïques
Author: Jules Claretie
Release date: November 9, 2025 [eBook #77202]
Language: French
Original publication: Paris: Hachette, 1923
Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Polona digital library)
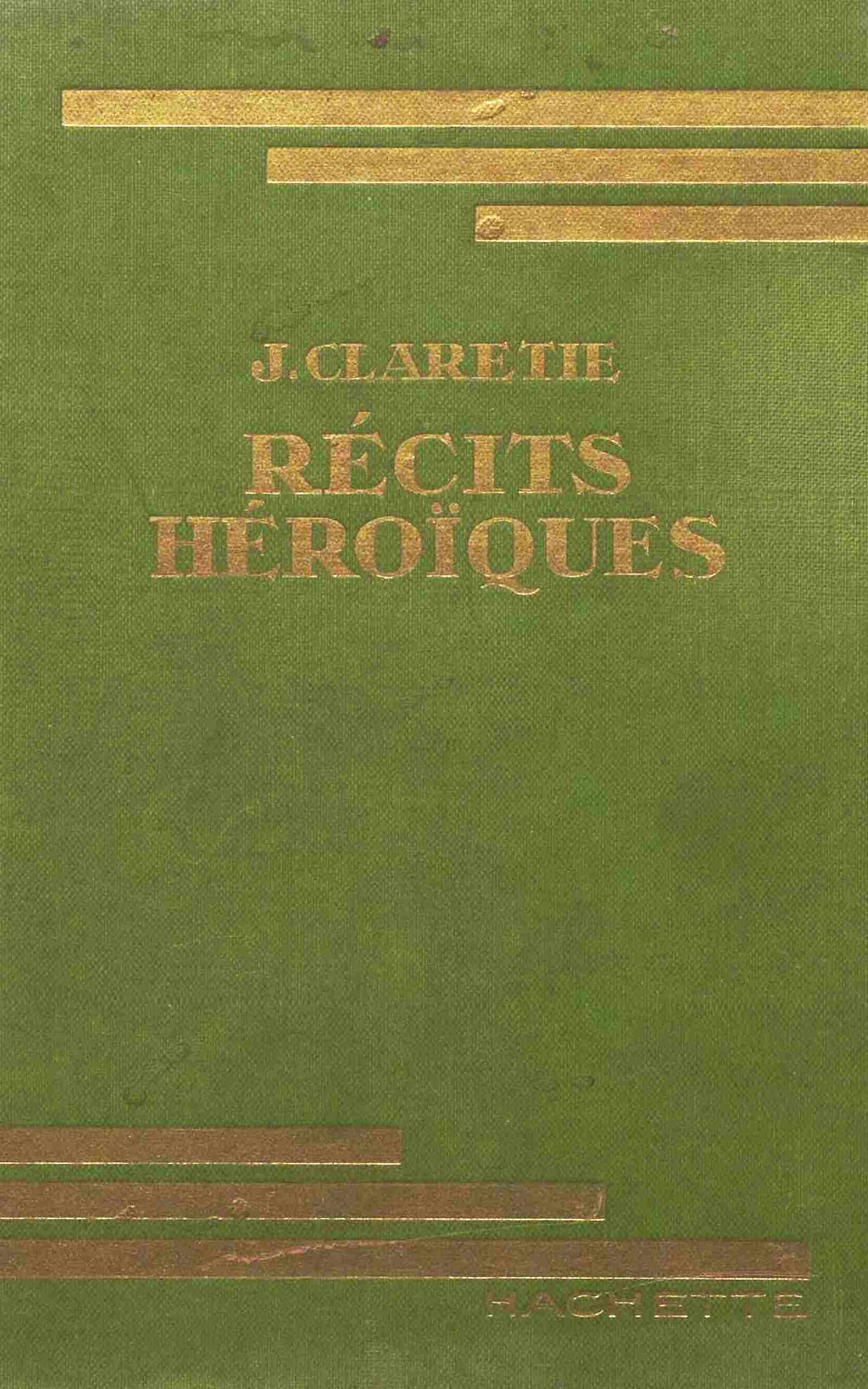
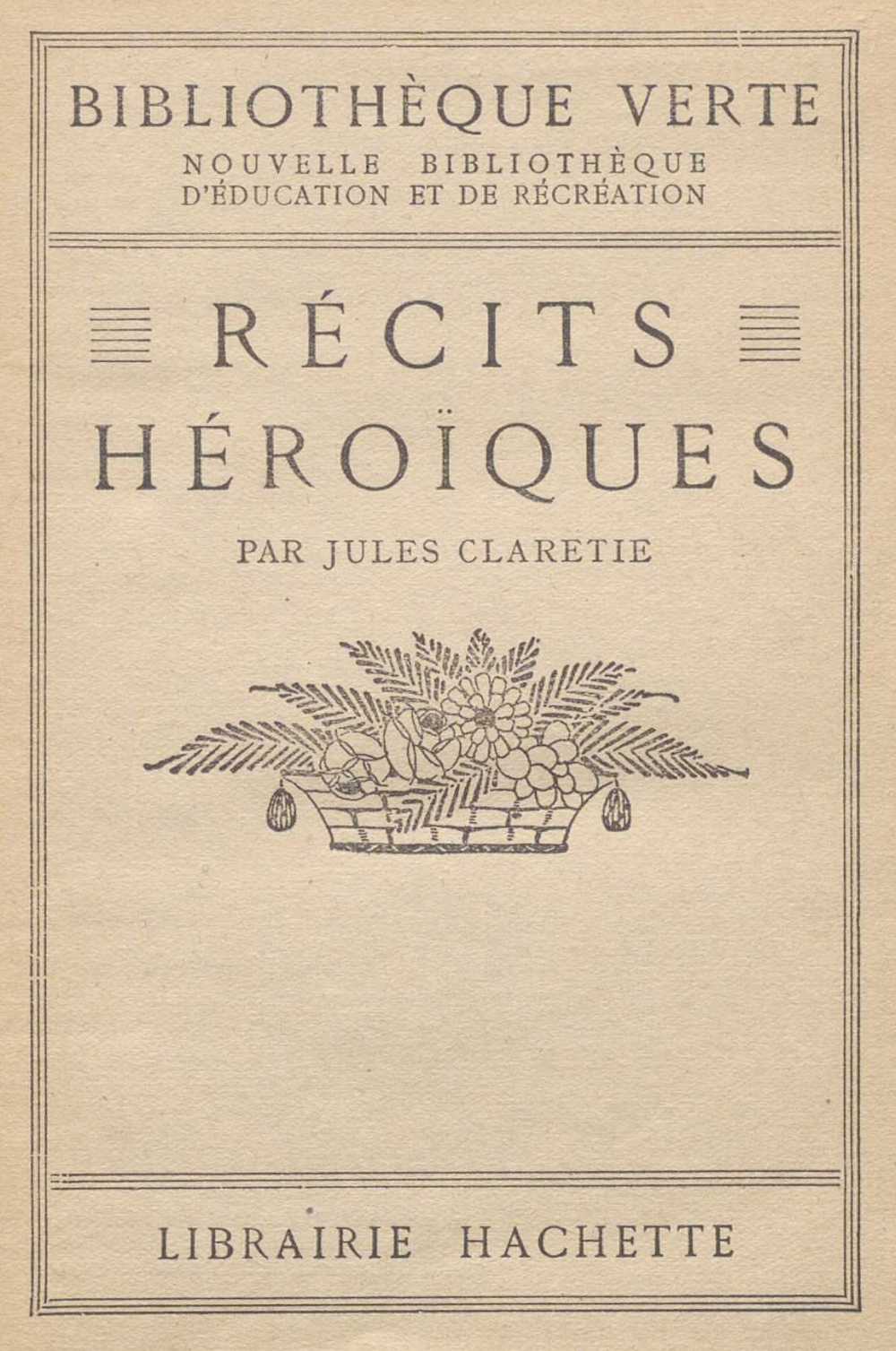
BIBLIOTHÈQUE VERTE
NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
D’ÉDUCATION ET DE RÉCRÉATION
PAR JULES CLARETIE
LIBRAIRIE HACHETTE
DANS LA MÊME COLLECTION
Copyright by Librairie HACHETTE, Paris, 1923. Tous droits de reproduction, de traduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
« Voyez-vous, disait souvent le vieux capitaine Fougerel en frappant sur la table, vous ne savez pas, vous autres, ce que c’est que le drapeau. Il faut avoir été soldat ; il faut avoir passé la frontière et marché sur des chemins qui ne sont plus ceux de France ; il faut avoir été éloigné du pays, sevré de toute parole de la langue qu’on a parlée depuis l’enfance ; il faut s’être dit, pendant les journées d’étapes et de fatigue, que tout ce qui reste de la patrie absente, c’est ce lambeau de soie aux trois couleurs françaises qui clapote, là-bas, au centre du bataillon ; il faut n’avoir eu, dans la fumée du combat, d’autre point de ralliement que ce morceau d’étoffe déchirée pour comprendre, pour sentir tout ce que renferme dans ses plis cette chose sacrée qu’on appelle le drapeau. Le drapeau, mes pauvres amis, mais, sachez-le bien, c’est, contenu dans un seul mot, rendu palpable dans un seul objet, tout ce qui fut, tout ce qui est la vie de chacun de nous : le foyer où l’on naquit, le coin de terre où l’on grandit, le premier sourire d’enfant, le premier amour de jeune homme, la mère qui vous berce, le père qui gronde, le premier ami, la première larme, les espoirs, les rêves, les chimères, les souvenirs ; c’est toutes ces joies à la fois, toutes enfermées dans un mot, dans un nom, le plus beau de tous : la patrie. Oui, je vous le dis, le drapeau, c’est tout cela ; c’est l’honneur du régiment, ses gloires et ses titres flamboyant en lettres d’or sur ses couleurs fanées qui portent des noms de victoires ; c’est comme la conscience des braves gens qui marchent à la mort sous ses plis ; c’est le devoir dans ce qu’il a de plus sévère et de plus fier, représenté par ce qu’il a de plus grand : une idée flottant dans un étendard. Aussi bien étonnez-vous qu’on l’aime, ce drapeau parfois en haillons, et qu’on se fasse, pour lui, trouer la poitrine ou broyer le crâne. Il semble que tous les cœurs du régiment tiennent à sa hampe par des fils invisibles. Le perdre, c’est la honte éternelle. Autant vaudrait souffleter un à un ces milliers d’hommes que de leur arracher, d’un seul coup, leur drapeau. Non, non, cent fois non, vous ne comprendrez jamais ce que peut souffrir un homme qui sait que son drapeau est demeuré, comme une partie intégrante du pays, aux mains de l’ennemi. C’est une idée fixe qui dès lors le torture et le déchire : « Le drapeau est là-bas ! ils l’ont pris ; ils le gardent ! » Nuit et jour il y songe, il en rêve… Il en meurt parfois. Qu’est-ce qu’un drapeau ? me direz-vous ; un symbole… Et qu’importe qu’il figure, ici ou là, dans une revue ou une apothéose ? Symbole, soit ; mais tant que l’espèce humaine aura besoin de se rattacher à quelque croyance saine, mâle et vraie, il lui en faudra encore, de ces symboles dont la vue seule remue en nous, jusqu’au profond de l’être tous les généreux sentiments, tout ce qui nous porte vers le dévouement, le sacrifice, l’abnégation et le devoir ! »
Quand il avait ainsi parlé, le capitaine Fougerel retombait bientôt dans un mutisme somnolent qui lui était habituel. C’était, d’ordinaire, un homme triste, accablé, pensif, courbé par l’âge, il est vrai ; et, dans le petit café de Vernon où il venait chaque soir lire les journaux de Paris en prenant son gloria, on n’entendait que rarement sa voix, et dans les grandes occasions. Depuis de longues années, Fougerel avait adopté le Café de la Ville, au coin de la ruelle qui longe l’église. Il y venait après dîner, chaque soir, au même moment, s’asseyait toujours à la même table, y demeurait le même nombre d’heures et se retirait à la même minute pour regagner son logis, situé près de là, dans la vieille rue Saint-Jacques. La table où il s’asseyait n’avait jamais d’autre occupant que lui. Que si, avant l’arrivée de Fougerel, un voyageur de commerce, nouveau venu à Vernon, ou un passant s’asseyait dans le coin où l’ancien soldat se tenait d’habitude, le garçon de café s’approchait doucement et, tout bas, disait :
« Il est impossible que vous restiez à cette table, monsieur : c’est la table des capitaines. »
La « table des capitaines » était célèbre dans le Café de la Ville, et, quoique Fougerel y vînt seul, elle avait gardé cette dénomination en souvenir d’un autre soldat, le compagnon de Fougerel, qui, lui aussi, au temps passé, s’asseyait chaque soir devant cette table de marbre. Vernon les avait vus, pendant longtemps, toujours au même endroit, dans ce café, roulant sous la paume de leurs mains les dominos qui rendaient, sur le marbre, leur bruit d’osselets, ou faisant flamber au-dessus de leur demi-tasse une couche légère d’eau-de-vie, et regardant, sans dire un mot, cette flamme qui s’éteignait bientôt, sans force, comme s’éteint un vieillard. Ils n’étaient ni grognons, quoique vieux, ni maussades ; mais ils ne se livraient et ne causaient point volontiers cependant. Leurs propos, où revenaient si souvent les souvenirs d’autrefois, les échos des journées de bataille, les visages d’amis maintenant disparus, leur suffisaient. Leur amitié leur tenait lieu de tout au monde, et, quoique peu fortunés et déjà atteints des maux de l’âge, ils se trouvaient heureux.
Fougerel et Malapeyre, comme s’appelaient les deux capitaines, étaient depuis longtemps de vieux amis. Ils s’étaient connus au même régiment de ligne, et, presque en même temps, ils avaient passé dans le même bataillon des grenadiers de la vieille garde impériale. Fougerel était Normand, engagé volontaire, parti tout jeune du pays, Pressagny, un petit village des environs de Vernon, — qui porte, on ne sait pourquoi, le surnom de l’Orgueilleux, — et, se battant bravement, n’épargnant, en campagne, ni son sang ni sa peine, il avait, à la pointe de la baïonnette et de l’épée, conquis les épaulettes de capitaine. Malapeyre avait fait de même, arrivant au même but par les mêmes chemins. Fils d’un pêcheur de Lormont près de Bordeaux, comme Fougerel était né d’une famille de fermiers normands, il avait voué sa vie à cette France que Napoléon Ier lançait alors — éperonnant jusqu’au sang ce cheval de bataille — dans toutes les aventures et dans toutes les guerres. Il avait trouvé, au bout de cette existence de labeur, une épée de capitaine, la croix d’honneur et une modeste pension de retraite, à peine de quoi vivre ; mais, toujours comme Fougerel, Malapeyre se souciait peu de vivre ou de dormir. Côte à côte, ces braves gens avaient fait, en soldats résolus, les dernières campagnes de l’Empire. Ils s’étaient battus à Smolensk, à Leipzig, en Allemagne, en France, et, après le retour de l’île d’Elbe, ils avaient versé leur sang à Waterloo, dans la partie suprême de l’ambitieux aux abois. Chacun des deux capitaines avait fait là tout ce que peut faire un homme pour ne point survivre. Blessés tous deux, laissés pour morts, ils étaient tombés avec les derniers carrés, leurs habits bleus entourés d’un monceau d’habits rouges. Puis, au lendemain de leur convalescence, ils avaient trouvé un roi assis sur le trône impérial qu’ils avaient si longtemps soutenu de leurs vaillantes mains, le drapeau blanc flottant à la place du drapeau tricolore, des uniformes nouveaux, une cocarde nouvelle, des Suisses qui nommaient les soldats de Milhaud ou de Ney des « brigands de la Loire ». Un rêve écroulé.
Les deux amis se regardèrent alors en hochant la tête. A quarante ans, en pleine vigueur, ils se réveillaient comme d’un songe et se trouvaient licenciés, sans état, sans espoir, avec une maigre pension de retraite qui leur payait avec avarice le prix de leurs blessures. Que faire ? Et quelle existence allaient mener dans cette France nouvelle ces deux soldats devenus suspects, bonapartistes pour les uns, jacobins pour les autres ? Fougerel et Malapeyre se consolèrent en se disant que la royauté des Bourbons ne pouvait durer, et qu’il suffisait d’attendre. Alors ils cherchèrent, dans ce grand pays pour lequel ils avaient tant et si bien combattu, un coin où se réfugier, où se reposer et patienter. Voilà vingt ans qu’ils avaient quitté, l’un ses pommiers normands, l’autre ses vignes bordelaises, vingt ans qu’ils menaient, à travers le monde, la vie des chevaliers errants, toujours cheminant, jamais au repos, vainqueurs et vaincus, entrant, musique en tête, dans les capitales conquises, et disputant, le lendemain, au Cosaque ou au Prussien, la terre de France toute trempée de sang français. Vingt ans de courses et de combats. En vingt ans, les foyers se vident, et les vieux parents disparaissent. Ni l’un ni l’autre des deux amis ne retrouva trace du passé. A la place de la petite maison de Lormont où il était né, Malapeyre rencontra une auberge nouvellement construite, qui servait de relais à la diligence de Bordeaux.
Lorsqu’il demanda, à Pressagny, des nouvelles de ses parents, Fougerel vit des gens qui interrogeaient leur mémoire et qui disaient :
« Oui, j’en ai entendu parler !… Ils ont quitté le pays pour s’établir à Pacy, et ils y sont morts. »
C’était tout ce qui restait aux deux amis : des noms sur une pierre, dans quelque cimetière de village. Aussi bien, se voyant inutiles et se sentant tout seuls dans le monde, ils résolurent de continuer coude à coude, comme des soldats dans le rang, le chemin de la vie. Ils ne se quittèrent plus. Fougerel décida Malapeyre à habiter le pays normand, et, choisissant leur logis dans cette calme et charmante petite ville de Vernon, ils y associèrent leurs deux médiocrités fort peu dorées, et parvinrent, habitués qu’ils étaient depuis longtemps aux privations, à en faire une sorte d’aisance. C’était le repos absolu après l’absolue agitation. Quelle vie différente que cette vie nouvelle ! Les années s’écoulaient en journées longues comme des veillées d’hiver, remplies par les mêmes occupations, les mêmes causeries et les mêmes promenades. La ville, avec ses rues pittoresques, où çà et là apparaît quelque vestige du passé, est de celles où il fait bon de s’arrêter pour prendre quelque repos. Tout y invite à une halte heureuse. La Seine coule paisiblement sous le vieux pont de pierre. Des fumées saines, odorantes, sortent des toits de Vernon et de Vernonnet, le village qui fait face à la ville, sur la rive opposée du fleuve. De gais visages reposés se montrent aux fenêtres des maisons grises. Point d’agitation, point de fièvre. A peine quelques soldats du train, logés aux casernes, frappent-ils d’un talon plus bruyant le pavé de la ville. Cette population de rentiers, de vieux militaires retraités, d’amateurs de jardins, vit doucement sous l’atmosphère normande.
« Je donnerais tous les cidres de l’Eure et de la vallée d’Auge pour deux tonneaux de notre Médoc, disait parfois Malapeyre à Fougerel ; mais j’avoue qu’on vit à l’aise en Normandie et qu’on y vieillit avec plaisir. »
Les joies des deux officiers n’étaient pourtant pas excessives, et toutes leurs distractions consistaient à longer les boulevards, l’avenue de la Maisonnette, jusqu’au bout de cette route bordée d’arbres qui côtoie les charmilles du parc de Bizy, puis, continuant leur chemin, en s’arrêtant parfois pour tracer sur le terrain quelque plan d’une bataille que les deux amis discutaient, ils entraient dans la forêt et ne s’arrêtaient que sous les arbres superbes des Valmeux. Ils revenaient ensuite, toujours devisant, jusqu’à l’Hôtel d’Évreux, où ils prenaient pension, et, saluant en entrant les convives, ils s’asseyaient à la table d’hôte, et écoutaient plus qu’ils ne parlaient. Repliant leur serviette, ils donnaient enfin un bonsoir collectif, se rendaient au café et attendaient là, en jouant aux dominos, que le premier coup de neuf heures se fît entendre à l’église. Aussitôt ils regagnaient leur logis, et, après avoir pris leur bougeoir à terre, au bas de l’escalier, ils échangeaient une poignée de main et montaient chacun dans sa chambre, puis s’endormaient, rêvant aux conquêtes passées et aux victoires évanouies.
Au lendemain de Waterloo, ils comptaient, encore une fois, que le gouvernement des Bourbons ne serait que provisoire, et ils espéraient bien, un jour ou l’autre, tirer encore l’épée qui demeurait accrochée à leur chevet. Un vieux fond d’humeur républicaine leur laissait croire que Louis XVIII ne régnerait pas longtemps. Cependant, les années passaient ; les deux capitaines se sentaient vieillir, et Charles X, après avoir succédé à Louis XVIII, continuait de régner.
« Allons, disait parfois Fougerel, c’est fini, vois-tu, mon vieux Malapeyre ; nous ne commanderons plus aucune compagnie ; il faut laisser la place aux plus ingambes ; les rhumatismes viennent !… Et puis on a pris l’habitude de flâner : l’air de la caserne nous semblerait bien lourd ! Adieu les beaux espoirs, mon pauvre ami. Nous mourrons capitaines, et rien que capitaines. Nous ne sommes plus bons à rien, le proverbe le dit : Vieux soldat, vieille bête ! »
Ils hésitèrent un moment, après 1830, à reprendre du service. Mais en réalité ils s’étaient faits à cette existence placide, à leur coin d’habitude, à la fillette souriante dont la tête brune apparaît entre deux pots de géranium, à la dame du café qu’on salue et qui vous respecte, à ces coups de chapeau des passants qui s’inclinent devant « les capitaines », à cet intime repos, à cet humble bonheur de tous les jours, à cette vie pénétrante, qui berce l’homme en quelque sorte et endort son souci. Ils n’osèrent point quitter cela. Ils avaient dépassé l’âge des aventures. Ne vivant que dans le temps d’autrefois, leurs souvenirs leur suffisaient. Après une première fièvre pleine de ferveur militaire, ils continuèrent donc au lendemain de Juillet à mener leur vie paisible, et on les vit, toujours souriants, silencieux et sympathiques, s’asseoir à table d’hôte, à l’Hôtel d’Évreux, et, dans le Café de la Ville, à la « table des capitaines ».
Habitués à passer presque toutes leurs journées en commun, décidés à achever ensemble leur existence, ces deux soldats, ces deux amis, différaient cependant sur plus d’un point physique et moral. Leur amitié si vive et si durable vint peut-être même des contrastes de leur nature. Fougerel, grand, maigre, sec, le visage légèrement pâle et la barbe grise, était plus sévère, sans tomber dans la méchante humeur, que Malapeyre, son compagnon. Celui-ci, la taille élevée, mais épaisse, gros, sanguin, souriait et plaisantait plus volontiers. Mais, dans leurs habitudes, la différence des tempéraments n’était pas très grande. Fougerel avait une passion, le tabac, fumant sans cesse, le matin à sa fenêtre, le jour en se promenant, le soir en lisant. Malapeyre avait un péché mignon, le vin muscat ou les vins de la Péninsule. Il avait, sous sa grosse moustache, des froncements de lèvres satisfaits lorsqu’il venait de déguster un peu d’alicante ou de xérès. Fougerel lui reprochait souvent en riant d’être « sensuel ». Ce goût du capitaine pour le vin fin n’allait d’ailleurs que jusqu’au caprice, et point jusqu’au défaut ; mais Malapeyre eût, certes, mal dîné, s’il ne se fût, avant le repas, ouvert l’appétit avec du malaga, et si, au milieu du dîner, on ne lui avait pas versé son verre de madère.
« Souvenir des campagnes d’Espagne et de Portugal, » disait-il en riant.
Fougerel n’osait blâmer Malapeyre de ces prodigalités, lui qui dépensait ses économies en tabacs exotiques et en pipes extravagantes qu’il suspendait par rang de taille, dans sa chambre, à un râtelier qu’il appelait « son Musée ».
On ne leur eût trouvé d’ailleurs, même en cherchant bien, aucun autre péché caché. Vieux déjà, après avoir risqué cent fois de se faire tuer, n’ayant jamais trouvé, dans leur jeunesse, six mois d’existence calme, de ces heures pendant lesquelles on se dit qu’après tout l’homme est fait pour aimer, être aimé, être père, vieillir en voyant grandir de petits êtres qui seront des hommes ; après avoir laissé un peu de leur cœur ou de leur fantaisie, comme un peu de leur sang, aux buissons du chemin, ils se retrouvaient sans enfants, sans autres ressouvenirs d’amour que des amourettes de garnison, bien las, bien oubliés, bien seuls dans leur refuge, et cependant heureux, calmes, sans désirs, sans regrets, certains d’avoir accompli le devoir que tout homme doit remplir. Ils étaient, disaient-ils, de ceux qui ont la patrie pour famille et l’abnégation pour loi. Soldats, ils avaient agi en soldats, et, contents du sacrifice, ils humaient joyeusement le soleil, se répétant qu’ils avaient certes le droit de se reposer après une journée bien remplie. Et ils demeuraient volontiers dans leur ombre, silencieux, humbles, inconnus, épaves vénérables d’un grand naufrage.
D’ailleurs, un amour profond leur restait, une consolation suprême, de celles qui peuvent emplir toute une vie.
Tombés à Waterloo, ils avaient clos du moins leur carrière par un acte de dévouement superbe qui satisfaisait pleinement leur conscience de soldats et de citoyens et faisait passer un éclair d’orgueil dans leurs prunelles, lorsqu’ils y songeaient.
C’était un de leurs plus chers souvenirs. Waterloo ! A d’autres, ce nom eût fait monter au front la rougeur de la honte. Eux, sous la colère grondante qu’excitait l’écho de la sombre journée, retrouvaient l’amère consolation de ceux qui font obscurément, mais stoïquement, leur devoir dans l’obscure nuit d’une tempête.
Ce jour-là, le 18 juin 1815, alors que la fortune colossale de l’homme qui avait tenu dans ses mains la France s’écroulait et se brisait comme verre, dans le sauve-qui-peut de la débâcle, ces deux hommes, perdus parmi la foule de l’armée vaincue, avaient jusqu’au dernier moment senti battre en eux-mêmes le cœur de la patrie. Ils avaient assisté, le matin, l’arme au bras, à cette première partie de la bataille qui fut une victoire. L’armée anglaise, décimée, vit plusieurs fois se dresser devant elle le spectre de la déroute. L’obstination de Wellington, le duc de fer, la sauva. Elle permit aux soldats de Bülow et de Blücher d’arriver sur le champ de bataille et de trouver les derniers Anglais debout. Les grenadiers de la garde, suivant de loin les luttes gigantesques qui se livraient sur le plateau de Mont-Saint-Jean, écoutant le bruit de la fusillade qui venait d’Hougoumont, sur la gauche, et la canonnade qui, vers la droite, faisait croire à l’arrivée de Grouchy ; les grenadiers attendaient l’heure où on les lancerait à leur tour sur l’ennemi, pour achever la victoire, comme on venait de lancer sur Mont-Saint-Jean la moyenne garde ; les vieux soldats impatients se disaient que la journée durait bien longtemps et se demandaient comment Ney n’avait point déjà balayé les dragons de Ponsomby, les « enfants rouges » de Wellington et les highlanders d’Écosse. Tout à coup, vers la fin du jour, alors qu’on pouvait encore croire gagnée cette rude et farouche bataille, l’arrivée soudaine de Blücher, que Lobau ne pouvait plus contenir comme il avait arrêté Bülow, cette irruption inattendue de troupes fraîches sur le terrain de la lutte changea brusquement la fortune et mit le désordre dans les rangs français. De toute cette armée compacte et solide, il ne restait d’intacts que les grenadiers de la vieille garde. Les autres corps, cruellement éprouvés depuis le matin, se trouvaient maintenant mêlés et confondus. Fantassins, cavaliers, cuirassiers de Milhaud, voltigeurs, lanciers de Ney, canonniers, grenadiers, tout roule, éperdu, comme un flot humain, sous la dure pression des colonnes prussiennes débouchant par Planchenoit. La garde alors se forme en carrés ; la vieille garde essaye d’opposer une résistance invincible aux soldats de Blücher et à ces Anglais de Wellington qui descendent maintenant, en poussant leurs hourras, du plateau où on les massacrait le matin. Impassibles, baïonnette croisée, cloués au sol, les grenadiers de la vieille garde attendent de pied ferme l’attaque suprême de l’ennemi ; leurs carrés, citadelles humaines, broyés par la mitraille, tournoient sous le feu, s’écrasent sous les balles, se dispersent en laissant des monceaux de cadavres pour marquer la place où ils ont combattu. Cinq sont détruits, trois résistent encore ! Les carrés que commandent les généraux Petit et Poret de Morvan, attaqués à leur tour, tiennent fièrement sous les boulets et les balles. Autour d’eux s’entassent les morts anglais et les cadavres prussiens. Et là, parmi ces héros, combattaient les capitaines Fougerel et Malapeyre, placés au centre, sabre en main, autour du porte-drapeau. Pâles de fureur, ils jetaient à l’ennemi des injures terribles, étouffées sous le fracas de la bataille. Une balle tout à coup vint frapper au front l’officier, un nommé Crosnier, qui tenait le drapeau tricolore. Un filet de sang coula du front troué de ce brave. Blessé à mort, il se tenait debout, encore cramponné à la hampe du drapeau. Puis, brusquement, ses doigts se détendirent, et il tomba de toute sa hauteur, la face dans la boue sanglante.
« Fougerel, s’écria Malapeyre, Fougerel, à toi le drapeau ! »
Fougerel saisit l’étendard échappé de la main du mourant et le brandit avec une colère superbe, l’agitant au-dessus des bonnets à poil et faisant claquer ses plis, dans cette atmosphère de fournaise, comme une bravade à l’ennemi. Une balle vint fracasser l’aigle d’or et l’emporta, et le capitaine sentit vibrer dans sa main le drapeau, qui semblait frissonner comme un être blessé !
En ce moment, les Prussiens, avançant lentement, mais sûrement, poussaient leurs masses sombres sur le carré, qui pliait. Déjà quelques soldats effarés se détachaient du groupe héroïque et se mêlaient à la cohue hurlante qui fuyait par la chaussée de Genappe.
Alors il sembla à Fougerel qu’il entendait un grand cri, à la fois suppliant et impératif, un cri poussé par Malapeyre, et qui lui ordonnait de sauver le drapeau. Ces deux hommes se regardèrent instinctivement dans la fumée sombre.
Ce ne fut qu’un éclair. Ils se comprirent.
La partie était perdue. « Ils sont trop ! ils sont trop ! » disait Malapeyre. Tout à l’heure les Prussiens allaient arracher aux soldats mourants le drapeau des grenadiers de la garde. Il fallait le leur dérober, le leur ravir ; il fallait le détruire. Fougerel fit glisser à terre la hampe qu’il tenait dressée, et, la brisant sur un canon, tandis qu’ils arrachaient l’étoffe de soie :
« Enterre-le, » dit-il à son ami.
Il y avait à leurs pieds, parmi les cadavres, un écouvillon cassé ; Malapeyre s’en servit pour faire un trou assez profond dans la terre détrempée, boueuse, et, quand il eut fini, recouvrant le drapeau, les lambeaux de soie, d’une couche de terre rouge de sang, il trépigna sur cette sorte de tombe ; puis, quand il releva la tête vers Fougerel, il entendit le capitaine qui lui disait avec un geste fier :
« Maintenant, vive la France ! On peut mourir ! »
Et tous deux, sous la mitraille épouvantable, parmi les cris de triomphe insultants des vainqueurs, au milieu des plaintes sinistres ou des menaces des vaincus, ces hommes froids, souriants, heureux d’avoir sauvé le drapeau, jetaient comme une arme impuissante la hampe brisée à la face des Prussiens, qui fusillaient maintenant le carré à bout portant.
Bientôt il n’allait plus rester sur le champ de bataille de Waterloo que le dernier carré, que commandait Cambronne, et où Napoléon Ier voulut du moins, lui, s’enfermer pour mourir. Les derniers combattants de la grande armée allaient tomber, côte à côte, écrasés, mais invaincus. Fougerel et Malapeyre furent laissés pour morts. Tous deux blessés, l’ambulance les sépara longtemps ; on les avait transportés dans des fermes et soignés là, tant bien que mal. Les paysans qui les avaient recueillis les avaient reçus à demi vêtus, les poches vidées par les maraudeurs, et il leur fallut, une fois guéris, regagner le pays à pied, étape par étape, plus semblables à des mendiants qu’à des soldats. Mais quoi ! ils se sentaient assez riches d’avoir enfoui, comme des avares, le seul trésor qu’ils estimassent plus que tout au monde, car il représentait l’honneur national, il portait les couleurs françaises et leur semblait comme une image palpable de la patrie.
Lorsqu’ils se rappelaient cette journée terrible, ou plutôt l’heure crépusculaire où, tout étant perdu, n’ayant plus autour d’eux que la mort, ils avaient résisté jusqu’à la fin, le sang aux yeux, l’injure à la bouche, la main crispée sur la garde d’une épée qu’ils eussent brisée et non rendue ; lorsqu’ils évoquaient cette dernière scène du drame dont ils avaient été les acteurs, ces tas de morts aux formes bizarres, ce ciel incendié, cette plaine immense, ce fourmillement à la fois rouge des uniformes britanniques et noir des uniformes prussiens, cette ligne de feu enveloppant ce carré d’hommes décidés à périr, puis ce drapeau déchiré, cette hampe brisée, cet étendard disputé à l’ennemi et sauvé de son atteinte ; lorsqu’ils se disaient : « Nous avons fait cela, » Fougerel et Malapeyre relevaient le front, se regardaient avec des yeux contents et se tendaient la main, en se répétant : « Au moins, ils ne l’ont pas pris, le drapeau des grenadiers de la garde ! » Cette idée était la consolation, ce fait d’armes la consécration de leur vie. Retraités, inutiles, bons maintenant à faire des invalides, ils se disaient du moins qu’eux seuls, d’un même élan, d’un même accord, avaient vengé l’honneur du pays et celui du régiment. Aussi bien, lorsqu’ils causaient de ce passé, les deux capitaines souriaient, Fougerel se frottait les mains, et Malapeyre lui disait : « Allons, un verre de madère à la santé du drapeau ! Tu ne peux pas lui refuser ça ! »
Ainsi vivaient humblement, doucement, apaisés et contents, ces hommes qui avaient ouvert leurs veines pour faire de la pourpre à un despote, et qui eussent voulu donner leur vie pour éviter une défaite à la France.
Un soir qu’ils étaient assis à leur table accoutumée, Fougerel, fumant sa pipe d’écume et écoutant le bruit des billes d’ivoire roulant sur le billard, Malapeyre, qui lisait le journal venu de Paris, fit tout à coup un mouvement sur sa chaise, poussa un cri étouffé, et laissa tomber sur la table de marbre le journal qu’il tenait à la main. Au geste de son ami, Fougerel avait regardé Malapeyre d’un air à la fois étonné et inquiet. Malapeyre était livide ; sa lèvre inférieure remuait nerveusement sous sa moustache. Il avait l’air d’un homme qui étouffe.
« Eh bien ! quoi ? dit Fougerel ; qu’as-tu donc ?
— Ce que j’ai ? » fit Malapeyre.
Il voulut parler : la voix s’arrêta dans sa gorge ; il prit le journal avec colère, et, désignant d’un doigt tremblant quelques lignes à Fougerel, il ne prononça que ce seul mot :
« Lis ! »
Fougerel hocha la tête, se disant que c’était sans doute encore un compagnon du vieux temps qui venait de mourir, — et la seule préoccupation du soldat était de savoir le nom de celui qui partait, — lorsque, en regardant le passage des faits divers que lui signalait Malapeyre, il sentit lui courir sur la peau un frisson étrange et plein de colère. Un flot de sang lui monta brusquement aux oreilles et aux yeux. On lui eût donné un coup de crosse sur la nuque, il n’eût pas été plus étourdi.
« Est-ce possible ! dit-il d’un air effaré. Comment ! comment !… Ils l’ont eu ?
— Lis, » répéta Malapeyre d’un ton sombre.
Fougerel relut, scanda un à un les mots imprimés. C’était un extrait de la Gazette de Berlin, qui contenait ce qui suit : « On vient de réparer, à la Garnisons-Kirche, à Potsdam, le tombeau du grand Frédéric. Au-dessus du mausolée, on a disposé circulairement les drapeaux français pris à Waterloo, et parmi lesquels se trouvent l’aigle des dragons de l’impératrice, celle des voltigeurs et l’aigle du 1er régiment des grenadiers de la garde. »
« Le drapeau ! dit Fougerel en s’interrompant, ils ont le drapeau !
— Continue, répondit Malapeyre, qui regardait son ami avec des yeux fixes.
— « Ce dernier étendard (le nôtre, dit Fougerel avec colère) avait été ramassé sur le champ de bataille le 18 juin 1815. Ses défenseurs l’avaient déchiré, puis littéralement enterré, et c’est le lendemain seulement qu’on en a retrouvé les lambeaux en creusant, pour enfouir les morts, les environs de la chaussée de Genappe. La princesse de Hohenlohe a recousu, de ses propres mains, ce glorieux trophée, qui orne maintenant le mausolée de Frédéric II. »
— Le drapeau, notre drapeau, répéta encore Fougerel, dont la colère augmentait, ils l’ont trouvé, ils l’ont gardé ! Ah ! tonnerre ! il valait bien la peine de le disputer ainsi à ces sauvages ! Ils l’ont pris ! Comment disent-ils ? « Il orne le mausolée de leur Frédéric ! » Mille dieux, mon pauvre Malapeyre, voilà une mauvaise journée !
— Très mauvaise, » répondit Malapeyre en se tordant la moustache.
Puis tous les deux, rêvant, absorbés, se turent et se mirent à songer. Quel écroulement ! quel réveil ! Cette idée qu’ils avaient, dans l’immense chute de la patrie, sauvé l’honneur du corps, enlevé à l’ennemi le droit d’afficher la défaite du 1er grenadiers, c’était leur consolation depuis vingt ans, leur joie intime, rendue chaque fois plus profonde par l’éloignement, par cette brume des temps qui est comme l’auréole des souvenirs. Ce suprême défi à la destinée et cette dernière lutte de deux hommes de cœur avec la fortune, lorsqu’ils y songeaient, les rendaient fiers. Dans la gloire du passé, ils ne voulaient pour eux que cette gloriole, mais ils la voulaient. Ils se sentaient persuadés que leur devoir n’avait pas été stérile, satisfaits d’avoir combattu jusqu’au bout et, dans le désastre de l’armée et de la nation, sauvé ce débris : un drapeau. Aussi bien les lignes traduites de la Gazette de Berlin leur faisaient l’effet d’un coup de foudre. Elles anéantissaient, en une seconde, l’échafaudage tout entier de leur bonheur calme et satisfait. Il semblait à ces soldats rigides qu’on venait brusquement de les mettre à l’ordre du jour, comme coupables de lâcheté. Cette mention du drapeau captif leur paraissait la plus cruelle des injures personnelles. C’était même plus qu’une injure, c’était le reproche sanglant de la patrie humiliée à ceux qui la devaient défendre. « Ils ont le drapeau ! » Cette seule pensée tint muets tout le soir les deux capitaines, et il fallut, pour qu’ils sortissent de leur torpeur assombrie, que le garçon de café vînt leur dire :
« Il est dix heures, capitaines ! »
Jamais on n’avait vu les capitaines demeurer si longtemps à leur table habituelle.
Ils rentrèrent au logis, soucieux et sans mot dire. Seulement, avant de se séparer, ils se serrèrent la main dans une étreinte nerveuse, éloquente et prolongée comme un adieu. Puis ils se mirent au lit, mais sans dormir ; tous deux revoyaient, en fermant les yeux, les lignes maudites de cet article qui tombait dans leur calme existence comme un boulet sur un toit paisible.
Le lendemain, au réveil, les deux amis se saluèrent d’un bonjour triste, Malapeyre soupirait ; Fougerel, tout en se rendant à l’Hôtel d’Évreux, frappait le pavé du bout de sa canne, comme s’il eût menacé un adversaire absent. Il faisait beau. Dans leur promenade aux Valmeux, pas un mot du drapeau ne fut dit entre eux. Ils ressemblaient à des parents qui évitent de parler de l’enfant qu’ils ont perdu. Le soir, avant le dîner, lorsque le garçon de café apporta à Malapeyre le verre de malaga qu’il buvait d’habitude, le capitaine dit d’un ton brusque :
« Merci, je n’en prendrai pas. »
Et comme le garçon le regardait d’un air surpris : « Je n’en prendrai plus, » fit Malapeyre doucement.
Fougerel laissa partir le garçon, aussi étonné que si le clocher de l’église fût tombé tout à coup ; puis, regardant Malapeyre en face :
« Tu prétendais, dit-il, que tu ne pouvais dîner sans ce que tu appelais un apéritif ?
— Oui, autrefois, répondit Malapeyre.
— Autrefois, c’était hier.
— Entre hier et aujourd’hui, il y a longtemps.
— C’est vrai, » dit Fougerel.
A table, Malapeyre refusa encore le vin qui faisait le « coup du milieu ». Toute la table fut ébahie. On se demandait si le capitaine n’était pas malade. Il était pâle, à la vérité, et assez morne, comme Fougerel. En quittant l’hôtel pour se rendre au café, Fougerel fredonnait, mais sans y penser, un air de marche.
« Tu chantes ça sur un air de De profundis, fit Malapeyre.
— C’est que c’en est un aussi, répondit le capitaine. Il y a en moi quelque chose de mort et qui vivait hier : une confiance, un espoir, une joie… Tu sais quoi ?
— Je le sais, » dit Malapeyre.
Le garçon du Café de la Ville demeura stupéfait, ce soir-là, lorsque les capitaines, apercevant les deux glorias qu’il apportait sur un plateau de tôle, Fougerel dit, en éloignant les grosses tasses à filets bleus et à contre-filets dédorés : « Je n’en prends pas, » et que Malapeyre ajouta : « Ni moi. Remportez cela. »
« Faut-il laisser le carafon, au moins ? demanda le garçon, en prenant par le col le flacon d’eau-de-vie.
— Non, rien. »
Il y avait évidemment quelque chose de brisé dans la vie des deux capitaines. Ce fut l’occasion de plus d’un propos, et les habitués du café prétendirent, mais sans preuves, qu’après avoir engagé leur demi-solde, ils l’avaient perdue dans de mauvais placements. Pauvres gens ! D’ailleurs, il faut le reconnaître, ces économies nouvelles apportées dans leur manière de vivre ne nuisirent en rien à la considération des vieux officiers. On n’en parlait à Vernon que pour tuer le temps, comme on dit. Eux, à partir de ce moment, passèrent à peu près, au Café de la Ville, du rôle de consommateurs à celui de spectateurs, suivant les parties de billard, de dominos ou d’échecs, et jugeant les coups.
Leur opinion faisait loi. Ils se plaisaient à retrouver, dans ces luttes des échecs, les émotions affaiblies et comme les fantômes des batailles d’autrefois. Des années s’écoulèrent ainsi. La sobriété des capitaines était devenue excessive. Fougerel ne fumait plus ; rarement et dans les grands jours, il décrochait du râtelier une pipe et la bourrait, aspirant lentement à sa fenêtre le parfum qui lui plaisait, puis il suspendait de nouveau la pipe à sa place, comme une arme hors d’usage. Quant à Malapeyre, sa tempérance était absolue. Il se fût contenté volontiers de devenir et de rester un buveur d’eau.
Ce système soudain d’économie avait une cause, et chacun de ces deux hommes devinait instinctivement le motif qui dictait la conduite de son compagnon, mais aucun d’eux n’y faisait allusion, même en passant. Ils avaient pris, en vivant dans une intimité si profonde, l’habitude des mêmes soucis, des mêmes pensées. Ils se comprenaient parfois, sans dire un mot, d’un geste ou d’un regard. La vie en commun et l’affection vraie ont très souvent de ces résultats. La pensée se dédouble, ou plutôt les deux pensées n’en font plus qu’une ; la même âme habite deux corps.
Fougerel et Malapeyre ne soufflaient mot de leurs projets, mais chacun d’eux les connaissait intimement et complètement, tout en sachant gré à son ami de ne point chercher à en deviner le secret.
C’était comme une idée fixe, que ces deux hommes caressaient à l’envi l’un de l’autre, une de ces idées qui absorbent tout dans une existence et servent parfois à l’homme de prétexte pour vivre, une idée absolue, comme toutes celles des chercheurs de mondes, une idée sublime et folle. Chacun d’eux avait résolu, à part soi, d’aller, sans plus hésiter, quand il le pourrait, à Potsdam, et, là, de déchirer, de reprendre, de brûler, de voler, d’anéantir — Dieu sait comment ! — le drapeau du 1er régiment des grenadiers de la garde, offert en pâture aux regards des curieux.
Cette idée, peut-être impraticable et à coup sûr étrange, insensée, avait germé dans le cerveau de ces deux soldats, à la même heure, depuis le jour où ils avaient appris que ce drapeau, qu’ils croyaient sauvé par leurs mains, servait de trophée à l’ennemi. Nulle puissance au monde n’eût certes pu les détourner de cette entreprise, ou leur en démontrer l’impossibilité. Il leur semblait que cette aventure était le devoir. Leur conscience leur dictait cette consigne étroite, définitive. « A quoi serait bon un soldat, pensaient les deux capitaines, s’il laissait ainsi son drapeau à l’étranger ? »
D’ailleurs, même au point de vue purement égoïste, l’entreprise devait être tentée. Depuis qu’ils savaient que leur dévouement dernier, leur sacrifice, leur suprême colère avaient été inutiles, ils étaient en effet devenus sombres, à demi accablés, à demi irrités, dormant mal, n’aimant plus les promenades d’autrefois, la causerie tranquille, la vie apaisée de la petite ville, inquiets, au contraire, et mécontents comme tous les Icares dont la réalité a durement brisé les ailes.
Une seule question les retenait en Normandie, la dure question d’argent : cela coûtait cher, à cette époque, un voyage en Prusse, et les anciens soldats n’étaient pas riches. Aussi c’était pourquoi, tous deux, sans souffler mot, avaient doucement rogné sur leurs plaisirs, sur leurs chères habitudes, les petites économies qui devaient leur permettre, avec le temps, de payer le voyage en diligence, de Vernon à Paris, de Paris à la frontière, et de la frontière à Potsdam. Des années se passèrent ainsi, dans la poursuite de la même touchante et héroïque chimère. Sou sur sou, comme tous les pauvres, les capitaines mirent de côté le prix du voyage, et lorsque la somme fut complète, lorsqu’ils demandèrent au receveur de leur changer leurs nombreuses petites pièces de monnaie blanche pour quelques pièces d’or, lorsque, en comptant ses saintes et modestes épargnes, chacun d’eux fut certain qu’il pouvait maintenant tenter l’aventure, ce fut une journée de joie entre ces deux vieux amis, et l’un à l’autre ils se révélèrent un secret déjà lointain dont chacun savait d’avance le dernier mot.
« Je t’avais deviné, mon brave Malapeyre, dit Fougerel, mais je voulais te laisser le bonheur de te croire seul à nourrir ton projet.
— Je t’avais deviné aussi, fit Malapeyre ; mais tu avais l’air si heureux lorsque je demandais pourquoi tu ne fumais plus et que tu me répondais : « Parce que… »
— Hypocrite, qui disait qu’il n’aimait plus le vin de Madère !
— Certes non, je ne l’aime plus. Je n’aime plus que ce drapeau qu’il faut reprendre. Je ne vis qu’en songeant à cela. On ne meurt point parce qu’on devient sobre. Si j’avais eu la folie de dépenser dix sous à une rasade, il me semble que le vin m’eût emporté le gosier. C’était de l’argent que j’eusse volé à mon tiroir secret.
— Tu avais un tiroir ! dit Fougerel en riant ; moi, une tirelire !
— Et combien au fond ?
— Neuf cents francs !
— Moi, treize cents !
— Crésus, s’écria Fougerel, tu as donc des économies cachées dans des silos ?
— Non, répondit Malapeyre, mais j’ai vendu le petit coupon de rente qui dormait au fond du portefeuille. Cela m’a donné cinq cents francs tout de suite !
— Allons, dit Fougerel, tu es un homme, vois-tu, vieux ! Embrasse-moi !
— C’est bon tout de même de se comprendre, ajouta Malapeyre un moment après. N’est-ce pas que tu ne pourrais pas vivre en le sachant là-bas, lui ?
— Nous le rapporterons ici, Malapeyre.
— Quand partons-nous ?
— Demain, si tu veux !
— Va pour demain. J’ai mon passeport tout prêt.
— Vois-tu, dit encore Fougerel, le voyage est long, la tâche est difficile ; d’autres la trouveraient peut-être ridicule ; mais, il n’y a pas à dire, si nous ne faisions pas cela, autant vaudrait avoir capitulé tout de suite au temps jadis, et mourir bêtement ici, gras comme des chanoines et sans souci de ce qui fait les hommes. Tu as raison, partons vite. Il n’est jamais trop tôt pour se mettre en route, quand on a à atteindre un pareil but ! »
Avant de partir, ils mirent en ordre leur logis, repliant au fond des armoires leurs vieux uniformes à demi rongés, et faisant un paquet de leurs épaulettes. Fougerel avait gardé au fond d’un coffre ses épaulettes de sergent, où les fils d’argent se mêlaient aux fils rouges, ses épaulettes de lieutenant et ses épaulettes de capitaine. Il les contemplait avec une émotion profonde, rattachant tant de souvenirs à chacune de ces choses muettes, qui lui rappelait un devoir accompli, un péril bravé, une victoire. C’était toute sa vie marquée par quatre étapes. Il les plaça, avec la croix d’honneur de Malapeyre, dans une boîte fermée à clé, et remettant la garde de tout cela à la vieille dame qui leur louait leur logis :
« Si nous ne revenons pas, dit-il, vous vendrez tout, et vous donnerez l’argent aux pauvres !
— Vous allez donc en guerre ? demanda la vieille dame.
— A peu près, » répondit Fougerel.
Ils avaient bien le cœur serré, en quittant Vernon, où, depuis plus de vingt ans, ils avaient pris l’habitude de vivre, mais les deux officiers retrouvaient en ce moment quelque chose de l’ardeur qui les enflammait autrefois, au début d’une campagne. Il leur semblait qu’un invincible clairon sonnait la charge.
Lorsque la diligence partit, les pavés faisant sauter les vitres qui rendaient, à chaque cahot, des bruits de fusillade, l’impression du combat leur revenait soudain, et ils se grisaient comme de l’odeur de la poudre.
C’est un dur voyage qu’ils entreprenaient, fatigant et pénible. Mais l’idée fixe, maîtresse souveraine de leur pensée, qui les entraînait, leur faisait paraître la route plus courte. On eût dit qu’à l’horizon, comme un signe entraînant, irrésistible, se dressait le drapeau arboré jadis sous le sifflement des balles. Une sorte de mot d’ordre leur revenait sans cesse à l’oreille. Chaque tour de roue les rapprochait du but fiévreusement désiré. Ils croyaient parfois faire un rêve. Il leur semblait, tant et depuis si longtemps ils avaient appelé de leurs vœux ce voyage, il leur semblait que cela n’était point vrai, qu’ils n’étaient pas en chemin, qu’ils n’allaient pas trouver Berlin et Potsdam au bout de la route.
« Sais-tu ce qui me fait peur ? dit une nuit Malapeyre à Fougerel. C’est que je crains de ne jamais arriver là-bas.
— Pourquoi ? demanda Fougerel.
— Je ne sais pas, » répondit le capitaine en regardant les croupes blanches des chevaux sur lesquelles sautaient les brides et les harnais éclairés par la rouge lumière des lanternes de la diligence.
Ils avançaient pourtant ; ils allaient bientôt se trouver en Belgique. Ils avaient déjà dépassé Rocroi.
Ils éprouvaient maintenant une émotion vraie, profonde, en se disant qu’ils allaient une fois encore quitter cette terre de France d’où ils partaient jadis, à pied, tambour battant, pour aller tirer et recevoir des coups de fusil à travers le monde.
Ils arrivèrent à Givet.
Ce n’était pas sans raison que, lassé par le voyage, Malapeyre était vaguement attristé. Depuis Rocroi, il s’était senti pris d’un malaise sourd qui devint profond, de douleurs de tête et de crampes. Il n’y avait, dès le début, fait aucune attention.
« Ce n’est rien, disait-il ; c’est une courbature. »
Fougerel pourtant le trouvait pâle, l’air accablé, avec une fièvre bizarre dans les yeux.
« Souffres-tu donc beaucoup, Malapeyre ? demandait-il d’un air inquiet.
— Pas du tout, » répondait le capitaine, qui mettait son orgueil à ne pas souffrir.
Malapeyre était atteint cependant, et il perdait l’appétit ; sa tête était alourdie, son crâne serré par une migraine persistante, mais il essayait de secouer tout cela lorsqu’il songeait qu’au bout du chemin était Potsdam, et, à Potsdam, le drapeau. A Givet, pourtant, au moment de passer la frontière belge, Malapeyre avait failli céder à la lassitude, au malaise qui l’accablait. Assis sur une borne, tandis qu’on attelait les chevaux à la diligence, il regardait au loin, vers la Meuse, cette terre verte qui se découpait sur l’horizon, et qui était la terre de Belgique.
« Derrière, se disait-il, est l’Allemagne, là-bas ! »
Le soir venait. Sur la place, au loin, les soldats français battaient la retraite avec un redoublement d’énergie, pour que le bruit de leurs baguettes vînt frapper, sur l’autre rive, les oreilles étrangères. Il faisait bon et beau. Dans l’air, du côté de la haute forteresse au ton gris, des nuées de moucherons tourbillonnaient dans le crépuscule d’un soir d’août. Et Malapeyre se disait avec une tristesse pénétrante qu’il ne pouvait, malgré lui, surmonter :
« Encore quelques pas, et ce ne sera plus la France ! Reverrai-je jamais le pays ? »
Fougerel tout à coup lui frappa sur l’épaule. La diligence était attelée. Le conducteur appelait les voyageurs.
On partait.
En s’appuyant sur le marchepied, Malapeyre eut une sorte d’étourdissement. Il se sentit faiblir. Mais, apercevant dans la diligence un uniforme d’officier belge, il se raidit, par une sorte d’amour-propre militaire, et pour n’avoir pas l’air de faiblir devant un étranger.
Il avait beau faire cependant, le mal était le plus fort. A Aix-la-Chapelle, Fougerel voulait que son ami prît quelque repos. Malapeyre s’y refusa ; mais, à Cologne, malgré l’énergie, la ferme volonté de Malapeyre, qui persistait à continuer la route, il fallut s’arrêter. Le malaise s’aggravait et devenait maladie. Fougerel était désespéré : il était certain que Malapeyre dissimulait une partie de ses souffrances et se trouvait plus durement frappé qu’il ne voulait le laisser paraître. Une sorte de pressentiment douloureux s’emparait de lui. Aux premiers pas faits dans Cologne, il éprouva une façon d’accablement moral, comme s’il devinait que dans ce voyage suprême son ami n’irait pas plus loin.
« Puisque tu le veux, dit Malapeyre, demeurons ici. Tu as peut-être raison. Deux jours de repos et deux bonnes nuits suffiront à effacer toute trace de cette bête de fatigue ! Mauviette, va ! Ah ! l’on n’a plus vingt ans ! »
Ils cherchèrent à travers les rues un hôtel ; Malapeyre s’appuyait sur le bras de Fougerel, et, en marchant, il frissonnait, secoué par la fièvre. Des guides se présentèrent, qui conduisirent les deux soldats dans un hôtel de second ordre, portant sur son enseigne en fer-blanc ces mots : Kœlnischer Gasthof. Il était situé dans une de ces petites rues, tristes le jour, bruyantes le soir, qui avoisinent le Rhin. Fougerel demanda une chambre à deux lits. L’hôtelier et les servantes de l’hôtel le regardèrent d’un air placide. Personne ne le comprenait. Cependant, on le fit monter au premier étage, on ouvrit devant lui la porte d’une chambre où se dessinaient, derrière des rideaux de percale jaune, deux lits de merisier. Il fit signe que le logis lui convenait. La nuit était tombée ; Fougerel mangea un peu de venaison, but un verre d’Affenthaler, et Malapeyre se coucha sans rien prendre.
« Demain, disait-il, après un bon sommeil, je serai mieux ! »
Il voulut se lever le lendemain, vers dix heures. A peine debout, la tête lui tourna ; il dit tout haut :
« Qu’ai-je donc ? »
Et Fougerel accourut pour le soutenir au moment où il allait tomber. Une fois remis sur l’oreiller, Malapeyre se sentit mieux. Un sourire triste releva sa moustache, et il dit à Fougerel :
« Voilà un voyage niaisement interrompu. Pardonne-moi, au moins, mon vieil ami ! »
Fougerel haussa les épaules en souriant et affecta de rassurer son compagnon par de confiantes paroles ; mais, dans son for intérieur, il se sentait véritablement navré. Jamais il n’avait vu Malapeyre se courber ainsi sous la maladie. Robuste, courageux, bravant le mal, le vieux soldat mettait une sorte de coquetterie à demeurer toujours en santé. Il se moquait, ayant bravé les biscaïens, des fièvres, qu’il appelait des bobos. Pour terrasser un être trempé comme le capitaine, il fallait une affection grave, un mal puissant. Le pauvre Fougerel avait, d’ailleurs, les superstitions des soldats. Ces hommes, habitués à la mort, ont leurs faiblesses aussi : le héros tient de l’enfant. Ils sont anxieux ou rassurés selon que le premier obus ou le premier boulet leur siffle à l’oreille droite ou à l’oreille gauche. Fougerel se reprochait maintenant d’avoir dit à son hôtesse de Vernon : « Si nous ne revenons pas ! » Il lui semblait que cette parole suffisait pour qu’un des deux, en effet, ne revînt plus.
Sa première préoccupation, en voyant Malapeyre décidément alité, fut de trouver un médecin. Il eût refusé pour lui tous les soins, prétendant que la médecine est la pire des maladies ; mais, pour son ami, il devenait croyant. Ce fut d’abord toute une affaire pour découvrir ce docteur. Personne, dans l’hôtel, n’entendait un mot de français ; Fougerel se heurtait à des Allemands qui le regardaient en ouvrant de larges bouches et de grands yeux. Alors, il s’emportait, et peut-être les autres mettaient-ils une véritable malice à ne le point comprendre. Le vieux soldat se sentait perdu dans cette ville, où il n’avait ni un ami ni un compagnon — personne — pour secourir avec lui le malheureux. Il lui prenait des colères sans raison ; il avait envie de repartir, d’emporter Malapeyre, de regagner Givet, de rentrer en France. Jamais la patrie ne lui avait semblé si chère, si attirante, si profondément bénie. La terre allemande lui brûlait les pieds.
Il parvint cependant à découvrir un médecin. C’était un vieux petit docteur fort savant, assez égoïste, n’aimant ni ne détestant les Français, dont il connaissait la langue, et tout entier à ses expériences. Il alla visiter Malapeyre, qui, en le voyant, bondit sur son lit et dit :
« Qui vient là ?… Je ne suis pas malade !
— Voyons, fit tout bas Fougerel, laisse-toi faire ; plus tôt tu seras guéri, plus tôt nous arriverons à Potsdam… au drapeau. »
Ce mot : le drapeau, faisait sur Malapeyre des miracles. Il lui avait donné l’énergie de continuer, quoique malade, sa route de Givet à Namur, puis à Aix-la-Chapelle et à Cologne ; il lui donna la patience de tendre le pouls au docteur, de se laisser examiner et ausculter. Le médecin ne disait mot. Pas un muscle de son visage ne remuait. Après avoir considéré le malade, il lui dit merci, prit à part Fougerel et lui annonça que le cas était excessivement grave.
« C’est un accès de fièvre bizarre ; le cerveau est congestionné. Il faudrait beaucoup de soins.
— J’en aurai, » dit Fougerel.
Il ne quitta plus dès lors le chevet de Malapeyre. Il demeurait dans la chambre, lisait ou, à la fenêtre, regardait passer avec colère des détachements de soldats prussiens, cuirassiers lourds, fantassins automatiques, dont Fougerel n’entendait jamais le pas sur le pavé sans éprouver une colère sourde. Et comme Malapeyre lui demandait alors quelquefois :
« Qu’est-ce que cela ? quel est ce bruit ?
— Ça ? répondait-il, ne fais pas attention… Des maçons qui passent ! »
Rien n’était plus touchant, d’ailleurs, ni plus triste que ces deux hommes, perdus dans une ville allemande, l’un mourant, incapable de bouger, l’autre incapable de se faire comprendre, et jetés ainsi, tombés dans une auberge où nul ne les savait au monde, où personne ne s’inquiétait de leur sort.
Que de fois Fougerel, qui, songeur, repassait au chevet de son ami tous les souvenirs de sa vie ; que de fois Malapeyre aussi, dans les rêves bizarres de sa fièvre, puis dans ses apaisements lucides, se disaient avec douleur que rien ne vaut le coin de terre où l’on est connu, aimé, où le chien familier court après vos pas, où les fleurs mêmes semblent vous reconnaître, le coin de terre qui est plus encore que la patrie, qui est le foyer dans la patrie !… Comme ils se sentaient seuls, isolés, dans cette ville où tout leur était étranger, les mœurs, les voix, les visages, où la langue de leur enfance était une langue inconnue ! et de quelle mélancolie amère ils étaient intimement pénétrés, lorsque le soir venait et que parfois l’écho funèbre des tambours prussiens, battant la retraite, leur parvenait, au lieu du gai clairon et du leste tambour français !
L’état de Malapeyre s’aggravait de jour en jour ; la fièvre n’était plus seulement menaçante, mais dévorante. Le pauvre homme avait désespérément maigri. Ses yeux brillaient d’un éclat de mauvais augure dans son visage si ouvert auparavant, maintenant creusé, méconnaissable. Malade, il avait toujours soif et trempait ses lèvres avec une avidité bestiale dans la tasse d’orangeade que lui tendait Fougerel. Très souvent il parlait avec une volubilité inquiétante, disant des mots bizarres, racontant des batailles que Fougerel ne connaissait pas. C’était le délire. Puis à ces fébriles accès succédaient des torpeurs profondes, des atonies comateuses, des sommeils qui faisaient peur. Combien de fois, regardant cette figure mâle, si franche et si française, ce profil amaigri de soldat assoupi par la fièvre, ce crâne chauve où l’on eût retrouvé la trace d’un coup de sabre, cette tête endormie qu’éclairait faiblement une lampe, Fougerel, en suivant sur la joue du malade la trace cruelle de la fièvre, sentit lentement une larme couler sur sa joue jusqu’à sa moustache, tandis qu’un soupir, gros comme un sanglot, soulevait sa poitrine !
« Pauvre vieux, murmurait alors Fougerel, étais-tu donc né pour mourir ici ? »
Parfois encore, le soir, tandis que Fougerel demeurait ainsi, aux côtés du malade, on entendait passer, dans la rue, quelque bande bruyante d’étudiants qui chantaient à pleine voix des chants de guerre. Il semblait à Fougerel que ces chansons bachiques, jetées au vent après un repas arrosé de bière, l’insultaient.
Il croyait souvent entendre, parmi ces mots allemands, ce nom belge : Waterloo. Le capitaine alors serrait les poings ou fredonnait en lui-même quelque refrain du pays, pour ne pas entendre, pour étouffer à son oreille les échos de la rue allemande.
Une nuit, Fougerel veillait. Malapeyre s’était endormi, après une journée de crise. Fougerel avait pris son repas à ses côtés, allumé la lampe, ouvert un livre français acheté la veille, et là, durant trois heures, Malapeyre n’avait point bougé. Il était une heure du matin environ. Fougerel, à la fenêtre, regardait à travers les vitres les silhouettes curieuses des vieilles maisons qui se dressaient devant lui, se découpant avec leurs toits élevés sur un ciel d’un bleu pâle, criblé d’étoiles, lorsque, en entendant un bruit vers le lit du malade, il se retourna. Malapeyre s’était mis sur son séant, et, le bras gauche appuyé sur l’oreiller, soutenant le poids de son corps, il étendait devant lui son bras droit, qui sortait, maigre et nu, de sa manche de chemise. Les yeux du capitaine étaient hagards et comme effrayés. Il ne disait rien, mais il désignait quelque objet, quelque vision, contre la muraille.
« Fougerel… Pierre, Pierre !… disait-il. Ote cela !… ôte cela ! Je t’en prie ! Je ne veux pas, je ne veux pas voir cela ! »
Fougerel s’était approché. Il prit Malapeyre par les épaules, forçant le malade à le regarder dans les prunelles, et, doucement :
« Voyons, dit-il, qu’as-tu ? que veux-tu ?
— Que tu enlèves cela !… C’est ce qui me tue, » dit Malapeyre en montrant du doigt deux gravures encadrées de bois jaune et suspendues à la muraille.
Ces gravures, Fougerel les avait aperçues déjà, mais sans les examiner de près, sans se rendre compte du sujet qu’elles représentaient. C’étaient deux reproductions de tableaux célèbres en Allemagne, l’une montrant la fin de la bataille de Leipzig, l’autre la poursuite de l’armée française vaincue, après Waterloo, par la cavalerie prussienne. Des deux côtés, même spectacle : des grenadiers prussiens, avec leurs schakos bas surmontés de pompons énormes, éventraient ici des fantassins français, tandis que là des hussards de la mort sabraient furieusement des grenadiers de la garde et leur enlevaient leurs aigles.
« Ote cela ! répétait Malapeyre ; ôte cela ! Ce n’est pas vrai, ils n’ont pas pris le drapeau, ils ne l’ont pas pris ! Tu l’as enterré, tu sais bien !… Enterré… Je te dis qu’ils ne l’ont pas pris !… Ote ces images, ôte-les ; elles mentent, Fougerel, tu sais bien qu’elles mentent ! »
L’état de Malapeyre était une sorte de délire terrible ; un moment, il se leva, droit sur son lit, montrant ses jambes amaigries aux nerfs tendus comme des cordes, et il voulut lui-même arracher ces tableaux insultants de la muraille. Il retomba, brisé, au milieu de son accès de rage, et demeura étendu de toute sa longueur sur son lit. Fougerel le couvrit, l’enveloppa avec des soins de mère. Puis il alla dans un coin de la chambre prendre une chaise pour atteindre les cadres où le mourant aurait pu lire ces noms sinistres : Leipzig. Mont-Saint-Jean !
Au moment où il s’approchait encore du lit, son regard rencontra le regard de Malapeyre, mais non plus menaçant cette fois, ni en quelque sorte fiévreux, mais calme, triste, presque attendri. Le délire avait cessé brusquement, faisant place à cet apaisement affaibli, comme tomberait un voile. Fougerel recula et se sentit troublé : il lui semblait que dans les yeux tout à l’heure enflammés de Malapeyre brillait maintenant une larme. Le moribond sortit alors de dessous sa couverture sa main maigre et la tendit à son vieil ami :
« Que tu es bon ! dit-il d’une voix pénible, lente et grave ; que tu es bon, mon pauvre Fougerel ! Te voilà garde-malade, à présent. Console-toi, ajouta le moribond après un soupir, tu n’as pas longtemps à faire ce métier. C’est fini. Je sens que c’est fini.
— Es-tu fou ? dit le capitaine. Ah ! c’est bien intelligent ce que tu dis là ! Je t’en fais mon compliment.
— Sans doute, reprit Malapeyre, c’est peut-être triste ; mais c’est vrai. Je te rends malheureux en te faussant compagnie ; ce n’est point ma faute. Ah ! Fougerel, si je regrette quelqu’un au monde, mon brave et bon Fougerel, tu peux bien dire que c’est toi !
— Tu n’as rien à regretter ; tu n’es pas mort, sacrebleu, et avant dix jours tu seras à Potsdam. Entends-tu, Potsdam ?
— Oui, oui, répondit Malapeyre en hochant la tête. Je sais bien, c’est la terre promise, mais on n’y entre pas comme on veut. Je sens que je n’irai pas plus loin, mon pauvre ami… Tu sais que j’ai déjà failli mourir une fois dans ce pays-ci, à l’hôpital de Mayence, blessé, à demi perdu, en 1813. Il paraît que ma destinée était de rester en Allemagne. Ce qui me navre, ce qui me torture, Fougerel, c’est de tomber comme ça, en route, bêtement, sans avoir fait ce que tu sais… Toi, c’est bien, tu es heureux. Tu iras là-bas. Je t’envie cette joie-là. C’eût été bon de revoir le chiffon, de leur reprendre le drapeau qu’ils ont volé… Si je pouvais marcher, j’irais, fût-ce sur les genoux. Du moins, vieux, ne manque pas de faire ce que je vais te demander. Écoute ! tu as beau te faire illusion ou essayer de m’en conter, je m’en vais. A nos âges, des patraques comme nous sont tuées par un coup de vent, après avoir résisté aux coups de sabre. Eh bien, quand ce sera fini, Fougerel, quand tu ne m’auras plus là, continue ta route seul ; fais ce que nous voulions faire à nous deux. Arrache-le, ce drapeau du 1er grenadiers, et rapporte-le en France, et quand tu l’auras pris, quand il sera à toi, quand il sera à nous, alors reviens de ce côté, va vers le coin de terre où tu m’auras couché, et, frappant du pied, mon vieux camarade, à l’endroit où je dormirai, dis-moi seulement ces mots : « Le drapeau est repris, Malapeyre ! » Et je te jure bien que je t’entendrai ! »
Le vieux soldat avait lentement prononcé ces paroles, qui, dans le silence de la nuit, retentirent déjà comme des accents d’outre-tombe. Fougerel, qui ne se sentait point facilement ému d’ordinaire, eut comme un frisson le long du corps. Mais lorsque Malapeyre lui dit, après un court silence :
« Tu me le promets, n’est-ce pas ? »
Il se redressa, regarda son ami bien en face, et lui tendant sa large main :
« Je te le jure ! » répondit-il.
Le survivant recevait, grave et résolu, la consigne que dictait le moribond.
La nuit fut longue encore. Malapeyre s’affaiblissait de plus en plus. La fièvre des derniers jours avait décidément cessé, mais en laissant ce pauvre corps en proie à la prostration la plus grande. Le capitaine était à bout de forces. Il n’y avait plus de vivant en lui que ses deux yeux noirs, qui brillaient d’un feu étrange ; ses lèvres pâles tremblaient, et le mal avait en quelques jours émacié ce visage robuste, creusant d’un doigt cruel les tempes et les joues, et faisant saillir les pommettes. Parfois, lorsque Malapeyre, accablé, fermait enfin les yeux, et qu’il demeurait ainsi étendu, la bouche ouverte et les paupières closes, Fougerel se demandait avec effroi s’il était mort, et, s’approchant alors, il se penchait pour écouter la respiration du malade ; mais, au mouvement de son ami, le capitaine rouvrait les yeux et fixait sur lui ses prunelles ardentes, tandis que ses lèvres essayaient de sourire.
Le matin, vers l’aube, Malapeyre fut pris tout à coup d’un frisson singulier. Il porta la main à sa gorge et, d’un ton bas, demanda à boire, puis, comme Fougerel lui tendait, du bout de la cuiller, une potion, ses dents mordirent durement le métal, et il repoussa avec un geste sec le bras de son ami. D’un mouvement saccadé, il s’était redressé encore une fois, et désignant toujours les images appendues au mur : « Non, non, dit-il d’une voix rauque… C’est faux !… Ils sont trop !… Le drapeau… » Il répéta encore, avec un accent à la fois plein de menace et de déchirement ce mot, le dernier qui vint à ses lèvres : Le drapeau ! et il retomba, raide, les yeux fixes, sur l’oreiller.
Fougerel lui avait pris la main ; il la sentit se contracter, se serrer, et, le regard abaissé sur ce mort, le capitaine demeura debout, laissant couler silencieusement ses larmes et sentant les doigts de Malapeyre se glacer entre les siens.
Le jour entrait, furtif et pâle, dans cette chambre, où la lampe jetait maintenant des lueurs intermittentes et mourait à son tour. Un rayon blafard se posait sur le visage mâle et fier de Malapeyre, et rendait ses orbites plus caves, ses joues plus creuses. Fougerel en avait bien vu, des morts et des mourants, dans ses années de guerre ; il avait vu tomber, ensanglantés, et demeurer immobiles, dans leurs poses étranges de foudroyés, bien des compagnons, bien des amis ; mais, cette fois, ce n’était pas seulement un frère d’armes qui tombait : c’était sa propre existence qui se dédoublait et se déchirait. Qu’il était seul maintenant, noyé, perdu dans l’immense foule ! La mort lui prenait la moitié de son être. Il restait là, cloué au parquet, regardant à travers ses larmes ce soldat mort, dont l’agonie, sur ce lit allemand, avait eu pour témoins les images des deux défaites : Leipzig et Waterloo !
Fougerel demeura ainsi, absorbé longtemps. Deux ou trois petits coups secs, frappés sur la porte, le tirèrent de son atonie. Il répondit machinalement :
« Entrez. »
C’était le docteur, le petit docteur, froid, impassible, qui doucement demanda :
« Eh bien ?
— Voyez, » répondit Fougerel en lui montrant le mort.
Le médecin fit simplement un ah ! sans étonnement, et après avoir considéré un moment le cadavre :
« Eh bien, monsieur, dit-il, n’ayant pu le sauver, je me mets du moins tout à votre disposition pour vous faciliter les détails, toujours ennuyeux, et surtout pour un étranger, de l’inhumation. »
Fougerel éprouva tout d’abord, devant ce calme et cette indifférence, une colère sourde, et il se demanda s’il n’allait point précipiter le petit homme par la fenêtre ; mais il songea qu’après tout le médecin n’avait aucune raison de s’émouvoir et qu’il faisait, au contraire, ce qu’il pouvait pour être aimable. Alors il remercia, et, machinalement, il suivit le docteur à travers les bureaux, les agences où devaient être reçues les déclarations.
Fougerel, déjà irrité par son séjour en Allemagne, était rendu plus nerveux par cette mort soudaine et cet implacable malheur. Il allait et venait dans les rues de Cologne comme un aveugle, ne voyant et n’entendant rien, suivant sa pensée avec une persistance douloureuse.
La souffrance qu’il éprouvait de la perte de son ami se trouvait doublée par cette mort en pays étranger, Fougerel eût dit volontiers en pays ennemi. « Il y a, sur le sol natal, des endroits bénis où la fin semblerait plus douce. On s’y endort, on meurt chez soi, » songeait Fougerel. Il avait eu l’idée de ramener le corps de Malapeyre au pays ; mais, outre que c’était long, difficile, et que Potsdam attendait, l’éternelle question d’argent était là ! « Après tout, se disait le capitaine, le vieil ami ne sera pas le seul. Tant d’autres pauvres diables sont morts avant lui, sur cette rive… autrefois… et dites-moi pourquoi. »
Il passa toute sa journée à courir dans cette ville inconnue.
Le petit docteur l’avait quitté, lui ayant donné tous les renseignements désirables ; mais Fougerel avait oublié vite, et, dans le dédale des ruelles et des couloirs, il lui fallut se débattre, chercher, demander, s’irriter, pour obtenir qu’on lui permît de donner une tombe à son ami. Il souffrait, le malheureux, à se voir ainsi forcé de parlementer avec des employés au ton rogue, avec des Prussiens à l’air railleur. Il se sentait secoué par d’âpres colères, bientôt refoulées ; il n’entendait rien à ces noms qu’on lui dictait ; il éprouvait l’immense souffrance de l’isolement, décuplée, cette fois, par une des plus profondes douleurs qu’il eût ressenties de sa vie. Le soir, brisé, las, pâle et défait, il rentra à son hôtel, qu’il eut de la peine à retrouver. Les gens de la maison le reçurent cette fois avec une politesse affectueuse. Il y avait tant de désolation sur ses traits que son rude visage en devenait imposant et beau. Il mangea du bout des dents, salua ses hôtes et monta à sa chambre. Du bas de l’escalier, une des servantes lui demanda s’il fallait faire un lit pour lui dans une autre chambre :
« Non, dit-il, merci. Je veillerai. »
On avait jeté sur le corps de Malapeyre ce drap blanc des morts dont les plis rigides prennent des aspects de marbre. Un peu d’eau bénite était sur une table, auprès du cadavre. Fougerel regarda ce lit mortuaire et soupira. Puis il s’assit. Il prit un livre et ne put lire. Alors il demeura là, rêvant, les yeux rivés à ce suaire, et la pensée amèrement emportée vers les souvenirs d’autrefois, les nuits de bivouac, les journées de bataille, et les longues et chères promenades aussi, les paisibles soirées de Vernon. Que de temps passé ! que tout cela était loin ! Quelle succession d’amertumes que la vie ! Mais, à travers ces pensées, une idée impérieuse revenait et se refaisait sans cesse sa place. Fougerel entendait encore et toujours la suprême parole du mort, et, au milieu du bourdonnement et du tintement que causaient la fatigue et l’espèce de vide de son cerveau, il lui semblait entendre répéter souvent ce mot : Le drapeau !
Fougerel, accablé, s’assoupit un peu vers le matin. Lorsqu’il s’éveilla, les porteurs de la bière et les ensevelisseurs arrivèrent. Le capitaine demeura là, voulut être présent durant les apprêts lugubres. Lorsqu’il vit son ami couché dans le cercueil comme un chevalier dans une armure, il souleva un coin du suaire, et, se penchant sur ce front de soldat, ridé, chauve et marqué d’un coup de sabre, il y posa ses lèvres, dernière accolade du frère d’armes au frère d’armes. Puis, jusqu’à la fin, il resta debout et l’air résolu.
Ce jour-là, le ciel, voilé depuis la veille, était devenu pluvieux. De petites gouttes d’une sorte de bruine froide tombaient, délayant la boue dans les rues. On put voir, traversant Cologne pour se rendre au delà du Hahnenthor, sur la route d’Aix-la-Chapelle, vers le cimetière, le triste convoi d’un inconnu derrière lequel, seul, la tête découverte, marchait un homme en cheveux blancs.
Le capitaine Fougerel ne prêtait aucune attention à ce qui se passait autour de lui ; il marchait, invinciblement attiré par cette bière qu’on portait devant lui ; cependant il remarqua que les passants ne se découvraient pas devant le mort comme en France.
« On ne te salue guère, mon pauvre Malapeyre, pensait-il. Dans notre petite ville de Vernon, tu aurais eu le piquet de troupiers pour faire escorte à ton ruban de la Légion d’honneur ! Après tout, je suis là, mon vieil ami, et cela te suffit, je gage ! »
Les passants devenaient sérieux à regarder cet homme qui marchait ainsi, inconnu de tous, sous la pluie, à travers les rues encombrées, et ils murmuraient tout bas :
« Un Français ! »
Au coin du cimetière, dans un angle paisible, loin des tombes monumentales, à côté d’humbles tumuli couverts de lierre et de fleurs, le capitaine fut placé, tandis que Fougerel, mordant avec douleur sa lèvre inférieure, ne pensait déjà qu’à ce jour prochain où il reviendrait, là, à cet endroit même, tenir le serment fait au mort et lui dire :
« Malapeyre, le drapeau est repris ! »
Lorsque tout fut achevé, Fougerel demeura encore un moment devant la tombe fermée.
« Mon pauvre Malapeyre, dit-il tout haut, mon vieux camarade !… Allons, ajouta-t-il avec un geste assuré, à bientôt ! »
Et il regagna le logis où il avait laissé une partie de sa vie.
En rentrant dans la chambre mortuaire, il la trouva immense, glacée. Ses pas dans cette vaste salle lui semblaient résonner comme sous des arceaux. En regardant le lit, maintenant recouvert d’une banale couverture de percale à fleurs en attendant un voyageur nouveau, ses yeux rencontrèrent les deux gravures dont la vue avait irrité cruellement le pauvre Malapeyre.
Cette fois, Fougerel atteignit les cadres insultants et, d’un coup de talon, les brisa au milieu de la chambre ; puis, heureux, avec des yeux pleins de larmes, il trépigna dessus avec une amère joie.
Le lendemain, il les fit mettre sur la carte.
L’aubergiste, flegmatique, ne laissa échapper aucune marque d’étonnement. Il ajouta, en le doublant, au total de la note, le prix des gravures.
Fougerel repartit aussitôt. Il avait hâte, en agissant, en recherchant le mouvement et la lutte, de secouer la tristesse profonde qui s’était emparée de lui.
Lorsque, au détour de la route, Fougerel vit disparaître, derrière un pli de terrain, la haute masse du Dom inachevé, il ne put s’empêcher d’éprouver ce serrement de cœur qui vous saisit lorsqu’on laisse derrière soi un coin de terre adoré.
Il avait regardé longtemps l’entassement des maisons, les flèches des églises, les ponts immenses jetés sur le vieux Rhin, et, dans ce tas de logis inconnus, de pierres et de rues, il cherchait toujours à deviner l’emplacement silencieux où dormait Malapeyre.
Cologne s’effaça au loin. Il répétait machinalement :
« Cologne ! venir mourir à Cologne ! »
Et cette ville étrangère lui paraissait à la fois haïssable et amie, car elle lui prenait — mais lui gardait aussi — la moitié de son cœur.
Puissance de l’idée fixe, de la volonté, de l’acharnement à un devoir ! Fougerel, à mesure que la petite diligence, étouffante et cahotée, qui l’emportait vers la Prusse, avançait, Fougerel ne songeait plus qu’à l’œuvre insensée qu’il voulait tenter, et il lui semblait que Malapeyre était toujours à ses côtés pour lui dicter sans cesse le mot d’ordre. Arrivé à Berlin, Fougerel se sentit pris de colère, devant cette capitale à l’aspect de caserne, pleine de soldats corrects et d’officiers insolents, ville de résidence de caporaux et de courtisans. Dès le premier jour, il prit des informations pour savoir comment on pouvait aller à Potsdam. On lui indiqua l’heure à laquelle partait la diligence, et le lieu où il pourrait la prendre. Un interprète débattit pour lui avec le cocher le prix voulu, aller et retour. Fougerel ne se souciait plus de converser avec des Allemands ; il éprouvait une sorte de rage à entamer ces dialogues, où il ne se faisait point comprendre. Le lendemain matin, rasé de frais, ganté, sanglé comme un jour de revue (et c’était un jour de bataille), le capitaine Fougerel partit pour Potsdam, où il allait se trouver enfin dans quelques heures.
Il avait la fièvre ; il fredonnait en lui-même un refrain d’autrefois ; il avait l’impatience de l’homme qui touche à la minute décisive de sa vie. Il pensait à Malapeyre aussi ; il regrettait jusqu’au profond de l’âme qu’il ne fût point là, à ses côtés.
« Pauvre ami, c’eût été sa grande joie ! »
Car il ne doutait pas, chose singulière, que le drapeau du régiment ne fût bientôt à lui. C’est un privilège de l’extase qu’elle rend tangible une impossibilité.
Il ne se demandait même point comment il ferait pour atteindre le drapeau, pour l’arracher à l’ennemi, pour l’emporter. Il était certain que le drapeau lui appartiendrait. Il le sentait déjà, pour ainsi dire, entre ses mains, et la soie frissonnait par avance sous ses baisers.
Il éprouva pourtant une émotion profonde et grave lorsque, la voiture s’arrêtant, le conducteur jeta ce nom :
« Potsdam ! »
Potsdam ? C’était donc là !
Il ne savait de toute la langue allemande que le nom de l’église où se trouve, dans cette ville solennelle et régulière, ornée d’arcades, de palais, de statues, le tombeau de Frédéric le Grand, la Garnisons-Kirche. Un passant la lui indiqua du doigt.
La Garnisons-Kirche, à Potsdam, nue et grise, comme toute église protestante, n’aurait rien de remarquable à coup sûr, si elle ne contenait le tombeau du grand Frédéric. C’est un temple froid et clair, avec des bancs et des galeries de bois, des murs sans ornement, des verrières sans couleur. Quelque chose comme une église de campagne. Le cercueil du roi emplit, semble-t-il, ce lieu sans grandeur. Il est de plain-pied avec le visiteur, ce tombeau devant lequel s’arrêta le vainqueur d’Iéna, pensif et satisfait. Au milieu de l’église, dans un caveau factice en forme de chapelle, le tombeau, d’aspect noir, en étain, sans ornements, apparaît, faisant face au cercueil paternel, à travers la grille de fer qui le sépare de l’église et de l’accès du public. Jadis figuraient là l’épée et les décorations de Frédéric le Grand. Napoléon, en 1806, les fit emporter. Et comme un des siens lui conseillait de mettre à son côté l’épée du grand Frédéric : « Imbécile ! répondit l’empereur, blessé dans sa vanité. A quoi bon ? J’ai la mienne ! »
La Prusse a fait à son roi des trophées de nos drapeaux. Deux trophées d’étendards captifs ornent la chaire ou chapelle de marbre qui surmonte le sépulcre royal.
Au-dessus de cette chapelle, une sorte de galerie s’élève, dominant le tombeau ; on y parvient à droite et à gauche par un escalier, et, arrivé à la galerie, on aperçoit alors au-dessous de son regard les dalles noires et blanches de l’église, la grille qui s’ouvre sur le caveau du roi, les deux faisceaux de drapeaux français, de ces drapeaux de la Grande Armée, aux couleurs fanées, aux franges déchirées par les balles, et qui pendent, carrés, à leurs hampes bleuâtres. Les plis poudreux de ces drapeaux des grandes guerres arrivaient alors jusqu’à la portée de la main des visiteurs. Depuis quelques années, une sorte de balustrade en sépare davantage le public. En se penchant sur la galerie, on pourrait cependant encore toucher cette soie déchirée, déchiquetée dans le combat, et qui répand comme une odeur de salpêtre et de poussière. Ces trophées des victoires de Blücher étendent ainsi leur ombre sur le sommeil du roi philosophe. Les petits-neveux du vainqueur de Rosbach témoignent de leur haine contre les vainqueurs d’Iéna.
Tout cœur français se sentirait durement frappé à la vue de ces drapeaux, arrachés aux mains crispées des morts de Waterloo. En entrant dans la Garnisons-Kirche, Fougerel, pâle, contenant, sous une froideur feinte, l’émotion la plus profonde qu’il eût ressentie de sa vie, avança lentement, les veines glacées, et tout d’abord ses yeux s’arrêtèrent sur le tableau des médaillés de 1813 morts à Potsdam, invalides de la guerre de l’indépendance allemande, dont on encadre les médailles en souvenir de leurs hauts faits. Le capitaine regarda cela, s’avança ensuite jusqu’à la grille de la chapelle, puis il s’arrêta brusquement. Au-dessus de lui, là, dans la lumière presque insultante d’un rayon de soleil, il avait vu enfin des drapeaux tricolores, des drapeaux français, avec leurs lettres d’or et leurs inscriptions. Un coup de couteau ne lui eût pas fait plus de mal. Il se sentit pris d’une rage profonde en les regardant, ces drapeaux, noircis et funèbres comme des crêpes de deuil. Il lui fallut demeurer un moment immobile, tant son émotion était grande. Le sang lui montait au front et battait à ses tempes. Puis le capitaine revint à lui, et il passa sur son crâne, qui brûlait, sur ses yeux gros de larmes, sa main tremblante, lorsqu’un vieillard presque gigantesque, maigre, sec, la moustache rude, coiffé d’une casquette à cocarde noire et blanche et portant une longue capote grise de sous-officier, s’approcha, et, après l’avoir un moment considéré, lui dit d’une voix gutturale :
« Monsieur est Français ? Monsieur veut visiter ?
— Oui, » répondit alors Fougerel en secouant son émotion terrible.
Le gardien fit quelques pas vers la chapelle, l’ouvrit, alluma une chandelle, puis s’arrêtant brusquement devant le tombeau, sur lequel tombait la lumière, et, prenant instinctivement la pose correcte et machinale du soldat prussien à l’exercice, il commença d’un ton de litanie l’explication qu’il donnait, depuis bien des années, aux visiteurs. Il détailla les hauts faits du roi de Prusse, le récit de ses combats ; puis, désignant les trophées suspendus au dehors, il entama machinalement le récit de la bataille de Waterloo, où les drapeaux français avaient été conquis ; mais au moment où il prononçait ce nom de défaite :
« Inutile, interrompit Fougerel, je sais… j’y étais…
— Ah ! » fit le sous-officier en demeurant immobile.
Il se fit un silence glacial entre ces deux hommes. Le capitaine, l’œil fixe, ne disait mot. Tout à coup le Prussien, au bout d’un moment, demanda tout bas à Fougerel :
« Quel régiment ?
— 1er grenadiers de la garde. Dernier carré !
— Ah ! dit encore le Prussien, c’est mon régiment qui vous a chargés…
— Quel régiment ?
— Hussards noirs ! »
Le capitaine ne répliqua pas, mais il redressa sa haute taille, et, regardant le gigantesque sous-officier droit dans les yeux, il fit vibrer dans l’éclair de ses prunelles toute sa rage concentrée, toute sa fureur passée, toute sa douleur présente ; et, devant l’électricité farouche de ce regard, le gardien baissa lentement ses paupières sur ses yeux d’un bleu gris et froid.
C’était comme une flamme de la lutte ancienne, qui brillait et incendiait encore, montrant la profondeur sinistre de la haine amassée entre ces combattants d’autrefois, maintenant vieillis, cassés, courbés par l’âge. Après trente ans, la patriotique colère, la rage de la mêlée subsistaient dans toute leur fièvre ardente. Fougerel, raide, superbe, fit d’un pied assuré deux pas en avant.
« De là-haut, — dit froidement le gardien en relevant un peu la tête et en montrant la galerie, puis l’escalier qui y conduisait, — on voit mieux les drapeaux. »
A ce moment même, la porte de la Garnisons-Kirche s’ouvrait et se refermait avec bruit. C’était une famille de touristes anglais qui y entrait en parlant très haut. Le sous-officier, avec cette avidité de valet qu’ont la plupart de ses compagnons d’armes, quitta un moment le capitaine pour aller recevoir les visiteurs, dont il attendait sans doute un pourboire plus considérable, et Fougerel en profita pour sortir de la crypte, et gravir aussitôt les marches qui conduisaient au premier étage. Son cœur sautait sous son habit boutonné. Une fois arrivé sur cette sorte de terrasse, le capitaine, en se penchant, eut comme un éblouissement. Là, près de lui, là, les aigles, dans la lumière, faisaient étinceler encore leur or poudreux ; les inscriptions glorieuses éclataient sur les drapeaux déchirés ; là, à portée de sa main, courbés en éventail devant le tombeau du roi prussien, les étendards de la vieille garde semblaient couchés comme des courtisans qui saluent un maître. Quelle âpre et violente douleur ! les revoir en ce lieu, captifs, offerts à la curiosité banale ou à l’ironie des foules ! Quelle fièvre aussi, quel immense rêve ! les sentir si près, les voir près de soi, les toucher !
Le sang de Fougerel battait horriblement, et une sorte d’angoisse lui serrait la gorge et le faisait vaciller sur ses jambes.
Il avait envie de s’élancer sur ces trophées et de les jeter bas, d’un coup violent, inouï, et de se précipiter avec eux dans le vide, les tenant embrassés, lorsque tout à coup, justement sur celui des drapeaux qui se trouvait le plus rapproché de la balustrade où il s’accoudait, le capitaine aperçut, luisant encore, le chiffre de son régiment, ce chiffre 1 des grenadiers.
Il le revit, ce lambeau superbe pour lequel il avait joué et voulu donner sa vie ; il le reconnut encore à cette hampe brisée, dont une balle avait emporté l’aigle, alors que le capitaine l’agitait dans la fumée. Le drapeau ! c’était le drapeau du régiment, le drapeau lacéré, déchiqueté, ramassé sur les corps étendus, et recousu, pour la plus grande gloire de la Prusse, par les jolies mains d’une princesse allemande.
« Malapeyre ! Malapeyre ! » murmura instinctivement Fougerel.
Il se sentait poussé par un sublime vertige ; il se pencha sur la balustrade, atteignit de sa main droite fiévreusement étendue le drapeau dont la soie vieillie caressa ses doigts comme une peau de femme, et, le prenant alors à pleine main, d’un coup violent, tirant à lui l’étoffe sacrée, il l’arracha, la déchira rapidement, l’attira vers lui, la baisa avec une joie débordante, puis brusquement, comme s’il venait de commettre un forfait, il serra d’un geste prompt ce lambeau tricolore sur sa poitrine, boutonnant en hâte sa redingote, et se redressant tout à coup, tandis que là-bas, dans l’église, le sous-officier-gardien disait en anglais aux nouveaux visiteurs :
« Approchez, s’il vous plaît ; le tombeau est au milieu. »
Fougerel, pareil en ce moment à un prêtre croyant qui vient de recevoir l’hostie, descendait déjà les marches qu’il avait gravies tout à l’heure, et, ému jusqu’aux os, étouffant son immense joie, il ne songeait qu’à regagner la porte de l’église et la rue.
Au bas de l’escalier, devant la grille du tombeau, il se heurta contre le gardien, qui le regardait, l’air obséquieux, la main tendue. Fougerel lui donna au hasard, sans le regarder, une pièce de monnaie (le gardien dit depuis que c’était un louis d’or) ; puis, brusquement, le capitaine alla droit devant lui jusqu’à la porte extérieure. Il étouffait. L’air du dehors le frappa en plein visage, frais et bon. Fougerel ôta son chapeau et se mit à marcher tout droit, à travers la place, d’un pas rapide, ne songeant plus à la voiture qui l’avait amené, ne pensant à rien qu’à fuir, qu’à emporter, à cacher, à dérober sa conquête. L’idée qu’il avait volé quoi que ce fût ne lui venait pas : il n’avait que la joie du soldat qui a emporté une position d’assaut, et qui se retrouve sain et sauf, après la victoire. Ce drapeau sur la poitrine lui causait une chaleur réchauffante. Le capitaine rayonnait, et cependant son cœur battait à coups précipités. Le carillon de la Garnisons-Kirche se mettait justement à jouer en sautillant un air guilleret, heureux, un air français. Fougerel l’entendait. Il lui semblait que le carillon joyeux célébrait son triomphe. Il avançait à grands pas, comme à la charge. Ces rues droites de Potsdam, tirées au cordeau, semblables à celles de Versailles, lui paraissaient interminables. D’ailleurs, il ne voyait rien, il avait devant les yeux comme un voile. Il allait. Un contentement vaste, profond, absolu, l’inondait d’une joie qu’il n’avait jamais ressentie, joie de fiancé enlevant sa fiancée, joie de poète touchant à son rêve, joie de fou embrassant sa chimère, ou plutôt joie plus profonde et plus grave, la joie faite de volonté du soldat qui vient, en dépit de tout obstacle, d’accomplir son devoir et de gagner la bataille.
Tout à coup, derrière lui, Fougerel entendit une clameur, un bruit de voix, des cris, le choc de talons lourds sur le pavé, et, livide, en se retournant, il aperçut un groupe d’hommes qui, du bout de la rue, couraient vers lui en criant. La seule pensée de Fougerel fut celle-ci :
« Il est perdu ! »
Il ne songeait qu’au drapeau ; il s’oubliait lui-même. Presque en même temps, la pensée lui vint de jeter au hasard dans quelque puits ou quelque trou, n’importe où, le drapeau qu’il avait enlevé. Il lui avait semblé, en venant, traverser une rivière. C’est la Havel, qui arrose Sans-Souci. Où se trouvait-elle ? Il eût, en roulant l’étendard autour d’une pierre, jeté ces lambeaux au courant de l’eau. Cette idée lui venait, tandis que, hâtant le pas pour fuir, il entendait les cris se rapprocher et redoubler. En courant, il se trouva brusquement devant le petit canal qui traverse la ville. Il se crut sauvé, ou du moins il crut sauvée l’étoffe tricolore qu’il avait conquise. Il s’arrêta court, chercha du regard un caillou, un objet quelconque, et, glissant sa main sous son vêtement, il y sentit la soie frissonnante, lorsque tout à coup, débouchant de l’angle d’une rue transversale, rouges, essoufflés, trois ou quatre sous-officiers prussiens, sortant de la caserne qui est proche, se précipitèrent sur le capitaine en hurlant des menaces.
Fougerel dégagea ses mains et, faisant quelques pas en arrière, s’adossa aussitôt à la muraille d’une maison : là, blême et menaçant, les yeux embrasés sous ses rudes sourcils, la moustache hérissée, les poings fermés, le grand vieillard attendit l’attaque des soldats, qui reculaient devant son regard.
« Vous ne l’aurez pas, disait-il ; lâches ! vous ne l’aurez pas ! »
Mais déjà la foule grossissait autour du Français. Le gigantesque gardien de la Garnisons-Kirche accourait, ameutant les passants, criant : A mort ! et montrant son poing osseux au capitaine, dont l’attitude menaçante demeurait pareille à une statue. Les injures, les cris, les hurlements se croisaient autour de Fougerel ; pourtant on n’attaquait pas encore, lorsque le sous-officier géant poussa par les épaules les soldats qui se trouvaient devant lui, et les jeta littéralement sur le capitaine. Alors, décidé à se laisser déchirer, assommer par ces furieux, Fougerel disputa sa vie et ce qui était plus que sa vie — le drapeau — aux soldats, dont les poings le prirent au cou, dont les souliers le frappèrent aux jambes. Il serrait contre sa poitrine le drapeau que d’autres mains tentaient de lui reprendre. Les doigts crispés sur cette étoffe sainte, il sentait les ongles des assaillants lui labourer la chair :
« Lâches, criait-il encore, vous ne l’aurez pas ! vous ne l’aurez pas ! »
Les soldats le poussaient furieusement contre la muraille.
« A coups de sabre ! » cria le sous-officier.
L’un d’eux dégaîna, et Fougerel sentit la lame de fer lui tomber sur la joue. D’autres le prenaient par les jambes et le renversaient. Cette meute l’eût mis en lambeaux sans remords.
« Misérables ! » cria le capitaine dont le sang coulait…
Il murmura encore quelques mots : « Malapeyre ! mon pauvre Malapeyre ! le drapeau… » et s’évanouit, perdant son sang.
Blessé à la tête, les soldats voulaient l’achever. L’arrivée d’un officier le sauva. On le porta à l’hôpital ou plutôt à l’infirmerie d’une prison. Quand il revint à lui, ce fut pour répondre aux questions que lui posèrent des juges instructeurs. D’abord il ne voulut pas se soumettre à l’interrogatoire ; il disait :
« Laissez-moi, fusillez-moi ; je ne vous connais pas ! »
Puis il se décida à dire pourquoi il avait arraché le drapeau :
« J’avais juré de le reprendre. »
Il ne donna plus, dès lors, d’autre raison. Lorsqu’il fut guéri, on le mit au cachot. Il y resta six mois, pendant qu’on instruisait son procès. L’affaire avait fait grand bruit ; les mangeurs de Français, comme s’appelaient alors les imitateurs de l’écrivain Menzel, en tiraient un parti considérable dans les gazettes. Fougerel, lui, ne sortait plus de son mutisme sombre. A la fin, l’ambassadeur de France intervint dans ce débat et laissa entendre que les six mois de prison préventive suffiraient bien à punir le capitaine. Il obtint que Fougerel serait mis en liberté, ce qui fit, à cette époque, accuser de faiblesse le gouvernement prussien. Lorsqu’on lui annonça ce résultat, Fougerel ne laissa paraître aucune joie. Il dit seulement :
« C’est bien. »
Une escorte de gendarmes prussiens le reconduisit jusqu’à la frontière. Il demanda à Cologne, la permission de s’arrêter une journée, une après-midi, une heure, afin d’aller au cimetière.
On lui refusa cette faveur.
Et, lui, hochant la tête :
« Après tout, se dit-il, cela vaut peut-être mieux. Qu’irais-je dire à Malapeyre ? Je n’ai pas tenu parole ! »
A la frontière belge, il fut libre, mais sans éprouver aucun sentiment heureux en recouvrant cette liberté. Il lui semblait maintenant que sa vie était finie, manquée, usée, inutile. Jamais, même après les désastres de son âge mûr, il ne s’était senti aussi profondément vaincu et humilié ! Lorsqu’il revit, à Givet, l’endroit où s’était assis Malapeyre, déjà malade, ce soir d’août où les moucherons volaient dans l’air, Fougerel sentit un sanglot lui monter à la gorge, et il pleura.
« Oui, dit-il tout haut, pleure, va ; maintenant, tu n’as plus que cela à faire ! »
Il revint à Vernon, et il éprouva une douleur profonde, mais silencieuse, en retrouvant dans la petite ville toutes choses en leur coin habituel, les mêmes gens, les mêmes pavés, tout, excepté l’ami qui lui rendait, en ce coin de France, la vie aimable et occupée. Comme ce petit logis de la vieille rue Saint-Jacques, plein de souvenirs de vingt années, où chaque objet rappelait le souvenir de Malapeyre, sembla triste et immense à Fougerel ! Il lui fallut conter à la vieille dame la mort de son ami. Elle écoutait, levait la main au ciel, disait :
« Pauvre monsieur ! »
Quand Fougerel eut fini, elle lui demanda doucement d’où lui venait sur la joue droite cette cicatrice qu’elle ne lui connaissait pas.
« Oh ! rien, répondit Fougerel. Un post-scriptum au passé, voilà tout. »
A partir de ce jour, il reprit peu à peu l’habitude d’aller comme jadis dîner à l’Hôtel d’Évreux et fumer sa pipe au Café de la Ville. On lui réservait toujours sa table, la table des capitaines. On le saluait, on le choyait. Il parlait peu et se promenait volontiers seul sur l’avenue de la Maisonnette, ou il allait jusqu’aux Valmeux, ainsi qu’autrefois avec son ami. Tout en marchant, on l’entendait parfois se parler comme à lui-même ou à un être imaginaire auquel il disait de temps à autre :
« Que veux-tu ? j’ai fait ce que j’ai pu. Il ne faut pas m’en vouloir. »
Souvent, à l’hôtel, il demandait, pendant son repas, un peu de malaga.
« Une larme, » disait-il.
Et il le buvait doucement en souvenir de l’ami mort. Puis il rentrait au logis, dépliait les vieux papiers laissés par Malapeyre, les relisait, hochait la tête ou encore regardait les épaulettes du capitaine, sa croix d’honneur et la capote portée à Waterloo, et s’occupant à rechercher dans le drap usé la trace de la balle qui avait blessé son ami :
« Voilà, disait-il. Oui ! En pleine poitrine. Et après avoir supporté ça, mourir d’une fièvre en voyage. Parodie que la vie ! »
Il vieillissait ainsi, de plus en plus triste, courbé. Les années passaient. Les petites filles que Fougerel avaient vues autrefois jouer à la corde dans le Bassin-Vert étaient devenues maintenant des femmes, des mères de famille, presque des grand’mères, dont les enfants jouaient aussi, à leur tour, sur le Bassin-Vert. Les petits garçons auxquels il apprenait en riant l’exercice étaient officiers, négociants, sous-préfets. La vieille dame qui louait le logis de la rue Saint-Jacques était morte. Tout changeait, grandissait, se modifiait ; une génération arrivait, d’autres partaient, et le vieux capitaine Fougerel, ridé, cassé, se traînant sur sa canne, allait toujours à la table des capitaines, donnant en passant son coup d’œil aux joueurs d’échecs ou de billard.
Il était maintenant plus qu’octogénaire, et le chagrin en avait fait un vieillard presque en enfance.
On l’entendait radoter et marmotter tout seul :
« Il ne faut pas m’en vouloir… Nous nous serions défendus à deux, voilà tout ! Mais à Potsdam, comme à Waterloo, ils étaient trop, va, vieux ! »
D’autres fois, il demeurait pendant les beaux jours, assis sur un banc, au soleil, le long des Avenues, le regard plongé dans une contemplation muette, ses yeux fatigués regardant devant lui sans voir, et sa main traçant machinalement sur le sable quelque plan de combat. En passant devant lui, les enfants marchaient à pas étouffés, mettaient leurs doigts sur leurs lèvres roses, et les plus raisonnables disaient aux plus petits :
« Taisons-nous ! c’est le capitaine Fougerel qui dort. »
Souvent aussi, le vieillard sortait de cette somnolence et de cette sorte de torpeur. C’était dans ses beaux jours et lorsqu’il consentait à parler. Alors sa figure ridée, mais encore mâle, s’animait et de sa voix grave et forte il donnait aux nouveaux le mot d’ordre des anciens :
« Sachez vous dévouer, vous autres ! Soyez généreux, quittes à être dupes. Soyez patriotes, quittes à être chauvins, comme les plaisantins disent. Aimez ce qui est beau, servez ce qui est bien. Ayez une foi, un drapeau, et mourez pour lui. Cela vaut mieux que de vivre sans lui. »
Puis il retombait dans son rêve.
Un soir du mois de juillet 1870, — il n’y a pas dix ans, et il y a dix siècles, — le capitaine Fougerel était allé machinalement, comme d’habitude, à la gare de Vernon, où, avec le train de Paris, arrivent chaque soir les nouvelles du jour. Non pas que le vieillard s’inquiétât beaucoup des nouvelles, mais c’était une promenade.
Il y était allé, courbé sur sa canne, traînant le pied, toussant et fatigué.
On le saluait en chemin, et il avait peine à rendre son salut.
En arrivant à la gare, il vit une foule compacte, il entendit un bruit inaccoutumé ; il remarqua que les regards des gens brillaient, que les gestes étaient saccadés et les mains fiévreuses.
Il demanda ce que c’était.
« Ce que c’est, capitaine ?… C’est la guerre !
— La guerre ? dit le vieillard en dressant l’oreille.
— La guerre avec la Prusse !… La guerre est déclarée ! »
Le capitaine Fougerel s’appuya, pour ne point tomber, à la grille qui borde la voie ; puis, blanc comme un linge, il se redressa brusquement, et, levant en l’air sa canne dont maintenant il n’avait plus besoin pour se soutenir, il poussa d’une voix forte un grand cri :
« Vive la France ! »
On vit alors le vieux soldat, tout à l’heure brisé, courbé, débile, retrouver une énergie suprême et marcher presque rapidement vers la ville, en faisant tournoyer son bâton de vieillesse entre ses doigts ridés.
Il parlait tout haut, et d’une voix ferme :
« Malapeyre ! mon vieux Malapeyre, disait-il, le drapeau, eh bien ! le drapeau, nous allons le reprendre enfin cette fois ! »
Pendant le repas, à l’Hôtel d’Évreux, le vieux soldat, pris d’une fièvre généreuse, rayonnait.
Il fit apporter du malaga pour toute la table, et l’on but bravement à l’armée qui partait, aux victoires futures. Quant à la défaite, qui y songeait alors ?
Comment ! un gendarme allemand passerait, flegmatique et lourd, à travers une campagne française marquée du fer de son cheval et lugubrement trouée de croix mortuaires ? Était-ce possible ?
« A la victoire des nouveaux ! » répétait Fougerel, dont la voix ardente vibrait comme un clairon.
Puis, après la soirée au café, prenant son chapeau et l’enfonçant d’un coup sec sur son front, le capitaine rentra en son logis, répétant tout haut dans les rues désertes :
« Le drapeau, ils nous le rapporteront, entends-tu, Malapeyre ? »
Et le vieux soldat s’endormit sur ce rêve.
Le lendemain, la ville de Vernon apprenait, avec une émotion profonde, que le vieux capitaine Fougerel avait été trouvé, le matin, dans son lit, frappé d’une attaque d’apoplexie.
Le vieillard était mort le sourire aux lèvres.
Depuis ce temps, personne ne s’assied, là-bas, à la table des capitaines.
Paris, 1873-1878.
— 1792 —
Au mois de mars 1793, les troupes de l’armée de Custine, casernées dans Mayence, qu’elles avaient arraché à l’ennemi, reçurent du général en chef l’ordre de sortir de la ville et de se replier sur les Vosges. Au besoin, Custine voulait s’enfermer dans Strasbourg pour y résister à l’armée prussienne qui venait de passer le Rhin et s’avançait, disait-on, formidable. Quelques bataillons de volontaires, renforcés d’artillerie, avaient déjà quitté la place, et campés en hâte sous Mayence, attendaient le jour avant de se remettre en marche, tandis que les Prussiens, au lieu de leur livrer passage pour les entourer et les écraser ensuite, se préparaient simplement à leur barrer le chemin.
Le camp dormait. On distinguait, dans la nuit, les grands plis droits des tentes grises. Les canons sur leurs affûts allongeaient leurs gueules puissantes. Un rayon indécis parfois venait frapper les cuivres et l’on apercevait vaguement des reflets jaunes. Sur le ciel les caissons se découpaient nettement, et l’on eût dit, à voir les rayons immobiles et noirs des grandes roues, d’immenses toiles d’araignées suspendues là-bas et guettant. Point de bruit, un calme mystérieux et inquiétant : ces bataillons, couchés pêle-mêle sur la terre et sous les arbres, semblaient retenir leur souffle et se dissimuler. Des lumières adoucies, trouant d’un reflet livide la toile verdie, comme une tache d’huile sur un papier brouillard, révélaient seules qu’il y avait, par là, sous les tentes, des êtres vivants. Les sentinelles marchaient d’un pas assoupi le long des batteries. On voyait aller et venir, sans presque l’entendre, quelque artilleur, son arme entre ses bras croisés, son sabre battant son mollet gauche. Il baissait la tête et songeait, ou dormait, tout en marchant. Une paillette égarée, un reflet douteux venait s’accrocher parfois au brillant de ses armes. C’était tout. Et près de là, noires et comme attentives, une file de voitures d’ambulance, avec les trousses en bataille sans doute, les bistouris aiguisés pour ouvrir les chairs, et les bêches et les pioches, toutes prêtes pour enterrer les morts.
Étendus au hasard, jetés pour ainsi dire à terre, quelques soldats, encore éveillés, parlaient tout bas, couchés sur le sol, avec une pierre pour oreiller. D’autres, accroupis autour des feux, dormaient, leur fusil entre les jambes, leur tricorne enfoncé sur les yeux, dans l’attitude des momies mexicaines. Des officiers passaient, enveloppés dans leurs grands manteaux et frappant du pied pour se réchauffer. Seul, assis contre un arbre, à deux pas des voitures d’ambulance, un jeune homme, le regard fixe et comme perdu dans la nuit, songeait. C’était un volontaire, arrivé de Paris depuis fort peu de jours, le citoyen Michel Verdure, un mois auparavant homme de loi, avocat, et maintenant soldat au service de la patrie.
Il n’avait pas vingt-cinq ans. De grands cheveux noirs tombaient sur le collet de son uniforme ; un visage maigre, intelligent et fier, de grands yeux embrasés d’enthousiasme et point de barbe. Il ressemblait à un Saint-Just brun. Michel avait là-bas, à Paris, dans cet autre terrible et bouillant champ de bataille, un vieux père, ex-greffier au Châtelet, et qui, timide, facilement effrayé, royaliste d’ailleurs par reconnaissance et par habitude, avait poussé les hauts cris lorsque la fièvre révolutionnaire, cette irrésistible fièvre, s’était emparée de son fils.
C’était peut-être à lui que songeait le volontaire. Il avait pleuré, le vieillard, lorsqu’un matin de février, sous la neige, avec d’autres jeunes gens des faubourgs, Michel était parti, chantant la Marseillaise. C’était une carrière brisée. Le bonhomme maintenant resterait seul et n’aurait d’autre but à Paris que d’aller, sur une tombe du cimetière des Enfants-Rouges, converser (comme si elle entendait encore) avec la « mère du petit », avec la morte. Peut-être, dans sa rêverie, Michel voyait-il le logis de la rue des Vieilles-Haudriettes, où il avait grandi, où ce vieillard était resté.
Ou plutôt il songeait aux combats du lendemain, à cette retraite devant les Prussiens, à cette marche en arrière, au territoire de la République envahi peut-être bientôt une seconde fois. Tout ce qu’il y avait alors d’angoisse et de résolution, de tristesse et d’espoir dans cette France assiégée, se trouvait dans cette âme de jeune homme et dans ce cœur épris de sacrifice.
Michel ne s’endormit qu’au matin. Un roulement de tambour le réveilla brusquement. Il fallait se mettre en route. Les bataillons de volontaires se formèrent, avec leurs équipements bizarres, les uns, coiffés d’un tricorne roussi, d’où pendait une crinière chauve, les autres avec un mouchoir enroulé autour du front, guêtrés, leurs culottes jaunies ou des pantalons rayés, frangés au bas et troués aux genoux, plusieurs avec un casque de rencontre, revêtus encore de la carmagnole, la plupart sordides, couverts de la poussière de la route ou de la boue du campement, bronzés, noircis, mais un rayonnement dans le regard, et la flamme dans leurs mouvements.
La petite troupe se mit en marche dans le brouillard du matin. On traversait des prés couverts d’une rosée froide. Les vieux riaient de la fatigue des nouveaux ou des précautions qu’ils prenaient pour ne point mouiller leurs chaussures crevées. Parfois une voix s’élevait qui marquait le pas avec le Chant du Départ ; une plaisanterie partait, fusée qui allumait et faisait, de rangs en rangs, crépiter le rire. Des volontaires soufflaient dans leurs doigts et se plaignaient de l’onglée. A quoi, d’une voix rude, il s’en trouvait qui répliquaient : « Ça se plaint ! Ça a froid ! Aristocrates ! » ou : « Fillettes ! »
Tout à coup, quelques grenadiers, marchant en éclaireurs, se replièrent sur les bataillons. Ils venaient d’apercevoir les Prussiens, postés dans un petit bois ; les soldats de Sa Majesté attendaient au passage les soldats de la République. Les officiers commandèrent halte, et le bataillon de Michel, qui marchait en avant, se mit en devoir d’engager le combat. On entendait çà et là le bruit sec des fusils et des chiens qu’on armait.
« Eh bien, muscadin, dit un soldat à Michel d’une voix rude, voilà le moment !
— Ne crains rien, citoyen, ça ira, » répondit le jeune homme avec un sourire.
Michel se retourna entendant, derrière lui, le galop d’un cheval. C’était le citoyen Rewbell, commissaire de la Convention, qui accourait, suivi d’aides de camp.
« Eh ! que me dit-on ? Qu’y a-t-il ? demanda le commissaire d’un ton bref lorsqu’il eut rejoint ce bataillon d’avant-garde. On a vu l’ennemi ?
— Il est à portée de canon, citoyen commissaire, » répondit un des éclaireurs.
Et, comme si les Prussiens eussent voulu souligner ces paroles, un boulet, à quelques pas de Rewbell, passa avec un ronflement de toupie, et s’en alla briser le tronc d’un noyer tout près de là. Le cheval du conventionnel s’était cabré en hennissant ; mais Rewbell, le maintenant d’une main ferme, se tourna du côté des volontaires et leur dit :
« Citoyens, nous avons devant nous toute l’armée prussienne sans doute, et nous sommes peu nombreux. Il s’agit de passer sur le corps de ces gens-là ou de mourir. Vous avez devant vous des esclaves, et vous êtes des hommes libres. En avant !
— Vive la République ! » répondit le bataillon tout entier.
Michel se sentait au cœur un besoin de combat, un appétit de lutte. Les nerfs surexcités par l’insomnie, les yeux fiévreux, il planta son tricorne sur sa baïonnette : « En avant ! » s’écria-t-il en élevant en l’air son fusil. Le bataillon courait déjà du côté des Prussiens.
Au bout d’un moment, on aperçut, à l’entrée d’un bois, l’ennemi, attentif et muet. Les volontaires voulaient l’aborder à la baïonnette, lorsque la voix forte du commandant cria : « Halte ! » Les Prussiens avaient sur ce point concentré leur artillerie. Le bataillon, courant de ce côté, eût été broyé et haché. Michel entendit bientôt les boulets gronder, et ressentit cette impression de chaleur, se trouva dans cette atmosphère d’un brun-rouge dont parle Gœthe. La terre tremblait ; on distinguait, à travers le ronflement du canon, le sifflement des balles. Les volontaires, écrasés, se replièrent dans un chemin creux, tandis que l’artillerie, sous le feu des Prussiens, venait se mettre en ligne.
Michel éprouvait comme des envies de crier, de bondir, de courir aux Prussiens et de lutter corps à corps. Il regardait, autour de lui, les visages. Quelques-uns étaient pâles, tous étaient décidés. Il y avait beaucoup de blessés. Un jeune homme, la poitrine trouée, regardait couler son sang.
Le canon français maintenant répondait au canon prussien. Ce duel se prolongea pendant de longues heures. Les boulets tombaient, s’enfonçaient dans la terre, couvraient de boue les artilleurs de la tête aux pieds ou les coupaient en deux.
« Est-ce que nous resterons là longtemps ? demanda Michel.
— En avant ! » dit un vieux soldat d’une voix rude.
Le commandant leva son sabre en l’air, les tambours, — des tapins de quinze ans, — battaient la charge, et, avec de grands cris, le bataillon courut aux Prussiens. Une décharge terrible les attendait. Il y eut dans cette foule comme le remous des épis de blé sous le vent : la troupe ondula. Michel vit tomber à ses côtés des compagnons qui tout à l’heure lui parlaient. Frappés par devant ils s’aplatissaient sur le nez. Les corps, tombant sur la terre, rendaient un son mat.
« En avant ! » répéta le commandant.
La charge battait toujours. Michel s’élança ; mais brusquement, il lui sembla qu’il venait de recevoir un coup de canne. Étourdi, il s’arrêta, balbutia quelques mots indistincts, tourna sur lui-même et tomba à son tour.
Sa dernière pensée fut une pensée de rage :
« Les Prussiens nous écrasent ! »
La canonnade avait duré longtemps, et c’était vers le soir que Michel avait été blessé.
Il faisait nuit lorsqu’il reprit connaissance. Michel regarda autour de lui, cherchant à s’orienter, à deviner où il se trouvait et en quelles mains. Était-il encore parmi des Français ? L’ennemi, maître de la position, ne l’avait-il pas fait prisonnier ? Il se rappelait la fusillade terrible, les boulets qui fauchaient le bataillon. Il glissait sur la terre, qu’une petite pluie fine, tombée après le combat, avait faite humide. Le ciel était noir, gros de nuages. Michel ne pouvait qu’indistinctement apercevoir, dans cette ombre, des formes vagues, étendues çà et là, des silhouettes d’arbres aux branches à peine feuillées, et, — comme grandie par la nuit, — à quelques pas une charrette embourbée, brisée sans doute, et qui lui sembla énorme. Il essaya de se soulever. Il éprouvait dans la tête comme un grand vide. Avec un effort il se mit sur ses genoux : son œil s’habituait à ces ténèbres. Il vit maintenant que les formes étendues étaient des blessés ou des cadavres. Au loin, pas une sentinelle, aucun bruit. On les avait tous abandonnés.
« Allons, se dit Michel, je ne suis pas prisonnier. »
Il se sentait affaibli ; son sang avait dû abondamment couler. Il voulait se relever pourtant. Mayence, après tout, n’était pas loin ; en suivant le cours du Rhin, il y arriverait bientôt, peut-être avant le jour. On avait dû se battre près de Laubenheim. Mais s’il se trompait ? S’il allait se jeter dans les avant-postes prussiens ? Et puis aurait-il la force de se traîner jusque-là ! Il s’était levé, et, comme il sentait sa tête tournoyer encore, il s’appuyait maintenant contre un arbre. Il lui sembla bientôt qu’il entendait, à quelques pas de lui, murmurer, avec des gémissements, des paroles françaises.
« Qui est là ? dit Michel. Etes-vous blessé ? »
On ne répondit pas. Michel eut cette idée, que les mots confus qu’il venait d’entendre sortaient d’une bouche d’agonisant.
« Pauvre diable ! songeait-il. Mourir là ! »
Michel s’était approché, titubant, de cet endroit d’où venaient les plaintes. Il éprouvait un soulagement extrême, il sentait littéralement la vie lui revenir peu à peu. Il regardait les morts étendus, assez nombreux, et dans cette nuit sans étoiles, il eût reconnu les Prussiens et les Français à leur taille, ceux-ci plus petits et plus maigres. A deux pas de la charrette, il s’arrêta.
« A moi ! » lui dit en français une voix faible, la voix de tout à l’heure.
Il s’avança, saisit au hasard une main qu’on lui tendait, et qui se crispa en se cramponnant à la sienne.
« Vous êtes Français, n’est-ce pas ?
— Oui. Et vous ?
— Moi aussi.
— Où êtes-vous blessé ?
— Là, au côté… Une balle…
— Pouvez-vous marcher ?
— J’essayerai ! »
Michel s’était penché sur le blessé, et, l’aidant à se relever, le tenait sous les bras en lui disant :
« Courage ! un effort !
— Tudieu ! fit l’autre, ce n’est pas facile ! Là, merci, monsieur… »
Ce mot de monsieur fit légèrement tressaillir le volontaire : c’était un ennemi assurément qu’il secourait là. Un Français l’eût appelé citoyen.
« Allons, dit-il, vous ne pouvez pas regagner Mayence avec moi.
— Pourquoi ? fit le blessé…
— Les vôtres vont peut-être revenir. Demeurez là. A Mayence, vous seriez prisonnier !
— Eh ! vertubleu, et que m’importe à moi ? Votre bras, je vous prie. Ouf ! j’aime mieux être prisonnier avec des compatriotes que libre avec des Prussiens. »
C’était un de ces émigrés qui combattaient aux côtés du roi de Prusse et qui l’avaient accompagné en Champagne, sur cette route de Paris, où Sa Majesté stupéfaite avait rencontré le canon de Kellerman et les combattants de Valmy. Un émigré ! Michel, quelques heures auparavant, lui eût jeté le nom de traître au visage : il lui servait maintenant d’appui, le soutenait et le guidait comme un enfant. Mieux que lui l’émigré connaissait le pays ; on s’était battu à quelques minutes de Weissenau, où l’on pouvait chercher asile. C’eût été peine perdue. Les habitants avaient fui et mieux valait encore aller droit à Mayence.
L’émigré avait sur lui une gourde emplie de kirsch, dont ils burent, l’un et l’autre, pour se donner des forces. Le petit jour venait. Cette lueur blafarde du matin montait lentement, et, du côté du Rhin, venait un brouillard froid. Michel et ce blessé étaient peut-être les seuls êtres vivants qu’on eût laissés sur ce champ de combat. D’un pas lourd, hésitant parfois, ils marchaient sous cette lumière douteuse. Vingt fois Michel se sentit près de s’arrêter ou de s’évanouir. Ses pieds se collaient à la terre, ses oreilles bourdonnaient ; une terrible angoisse le prenait à la gorge. Il lui semblait que s’il tombait là, il y mourrait. Son compagnon, horriblement pâle, s’appuyait sur lui et ne parlait pas. Tout à coup, le malheureux s’arrêta net, et d’une voix brisée : « C’est assez, » dit-il à Michel. Il poussa un grand soupir et s’affaissa sur le sol. Michel le crut mort, et lui mit la main sur le cœur.
« Oh ! fit le blessé doucement, il bat encore. C’est tout à l’heure qu’il ne battra plus. Allons, tout est dit. Votre nom, au moins, monsieur, que je sache pendant cette dernière minute à qui je dois…
— Michel Verdure, citoyen. »
Au mot de citoyen un triste sourire illumina ce visage livide de moribond.
« Citoyen ! murmura l’émigré… un grand et beau mot !… Vous êtes volontaire, vous, vous vous battez pour votre foi. Moi, je meurs niaisement, et pourquoi ? Savez-vous pourquoi ? J’ai émigré parce que le décret de 1790 exigeait que tout le Royal-Comtois renonçât à porter ses cheveux en catogan et prît la queue nattée comme tout le monde. Que le diable emporte le décret ! J’aurais servi la République, moi aussi, sans cette maudite… mode… mais les cheveux nattés, fi ! c’est trop laid !… Bon pour des goujats… Près d’Amiens, il y a trois ans, nous nous sommes battus pour nos coiffures contre le régiment d’Anjou-Infanterie, qui a adopté la mode nouvelle. Bah ! on se fait tuer pour pis que cela… Je veux porter mes cheveux à ma guise… c’est bien le moins… »
Il essayait de sourire et de railler, et ses yeux, dont les prunelles s’élargissaient, regardaient à l’horizon, dans l’aurore, les tours des églises de Mayence, le clocher et la coupole du Dom, qui se détachaient sur le ciel gris. Un coup de vent apportait de ce côté les appels de la diane.
« La diane ? fit l’émigré en tressaillant. Allons, debout, je veux mourir debout ! Soutenez-moi, » dit-il à Michel.
Le volontaire le prit dans ses bras.
« A la bonne heure, fit le mourant. C’est bien. Si vous venez rechercher mon corps de ce côté, dit-il, souvenez-vous que je veux qu’on m’enterre avec cette coiffure-là. Les émigrés de Coblentz portent la cocarde blanche, les émigrés d’Angleterre portent la cocarde noire. Moi, ma foi, moi… je veux… Tenez, mettez la cocarde tricolore à mon cadavre… Après tout, les couleurs en sont plus charmantes… Mais surtout laissez-lui le catogan. Ah !… au fait… Je m’appelle… vous en souviendrez-vous ? le citoyen Robert de Piennes… Je dis citoyen, vous entendez ? Citoyen comme vous ! Pourquoi pas ? Je vous ai bien embarrassé jusqu’ici. Oui… mais voilà votre fardeau qui s’en va ! Merci ! Après cela la vie n’est point chose si précieuse. Et surtout battez les Prussiens ! »
Il tomba sur le revers d’un fossé. Michel le regarda un moment, se pencha sur lui, le secoua, lui versa sur les lèvres les dernières gouttes de kirsch pour le rappeler à la vie. Le cœur ne battait plus.
« C’est fini, » dit le volontaire.
Il regarda autour de lui pour chercher du secours, pour appeler un aide. Personne. Le jour était venu, mais dans les champs déserts les paysans effrayés n’allaient plus à l’ouvrage. Michel donna un dernier regard à M. de Piennes. Il lui sembla qu’un sourire d’ironique et fière résolution relevait la lèvre de ce mort, dont on apercevait les dents blanches et serrées.
« Il est mort en citoyen, songeait-il, et si on trouve ici son cadavre, on l’enterrera comme celui d’un suspect. »
Michel eût arraché la cocarde de son tricorne pour l’attacher à la poitrine de M. de Piennes. Mais, blessé à la tête, il avait pour toute coiffure son mouchoir noué autour de son front. Il allait s’éloigner lorsqu’il se rappela qu’il avait gardé sur lui sa carte du Club des Cordeliers, et, la tirant de sa poche, il raya son nom d’un coup de crayon et écrivit :
« Celui-ci s’appelle Robert de Piennes, mort citoyen de la République française une et indivisible. »
« C’est bien cela qu’il a voulu, » songeait Michel.
Il mit le papier entre les doigts crispés du mort et s’éloigna, regardant toujours, avec anxiété, si l’émigré ne remuait pas.
Le Dom de Mayence était encore loin. Le volontaire, épuisé, les yeux sur ce clocher où flottait indistinct un drapeau tricolore, se hâtait, comme un coureur hors d’haleine qui va tomber, mais du moins en arrivant au but. Il était, lui semblait-il, plus vaillant et plus fort tout à l’heure, lorsqu’il lui fallait soutenir ce blessé. Sa tête, peu à peu, semblait s’être alourdie. Ses jambes, affaiblies, pliaient.
« Je ne veux pourtant pas mourir là, » disait tout haut Michel Verdure…
Il avançait, marchait, redoublait d’efforts. Parfois aussi il s’arrêtait : il croyait entendre des voix, des bruits confus, des roulements de caissons. Sa blessure lui donnait comme le délire. Tout, au contraire, était calme dans ces champs où courait la sève, où s’ouvraient les premières feuilles. Dans les profondeurs de ces plaines, à l’horizon, derrière ces murailles, là-bas, sur l’autre rive du Rhin, qui eût deviné deux armées prêtes à s’entr’égorger ? Il y avait dans l’air comme des chants d’oiseaux ou des bourdonnements d’insectes.
Exténué, Michel avançait toujours, mais le Dom paraissait s’éloigner. La route était plus longue qu’il n’avait cru. Ces bruits de clairon, apportés par le vent du matin, l’avaient abusé. Il se trouva soudain pris d’une lassitude immense. A quoi bon marcher ? Pourquoi ne pas tomber là, comme l’autre, et comme tant d’autres de ses compagnons ? Si les hussards de Cassel venaient de ce côté au fourrage, ils le traîneraient, le rapporteraient en croupe à Mayence. C’était le seul espoir. Quant à avancer maintenant, impossible. Michel éprouvait dans la tête des douleurs horribles. La fièvre lui revenait. Il se laissa aller à terre avec un soupir profond, murmura encore un de ces magiques mots qui couraient alors sur les lèvres des mourants et s’évanouit.
Ce ne fut pas un hussard de Cassel, mais un jeune homme de Mayence, Otto Schwartzen, qui trouva Michel Verdure étendu sur le chemin. Otto, ce matin-là, était allé, herborisant, du côté de Laubenheim. Il aperçut ce corps sanglant et s’assura qu’il respirait encore : il donna les premiers soins au blessé, et avertit les avant-postes français qu’un volontaire moribond avait besoin de secours. Des hommes d’ambulance rapportaient Michel sur les brancards déjà tachés de tant de sang, lorsqu’à la porte du grand hôpital, un chirurgien fit des difficultés pour recevoir le moribond.
« Nous sommes encombrés ; les salles sont empestées de malades. Emportez ce nouveau venu au Dom ou logez les blessés chez les habitants. Que diable ! ils doivent bien nous aider un peu, je pense !
— Citoyen, dit Otto qui avait suivi, vous avez raison. Il fit un signe aux soldats, leur dit : Venez, et les conduisit, tout près de là, à l’angle de la place Gutenberg, devant une petite maison dont il ouvrit la porte, en appelant : Magdet ! »
Une vieille femme mit soudain la tête à la fenêtre, glissant un regard dans la rue avec un air effrayé :
« C’est moi, Magdet, dit Otto, et je vous amène un blessé. »
La vieille femme descendit en hâte.
« Prévenez mademoiselle de Smeyer, fit le jeune homme. Mon logis est trop étroit pour servir d’ambulance, et je sais que le dévouement et la charité d’Elisabeth sont tout acquis à un citoyen du monde et à un Français ! »
Michel Verdure avait repris connaissance en route, mais pour s’évanouir de nouveau. Il revint à lui, couché dans un lit auquel rapidement Magdet mit les draps les plus beaux, et, en rouvrant les yeux, il éprouva comme une sensation de bien-être. Il avait encore devant lui ce paysage indécis d’un matin de printemps frileux : la longue route solitaire ; Mayence, au fond, but désiré qu’on n’atteindrait pas. Et voilà qu’il se retrouvait dans une chambre allemande, où tout luisait de propreté, — ce sourire des choses, — où les grandes armoires de chêne reflétaient le soleil de la rue, où le tic-tac d’un de ces coucous de la Forêt-Noire semblait avoir bercé son sommeil. Et tout cela était gai et sentait bon.
Il laissa échapper un soupir satisfait, le soupir enfantin des souffrants, et comme si c’eût été une plainte, à ce bruit il vit entrer doucement un jeune homme, grand, blond et maigre, puis une jeune fille qui vint à son chevet, et d’une voix douce, sans accent germanique, lui demanda :
« Souffrez-vous, monsieur ?
— Moi ? » fit Michel sans répondre.
Et il la regardait. Sa taille était svelte, élancée, prise dans un de ces caracos du temps, qui sculptait sa poitrine et la rendait plus charmante. De longs cheveux noirs roulaient aux deux côtés de son visage, d’une blancheur lactée. Elle ouvrait sur le blessé de grands yeux aux prunelles brunes et pleines d’une bonté fière.
« Mais où suis-je donc ? demanda Michel. Pourquoi ne suis-je pas à l’hôpital ?
— Les Français ont été repoussés par les troupes allemandes et se sont repliés sur Mayence. Vous êtes chez mademoiselle de Smeyer, citoyen, répondit le jeune homme, chez de bons patriotes allemands, qui veulent, comme vous, la liberté universelle et rêvent la grande concorde humaine ! »
Otto Schwartzen avait parlé avec une énergie singulière, de la voix altière d’un tribun. De toutes ces paroles vibrantes et généreuses, Michel n’avait pourtant retenu qu’un mot : mademoiselle de Smeyer. « Mademoiselle ? » Il la regardait toujours de son regard fiévreux, et Elisabeth, sans baisser les yeux, répondait à ce regard étonné par un sourire qui voulait dire :
« Soyez sûr que nous vous sauverons ! »
La blessure de Michel n’était pas grave. Elle lui donnait pourtant assez souvent des accès de fièvre. Il s’agitait alors, voulait partir, s’élançait hors du lit, où Otto le maintenait doucement ; puis revenu à lui, se retrouvant dans ce milieu calme et sain, dans des draps embaumés, avec mademoiselle de Smeyer à ses côtés, qui veillait et le regardait de ses yeux profonds, il éprouvait bientôt une sensation pénétrante, il se sentait comme rafraîchi, baigné d’une atmosphère nouvelle. Une semaine auparavant, il courait les champs, couchant au hasard des marches, et maintenant, dans cette hospitalière maison, il croyait retrouver le toit maternel, la noire et chère maison de la rue des Vieilles-Haudriettes.
« Comment vous trouvez-vous ? » demandait bien souvent la vieille Magdet avec sa voix basse ; et il semblait à Michel retrouver dans ce timbre caressant et un peu cassé, comme un accent de la mère restée là-bas, à Paris.
« Savez-vous à quoi je pense, mademoiselle ? dit-il un matin à Mlle de Smeyer, je pense à ces malheureux soldats qui n’ont pas eu la bonne fortune d’être blessés comme moi. Je vois bien qu’à la guerre les plus chanceux sont précisément ceux-là que n’épargnent point les balles. »
Peu à peu, Michel reprenait des forces, il sentait, pour ainsi dire, sa blessure s’effacer. Il se levait, il regardait, par la fenêtre, les patrouilles défiler, il écoutait tonner le canon. Il avait hâte de retourner à son poste.
« Non, vous êtes trop faible encore, » disait Otto Schwartzen.
Michel s’inquiétait avant tout des travaux du siège ; il fallait qu’Otto lui apportât chaque soir les nouvelles de la journée, chaque matin les nouvelles de la nuit. C’était là le vrai remède. Les coups de feu semblaient répondre par un douloureux écho dans la poitrine du blessé, et son pouls, alors que le bruit de la fusillade éclatait, battait plus fort et plus vite.
« Vous aimez donc bien la guerre ? lui demanda un jour Otto Schwartzen d’une voix lente.
— Je la hais, dit Michel, mais j’aime la République. Nous autres, Français, nous ne combattons, à cette heure, que pour la paix générale et l’affranchissement du monde. Aussi notre cause est-elle invincible.
— Vous avez raison, réplique Otto. Cette boucherie peut devenir sainte à son heure. Mais maudits soient tous ceux qui la rendent nécessaire ! »
Ils se connaissaient maintenant l’un l’autre. Otto Schwartzen était le fiancé d’Elisabeth. Orphelins tous deux, elle ruinée, lui pauvre, et forcé d’élever un frère plus jeune que lui, qui grandissait sous ses yeux, ils étaient entrés dans la vie, unis déjà par une communauté de malheur. Ensemble ils avaient grandi ; à quelques années de distance, ils s’étaient trouvés isolés et sans parents. Le vieux Schwartzen, maître de chapelle de l’Électeur, avait mis tout ce qu’il possédait, toutes ses ressources et tous ses espoirs, la réalité et le rêve, — sur la tête de son fils aîné. « Je fais pour toi tout ce que je puis, Otto, tu feras pour Franz ce que tu pourras. » Franz, le dernier né d’une union sainte, avait coûté la vie à sa mère. Quand le père Schwartzen mourut, l’enfant avait cinq ans. Otto, son aîné, était déjà docteur. Il avait marqué son passage dans les Universités par des succès vaillants. Ardent, généreux, l’âme embrasée de ce feu sacré qui venait de France, il portait en lui toute la flamme de ce grand siècle calomnié, le siècle qui a fait le plus pour l’humanité et le droit, le siècle de Diderot et de Voltaire. Peu ambitieux, d’ailleurs, au lieu de porter à Berlin sa science et de chercher une vaste scène pour ses désirs, il rentra en sa maison natale, à Mayence, où il s’enferma avec ses livres, dans le vieux logis où il était né, à l’ombre de l’ancien château électoral.
Il y avait longtemps déjà qu’il n’était revenu là ! Il était demeuré, le front penché sur les livres, à Heidelberg, à Bonn, à Gœttingue. La science avait pâli son jeune visage, maigre et fier, encadré de longs cheveux blonds, qu’il rejetait en arrière de chaque côté des tempes, et qui lui donnaient je ne sais quoi d’inspiré et de fier. Il s’était transformé, il avait grandi ; mais ici tout était à sa place comme jadis, et il s’assit, avec une respectueuse émotion, dans le fauteuil où jadis s’asseyait son père. Il voulait garder le petit Franz avec lui, l’élever, l’instruire et en faire un homme.
A Mayence, il n’avait laissé d’autre souvenir que celui d’une petite fille qu’on asseyait autrefois à ses côtés, en leur faisant jouer du clavecin, dans le salon d’un pauvre gentilhomme dont son père, l’humble musicien, était l’ami. Il la retrouva, charmante, mélancoliquement souriante, orpheline comme lui ; elle lui tendit la main, ils causèrent du passé, ils remontèrent doucement vers ces souvenirs baignés de brume bleue de l’enfance. Ils se rappelaient que leurs pères, en riant, disaient jadis qu’ils les marieraient. Et la vieille nourrice d’Elisabeth, Magdet, hochant la tête, répétait : « Ne rions pas. Les paroles des morts sont sacrées. Oui, vous êtes fiancés dès longtemps, et le bonheur est fait pour vous. »
Le bonheur ! Ils n’avaient guère connu, ces deux enfants, que la détresse. Leur sympathie venait peut-être de la fraternité de leurs souffrances.
« Vous rappelez-vous, disait-il souvent à Elisabeth, les soirs d’hiver, quand M. de Smeyer, prenant son violon, jouait avec mon père cette musique qu’il avait composée ? Nous écoutions, nous applaudissions. Ah ! ces vieux airs, je les sais toujours. Et quand je me les chante à moi-même, mes yeux tout à coup deviennent troubles, et je me mettrais à pleurer.
— N’était-ce pas cela ? » répondait alors Elisabeth.
Et sur le clavecin elle retrouvait les airs de l’enfance, tandis qu’Otto, tout ému, la regardait et revoyait, en la regardant, tout son passé évanoui !
Ainsi la calme idylle de leurs honnêtes amours était comme trempée de larmes. Ils se sentaient unis par ces liens d’autrefois. Ils s’étaient fiancés l’un à l’autre. Ils s’aimaient d’une affection douce, d’une fraternelle tendresse. Michel Verdure savait tout cela. Dans les causeries qu’avait fait naître cette intimité entre le blessé et le garde-malade, le volontaire s’était livré, on s’était confié à lui. Et Michel avait répondu à ces confidences d’un calme et touchant roman par sa propre histoire, bruyante, toute d’orages et de traverses.
« Vous avez vécu ici, dans ces maisons paisibles, laissant le murmure du Rhin bercer vos rêveries. Moi, j’ai grandi dans la lutte, dans l’atmosphère de salpêtre des dernières années de la monarchie. Je n’ai souffert ni la misère ni la faim. La bonne vieille mère veillait à tout, et trempait la soupe chaque soir. Elle se saignait, elle aussi, pour faire de son fils un savant. Je ne devins pas savant, mais de bonne heure, sur les bancs d’étude, j’appris ce que signifiaient les mots liberté et justice. J’allais aux représentations du Mariage de Figaro, applaudissant à tous les soufflets que le laquais donnait à la noblesse, et que les nobles, dans la salle, recevaient sur les deux joues en riant. J’avais vingt ans quand on prit la Bastille. J’y étais. J’ai porté sur mes épaules les prisonniers, à barbe blanche, éblouis par la lumière et tordus par la prison. J’ai senti mon cœur s’épanouir avec la Révolution, j’ai grandi avec elle. Tous les hommes qui l’ont servie, quelles que soient leurs nuances, je les ai aimés, depuis Mirabeau jusqu’à Barnave. Que de beaux spectacles ! Quelles journées de fièvre ! J’ai traîné la brouette en chantant le jour de la Fédération ! J’ai eu sur la tête ce coup de soleil réchauffant d’une lumière nouvelle. Chère France ! Je suis fier d’être ton fils. Mon pays, il a brisé les abus, jeté bas les préjugés, donné son cœur, donné le sang de ses veines pour la liberté du monde ! La délivrance de notre patrie, c’est l’affranchissement de la vôtre. Liberté, le beau mot ! la grande chose ! Et quand nous la proclamions d’une voix si haute que l’univers entier allait l’entendre, les rois ameutés se jettent sur cette terre libre pour la dépecer comme des chiens à la curée ! Alors, un appel déchirant est sorti de toutes les poitrines, le drapeau noir a flotté sur l’Hôtel-de-Ville, le canon d’alarme a jeté sur le Pont-Neuf son qui-vive héroïque ; d’une frontière à l’autre ont retenti les mêmes cris : La patrie est en danger ! J’ai jeté le costume d’avocat, laissé les livres et les plumes, envoyé les paperasses au vent de la Seine, et, le fusil au poing, la baïonnette en avant, je me suis jeté sur les soldats du despotisme, en soldat volontaire, avec la tyrannie devant moi et le droit derrière moi, qui, sous les balles, les boulets et les biscaïens, me poussait par les épaules ! »
En parlant, Michel avait comme une fièvre qui semblait inquiéter Elisabeth. Elle attachait sur lui de grands yeux étonnés et interrogateurs. Elle tremblait que la blessure du convalescent ne se rouvrît. Elle demeurait, comme fascinée, ses grands yeux sur le jeune homme exalté, et qui parlait alors comme du haut de la tribune des Jacobins. Elle laissait ses doigts s’arrêter sur les linges qu’elle cousait pour les blessés ou sur la charpie, et, muette, elle contemplait Michel, dont le regard jetait des flammes.
Alors Otto se levait tout droit, redressait sa haute taille maigre, et levant ses grands bras :
« Voilà pourquoi, disait-il d’un geste inspiré et avec un enthousiasme un peu mystique, je l’aime cette France, qui porte dans son sein la destinée de la liberté. Soldat de Dieu, dit Shakespeare, elle est surtout le soldat des peuples. Citoyen, vous ne savez donc pas que nos entrailles ont tressailli à la nouvelle de votre délivrance ? Le pont-levis brisé de la Bastille faisait tomber toutes les chaînes. Les nations sont solidaires. Vos armées de liberté sèment dans nos villages les idées de liberté, qui germeront demain. Mon Allemagne ! Teutonia ! Teutonia ! tu ne sens donc point passer sur tes forêts le vent de liberté qui vient de France ? Tu as beau envoyer contre ces combattants du droit tes légions énormes et tes grenadiers, la force vient du point où souffle l’esprit. Prussiens, Autrichiens, armée du prince royal, armée de Condé, ces volontaires auront raison de vous, car ils s’appellent le dévouement, la liberté, le patriotisme et le droit.
« Eh ! vive la République ! citoyen, concluait Michel, quand Otto, recueilli, éloquent à la façon germanique d’Anacharsis Clootz ou d’Adam Lux, s’était tu. Nous sommes du même avis. Donnons-nous la main. »
Que de fois, après ces causeries, seule en sa chambre, Elisabeth avait-elle tout bas, avec une sorte de terreur vague, répété les paroles ardentes du soldat ! Que de fois aussi Michel, avant de s’endormir, avait-il revu le regard clair de Lisbeth, — Lisbeth, comme l’appelait Otto Schwartzen, — attaché sur le sien !
Une fois guéri, il voulut sortir, reprendre aussitôt son service. Son bataillon venait, quelques jours auparavant, d’enlever Sainte-Croix aux Autrichiens. Il ramenait des prisonniers en ville, de grands cuirassiers lourds, tandis que l’église et le bourg en flammes, incendiés par nos grenadiers, brûlaient à l’horizon. On fit bon accueil à Michel, qui apparaissait comme un revenant.
« Hé ! muscadin, dit Brutus Toussaint, patriote enragé, qui regardait assez souvent d’un œil railleur les mains blanches de Michel, nous ne sommes donc pas tout à fait mort ?
— Pas tout à fait, citoyen. Il me reste encore à brûler plus d’une cartouche au service de la République. »
Michel croyait, d’ailleurs, en marchant par les rues de Mayence, se trouver dans une autre ville.
Le blocus, que les ennemis resserraient, s’abattait là comme une épidémie. La famine avait pris cette ville assiégée à la gorge. Les soldats, déguenillés, couraient les rues, cherchant leur nourriture au coin des bornes, aux angles des maisons, dans les détritus, comme les pourceaux. Michel parcourait, le cœur attristé, ces carrefours, qui sentaient la maladie, la faim, la mort. De vieilles femmes étaient là, accroupies, regardant la terre d’un œil fixe ; des mères présentaient aux soldats de petits enfants qui demandaient du pain. Des spéculateurs (il s’en trouve partout et toujours) avaient établi, dans des maisons aux toits enfoncés par les bombes, des débits de viande où l’on dépeçait et vendait de la chair de cheval. Le tarif, écrit à la main, en langues allemande et française, sur une vieille enseigne écornée par les balles, se balançait au vent en grinçant. Les soldats s’assemblaient parfois devant ces boucheries d’espèce nouvelle et protestaient :
« Comment ! disaient-ils, un chat, six francs ? Quarante-cinq sols la livre de cheval ? On rançonne les défenseurs de la patrie ! les trafiquants se glissent partout ! Voulez-vous leur faire concurrence, citoyens ? Allons au Rhin ! Le fleuve roule des chevaux morts. Harponnons-les au passage, sous les biscaïens allemands, et moquons-nous des fournisseurs ! »
En rentrant au logis de Mlle de Smeyer, d’où il n’était pas encore sorti, Michel se laissa tomber brisé, écœuré, sur un escabeau.
« Les misérables ! dit-il. Voilà la guerre ! Allemands, ils font mourir de faim les Allemands pour arriver jusqu’aux Français ! C’est horrible !
— N’est-ce pas ? » disait Lisbeth… en le regardant attendrie.
Otto prêtait l’oreille à la canonnade, qui, menaçante, éternelle, venait du côté du Rhin.
« Un jour se lèvera, fit-il, où l’homme n’aura plus d’autres armes que le scalpel et la charrue !
— Qu’il se lève demain ! » répondit Michel.
Le volontaire redevint bientôt soldat.
Ces nuits de juin, tièdes et étoilées, Michel les passait bien souvent dans la redoute du Rhin, en sentinelle, ou, veillant, absorbé par ce grand spectacle du vaste fleuve qui se déroulait sous les murs croulants de Mayence, par tous ces bruits de la nuit, appels de sentinelles, mugissements indistincts, plaintes qui traversaient l’ombre, coups de canon qui faisaient vibrer l’air, boulets qui passaient en sifflant, lugubres hurlements de chiens, murmures prolongés de ces sombres veillées, qui ressemblaient à des veillées de morts.
Il s’inquiétait bien peu, le vieux Rhin, de ces combats qui ensanglantaient ses rives. Il coulait, large, profond, superbe, avec de grandes nappes de lumière, des paillettes, des plaques luisantes. Les clartés de la lune donnaient au fleuve une mystérieuse et sinistre allure. Parfois, on apercevait, çà et là, quelque objet indistinct que roulaient les flots, cadavres d’hommes ou de chevaux, débris de fermes incendiées, bateaux courant à la dérive.
Michel, les yeux fixes, regardait tout cela, pendant que des bruits de sabres, des cliquetis d’éperons, les murmures sourds de la nuit berçaient son rêve.
Il éprouvait, comme tous les assiégés rejetés sans secours dans Mayence, la nostalgie du pays. Que faisait-on à Paris ? Que devenait la Révolution ? Que disait l’Assemblée ? Que faisaient aussi la vieille mère, les amis qu’on avait quittés ? Que de craintes, de terreurs, quelles angoisses ! Un matin, passant sous la grande porte, Michel entendit un grand bruit de voix ; les soldats couraient, se groupaient, se pressaient autour d’un jeune homme, un Parisien, qui venait de ramasser, près d’une batterie, un journal venu, sans aucun doute, du camp prussien, et que le vent ou le hasard avait apporté par là.
« Un journal ! Des nouvelles ! Il y a des nouvelles ! » criaient les soldats.
On se précipitait vers le jeune homme qui agitait triomphalement le journal au-dessus des têtes avides.
Des nouvelles de France !
Il y eut dans toute cette foule hâve et souffrante un rayonnant éclair de joie. Les yeux brillaient, les pieds trépignaient d’impatience. On allait enfin savoir ce qui se passait à Paris. Michel lui-même se sentait légèrement oppressé, et il regardait ce morceau de papier jaune que tenait le soldat, avec cette expression hésitante d’un homme qui relit l’adresse d’une lettre importante avant de l’ouvrir.
Que contenait-il, ce journal, et qu’allait-il apprendre à ces pauvres gens traqués, séparés des leurs, massés sur une rive du Rhin et sous les boulets ennemis ?
« Silence ! hurlait cette foule.
— Lis, Scevola !
— Lis donc ! »
Scevola avait jeté les yeux sur le journal, et toussant, donnant du ton à sa voix, et prenant la pose d’un homme qui se sent écouté :
« Gazette nationale ou Moniteur universel, dit-il, no 172, vendredi 21 juin 1793, l’an II de la République française.
— Eh ! passe donc le titre, clampin, dit Brutus Toussaint de sa voix rude.
— Ne faut-il pas tout lire, pour tout connaître ? Politique… Nouvelles de Paris… Écoutez-moi ça : « Le général Dumouriez a balayé la Convention comme le vent chasse les feuilles mortes… »
— Comment ? » s’écria, en jurant, Brutus Toussaint qui s’était approché.
Les auditeurs se regardaient les uns les autres. Le pauvre Scevola était devenu tout pâle, et maintenant sa main tremblait.
« Y a-t-il cela ? Qu’est-ce donc que ce sacré papier ? » répétait Brutus.
Michel se croyait le jouet d’une hallucination. On entend ainsi, dans les rêves, bourdonner des paroles qui vous vont droit au cœur et le brûlent. Il regardait Scevola qui jetait sur le Moniteur des yeux effrayés, et promenait ensuite ses prunelles à demi égarées sur la foule.
« Faut-il continuer, citoyens ? demanda le Parisien… savez-vous que c’est affreux, ce journal-là ? La Convention dissoute ! Dumouriez maître de Paris ! Le petit Capet proclamé roi sous le nom de Louis XVII et régnant avec une régence ! Tout cela est imprimé. Lisez. »
Il montrait le Moniteur aux soldats qui se penchaient sur le feuillet, et tâchaient, ceux-là mêmes qui ne savaient pas lire, d’en déchiffrer les caractères.
« Mille millions de tonnerres ! répétait Brutus en serrant les poings, est-ce que c’est possible, ces choses-là ? est-ce qu’ils se sont laissés, tous les bons, les Danton, les Billaud, les Romme et les autres, jeter à la porte comme des enfants ? Comment ! La République est finie ! Dumouriez a pris Paris ! Les Prussiens y sont peut-être ! Les Prussiens !
— Voyez, voyez, disait Scevola en agitant le journal. Les étrangers sont entrés par le faubourg du Temple ! Mon faubourg, à moi, mon pauvre faubourg ! »
Les exclamations, les cris d’étonnement ou de fureur, partaient du groupe comme par explosion. On entendait, au loin, le canon de la redoute des Clubistes, qui répondait par ses grondements à l’attaque de la troisième parallèle prussienne. Michel avait envie de courir au feu, de se jeter, comme un fou, au-devant des balles et de mourir sous le drapeau républicain, puisque la République était morte.
Il lui montait au cerveau comme une fièvre. Son sang battait.
Tout à coup, écartant la foule brusquement, il se jeta sur le papier que Scevola tenait encore, le lui arracha des mains et, le regardant avec rage :
« Voulez-vous que je vous dise ? s’écria-t-il. Ce papier ment ! Tout ce qu’on a imprimé ici est faux. Je n’ai point de preuves, mais j’en suis sûr. Est-ce que la Convention peut périr ainsi et terminer son œuvre par la honte ? La Convention chassée par Dumouriez, citoyens, cela est faux, je jure que cela est faux.
— C’est imprimé, répétait le malheureux Scevola avec désespoir.
— Regardez ce papier, continuait Michel. D’où vient-il ? Qui nous l’envoie ? Des émigrés, peut-être, des traîtres. Il nous dit que Paris appartient à la réaction. Si cela était, mes amis, il commencerait par déclarer que tous les citoyens dévoués ont été tués par les houzards de Dumouriez ou les grenadiers du roi de Prusse sur leurs bancs, comme les sénateurs romains sur leurs chaises curules. Où parle-t-on de la mort d’Hérault, de la mort de Desmoulins, de la mort de Cambon ? Je vous dis que ce journal en a menti. La Convention n’est pas morte ! Vive la Convention !
— Vive la Convention ! » répondit une voix forte, et les soldats aperçurent Merlin de Thionville arrêté auprès de Kléber.
La haute taille du soldat alsacien se dressait à côté de Merlin, dont la stature était pourtant superbe. Kléber, la tête nue, la poudre et la poussière dans ses cheveux crépus, se tenait à un ou deux pas en arrière de Merlin qui, le visage échauffé, ruisselant sous son chapeau de représentant, bossué et rougi au feu, le cou découvert, l’écharpe en lambeaux, le sabre tordu, s’avança vers Michel et lui tendit la main :
« C’est bien, citoyen, dit-il. Et voilà qui est parler en homme ! Ces numéros de journaux qu’on sème dans Mayence pour nous arracher l’espoir, pour mettre dans nos rangs la confusion, — comme si la garnison de Mayence, comme si les soldats de la République pouvaient faiblir, — ils sont imprimés à Francfort par des mains françaises. C’est je ne sais quel rebut de faiseurs de libelles qui les fabriquent. (Il avait pris le faux Moniteur et le mettait en pièces.) Les Prussiens les répandent parmi nous. Leurs soldats d’avant-postes nous les jettent comme des bombes plus terribles que les autres. Citoyens, prenez les lambeaux de ces mensonges de traîtres et renvoyez-les à l’ennemi en en faisant des cartouches.
— Vive la Convention ! » répétèrent les soldats, et ce cri vibrant partit comme un bouquet d’artifice.
Ils se partageaient déjà les fragments du journal, et Merlin, tirant de sa poitrine un papier déchiré :
« Sais-tu lire, citoyen ? dit-il à Michel.
— Le muscadin sait même le latin, répondit Brutus.
— Lis, » ajouta le conventionnel.
C’était le no 255 du journal d’Hébert : « La grande joie du père Duchesne de voir la Constitution acceptée par tous les citoyens de Paris, ses avis à tous les sans-culottes des départements, dont on veut nous faire peur, d’arriver promptement au milieu de nous, pour nous en donner ensemble des piles éternelles de réjouissance de ce que la République est sauvée, malgré les Brissotins, les Rolandins, les Buzotins et tous ceux qu’a soudoyés l’Angleterre pour nous mettre à chien et à chat les uns contre les autres, et nous détruire par le pillage, la guerre civile et la famine. »
« Vous l’entendez, citoyens ? dit Merlin de Thionville, lorsque Michel eut achevé. La Constitution est acceptée. Paris est libre. Dumouriez, traître envers la patrie, sera puni comme un traître. La Convention est toujours digne de la France, et nous, ses soldats et ses enfants, nous devons nous montrer toujours, comme nous le sommes, dignes de la Convention et de la patrie !
— Vive Merlin ! dit Scevola, qui répétait : Le faubourg est libre. Ils n’ont pas mis les pieds dans le faubourg du Temple. Vive Merlin !
— Allons donc ! fit le commissaire… Vive la République ! »
Il se retourna vers Kléber.
« Ces Brissiens, disait le général entre les dents avec son accent d’Alsace, ce n’est bas assez de lutter avec le fer et le feu, il faut encore qu’ils s’arment du mensonche !
— Les républicains se moquent de leurs fausses Gazettes nationales de Francfort comme de leur artillerie, répondit Merlin en souriant. Allons, viens ! »
Les soldats les suivirent un moment de leurs acclamations. Brutus Toussaint s’était approché de Michel, et lui tendant la main :
« Muscadin, lui dit-il, décidément tu es un homme !
— J’ai foi, voilà tout. Crois-tu que la République peut finir ainsi ?
— Et si elle finissait comme ça ?
— Nous nous ferions encore tuer pour elle, voilà tout.
— C’est juste. »
Il y avait, dans cette ville de Mayence, un coin où Michel Verdure était sûr de retrouver un peu de joie. C’était la maison de Mlle de Smeyer. Lorsque Otto n’était pas au club, Michel le rencontrait là, lisant tout haut quelque maître livre, tandis que la vieille Magdet écoutait et disait à Lisbeth :
« Je ne comprends point. »
Peu à peu Michel en était venu à considérer ce logis comme le sien. Il s’était senti invinciblement attiré vers cet enthousiaste Otto Schwartzen, dont le mysticisme même avait un charme. Il s’était habitué à causer avec Mlle de Smeyer, à se confier à elle, à se livrer, à se laisser aller à ce courant harmonieux des petits secrets qui vous entraîne et vous enivre en vous berçant.
Michel était maintenant comme pénétré d’un sentiment nouveau. Il n’avait jamais aimé. Sa jeunesse active s’était dépensée dans les premières luttes de l’aurore révolutionnaire : le jour, aux assemblées tumultueuses du Palais-Royal, écoutant pérorer l’énorme marquis de Saint-Huruge ; le soir, aux Jacobins, devant la tribune où montait quelque orateur superbe. Le temps manquait pour les idylles. Toute son énergie, Michel l’avait vouée au triomphe des idées naissantes. Il rêvait bien, comme tant d’autres, le foyer heureux, la compagne aimée, les enfants se roulant, joyeux, sur les tapis. Mais la grande famille, la patrie, ne lui laissait point le loisir de songer à la petite. Chacun alors remettait le bonheur possible à plus tard.
Il avait ainsi passé, ce Michel, de l’orageuse atmosphère de la rue à l’atmosphère de salpêtre des camps. Il avait marché gaiement, la pluie dans le visage, la boue aux pieds, l’enthousiasme au cœur. Puis, comme si tout cela eût été un rêve, il s’était éveillé justement au coin de ce foyer souhaité ; son premier regard avait rencontré le sourire de cette compagne idéale à laquelle il songeait parfois. Il avait éprouvé cette sensation de l’homme qui sort d’une étuve et qu’on transporte, en le soignant, dans un air plus doux, pénétrant et sain. Il avait éprouvé l’envie de faire halte ici, après tant de traverses et d’orages. Cette salle lambrissée de chêne, ces vieux meubles tarotés de vers, ce coucou qui poussait son cri aigu à toute heure nouvelle, ces vieilles gravures encadrées çà et là, cette maison aux escaliers de bois, tout cela pour lui c’était le paradis, un eldorado allemand où l’on eût été si bien pour se reposer, pour demeurer, pour aimer !
Il aimait vraiment cette Elisabeth, blonde, douce, et d’une grâce honnête et charmante. Il l’avait aimée d’abord par reconnaissance, mais la reconnaissance mène loin. Il avait passé tant d’heures à ses côtés, de ces heures où les convalescents se sentent revivre, aspirent avec volupté l’air qui leur semble meilleur, et de leurs pieds mal affermis encore reprennent, avec des naïvetés d’enfants, possession de la terre qui les enivre ! Il confondait cette figure de jeune fille avec les impressions de reconnaissance qu’il avait éprouvées. C’était elle, lui semblait-il, qui lui avait rendu la vie.
Pour elle, elle ne l’aimait pas encore. Mais elle aussi se sentait troublée par cette affection qu’elle devinait, — car les femmes, comme certaines gens découvrent les sources, découvrent l’amour où personne ne le soupçonnerait. — Fiancée à Otto Schwartzen, elle se rappelait les promesses anciennes, elle aimait toujours et d’une affection vraie cet apôtre de liberté qui lui inspirait à la fois de l’admiration et du respect. Elle songeait pourtant, elle aussi, à cet étranger d’hier qui s’était maintenant emparé de ses préoccupations et dont le souvenir ne la quittait plus. Elle lui savait peut-être gré des soins qu’elle lui avait donnés. Pourquoi non ? La femme est reconnaissante du dévouement qu’on lui donne l’occasion de montrer.
Michel ne devinait pas tout ce que Mlle de Smeyer se cachait encore à elle-même. Lorsqu’il la voyait sourire à Otto, il lui prenait des accès de jalousie, des mouvements de colère qui se fondaient en envie de pleurer. « Après tout, se disait-il, elle l’aime. » Il eût voulu fuir Mayence pour ne plus la revoir, il se jurait de ne plus remettre les pieds dans cette maison où il entrait joyeux, d’où il ressortait troublé, inquiet, et dès le soir même il y retournait avec des battements de cœur.
Il n’avait d’ailleurs jamais laissé échapper un mot qui pût faire soupçonner qu’il aimait celle que tout bas il appelait — comme Otto la nommait tout haut — Lisbeth.
Un soir, ils parlaient de l’avenir l’un et l’autre, et ils étaient seuls.
Elle dit doucement :
« Je suis triste, monsieur Verdure. J’ai vu tout à l’heure une mère dont un boulet a tué le fils. Les pauvres mères ! La guerre est faite contre elles. Si j’avais un enfant… »
Elle sourit tristement :
« Mais j’en ai un, le petit orphelin, le cher petit Franz…
— Franz ?
— Le frère de mon fiancé. Un beau-frère, qui sera et qui est mon enfant. »
Michel eût préféré qu’on lui plongeât un couteau dans le cœur. Il prit son chapeau brusquement.
« Vous partez ?
— Oui. On se bat. Je vais me battre. »
Il avait eu l’envie de dire :
« Je vais me faire tuer. »
On se battait en effet, ou plutôt on allait repousser un assaut.
C’était le 6 juillet. On savait depuis la veille que les Prussiens voulaient décidément enlever la redoute des Clubistes. Merlin était accouru, haranguant les artilleurs, pointant lui-même les canons. Le bataillon des volontaires, que Michel venait de rejoindre, l’arme au pied, attendait. Brutus Toussaint mâchonnait sa moustache, tandis que Michel songeait à ces dernières paroles d’Elisabeth et sentait ses yeux s’emplir de larmes. « Mon fiancé ! » Ce doux mot lui semblait atroce, cruel comme une ironie. Il avait envie de se jeter au-devant des balles. Que lui importait de vivre ? Elle ne pouvait être à lui. Elle appartenait à Otto, ce vaillant et fier Otto, qui l’aimait, lui aussi, et de toute son âme.
Merlin parcourait les rangs et soufflait l’enthousiasme. C’était bien là celui que les Allemands appelaient le Démon du feu. Il semblait, dans l’atmosphère de la bataille, être dans son élément.
Les Prussiens avaient cessé de bombarder la redoute. Il s’était fait de ce côté ce silence solennellement mortel qui précède l’assaut. L’ennemi devait suivre sans doute le sillon de sa troisième parallèle, se découvrir tout à coup et bondir sur la redoute, à l’arme blanche. Fusils chargés, mèche allumée, on l’attendait. Lorsque le premier bataillon se montra, la grande voix de Merlin donna le signal : ce fut un carnage fou. La mitraille fit reculer le flot des Prussiens, qui se reformèrent bientôt sous le feu des volontaires, et roulèrent tumultueusement jusqu’aux canons, en escaladant les fascines.
Les volontaires s’étaient déjà précipités, la baïonnette en avant. Michel, avec son appétit d’héroïsme, s’enfonçait dans le bataillon prussien, tête basse, comme un taureau qui lutte, et frappait en aveugle, dans la poussière et le bruit. L’attaque des Prussiens était manquée. Ils se retiraient déjà, pêle-mêle, dans leurs fossés, et se massaient pour une nouvelle attaque. Mais les canonniers de Merlin les délogèrent bien vite. On les apercevait courant et s’abritant derrière les ouvrages en terre.
« Vive la France ! dit une voix claire derrière Michel. La redoute nous reste !… »
En se retournant, le volontaire aperçut une figure pâle et maigre, mais souriante, qu’il reconnut aussitôt. C’était l’émigré de Piennes, ce compagnon de route abandonné, laissé pour mort quelques semaines auparavant au revers d’un fossé.
« Vous, vivant ?
— Et bon vivant, de par Dieu ! Je vous retrouve donc ? Je vous cherchais partout. »
M. de Piennes, vêtu tant bien que mal d’un uniforme semi-militaire, défroque de quelque pauvre diable, ôta son chapeau et montra à Michel une cocarde tricolore qu’il y avait attachée.
« Voici ma cocarde, citoyen, vous aviez raison, c’est la bonne ! »
Et se retournant, il montra à Michel sa nuque rasée.
« Voyez-vous cela ? fit-il. Adieu le catogan ! Il était dit que je mourrais sans le catogan du Royal-Comtois. C’est un hussard prussien, au pré de Plomb, qui me l’a coupé d’un coup de sabre. Peste ! ces messieurs me le payeront. Ils me l’ont payé, ajouta M. de Piennes en montrant son fusil. »
En ce moment Merlin arrivait, suivi d’Aubert-Dubayet et de Kléber :
« Il nous faut dix hommes de bonne volonté, dit-il. Les Prussiens ont établi tout près de nous deux pièces d’artillerie qui balayent notre mur principal. Il faut les chasser ou se faire tuer. Allons, citoyens, à l’œuvre et ça ira ! »
Une trentaine d’hommes sortirent des rangs.
« Dix hommes seulement, dit Aubert-Dubayet.
— Tix, » fit Kléber.
Les trente hommes demeuraient immobiles.
« Eh bien, dit Merlin en désignant les plus rapprochés de lui, je prends au hasard. »
Il mit la main sur l’épaule de M. de Piennes.
« Toi d’abord.
— Merci, citoyen commissaire. Tu vas voir comment se comportent les ci-devant.
— Toi, ensuite. »
C’était Michel.
Quand il en eut désigné dix, ils partirent. Brutus Toussaint marchait en tête. On se glissa le long de la muraille, se laissant couler par la brèche, et, une fois hors des murs, en courant, les dix volontaires abordèrent les Prussiens à la baïonnette. Ils étaient tout près des canons lorsque la batterie fit feu.
« A terre ! » dit Brutus.
Le petit groupe héroïque se jeta à plat ventre, puis, se relevant, poussa un grand cri et se précipita sur les canons. Les artilleurs furent tués sur leurs pièces. Michel avait bondi le premier, avec une sorte de rage.
« Bravo, citoyen, lui dit M. de Piennes qui enclouait un canon, vous êtes un Achille. Mais on eût juré que vous cherchiez à vous faire tuer…
— Qui sait ? » dit Michel.
Il se sentait décidément envahi par une torpeur singulière ; son amour grandissait, remplissait son cœur, l’absorbait. Il était maintenant sombre, presque désespéré, héroïque, d’ailleurs, et, après cette journée où il avait vu la mort en face, allant demander un sourire à Mlle de Smeyer. Elle l’accueillit avec sa bonté charmante, sans se trahir, et pourtant laissant échapper son secret dans chacun de ces gestes, de ces regards que Michel ne savait pas comprendre.
Un soir, Michel se tenait à la fenêtre, regardant la nuit, tandis que silencieusement Elisabeth, les yeux sur un livre, semblait lire et ne lisait pas.
Cette nuit d’été, chaude, à la fois splendide et sinistre, Michel la trouvait atrocement douloureuse et se demandait si elle ne finirait pas. Quand on souffre, on voudrait hâter la marche du temps. Etre à demain, c’est le vœu de tous les misérables. Or, demain, pour Michel et pour l’armée, c’était l’anniversaire de la Fédération, le 14 juillet, le jour patriotique et sacré. Il se revoyait, le fusil au poing, courant à la Bastille qu’il fallait prendre, et, plus tard, brouettant au Champ de Mars, avec des femmes en robes rayées, des jeunes filles en robes blanches à rubans tricolores, la terre des fossés, et travaillant à l’autel de la Patrie. Que de souvenirs dans une date ! Et quatre ans déjà écoulés depuis ces premières et chères fièvres ! Ces éblouissements du passé lui faisaient oublier le présent, mais peu à peu sa pensée revenait à Mayence et se retournait vers Elisabeth, vers Otto, vers cette femme qu’il ne pouvait s’empêcher d’aimer, vers ce rival qu’il ne pouvait point haïr.
« Ah ! la mort, encore une fois, la mort glorieuse, en plein jour, sous une balle ennemie ! »
Et Michel écoutait le bruit incessant du canon, il regardait dans l’air les sillons que décrivaient les bombes, clartés fugitives qui rayaient de leur lueur le ciel plein de scintillements d’étoiles.
Il n’entendit pas le bruissement de la robe d’Elisabeth ; il n’entendit point le pas de la jeune fille qui s’approchait de lui. Il se retourna vivement avec un sourire étonné, lorsque Mlle de Smeyer lui posa la main sur l’épaule en lui disant :
« A quoi songez-vous, Michel ?
— A vous, » répondit-il simplement.
Ces mots avaient, pour ainsi dire, jailli de ses lèvres : Elisabeth rougit, et tous deux, à cette fenêtre, demeurèrent un moment sans parler.
« Oui, reprit enfin Michel, je songeais à vous, mademoiselle, et en y songeant je voyais passer devant moi, ironiques et railleurs, tous mes rêves d’un jour, tous mes fantômes heureux, fustigés, chassés d’un mot… Ah ! je suis malheureux et je souffre bien !
— Croyez-vous souffrir seul, Michel ? dit-elle avec une lenteur musicale : la douleur est le sort commun. Il faut nous y résigner et faire notre devoir.
— C’est vrai, dit-il avec une certaine fièvre. Et puis, après tout, ceux-là seuls sont malheureux qui le veulent bien, qui rêvent, se forgent un avenir impossible et demandent à la vie ce qu’elle ne peut donner. La vie est un sacrifice, elle n’est pas une joie. Tant pis pour ceux qui, comme moi, comme tant d’autres fous, réclament en égoïstes… »
Il s’arrêta, regarda Elisabeth, dont les grands yeux bleus, honnêtes et doux se levaient sur les siens.
« Et que réclamiez-vous, Michel ? dit-elle.
— Moi ?… Je… Et pourquoi ne vous le dirais-je pas ? Car enfin, cette affection est sacrée et de celles qu’on peut proclamer. Je vous aime, mademoiselle. (Elisabeth ne fit pas un mouvement et le regardait toujours.) Oui, je vous aime, et du fond de l’âme. Je vous aime, à ne plus songer, quand je pense à vous, à cette République pour laquelle je veux mourir. Je vous aime, encore une fois, en insensé, car que puis-je espérer ? Vous êtes fiancée à un autre. Que puis-je demander et attendre ?
— Mon affection, dit-elle lentement, mon amour de sœur et mon amitié. Je vous parlais de devoir, Michel ; mon devoir, c’est le bonheur d’Otto et de cet enfant qui n’a plus de mère. Le rêve, — le rêve, mon ami, c’était — … Mais laissons cela. Ne parlons plus de cela…
— Comment ? s’écria Michel éperdu. Qu’avez-vous dit ? Non, je suis fou, n’est-ce pas ? »
Elisabeth tenait à la main un de ces bouquets de myosotis qui fleurissent aux bords des ruisseaux. Elle le tendit à Michel.
« Tenez, dit-elle, je vous ai dérobé un jour, — et vous ne l’avez jamais su, — un petit ruban tricolore que vous aviez laissé tomber ici. Je vous donne ces fleurs en échange. Ce sont de pauvres petites fleurs bleues, dit-elle. Selon une de nos légendes, une jeune fille qui se noyait, notre Ophélie à nous, en jeta quelques-unes à son amant en lui disant : Wergiss-meinnicht. C’est le nom de la fleur. En français cela veut dire : Ne m’oubliez pas !
— Ah ! Lisbeth, Lisbeth, s’écria Michel en tombant à genoux, vous êtes bonne et je puis mourir ! »
Les obus passaient sur le ciel d’été, le canon jetait au loin son mugissement rauque. Et Michel, devant l’horizon plein d’étoiles, les lèvres sur ces fleurs qu’on lui donnait, demeurait prosterné.
Otto entra. Il vit le volontaire encore à genoux et Lisbeth qui le regardait.
« Citoyen, dit-il à voix haute, l’hôtel de ville est en flammes, on appelle tous les soldats à l’incendie. Debout ! »
Elisabeth s’était avancée vers Otto :
« Otto, dit-elle avec une dignité fière, en montrant Michel, celui-ci est mon frère ! »
Pâle, Michel alla droit vers Otto :
« Adieu, dit-il.
— Je savais que vous l’aimiez depuis longtemps, répondit tout bas Otto en rejetant en arrière ses longs cheveux blonds. Pourquoi adieu ? »
Il ajouta de sa voix harmonieuse et mélancolique :
« Vous pouvez l’aimer. Elle ne sera ni à vous, ni à moi. Le sort n’est jamais si clément que cela ! »
Michel sortit à la fois heureux et navré. Elle l’aimait, il n’y avait entre elle et lui d’autre obstacle que le devoir. Elle eût pu devenir sa femme sans Otto. Il en était comme enivré et puis, en y songeant, tant d’obstacles à cet amour, un fossé si profond ! il reculait. Pas une pensée de haine ne lui vint d’ailleurs contre ce rival dont la grandeur d’âme s’imposait. Michel entendait encore cette voix douce, triste, irrésistible. Il se fût dévoué pour lui, il admirait ce jeune homme à figure de femme qui portait en son cœur l’énergie du lion. L’incendie était étouffé.
Le volontaire rentra à la caserne et trouva Scevola essayant une jupe de femme, tandis que Brutus Toussaint, dans un coin, étudiait un rôle. Les troupiers devaient jouer le lendemain, à l’occasion de la fête de la Fédération, le Siège de Lille, l’opéra qu’on avait tant applaudi, à Paris, rue Favart, et la Caverne, du citoyen Lesueur. Brutus Toussaint s’était chargé de chanter pendant un intermède la Chanson du salpêtre.
« Débuts du citoyen Toussaint, dit-il à Michel. Écoute-moi ça, muscadin. »
Et d’une voix de basse-taille il entonna le refrain populaire qui sentait la poudre :
Michel s’étendit sur le lit de camp, tenant encore dans sa main brûlante le bouquet de myosotis.
Le lendemain était un dimanche. Les deux armées avaient conclu pour quelques heures un armistice. Il y avait fête sur les deux rives du Rhin : les guerriers donnaient leur représentation et la mort faisait relâche. Tandis que Scevola, costumé en déesse de la Liberté, récitait des vers de Marie-Joseph Chénier, les alliés, Autrichiens et Prussiens, tiraient des coups de canon pour célébrer la prise de Condé.
« Canons sans boulets, disaient nos soldats, poudre aux moineaux ! »
Et ils chantaient.
Michel, seul, parmi la population de Mayence, qui respirait pendant cet entr’acte du terrible drame du siège, parcourait les rues en regardant, en rêvant. Cette nuit même le bombardement recommença avec une furie plus intense. Les couvents incendiés, les magasins de poudre sautant en l’air, le bruit des écroulements de cheminées, des bris de portes faisait un infernal vacarme. Les bombes tombèrent comme grêle pendant les jours qui suivirent.
La ville tout entière était écrasée ; les murs croulaient. La coupole byzantine du Dom, criblée de boulets, semblait près de s’affaisser. Les murailles de grès rouge des monuments, noircies par la fumée de l’incendie, éventrées par les obus, se dressaient avec des attitudes lugubres. A chaque pas, la flamme et les boulets avaient laissé leurs traces. Les soldats riaient, — rire éternel de notre race, — en comparant Mayence à une écumoire. On voyait errer à travers ces ruines des ombres hâves, de pauvres diables qui cherchaient du pain. Le soir, des maisons désolées sortaient souvent, comme une protestation ironique, des bruits de fête joyeuse. C’étaient les Français qui organisaient des bals et narguaient la famine avec des entrechats.
Merlin de Thionville, dans le palais du gouverneur, invitait à ses réceptions la bourgeoisie de la ville. Une fusillade interrompait la danse. La musique était ponctuée par les coups sourds du canon. Peu importe. On dansait, et le conventionnel ouvrait le bal dans son costume de commissaire déchiqueté par les baïonnettes autrichiennes.
Pour la disette, on s’en moquait. Les rats payaient les frais de la guerre. On parlait beaucoup du succulent dîner qu’avait offert à son état-major le général Aubert-Dubayet : un chat rôti servi au milieu de douze souris farcies de poudre. Les grenadiers criaient au gourmet.
Malgré tant de malheurs, ils savaient rire encore.
Lorsque l’arrivée des Français avait été annoncée à Mayence, la plupart des familles, entassant à la hâte leurs tableaux, leurs meubles précieux, leurs papiers dans les berlines, avaient pris la fuite aussitôt. Le gouverneur, un des premiers, réunissant ses titres, bourrant ses malles, transi de peur, était parti, laissant la population un peu effrayée, il avait emmené ses gens et jusqu’à son chien, qui trottait derrière la voiture. Le soir, dans les rues, on s’entretenait avec stupeur de ce départ soudain, qui présageait tant de malheurs. Si le gouverneur fuyait ainsi, quels désordres les Français allaient-ils donc commettre dans Mayence ? Et voilà qu’on vit arriver, passant le pont, entrant bravement par la porte de la ville, triomphant, rassuré, le chien du gouverneur, qui abandonnait son maître fugitif pour rester à son poste. Le palais du gouverneur était désert, mais la niche du chien du gouverneur n’était plus vide. — « C’est bon signe, » dirent les commères mayençaises !
Les Français, en arrivant, avaient adopté le chien, le baptisant Brunswick. On lui faisait faire l’exercice. Brutus Toussaint lui apprenait la manœuvre.
« Saute pour la République, Brunswick, » disait Scevola.
Le chien du gouverneur sautait pour la République.
« Un grognement pour Pitt et Cobourg, Brunswick ! »
Le chien grognait contre Pitt et Cobourg.
Et les pauvres diables, sans pain, trouvaient toujours çà et là quelques miettes pour Brunswick.
Tant de misère ne pouvait pourtant durer. Après avoir tout épuisé, munitions, armes, dernières ressources, Merlin se décida à traiter. Michel errait autour de la cathédrale, un matin, lorsque Brutus lui dit avec un juron :
« Tonnerre ! c’est vexant, citoyen, nous déguerpissons ! Dorénavant on va manger à son aise, à ce qu’il paraît. Comme si un sans-culotte avait besoin de dîner autrement qu’en se serrant le ventre ! On capitule, c’est dit. Moi, j’aurais préféré crever de faim et crever ici.
— Es-tu sûr qu’on capitule ?
— Entre là, » dit Brutus, en désignant la cathédrale.
Michel entra dans l’église. Les hussards s’occupaient à enlever les maigres restes de fourrage qui avaient un moment caché les tombes des électeurs et les statues des évêques de Mayence. La vieille église, le Dom, était dans un piteux état. Les bombes avaient pénétré dans le chœur, éclaté parmi ces marbres écornés. Les vitraux brisés des chapelles gardaient encore la trace du foin. Les soldats s’étaient exercés à faire, au charbon, des moustaches aux figures des saints ; d’autres avaient cassé le nez des statues de ces terribles évêques de Mayence, qui, de leur crosse et de leur épée, faisaient trembler sur leurs trônes les empereurs d’Allemagne.
Au-dessous des inscriptions latines, les hussards avaient tracé leurs devises : « A Clémentine pour la vie. — Vive la nation ! — A bas l’abbé Maury ! »
« Est-ce que nous quittons la ville, citoyen ? demanda Michel au brigadier qui surveillait ce déménagement.
— Dans deux jours, dit-on. Ces préparatifs sentent le boute-selle. Oh ! le siège est fini !
— Les volontaires sont-ils prévenus ?
— Non, mais la division Kléber fait ses sacs. »
On partait. Il fallait quitter Mayence, quitter cette maison où Mlle de Smeyer demeurait. Michel se sentait le cœur serré. Il voulut aller droit à Elisabeth, lui dire une dernière fois qu’il l’aimait et s’éloigner. Mais non ; il fallait voir avant elle Otto. C’était l’heure du club et jour de séance. Pour trouver Schwartzen, il y alla.
La salle était pleine déjà, et, sous un drapeau tricolore dont les plis embrassaient un buste en plâtre de Brutus, se dressait la tribune vide encore. Les clubistes attendaient, assis sur des gradins. Il se faisait un silence tragique, et tandis qu’un amer souci plissait tous ces fronts, une résignation stoïque animait tous ces regards. Michel s’assit entre deux jeunes gens qui causaient de la capitulation prochaine. La nouvelle en était décidément officielle.
« Les Français partis, disait l’un, le roi de Prusse voudra venger sur nous l’affront fait à ses armes. C’est notre arrêt de mort.
— Nous mourrons, » répondit l’autre.
Le président du club expliquait déjà à l’assemblée la situation de Mayence. L’héroïque garnison ne pouvait plus lutter. Point de fourrages, l’incendie avait tout détruit. Plus de nourriture, on avait abattu et mangé les chevaux inutiles. Les hôpitaux encombrés de malades, et point de remèdes. Des décoctions au lieu de bouillon. La misère, la maladie, la mort par la faim. Dans tout Mayence, avait dit et répété Merlin, pas une place large comme un chapeau où un homme pût être en sûreté pendant une heure. Il fallait céder. On avait cédé. Le roi de Prusse laissait librement partir cette garnison de héros, et avec eux tous ceux des patriotes mayençais qui voudraient suivre l’armée française.
« On les échangera, ajouta le président, contre ceux des otages allemands que la République française retient prisonniers à Nancy. Et il nous faut, citoyens, remercier ici le représentant de la Convention, qui a refusé de laisser aux haines et aux vengeances de la réaction ceux d’entre nous qui ont embrassé le parti de la liberté.
— Vive Merlin ! » dit le voisin de Michel avec un grand cri.
Un jeune homme s’était levé, demandant la parole, et Michel le vit monter d’un pas lent et ferme les degrés de la tribune. C’était Otto.
« Citoyens, dit-il, vous avez entendu, vous avez compris le sens de la capitulation. Les Français ont défendu nos droits et sauvegardé notre liberté. Nous pouvons les suivre et marcher avec eux, aller en France. Rien ne nous arrête. Les grenadiers du roi de Prusse nous laisseront passer. Voilà notre droit. Voulez-vous que je vous dise quel est votre devoir ?
— Oui ! oui ! s’écrièrent plusieurs voix.
— Votre devoir est de rester sur la terre allemande, votre devoir est de ne pas quitter Mayence. Nous pouvons parler sous ce drapeau français, dont les trois couleurs disent liberté, égalité et fraternité, mais nous ne pouvons pas combattre. Allemands, nous pouvons réclamer la liberté de nos frères et du monde, nous ne pouvons pas lutter contre nos compatriotes, même dans les rangs de nos libérateurs. Suivre l’armée de la Convention, ce serait déserter la patrie. Notre place, citoyens, est sur cette terre de Germanie, qui sera libre un jour, — peut-être parce que nous l’arroserons de notre sang aujourd’hui.
— Vive l’Allemagne !
— Vive la liberté ! » répondit Otto.
Michel se sentait électrisé, entraîné, il eût voulu aller droit à son rival et l’embrasser.
« Oui ! continuait le jeune homme, la liberté ne demande pas seulement des héros, elle réclame des martyrs. Nous serons ces martyrs-là. Nous serons ceux dont on répétera les noms plus tard pour dire dévouement et sacrifice à la patrie. Nous serons ces ambitieux qui veulent baptiser de leur sang les nations régénérées. Pour moi, je le jure, au nom de notre chère Allemagne, je ne quitterai point Mayence, et j’attendrai, calme, résolu, heureux et fier, l’arrivée de nos bourreaux. »
Une immense acclamation retentit. D’un seul mouvement, tout ce club se leva, répétant, la main étendue, le serment de mourir sur la terre allemande. Les cœurs battaient, les voix étaient énergiques et assurées. Michel seul, les larmes aux yeux, se sentait ému.
Quand Otto descendit de la tribune, la première main qu’il rencontra fut celle de Michel.
Ils revenaient tous deux par les rues désertes, silencieux, lorsque Otto dit lentement :
« Avant de partir, citoyen, venez me voir chez moi. Je veux vous demander quelque chose, un service.
— Nous partons bientôt, peut-être. Demain, je serai chez vous. Salut et fraternité.
— Fraternité, » dit Otto Schwartzen en appuyant sur le mot.
Le lendemain, 24 juillet, les premières troupes devaient déjà quitter Mayence. Les alliés avaient pris possession, dans la nuit, des ouvrages avancés.
Le défilé commença à midi, sous le soleil de juillet qui incendiait les édifices, couvrait le large Rhin d’étincelles et de rayons, et dorait les hauts édifices de Mayence où les bombes et les boulets avaient marqué leurs trous à côté des dentelures gothiques. La chaussée entière était envahie par le peuple, par les curieux, par la foule, toujours âpre à tout spectacle comme à toute curée. Otto, seul, et sorti tout exprès pour voir ce spectacle de loin, les bras croisés et l’attitude sombre, contemplait cet amas de gens se pressant pour voir partir l’ennemi et lui jeter des malédictions ou des menaces. L’immense murmure sourd de cette ville en mouvement, le mugissement qui s’échappe de la foule comme de la mer, l’attristait, et pourtant l’électrisait comme un premier grondement d’orage :
« Eh bien ! soit, pensait-il, acclamez le retour de ces troupes du roi qui traînent après elles le despotisme et la féodalité. Je mourrai pour affirmer la grande liberté que ces Français, les ennemis, emportent enveloppée dans leurs drapeaux en haillons. »
Il demeurait là, lorsque tout à coup il se fit un grand remous dans tout ce monde. Des milliers de têtes se tournaient d’un même côté et un piétinement de chevaux, un bruit d’acier annonçaient un escadron en marche. C’étaient des cavaliers prussiens, sabre en main, qui ouvraient le défilé. Le soleil pailletait leurs cuirasses et y allumait un feu comme un foyer d’incendie. Les armes embrasées ressemblaient à des lignes d’acier en fusion. « Vive le roi ! » criait la foule, « Vivent les cuirassiers ! » Noirs de poudre, en guenilles, les habits déchirés, héroïquement hideux, marchant allégrement, le front haut, fiers de leurs loques, les troupiers français suivaient, regardant la haie de curieux avec l’air ironique du Gaulois que rien n’effraye. Otto voyait se dérouler, au-dessus des têtes, les baïonnettes étincelantes balancées par la marche, elles semblaient un fleuve de fer.
Otto, levant les yeux, remarquait à l’une des fenêtres de la maison de la chaussée, un homme à visage de demi-dieu, le front immense, un regard d’aigle sous d’épais sourcils, je ne sais quoi d’olympien et d’imposant dans sa beauté superbe, et qui, avec le calme dédaigneux de l’artiste qui observe, regardait tout cela passer avec une altière majesté.
Les Français défilaient. Le flot poussait les grenadiers après les volontaires, tous maigres et farouches, marchant au pas, marchant en rang, avec cette idée de faire mâle figure devant toute insulte. Les uns, les cheveux longs, ressemblaient à des paysans bretons ; les autres, rasés tant bien que mal, les cheveux coupés au hasard, à coups de sabre, avaient l’air de forçats. Un tambour-major, splendide en ses haillons, jetait en l’air sa canne, dont une balle avait bosselé le cuivre. Les curieux, saisis, émus peut-être, n’injuriaient pas. On eût dit qu’ils admiraient.
« Les chasseurs ! les chasseurs ! » s’écria-t-on.
Les chasseurs à cheval débouchaient, mettant au pas leurs montures, superbes de tenue et silencieux. On se rappelait ce qu’ils avaient fait une nuit, lorsque bon nombre de femmes et d’enfants de Mayence, fuyant la famine, s’étaient réfugiés au camp du roi de Prusse. Le roi prussien les avait chassés, eux, des Allemands, à coup de canon, et les chasseurs français, accourant, avaient ramené à Mayence les femmes et les enfants en croupe sur leurs selles.
Peu s’en fallait qu’un grand cri ne sortît de cette foule venue pour maudire : « Vivent les chasseurs de Cassel ! »
Tout à coup, la musique des cavaliers, attaqua bravement et brusquement la Marseillaise. Ce fut comme un coup de tonnerre. Un frisson électrique parcourut toute la chaussée ; Otto sentit vibrer en lui toutes les cordes du vrai patriotisme, de l’héroïsme et du sacrifice. Il fit quelques pas en avant, écarta des curieux, et, comme transporté, il s’écria, levant les bras, jetant aux chasseurs comme un dernier adieu :
La foule oscilla, et autour du jeune homme éclata aussitôt en menaces. On repoussa Otto, qui semblait ne pas voir et ne pas entendre.
« C’est un clubiste ! dit quelqu’un. — Je l’ai vu au club, je l’ai écouté. — C’est Otto Schwartzen ! Un buveur de sang ! — A mort ! — Otto Schwartzen, à mort !
— Allons donc, s’écria Otto, dont l’œil flamboya, tuez-moi, puisque la liberté est morte ! »
Il croisa les bras, levant ses yeux bleus vers ce ciel de juillet et attendit. « A mort ! à mort ! » Les foules sont lâches. Elles ont en elles de la bête fauve ; dès qu’une goutte de sang est versée, elles mordent et déchirent, mais elles hésitent devant le premier coup. Un homme à cheval se détacha d’un escadron de cavaliers qui passait, et poussant la tête de sa monture vers le groupe qui entourait Otto :
« Arrière, dit-il en se penchant (il portait un uniforme de conventionnel, et son sabre battait sur ses bottes déchirées). Je représente ici la République française, une et indivisible. Tout citoyen qu’on attaquera pour avoir aimé la liberté sera vengé, sachez-le bien, par les enfants de la liberté. Que pas un de vous ne touche à un cheveu de ce jeune homme !
— C’est un clubiste ! A bas les clubistes ! A mort les Français ! »
Le cavalier se redressa, promena sur la foule un de ces regards dominateurs qui font reculer les masses, et cria fièrement :
« Je suis Merlin de Thionville ! Est-ce que vous croyez que c’est la dernière fois que vos soldats vont nous revoir ? Nous les retrouverons, et Mayence aussi. Soyez prudents ! »
Il fit signe à des officiers prussiens qu’il apercevait dans la foule :
« La promesse de votre roi est formelle. Nul ne sera inquiété ! Vous ferez respecter cette convention, j’espère ! »
On s’était écarté déjà et Otto était libre. Il voulait remercier Merlin, mais le conventionnel avait déjà rejoint le groupe à cheval de commissaires français et disparaissait, aux côtés de Rebwell, leurs plumes roussies par la pluie et la poudre rayonnant encore avec leurs trois couleurs.
Otto s’éloignait, poursuivi par quelques clameurs et abattu comme tout homme qui voit s’écrouler son rêve, lorsqu’il se trouva face à face avec l’homme qu’il avait tout à l’heure aperçu à la fenêtre.
« Vous êtes perdu, lui dit ce spectateur à l’air froid. Voulez-vous que je vous obtienne un sauf-conduit du roi de Prusse ? »
Otto regarda cet inconnu, dont l’œil était à la fois sévère et attendri.
« Je ne vous connais pas, murmura-t-il, citoyen.
— Vous me connaissez, fit l’autre. Moi aussi je sais votre nom. On m’a rapporté les folles paroles que vous avez prononcées dans les clubs ; certes, vous êtes fou, vous et vos pareils, mais un fou en liberté parle sagement et la sagesse est muette quand elle est esclave. Je comprends aussi votre enthousiasme pour la Révolution de France. Sous le canon de Valmy, pendant que les boulets de Kellermann couvraient de boue nos soldats décontenancés, j’ai bien vu que là et en ce jour commençait une grande époque historique. Mais il faut être prudent en notre monde, et ne s’émouvoir qu’à de certaines heures. L’art, — quel que soit un métier, et je ne connais point le vôtre, il peut devenir un art, — l’art est un calmant qui vous consolera de la politique. Schiller se consume à lutter contre des abus ; j’ai ramassé des cailloux et fait des expériences physiques pendant des batailles. Un conseil, citoyen clubiste. Quittez Mayence, oubliez ces accès de fièvre, et si dans le refuge que vous choisissez vous avez besoin de Gœthe, je suis là !
— Merci, répondit Otto, fou je suis et fou je resterai, citoyen. Ma place est à Mayence et peu m’importe que ce soit une tombe. Adieu ! »
Il prit le détour d’une rue et Gœthe le suivit des yeux longuement, comme un homme qui observe et qui n’oubliera plus.
Rentré chez lui, Otto y trouva Michel Verdure qui l’attendait. Il lui raconta cette scène.
« Les hommes, dit-il, sont une triste espèce ! Pour les aimer il ne faut considérer que l’humanité.
— Mais, dit Michel, vous devez bien voir quel sort vous attend. Pourquoi demeurer ? Malgré votre noble langage de l’autre soir, pourquoi vous exposer à une mort certaine ?
— Mon ami, dit Otto avec une résignation stoïque, il m’est indifférent de vivre ou de mourir. Je puis tomber aujourd’hui, les idées que j’ai défendues triompheront demain. C’est l’important. Je le vois bien que nous sommes condamnés, les clameurs de mort se sont déjà fait entendre. La meute des réacteurs est entrée à Mayence avec les Prussiens. Des bourgeois paisibles, de braves gens aveuglés par la peur menacent d’assommer tous les clubistes. Je serai peut-être arrêté cette nuit. J’en suis heureux. A toute cause, je vous le répète, il faut des martyrs.
— Vous avez raison, fit Michel lentement.
— Je ne regrette, reprit le jeune homme, qu’Elisabeth au monde, elle et ce pauvre enfant, mon frère. Elisabeth ! je l’aimais et l’aime bien. Je l’aime plus que vous, Michel. Elle a été toute ma vie. Vous, entraîné dans l’aventure, avec cette vie de soldats qui vous attend, vous l’oublierez. Moi, je veux partir en me répétant qu’elle aimera le petit comme je les eusse aimés l’un et l’autre. Laissez-la-moi, Michel. Lisbeth sera la mère de Franz. Elle ne peut être la femme de personne.
— Je n’oublierai point Mlle de Smeyer, répondit Michel d’une voix brisée, j’emporterai partout, — et ce sera bien loin, — votre souvenir à vous deux. »
Otto lui tendit la main.
« C’est l’égoïsme du mourant, dit-il. Avec son nom sur mes lèvres, l’appelant toujours ma fiancée, je tomberai mieux, j’en suis sûr.
— Nom de fiancée, nom de sœur, répondit Michel, nous l’aimons comme elle mérite d’être aimée. »
Il mit sa main dans la main d’Otto.
« Vous avez la fièvre, Michel. Vous souffrez ?
— C’est mon état de souffrir, » dit le volontaire.
Ils demeurèrent encore ainsi, l’un devant l’autre, debout. Tout à coup on entendit dans la rue un peloton de soldats qui défilaient en chantant un refrain de caserne et, changeant de ton, Otto dit en montrant par la fenêtre les maisons effondrées de Mayence :
« Voilà pourtant ce qui nous a rapprochés l’un de l’autre, cette horrible chose : la guerre. Maudits soient ceux qui nous condamnent à ces crimes ! Michel, je vous ai aimé parce que vous étiez le soldat de la liberté, le citoyen armé pour l’affranchissement de sa patrie et le volontaire du droit. Mais j’ai peur en entendant vos grenadiers fredonner ces chansons de soudards. Votre humeur française est belliqueuse, et je tremble qu’après les guerres de justice, quelque général vainqueur, votre Dumouriez ou votre Moreau, n’entreprenne les guerres odieuses, pseudonymes du crime, guerres entreprises pour galonner les habits de grenadiers ou donner une plus haute paye aux officiers. Pourquoi avez-vous enfoncé les bataillons des soldats du roi de Prusse ? C’est qu’avec vous marche l’idée. L’idée contre l’obéissance passive, la foi contre la solde, l’idéal humain contre l’abdication de l’individu, voilà les véritables forces. Citoyen armé, je vous ai tendu la main ; soldat marchant au pas sous un caporal, je vous eusse haï.
— Ne craignez rien, dit Michel. Nous avons des généraux qui ne font la guerre que pour arriver à la paix… Hoche appelle ses soldats mes camarades, et leur dit : Battons l’ennemi pour retrouver plus vite notre foyer vide. La France a pris les armes pour se défendre, elle ne les gardera point.
— Je le souhaite, » fit le jeune homme.
Pendant qu’ils parlaient, la porte de la chambre s’était ouverte doucement, et un enfant de dix ans, blond, le visage déjà sérieux, s’était glissé derrière Otto, et lorsqu’il eut fini :
« Mon bon frère, dit-il en tendant son front où frisaient ses cheveux bouclés, pourquoi ne m’as-tu pas embrassé aujourd’hui ? Est-ce que tu es fâché ?
— Cher enfant ! » répondit-il.
Il l’attira à lui, l’embrassa à plusieurs reprises, et le montrant à Michel :
« Voilà le fils de Lisbeth, » dit-il avec mélancolie.
L’enfant regardait, sans comprendre, avec un air triste.
« Elle l’élèvera, elle en fera un homme. Mon cher et pauvre petit Franz ! »
Sans dire un mot, Michel reprit la main d’Otto.
« Vous avez raison, » dit-il tout bas, étouffant un sanglot qui lui montait à la gorge.
Otto lui tendait les bras ; il s’y précipita. Lorsqu’ils se furent un moment embrassés :
« Eh bien ! dit Michel, je n’aurai point le courage de la revoir. Dites-lui que je l’aimais et que je ne l’oublierai jamais. Oh ! jamais ! »
Il sortit. La nuit venait. Il boucla son sac, mit le bouquet de myosotis qu’elle lui avait donné jadis dans les feuillets de son Montaigne, et dit à Toussaint :
« Quand partons-nous ?
— Demain, à l’aube. »
Michel prit un feuillet de papier et écrivit d’une main ferme :
« Je vous aimais, Elisabeth. Mais celui qui est digne de votre amour, c’est celui que vous épouserez. Aimez-le. C’est l’âme d’homme et de républicain la plus haute qu’ait rencontrée celui qui signe
« Votre frère. »
Il pria Scevola de porter le billet à la maison Smeyer.
Le lendemain, comme le tambour battait la diane, en descendant dans la cour de la caserne, sac au dos, guêtré, prêt à partir, Michel Verdure aperçut avant tous Otto qui venait à lui.
« Lisez, » dit le jeune homme, en lui tendant un billet.
Le volontaire déploya le papier d’une main fiévreuse.
« Adieu, disait Mlle de Smeyer. Je suis fiancée à Otto Schwartzen qui s’est lui-même fiancé à la mort. S’il n’est plus là pour élever le petit Franz, je resterai, portant son deuil, en apprenant à l’enfant qui grandira le nom du patriote mort pour son pays, et aussi, Michel, celui du fier soldat qui s’est assis à notre foyer et qui pour toujours y a laissé son souvenir. »
« Ah ! dit Otto, en voyant l’émotion de Michel, nous avons raison de l’aimer. Celle-là est une femme.
— Adieu, mon frère ! » dit le volontaire.
Le tambour battait.
« Adieu, dit Otto. Moi ici, vous là-bas, nous combattrons avec le même nom sur les lèvres. Allez combattre. Moi je vais mourir.
— Vive la République ! s’écria Michel avec une sorte d’ivresse et pour secouer sa douleur.
— Vive, répondit Otto, la liberté du monde ! »
Le bataillon se mit en marche. Scevola sifflait le Ça ira. Brutus Toussaint jetait aux Autrichiens qu’il rencontrait dans les rues des menaces terribles. M. de Piennes, qui suivait, embrassait pour la dernière fois, tout en marquant le pas, des Mayençaises. Les fillettes riaient et se laissaient faire.
Le bataillon devait passer justement devant la maison d’Elisabeth.
Michel se rappelait ce jour où on l’avait apporté là, mourant. Que de temps passé ! Quelles longues heures ! Et voilà que tout allait finir et que tout s’effaçait. Il lui semblait qu’il avait fait un rêve et que rien n’était arrivé. Ses yeux se levaient pourtant vers les fenêtres closes avec une avidité tremblante, une anxiété et comme une ardente prière.
Quand il passa, il vit une main qui tremblait, tenant un bouquet de myosotis noué d’un ruban tricolore ; le ruban qu’elle avait ramassé.
Le bataillon tourna l’angle de la rue. Tout disparut. Adieu, fantômes !…
M. de Piennes maintenant chantait aussi le Ça ira, et l’on apercevait, sur le pont du Rhin, les soldats qui fièrement défilaient, tête droite devant l’ennemi.
L’armée de Mayence alla se fondre en Vendée. Elle entra, baïonnettes en avant, dans ces buissons, dans ces genêts, dont chacun cachait un ennemi. Elle poussa devant elle les bandes terribles de l’armée royale. Dans ces mêlées atroces où Bourbotte et Kléber écrasaient les Vendéens, les intrépides Mayençais marchaient en avant, donnant leur vie, donnant leur sang.
Leurs rangs s’éclaircissaient d’ailleurs. Les blancs achevaient l’œuvre des grenadiers prussiens, des hussards saxons et de la famine. Pas un ne murmurait.
Dans les haltes, dans les marches, Michel songeait à cette idylle allemande, à ce songe entrevu au bord du Rhin et disparu soudain. La fin avait été tragique. Un mot d’Elisabeth avait tout appris à ce volontaire errant, condamné à la guerre civile après avoir souhaité la paix universelle :
« Otto a été fusillé. Je suis veuve. Il me reste le petit Franz. Oubliez-moi. »
L’oublier ! Michel n’oubliait pas. Il mêlait ce doux souvenir de femme à son ardent amour de la patrie.
Il le gardait, ce débris de tendresse unique, comme un secret amer, savouré en silence, et plus cher, et plus puissant, plus profond par son amertume même. Le volontaire avait juré de mourir avec les fleurs fanées et la fière cocarde au chapeau.
Une nuit, posté dans une petite maison incendiée à demi et dont les quatre murs écroulés offraient à peine un abri contre la pluie, Michel Verdure veillait, tandis que M. de Piennes, accoudé à une fenêtre sans carreaux, regardait la nuit. Les soldats jouaient autour d’une chandelle de résine avec un vieux jeu de cartes crasseux. Michel pensait aux absents, songeant aux morts. M. de Piennes, dans la nuit noire, pluvieuse, malsaine, regardait la sentinelle (c’était Brutus Toussaint) piétiner dans la boue. Scevola fredonnait gaiement sur l’air : Adieu donc, dame Françoise, la ronde patriotique de l’almanach du père Gérard :
M. de Piennes se retourna.
« Brr, dit-il. La vérité est que rien ne me semble plus désagréable qu’une fenêtre brisée par un temps de bise. Eh bien ! citoyen Verdure, nous voilà rêveur comme sir Hamlet ! A bas les Anglais donc ! Pas de spleen. Voyez ce beau ciel de France, noir comme l’encre ; y a-t-il rien de plus gai au monde, je vous prie ? »
Michel parut secouer sa torpeur, il releva la tête.
« Vous avez raison, haut le front ! Nous avons besoin de toute notre décision !
— Bah ! parce que ces paysans croient nous tenir et nous donneront l’assaut demain ? Peste soit de leurs faulx, je m’en moque comme d’un rhume. Laissez le jour se lever.
— Ils nous attaqueront cette nuit.
— Oui-da ! Tant mieux. Je n’ai pas sommeil. Une bataille est un remède certain contre l’insomnie ! »
Il se fit un silence. Scevola continuait sa chanson.
M. de Piennes se mit à rire.
« Au refrain ! » dit-il. Et ce refrain il l’entonna gaiement :
En ce moment la voix de Brutus Toussaint demandait au dehors :
« Qui vive ?
— Alerte, dit Michel.
— Qui vive ? » répéta la sentinelle.
On entendit, dans la nuit, un double coup de feu retentissant. Tout le monde fut sur pied. Les soldats prenaient leurs fusils, se jetaient hors de leurs masures, interrogeaient la nuit.
« Les brigands sont là, dit Brutus à Michel d’une voix rauque, haletante, là… là… »
Il indiquait dans l’ombre un point invisible.
« Qu’est-ce que tu as ? Est-ce que tu es blessé ? demanda Michel frappé du son de voix de Brutus.
— Ce que j’ai ?… Mon compte est réglé. Une balle dans le ventre. Ils ont tiré les premiers. Canaille, va ! Vive la République ! »
Il tomba sur les deux genoux, dans la boue.
Michel, dont les yeux s’habituaient à l’obscurité, regardait une masse noire devant lui, une chênaie où devaient être tapis les blancs.
« Attendons ! »
Le petit détachement, les armes prêtes, se massait et se tenait coude à coude pour former un point plus petit sur ce coin de terre où le sol lui-même était ennemi.
« Qu’ils attaquent au moins de suite, disait M. de Piennes. L’attente impatiente. »
On eût dit que ces paroles, murmurées tout bas, étaient un signal. Cette nuit opaque fut rayée d’une dizaine de coups de feu. Le groupe de volontaires oscilla, on entendit des soupirs dans la nuit. Michel sentit glisser sur son épaule la tête de Scevola qui s’appuyait sur lui et une liqueur chaude lui tomba dans le cou, — du sang, le sang de son voisin.
« Feu ! cria-t-il. Ah ! tonnerre ! »
Il était fou de rage. Le détachement avait déjà riposté. Le bruit sourd des corps qui tombent, le grincement d’armes qu’on recharge, les plaintes de blessés qu’on ne voit pas, se croisaient dans cette ombre.
« Dans la masure, dit Michel ; ils sont nombreux, défendons-nous dans la masure !
— Impossible de marcher, fit M. de Piennes. J’ai la cuisse brisée. »
Au même moment, comme une tribu de Mohicans qui eût bondi sur l’ennemi, les chouans se précipitaient sur les soldats, la baïonnette au bout du fusil et poussant des cris terribles. Les volontaires se sentaient entourés, cernés, sûrs d’être égorgés. Ils se battaient dans la nuit, corps à corps. Les armes, les couteaux, s’enfonçaient dans les poitrines. On se prenait à la gorge. On se traînait en hurlant dans la boue et dans le sang. Michel frappait, de son sabre, au hasard, en criant. Il se sentit tout à coup blessé à la jambe et poussa une plainte horrible. On lui sciait la jambe avec une serpe. Il s’affaissa ; on se précipita sur lui. Des ongles s’enfonçaient dans son visage. On le garrottait. Il voyait vaguement s’agiter dans l’ombre des silhouettes tragiques, des démons armés.
« Mais tuez-moi donc, » disait-il.
La lutte continuait, — vingt hommes contre cinq cents peut-être. On emporta Michel Verdure dans la petite ferme où les républicains devaient passer la nuit. Les chouans avaient allumé dans les restes de la haute cheminée un grand feu clair qui incendiait ces murailles d’un reflet rouge. Autour du feu, accroupis et joyeux, leur croix au chapeau, leur signe de ralliement sur leurs vestes, les chouans riaient. Michel regarda.
M. de Piennes, le front en sang, les jambes dans le feu, se retourna vers lui et eut la force de plier son visage à un sourire contracté, sinistre, d’une gaieté affreuse. On lui brûlait les pieds, on le chauffait.
« Les lâches ! ah ! les lâches ! s’écria Michel.
— Laissez donc, laissez donc, citoyen, murmura M. de Piennes d’une voix faible, ces messieurs s’amusent.
— Ah ! misérables, on vous fusillera ! dit Michel.
— Patience, répondit un des chefs, taillé en boucher, — Barbotin ou Six-Sous, — nous vous en ferons bien voir de plus belles !
— Et il ne crie pas ! fit un autre en mettant son poing fermé sous le nez de M. de Piennes.
— J’ai l’humeur taciturne, » répondit le marquis souriant toujours.
Il regarda encore Michel :
« Est-ce que le cœur vous en dit, citoyen ?… Ah ! sur l’honneur, je n’ai jamais compris comme aujourd’hui l’histoire de Guatimozin ! »
Puis, tout à coup, grimaçant malgré son courage, il poussa un grand soupir et s’évanouit.
« A celui-ci, dit le chef en montrant Michel.
— Vive la patrie ! dit le volontaire. Vive la République ! »
On prit Michel, garrotté, à bras-le-corps et on lui mit les pieds dans le brasier. Il poussa un cri perçant, un cri sinistre, aigu, atroce. D’un mouvement terrible, il se dégagea des mains qui le tenaient, il brisa ses liens, il bondit comme un fou, la douleur doublant ses forces, et il se précipita sur la baïonnette d’un chouan. L’arme lui entra dans le cœur.
Il lui vint aux lèvres une mousse rouge, et, les bras étendus, il tomba à côté du brasier.
« C’est de l’ouvrage de moins, fit un chouan.
— Soyons humains, répondit le chef. Cet autre-là peut respirer encore ! »
Et appuyant un pistolet sur la tempe de M. de Piennes, il lui fit sauter la cervelle.
— 1869 —
Paris a, pour ainsi dire, ses banlieues et ses villes de province intérieures. Le quartier des Invalides est de ces banlieues-là. C’est un coin spécial de la grande cité, c’est une ville dans une ville. La proximité de l’École Militaire et l’éloignement du centre bruyant lui donnent à la fois l’aspect d’une sous-préfecture et d’une ville de garnison. Les bourgeois du quartier y saluent en passant les officiers du voisinage. On y vit retiré, oublié, recevant les gazettes du jour trois ou quatre heures après que le contenu en a été lu, relu, commenté et réfuté sur le boulevard ou dans le quartier Montmartre ; on y respire paisiblement, on y boit, comme à petites gorgées, un air moins épais que dans les rues centrales. On y est à la fois à la campagne et à Paris.
Les rues, les boulevards, de ce côté, rappellent tous des souvenirs de guerre et portent des noms de généraux, Cambronne, Chevert, Éblé, Oudinot ou La Tour-Maubourg. Des cafés, des restaurants, des guinguettes, des marchands de vins à la porte desquels des lauriers-roses fleurissent dans leurs caisses de bois peint en vert, des gargottes où l’on entend crépiter les fritures, tout un petit commerce de nourriture vit là, côte à côte, se faisant concurrence sans se ruiner. Les boulevards, larges et à demi déserts, sont occupés par des terrains encore vagues, mais qui, de mois en mois, se couvrent de maisons. On croirait retrouver les boulevards voisins de la Bastille, il y a vingt-cinq ans. Des chantiers, des briqueteries, des fabriques, des plâtreries. Çà et là quelques marchands de bric-à-brac, vendant les détritus entassés de tout ce qui fut le luxe d’un Paris éteint ou la gloire d’une époque évanouie : habits de généraux ou d’académiciens, sabres de mamelucks, pendules aux ornements de sphinx, datant de la campagne d’Égypte, baromètres dédorés et brisés à demi, vieux livres dépareillés, vieilles gravures trouées et déchirées, études académiques de rapins morts de misère, shakos de voltigeurs du premier empire, capotes de soldats de Waterloo ou de figurants du Cirque. Tout se coudoie dans un pêle-mêle poudreux et affligeant. Mais la vie est auprès de ces choses mortes. Des enfants passent, jouant au cheval, se tirant la blouse ou causant, leur panier de classe pendu au bras gauche. Les longues rues qui partent de la place Cambronne — la rue Croix-Nivert, la rue Cambronne — avec leur physionomie populaire et laborieuse, leurs débits de liqueurs, leurs magasins d’habillements, leurs épiceries, leurs blanchisseries, ne sont point sans garder un je ne sais quoi de vigoureux et de hardi.
Le soir, en effet, tout ce quartier, paisible et silencieux durant le jour, s’allume et se met en joie. Les rues sont animées, pleines de bruit et de chansons. Derrière les rideaux rouges des marchands de vin, on aperçoit des faces rubicondes, on entend s’épanouir de gros rires bruyants, dignes des buveurs de Brauwer ou d’Ostade. Les gamins jouent en pleine rue, et se traînent et se roulent dans le ruisseau, à deux pas des voitures qui les éclaboussent. Les femmes, en camisole blanche, accroupies devant les portes, causent dans le crépuscule des soirs d’été. Les larges lanternes et les enseignes transparentes des hôtels garnis forment, le long de la rue, comme des éclairages d’illuminations. Ici on loge à la nuit. Par les fenêtres ouvertes des bals, la musique des quadrilles, le bruit des talons battant le parquet, les rires des danseurs et les cris de commandement du chef d’orchestre, arrivent au passant et forment de tous côtés un bruit bizarre, où tout se mêle, le couac de la clarinette et le titillement grinçant du crin-crin, l’appel du cavalier seul et la note aiguë de la valseuse dont la tête tourne, sorte de confusion plus musicale qu’harmonieuse, et qui grise pourtant, et donne des envies de se joindre à la ronde, à cette joie brutale, tapageuse, assourdissante mais gaie.
C’est le quartier de Grenelle et c’est la promenade et le lieu de plaisir des invalides. L’Hôtel où les vieux soldats ont trouvé asile n’est pas loin et on aperçoit d’à peu près partout, de ces côtés, sa coupole.
De loin, le dôme doré scintille, avec ses ornements brillants, bruni sur les nervures, comme si toutes les misères que contient l’Hôtel des Invalides s’épanouissaient, se sublimaient dans un nimbe de gloire. Le soleil accroche ses rayons à cette coupole élégante, à ces toits d’ardoises d’un noir bleu qui couvrent l’Hôtel, puis redescendant, comme pour se jouer, vers le jardin de l’Hôtel, il fait reluire les ciselures des canons de bronze qui semblent défendre le palais et s’allongent devant le large fossé rempli d’herbe. Canons, jadis grondants, aujourd’hui pacifiques. Les uns sont encore dressés sur des affûts, les autres gisent à terre, supportés par des soutiens de pierre. Quelques-uns ont gardé les éraflures des combats d’autrefois. Presque tous ciselés et sculptés comme des pièces d’orfèvrerie, semblent plutôt des œuvres d’art que des agents de mort. Les inscriptions, les ciselures, les blasons de rois ou de margraves, les aigles couronnés se creusent élégamment ou se relèvent en bosse sur ces dos de canons apaisés. L’un d’eux, par une ironie funèbre, montre l’enlacement de deux corps amoureux près de la lumière d’où jaillissait le meurtre. Ailleurs un long serpent de bronze s’enroule, se coule le long de la pièce de bronze et glisse sa tête plate et sa gueule ouverte à côté de la gueule du canon. Il y a des canons allemands et des canons anversois, des canons d’Algérie et des canons de Chine. Deux obusiers pris à Sébastopol semblent les garder, à droite et à gauche.
Les Invalides, qui vont et viennent, ne donnent pas un regard à ces canons qui ont coûté tant de sang à ceux qui les ont fondus et à ceux qui les ont pris. Des gamins grimpent parfois gaiement sur ces colosses de bronze et s’amusent à enlever les bouchons dans les gueules des canons. Dans le jardin, les visiteurs circulent, suivant les allées et s’arrêtant devant les parterres entourés, sertis de verveine rouge et riante, jetant en passant un regard curieux aux tonnelles latérales où quelque vieux se tient assis. Des invalides passent, se traînant sur leur canne, d’autres se brouettent eux-mêmes dans quelque chaise mécanique de malade et toussent à chaque effort fait pour tourner la roue. Placés en sentinelle, à l’entrée de la grille qui donne sur l’esplanade ou à la porte de l’Hôtel qui s’ouvre sur la cour d’honneur, quelques-uns tiennent un sabre à poignée de cuivre, un de ces sabres qui ne semblent plus couper, un humble briquet qui se dandine au bout d’une buffleterie jaunie, tapant de temps à autre la capote usée ou le mollet défunt. Des cheveux blancs s’échappent en mèches rebelles des casquettes de cuir à petite cocarde. D’autres têtes sont chauves. Tout cela, tout ce monde toussant et ridé, se traîne et va quelque part. On en voit assis sur des bancs et qui prennent le frais, d’autres qui, dans un coin, lisent quelque journal à travers leurs lunettes rondes. Ils semblent tous dispersés et pareils à des fourmis hors de la fourmilière, fourmis lentes et vieilles.
De tous côtés, quelque scène, quelque croquis à la Charlet vous attire par la simplicité mélancolique. Là un pauvre vieux, de sa main qui tremble, verse du coco dans un verre. La cruche est lourde à son poignet sans force. C’est un débitant de rafraîchissements. « A la fraîche ! qui veut boire ? » Un autre vend des sucres d’orge, des balles en cuir, des soldats en papier. Ainsi ces pauvres gens font, comme ils peuvent, un peu de commerce. Mercure après Bellone, eût dit un poète de leur temps. Et voilà ce que devient le héros. C’est la gloire tombée en enfance, c’est le troupier devenu ganache, c’est le grenadier tonsuré et rasé ; peu de vieillards, beaucoup de vieux. Pour une tête énergique de grognard, cent têtes abêties de malade ou de bonnetier retiré. L’âge a chargé à son tour. Et le cuirassier de Milhaud ou le voltigeur de Lannes, le soldat de Saragosse ou de Smolensk est devenu, après avoir été terrible, ce paterne personnage dont les petits enfants ne rient point parce qu’ils en ont pitié.
La grande cour de l’Hôtel, qu’on rencontre en entrant, la cour d’honneur au fond de laquelle se dresse la statue de Napoléon Ier, cette cour est d’un couvent. Les longues galeries, avec leurs murs peints à la chaux, leurs plafonds traversés par des poutres, leurs enfoncements un peu sombres, les portes qui s’ouvrent, çà et là, comme des portes de cellules, donnent à l’immense Hôtel l’aspect monacal d’une communauté. Il y a du corridor de Chartreuse dans cet asile de soldats. Sur des bancs, contre les piliers, les invalides causent, rêvent et se reposent.
A gauche, sur la muraille d’un de ces couloirs, — celui qui mène aux réfectoires — un artiste moderne a peint, d’une teinte un peu trop vineuse et comme à l’encre de Chine, les fastes de l’histoire de France. Depuis les druides jusqu’aux communes, à travers les massacres mérovingiens, les assassinats et le sang des premiers temps de l’histoire, on retrouve, groupés dans sa fresque sombre, les épisodes tragiques des époques quasi fabuleuses qui ont précédé les temps nouveaux. Un Charlemagne au regard pâle et bleu comme l’œil de Napoléon III (mesquine flatterie du peintre) trône au milieu de ces scènes de barbarie atroce, de ces égorgements de Francs et de Northmans. Les invalides regardent ces scènes d’autrefois, ces tueries oubliées, et ils hochent la tête d’un air qui veut dire : Bah ! nous en avons vu bien d’autres !
En longeant cette fresque qui aura son pendant, on rencontre trois portes surmontées d’une fresque nouvelle, représentant la Guerre et la Paix. La porte de face mène aux cuisines, celle de gauche au réfectoire des invalides, celle de droite au réfectoire de « MM. les officiers ». Ces longues salles de réfectoire ont (la comparaison nous poursuit) l’aspect claustral des réfectoires de moines. Les rideaux blancs tombent le long des fenêtres et s’agitent avec de grands plis de suaires. Des batailles de Louis XIV couvrent les murs. Ici, la fresque de Van der Meulen montre des états-majors en habits rouges assiégeant des villes représentées sous la forme de plans, c’est Luxembourg, c’est Oudenarde. Les officiers caracolent et indiquent du geste aux mousquetaires les bastions qu’il faut prendre. C’est là que les invalides mangent autour de leurs tables rondes. Les officiers ont des nappes, un service d’argent donné par Marie-Louise, et qu’on montre au public, en le faisant soupeser. Et la foule des visiteurs, fascinée par cette argenterie, chante mentalement la louange de cette impératrice qui donnait ainsi des huiliers de trois cents francs et des plateaux de cinq cents. Près de là, dans d’immenses casseroles polies, aux couvercles d’un brun rouge, bout le potage gigantesque des pauvres vieux. Une vapeur saine et appétissante se dégage du matin au soir de cette étuve. C’est la cuisine de Gargantua, l’antre charmant de la mangeaille. On en sort les papilles frémissantes.
Plus loin, sous l’horloge, à côté des petites portes qui mènent, par des escaliers à rampes de bois, aux étages supérieurs, à gauche, s’ouvre un débit de tabac, — tabac et épicerie, dit une inscription, — et à droite une cantine. Une indication apprend au public que les étrangers sont admis à consommer. Le débit de tabac et le café sont également minuscules. La marchande de tabac, lunettes sur le nez, roule ses cornets et pèse sa poudre brune d’un air majestueux. Au café, devant de petites tables, les invalides sirotent doucement leur gloria ou leur cognac. Un peu de verdure apparaît au fond de l’étroite pièce où l’atmosphère est doucement chargée d’une odeur rance.
On passerait des journées dans l’Hôtel, allant des dortoirs aux chambres, de galerie en galerie, des couloirs aux dortoirs, et de l’église où dévident leur chapelet quelques vieux invalides pieux, à la bibliothèque où de plus mondains lisent les Victoires et Conquêtes, ou les tragédies de Voltaire. On montre au premier étage la salle du conseil avec ses portraits de maréchaux, et de gouverneurs de l’Hôtel, et les curiosités historiques conservées ici : des feuilles recroquevillées et jaunies, des rondelles de branches mortes, des plâtras informes. Saluez : ce sont les reliques de Longwood. Sous un autre globe de verre est le petit boulet qui a tué Turenne.
Le tombeau de Napoléon Ier est placé sous le dôme. Pour le voir, il faut longer l’Hôtel et entrer par la cour Vauban.
La foule, aux jours fériés, se presse de ce côté et défile autour de la chapelle. La grille a deux entrées : à gauche ceux qui veulent voir, à droite ceux qui ont vu. Il faut bien qu’en France tout soit réglé et ordonnancé par l’autorité. De la grille à la chapelle, le double défilé dure, ou plutôt durait pendant des heures. La légende de Sedan a tué la légende de Waterloo. Lorsqu’on approche de la chapelle par la vaste porte ouverte, on aperçoit vaguement le rayonnement doré d’un autel et des colonnes qui étincellent. Des éclats de lumière font jaillir de ce fond d’église des reflets jaunes, et pierre, marbre et dorures, tout est enveloppé comme d’une buée lumineuse, d’un chaud rayon ensoleillé, d’une vapeur d’or liquide. La foule va et vient sous ces coupoles hautes, se heurtant à des mausolées superbes, épelant un nom çà et là, un nom historique, avec cette curiosité béate et cette admiration quasi religieuse qu’elle a pour les gens de guerre. Elle bourdonne, elle murmure, elle descend les marches qui conduisent à la crypte devant la porte de bronze, derrière laquelle est le tombeau de l’Empereur. Deux grandes figures colossales et mâles veillent à l’entrée du tombeau : l’une tient l’épée, l’autre le sceptre. Ces géants de bronze regardent devant eux de leurs yeux fixes. Ils semblent muets pour l’éternité, l’agrandissement et la personnification gigantesque de l’obéissance passive.
Mais c’est du haut de la chapelle, en se penchant comme sur un gouffre, qu’on aperçoit le tombeau de l’Empereur. Masse énorme de quartzite rouge de Finlande, reposant sur un piédestal de granit vert des Vosges. C’est bien la tombe d’un tel homme. La toute-puissance repose dans un colossal mausolée. Le sarcophage a la couleur rouge du sang pâli, le piédestal la teinte terrible du fer. Des drapeaux, accrochés au-dessus des victoires, s’inclinent encore, poudreux, avec leurs aigles à deux têtes criblés de balles ou leurs étoffes déchirées, devant ce fantôme de vainqueur.
Le nombre des invalides décroît. En 1818, la Restauration supprime la succursale d’Arras ; en 1850, la République présidentielle rend un décret contre la succursale d’Avignon. Il n’y avait plus à Arras, en 1818, que 998 pensionnaires ; à Avignon, 500 seulement. Au 1er janvier 1851, l’Hôtel des Invalides qui, après les grandes guerres du premier empire, avait compté jusqu’à 20.000 militaires invalides, n’en avait plus que 3.200. Et depuis, le nombre a considérablement diminué. Presque tous les militaires mutilés, au lieu de chercher refuge aux Invalides, préfèrent jouir de leur pension de retraite chez eux, en famille, et bientôt, disait naguère M. de Goulhot de Saint-Germain au Sénat, l’institution des Invalides ne sera plus qu’une infirmerie militaire.
« Dès lors, ajoutait l’orateur, rapporteur d’une pétition relative aux Invalides (mai 1870), dès lors, on est porté à se demander s’il ne serait pas préférable que les hommes placés dans ces conditions fussent admis, aux frais de l’État, dans les maisons hospitalières de leurs départements. Ce classement aurait peut-être un double avantage : en premier lieu, il ferait revivre, chez les militaires ainsi rapatriés, les souvenirs et les sentiments de famille, que leur imposerait le respect humain qu’ils sont parfois enclins à oublier, inconnus qu’ils sont dans le milieu où ils vivent ; en second lieu, ils auraient plus de chance de se soustraire au désœuvrement qui est à la fois pour eux, dans l’intérieur de l’Hôtel, une souffrance et un danger. »
Quant à l’Hôtel lui-même, en pareil cas, on y placerait, soit l’administration de la guerre, soit toute autre administration de ce genre. Naguère, depuis la République, un membre de l’Assemblée nationale faisait à Versailles une proposition analogue à celle que formulait sous l’empire M. de Goulhot de Saint-Germain. Tout ce qui pourra ramener à la vie de famille, au foyer, au repos, le soldat mutilé, vaudra mieux, en effet, que cette vie oisive, débilitante des Invalides, existence hors le monde, en quelque sorte, et dont le présent récit voudrait fournir un épisode.
On sort d’une telle visite le cœur plein d’une mélancolie profonde, et en se demandant si l’humanité élèvera éternellement des temples à ceux qui la violent et la torturent, et si décidément elle n’a pas de préférence folle et malsaine pour les carnassiers et les bourreaux.
Ce qui frappe surtout, et ce qui comble d’étonnement, c’est le peu de mélancolie qu’a laissé tout ce passé ou le peu de réflexion que suscitent ces spectacles quotidiens dans l’esprit des invalides qui vivent avec de tels souvenirs et à côté de telles grandeurs. Ces braves gens, vivant d’une vie végétative, n’essayent point de mesurer le néant de ces choses ou de tirer la moralité de ce qu’ils ont vu. Ils vivent, cela leur suffit. C’est leur occupation de tous les jours. Épaves de tant de naufrages, après avoir tant duré, ils ne songent qu’à durer encore. Ils voient, chaque soir, se coucher une journée comme ils doubleraient, chaque jour, un cap. Sans redouter la mort, qu’ils ont tant de fois bravée, ils essayent de lui faire faux bond le plus longtemps possible. Ils ont été exacts à tant de rendez-vous ou d’amour ou de guerre, qu’ils sont bien excusables de chercher à manquer à celui-là !
Presque tous, d’ailleurs, ont un but dans la vie. Les uns ont leur jardin, leurs fleurs, leurs fruits, la poire qui verdit au bout de la branche luisante, la feuille flétrie qu’il faut arracher du pied de capucines ; ou bien ils ont en ville un état. Ils font des courses, s’ils sont ingambes encore. Il en est qui portent des journaux illustrés. D’autres, jadis, passaient la nuit auprès des maisons en construction ou en démolition et veillaient, leur briquet à la main, sur les décombres ou les instruments de travail. On les voyait parfois, assis auprès d’un brasero, réchauffant leurs mains ridées ou dormant les pieds étendus. Ils savaient et pouvaient encore être utiles.
Le métier n’était pas doux, pendant les nuits d’hiver, mais on le faisait. Après tout, qu’était cela auprès de la Bérésina ? Les glaçons de Paris, comparés aux glaçons russes, ressemblaient à des caresses.
Le froid était cependant atrocement vif, la nuit de décembre 1853, où le père Jacques Cœurdeloy, en faction devant une maison de la rue Neuve-Saint-Jean, surveillait les démolitions d’une maison bâtie près de ce chantier Saint-Jean, à côté duquel, paraît-il, habitait alors Monsieur de Paris, ou, pour parler comme la Dubarry, M. le bourreau.
La rue Neuve-Saint-Jean est devenue, depuis quelques années, la rue du Château, et toute cette portion des quartiers Saint-Denis et Saint-Martin s’est complètement modifiée par le percement de tant de boulevards. La rue de la Fidélité, par exemple, ne ressemble plus à ce qu’elle était, le marché Saint-Laurent a disparu comme la rue Neuve-de-la-Fidélité ; la rue Neuve-Saint-Nicolas et la rue Neuve-Saint-Jean ne forment plus qu’une seule rue, la rue du Château-d’Eau. A cette époque, ce coin de Paris, si voisin du faubourg Saint-Denis, gardait encore un caractère populaire et quasi désert, et ressemblait un peu à ce qu’est aujourd’hui le quartier Popincourt : des marchands de vins, des terrains vagues, un bal-concert où, certain soir, Rachel se risqua à chanter la Marseillaise, bal devenu café-concert sous l’empire et changé en club pendant le siège de Paris. Les rôdeurs de nuit, vers 1853, prenaient volontiers ces rues et ruelles pour points de ralliement, et le père Cœurdeloy devait faire bonne garde s’il ne voulait pas être surpris ou par le sommeil ou par les filous. Il allait donc et venait, s’agitant autour de son feu et fredonnant, pour se tenir éveillé, un air du pays limousin, son pays, qu’il avait bien des fois murmuré tout bas, pendant ses campagnes. Tout en se remuant pour chasser l’onglée, Cœurdeloy songeait que Noël approchait et qu’on allait faire réveillon à l’Hôtel des Invalides, et un réveillon de bonnes vieilles gens qui ne vaudrait pas les réveillons du bon vieux temps, à Limoges, dans le faubourg Montmailler, ces réveillons de jeunesse, où l’on mangeait des gireaux et des gogues arrosés de vin blanc et suivis de châtaignes blanchies. Mais quoi ! on prend ce qu’on trouve et c’est déjà beaucoup, songeait le philosophe Cœurdeloy, de trouver quelque chose.
Cœurdeloy n’était pas un mécontent. La vie ne lui avait pas été particulièrement douce ni clémente, mais il l’avait prise comme elle était venue. C’était un petit homme souriant, un peu joufflu, gras comme un moinillon et l’air peu farouche. Il y a de ces visages ridés qui gardent encore des apparences de visages enfantins. Il semble que la nature se plaise à de ces paradoxes, et donne à ceux qui vont finir la vie le sourire naïf de ceux qui la commencent. La naïveté et la douceur de Cœurdeloy étaient d’ailleurs proverbiales. Il était de ces soldats dont on dit, au régiment : c’est une demoiselle ! et qui sont des hommes sous le feu.
Cœurdeloy avait d’ailleurs, à cette époque, un tic, une habitude, une affection qu’il gardait encore. Il se plaisait, aux jours de bataille, à jouer sur son flageolet des airs du pays. Il prétendait que cela donnait du cœur aux voisins. Au lieu de charger son fusil il jouait, et, lorsque les balles sifflaient, on entendait parfois, dominant la fusillade ou plutôt filtrant à travers, l’éclat de rire de son flageolet répondant : Va-t’en voir s’ils viennent ! Il raillait le danger et s’amusait à dialoguer avec les tirailleurs. Un jour, son bataillon était lancé sur une batterie prussienne. Après avoir enlevé les canons, il reculait devant un retour offensif de l’ennemi. La voix des officiers, leurs ordres, leurs menaces ne pouvaient ramener au feu les voltigeurs mis en désordre, lorsque, à travers le bruit, un écho vient encore frapper leurs oreilles, un refrain, un refrain français joué sur un flageolet, ce refrain que chantait Napoléon Ier montant à cheval pour se rendre en Russie : « Marlborough s’en va-t’en guerre ! » Ils relèvent la tête, ils regardent. Une poignée de Français disputaient encore un dernier canon à l’ennemi et, debout sur la pièce de bronze, Cœurdeloy, impassible et doux, jouait allégrement son air de flageolet. Miron ton, ton, ton, mirontaine ! Cela suffit pour redonner du cœur à tous. Le bataillon s’élança et la batterie fut prise. Et qui l’avait enlevée, en réalité ? Cœurdeloy, Mademoiselle Cœurdeloy.
Le bonhomme avait fait ainsi, jouant du flageolet, les dernières guerres de l’empire. En 1808, à vingt-deux ans, en Espagne, il faisait danser les jolies filles en leur jouant un air du pays. Ce son aigre et vieillot du flageolet faisait rire les Castillanes, habituées à la mélopée mâle des danseurs. Cœurdeloy faisait partie de la division Dupont, qui capitula honteusement à Baylen, capitulation dont rougissait la France avant que ce mot sinistre prît, avec le second empire, une signification autrement colossale et lugubre. Dupont ne livra que 6.000 hommes. Cœurdeloy fut de ces pauvres gens. Il fut emmené par le vainqueur et, durant la route, sous le dur soleil andalou, pour faire prendre patience aux compagnons et leur rendre du cœur, il joua du flageolet, et il faut avoir été captif pour comprendre quelle intime poésie prend soudain l’air le plus vulgaire, ainsi joué sous un ciel étranger. Au clair de la lune a, de la sorte, fait pleurer bien des gens. Cœurdeloy jouait Marlborough, jouait Il pleut bergère, jouait même la Marseillaise, et les colonnes marchaient, avançaient sur cette terre d’Espagne qui brûlait les pieds. Les Espagnols laissaient jouer le joueur de flageolet et marquaient aussi le pas sur ses airs français. On interna les captifs à Caprera. Ils souffrirent là tout ce que des hommes peuvent souffrir. La famine, l’isolement sinistre, la maladie, l’ennui rongeant, la vermine, tous les genres de mort à la fois. Cœurdeloy souffrait comme les autres, mais il tirait parfois ce petit morceau de bois jaune et, de son souffle épuisé, de ses lèvres sèches, il jouait. Il jouait toujours. Ses fredons ranimaient, réveillaient, sauvaient, mouillaient les yeux et ranimaient les cœurs.
Il resta longtemps prisonnier. On le transféra sur des pontons anglais. Il souriait, puisqu’on lui laissait ce pauvre misérable flageolet, sa vie, sa consolation, sa poésie, à lui, et sa gaieté. Lorsque tomba l’empire, il n’avait point d’état. Il demeura soldat. Ce fut encore le flageolet qui lui fit paraître moins longs, moins lents, moins lourds, les jours pénibles de la caserne. Bref, il vieillit, il se rida et s’affaiblit, il se maria, il devint veuf, il demanda d’entrer aux Invalides, et toujours, comme un fidèle compagnon des bons et mauvais jours, son flageolet le suivit, le consola et adoucit le déclin de sa vie après en avoir charmé le printemps. Aussi Cœurdeloy, ne demandant rien, regrettant dans le passé, non pas ses ambitions ou ses plaisirs perdus, mais ses affections disparues, vivait reposé, tranquille, et quand on lui parlait de sa vie d’autrefois :
« Moi, disait-il, j’ai été quarante ans soldat, et je suis bien certain que je n’ai jamais tué personne. Je n’ai pas tiré un coup de fusil.
— Et qu’avez-vous fait pendant quarante ans ? »
Alors Cœurdeloy découvrait ses dents nacrées, et, avec un bon petit rire narquois et naïf à la fois :
« Moi ? disait-il, j’ai joué du flageolet ! »
Il pensait peut-être à ces jours évanouis, tout en montant sa garde.
Rue Neuve-Saint-Jean, le froid était mordant, et Cœurdeloy, nouant son foulard par-dessus ses oreilles, et donnant, autour de son cou, un double tour à son cache-nez de laine bleue, glissait dans ses poches ses mains garnies de mitaines et battait la semelle autour de son feu de charbon. Certes, encore une fois, cette gelée n’était rien, comparée aux froids noirs de la Russie, mais Cœurdeloy se disait pourtant qu’on était mieux entre deux draps qu’en plein air. Vers deux heures du matin, le froid se calma un peu, et, s’asseyant sur une chaise, l’invalide, tout en tendant au foyer ses semelles de souliers, se mit à regarder dans le brasier les charbons qui brûlaient. Peu à peu il se sentit alors la tête alourdie, les paupières hésitantes, et doucement, comme on glisserait sur une pente, il se laissa aller au sommeil. On dit des enfants que leur sommeil est celui de l’innocence. Le sommeil de ce vieillard ressemblait terriblement à celui des enfants. Petit, poupin, souriant vaguement à quelque rêve, le père Cœurdeloy laissait pendre sa tête ronde sur son épaule et ronflait doucement, mathématiquement, le repos tranquille comme la conscience, par cette nuit d’hiver où les étoiles scintillaient comme des éclairs au fond du ciel glacé.
Tout à coup, — peut-être avait-il entendu du bruit ? — Cœurdeloy s’éveilla d’un saut, tourna la tête vers un point invisible, dans l’ombre, et demanda :
« Qui va là ? » en portant la main à son sabre.
Personne ne répondit.
« C’est, pensa Cœurdeloy, qu’il n’y a personne ! »
Le feu du brasier était toujours ardent, et le vieux, qui frissonnait un peu, s’y réchauffa en chantonnant encore, machinalement, un air de son flageolet :
Il fut brusquement interrompu par un cri, une sorte de vagissement d’enfant, parti du point obscur où tout à l’heure il avait entendu du bruit, et, dressant l’oreille, il écouta. A n’en pas douter, il y avait un enfant là. Le père Cœurdeloy prit sa lanterne, l’alluma au brasier, et, pas à pas, comme à tâtons, se dirigea du côté d’où venait le bruit.
« Voyons, disait-il, qui est là ? Répondez donc, on ne vous mangera pas !
« Imbécile que je suis, dit-il tout haut, avec ça que ça peut répondre ! »
Il venait, à travers ses lunettes, d’apercevoir, éclairé par la projection de la lumière de la lanterne, un enfant, enveloppé dans un châle tartan, et doucement posé sur un tas de linges, à côté de sacs de plâtre que les maçons avaient laissés là. L’enfant, tout petit, les yeux clos, dormait profondément, avec de légers froncements de lèvres.
« Ah ! bien, fit Cœurdeloy, s’il n’y a que ce citoyen-là pour voler les démolitions, il n’en emportera pas lourd dans sa poche ! »
Il se pencha sur l’enfant, et la première chose qu’il aperçut fut un petit papier piqué au tartan avec une épingle à tête noire. Le père Cœurdeloy approcha le papier de sa lanterne, et, lentement, lettre par lettre, épela ce petit billet :
Ce n’est pas moi qui me sépare de mon enfant, c’est la misère qui me l’arrache des bras. Je suis trop pauvre pour nourrir ce petit être ; trop pauvre ou trop lâche. Ma petite fille s’appelle Marguerite. Elle a treize mois. Elle est sevrée. Je la recommande au bon Dieu et je la confie au bon cœur qui la recueillera et qui la fera vivre, puisque son père a laissé là sa mère et que sa mère a peur de la voir mourir de faim.
La mère.
« Allons, bon, pensa Cœurdeloy, en voici bien d’une autre ! Une petite fille ! Une enfant trouvée ! (Il hocha la tête et se mit à rire.) Me voilà nourrice ! »
Et comme il ramenait un pan du châle sur la petite pour qu’elle n’eût pas froid, il crut apercevoir, dans l’obscurité, quelque chose comme une ombre qui se détacha de la muraille et qui s’enfuit en poussant, eût-on dit, un sanglot. Cœurdeloy s’élança. Il eut la conviction que la mère était là, attendait et guettait ; mais il eut beau courir, de ses petites jambes, il ne put rattraper personne. Il revint à son feu et à sa masure. La petite fille, qu’il tenait serrée contre sa capote, ne s’était pas réveillée.
« Comme ça dort, les enfants ! dit Cœurdeloy. Comme des anges ou comme des souches ! »
Puis il s’assit, mit la petite sur ses genoux et l’approcha du feu. Il la regardait, la trouvant jolie. Ces petites mains potelées, ces grosses joues duvetées, ce front sans ride, cette fleur de santé et de vie le charmaient. Il se disait que ceux qui ont des enfants comme cela et qui en font des hommes et des femmes sont bien heureux. Si sa femme lui eût laissé un petit être comme cela, qu’il l’eût choyé, élevé, adoré ! La petite dormait si bien ! Quelquefois, Cœurdeloy se penchait et l’embrassait en s’appelant tout bas : Vieille bête. D’autres fois il songeait à ces pantomimes des Funambules qui l’amusaient et où il aimait à voir Debureau faisant fonction de bonne d’enfants. Alors il riait et il se disait : C’est moi qui suis Pierrot maintenant. Mais, peu à peu, tout ce que cet homme gardait en lui de bonté, tout ce que la dure vie du soldat avait, non pas desséché, mais empêché de s’épanouir en lui, tout ce qui le sollicitait vers le foyer, le bonheur domestique, le repos, l’affection paternelle, calme, saine et sainte, tout s’éveilla en lui et se prit à lui murmurer, durant cette nuit, bien des choses. « La mère est partie… Je la confie au bon cœur qui la recueillera… Avoir une fille… ta fille, Cœurdeloy, ta fille à toi ! » Et tant et si bien que le jour, l’aurore glacée de décembre trouva l’invalide sur le chemin du commissaire de police, décidé à déclarer qu’il se chargeait de l’enfant abandonné !
Et il s’en chargea, et à partir de ce jour, ou plutôt de cette nuit, Cœurdeloy se sentit vivre. Il n’avait jamais été si heureux. Le hasard avait fait que, né bon, aimant, né père, en un mot, il avait été jeté à tant de récifs, ballotté comme un morceau de liège au bout d’un flot par tous les vents. La petite Marguerite devint sa fille. Il ne rechercha point où pouvait se trouver la mère et quelle était cette ombre qu’il avait vue se glisser contre la muraille au moment où il avait ramassé l’enfant. Il eût craint de rencontrer cette mère et d’être forcé de lui rendre la petite fille qu’il adorait déjà. Il la mit en garde chez des amis, des blanchisseurs qui habitaient Vaugirard. Il allait la voir grandir, il lui apportait des bonbons, des bonnets, des jouets. Il avait acheté une tirelire, et il y glissait, de temps à autre, quelque pièce blanche. Ce serait, plus tard, pour Marguerite. Bref, le petit vieillard avait une famille maintenant, une enfant, et il lui restait, comme il disait, un prétexte pour vivre.
Il ne semblait d’ailleurs aucunement près de mourir. Le père Cœurdeloy, ainsi qu’on l’appelait (et il disait gaiement : « Mais oui, mais oui, je suis père, vous ne croyez pas si bien parler »), le père Cœurdeloy avait bien près de soixante-quinze ans, mais, à coup sûr, personne ne lui en eût donné plus de cinquante. Il était, non pas momifié, comme certains vieux, mais conservé dans une sorte d’ardeur et de jeunesse comparative. « Je suis leste, disait-il, comme un homme de soixante ans. » Il lui restait toutes ses dents, de jolies dents blanches qui éclataient dans son visage un peu rouge et toujours rasé de frais, propre et sentant bon. Il lui restait aussi tous ses cheveux, blancs, d’un blanc soyeux et fin, et frisant légèrement au-dessus des tempes. Ses yeux, d’un bleu déjà déteint et comme passé, gardaient pourtant encore une vivacité singulière, et, derrière ses lunettes d’or, ils avaient parfois des éclairs. Éclairs fugitifs, car tout dans cette physionomie saine et fixe de petit vieux tel qu’en peignit Holbein, respirait le calme, une bonté à la fois souriante et narquoise.
L’ancien soldat, l’invalide ridé, mais pimpant, n’avait rien, en effet, du sabreur et du traîneur de guêtres. On eût dit un vieux maître à danser ou un professeur d’écriture. Il était coquet, propret, tiré à quatre épingles, et, très souvent, sous sa capote, cravaté de blanc ou encore de petites cravates bleu de ciel à pois ; c’était quand il s’habillait pour aller voir Marguerite. On disait alors en souriant aux Invalides : Cœurdeloy fait le joli cœur !
Et lui, sautillant, souriait en montrant ses dents blanches.
Ses visites à Vaugirard étaient, en effet, ses grandes joies.
Le reste du temps, il demeurait des heures entières assis sur un banc, devant les tonnelles de l’Hôtel, regardant devant lui l’esplanade où de jeunes soldats en pantalons rouges faisaient l’exercice, les arbres des avenues qui frissonnaient de sève au printemps et dont le premier vent d’automne emportait, en les faisant tournoyer, les feuilles jaunies. Il regardait au loin, là-bas, la profondeur, les quais à la couleur blanche et le palais de l’Industrie dont les vitraux, criblés de soleil, renvoyaient en l’air par une projection brusque, les rayons vigoureux comme ceux d’un foyer incandescent.
Jadis ces contemplations et ces calmes bains d’air lui eussent suffi, mais peu à peu des démangeaisons de sortir, des velléités d’escapades le prenaient ; il s’acheminait vers Vaugirard, il montait voir la petite, il la descendait et la faisait marcher dans la rue. On disait, dans le quartier, que c’était un vieux brave qui élevait à ses frais l’enfant que sa fille avait eu d’un séducteur. Délaissée par le séducteur, elle s’était tuée, et le grand-père avait gardé la petite. Le peuple est le plus rapide des romanciers ; il bâtit des scénarios compliqués autour des choses les plus simples. Lorsqu’on faisait allusion à cela, Cœurdeloy se mettait à rire, puis il ajoutait :
« Après ça, un mirliflor, une pauvre fille, un enfant qui naît et un papa gâteau qui se trouve là, la vérité n’est pas si loin des cancans. C’est peut-être vrai, ce que les voisins disent. »
Cependant les années passaient, s’abattant comme un poids accablant sur le front du vieillard et faisant au contraire, de l’enfant, une femme. Cœurdeloy disait, en la voyant grandir : « Ça nous repousse ! » Mais il semblait qu’il ne se sentît point vieillir. Le bonheur est encore pour l’homme la meilleure eau de Jouvence. Le sourire va bien à toutes les lèvres et rajeunit les plus âgés. C’est pourquoi le destin, qui semble haïr ce qui est jeune comme il déteste ce qui est heureux, ne permet pas longtemps le sourire à deux humains et leur demande bientôt des larmes. Un être heureux serait éternel et l’universelle vie ne se nourrit que de la mort individuelle.
Marguerite allait avoir dix-sept ans bientôt. C’était une femme déjà et, comme on dit, bonne à marier. Le père Cœurdeloy, qui n’était pas riche, avait voulu lui faire apprendre un état. Il l’avait placée chez une modiste, payant d’avance une petite somme pour qu’on lui fît faire son apprentissage en l’exemptant des courses imposées d’ordinaire aux apprenties qui, leur carton sous le bras, sont exposées aux mauvaises rencontres. Cœurdeloy n’étant pas satisfait de la maison en retira bientôt Marguerite, se demandant ce qu’il en ferait.
« Bah ! ajoutait-il alors, elle grandit et s’épanouit comme une rose, je n’aurai pas longtemps à attendre pour la caser ! »
Et dans ses projets de mariage, il faisait des rêves pour elle.
Elle pouvait prétendre, jolie fille comme elle l’était, à épouser un bon parti !
Elle était grande, le teint pâle, légèrement ambré, avec de grands yeux bruns et bons, des cheveux partagés en bandeaux qu’elle enroulait derrière sa tête, enfonçant le peigne dans ces nattes profondes. Toute sa physionomie était faite de douceur un peu triste et de bonté souriante. Elle avait des regards d’une tendresse profonde, un peu alanguis et charmants.
« Savez-vous, dit un jour à Cœurdeloy un invalide facétieux, savez-vous que c’est un beau brin de fille, votre petite ?
— Je le sais, fit Cœurdeloy en se rengorgeant.
— Un morceau de roi !
— Oui, mais heureusement qu’il n’y a plus de rois, dit Cœurdeloy qui se mit à rire.
— On l’épouserait bien tout de même.
— On ne serait pas dégoûté !
— Est-ce que vous me donneriez sa main, Cœurdeloy ?
— Sa main ? à qui ? à vous ? mon vieux Ragache ! Vous avez donc bu un coup de trop pour me faire des questions pareilles ? »
Et de bon cœur, il accentua son rire qui devint éclatant. L’autre ne répondit pas, mordit ses lèvres et s’éloigna en sifflant. Cet incident procura au père Cœurdeloy une journée de bonne humeur, et il s’en alla raconter l’affaire à ses amis Jupille et Bimborel.
Ragache ne semblait pas fait, il eût dû le reconnaître, pour prétendre à la main de la jolie fille. Mais il mesurait son but à ses prétentions. Il avait bien près de soixante ans, mais sa vigueur, qui avait été jadis prodigieuse, était grande encore, et il avait, comme il s’en vantait, le poignet solide. Autrefois il cassait facilement entre ses doigts un écu, absolument comme le maréchal de Saxe. Maintenant muscles et nerfs s’étaient terriblement affaiblis chez lui, mais lorsqu’il entrait dans ses colères et qu’il avait un verre de cognac de trop, Urbain Ragache était encore redoutable. Il était redouté d’ailleurs, comme tous les méchants. Les hommes n’aiment la bonté que d’une affection platonique ; ils gardent pour la force seule, et surtout pour la force mise au service de la brutalité et de la violence, leur estime et leur respect. On savait qu’avec Ragache il ne fallait pas badiner.
Grand, maigre, comme taillé à coups de serpe en plein tronc d’un de ces bois qui semblent durcir en vieillissant, Ragache marchait toujours droit, en se dandinant d’un air de conquérant. Il portait sa casquette sur l’oreille, et ramenait en forme de volute au-dessus de ses oreilles une mèche de cheveux d’un blanc sale. De gros sourcils épais et drus se hérissaient au-dessus de ses paupières ridées. Des yeux gros, à la conjonctive sanguinolente, roulaient leurs paupières grises dans des orbites cerclées de brun. Un gros nez empourpré, strié de fibrilles violettes, sortait de son visage maigre aux méplats durement sculptés, et laissait échapper de ses narines largement ouvertes des bouquets de poils qui rejoignaient une moustache blanche, rude comme une brosse de chiendent et légèrement teintée de jaune par les abondantes prises de tabac. Des lèvres minces et un menton carré, assez souvent rasé de frais, complétaient cette physionomie rude, mâle et antipathique qu’un clignement d’yeux, une affectation de galanterie, un sourire vainqueur et l’habituelle démarche du personnage rendait encore plus repoussante. Il y avait, dans ce sec et dur vieillard, du soudard encore vert et du Don Juan sexagénaire, deux types distincts fondus en une personnalité douteuse et déplaisante.
Ragache avait, en effet, deux coquetteries à la fois et deux vanités colossales : sa force à toutes les armes, depuis l’épingle jusqu’au canon, comme il disait en riant pour montrer ses dents dont l’émail était pourtant usé, et ses succès auprès des femmes. Ce bretteur de régiment avait été aussi, paraît-il, un séducteur. Il avait fait les délices des Espagnoles, lors de l’expédition de 1823, et, après la prise d’Alger, il se vantait d’avoir apprivoisé les premières Algériennes. Quant à ses duels, il ne les comptait plus. Le plus terrible était son duel au sabre de cavalerie avec le canonnier qu’il avait presque fendu en deux, près du monument de Desaix, dans l’île des Épis, devant Strasbourg. Lorsque Ragache contait ce bel exploit, ses yeux gris pétillaient d’une flamme méchante.
« Il fallait voir, disait-il, la tête du canonnier. Une pêche coupée en deux. »
Comme après tout Ragache était brave, qu’il avait servi longtemps, qu’il était couvert de blessures, il avait pu, malgré sa réputation de mauvais coucheur, obtenir d’entrer aux Invalides. Dans les premiers temps, il avait apporté à l’Hôtel ses allures cassantes et rageuses, et il parlait à tout moment de décrocher le bancal. Le gouverneur songeait à le congédier. On lui fit des observations assez vives, et comme il n’était pas d’âge ni d’humeur à gagner sa vie facilement, et qu’il trouvait bonne la soupe de l’Hôtel, il baissa le ton, et au lieu de mordre, le dogue se contenta de grogner. Tous, sans en avoir peur, car le danger est un vieil ami pour ces vieilles gens, tous les invalides eussent préféré voir Ragache au diable, et subir le voisinage de cet homme était dur ; mais on se fait à tout, et c’est l’inconvénient, la quotidienne douleur de cette vie en commun que des coudoiements pareils, des rencontres inévitables.
On vit là comme à bord d’un navire sans pouvoir guère s’éviter, se rencontrant sous les tilleuls des jardins, sur les bancs de l’esplanade, près du poêle de faïence, ou autour de la table ronde du réfectoire. La haine s’aigrit dans ces cœurs que la vie a desséchés peu à peu et que l’âge a rendus presque tous secs comme des éponges poudreuses.
Cœurdeloy, depuis longtemps, ressentait contre Ragache une certaine répulsion instinctive qui n’était point de la haine, mais qui pouvait y conduire. Peu s’en était fallu aussi bien qu’au lieu de prendre en manière de plaisanterie la demande du vieil Urbain, Cœurdeloy ne se fâchât un peu : il n’entendait pas rire au sujet de Marguerite. L’espèce de petite rivalité, de pique, comme on dit vulgairement, qui existait entre les deux vieux, était née du hasard. C’est un jardin qui en fut cause, un de ces jardins qu’on tire au sort entre les invalides lorsqu’un des possesseurs viagers vient à mourir. Le sort avait favorisé Cœurdeloy aux dépens de Ragache, et celui-ci lui en avait longtemps tenu rancune. Ces jardinets, qui longent parallèlement les deux petites avenues de tilleuls plantées devant l’aile droite et l’aile gauche du palais, ces petits jardins séparés par des palissades peintes en vert, par des treillages ou des grilles ont perdu de leur physionomie bizarre d’autrefois. Ils ne sont plus fantaisistes ainsi que jadis, ils sont devenus graves comme l’époque actuelle. On y voyait autrefois des curiosités et des étrangetés, et les goûts de chaque propriétaire s’y révélaient par l’arrangement plus ou moins original de ses deux mètres carrés de jardin. Il y avait le jardinier napoléonien, dressant au fond de quelque grotte tapissée de coquillages une sorte d’autel à Bonaparte. Il y avait le céladon élevant sous une charmille un temple secret à l’Amour et plus souvent encore à Bacchus. Un Cupidon en plâtre y voltigeait bouffi, ou, ventripotent, s’y étalait quelque Silène aux chairs plissées, au-dessus de quelques pieds de réséda ou de pensées. Des devises de mirliton inscrites sur quelque guirlande de fer-blanc y faisaient songer à Cythère transportée à Sainte-Périne. Et c’étaient des jets d’eau, des petits moulins, des acrobates tournant avec le vent, quelque chose comme ces jardins où les Hollandais, dans une sorte de fantaisie asiatique évidemment rapportée du Japon, ou de Java, multiplient les figurines, les animaux en faïence peinte ou en terre cuite.
Aujourd’hui, les jardinets ne sont plus que des jardins et quelques-uns même de fort jolis jardins minuscules, où les plantes grasses étiquetées dans leurs pots, les fleurs aristocratiques fraternisent avec les volubilis ou les capucines démocratiques. Jardins pleins d’ombre, de paix, de fraîcheur ; jardins qui font déjà songer à ceux qui ombragent les tombes, et où les pauvres vieux viennent se reposer ou lire, reçoivent leurs visites, causent et font sauter sur leurs genoux les enfants de leurs petits-enfants.
Les fleurs y grimpent le long des charmilles ; les rhododendrons, les dahlias éclatent dans les petits parterres. Il y a, çà et là, des fruits, des abricots, du raisin, des prunes.
Mais le père Cœurdeloy, en fait de jardins, tenait pour le vieux système. Il aimait les bassins où rit le jet d’eau, la girouette qui tourne au bout de sa tringle, les statuettes et les poissons. Il était classique sur le chapitre jardinet. Que de fois Ragache, en passant devant les treillages verts, regardant Cœurdeloy en manches de chemise et arrosant ses fleurs, avait-il laissé échapper un grognement ou un quolibet !
« Un propre jardin ! disait-il. J’en aurais fait autre chose si le sort m’avait favorisé.
— Oui, mais voilà, répondait Cœurdeloy, le jardin m’est échu et je le garde ! »
A côté du jardin de Cœurdeloy, l’ami Jupille, possesseur d’un carré de fleurs, avait élevé un autel au dieu du vin. Jupille qui, avec Bimborel, était l’intime de Cœurdeloy, professait, dans son jardinet, ses sentiments bachiques. Au-dessus de la statue de Bacchus, il avait appendu une pancarte écrite et enluminée de sa main, contenant les principaux articles du Code pénal des buveurs. C’était une de ces plaisanteries comme en font les habitués de cafés de province. Mais telle qu’elle était, elle avait fait rire, et Jupille en était content.
La pancarte, collée sur un morceau de carton soutenu par deux bouts de bois, autour desquels s’enroulaient des pois de senteur, s’étalait, peinte aux couleurs françaises, et attirait le regard des passants :
CODE PÉNAL DES BUVEURS
Manquer à la réunion, quand on boit, prison, 1 an.
Abandonner son poste au cabaret, boulet, 6 ans.
Achat de vinaigre pour mettre dans l’eau, détention.
Boire son verre en deux fois, prison, 6 mois.
Changer de vin s’il n’est meilleur, prison, 2 ans.
Avoir voulu détruire un ivrogne, mort.
Dormir à table ayant du vin, boulet, 2 ans.
Endurer la soif ayant de l’argent, perpétuité.
Etre invité à boire et refuser, travaux forcés, 10 ans.
Vider son verre sous la table, prison, de 2 à 5 ans.
Boire sans rendre hommage à Bacchus, prison, 13 mois.
Ne pas sourire à l’approche d’une bouteille, exposition.
Réception d’une bouteille d’eau à table, boulet, 6 ans.
Rougir au nom d’ivrogne, fers, 20 ans.
Tambour qui quitte cantine pour battre aux consignés, mort.
Vider le verre de son camarade sous la table, dégradation.
Rendre le vin bu, guillotiné.
Fait en notre Palais des Plaisirs, l’an 8.000 de notre bien-aimé règne.
Le roi : BACCHUS.
Ses ministres,
Chasselas, Boit-Sec, et Rubis-sur-l’Ongle.
Pour copie conforme, R…
En sa qualité d’ivrogne de méchante humeur, Ragache avait trouvé la plaisanterie stupide.
« C’est qu’il n’aime pas le vin, mais l’absinthe, et voilà tout, » avait fait Jupille.
Et on n’en avait plus parlé.
Jupille, Bimborel et Cœurdeloy formaient un trio qui n’aimait pas précisément Urbain Ragache. Ils le rencontraient cependant assez souvent au cabaret de la mère Madras, où les invalides se réunissaient d’habitude. Parfois, Cœurdeloy amenait avec lui Marguerite, que les vieux fêtaient en redoublant de rasades et de santés.
Le cabaret de la mère Madras, que quelques-uns appelaient aussi la mère Major, était d’ailleurs un des plus fréquentés et des plus bruyants de la rue Croix-Nivert. L’enseigne, peinte en vert sur fond rouge, était celle-ci : A la Belle Obus. Le peuple dit une obus (en sous-entendant le mot bombe) comme il dit une omnibus (en sous-entendant le mot voiture). Un peintre avait représenté sur un panneau assez grand et qui se dressait, tenu par deux crampons de fer au-dessus de la boutique, un obus colossal qui, en éclatant, laissait apercevoir un grenadier de la vieille garde donnant la main gauche à un zouave et la main droite à un chasseur à pied. Des flammes et des roses entremêlées formaient une agréable guirlande autour des trois guerriers. Dans un horizon couleur de soupe au potiron, on apercevait le légendaire petit chapeau surmonté d’une rayonnante étoile. Ce rébus attendrissant amenait des larmes aux yeux des grognards qui fréquentaient assidûment le cabaret de la Belle Obus.
La patronne de l’établissement, la mère Madras, comme on disait, la veuve Madras, comme elle tenait à être nommée, était une grosse, rude et forte femme, le ventre en avant, les poings sur la hanche, la tête haute, le regard droit et la voix arrosée de rhum. Elle avait été cantinière. Elle avait, comme la vivandière de Béranger, versé le rogomme en riant. Elle passait alors pour porter, comme on dit, les culottes dans le ménage. Madras, son mari, espèce de personnage silencieux et timide, rinçait les verres et servait la pratique, tandis que sa femme trônait au comptoir et regardait les beaux fils de la caserne avec des yeux doux. Devenue veuve, elle avait quitté le régiment et s’était établie rue Croix-Nivert, où d’anciens amis lui conservaient leur pratique. Elle trônait là, à son comptoir, entourée de bouteilles de kirsch, de cognac, d’anisette ou de raspail qui, par leurs couleurs, faisaient comme un nimbe autour du front de Mme Madras. Elle passait pour témoigner quelques bontés à ce grand diable de Ragache, qui avait chez elle sa pipe accrochée à un râtelier spécial et ne réglait sa note tracée sur une ardoise que de temps à autre. Mais nous devons peut-être négliger ces méchants propos.
Toujours est-il que, dans le cabinet du fond, cabinet tendu de papier peint représentant, deux cents fois répété, le groupe des deux grenadiers de Waterloo répondant à un major anglais par le mot de Cambronne, dans ce cabinet discret, Cœurdeloy, Poujade et Bimborel venaient souvent et, attablés en face d’une bouteille, buvaient, prisaient, toussaient et causaient d’autrefois.
Le plus vieux des trois était Poujade. C’était un vieux sceptique, gouailleur, farceur, se faisant des journées à promener les étrangers dans l’Hôtel, leur expliquant tous les détails avec une émotion qu’il n’avait pas, leur racontant des batailles auxquelles il n’avait pas toujours assisté, et s’attendrissant devant le tombeau de l’Empereur dont il disait, dans l’intimité : « S’il me reste encore la peau et des os, et encore une jambe, par hasard, ce n’est pas la faute de ce parisien-là ! » Bavard, amusant, tapageur, tel était ce petit vieux qui s’amusait, lui aussi, à faire poser le bourgeois et à blaguer le pékin visitant l’Hôtel.
D’ailleurs, probe et bon, sans méchanceté, sinon sans malice. Un rapin dans la capote d’un invalide.
C’est lui qu’on entendit longtemps montrer ainsi le tombeau de Napoléon :
« Espacez-vous. Très bien ! Vous voyez à droite, le dogme de la force, à gauche, le dogme de la force. Otez votre chapeau. Vous voyez Bertrand, premier grand maréchal du palais ; Duroc, second grand maréchal du palais… Remettez votre chapeau ! »
Poujade, dans l’intimité, chantait le couplet comme un vrai goguettier, mais il le chantait en faisant la charge du refrain, et il était revenu de son amour pour la gloire : « On sait ce que c’est, la gloire ! disait-il. Une femelle qui vous fait des signes et qui vous renvoie avec une patte de moins ou une estafilade de plus, quand on a la bêtise de l’écouter. » Et il montrait sa jambe de bois dont il se servait depuis Montmirail. Aussi, rien n’était comique comme Poujade lançant au dessert les chansons que d’autres entonnaient de bonne foi et dont il faisait, lui, des bouffonneries amusantes. Tantôt c’était sur l’air : C’est un luron, le discours du maréchal Gérard au général Chassé, ou la prise de la citadelle d’Anvers :
Et le refrain :
Tantôt remontant plus haut, c’était le couplet sentimental sur la perte du grand Napoléon par la France.
[1] Chansonnier nouveau, dont le dépôt est chez le sieur Aubert, rue du Plâtre-Saint-Jacques, 16, à Paris.
Poujade, au refrain, feignait de pleurer largement et sa grimace était à mourir de rire. Et voilà ce que l’âge et la vie avaient fait de cet homme, intrépide jadis, allant gaîment au danger, blessé dix fois, et qui maintenant raillait ses vieilles amours et ses vieilles chimères, comme tous ceux qu’a détrompés l’avenir raillent leurs illusions perdues.
Bimborel, l’autre ami de Cœurdeloy, moins âgé que Poujade, était aussi moins sceptique. C’était dans toute la force du terme le soldat, humble, timide, résolu, attristé, le soldat esclave de la consigne et du devoir. Il avait fait, depuis l’Afrique, jusqu’à la Crimée, toutes les campagnes. Au retour de Sébastopol, en débarquant, il s’était cassé le bras. Il était déjà vieux, ayant plus d’années de service qu’il n’en fallait et il entra aux Invalides. Il y avait, en 1869, treize ans déjà que Poujade et Cœurdeloy le connaissaient.
Bimborel mettait tous ses souvenirs dans ce terrible combat de la Macta, en Afrique, où il avait, avec ses compagnons du 66e, vu de si près la mort, une mort affreuse, la mort par la décapitation et le massacre. Il se plaisait à raconter, en hochant la tête, ces journées d’Afrique :
« Lorsqu’on quitta le champ du Sig, le 28 juin, sur trois files, avec le bataillon d’Afrique en tête et nous à l’arrière-garde, on ne se doutait pas de ce qu’on allait voir. L’émir Abd-el-Kader nous attendait (Bimborel l’appelait plus souvent Abel-Kader) et, ses fantassins allant en croupe avec ses cavaliers, il nous attendait au passage sur des montagnes et caché dans les bois. Ses réguliers (vous ne savez pas ce que c’est que les réguliers d’Abd-el-Kader ? des mauricauds jambes nues, tête rasée, avec de petits burnous bruns en poil de chèvre), ses réguliers nous guettaient, et quand nous arrivons, feu partout. Avec cela, des feux d’herbe sèche qu’ils allument et la fumée qu’ils nous envoient avec des balles. On était aveuglé, criblé, canardé, assassiné. Les conducteurs des trains de blessés coupaient les traits des voitures et les Arabes égorgeaient les malheureux. On se défendait comme on pouvait, mais la chaleur était celle d’un four chauffé. On devenait fou. J’ai vu des camarades se déshabiller et se mettre à danser, tout nus, devant les Arabes, qui les descendaient. Je vous dis, on était fou, la tête perdue. Le soleil était écrasant. Sans nous et sans une poignée d’artilleurs, tout était fini. Mais on chanta la Marseillaise, on chanta, et en se dévouant et en se faisant tuer, on sauva les débris de la colonne ; mais il y avait des vides dans les rangs, et le général Trézel ne riait pas. »
Ainsi Bimborel avait laissé toute sa jeunesse et sa vigueur dans cette terre africaine, et il aimait à y retourner en pensée. Sans être un rêveur, et préférant, sans contredit, un verre de vin blanc à un sonnet, il avait aussi ses heures de mélancolie, quand il songeait à ces soirs de Constantine, aux rues d’Oran, aux petites juives avec leurs grands yeux veloutés, aux orangers qui sentaient bon. Il était fier aussi de se rappeler ses campagnes, les rudes assauts de Constantine, la retraite avec Changarnier, l’assaut avec Lamoricière, Orléans et Nemours, Tlemcen avec Cavaignac, et toutes ces courageuses campagnes qui devaient faire de la première armée d’Afrique (l’armée d’Afrique avant les bureaux arabes) une légendaire et intrépide armée.
« Il ne faut pas croire, disait-il encore, que nous nous soyons amusés non plus en Crimée. En faction, la nuit, à dix mètres des Russes, on gelait. Il fallait, le lendemain matin, casser la glace autour des sentinelles qu’on venait relever. Les pieds étaient pris. Rude armée, je vous le promets. On parle des Prussiens. Ils ne gagneraient pas la bataille de Traktir et renâcleraient devant ce siège où l’on mourait dans la nuit.
« Quand nous sommes entrés à Malakoff, ajoutait Bimborel, les jours où il était causeur, j’étais crevé de fatigue. Il faisait nuit. Je vois des sacs, des sacs gris. Je me dis : Voilà mon traversin trouvé ! Je me couche dessus et, pas plus tôt couché, je m’endors. Ah ! quel sommeil ! A poings fermés. Au petit jour, je m’éveille. Ça sentait une odeur fade, j’avais mal au cœur ; je me dis : Mais ce sont ces sacs, ils puent, ces sacs ! Je regarde, je crois bien qu’ils pouvaient puer ! C’étaient des Russes, des cadavres de Russes tués la veille, et j’avais couché et dormi là-dessus, moi, sans savoir. Ce qui prouve que tous les lits sont bons quand on est fatigué ! »
Tel était ce trio de braves gens parmi lesquels Marguerite grandissait et qui l’aimaient, tous les trois, d’une affection vraie et quasi paternelle. Cœurdeloy n’en était pas jaloux. Tous ceux qui aimaient Marguerite, au contraire, il les aimait. La petite maintenant était demoiselle de magasin, rue du Faubourg-Saint-Denis, chez une mercière, une payse de Cœurdeloy, Mme Sauviat, de la rue Manille. Cœurdeloy était assuré du moins que Marguerite, surveillée et choyée à la fois, n’avait rien à craindre. Aussi disait-il parfois, se frottant les mains :
« Allons, il ne s’agit plus que de trouver un parti à l’enfant, et je ne plains pas, je le dis d’avance, celui que je trouverai ! »
« Cœurdeloy, dit un matin Poujade en se promenant sur l’esplanade, tu parles souvent de marier la petite. C’est très bien. Mais es-tu parfaitement sûr qu’elle n’aime personne ?
— Qui ? Marguerite ? Aimer quelqu’un ?
— Ce serait donc bien étonnant ? Crois-tu que tout le monde a des frimousses comme Bimborel, toi ou moi ? Avant de chercher, consulte Marguerite. Je parierais qu’elle a un nom sur les lèvres et qu’elle rêve à une moustache plus ou moins frisée.
— Tu sais donc ?…
— Je ne sais rien du tout. Je présume. A dix-sept ans, ce n’est pas à Ragache qu’on pense, m’est avis. Interroge, tu sauras.
— Je suis bête, se dit Cœurdeloy, le fait est que Poujade a bien raison. Les fillettes savent quelquefois autrement mieux choisir que leurs parents le parti qui leur convient. »
Il s’habilla, alla au faubourg Saint-Denis et demanda Mme Sauviat. La mercière était enchantée de Marguerite. Intelligente, douce, dévouée, la jeune fille ne recevait que des éloges. On lui avait donné pour chambre la chambre de Mlle Sauviat, mariée récemment. Elle était là comme chez des parents. Cœurdeloy lui demanda si elle était heureuse, si elle souhaitait quelque chose. Elle ne souhaitait rien, elle se trouvait absolument heureuse. Pourtant, lorsque Cœurdeloy aborda de front, comme une redoute, la question du mariage, Marguerite rougit un peu, et lorsqu’il lui demanda si elle n’aimait pas déjà quelqu’un, elle se troubla visiblement. « Ce diable de Poujade, pensait Cœurdeloy, il avait deviné tout de même ! »
Marguerite avait, en effet, un secret qu’elle avait caché jusqu’ici au père Cœurdeloy, quoique ce mystère ne fût pas bien coupable. Elle passait, un jour, rue du Faubourg-Saint-Denis, au moment où un cheval emporté, traînant après lui un fiacre, se précipitait descendant la pente assez rapide qui va de la prison Saint-Lazare à la rue de Paradis-Poissonnière, et que les omnibus gravissent avec un cheval de renfort. En voyant cette voiture, ce cheval lancé au galop, on criait, on fuyait. Une bonne du quartier, portant un enfant, une Alsacienne, traversait en ce moment la chaussée, et ne paraissait ni voir le cheval ni entendre les cris. « Mais elle va se faire écraser, » dit Marguerite qui, avec Mme Sauviat, étaient accourues à tout ce bruit sur le pas de la porte. La pauvre fille et l’enfant eussent, en effet, été renversés et écrasés sans un jeune homme qui se jeta brusquement, intrépidement aux naseaux du cheval, et l’arrêta net d’un effort puissant. La foule applaudit, entoura le brave garçon. Lui, souriait.
« Vous avez le poignet solide, lui dit quelqu’un.
— Il le faut bien, répondit-il, quand on n’en a plus qu’un ! »
Marguerite le regarda. Le jeune homme était manchot. Il lui manquait le bras droit. Elle vit en même temps qu’il portait à sa boutonnière un ruban double, le ruban de la médaille militaire et celui de la Légion d’honneur. C’était dommage. Le jeune homme était réellement charmant, beau d’une beauté mâle, brun, solide, les yeux francs et le regard profond.
Comme il allait s’éloigner, Marguerite remarqua qu’il était légèrement blessé au front, le timon de la voiture l’ayant peut-être un peu frôlé. Mme Sauviat le vit aussi. Elle fit entrer le jeune homme à son magasin, et Marguerite étendit un peu d’arnica sur un mouchoir de batiste.
« Allons donc, mademoiselle, disait-il, j’en ai bien vu d’autres. Qu’est-ce que cette égratignure pour un Mexicain comme moi !
— Vous avez été au Mexique ?
— Et je n’en suis pas revenu tout entier, » fit-il en montrant d’un signe de tête sa manche droite repliée, cousue à son paletot.
Marguerite le regardait et se sentait prise de pitié pour ce jeune homme, brave, charmant et ainsi mutilé. Elle pensait que le père Cœurdeloy serait content de pouvoir le féliciter et lui dire qu’il avait bien agi.
Élevée dans ce milieu de vieux soldats et d’invalides, elle s’était accoutumée peu à peu à admirer par-dessus tout le courage militaire et à honorer les blessés des batailles. Le pilon qui servait de jambe à Poujade, les rhumatismes de Bimborel, la toux qu’avait parfois le père Cœurdeloy l’avaient depuis longtemps habituée aux infirmités humaines. Il y avait un peu en elle de la sœur de charité, qui ne s’effraye point devant un malade ou un amputé. C’est pourquoi Marguerite ne trouvait pas déplaisant, malgré le bras qui lui manquait, ce jeune homme dont la main virile venait de sauver la vie à deux êtres à la fois. Lorsqu’il prit congé de Mme Sauviat, Marguerite le vit s’éloigner à regret. Il avait laissé son nom, André Fabreveyre ; il avait même laissé échapper qu’il était Limousin, né à Saint-Yrieix, comme Dupuytren, et Marguerite était devenue toute rouge en disant : « Tiens, mon père Cœurdeloy aussi est Limousin ! » mais c’était tout. Elle eût voulu connaître l’histoire de ce passant, dont elle ignorait même l’existence une heure auparavant. Il est de ces sympathies invincibles qui feraient croire entre les êtres à une électricité latente.
Cette histoire d’André n’était pas bien romanesque ; la vie de ce jeune homme de trente ans était faite de devoir. Fils d’un petit épicier de Saint-Yrieix, il était tombé au sort et n’avait pu être racheté, quoique le père, le vieux, comme il disait, eût voulu vendre son fonds pour « acheter un homme. » Il était parti et, après un ou deux ans de vie de garnison, où il avait, en lisant, achevé l’éducation reçue jadis au lycée de Limoges, on l’avait envoyé au Mexique où, pendant plusieurs années, il s’était battu. Dans une des dernières rencontres avec les soldats de Juarès, il avait reçu une balle dans le bras et l’amputation avait été déclarée nécessaire. Elle avait réussi. Il était revenu en France et, après avoir obtenu une place de contrôleur au chemin de fer de l’Est, il espérait entrer dans les bureaux et il vivait dans cette espérance, apprenant le soir, tout seul, l’allemand et l’anglais. Le père Fabreveyre était mort, la mère aussi. André se trouvait donc seul au monde, seul avec ces espoirs qui, à trente ans, sont encore fleuris et comme parfumés, seul avec ses souvenirs, qu’il se plaisait à évoquer, quand il était seul et rêvait.
Un des plus terribles souvenirs d’André était celui-ci. Une nuit, sa compagnie, étant détachée pour donner la chasse à une bande mexicaine, s’était établie dans une hacienda abandonnée, pour y passer la nuit. On s’était logé et couché tant bien que mal dans l’auberge, et on commençait à dormir, lorsqu’un coup de feu traversa l’air, claquant avec un bruit sec, comme un coup de fouet. C’était une alerte. Les Mexicains entouraient la maison et comptaient surprendre le poste. Les sentinelles se replièrent sur la hacienda et chacun sauta sur son fusil. Le capitaine disposa en hâte ses hommes autour de la maison, en tirailleurs. La nuit était profonde, noire comme un ciel d’orage, et, la fusillade éclatant de tous côtés à la fois, l’obscurité semblait littéralement rayée de flammes. Un cercle de feu entourait le poste français, et si la compagnie n’avait pas eu le temps de se déployer autour de la ferme, elle était prise dedans et égorgée comme dans une ratière. Ordre avait été donné de riposter, sans s’avancer trop sur l’ennemi.
« Laissez venir, » avait dit le capitaine.
Les chinacos devaient être nombreux, car leur feu était vif. André, tapi derrière un mamelon de terre, entendait les balles bourdonner autour de son képi comme des essaims d’abeilles : « Ça serait bête tout de même, pensait-il, de mourir comme ça en pleine nuit. » Il guettait les coups de feu et brusquement tirait aussitôt sur la lumière, au juger, avec la froideur et le sang-froid d’un chasseur qui vise un perdreau. De tous côtés on ripostait. On se battit ainsi pendant toute la nuit. A la fin André, étouffant sous une chaleur torride, se mit en manches de chemise.
« Comment ! fit un soldat qui tiraillait à côté de lui, vous n’avez pas peur, mon fourrier, que ce blanc devienne un point de mire ?
— Que voulez-vous qu’on y voie quelque chose ? Il fait noir comme chez le loup.
— Et chaud comme chez le diable ! »
Cependant il fallait se battre ; André avait le gosier sec et faisait claquer sa langue contre son palais. La gorge serrée, il s’efforçait d’aspirer, dans cette nuit torride, un peu d’air frais.
« Vous n’avez pas votre gourde, vous ? disait-il à son voisin qui rechargeait son fusil.
— Non, fourrier. Mais si vous voulez, à dix pas d’ici, en vous glissant derrière les arbustes, il y a une flaque d’eau, et j’y ai bu.
— Y venez-vous avec moi ? »
André se glissa, s’abritant derrière des herbes hautes, jusqu’à l’endroit indiqué ; son soldat le suivait.
Dans la nuit, au clapotement de l’eau sous leurs pas, ils reconnurent la flaque, et, se penchant, André ramassa un peu d’eau dans ses mains réunies en forme d’écuelle et but. Il trouvait à cette eau un goût saumâtre, étrange, un goût de fer, mais il buvait. Un je ne sais quoi de solide et de semblable aux grumeaux de la colle lui passait parfois par la gorge, et cette eau devait être pleine de détritus d’herbes, peut-être de mousse verdâtre nageant dans la mare croupie ; mais sa soif était si intense, si affreuse, qu’il buvait encore. Son compagnon, buvant aussi, disait :
« C’est bon tout de même ! »
Puis il retourna à la petite ferme et passa la nuit à faire le coup de feu.
Le matin, les Mexicains étaient repoussés, et quand le soleil se leva sur ce champ resserré de combat, André, en allant vers la flaque d’eau, recula terrifié et ses cheveux se dressèrent avec horreur sur son crâne tandis qu’un haut-le-cœur atroce le secouait et le soulevait brusquement. O dégoût ! Il y avait dans la mare un cadavre étendu, un cadavre de Mexicain au front ouvert par une balle et dont la cervelle nageait, hideuse, dans l’eau rouge comme du sang. Cette cervelle et cette eau, c’était ce qu’André avait bu, et quand il y songeait un frisson d’horreur lui revenait encore.
« Et voilà, disait-il, ce que c’est que la guerre ! »
Les sympathies, dans ce monde, sont le plus souvent réciproques, et si André avait fait quelque impression sur Marguerite, la jeune fille avait absolument séduit André. Il y songea longtemps, et plus d’une fois il passa devant le magasin de Mme Sauviat pour la revoir. Du fond du logis de la mercière, Marguerite apercevait André et devenait rouge. Elle avait envie d’aller lui parler. Elle trouvait ridicule qu’il n’entrât pas saluer Mme Sauviat. Un jour qu’en prenant son courage à deux mains il se risqua dans la boutique, Marguerite fut heureuse et tentée de lui dire : Merci.
Peu à peu, il s’était établi entre les jeunes gens un courant magnétique et ils ne se dissimulaient pas l’un à l’autre, par l’éloquence du regard, qu’ils se plaisaient et s’aimaient sincèrement. Maintenant Marguerite savait le nom du jeune homme et André connaissait la parenté de Marguerite. Lorsque le père Cœurdeloy eut flairé le secret, il l’obtint bien vite et Marguerite avoua tout. Elle tremblait que le petit vieux ne se fâchât. Point du tout. Au contraire.
« Eh ! bien, mais, s’il est charmant, ce M. André, qu’il vienne me trouver, et si c’est un honnête garçon on lui donnera tes deux mains, quoiqu’il n’en ait qu’une ! »
Le lendemain, André se présentait à Cœurdeloy. Marguerite avait tout dit. Il venait faire officiellement la demande. Il séduisit le vieillard comme il avait séduit la jeune fille ; mais Cœurdeloy, qui, pour lui, eût été le plus insouciant des hommes, devenait pour Marguerite un calculateur effréné ! Il trouvait que la position d’André n’était pas, disait-il, suffisante.
« Vous concevez, mon garçon, en élevant la petite, j’ai contracté vis-à-vis de moi-même l’obligation de la faire heureuse. La richesse, je m’en moque. On aurait beau être Rothschild, on ne mange pas deux fois, et quand on a de quoi vivre, cela suffit. Mais je veux au moins que Marguerite soit assurée de ne manquer de rien. Supposez que la maman, celle que j’ai vu filer le long des murs en 1853, revienne me réclamer sa fille un beau matin, je veux qu’elle puisse dire : « Eh ! bien, père Cœurdeloy, vous avez joliment pris soin de son avenir tout de même. » Elle ne viendra pas, mais c’est tout comme. Mon garçon, le jour où vous pourrez me dire : J’ai trois cents francs par mois d’assurés, je vous donnerai Marguerite. Ainsi, piochez, travaillez.
— Ne craignez rien, monsieur Cœurdeloy, on travaillera. »
Et André se mit à piocher, comme il disait, davantage. On lui avait promis, au chemin de fer, une place dans les bureaux. Avec sa double pension, il aurait bientôt atteint les 3.600 francs par an qu’exigeait Cœurdeloy pour lui donner Marguerite.
André, de sa main gauche, s’exerçait à écrire et faisait, grâce à des efforts de volonté, des progrès étonnants. Son écriture, superbe au temps où il était fourrier et où il écrivait de la main droite, prenait, tracée de la main gauche, une tournure, une inclinaison de ronde et, s’il mettait plus de temps à tracer ainsi une ligne, les caractères y gagnaient singulièrement en netteté. Il ne désespérait point d’acquérir une adresse, — je ne puis pas dire une dextérité, faisait-il en souriant — qui lui permît d’être employé avec profit.
Il avait, il est vrai, parfois bien des mélancolies et des découragements.
Du haut de sa mansarde du faubourg Saint-Denis, André, fumant sa pipe, songeait à Marguerite, tout en regardant vaguement devant lui. Des toits recouverts d’ardoises et de zinc se détachaient, couronnés de petites cheminées de briques jaunes, sur le fond bleu d’un ciel d’été. Au-dessous de la fenêtre, sur le pavé bruyant du faubourg, des fiacres passaient lentement, des haquets, des camions chargés, et un roulement sourd montait jusqu’à la fenêtre où s’appuyait André. Il laissait machinalement ses regards aller sur les choses. En face de lui un petit tuyau de machine à vapeur lançait par jets rapides des bouffées de fumée blanche, tandis que d’une haute cheminée carrée sortait une fumée noire rabattue et dispersée par le vent. Au loin, dans un horizon noyé de brume apparaissaient des maisons, des toits, des cimes d’arbres, des lambeaux de mamelons de terre, couverts d’herbe pelée, et deux clochers parallèles, blancs et élancés, se dressant sur les nuages. C’était Belleville, son église, ses buttes. André regardait cela, puis ramenait son regard sur les mansardes qui faisaient face à la sienne. Presque toutes les fenêtres étaient closes, à cause de la chaleur ; une seule, ouverte, laissait apercevoir, entre deux rideaux blancs, une petite chambre tendue de papier à fleurs jetées, et devant la fenêtre, deux hommes en manches de chemise qui achevaient de déjeuner. L’un avait les cheveux blancs, l’autre était jeune. Des ouvriers l’un et l’autre. Une femme mince, pâle, frêle et charmante leur versait en souriant du café dans des tasses à filets d’or. Elle souriait à l’un et à l’autre, au vieux qui était sans doute son père et au jeune homme qui était son époux. Puis, quand elle avait fini, elle prenait au fond de la chambre, dans un berceau, un petit enfant qui criait, enveloppé de langes, et, le faisant sauter dans ses bras, elle se mettait à baiser ses joues rouges où le sang du nouveau-né courait à fleur de peau. — Dans une cage pendue à la fenêtre des chardonnerets chantaient.
André, regardant cela, se sentait pris d’une mélancolie profonde. Ces gens-là s’aimaient et ils étaient heureux ! Ils étaient libres ! Leur existence toute de travail avait aussi sa part de bonheur. Il souhaitait pour lui cette félicité tranquille, le coin de logis, ce nid sous les toits, cette tranquillité savourée ainsi, entre le brave père Cœurdeloy et Marguerite. Qui l’empêchait d’avoir cela bientôt ?
Tout arrive, a dit un philosophe pratique. Le jour qu’espérait André arriva. On le prenait décidément au chemin de fer de l’Est, on l’employait. Il avait enfin des appointements suffisants, il pouvait vivre convenablement, faire vivre Marguerite, élever ses enfants, s’il en avait ! Il courut aux Invalides. Le père Cœurdeloy l’écouta, sourit, lui tendit la main et dit :
« Tope, vous serez mon gendre ! »
Et Cœurdeloy hochait la tête à ce nom : mon gendre !
« Après tout, disait-il, elle est ma fille ! »
Cœurdeloy revint avec André, bras dessus bras dessous, jusqu’au faubourg Saint-Denis et on alla chercher Marguerite.
« Tiens, dit l’invalide, épouse-le ton André, puisque tu le veux ! »
On alla dîner dans la mansarde d’André. Et on dîna bien. Au dessert, Cœurdeloy chanta sa chanson limousine, puis il s’endormit sur un fauteuil. Les deux jeunes gens étaient à la fenêtre et regardaient, sans dire un mot, le crépuscule qui venait…
Un de ces crépuscules de la fin d’août où les soirs ont déjà la mélancolie de l’automne. Le ciel prend des tons, non pas frileux encore, mais apaisés et comme assoupis. Des rougeurs calmées courent au couchant et s’unissent à des nuages d’un violet gris, d’un bleu sombre, étendus dans l’immensité grise comme un lavis d’aquarelle. Le haut des maisons s’incendie encore, les vitres ont des reflets roses, le crépuscule couvre les toits, l’horizon, d’une teinte bleuâtre encore vigoureuse mais attiédie et fraîchissante. L’air est plus frais, le soir plus rapide, et la lampe commence à s’allumer plus tôt. C’est le prologue de l’automne, c’est, dans un lointain pourtant rapide, la première vision de l’hiver.
André, accoudé là, ne disait rien et savourait ce moment de volupté sainte, lorsque doucement, tendrement, Marguerite lui dit tout bas :
« Nous nous aimerons toujours ?
— Toujours ! répondit André.
— Comme nous serons heureux !… Que vous êtes bon !
— Que vous êtes jolie !
— Mais toujours, n’est-ce pas ?
— Toujours !
— Que c’est beau cet horizon !
— Parce que vous êtes là !
— Flatteur. Ah ! si vous savez flatter, je croirai que vous pouvez mentir.
— Je ne flatte ni ne mens, Marguerite.
— Alors vous m’aimez bien ?
— Je vous adore.
— Je vais bien voir… Dites-moi quel jour vous m’avez parlé pour la première fois…
— Un mercredi.
— C’est vrai. Je vois que vous m’aimez bien…
— Marguerite !
— Bien, bien, bien, bien ?
— Plus que tout au monde et pour toujours.
— Le joli mot ! disait-elle, et, les yeux fixés sur l’horizon, la tête appuyée sur l’épaule d’André, elle murmurait, doucement, tendrement, ce mot musical et séduisant : toujours ! »
Puis elle ajouta :
« Ah ! comme mon cœur rit, André ! »
Il se pencha vers elle et, baissant jusqu’à ce front de jeune fille ses lèvres, il demeura ainsi longuement la tenant embrassée, elle heureuse d’une ivresse pure, jusqu’au moment où Cœurdeloy s’éveillant dit :
« Allons, bon ! Il faut que je rentre ! Je n’ai pas de permission pour ce soir ! »
Il serra la main d’André, conduisit Marguerite jusque chez Mme Sauviat et prit en trottant le chemin des Invalides.
Cœurdeloy annonça le lendemain à l’Hôtel qu’il mariait Marguerite. « Bravo, dit Poujade, on boira à la santé de la mariée ! — On dansera, » ajouta Bimborel. Cœurdeloy s’occupa de régulariser la situation légale de Marguerite. Aucun obstacle ne s’opposait à l’union des deux jeunes gens, et tout eût fini sans encombre, n’eût été Urbain Ragache qui, depuis qu’on avait parlé de ce mariage, était devenu plus désagréable qu’auparavant.
Le soudard, en effet, avait eu longtemps, comme on dit, des idées sur la petite. Il la trouvait de son goût. Lorsqu’elle venait à la Belle Obus, chez la mère Madras, il lui tournait galamment des couplets de mirliton :
Ragache tournait et, comme on dit, papillonnait autour de la jolie fille, mais Marguerite était véritablement trop honnête pour s’en apercevoir. Elle ne rougissait même pas quand cet homme en la regardant clignait ses paupières et souriait. Elle ne comprenait point. Lorsque la mère Madras, jalouse des attentions qu’avait Urbain pour « cette petite », risquait quelque allusion mordante, Marguerite répondait en toute sincérité : « Je ne sais, madame, ce que vous voulez dire ! » Cette candeur n’entendait rien ni aux galanteries de Ragache, ni aux grognements de Mme Madras, elle ne comprenait rien à ces fureurs du vice vieilli.
Urbain Ragache était furieux. Il faisait payer à Cœurdeloy les dédains de Marguerite. Et le calme de la jeune fille n’était pas même du dédain. Ragache maintenant regardait souvent Cœurdeloy d’un air tantôt railleur, tantôt agressif. La plupart du temps Cœurdeloy ne s’en apercevait pas. Cela dépendait de ses lunettes. Mais quand Ragache en passant cassait un barreau de la clôture du jardin, ou faisait tomber les deux ou trois poires qui mûrissaient sur les poiriers, ou renversait l’arrosoir que Cœurdeloy avait rempli à la fontaine, quand il prenait ses airs narquois et sifflait en prenant le pas sur le petit homme, Cœurdeloy se sentait pris d’une envie folle de lui en demander raison. Il se calmait bientôt en se disant qu’après tout il faut bien souffrir en ce monde quelque chose des voisins grincheux, et que Ragache en avait bien fait d’autres jadis, lorsqu’il donnait des pichenettes sur le nez d’un invalide sans bras et tendait — on l’en soupçonne du moins — des ficelles dans les corridors pour faire trébucher les camarades. Et puis Ragache était farouche. D’un coup de sabre il pouvait tuer Cœurdeloy, comme il avait tué le canonnier, dans l’île des Épis. Et, depuis qu’il avait Marguerite auprès de lui, Cœurdeloy tenait à vivre.
Alors il se calmait. « Laisse-le donc tranquille, le Ragache, disait Poujade, moins on s’occupera de lui, plus il ragera. » Mais Bimborel hochait la tête et disait que celui qui adoucirait le matamore par une petite saignée donnée à propos rendrait un signalé service à l’Hôtel tout entier.
Ragache était hors de lui depuis qu’il savait que Marguerite épousait André, un ébraté, disait-il à la mère Madras qui, de son côté, voyait avec une violente jalousie les attentions de Ragache pour Marguerite. Un soir, Ragache vint à la Belle Obus dans un tel état de colère que Mme Madras se sentit piquée au vif et demanda au grognard si c’était le mariage de la petite qui le tracassait ainsi :
« Pourquoi pas ? » fit Ragache d’un air maussade.
La veuve Madras, rouge d’ordinaire, devint pourpre.
« Pourquoi pas ? Parce que vous pourriez bien avoir la politesse de ne pas me dire, à moi, quelles sont les poulettes que vous convoitez pour vos fredaines !
— Des poulettes ! mes fredaines ! Ah çà ! dit Ragache en frappant sur la table, je crois que je suis libre de courtiser qui je veux et de ne plus cultiver qui je ne veux plus !
— Vaurien, fit Mme Madras, tu viendras encore boire mon vin blanc et mon vespétro, pour me dire après cela des sottises ! Eh bien ! on te l’arrangera, ta donzelle ! Ne crains rien ! J’ai des moyens de me venger !
— Fais ce que tu voudras, répondit Ragache en haussant les épaules. Misère ! Après tout, ce n’est pas moi qui la défendrai, cette chipie ! »
La vengeance de la mère Madras devait être féroce et lâche. Cette femme haïssait Marguerite comme la laideur déteste la beauté, comme la bêtise déteste l’esprit. Elle inventa pour la perdre une combinaison : un mensonge absurde, mais qui devait avoir d’autant plus de prise qu’il était plus brutal. La mère Madras savait par Ragache que Cœurdeloy avait donné rendez-vous à Marguerite au cabaret de la Belle Obus pour aller de là à la mairie chercher des papiers. Sur cette simple indication, elle établit son plan de campagne. Elle jeta les hauts cris, disant qu’on l’avait volée ; que sa montre, suspendue à un clou derrière le comptoir, avait disparu ; que Marguerite, l’avant-veille, avait justement passé par là, s’était appuyée contre le comptoir en attendant Bimborel et Cœurdeloy, qui portaient un dernier toast dans le cabinet voisin. Et, tout en guettant l’arrivée de l’omnibus que Marguerite avait coutume de prendre lorsqu’elle venait retrouver Cœurdeloy rue Croix-Nivert, la Madras répétait de tous côtés : « Ma montre ! Je sais bien qui m’a volé ma montre ! »
C’était absurde et niais, mais c’était grossier et facile à saisir. Une accusation de vol est brutale comme un fait. Elle foudroie lorsqu’elle tombe sur quelqu’un.
Lorsque Marguerite arriva, elle trouva, sur le seuil du cabaret, la mère Madras, rouge et furieuse, qui la salua par cette interrogation jetée en plein visage :
« Ah ! c’est vous, enjôleuse ! Eh ! bien, dites donc, s’il vous plaît, j’espère que vous allez me rendre ma montre ?
— Quelle montre ? balbutia Marguerite stupéfaite et qui devint rouge à son tour.
— Comment ! quelle montre ? glapit la mère Madras. Elle a le toupet de me demander quelle montre ! La montre que vous m’avez prise donc, ma montre à moi ; vous entendez bien !
— Une montre… moi ?… votre montre ?… » répétait Marguerite écrasée.
La rue Croix-Nivert était pleine de monde et la foule, attirée par le bruit comme le papillon par la lumière, se massait, grossissait et faisait cercle autour de la porte. La mère Madras, debout sur le seuil, entre ses deux caisses de lauriers roses, montrait à tout ce monde Marguerite, pâle et qui tournait autour d’elle des yeux égarés.
« Qu’est-ce qu’il y a ? qu’est-ce qu’il y a ? disaient les commères.
— Il y a, répondait Mme Madras parlant à la foule, il y a que cette petite malheureuse, vous la voyez bien, m’a volé ma montre, la grosse montre à répétition qui venait de feu Madras, un souvenir pieux, le souvenir de vingt années de félicité parfaite !
— Volé ? j’ai volé ? s’écria Marguerite, ah ! vous mentez, madame, vous mentez ! »
Et, d’un mouvement brusque, irréfléchi, elle allait se jeter sur la mégère, lorsqu’elle sentit son sang se glacer et, livide, elle tomba évanouie dans les bras d’un ouvrier qui s’élança. On la porta chez le pharmacien, à côté, et la foule s’assemblait et grossissait, lorsque, au coin de la rue se montra, un mouchoir à la main, s’essuyant le front, le père Cœurdeloy.
Cœurdeloy, essoufflé, accourut, et quand il demanda de quoi il s’agissait, un maçon répondit :
« Ce n’est rien, c’est une rien du tout qui a volé une montre à une grosse mère.
— C’est votre Marguerite, » dit une voix méchante et rauque, la voix de Ragache.
Ragache était enchanté de l’invention de la Madras, il avait tout compris et tout approuvé.
Cœurdeloy leva les yeux sur l’invalide et dit :
« Comment ?
— C’est votre Marguerite qui est une vol… » commença Ragache. Mais il n’acheva pas. Reculant un peu, se mordant les lèvres, furieux, le petit Cœurdeloy bondit et lança, comme d’un trait, sa main au visage de Ragache. Cette main s’abattit sur la joue grise du soudard et Ragache, étonné et étourdi, recula à son tour, tandis que Cœurdeloy répétait :
« Qui a dit que Marguerite était cela ? Canaille ! »
A son tour, Ragache voulut s’élancer. On le retint.
Tufille, d’autres invalides, qui étaient là, s’interposèrent.
« Tu sais ce que ça te coûtera, ça ! disait Ragache furieux. Tu le sais, espèce de potiron ?
— Oui, oui, je le sais, répétait Cœurdeloy.
— Je te tuerai comme le canonnier, je te fendrai en deux !
— Oui, oui, » disait toujours Cœurdeloy, qui demandait déjà à la foule : « Où est ma fille ? où est Marguerite ! où est-elle ? »
On le conduisit à la pharmacie, tandis que Ragache disait à la mère Madras que le soufflet serait payé cher, et que la cabaretière lui versait un verre de cognac pour le remettre. Lorsque Marguerite, qui revenait à elle, aperçut Cœurdeloy, elle se jeta à son cou et se mit à pleurer à chaudes larmes.
« Pleure, ma pauvre petite, pleure, ça te fait du bien. Ne crains rien, ne crains rien ; le père Cœurdeloy est là ! C’est une vilaine femme la Madras, et le Ragache est un coquin… Pleure… Non, ne pleure plus, tiens, je t’en prie, ne pleure plus… Allons-nous-en… »
Un gamin alla chercher une voiture place Cambronne, et le père Cœurdeloy y monta avec Marguerite. Il ramena la pauvre enfant faubourg Saint-Denis, puis, après l’avoir bien recommandée à Mme Sauviat, il reprit, en fredonnant, un air du pays, une chanson limousine de Foucaud, le chemin de l’Hôtel :
Ce soir-là, André vint justement voir Marguerite. Quoiqu’elle se fût bien promis de ne rien dire, elle n’eut point la force de lui cacher ce qui était arrivé. Il devint vert de fureur en apprenant cela, et instinctivement ses yeux se portèrent sur la place de son bras absent : « Manchot ! pensa-t-il. » Ce ne fut qu’un éclair, il songea bien vite qu’on peut encore souffleter et tuer un homme du bras gauche et il se dit que dès demain il ferait cela. Il promit cependant le contraire à Marguerite qui devina sa pensée. Puis il rentra chez lui et se mit à écrire. Il écrivit à Marguerite une seule ligne : « C’est la seule fois que j’aurai menti et que je vous tromperai. Marguerite, je vais souffleter le lâche qui vous a insultée. » Le lendemain de bonne heure, il se dirigeait vers les Invalides. Lorsqu’il y arriva, il demanda Ragache.
« Sorti, lui répondit laconiquement un vieux appuyé sur sa canne.
— Ah ! Et le père Cœurdeloy ?
— Sorti, dit encore l’invalide.
— A cette heure-ci ?
— Sortis tous deux et ensemble, » ajouta le vieux d’un air qu’il voulait rendre fin.
André recula brusquement et, se frappant le front :
« Mon Dieu, dit-il, ils se battent ! »
L’invalide ne répondit pas, mais il sourit.
André eut un effroyable déchirement de cœur. Le père Cœurdeloy se battant avec ce bretteur était perdu.
« Quel malheur ! » dit tout haut l’ancien fourrier.
Il essaya d’obtenir des renseignements sur le lieu du combat, car il voulait à tout prix rejoindre Cœurdeloy, empêcher le duel et détourner sur lui la colère de Ragache. Il se mit à courir et à questionner de tous côtés en se répétant :
« Il le tuera, ce gredin-là le tuera ! Pauvre Marguerite ! »
Cœurdeloy se battait en effet. La veille, à peine arrivé à l’Hôtel, il avait prié Poujade et Bimborel de lui servir de témoins, puis il était allé demander au gouverneur la permission de se battre. Le général n’était pas là, mais le colonel V… était de service. Quand il entendit Cœurdeloy parler de duel, il se mit à rire, mais il ne rit plus quand le petit homme nomma son adversaire, Urbain Ragache.
Le colonel dit seulement :
« Vous tenez donc bien à faire casser une vieille trompette comme la vôtre ? »
Puis, devenant brusquement plus grave et presque ému :
« Comment, Cœurdeloy, voyons, deux vieillards, deux êtres qui avez votre bière tout équarrie chez le menuisier, qui en avez fini avec la vie, on peut le dire, deux échappés de tant de batailles, vous voulez encore vous battre au bord du tombeau, après vous être tant de fois battus ?
— C’est justement, répondit doucement Cœurdeloy, parce qu’il ne nous reste qu’un lambeau de vie à user qu’il faut le garder sans taches, mon colonel ; quand on a vécu honnêtement jusqu’à nos âges, on peut bien partir un peu plus tôt pour ne pas risquer de finir mal ce qu’on a bien commencé. »
Le colonel regarda fixement Cœurdeloy :
« Vous avez raison, dit-il. Faites comme vous l’entendrez. »
Et, soupirant, il dit au vieux soldat :
« Au revoir, j’espère !
— Je l’espère aussi, mon colonel. Dans tous les cas, merci ! »
Ragache avait choisi pour témoins Tufille et Taboureaux, deux solides. Les témoins avaient décidé qu’on se battrait au briquet.
« C’est au sabre de cavalerie que j’ai tué le canonnier, dit Ragache, mais le briquet suffira cette fois.
— Très bien, » fit Cœurdeloy.
Il se coucha de bonne heure et dormit bien. A l’heure ordinaire il s’éveilla. On ne devait sortir et s’aller battre qu’après l’appel du matin, pour ne pas donner l’éveil à l’Hôtel qui, de la base au faîte, savait pourtant ce qui se préparait. L’appel terminé, le père Cœurdeloy rentra au dortoir, inspecta ses hardes, posa un mouchoir sur son lit et, y mettant sa croix d’honneur, sa tabatière, sa chaîne d’or, sa montre et son flageolet (toute sa fortune), il le noua ensuite aux quatre coins et descendit dans la cour d’honneur où Poujade et Bimborel l’attendaient.
« Là, dit-il alors en leur tendant le paquet, voilà ce que l’un de vous deux rapportera à la petite s’il m’arrive malheur aujourd’hui. C’est entendu ?
— C’est entendu, » dit Bimborel.
Poujade prit le paquet et l’ensevelit dans la large poche de sa capote.
« Maintenant, dit Cœurdeloy, allons-y. Il ne faut faire attendre personne. »
On se mit en marche doucement, Poujade clopin-clopant, et Bimborel se plaignant de son asthme. Le petit Cœurdeloy seul avait l’air allègre et décidé, il redressait sa tête comme un coq redresse sa crête et il y avait dans toute sa personne une expression de résolution belliqueuse que lui donnait la pensée de se mesurer avec l’homme qui avait insulté Marguerite. Poujade, qui regardait le petit vieux du coin de l’œil, étouffait de temps à autre un soupir et disait tout bas à Bimborel :
« Ça fait pitié, Ragache va nous l’embrocher comme une mauviette ! »
On arriva rue Lecourbe, dans le chantier qu’on avait choisi. C’était un chantier de bois, où l’on pouvait facilement se dissimuler derrière les hautes piles alignées au cordeau. Le portier, ami de Taboureau, autorisait la rencontre. Les charretiers étaient partis pour livrer des falourdes en ville, et l’intérieur du chantier était assez éloigné de la rue pour que le bruit du fer et du choc des sabres n’arrivât pas jusqu’aux rares passants.
Ragache et ses témoins étaient arrivés déjà, Ragache, le visage rouge, les yeux allumés, se promenait le long d’une pile de bois, les mains dans ses poches. Le père Cœurdeloy fut contrarié de n’être pas le premier au rendez-vous ; il fit claquer sa langue contre son palais et hocha la tête. De loin, Ragache, qui l’avait aperçu, le regardait en fronçant ironiquement la lèvre. Toute la physionomie brutale du vieux soudard avait quelque chose de plus féroce encore que de coutume.
« Toi, tu vas avoir ton affaire faite, Tom-Pouce, » maugréait Ragache entre ses dents jaunes.
Instinctivement, en regardant ce grand vieillard solide qui faisait de si longues enjambées et dont les muscles du visage avaient des froncements sinistres, Poujade et Bimborel songèrent au canonnier de Strasbourg et se dirent, chacun à part soi, que le père Cœurdeloy n’avait pas longtemps à vivre.
« Je ne flanquerais pas quatre sous de sa peau, » avait dit la veille Tufille, qui devait le lendemain revêtir pour la circonstance son vieil uniforme de lancier rouge, au plumet dépecé et au drap rongé de mites.
On se salua. Les témoins mesurèrent les briquets et les tendirent ensuite aux deux adversaires. Ragache avait quitté sa capote, son gilet et relevé sa manche droite. On apercevait, par l’échancrure de sa chemise, un peu de sa poitrine noire et velue, et les nerfs de son bras droit se détachaient roides et tendus, gros comme des cordes. Le père Cœurdeloy en manches de chemise était tout simplement ridicule. Des bretelles à fond rose brodées de lauriers verts — les bretelles que lui avait ornées Marguerite — se collaient sur sa poitrine rebondie et faisaient remonter jusqu’au milieu du dos son large pantalon flottant. Il avait posé ses lunettes d’or sur son nez et agitait un peu ses jambes comme un homme qui sent, comme on dit vulgairement, des fourmis. Entre ce solide vieillard et ce petit vieux pacifique le combat ne pouvait être ni long ni douteux. Le pauvre Poujade en frissonna jusqu’à la moelle.
« En garde ! » dit Bimborel.
Ragache se posa, le poing gauche sur la hanche, et, après avoir salué, il tomba en garde avec la désinvolture assurée d’un bretteur de profession, battant la terre du bout de son pied et regardant son adversaire dans les yeux. Cœurdeloy doucement s’était mis en garde et attendait. Ragache brusquement attaqua, détendant son bras et portant à Cœurdeloy un robuste coup de tête, le coup qui avait fendu le crâne au canonnier. A ce geste, les témoins frémirent, sentant déjà que Cœurdeloy était perdu. Mais, par un mouvement brusque et ferme, Cœurdeloy, prenant la garde haute, prévint le terrible coup, et le sabre de Ragache vint se heurter à son sabre avec un bruit sinistre et des jaillissements d’étincelles. Le grand vieillard, furieux de la parade inattendue, laissa échapper un juron énergique, et Cœurdeloy demeura à sa place, solide sur ses petites jambes et prêt encore à parer.
Cœurdeloy éprouvait, en ce moment, comme une hallucination singulière. Il lui semblait que Marguerite était là, la pauvre Marguerite tout en larmes, la tête dans ses mains, telle que lorsque la mère Madras l’avait brutalement chassée devant tout ce monde. Il voyait la malheureuse enfant humiliée, frémissante, désolée. Assurément il la voyait, et cette vision lui rendait le pied plus sûr, la main plus ferme, le coup d’œil plus net. Et, au même moment, une sorte de chanson douce, naïve, charmante, la chanson du pays, jouée par une sorte d’invisible flageolet, lui riait doucement, tendrement aux oreilles. Il avait envie à la fois de pleurer et de se précipiter sur Ragache. La chanson lui disait : « Courage ! » et la vision lui criait : « Venge-moi ! »
Tout à coup, après le coup de lame porté en tête, Ragache envoya violemment un coup de pointe en pleine poitrine à Cœurdeloy. Sans un mouvement instantané, l’invalide était mort. Mais il opposa encore une parade nerveuse à cette furieuse attaque, et, tout à coup, instinctivement entraîné, poussé, emporté, il se fendit brusquement sans donner à Ragache le temps de se remettre en garde et, allongeant le bras avec colère, perdant presque pied en se lançant sur l’ennemi, il enfonça son sabre tout entier dans la poitrine de Ragache. La lame du briquet disparut jusqu’à la garde et la pointe sortit avec un flot de sang dans le dos de Ragache qui, debout, l’œil fixe, tenant encore son sabre de sa main qui venait de glisser le long de son corps, roulait des prunelles hagardes et se dressait, droit et roide comme un pieu.
Au moment où les témoins se précipitaient sur lui pour le soutenir, une bave rouge ensanglanta sa lèvre et sa moustache grise et il tomba de toute sa hauteur, avec un hoquet affreux et sourd.
« Nom de nom, dit Poujade, son affaire est faite !
— Mort, » dit Taboureau.
Cœurdeloy regardait devant lui, les verres de ses lunettes brouillés par les larmes qui venaient à ses yeux, et il demeurait immobile à sa place avec des étourdissements dans les oreilles.
« Je l’ai tué ? demanda-t-il de sa petite voix, au bout d’un moment.
— Tué net, » répondit Bimborel.
Poujade ajouta entre sa moustache :
« De Profundis !
— Sacré nom, dit Tufille, j’aurais parié le contraire !
— C’est le premier, fit Cœurdeloy en hochant la tête ; et ça fait un drôle d’effet tout de même. Brr ! Allons-nous-en ! J’ai besoin d’embrasser Marguerite ! »
C’est une vieille histoire, cette histoire qui date d’un an. Elle a fait causer bien des gens dans le quartier des Invalides. Depuis, Marguerite a épousé André. Cœurdeloy a quitté l’Hôtel. Il vit paisible maintenant, jouant toujours de son flageolet et racontant, avec un certain frisson, ce terrible duel avec Ragache. « Je n’aurais pas voulu le tuer, » dit-il. Et Bimborel l’interrompt en disant : « Le gredin ne l’avait pas volé ! » La mère Madras a depuis avoué son mensonge. Elle a fait faillite et depuis elle a disparu. Le cabaret de la Belle Obus est fermé.
Poujade est encore à l’Hôtel. Il sert toujours de guide aux étrangers. Lorsqu’il montre à présent le tombeau de l’Empereur, il se plaît à ajouter :
« Maintenant c’est fini de rire ! Le neveu a fait du tort à l’oncle ! »
André s’est bravement battu pendant le siège. « Ce n’est pas une raison, disait-il, parce qu’on est infirme pour ne pas faire son devoir. » Il fut des gardes nationaux qui entrèrent à Buzenval. Cœurdeloy, de temps à autre, lui dit :
« C’est bien, mais avec tout ça je ne vois pas venir les petits grenadiers que j’attends. » Puis il ajoute : « Bah ! à bientôt ! Mais quelle étrange chose tout de même ! Si je n’avais pas monté ma faction rue Neuve-Saint-Jean, il y a des années, j’aurais vieilli seul, oublié, et fini comme une bête. Pas de famille, pas d’enfant, la solitude et l’ennui, c’est le lot de l’invalide. Voulez-vous que je vous dise ? Un soldat ne devrait pas vieillir, il devrait finir un jour de bataille, un jour de victoire ! Il y a quelque chose de plus triste que la défaite, c’est la gloire qui se ride et qui tousse !
— Ce qui n’empêche pas, ajoutait Bimborel, que, tout vieux et laids que nous sommes, nous avons fait notre devoir en son temps et que nous avons aimé quelque chose qu’on aime toujours et qui s’appelle le pays. »
Cœurdeloy ! Bimborel ! Quand je longe parfois l’esplanade où tant de maux se traînent qui furent jadis des énergies, des dévouements et des courages, je me prends à songer à tout ce qu’il y a de grand dans le sacrifice, à tout ce qu’il y a de consolant dans l’honnêteté, et aussi à tout ce qu’il y a d’ironique dans la destinée, et je salue avec un certain respect ces témoins d’un passé qui fut héroïque et ces êtres qui tiennent au sol comme si la glaise du cimetière les sollicitait déjà et glissent lentement comme des escargots après avoir rugi et bondi comme des lions.
Ce sont les derniers. Chaque jour ils disparaissent, ils meurent. Les feuilles jaunes ne tombent pas plus vite aux premières bises d’automne. Ils s’en vont. « On bat le rappel là-haut, disait le maréchal Soult. » Le cimetière Montparnasse garde leurs tombes. Et le dernier invalide des guerres de l’empire ira bientôt dormir là-bas, oublié, sans nom, auprès de la fosse commune… Et c’est avec ces vieux qu’on bâtit des arcs de triomphe et qu’on grave sur la pierre ou le bronze des noms éclatants de victoires ! Braves gens ! Pauvres gens !
La gloire, la gloire, est-ce donc un mot ?…
— 1870 —
On amena, le soir du 21 décembre 1870, à l’ambulance du Grand-Hôtel, un officier qui avait été blessé le matin, à l’attaque du Bourget. Une balle lui avait brisé le genou. Il souffrait horriblement ; mais essayant de dissimuler sa souffrance, en vieux soldat qu’il était, il se contentait de mordiller sa lèvre inférieure et un peu de sa barbiche. Lorsqu’on le descendit de la voiture d’ambulance pour le transporter dans un lit, il dit froidement aux hommes qui le portaient et dont chaque mouvement eût dû lui tirer un cri, tant sa blessure était douloureuse :
« Fâché de la peine, les amis, mais il faut bien avoir recours aux bras des autres quand on n’a plus ses jambes à soi. »
On le coucha sur un lit. Il enleva lui-même sa tunique, son gilet, défit ses bretelles, mais arrivé au pantalon, les forces lui manquèrent :
« Non, c’est impossible, » dit-il.
Et il s’abandonna aux infirmiers.
Il s’appelait Merlier. Il avait quarante-cinq ans. Il était commandant d’infanterie de ligne.
Dans sa vie, cet homme avait vu souvent la mort de près et senti passer sur sa peau le froid du fer ou le sifflement de la balle. Il n’avait jamais été blessé. En Italie, au Mexique, à Wissembourg, à Frœschwiller, il eût dû rester cent fois sur le carreau. « C’est une des plus belles chances de soldat qu’on puisse rencontrer, disait-on de lui au régiment. Pour tant de campagnes, pas une égratignure. » Le commandant Merlier avait, avec une poignée d’hommes, défendu une des dernières maisons de Reichshoffen et arrêté l’élan de la horde prussienne acharnée à la poursuite de l’armée vaincue.
Après Sedan, honteux et furieux de cette capitulation lâche, Merlier, après avoir trépigné dans la boue de cette île de la Meuse où les Allemands avaient parqué nos soldats prisonniers, s’était, après avoir refusé de donner sa parole qu’il ne combattrait point contre la Prusse, échappé, au risque d’être repris et fusillé, gagnant la Belgique.
De là, il était rentré à Paris par le dernier train venant du Nord, et il s’était rendu à l’hôtel du gouverneur de Paris.
Il ne demandait pas un grade plus élevé, mais il réclamait le droit de commander, à Paris comme à Wissembourg, comme à Wœrth, un bataillon.
Le commandant Merlier fut des plus intrépides en octobre, le jour de la sanglante tentative de sortie par la Malmaison et la Jonchère.
Le matin du 21 décembre, à l’attaque du Bourget, il fut frappé au milieu de la grande rue, pendant que son régiment se lançait bravement, poitrines découvertes, contre des murailles et des tirailleurs abrités.
Par un prodige d’énergie, le commandant, tombé de cheval, se tint encore debout tandis qu’on sonnait la retraite ; mais quand il voulut suivre ses fantassins, un éblouissement le prit, et, s’appuyant sur son sabre :
« A moi, dit-il, mes enfants, ne partez pas sans moi ! »
Deux de ses hommes le ramassèrent sous une pluie de balles et le transportèrent à la suiferie, à droite de la route du Bourget. Les fusiliers marins avaient enlevé, quelques heures auparavant, la suiferie comme à l’abordage, la carabine en bandoulière et la hache à la main. Elle était à nous. On laissa là le commandant durant de longues heures. Un officier de mobiles lui avait donné sa gourde, et, de temps à autre, Merlier humectait ses lèvres d’un peu de cognac, mais sans boire. Il savait que l’alcool, loin de réchauffer, débilite et glace.
Des ambulanciers, se disputant l’honneur de soigner un commandant, arrivèrent au bout de quelque temps. Ces hommes faisaient partie d’ambulances rivales. Le commandant leur dit :
« Finissez de vous chamailler, et enlevez-moi, puisque je ne suis plus bon à rien. »
On le coucha dans une voiture à côté d’un petit mobile de Paris, pâle, maigre, blessé à la poitrine, et qui, pendant la route, chantonnait encore, d’un ton narquois, comme pour braver le mal, ce refrain des moblots de 1870, à la fois gamin et attristé :
Et le commandant se disait qu’on pouvait faire quelque chose de ces insouciants et de ces tapageurs.
Merlier n’était pas depuis douze heures au Grand-Hôtel que le chirurgien lui dit que la blessure reçue nécessiterait l’amputation.
Merlier regarda fixement le docteur et dit :
« Il n’y a pas moyen de me sauver cette jambe ? J’ai un fils au collège ; il me faut l’élever, et je voudrais bien n’être pas mis à la retraite et aux impotents.
— C’est impossible, commandant.
— Notez que j’aimerais autant en finir que de me voir forcé de me traîner comme un escargot avec un pilon pour soutien.
— L’os est broyé, mon commandant, nous serions impuissants à vous sauver si vous vous refusiez à l’amputation.
— C’est bon. Charcutez. »
On lui proposa de l’endormir avec le chloroforme pendant l’amputation. Le commandant se mit à rire :
« Vous me prenez donc pour un poulet ? »
Il regarda, pâle, mordillant une cigarette de laquelle il tirait de temps à autre une bouffée, il regarda l’opération, cette jambe tuméfiée qui était la sienne, ces instruments posés sur le linge blanc, ces aiguilles, cette charpie disposée en bourdonnets, et ce chirurgien qui, plus ému que lui, préparait toutes ces choses. Durant l’opération il ne poussa pas même un soupir, mais quand il vit ce moignon saignant, cette cuisse d’où s’échappait un sang noir, et dont les chairs semblaient palpiter, prises d’un frémissement nerveux tandis qu’on les recousait en recouvrant l’os blanc et coupé avec le lambeau de chair qui dépassait, il hocha la tête et dit :
« Infirme, va ! »
Au moment où on le rapportait dans son lit, un officier prussien, pâle, élancé, un lorgnon à l’œil et le bras en écharpe, entrait dans la salle. On venait de le faire prisonnier, et il avait la main droite brisée.
Cette main était encore gantée.
De sa main gauche, l’Allemand tenait sa casquette, et, froidement, il demanda à ceux qui l’escortaient « où était son lit ».
Quelqu’un lui désigna un lit voisin de celui du commandant Merlier.
Celui-ci vit l’officier prussien jeter sa casquette sur le lit, puis tirer de sa poche un petit livre, de science sans doute, qui ne le quittait jamais, et qu’il jeta à côté de sa casquette, enfin s’asseoir et regarder à droite et à gauche pendant qu’on retirait son gant collé à la chair et qu’on faisait à sa main broyée un premier pansement.
Merlier entendit qu’on agitait tout bas, parmi les médecins, la question de savoir si on laisserait le Prussien si près du commandant.
« Pourquoi pas ? dit l’amputé en interrompant le colloque à voix basse ; deux blessés ne sont plus ennemis. »
A ces mots, l’officier prussien se retourna lentement du côté de Merlier, et, de cet accent légèrement gascon des Allemands qui parlent correctement le français :
« Vous vous trompez, monsieur, dit-il d’un petit ton impertinent, blessés ou bien portants, les Allemands et les Français ne peuvent jamais être amis ! »
Merlier haussa légèrement les épaules.
« Avec votre main en compote et ma cuisse rasée, dit-il, nous sommes propres et nous avons bien le temps de discuter ! Ne craignez rien, ce n’est pas l’amitié qui m’étouffera jamais pour les incendiaires de Bazeilles et les fusilleurs de femmes ! »
Le Prussien regarda Merlier et aperçut le képi de commandant suspendu à la tête du lit. Soit respect instinctif du grade (l’Allemand était lieutenant), soit dédain affecté, il ne répondit pas.
On offrit encore à Merlier de le transporter ailleurs, de donner un autre lit au Prussien. Le commandant ne voulut pas. Il promit de ne point s’emporter, d’être calme.
« Après tout, disait-il, tant que je pourrai manier un sabre ou tenir un revolver, je serai bon à quelque chose. »
Pendant deux jours, l’amputation parut avoir réussi, mais, au bout de ce temps, des symptômes alarmants parurent. Merlier sentait vaguement, à une faiblesse plus grande et aussi à la façon dont on lui parlait et dont on parlait de lui, qu’il était perdu.
Alors il se dit qu’il voulait au moins voir son fils et l’embrasser. Il n’avait pas voulu, jusqu’ici, qu’on dérangeât l’enfant, qu’on l’attristât déjà. Maintenant, il le fallait. Il demanda un capitaine de son régiment, Lavoine, un vrai soldat, esclave de la discipline et de l’amitié.
Lorsque le capitaine fut à son chevet, Merlier lui dit :
« Causons un moment. Mon cher, nous sommes battus, culbutés, perdus peut-être pour l’instant. Mais il faut savoir à quoi cela tient. Nous avons mérité nos défaites. Tous, depuis le premier jusqu’au dernier, nous avons abdiqué, nous nous sommes endormis sur nos lauriers, nous avons oublié que le patriotisme, l’esprit de dévouement, l’amour du drapeau sont des vertus pareilles à ces plantes qu’il faut arroser chaque jour. La vie nous était trop facile. Nous étions trop heureux, malgré nos plaintes. Je ne parle pas seulement de l’armée, de l’officier devenu faraud, du soldat devenu douillet, de tout ce monde à qui il fallait des londrès, du café et des sommiers doux, je parle aussi de la nation, du peuple, de la bourgeoisie, de l’ouvrier. Nulle nation n’était comme la nôtre envahie par le luxe au point d’en être amollie, et, avec cela, nous gardions le prestige de la grandeur conquise par nos aînés. Mais qu’était-ce que cette fausse grandeur et cette richesse d’apparence sans la liberté dans la loi et la virilité dans les mœurs ? Or, ces deux forces, mâles et fières, étaient depuis longtemps dans le coffre aux oublis. Confisquée, la liberté ! Ridicule, l’honnêteté ! Avec l’humeur gouailleuse que nous avions, nous devions fatalement arriver où nous sommes venus. Notre armée, nos soldats perdaient, peu à peu, comme le reste de notre France, l’âpre attachement au sacrifice. Et les chefs ! Vous les avez vus à l’œuvre. Des héros quelquefois, des lâches souvent, des incapables toujours. Qui s’est fait tuer dans cette campagne ? Comptez : les soldats, puis, et surtout, les bas officiers du sous-lieutenant au capitaine ; il y a, je parie, dix pour cent d’officiers parmi les morts. Les jeunes gens ne pouvaient supporter le poids d’une défaite. Débuter par Sedan, c’était dur. Alors, ils ont demandé une balle à l’ennemi, et beaucoup l’ont trouvée. Moi, j’ai fait antichambre avant de la rencontrer : de Frœschwiller au Bourget, cinq mois passés. Mais quoi ! mourir bien, c’est quelque chose, mais ce n’est pas tout, je dirais presque que ce n’est rien ; il faut vivre et grandir, c’est la loi du progrès, c’est la loi de tous, nations et individus.
« Or, pour durer, corrigeons-nous. Le jour où nous aurons acquis la conviction de notre faiblesse, de nos défauts, de notre mauvaise éducation, de notre vanité nationale et privée, ce jour-là nous serons bien près de nous relever. Je n’aurais peut-être pas vu ça, même en supposant que j’eusse survécu à l’amputation. Mais d’autres le verront, vous le verrez peut-être, vous, Lavoine ! Et dans tous les cas, il y aura quelqu’un après moi qui le verra. Écoutez, dit-il en tendant la main à son ami, il y a à Paris, au collège Chaptal, un garçon, — il a dix ans, — que je fais élever là. Ma femme étant morte jeune, le pauvre petit n’a jamais été bien dorloté. Mais c’est un brave enfant et je mettrais ma main au feu qu’il sera un homme. C’est à vous que je confie son éducation, le soin de lui apprendre que je ne boudais pas et le souci de lui conserver les quatre sous que je laisse après moi. Je puis compter sur vous, Lavoine ? »
Le capitaine serra la main de Merlier. Il avait des larmes dans les yeux. Le mourant souriait.
« Allons, dit-il, je vous remercie, mon ami. »
Le lendemain, le commandant, qui s’affaiblissait de plus en plus, demanda à voir son petit Georges. On amena le collégien, tout ému, dans ce dortoir de moribonds. C’était un enfant pâle et triste, l’air sérieux et bon.
Le commandant l’embrassa.
« Écoute, Georges, dit-il, j’ai attendu de te voir pour mourir. Oui, je vais m’en aller. C’est fini. Tu ne me reverras plus. Mais tu m’aimeras, mon petit Georges ? Je t’ai beaucoup et bien aimé, moi !
— Oh ! dit l’enfant, retenant ses sanglots, si bien et tant que personne ne m’aimera plus comme ça !
— Tu n’en sais rien, fit le commandant. Tiens (et il montrait le capitaine Lavoine), voilà quelqu’un qui me remplacera. Respecte-le et obéis à tout ce qu’il te dira ! »
Il prit la tête de l’enfant, à deux mains, et tout bas, en l’embrassant :
« Tu t’appelles Merlier, comme moi, ne l’oublie pas, et sois un homme ! »
L’enfant répondit d’une voix lente :
« Oui, un homme… comme toi !
— Mais plus heureux que moi, dit le commandant, car Dieu te garde de revoir ce que nous avons vu depuis Wissembourg ! »
Il posa ses deux mains à plat sur son lit, fit un effort violent pour se redresser un peu et, s’adressant d’une voix bizarre, stridente, à l’officier prussien qui, assis sur son lit, de sa main gauche feuilletait un livre, selon son habitude studieuse :
« Monsieur, dit-il, oui, vous, là-bas, lieutenant, donnez donc votre adresse à ce petit, qu’il aille vous rendre visite ! »
L’officier prussien se redressa, à la fois étonné et ironique, et son regard pâle rencontra les yeux du petit Georges attachés et rivés sur lui.
Il essaya de sourire et ne répondit pas.
Une sorte de transformation soudaine s’était faite sur le visage du commandant. Il ouvrait ses paupières, il tournait et retournait sa tête qui, brusquement, avec un soupir, retomba livide sur l’oreiller.
« Mort ! cria l’enfant en se jetant sur ce corps amputé, est-ce qu’il est mort ? »
Et il regarda le capitaine en criant.
Le commandant Merlier n’était pas mort. Mais il ne devait pas, comme on dit, passer la nuit. Le soir, — l’enfant était toujours à ses côtés, — il appela doucement : « Georges ! Georges ! »
Et regardant fixement son fils :
« Où es-tu ? » lui demanda-t-il.
Ses yeux ouverts ne voyaient plus.
« Je suis là, » dit l’enfant effrayé.
A cette voix, un sourire de joie mâle souleva la moustache grise de Merlier.
« Je te croyais parti, fit-il. Tu es là, tant mieux. »
Alors, il tendit à l’enfant sa large et vaillante main, où Georges mit sa petite main tremblante.
« Mon fils, dit le mourant d’une voix lente, fils de soldat, deviens soldat un jour. Et retiens mes paroles, retiens-les, car ce sont les dernières que tu entendras de moi. Sois le soldat de la patrie humiliée, qu’il faut venger, et de la France à refaire. Ne sers ni un homme, quel qu’il soit, ni un parti, ni une famille, mais une idée et une chose, la liberté et la République. Travaille, étudie, cherche, médite, apprends, et quand tu auras, toi et ceux de ton âge, rendu par la science, par le travail, par la force du droit, à la patrie sa grandeur, reviens alors frapper de ta petite main devenue forte sur la pierre où je vais dormir, et dis-moi trois mots, trois mots seuls, mais dis-les : La revanche est prise ! »
Le commandant Merlier prononça encore quelques mots que l’enfant seul entendit. Debout, l’officier prussien écoutait cette voix sépulcrale qui semblait déjà venir d’outre-tombe, pareille à une voix de prophète, il lui sembla, dans une hallucination qu’il attribua plus tard à la fièvre, à l’ombre de la nuit, aux fantômes produits par les veilleuses vacillantes, il lui sembla qu’il voyait cet enfant grandi, menaçant, l’épée au poing et marchant d’un air résolu, en agitant son glaive, vers un grand fleuve, un fleuve immense, le « vieux père Rhin », dont l’eau verte mugissait au loin… Illusion, sans doute !
L’enfant, à genoux, les lèvres sur la main froide de Merlier, pleurait immobile.
Quant au commandant, il était mort.
Pour nous, hommes d’une époque de transition, d’expiation et d’une génération sacrifiée, ce vaincu qui venait d’expirer représentait la France d’hier ; cet enfant qui priait, ce vengeur prêt à grandir, personnifiait la France de demain.
Paris, 4 septembre 1871.
Imp. d’Éditions, 9, rue Édouard-Jacques, Paris. — 1-30