
A. GUINNARD.
Title: Trois ans d'esclavage chez les Patagons
Author: A. Guinnard
Release date: November 4, 2025 [eBook #77179]
Language: French
Original publication: Paris: P. Brunet, 1864
Credits: Laurent Vogel, Pierre Lacaze and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Library of Congress)

Si le mot reconnaissance peut suffire aux cœurs bien nés pour exprimer toute leur profonde gratitude, permettez-moi, Madame, de vous dédier ces souvenirs de mes souffrances passées.
Daignez, Madame la Marquise, en agréant ce faible hommage, le considérer comme la preuve du meilleur et du plus respectueux souvenir qui se soit gravé en lettres ineffaçables dans la mémoire du pauvre voyageur éprouvé que vous avez bien voulu honorer de votre précieux et bienveillant intérêt.
A. G.
[Pg 1]
J'ai publié il y a quelques mois, dans le Tour du Monde, un sommaire de mes aventures en Patagonie. Le mauvais état de ma santé fut la seule cause qui m'empêcha d'en faire tout d'abord la relation complète; néanmoins je n'avais pas renoncé à la réalisation de ce projet qu'aujourd'hui seulement, il m'est permis de mettre à exécution.
Pressé par de nombreux encouragements, ainsi que par les bienveillants conseils dont ont bien voulu m'honorer les personnes les plus distinguées, soit par leur science, soit par le rang élevé qu'elles occupent, je me suis déterminé à dépeindre les horribles souffrances que j'ai endurées pendant ma longue captivité, et à décrire les mœurs et les coutumes des diverses peuplades dont j'ai été l'esclave.
[Pg 2]
Ce livre n'a aucune analogie avec les nombreuses et romanesques relations de voyages qui ornent nos bibliothèques; il est tout simplement l'œuvre d'un malheureux voyageur éprouvé qui n'aurait sans doute jamais osé écrire, sans cette circonstance.
Je n'ai pas, ainsi que tant d'autres, cherché à imiter; je me suis purement et simplement borné à faire la narration scrupuleuse de mes aventures et celle des mœurs et coutumes des Patagons, des Puelches, des Pampas et des Mamuelches avec lesquels, par un enchaînement de circonstances malheureuses, j'ai dû forcément vivre pendant plus de trois ans et demi. La connaissance de leur langage et une longue habitude de leur genre d'existence, m'ayant mis à même de les considérer sous leur véritable point de vue, on pourra prendre pour termes de comparaisons avec tels ou tels écrivains que je m'abstiens de nommer, les diverses observations que j'ai pu faire.
Je ne me suis pas adonné plus spécialement à la science qu'à la littérature, mais étant le seul qui, jusqu'à ce jour, ait pu pénétrer aussi avant dans l'intérieur de la Patagonie, je me trouve par cela même plus que tout autre dans la possibilité de renseigner exactement le lecteur sur ses nomades habitants. J'ai l'espoir que ce récit d'une des phases terribles de mon existence, offrira quelqu'intérêt, et que la jeunesse entreprenante et inexpérimentée,[Pg 3] qui chaque année s'expatrie, poussée, comme je le fus moi-même, autant par l'ambition que par l'attrait de l'inconnu, y trouvera une leçon salutaire.
Sur la carte qui figure à la fin de ce récit, j'ai tracé un itinéraire des parages où j'ai vécu pendant si longtemps. Ce travail ne pouvait être et n'est point d'une exactitude mathématique, car ayant été dans le plus complet état de dénument, je n'ai pas eu à ma disposition les instruments propres à déterminer les diverses positions des lieux que j'ai parcourus. Cependant, grâce à ma fidèle mémoire et au soin que j'ai toujours eu de remarquer les différentes directions que j'ai suivies avec les Indiens mes maîtres, grâce aussi à l'habitude que j'avais contractée d'évaluer les distances franchies avec les incomparables chevaux de ces régions lointaines, lesquels galopent facilement depuis l'aurore matinale jusqu'au tardif coucher du soleil, j'obtins pour moyenne, tout en faisant la part des difficultés du terrain, vingt-cinq lieues par jour. Toute approximative que puisse être cette mesure, elle n'est pas bien éloignée de la vérité; et l'on pourra s'en convaincre lorsqu'il sera permis de pénétrer dans l'intérieur de ces terres, ce qui ne saurait du reste manquer d'arriver un jour ou l'autre. Je dirai même plus, c'est que j'espère même qu'il sera possible de reconnaître les endroits que je désigne.
[Pg 4]
On se demandera sans doute pour quelle raison cette carte est écrite en langue inconnue? c'est, parce que, sachant le langage de ces nomades, j'ai acquis la certitude qu'on a jusqu'alors, non seulement tronqué les noms de leurs tribus, mais encore qu'on n'en connaît qu'un petit nombre. L'orthographe de ces noms diffère de celle généralement adoptée parce que je pense, que non seulement il est nécessaire de faire connaître ces diverses dénominations, mais qu'il est, pour le moins, aussi utile de leur conserver leur véritable prononciation indienne.
Ma délivrance ayant été aussi subite qu'imprévue, je n'ai pu rapporter aucun objet en souvenir de mon pénible voyage, de sorte que nombre de personnes ont peine à croire à la possibilité de mon retour après de semblables épreuves et que quelques-unes ont paru mettre en doute, les tristes et cruelles péripéties de mon exceptionnel voyage. Telle ne fut pas toutefois l'opinion de plusieurs membres de la science et particulièrement celle du bien regrettable M. Jomard, membre de l'Institut, qui parfaitement renseigné à cet égard, daigna me faire l'accueil le plus bienveillant. Cet homme illustre, qui jusque dans l'âge le plus avancé conserva toute la plénitude de ses facultés et dont le cœur resté jeune jusqu'au dernier instant, battit d'un si généreux enthousiasme pour les voyageurs éprouvés, m'honora de ses[Pg 5] bons conseils et m'engagea à faire une relation pour laquelle il voulut bien me promettre sa précieuse coopération. Mais hélas! je ne devais point être assez heureux pour jouir d'une semblable faveur, car bientôt après la mort en le surprenant au milieu de ses travaux, l'arrachait au monde scientifique dont il avait été un si digne représentant.
[Pg 7]
Comment il se fait que je pars pour Montévidéo, et dans quel but j'entreprends ce voyage.
Je n'avais encore que vingt-trois ans en 1855, fort peu d'expérience, quelque ambition, et je possédais par-dessus tout l'amour des voyages. Dès ma plus tendre enfance, je m'étais senti comme électrisé au récit de ceux de mon aïeul maternel Ulliac de Kvallant, officier de marine, qui, à vingt-deux ans, avait déjà fait trois fois le trajet des Grandes-Indes et que la fortune avait daigné favoriser d'un de ses plus gracieux sourires. Plus tard la lecture développa encore chez moi cette passion d'une[Pg 8] manière plus prononcée. J'avais tellement foi dans ma réussite au loin, que me voyant sans un avenir de mon goût, je pris subitement la fatale résolution de m'expatrier pour quelques années que je me proposais d'employer aussi fructueusement que possible, tant au profit de ma mémoire qu'à celui de ma bourse. Je songeais au bonheur que je ressentirais s'il m'était permis de mettre un terme aux inexorables coups du sort qui s'appesantissait sur ma famille, et cette seule idée suffisait à me consoler de la douloureuse séparation que je m'imposais.
Je ne fis part de ma résolution à mes parents que quelques jours seulement avant mon départ. Ce fut pour chacun d'eux une triste surprise: mais quelques efforts qu'ils fissent pour me détourner de cette idée je n'en persistai pas moins dans ma résolution. C'est ainsi qu'après avoir reçu la visite de mon bien-aimé frère, qui m'était venu faire ses adieux et en même temps ceux de tous mes parents, je m'embarquai au Havre, dans le courant du mois d'août 1855 pour Montévidéo.
[Pg 9]
Nous mîmes à la voile par un temps magnifique, mais qui changea tellement dès la nuit suivante, que nous restâmes durant tout une quinzaine, exposés au gré des flots furieux de la Manche malgré tous les efforts que l'on fit pour entrer dans l'Océan Atlantique. Enfin le seizième jour le vent changea, la mer redevint calme, nous commençâmes à faire bonne route.
Il semblait en nous éloignant que le temps devenait de plus en plus radieux; nous naviguâmes de la sorte jusqu'à l'embouchure de la Plata sans avoir l'ombre d'un danger à redouter. Cependant nous ne devions point arriver à destination sans que je fusse à même de me rendre compte de l'horrible situation où se trouvent parfois les navigateurs; car à notre entrée dans la Plata, nous essuyâmes la plus horrible tempête que l'on puisse imaginer; et nous fûmes jetés sur le banc anglais où peu s'en fallut que nous ne périssions corps et bien. Nous ne dûmes notre salut qu'à la grande solidité du navire, qui heureusement était neuf, et au grand sang-froid de notre habile capitaine, qui sut[Pg 10] ranimer l'énergie de ses hommes, un instant paralysés par la frayeur.
Une fois le danger passé, et le calme rétabli à bord, j'entendis de nouveau les hommes de l'équipage, se communiquer leurs projets de délassements et de plaisirs. Je ne cessais de les questionner sur Montévidéo, où tant d'autres venus avant moi avaient été assez heureux pour voir leurs désirs se réaliser; aux vœux de toutes sortes que je formais, vint encore se joindre la fébrile impatience de poser enfin le pied sur le sol américain que l'on me disait être si merveilleux.
Mais à peine arrivé je fus saisi d'une sorte de pressentiment de mauvais augure, quand d'épais tourbillons de fumée s'offrirent à ma vue, et que les premiers bruits qui frappèrent mon oreille, aux portes du Nouveau-Monde, furent ceux d'une vive fusillade et du canon entremêlés.
J'arrivais juste à temps, pour être le témoin d'une de ces insurrections si fréquentes dans les républiques de la Plata. Je me rendis à terre dès le lendemain matin, et malgré l'état de dissension du pays, je me sentis tout rempli[Pg 11] d'aise de faire connaissance avec un peuple si nouveau pour moi, dont le langage éveilla de suite toute ma sympathie.
Je parvins non sans peine à me faire admettre dans un hôtel de modeste apparence, le premier que je trouvai sous ma main, et dont la porte était fortement barricadée intérieurement. Quoique j'eusse fait une traversée des plus heureuses, j'éprouvais le plus grand besoin de prendre quelque repos; mais il me fut impossible de dormir, car les cris de la populace et une vive arquebusade m'en empêchèrent. Le jour suivant, je fus sur pied dès l'aurore, mû par un désir ardent de parcourir la ville, ce à quoi je me hasardai, malgré les exclamations charitablement hostiles de mon hôte, qui, tout d'abord, craignait de perdre un pensionnaire; mais, bientôt rassuré dès qu'il sut que je lui laissais tout mon bagage en dépôt, il fut le premier à m'expliquer le peu de danger qu'il y avait à parcourir les rues durant le jour. Il disait vrai, car malgré les cris et la fusillade, la plupart des habitants s'y montraient aussi pour renouveler leurs provisions. J'eus bientôt parcouru[Pg 12] les principales rues encombrées de soldats presque tous nègres, en haillons et les pieds nus, offrant l'aspect d'une véritable horde de brigands, et paraissant bien plus redouter les coups qu'ils sont sujets à recevoir, que soumis à une discipline quelconque, et auxquels, dans ces moments de troubles, on peut attribuer hardiment la plus grande partie des crimes et des désordres qui se commettent.
Dans ces pays lointains, c'est à peine si quelques hommes succombent dans un combat loyal; car les luttes sont purement dérisoires. Les nombreuses victimes que l'on y compte cependant, ont pour cause la vengeance que semble faciliter l'obscurité des rues non-éclairées pour la plupart. Il n'est pas rare, même en temps de paix, d'entendre la nuit, les gémissements de quelque malheureux attardé, ayant négligé de se faire reconduire par Los serènos ou veilleurs de nuit, qui moyennant une rétribution, illicite à vrai dire, se le transmettent de consigne en consigne jusqu'à son domicile. Ces veilleurs portent de la main gauche une lanterne, et tiennent une lance de[Pg 13] la droite; leur armement se complète par un sabre. Ils doivent veiller à la sécurité des habitants et crier par les rues les heures et les variations du temps. Mais le sentiment du devoir est, pour eux, une chose tellement secondaire qu'il leur arrive fréquemment de se refuser à accompagner los ciudadanos—les citoyens—qui ne leur offrent point quelqu'argent. Et beaucoup d'entre eux poussent à un tel point l'amour de la propriété, qu'ils n'hésitent nullement à dépouiller ceux qu'ils accompagnent gratuitement.
Après un mois et demi de séjour à Montévidéo, pendant lequel je visitai tous les environs, le mauvais état des affaires générales, me mettant dans l'impossibilité d'employer fructueusement mon temps, et de me rendre par terre, soit à l'Assomption soit au Brésil, je me déterminai à gagner Buenos-Ayres, voyage que j'effectuai en une nuit avec le bateau à vapeur. Je trouvai cette ville également morcelée par une guerre intestine dont la fin ne pouvait encore se prévoir, ce qui m'empêcha, comme à Montévidéo, de faire usage de mes lettres de recommandations.
[Pg 14]
La vie des étrangers y étant fort compromise, je me vis de nouveau dans la nécessité de m'éloigner. Je songeai tout d'abord à Rosario, rendez-vous général des Européens; mais ne voulant pas avoir à me reprocher plus tard, d'avoir agi trop précipitamment, j'employai tous les moyens imaginables afin de me créer quelques relations avec des commerçants. Toutes mes tentatives furent vaines, et j'en revins à ma première idée de gagner Rosario après avoir exploré toutes les provinces Argentines.
Nous étions déjà au mois de février 1856. L'hiver commençant au mois de mai, je n'avais donc plus que deux mois pour trouver où me fixer. Après avoir visité au sud la Confédération argentine, Carmen sur le Rio-Négro, le fort Argentino et la baie blanche, j'errai parmi tous les districts Buenos-Ayriens, fort clair-semés à partir du Rio Quéquène, cours d'eau rarement tracé, et plus rarement encore dénommé sur les cartes. Ayant ainsi vainement parcouru le Tendil, l'Azul, le Bragado-Grande, le Bragado-Chico, Mûlita et jusqu'aux moindres hameaux et fermes qui[Pg 15] relient entre elles ces diverses populations trop éloignées les unes des autres pour former une frontière proprement dite.
Reconnaissant qu'en vain, j'avais espéré rencontrer de meilleures chances sur ce sol moins battu des Européens, je voulus mettre mon premier projet à exécution. Dans ce but, je revins à Quéquène-Grande afin de me munir des provisions nécessaires à un semblable voyage, recevant sur ma route l'hospitalité des Estanceros ou fermiers spécialement adonnés à l'élève et au trafic du bétail.
De retour à Quéquène, j'y fis la rencontre d'un italien nommé Pédritto, comme moi fourvoyé dans ce district perdu. Nous ne tardâmes guère à lier connaissance; nous découvrîmes en causant, que nous étions arrivés l'un et l'autre en Amérique à quelques jours de distance seulement, animés tous deux du plus vif désir de nous créer une position sortable et que vu les nombreuses difficultés qui nous avaient assaillis en débarquant, nous avions formé le même projet de nous rendre à Rosario. Dès lors nous ne songeâmes plus qu'à nous réunir pour entreprendre[Pg 16] ce voyage, d'autant plus difficile, que nous ignorions encore l'un et l'autre le langage espagnol, et que nous n'étions point cavaliers; ces raisons en nous privant de guides et de chevaux, nous forcèrent à voyager pédestrement. Nous confondîmes nos ressources pécuniaires, et nous achetâmes des armes et des munitions en quantité suffisante pour un mois; nous emportions chacun cinq livres de poudre, quinze livres de plomb, quelques provisions de bouche et de menus objets de rechange.
Nous n'ignorions point que des dangers et des difficultés sans nombre, viendraient nous assaillir, mais nous étions décidés à tout braver, nous ne prîmes d'autre précaution que celle d'acheter une boussole cadran solaire, et de faire un plan de route, où chaque journée de parcours était indiquée; puis nous partîmes avec cette confiance que donne à la jeunesse beaucoup de résolution et d'espoir.
Ce fut le 18 mai 1856 que nous fîmes les premiers pas sur le sol désert de la Pampa, dans la direction Ouest que nous devions suivre jusqu'à la Sierra Ventana seulement.
[Pg 17]
Mais ainsi que je l'ai déjà dit, cette époque de l'année qui coïncide avec l'hiver de ces régions, nous faisait craindre plus de mauvais que de beau temps.
En effet le lendemain de notre départ une pluie torrentielle, qu'augmentait encore un vent violent et glacial soufflant des profondeurs de la Patagonie, nous assaillit cruellement. Ce mauvais temps dura quatre mortels jours, pendant lesquels nous fûmes contraints pour nous reposer de nous étendre sur la terre détrempée, sans qu'il nous fut possible de chasser ni de faire du feu. Nous eûmes la plus grande peine à garantir nos armes, dont dépendait notre existence durant le cours du long voyage que nous commencions seulement et qui déjà s'annonçait pénible et dangereux.
Ce fut seulement dans la soirée du quatrième jour que la pluie cessa, et que survint fort à propos, un rayon de soleil qui ranima notre ardeur et nous permit de faire sécher nos vêtements. Durant les quelques heures que nous nous reposâmes, il nous fut loisible d'admirer les immenses plaines vertes et touffues qui se déroulaient à nos yeux, jusqu'à[Pg 18] l'horizon sans bornes et dont le soleil couchant faisait ressortir toute la beauté.
Avant le retour de la nuit nous avions de nouveau endossé nos vêtements alors parfaitement secs, et nous pûmes profiter de la facilité que nous offrait la chasse aux viscachas (note A), pour renouveler nos provisions; car nous avions épuisé, ce jour même, le peu qui restait de notre pain trempé de pluie. Nos forces étant réparées et notre moral raffermi, nous consultâmes notre plan de route et notre boussole, puis nous prîmes la direction Sud-Est qu'elle nous indiquait, parfaitement convaincus que nous faisions bonne route pour le Rosaire. Notre marche devenait de plus en plus difficile, obstruée qu'elle était par une masse compacte de hautes herbes qui nous obligeant à lever les jambes outre mesure, nous fatiguaient extrêmement. De plus, la terre fort détrempée endommageait et élargissait tellement nos chaussures que nous étions fréquemment menacés de les perdre. C'est ce qui nous arriva en effet la nuit suivante et pendant la plus complète obscurité, alors que nous étions engagés dans un bas-fond[Pg 19] vaseux, dont nous eûmes toutes les peines du monde à nous tirer. Comme il nous avait été impossible de nous procurer des souliers de rechange avant notre départ de Quéquène-Grande, nous fûmes dès lors réduits à affronter pieds nus, un sol souvent hérissé de pierres anguleuses ou d'épines et l'intensité du froid qui augmentait de plus en plus.
Vers la matinée du cinquième jour, malgré les nombreuses difficultés qui semblaient devoir s'opposer à notre marche, nous n'avions pas moins parcouru déjà une assez grande distance, lorsque dans la soirée qui suivit, nous rencontrâmes une rivière étroite, profonde et encaissée dans un terrain à pic qu'il nous fallut songer à traverser. Descendre au bord de l'eau fut un véritable travail, vu l'élévation de la rive escarpée; le reste du jour fut employé à rechercher un passage pour gagner le côté opposé. Quand nous réussîmes à le trouver il était déjà fort tard, et nous étions tellement accablés de lassitude, que nous préférâmes en remettre la traversée au lendemain. Le côté où nous étions paraissait du reste nous promettre[Pg 20] un abri plus sûr contre le vent glacial qui ne cessait de souffler avec violence. Mais afin de nous garantir complètement de la température froide et humide, nous imaginâmes de creuser, avec nos couteaux, une grotte dans le flanc de la falaise escarpée. Ce travail achevé nous poussâmes la minutie jusqu'à brûler dans l'intérieur, un amas de broussailles pour en sécher les parois; et après avoir fait honneur à un excellent souper composé d'un gigot de gama, produit de notre chasse, nous nous installâmes dans notre réduit encore chaud, qui semblait promettre à nos corps brisés de fatigue une délicieuse nuit de repos.
Mais hélas! on ne ne songe jamais à tout! et dans notre grande préoccupation de bien-être, nous n'avions prêté aucune attention à la crue des eaux qui s'était déjà fait sentir dans le jour. A peine avions nous clos la paupière que notre grotte, soudainement envahie par l'eau tourbillonnante et rapide, faillit devenir notre tombeau. N'étant fort heureusement pas encore bien endormi, j'eus le temps d'éveiller mon compagnon et de saisir nos armes pour fuir.
[Pg 21]
Mais s'échapper n'était pas chose facile à deux hommes ainsi surpris par le danger au moment de leur premier sommeil. Il fallut nous frayer un chemin à travers les eaux déchaînées et les ténèbres, et nous servir de nos poignards comme d'échelons, pour franchir un escarpement élevé qui, battu à sa base par l'inondation, menaçait à chaque mouvement un peu brusque de notre part, de s'écrouler sur nous. Malgré tout notre sang-froid, il fallut que la providence nous vînt en aide, car malgré l'imminence du péril nous eûmes le bonheur d'atteindre sains et saufs le sommet de la falaise munis de toutes nos armes. Nous eûmes seulement à déplorer la perte d'une partie de nos munitions, de notre poudre et des menus objets de rechange que nous possédions, lesquels devinrent sous nos yeux, la proie du torrent impétueux. Cette nuit commencée sous de si tristes auspices s'acheva cependant dans un sommeil profond, et le lendemain à notre réveil, il ne nous serait resté du danger passé, qu'un souvenir fait plutôt pour nous encourager que pour nous abattre, si nous n'eussions pas été obligés[Pg 22] d'attendre pendant deux longs jours de privation absolue et de famine, que la baisse des eaux nous permît de franchir la rivière.
Le troisième jour seulement nous en tentâmes le passage après avoir fait un paquet de nos hardes et l'avoir placé sur notre tête. Nous nagions d'une main, tandis que de l'autre nous nous efforcions de tenir nos fusils et nos revolvers hors de l'eau, mais ce n'était pas chose facile à exécuter. Le courant d'une force extrême nous entraîna dans un tourbillon où nous faillîmes périr tous deux; et lorsque enfin nous abordâmes la rive opposée nous étions totalement à bout de forces. Nous fûmes cependant assez heureux pour pouvoir faire un bon feu de racines qui ranima nos membres engourdis, fit sécher nos vêtements et nos armes que nous visitâmes avec le plus grand soin.
Si d'un côté ces douloureuses épreuves augmentaient notre confiance en nos forces et notre mépris du danger, d'un autre elles ralentissaient notre marche. En outre, nos pieds déjà en sang nous faisaient souffrir d'autant plus cruellement que nous[Pg 23] n'avions plus aucun moyen de les garantir ni contre les aspérités du sol, ni contre l'influence de la gelée. Vers le milieu du jour pourtant, ayant eu l'heureuse chance de tuer une biche-gama (note B) que nous fîmes rôtir, un peu de gaîté se mêla à notre repas et le rendit délicieux. Du cuir de cet animal nous essayâmes de nous faire des sandales, mais cette chaussure délicate, en outre qu'elle ne pouvait suffire à nous garantir contre les pierres et les épines, se déchira promptement. Elle ne servit pas même à diminuer l'effet du froid intense sur nos plaies vives. Incapables désormais de doubler le pas, nous résolûmes afin de ne point prolonger notre voyage outre mesure de marcher jour et nuit en n'accordant aux besoins impérieux du sommeil et de la faim que le temps strictement nécessaire.
En dépit de ce calcul économique, nos provisions s'épuisèrent promptement sans qu'il nous fût possible de les remplacer, car nous étions entrés dans uno campo ou espace de pampas, au sud-ouest de quelques montagnes se ralliant à la sierra Ventana par les accidents d'un terrain d'une nature calcaire[Pg 24] et où de nos yeux avides, pauvres voyageurs affamés, nous n'aperçûmes aucune trace d'animaux ni de végétation.
Le jour tout entier s'écoula lentement sans nous laisser entrevoir le moindre atôme qui put apaiser notre faim et notre soif. Le soir venu, ne trouvant aucun abri, nous fûmes réduits à nous coucher sur le sol pierreux et blanc de givre. Aux atroces tortures que nous faisait éprouver la faim, succéda l'inertie la plus complète. Grâce à Dieu pourtant, l'ardente fièvre que nous éprouvions vint clore nos paupières d'un sommeil de plomb, pendant lequel nos membres endoloris et accablés de lassitude, puisèrent de nouvelles forces. A notre réveil, nous reprîmes notre triste pélerinage à travers des plaines d'une nature salpêtrée et couvertes de nombreux étangs salés, de peu de profondeur, dont les eaux infectes, au goût de cuivre, reposent sur un lit de vase noire et nauséabonde dans laquelle disparaissent parfois les animaux attirés par la soif et trompés par la limpidité de l'eau.
Sur ces lacs se tenaient des myriades de phoénicoptères au long cou, au corps étroit[Pg 25] sans queue, hauts sur pattes, et dont les ailes du ponceau le plus vif se détachaient avec éclat sur la blancheur irréprochable de toutes leurs autres plumes. A notre approche nous les vîmes s'envoler simultanément, leur cou tendu, leurs longues pattes jointes en arrière en forme de gouvernail, et fuir silencieusement avec la vitesse et la légèreté d'une flèche dont ils ont toute l'apparence. Je voulus en tirer quelques-uns, mais mon fusil ayant fait long feu je ne pus y réussir.
Bien que nos pieds fussent profondément écorchés et remplis d'épines, les angoisses de la faim nous avaient plongé dans un tel état de surexcitation et de délire qu'à peine nous faisions attention au douloureux contact de la terre gelée. Nos entrailles étaient atteintes de souffrances mille fois plus horribles que la mort.
Dans les courts instants de répit que nous laissa cette longue et cruelle journée nous mangeâmes de la terre et les premières racines qui nous tombèrent sous la main, sans pouvoir étancher notre soif, que semblait augmenter encore la vue continuelle des lacs[Pg 26] salins. Mon compagnon, quoique beaucoup plus fort que moi, en apparence, ayant plus tôt ressenti les tristes effets de la faim et ayant aussi eu recours beaucoup plus tôt aux moyens extrêmes dont je parle était en proie à de telles souffrances qu'il se roulait sur le sol en poussant des cris déchirants qui n'avaient plus rien d'humain. La nuit ne revint pas sans que je fusse à mon tour plongé dans ce triste état. Nous nous reprochions l'un et l'autre notre voyage, dans les termes les plus amers; ou bien, dans les courts intervalles où la souffrance semblait ne plus avoir de prise sur nous, nous étions comme plongés dans une douce béatitude voisine de l'extase et, les larmes aux yeux, nous nous demandions réciproquement pardon de nos brusqueries.
La nuit suivante ne ramena point le sommeil dans nos sens torturés; nous demeurâmes les yeux ouverts sur le désert, et la pensée fixée sur notre triste situation. Le lendemain, troisième jour de jeûne, l'épreuve fut plus terrible encore; nous avions tous deux le délire. Nous échangeâmes jusqu'à des menaces et des voies de fait. Notre marche[Pg 27] fut lente et souvent interrompue par la lassitude. Notre soif fut telle qu'à défaut d'eau, nous avalâmes jusqu'à des cailloux, et que nous eûmes recours pour l'apaiser à l'extrême et répugnant moyen dont parlent tant de relations de naufrages; ou bien encore, lorsque le terrain était humide de givre nous y promenions notre propre linge pour le tordre ensuite au dessus de notre bouche. Cédant de nouveau à la rage de la faim nous mangeâmes des racines que nous ne connaissions point, dont le goût était révoltant et qui nous indisposèrent gravement.
Le soir succéda à cet interminable jour, et le seul allégement que nous pûmes apporter à nos souffrances, fut un peu de feu alimenté par quelques rares épines glanées çà et là sur le sol de la pampa. Assis tous deux tristement autour de notre humble foyer, nous sentant trop faibles pour supporter plus longtemps l'horrible épreuve des angoisses de la faim, à bout de force et d'espérance nous sentîmes poindre l'un et l'autre en nous la terrible tentation de mettre fin à nos souffrances. Tout en préparant nos[Pg 28] armes à cet effet, nous vînmes à penser amèrement au foyer de la famille, aux êtres chéris que nous ne devions plus revoir. Ces souvenirs nous conduisirent à élever notre âme à Dieu. L'invocation de son nom faite à haute voix nous fit sentir combien était grande la lâcheté qui s'était emparée de nous; notre courage se retrempa dans la prière et au plus profond désespoir succéda l'assoupissement: cette nuit-là nous dormîmes. Notre réveil fut moins triste que les précédents: nous nous sentîmes plus dispos quoique extrêmement faibles. Nos jambes fatiguées, meurtries et écorchées ne nous permettaient plus d'avancer que bien lentement.
Nous marchions cependant, aiguillonnés par le besoin de nourriture, lorsque quelques heures plus tard nous eûmes enfin le bonheur de reconnaître un changement dans la nature du sol, désormais sablonneux et planté de génériums-argentinus, ou cortadéras, en indien, Koëny, hautes touffes d'herbes qui ne se trouvent généralement qu'aux abords des étangs et des cours d'eaux. Le terrain devenait moins dur à nos pieds sanglants, et un peu[Pg 29] plus loin nous atteignîmes effectivement un étang où nous pûmes étancher notre soif aride. C'était beaucoup déjà; mais à cette première trouvaille il nous en fallait ajouter une seconde, des aliments; car cette eau qui nous avait causé une si grande joie et nous avait tout d'abord soulagés devait rendre l'impression de la faim encore plus insupportable. En conséquence, nous nous mîmes en devoir d'inspecter les pourtours de l'étang en prenant chacun un côté opposé afin de nous rencontrer de temps à autre.
Une première exploration étant devenue infructueuse, je revenais anéanti, découragé, lorsqu'un bruit qui se fit entendre derrière moi au milieu des hautes herbes m'ayant fait tourner la tête, j'aperçus un puma qui épiait mes mouvements et semblait prêt à s'élancer de mon côté. Bien que cet animal n'ait rien dans sa taille et dans son allure du lion d'Afrique, dont les Américains lui ont donné le nom, ma première impression à sa vue, fut le saisissement; ma seconde fut de faire feu sur cet habitant du désert. Je l'atteignis en plein poitrail: rendu furieux par sa[Pg 30] blessure, il se traîna vers moi en allongeant ses griffes comme pour me saisir; heureusement les forces vinrent à lui manquer, il me fut facile de l'achever à l'aide de mon poignard. Au bruit de la détonation, mon compagnon accourut. Il fut agréablement surpris du produit de ma chasse, et m'en félicita sincèrement, en s'assurant préalablement que le sang dont j'avais les mains couvertes était autre que le mien.
Nous dépouillâmes en peu d'instants le puma, que nous éventrâmes ensuite, en ayant soin de le maintenir sur le dos pour ne point perdre le sang que nous bûmes à même le corps. Peu d'instants après, accroupis autour d'un feu de broussailles, sur lequel nous flambâmes plutôt que nous ne fîmes cuire les quartiers de puma, nous nous gorgeâmes avec voracité de cette chair tout à la fois grasse et coriace, mais qui nous parut délicieuse.
Après tant de fatigues et de privations, un repos d'un jour ou deux nous parut indispensable. L'endroit où nous étions était favorable; nous y fîmes halte. Grâce aux[Pg 31] nombreuses touffes de generium qui encadraient l'étang, il nous fut facile de nous abriter et de nous faire un lit plus moëlleux que la terre gelée. La fièvre nous quitta; mais l'état de nos pieds empirait; nous ne pouvions les poser à terre sans croire fouler du verre cassé. Après les avoir enveloppés de notre mieux avec les lambeaux de notre linge, nous jugeâmes prudent, néanmoins, de reprendre le cours de notre malheureux voyage en faisant usage de nos fusils comme de bâtons jusqu'à ce que nos plaies fussent suffisamment échauffées pour engourdir les douleurs qu'elles nous causaient. Nous prenions à tâche de nous distraire en formant des projets pour l'heureux jour où nous arriverions enfin à destination.
Nous cheminâmes de la sorte trois jours encore durant lesquels nous fûmes assez favorisés pour tuer un lièvre et un daim qui suffirent aux besoins démesurés de nos estomacs sur lesquels l'air vif du désert agissait d'une manière presque tyrannique. Loin de nous en désoler nous nous réjouissions au contraire extrêmement, car la nature du pays[Pg 32] semblait par sa riche apparence nous présager d'abondantes chasses.
Mais il était écrit là-haut que tous les malheurs nous accableraient tour à tour et que nous aurions vainement surmonté les terribles tourments de la fatigue et de la faim. Une plus cruelle épreuve encore nous attendait: notre boussole, objet si précieux pour nous, s'était avariée, dans les eaux du torrent où nous avions failli périr; depuis lors, par une étrange fatalité, le soleil ne s'était point montré et nous n'avions pu remédier à ce grave inconvénient. Fatigués d'esprit et de corps, nous nous étions jusque-là contentés d'un simple coup d'œil sur l'instrument dont l'aiguille s'était rouillée dans son encastrement. Mon plan de route n'existait plus depuis longtemps déjà, lorsqu'au retour du soleil nous nous aperçûmes que nous avions fait fausse route, en suivant la direction sud-ouest, point diamétralement opposé à celui vers lequel nous devions marcher. Au lieu de côtoyer le territoire Indien nous nous y étions complètement engagés depuis longtemps déjà.
Quoique cette certitude fût accablante, nous[Pg 33] tentâmes néanmoins de changer de direction, en nous rapprochant des montagnes que nous apercevions au loin devant nous, comptant y trouver plus de sécurité. Nous fûmes assez heureux pour repasser une rivière que nous avions déjà franchie la veille, et de les atteindre avant que le temps, déjà menaçant depuis le matin, ne devint mauvais. Nous pûmes nous y construire un petit réduit dans un des plis du terrain à l'aide des nombreuses pierres plates qui jonchaient le sol en cet endroit. Pendant quarante-huit heures, assiégés par une affreuse tourmente, nous restâmes blottis avec quelques provisions provenant de nos dernières chasses, sans pouvoir nous aventurer au-dehors; car la pluie et les rafales de vent faisaient ébouler de véritables avalanches de pierres de toutes les pentes rocheuses qui nous environnaient.
La tourmente apaisée, nous trouvâmes les matériaux d'un bon feu, dans les nombreuses épines—mamouël cêton—(note C), qui hérissaient le sol, et qui toutes portaient les traces d'un précédent incendie. Ce fut pour nous une preuve évidente du voisinage des[Pg 34] Indiens; car nous n'ignorions pas, qu'il est dans leur habitude d'incendier ainsi les champs qu'ils abandonnent.
Avant de suivre la nouvelle direction que nous adoptâmes, lorsque notre boussole fut réparée, il était urgent de renouveler nos provisions de route, et par conséquent de rentrer dans la plaine où sous nos yeux un grand nombre de gamas se prélassaient au soleil du matin. Plusieurs légèrement atteintes nous échappèrent grâce à la distance et à leur agilité; une seule, blessée de deux coups de feu, nous parut hors d'état de fuir bien loin; nous nous élançâmes à sa poursuite avec toute l'ardeur que nous permettait la faiblesse de nos jambes. Déjà sa course paraissait se ralentir visiblement, et l'espoir de nous en rendre maître grandissait d'autant plus, quand soudain, au détour d'une éminence, nous vîmes avec terreur un parti d'Indiens qui étaient évidemment sur la piste d'une proie quelconque: homme ou gibier.
Regagner l'antre de la montagne et notre hutte, était ce que nous avions de mieux à faire; nous fûmes assez heureux pour exécuter[Pg 35] ce mouvement de retraite sans être vus. Pendant deux longs jours, tapis dans notre cachette, appréhendant d'y être d'un moment à l'autre découverts et assaillis par un ennemi sauvage et sans pitié, nous ne tardâmes pas à y être assiégés par la faim. Obligés de tenter quand même une sortie le troisième jour, pour renouveler notre chasse, nous reprîmes confiance et espoir, en tirant à peu de distance une gama d'assez belle taille. Déjà je la chargeais sur mes épaules, lorsque les Indiens, fort nombreux cette fois, surgirent comme par enchantement de tous les replis du terrain et nous entourèrent en se livrant à une joie féroce, en poussant des cris gutturaux tout en brandissant leurs lances, leurs boleadoras, boules—en indien locayos—et leurs lazzos.
Rien ne me parut plus bizarrement triste, que l'aspect de ces êtres à demi nus, montés sur des chevaux ardents qu'ils manient avec une sauvage prestesse, ainsi que la couleur bistrée de leurs robustes corps, leur épaisse et inculte chevelure, tombant autour de leur figure et ne laissant entrevoir à chacun de[Pg 36] leurs brusques mouvements, qu'un ensemble de traits hideux, auxquels l'addition de couleurs vives donnait une expression de férocité infernale.
Le résultat d'une lutte entre nous et cette bande, ne pouvait être douteux, mais nous jugeant perdus sans espoir, et regardant la mort en face, nous nous serrâmes la main, en nous exhortant mutuellement à une bonne et commune défense, puis nous fîmes feu sur les plus avancés de nos ennemis. Un d'entre eux, plus grièvement blessé que quelques-uns de ses compagnons, tomba de cheval; mais sa chûte n'arrêta point les autres qui se ruèrent en masse sur nous, pendant que nous nous empressions de recharger nos armes. Mon camarade, accablé par le nombre et percé de coups, tomba pour ne plus se relever. De mon côté, vivement pressé, je venais d'avoir l'avant-bras gauche transpercé par une des lances que je m'efforçais de détourner de ma poitrine, quand une de ces boules de pierre, dont se servent également les gauchos, soit pour renverser les chevaux sauvages au plus fort de leur course, soit pour assommer[Pg 37] les bœufs, m'atteignit en pleine tête et me fit rouler inanimé sur le sol. Je reçus encore d'autres blessures et d'autres contusions, mais je n'en eus connaissance que quand je sortis de mon évanouissement et que je tentai de me relever, sans pouvoir y parvenir.
Les Indiens qui m'entouraient, voyant mes mouvements convulsifs, se disposaient à y mettre un terme en m'achevant, lorsque l'un d'eux, jugeant sans doute, qu'un homme aussi dur à mourir, ferait un utile esclave, s'opposa à leur dessein. Cet homme après m'avoir complètement dépouillé me lia les mains derrière le dos, puis me plaça sur un cheval aussi nu que moi-même et m'y assujettit étroitement par les jambes.
Alors commença pour moi un voyage vraiment terrible, et je renouvelai à un siècle et demi d'intervalle, à l'autre bout du monde, la course épouvantable de Mazeppa. La perte continuelle de mon sang me livra à une succession d'agonies et de faiblesses pendant lesquelles je me trouvai balloté de côté et d'autre comme un fardeau inerte, au galop d'un cheval sauvage[Pg 38] qu'aiguillonnaient ses barbares maîtres.
Combien dura ce supplice? je n'en sais rien; tout ce que je me rappelle, c'est qu'à la fin de chaque jour on me déposait à terre sans me délier les mains; les Indiens craignant sans doute de ma part, malgré le triste état où je me trouvais, quelque tentative de fuite ou de suicide. Pendant tout ce long voyage qui me parut une éternité, je ne mangeai quoi que ce fût, bien que les Indiens m'offrissent de temps en temps des racines.
Arrivé au camp de la horde, lieu de notre destination, on enleva enfin les liens étroits qui m'avaient torturé les pieds et les mains au point qu'ils ne pouvaient m'être d'aucun usage. Incapable de me mouvoir je restai étendu sur la terre, au milieu de mes ravisseurs. Hommes, femmes, enfants, tous me contemplaient avec une curiosité farouche, sans qu'un seul d'entre eux cherchât à me procurer le moindre soulagement. Au récit de ma résistance sans doute, que mon maître renouvelait à chacun, des gestes menaçants m'étaient adressés.
Le soir seulement de cette demi-journée de poignantes émotions, on me présenta de la nourriture,[Pg 39] à laquelle je ne me sentis pas encore la force de faire honneur; c'était de la viande crue de cheval, principal aliment de ces nomades. La nuit qui suivit, un monde de pensées m'accabla. Dans mon insomnie, j'avais toujours présente à la pensée, la mort de mon compagnon. Je formais mille conjectures sur la destinée que me réservaient les Indiens. La plus grande probabilité me paraissait être qu'ils me gardaient pour quelque solennel supplice: cependant il n'en fut rien.
Sans avoir la moindre pitié pour ma triste position dont ils se riaient, ils me laissèrent pendant plusieurs jours sans rien exiger de moi. Je pus ainsi donner quelque repos à mon corps brisé et voir l'état de mes nombreuses blessures s'améliorer un peu, sans autre secours que celui de la volonté divine et de l'application que je fis de certaines herbes.
Mais la nudité complète à laquelle j'étais condamné ne tarda point à me devenir des plus sensibles. A dormir sur la terre, sans abri, sans couverture, mon malaise augmenta; je gagnai des douleurs aiguës dans tous les membres. Puis à son tour vint la faim, une faim voisine[Pg 40] de la rage pendant laquelle je tentai vainement de me nourrir d'herbes et de racines. Il fallut me résigner à ne dévorer que de la chair sanglante, comme le font les Indiens eux-mêmes; mais chaque fois que j'achevais un si répugnant repas, le cœur me manquait. Ce ne fut qu'à la longue que je parvins à surmonter l'horreur que ce genre de vie m'inspirait.
Que de fois un morceau de chair crue à la main, et réduit à disputer chaque bouchée de cet effroyable mets aux chiens affamés qui m'entouraient en s'entre-battant, je me suis laissé aller à établir mentalement une comparaison entre cet ignoble repas et la table élégamment ornée, couverte de linge éblouissant, de riches porcelaines et de brillants cristaux, autour de laquelle nos heureux d'Europe, dégustant avec insouciance les mets les plus délicats et les vins les plus généreux, font assaut de saillies spirituelles et de doux propos.
[Pg 41]
En quelles mains j'étais tombé.
A l'époque où le soleil ne se couchait pas sur les domaines des monarques espagnols, les vastes plaines qui se déroulent entre Buenos-Ayres et le détroit de Magellan, d'un côté, et de l'autre, entre l'Atlantique et les Andes jusqu'à Mendoza, était censé faire partie de la vice-royauté de la Plata, bien que la plupart des Nomades qui les occupaient fussent alors, comme à présent, libres de tout joug. Aujourd'hui une ligne fluctueuse, déterminée, à l'est, par la Cordillière de Médanos et le Rio-Salado, au nord, par le Rio-Quinto, le Cerro Verde et le cours entier du Diamante qu'elle remonte jusqu'au sein des Andes, forme la limite commune de la Confédération[Pg 42] Argentine et de la Pampa indépendante; au sud du Rio Négro commence la Patagonie.
Plus de trois ans de séjour forcé dans ces régions m'ont mis à même d'y connaître trois groupes distincts de population, dont chacune correspond à une division naturelle du sol.
Dans la zône de l'est, qui va du Rio Salado au Rio Colorado, vivent les Pampéens proprement dits, divisés en sept tribus. La région boisée, qui s'étend entre le lac Bévédèro et le Courou-Lafquène—lac Noir,—ainsi que le long des cours d'eau qui remontent de ce dernier lac jusqu'au Rio Diamante, est la terre des Mamouelches—habitants des bois—qui forment huit tribus importantes que les Indiens désignent par les appellations de: Ranquel-tchets, Angneco-tchets, Catrulé-Mamouel-tchets, Quinié-Quinié-Ouitrou-tchets, Lonqueil-ouitrou-tchets, Renangne-Cochets, Epougnam-tchets et Motchitoué-tchets. Toutes ces tribus sont également subdivisées et chacune des subdivisions a son chef.
Enfin du Rio Colorado, jusqu'au midi du Rio Négro, fleuve étroit, mais profond, dont le cours est plus long que celui du Rhin ou[Pg 43] de la Loire, j'ai compté neuf tribus de Patagons, dont voici les noms:
Les Payou-tchets, les Puel-tchets, les Caillihé-tchets, les Tchéouel-tchets, les Cangnecaoué-tchets, les Tchao-tchets, les Ouili-tchets, les Dilma-tchets, et les Yacanah-tchets.
Chacun sait que l'Amérique méridionale est citée comme étant un pays, qui par la nature de son climat, de son sol et de ses productions, présente les plus grands contrastes; mais on ne connaît que fort peu l'intérieur des terres habitées par les Patagons.
Quelques détails ne seront donc point ici déplacés.
Depuis Quéquène, notre point de départ, jusqu'à la Sierra Ventana (note D), et très au loin dans la direction sud-ouest que nous avions tout d'abord été forcés de prendre, nous parcourûmes mon compagnon et moi un sol accidenté, le plus souvent d'une fertilité dont on n'a aucune idée. Il était entrecoupé çà et là par quelques torrents dont les eaux limpides, vont, tout en se jouant avec rapidité sur un fond rocheux et inégal, se perdre dans un lac profond dont le niveau ne varie jamais, quelle[Pg 44] que soit l'affluence des cours d'eau qui s'y jettent. Les Indiens nomment ce lac Gualichulafquéne—le lac du Diable.
Toute cette partie du désert américain jusqu'au Rio-Colorado est d'un aspect des plus flatteurs; exploitée par une nation active et intelligente, cette contrée serait la source de grandes richesses car le sol y est partout noir et vierge et rendrait facilement au centuple la semence qu'on y laisserait tomber. Sous une épaisse et haute couche d'herbe, à peine atteinte par le givre, il nous fut facile de voir celle de l'année précédente qui ne lui était vraiment inférieure que par sa couleur, et sous cette dernière, une troisième dont la décomposition n'était point encore achevée. Nous trouvâmes dans ces endroits une chasse abondante et variée, des gamas, des lamas, des Nandous—autruche de la Patagonie,—jusqu'à des perdrix de la plus grande espèce et quantité de petits étangs d'une eau douce et agréable.
Jusqu'au Colorado, dans toute la direction sud-ouest et sud, cette fertilité devient irrégulière et diminue sensiblement; elle n'apparaît[Pg 45] plus qu'entrecoupée par un sol tantôt sablonneux, tantôt rocheux; ou bien encore, le plus souvent, d'une nature salpêtrée et couvert d'étangs salés et infects, d'une limpidité trompeuse. Ces sortes d'étangs, fort communs dans les parages nord, et nord-ouest, sont dans le sud et le sud-ouest fort souvent entremêlés à d'autres lacs salés, généralement fort profonds, d'une grande étendue, dont le niveau varie fréquemment et dont les eaux sont chaudes en hiver et glaciales durant l'été. Ces lacs donnent un sel magnifique, dont les Indiens font d'amples provisions, tant pour leur consommation particulière que pour celle des autres tribus, qui le leur achètent à vil prix.
Les abords de ces lacs sont généralement durant l'hiver entièrement dépourvus de verdure; mais cependant leurs eaux bleues, profondément emprisonnées entre des rives d'une nature crayeuse, forment un contraste admirable, et l'on se croirait presque transporté par un beau temps au sein des mers glaciales.
Pendant l'été, au sommet des rives de ces[Pg 46] lacs, se montrent quantité de broussailles épaisses, que les Indiens nomment Tchilpet et dont les feuilles leur sont d'un très-grand secours pour soigner leurs bestiaux blessés; les parties inférieures sont abondamment pourvues d'une sorte de végétation composée de petites tiges rondes et minces, terminées en pointe, sans aucune feuille, dont la hauteur ne dépasse point vingt-cinq centimètres. Cette herbe est intérieurement conformée absolument comme le jonc commun, mais sa grosseur ne dépasse pas celle d'une aiguille à tricoter. Les chevaux et les bœufs en mangent quelquefois, mais sa dureté et son âcreté la leur rend indigeste. Enfin, à une assez grande distance, ce singulier assemblage de fertilité et de stérilité cesse brusquement; puis quelques montagnes de granit noir, de formes peu variées, à l'aspect sévère, infranchissables et isolées les unes des autres complètent le bizarre tableau de cette sauvage et silencieuse nature, tout à la fois superbe et triste.
Au-delà apparaissent les rives du Rio Colorado qui sont fort accidentées vers sa[Pg 47] source. Ce fleuve s'échappe d'un pays montagneux et entrecoupé de profondes vallées dans lesquelles circulent également d'autres cours d'eau, sortant aussi du sein des Andes. Les uns viennent de la direction ouest-nord-est, les autres de celle ouest-sud-est, mais ces divers affluents ne viennent grossir le Colorado que beaucoup plus au loin. A l'endroit où commence, pour ainsi dire, cette vaste plaine émaillée de verdure qui s'étend jusqu'à la côte orientale, et qu'habitent le plus généralement les Puelches échelonnés sur l'une et l'autre rive de ce fleuve, on rencontre une grande quantité de génériums-argentinus, dont la prodigieuse hauteur masque leur Roukahs—maisons—à la vue des voyageurs qui tombent ainsi entre leurs mains sans s'en douter; ces herbes touffues, servent aussi la plupart du temps, de repaires aux pumas et aux jaguars épiant la gama au passage.
Au Rio-Colorado que j'avais déjà franchi bien avant le commencement de ma douloureuse captivité se rattache un de mes plus saisissants souvenirs. Ce fut sur sa rive gauche[Pg 48] que nous éprouvâmes, mon compagnon et moi, la seule joie qu'il nous fût permis de goûter lors de notre triste et aventureuse pérégrination. Cette joie, qui fut alors si grande pour nous, pauvres voyageurs éprouvés par la misère, la maladie et les privations de toutes sortes, eut pour cause la rencontre de quelques navets monstrueux et exquis d'une aussi belle venue que s'ils eussent été cultivés par la main d'un habile jardinier. Tout en profitant de cette bonne fortune dont nous rendîmes grâces au ciel, nous nous perdîmes en conjectures sur la manière dont avait pu croître ce légume, dans des régions beaucoup plus froides que le Chili, et tellement éloignées de tout peuple, que sans nul doute, aucun être humain ne les avait encore parcourues. Mais ce ne fut que plus tard, lorsque je vécus au milieu des Indiens, qu'il me fut facile de me rendre compte de ce fait et que j'attribuai la venue de ce légume à quelque excursion faite par les sauvages, connaissant leur habitude d'emporter pêle-mêle tout ce qu'ils trouvent dans les fréquents pillages qu'ils effectuent[Pg 49] chez les Hispanos-Américains quitte à se débarrasser chemin faisant à leur retour des choses qui leur sont inutiles ou inconnues. Mais toutefois ce qui ne laissa pas que de me sembler aussi surprenant que cette trouvaille, ce fut l'impossibilité d'en retrouver jamais d'autres, car j'eus maintes fois depuis l'occasion de parcourir ces mêmes parages avec les Indiens mes maîtres.
Inutile de dire que la manière de vivre de tous les nomades dont j'ai à entretenir le lecteur, diffère en raison des nombreuses variétés de la nature du sol et du climat. Les uns résidant dans la portion septentrionale, la plus tempérée des Pampas, sont à demi-vêtus et se ressentent du voisinage des populations Argentines, avec lesquelles ils sont alternativement en paix ou en guerre. Les autres, Patagons, fort éloignés de ces premiers, n'ayant sous leurs yeux que le rivage de la mer ou l'immensité de leurs steppes stériles, vivent à l'état nomade dans toute sa rudesse primitive.
La tribu aux mains de laquelle le sort m'avait livré était celle des Poyuches qui errent[Pg 50] indifféremment sur l'une et l'autre rive du Rio-Négro depuis le voisinage de l'île Pacheco, jusqu'au pied des Cordillières, pays montagneux et entrecoupé de profondes vallées. Le genre de vie de ces Indiens, peu nombreux, offre moins d'intérêt que celui des Patagons Orientaux, et leur seul moyen d'existence est la chasse au guanaco—lama sauvage,—aux nandous et aux gamas. Bien que leurs parages ne soient pas, comme on l'a cru jusqu'alors, complètement arides, les Poyuches ne possèdent que peu de bestiaux. Leur petit nombre de chevaux et de bœufs provient des échanges qu'ils font avec les autres tribus au moyen de Makounes turquets ou manteaux en cuir de guanaco qui sont généralement fort appréciés par les indigènes et par les Hispanos-Américains; mais comme ce trafic n'a lieu que sur une très-petite échelle, ils sont fort pauvres et ne peuvent que rarement entreprendre les expéditions lointaines auxquelles se livrent constamment les Puelches et les Pampéens dont ils sont séparés par de grandes distances. Leur intelligence est bornée, leur caractère grave, leur physionomie[Pg 51] empreinte d'une férocité sauvage et d'une hardiesse incroyable. Ils sont peu communicatifs, mais doux et serviables entre eux. Ils sont très-courageux et très-entreprenants dans les rares combats auxquels ils ont occasion de prendre part, mais des plus barbares envers leurs ennemis, les chrétiens, qu'ils torturent et tuent sans pitié.
Leur type est approchant le même que celui des Patagons orientaux; mais ils sont généralement plus maigres et ont les pieds moins bien faits parce qu'ils marchent beaucoup. Ils ne s'occupent que de chasse; c'est tout à la fois pour eux, un divertissement et un moyen d'existence. Ils s'abritent sous des tentes construites avec des cuirs de chevaux, ou de veaux marins pêchés à la côte orientale pendant l'été.
Ces sortes d'habitations fort légères se composent de quelques piquets de bois tortueux plantés sur trois rangs: celui du milieu plus élevé que les autres auxquels il se rallie par des cordons de cuir qui en maintiennent l'écartement, forme avec eux une sorte de triangle semblable à celui d'une toiture. Des[Pg 52] peaux artistement cousues ensemble avec des fibres extraites de la viande, recouvrent ce frêle échaudage et le solidifient par leur tension opérée au moyen de petits piquets d'ossements qui en fixent les extrémités au sol. L'intérieur de ces maisons se divise en deux parties exactement semblables, subdivisées chacune en plusieurs petits compartiments dans lesquels chaque indien dépose ce qu'il a de plus précieux; le soir venu, quelques cuirs de guanacos étendus sur le sol servent de couche aux hommes et aux femmes qui s'y endorment pêle-mêle après s'être dépouillés de leurs mantes, leur unique vêtement, dont ils se servent alors comme de couvertures.
La superstition de ces sauvages surpasse l'imagination. Suivant eux le nord et le sud leur sont défavorables: le nord est le point où disparaissent à tout jamais les vivants visités à l'improviste par les mauvais esprits venant du sud. Ils ont une très-grande peur de la mort et prétendent que le seul moyen de veiller à la prolongation de leur existence, est de s'endormir la tête soit à l'est ou à l'ouest.
[Pg 53]
Quoique les régions habitées par ces Indiens soient pour la plupart du temps très-froides, ils vont se baigner le matin avant l'aube, quelle que soit la saison, sans distinction de sexe ni d'âge. Cet usage, auquel force fut de me soumettre, contribue puissamment je présume, à les sauvegarder de toutes maladies, et je suis convaincu que c'est grâce à ces bains fréquents qu'il m'a été possible de conserver la santé dont je jouis encore. A voir les Indiens, couverts de vermine, il serait difficile de croire à leurs fréquentes ablutions; mais en ma qualité de témoin oculaire, il m'appartient, je crois, de réhabiliter les Patagons Orientaux, jusqu'ici taxés de la plus grande malpropreté.
C'est généralement après leur bain matinal, que les Indiens possesseurs de quelques troupeaux, montent à cheval pour s'élancer sur leurs traces et les ramener dans le voisinage de leurs tentes. Cependant, lorsque le temps est mauvais, ils délaissent momentanément cette occupation, et restent confinés dans leur intérieur, pendant toute la durée du mauvais temps, sans même songer à manger. En[Pg 54] vérité, j'ai été fort souvent étonné de la facilité avec laquelle ces êtres gloutons et voraces se passaient ainsi d'aliments pendant tout une journée, tandis, que sans murmurer, ils restaient étendus sur le sol inondé de leurs Roukahs, retenus par la crainte; car le mauvais temps dans ces régions prête vraiment à la frayeur. C'est un mélange de pluie torrentielle, de foudroyants éclairs et d'éclats de tonnerre qui se répercutent à l'infini; à tout cela s'ajoute le terrible souffle du Pampéro, vent glacial qui venant des profondeurs de la Patagonie, souffle en mugissant, d'une seule haleine, souvent pendant plusieurs heures consécutives, brisant, culbutant tout, et déracinant même jusqu'aux moindres herbes qui se trouvent sur son passage.
La grande superstition qui caractérise les Indiens, semble encore augmenter toutes les fois que quelque phénomène s'opère sous leurs yeux; ils s'imaginent alors que ses causes se rattachent à leur conduite, et, selon la nature de ce phénomène, ils éprouvent tour à tour de la joie ou de la crainte. L'orage, par exemple, paralyse toutes leurs[Pg 55] facultés, et leur inspire une grande frayeur; il semblerait, qu'à leur insu, leurs consciences sont tourmentées et qu'elles redoutent la colère divine, car ils n'osent se hasarder à envisager le ciel courroucé. Ils se blottissent les uns contre les autres, la figure cachée entre les mains, sans tenter de retenir pour s'abriter, les quelques cuirs de leurs roukahs arrachés par le vent.
A peine s'était-il écoulé quelques mois depuis que de l'Européen il ne restait plus en moi que l'esprit et le cœur, lorsque je fus vendu à des Puelches visiteurs, qui donnèrent à mes maîtres, aussi avides que pauvres, un bœuf, un cheval et les portraits de ma famille. Ce marché leur parut tellement avantageux, que bien qu'il m'eût été impossible de leur rendre quelques services, ils ne se firent cependant pas faute de vanter aux nouveaux venus, mes bonnes qualités connues ou inconnues. Ceux-ci persuadés qu'ils avaient fait une excellente emplète, grimacèrent un sourire de satisfaction, qui m'eût certes fort diverti dans toute autre circonstance, car il ne servit qu'à les enlaidir encore.
[Pg 56]
Je ne songeai nullement à regretter les Poyuches, car le peu de temps que je venais de passer parmi eux suffisait pour m'en donner une triste opinion. Leurs femmes cependant sont assez actives et elles font preuve de beaucoup d'habileté dans la confection des vêtements. Quant aux hommes, en dehors de la chasse, où ils se montrent fort adroits et féroces, ils vivent dans la plus grande paresse. Ils sont d'une gourmandise et d'une voracité incroyables, et fort malpropres. Cependant ils déploient beaucoup de minutie dans l'art de parer leurs têtes hideuses; graissant leurs cheveux avec de la graisse de jument ou de cheval, s'épilant les sourcils et la barbe et s'enduisant la figure de couleurs volcaniques, ils possèdent, comme tous les Indiens, des petits sacs en cuir renfermant les couleurs nécessaires à leur tatouage et qu'ils portent toujours avec eux.
Les Poyuches donnent le nom de Melly-roumey-co—quatre petites rivières—à la source du Rio-Négro parce qu'il reçoit, dès sa sortie des Cordillières quatre affluents; mais plus au loin, lorsque ce fleuve reparaît[Pg 57] après avoir traversé le lac des Tigres—Naouals-Lafquen—ils l'appellent, ainsi que nous, Courou-roumey-co—Rivière-Noire—en raison de l'aspect que lui donne sa profondeur et son étroitesse. Son cours violent est fort tortueux tant qu'il parcourt un pays accidenté, mais souvent régulier dans la plaine où ses rives escarpées sont parfois fertiles. Les eaux rapides de ce fleuve n'offrent aux Indiens de passage sûr que vers leur source, cependant ils le traversent fréquemment en quelqu'endroit que ce soit en s'aidant de quelques bottes de jonc sur lesquelles ils se cramponnent à l'aide des mains et en nageant seulement des pieds.
On trouve encore campées sur les bords du Rio-Négro, plusieurs tribus au nombre desquelles figure celle des Puelches, une des plus importantes comme nombre ainsi que par ses rapports continuels avec toutes les autres peuplades, aussi bien avec celles de l'extrême pointe de Magellan qu'avec les Mamuelches situées dans le voisinage de Mendoza au nord-ouest de la Pampa.
C'est, on se le rappelle, entre les mains[Pg 58] d'Indiens de cette tribu que je fus remis par les Poyuches. Je demeurai pendant six mois consécutifs dans cette importante peuplade qu'il m'a été facile d'étudier et de comparer avec les autres tribus Patagones de la partie orientale dont les navigateurs ont tant parlé.
Dès mon installation chez eux je me flattais d'être mieux traité que par les Poyuches; mais à peine s'était-il écoulé quelques jours depuis que j'étais en leur possession que reconnaissant l'impossibilité où j'étais de leur rendre aucun service, vu mon ignorance à manier un cheval, ils me brutalisèrent cruellement en proférant des injures. C'est ainsi que les mots: Théoa-ouignecaë—chien de chrétien,—Ouésah-Ouignecaë,—mauvais chrétien,—furent les premiers dont je compris la signification. J'essayai plusieurs fois de me faire comprendre et je leur demandai quels motifs pouvaient les conduire à me traiter de la sorte; pour toute réponse ils me rudoyèrent avec plus de force. A la suite d'une de ces déceptions, mon chagrin fut tel que considérant comme à tout jamais perdues pour moi et la famille et la patrie,[Pg 59] je ne pus retenir quelques larmes amères. Les Indiens s'en aperçurent et leur fureur ne connut plus de bornes; ils me battirent tellement que je crus qu'ils allaient me donner la mort, ainsi qu'ils m'en menaçaient.
Depuis lors, je parvins à leur dissimuler ma douleur, sous un continuel et mensonger sourire, auquel ils se laissèrent prendre. Déployant toute la bonne volonté et toute l'adresse dont j'étais capable, je fis de rapides progrès dans l'art de l'équitation et dans la connaissance de leur langage sur lesquels je fondais des espérances de fuite. J'appris également vite à me servir du lazzo, de la boléadora—locayo—qui jouent un si grand rôle dans leur existence et qui sont vraiment indispensables à tous ceux qui se hasardent dans le désert américain.
Dans cette tribu je remarquai que la stature des hommes est assez haute, et qu'elle n'est pas inférieure à celle des Patagons. Les Puelches sont bien faits et bien proportionnés des membres; leur figure a une expression de fierté que ne dément point leur manière d'être. Ils sont nomades par goût et non par[Pg 60] nécessité, car la nature de leurs parages est généralement d'une grande fertilité. Leurs principales passions sont la chasse et l'ivrognerie. Leurs idées religieuses, ainsi que celles de toutes les autres tribus, se bornent à l'admission de deux dieux; celui du bien et celui du mal. Ils se livrent fréquemment au pillage des fermes dont ils tirent un grand nombre de chevaux et de bœufs; leur nourriture consiste en viande de cheval, d'autruches ou de gamas produit de leurs chasses; les morceaux de choix qu'ils mangent sont le foie, les poumons, et les rognons crus, saucés dans du sang chaud ou caillé préalablement salé, car ils connaissent l'usage de ce condiment. Les tentes des Puelches sont plus régulières et plus spacieuses que celles des Poyuches; souvent en y plongeant les yeux je reconnus des objets de ménage ou des vêtements conquis au prix du sang de quelque malheureux Hispano-américain. Les Indiens dont l'habitude était d'épier mes moindres mouvements n'étaient point sans saisir le coup d'œil, quelque rapide qu'il fût, que je lançais à la dérobée sur ces objets; ils les[Pg 61] faisaient alors cacher aussitôt dans la crainte que je n'eusse la pensée de me les approprier; puis ils me criaient: Ouakoune-tchipato émy ouésah-ouignecaé—sors bien vite dehors vilain chrétien: soit—Ouakoune-mouleta-émy véécah metène—que tu sois dehors, c'est assez bon pour toi.—En effet, il est à croire qu'ils pensaient sérieusement de la sorte, car qu'il fît chaud ou froid, je n'eus jamais d'autre lit que le sol quel qu'il fût, ni d'autre abri que le ciel.
A part leur barbare cruauté, ces Indiens, ne laissent pas que d'être industrieux et intelligents. Les harnachements de leurs chevaux composés d'une bride, d'une selle et d'étriers sont de curieux échantillons de leur industrie; ils sont pour la plupart tressés avec une si grande perfection qu'on serait vraiment peu disposé à croire que ce sont eux qui les font.
C'est simplement en se servant de très-mauvais couteaux qu'ils découpent avec une adresse et une dextérité sans égale, dans les cuirs tendres de jeunes chevaux préalablement pelés avec un bâton bizauté et[Pg 62] de la cendre, les fines lannières destinées à cette fabrication. Leurs selles sont fabriquées de roseaux recouverts de cuirs assouplis, quelques-unes sont en bois, semblables à deux dossiers de chaises assemblés à chaque extrémité par des triangles. Deux trous ménagés à l'avant servent à suspendre des étriers en bois de forme triangulaire, dont la plus grande ouverture permet tout au plus d'y engager trois doigts. Quelques cuirs placés entre la selle et le dos du cheval, le préservent de toutes blessures sous la pression exagérée de la sangle. Ces mêmes cuirs leur servent de lits en voyage. Leurs lazzos ont pour le moins une trentaine de pieds de longueur; ils sont découpés d'une seule pièce dans la peau d'un bœuf, ou bien tressés. Les Indiens ont coutume d'en fixer l'une des extrémités à la sangle de leur cheval et de l'enrouler dans leur main gauche en forme de cerceau. Le bout se termine en une boucle à nœud coulant à laquelle ils donnent plus ou moins d'ouverture, selon le genre et la grosseur de l'animal qu'ils veulent prendre. Ils le lancent de la main droite après l'avoir tourné plusieurs fois au-dessus[Pg 63] de leur tête avec cette même main en ayant soin de maintenir ouvert le nœud coulant. Comme on le voit ces lazzos sont bien différents de ce qu'on les a dits être et ne ressemblent nullement à ceux que l'on a vu employer par les Russes dans des guerres à tout jamais mémorables pour notre belle patrie. Les éperons dont se servent les sauvages sont composés de deux petits morceaux de bois armés chacun d'une pointe de métal ou d'ossement et fort longue qui tient lieu de molette. Fixés aux pieds, chacun de ces aiguillons se trouve l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Les Indiens, quoique exercés à s'en servir, ensanglantent généralement leurs montures qu'ils font courir très-vite.
Ces chevaux en général sont moyens et bien faits, assez faciles à dompter, et presque infatigables. J'ai vu souvent ces animaux qui ne le cèdent en rien aux plus beaux andalous, galoper pendant tout un jour et toute une nuit sans prendre autre chose que de l'eau. Les Indiens s'y prennent d'une manière fort brutale pour les dompter: une fois pris au lazzo, ils les renversent sur le sol pour[Pg 64] leur lier les pieds ensemble afin de pouvoir leur passer sans difficulté dans la bouche une courroie qu'ils attachent fortement au-dessous de la lèvre inférieure après leur avoir préalablement écorché les gencives et les lèvres afin de les rendre plus obéissants à la pression de ce mors trop souple. Ils leur apposent ensuite une selle et les font relever en les maintenant à deux, l'un par les naseaux et une oreille, l'autre à l'arrière-train par un nœud coulant qui leur retient les deux jambes; alors le dompteur armé d'une large lannière de cuir cru—trupouet,—sorte de cravache très-dure et fort pesante terminée par un morceau de bois destiné à frapper tantôt les flancs tantôt la tête de son cheval, s'élance lestement sur l'animal. Au signal donné, les aides rendent, avec un parfait ensemble de mouvement, la liberté au coursier qui part le plus souvent comme un trait, non sans avoir lancé bon nombre de ruades et s'être effacé de côté et d'autre. Quelques-uns résistent aux prodigieux efforts que font leurs cavaliers pour leur faire tourner la tête à droite ou à gauche et se roulent avec eux; mais en général, quelle que[Pg 65] soit leur fougueuse résistance au premier abord, en deux ou trois jours, ils sont suffisamment doux pour être montés à poil.
C'est à deux ans et demi environ que les Indiens les domptent de la sorte et qu'ils les soumettent à une épreuve, afin d'apprécier leur vitesse; ils leur font franchir, tout d'une haleine un espace déterminé; ceux qui n'atteignent point le but avec facilité sont jugés impropres au service et impitoyablement condamnés à être mangés.
Les Puelches habitent les parages situés entre le Rio-Négro et le Rio-Colorado que rarement ils franchissent. Le côté oriental se compose de plaines fertiles où se trouvent nombre d'étangs poissonneux dont les eaux sont excellentes. Le côté occidental n'est pas moins fertile; il est très-montagneux et arrosé par de nombreux torrents qui grossissent le Colorado. Il s'y trouve également une grande quantité d'étangs salins et infects comme dans tous les parages stériles de l'Amérique méridionale et quelques algarobes tortueux et de chétive apparence.
Les Puelches ayant des rapports continuels[Pg 66] avec les Indiens de toutes les tribus sans exception sont les plus aptes à donner des renseignements concernant l'immense territoire occupé par tous leurs nomades compagnons, dispersés depuis le détroit de Magellan jusqu'à Mendoza; car il leur arrive aussi très-fréquemment d'aller jusque dans ce pays. Ils sont généralement très-visiteurs, ce qui donne toujours un surcroît d'occupations aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de donner à manger à tous. Les arrivants sont salués par les femmes et les enfants. Le chef de la famille ne remplit cette civilité que lorsqu'ils se sont assis et qu'ils ont bu quelques gorgées d'eau. Le salut échangé de part et d'autre, c'est au milieu du plus profond silence de la femme et des enfants que les hôtes, exposent chacun à leur tour, le but de leur visite dans un long discours qui n'est exempt ni de courtoisie, ni même d'une certaine poésie dont on les croirait incapables. Leur langage est guttural et chantonné. Le maître du logis après avoir écouté religieusement tous ses hôtes leur répond fort longuement aussi, puis il termine[Pg 67] en leur adressant ses remercîments d'avoir bien voulu le visiter; et sans ajouter un mot de plus, il les laisse faire honneur au repas que les femmes leur servent avec empressement. Ce repas se compose généralement de rognons et de poumons crus coupés par morceaux et mis dans de petites sibilles de bois pleines de sang caillé mêlé de sel. Quand les convives se sont bien repus la conversation s'engage de nouveau sur un ton familier, fort différent du premier, car ils ne chantonnent plus. C'est le moment où les enfants envieux de faire aussi quelques amitiés aux hôtes de leur père, viennent à l'envi se grouper étroitement autour d'eux. Ceux-ci en forme de caresses s'emparent de leurs jeunes têtes, y cherchent les nombreux insectes qui y fourmillent, pour les manger; comme remercîment la réciprocité est de rigueur.
Fort rarement les hommes adressent la parole aux femmes que l'usage leur défend même de regarder en face, à moins qu'elles ne soient leurs parentes, leurs belles-mères excepté.
[Pg 68]
Tout visiteur reçoit une ample hospitalité et peut co-habiter chez ses hôtes un temps illimité pendant la durée duquel il sera toujours l'objet des plus grandes prévenances. Lorsque l'heure du repos approche le plus grand silence se fait de tous côtés, les hôtes s'absentent quelques minutes pendant lesquelles le maître du logis leur fait préparer à la hâte un coucher composé de tout ce qu'il a de plus précieux en cuirs dans son Roukah.
Une fois le soleil couché, le voyageur, si voisin qu'il soit de sa destination, ne peut, sans enfreindre les règles de la bienséance, se présenter devant une tente; aussi attend-il pour cela le retour de l'aurore. Seuls, les porteurs d'ordres des caciques sont en dehors de cette étiquette.
Les femmes se reçoivent entre elles: elles se font mille agaceries, alors même qu'elles seraient ennemies jurées. Leur conversation a lieu presqu'à voix basse, tout en s'épilant les sourcils ou en se peignant réciproquement la figure. Le cérémonial ne s'oppose nullement à ce qu'elles accompagnent la maîtresse[Pg 69] du logis quand ses occupations l'appellent au dehors; aussi les voit-on presque toujours allant et venant. Les hommes ne jouissent point de cette prérogative, car à moins qu'il ne s'agisse de chasse, tels on les voit s'asseoir à leur arrivée, tels ils sont obligés de rester jusqu'à leur départ.
Les visiteurs ne manquaient jamais d'entretenir leur hôte à mon sujet ce qui le flattait extrêmement. Dans ces moments-là il feignait même d'avoir pour moi quelque amitié, il me faisait manger avec lui, mais en homme qui sait son métier j'avais l'air d'être la dupe de toutes ses cajoleries. Je vis ainsi tour à tour les Indiens de toutes les tribus Patagones. J'étais pour eux une rare curiosité; j'en jugeai par la manière dont ils me contemplaient, et par la surprise de trouver en moi—laftra-ouignecaë,—petit chrétien, des facultés semblables aux leurs.
Je vis ensuite les Tchéouelches, race de nomades des plus arriérés et des plus pauvres dont les mœurs sont des plus primitives. Leur langage, ainsi que leur personne, a quelque chose de féroce; ils articulent des sons excessivement[Pg 70] gutturaux qu'au premier abord on croirait être une langue différente de celle des autres Patagons; cependant en prêtant bien l'oreille, il me fut facile de les comprendre. La blancheur de mon corps parut les préoccuper beaucoup, ainsi que la couleur de mes cheveux déjà très-grands et rougis par l'action du soleil. Ils témoignèrent le désir de m'entendre prononcer quelques mots de français qui furent un sujet d'hilarité générale.
Ces Indiens sont d'une stature un peu inférieure à celle des Patagons orientaux et des Puelches; ils ne sont pas moins remarquables par la régularité de leurs formes. Ils ont les épaules fort larges et bien effacées, la poitrine très-bombée, les bras et les jambes de moyenne grosseur, les pieds fort larges et plats. Leur tête est grosse, leur front découvert et proéminant: les pommettes sont fort saillantes, la figure plate, le menton un peu avançant, la bouche grande, généralement entr'ouverte, les yeux sont noirs, fort grands et horizontaux, ils ont une expression de féroce égarement. Un nez souvent[Pg 71] recourbé, long et mince, aux narines bridées, leur donne un faux air d'oiseaux de proie. Leurs lèvres sont un peu épaisses; leurs oreilles grandes et allongées par de grossiers ornements de leur fabrication qui leur tombent sur les épaules. Ils portent généralement leur chevelure enroulée sur le sommet de la tête, de même que les indigènes du Paraguay. Ils se servent d'arcs et de flèches, et manient fort bien la fronde,—oui-trou-courah-ouëy—le lazzo, et la boleadora—locayo—sorte de jeux de boules au nombre de trois, fixées à des lannières de cuir d'égale longueur, et généralement en pierre dure ou en une sorte de granit fort commun dans leurs parages. Ils s'en servent fort habilement, et atteignent à une grande distance les lamas sauvages—guanacos—dont ils font la chasse à pied.
Aucun de ces Indiens ne possède de chevaux. Les plus jeunes s'élancent à la poursuite du gibier et se bornent à le tuer, laissant aux femmes et aux vieillards le soin de le dépouiller et de le transporter sur leurs épaules tandis qu'ils poursuivent leur chasse. Ils ont aussi pour coutume de[Pg 72] s'épiler toutes les parties du corps; mais peu préoccupés d'idées de coquetterie, ils se contentent de se peindre grossièrement le visage. Ils sont des plus agiles à la course et presqu'infatigables. J'en ai vu courir fort vite pendant plusieurs heures de suite sans en éprouver aucune fatigue.
Ces Indiens sont fort sobres comparativement à la majorité des autres Patagons et malgré le grand exercice qu'ils se donnent dans leurs chasses. Il est à peu près inutile d'ajouter, ainsi qu'on le pense bien, que leurs repas se composent spécialement de viande crue, de racines ou bien encore de veau marin, car ils se livrent également à des pêches de plusieurs jours durant l'été. Leurs parages sont stériles et s'étendent jusqu'à plus de deux cents lieues de la limite sud du Rio-Negro. L'hiver ils se rapprochent sensiblement des contreforts des Andes qui leur offrent un abri plus sûr contre les intempéries et ils y trouvent quantité d'arbrisseaux, éléments d'un bon feu.
Leurs vêtements se composent d'une sorte de chemise à manches courtes, faite de six[Pg 73] cuirs de veaux marins superposés et doublés d'une peau de lama parfaitement assouplie dont ils juxtaposent la chaude fourrure sur leur corps. Ce costume est généralement apprêté sur les reins et enjolivé extérieurement de dessins bizarres qui en rendent l'aspect grotesque. Dans les combats ces vêtements leur tiennent lieu de cuirasses; ils y ajoutent une sorte de coiffure plate et ronde, formée de deux cuirs épais cousus ensemble et solidement fixée au-dessous du menton. La liberté, dont les Indiens jouissent entre eux est excessive; on peut en juger: dans les autres tribus, si un visiteur a faim, il se garde bien de le donner à penser à ses hôtes qui, du reste, ne se font pas faute de lui offrir plus d'aliments qu'il n'en prendra, tandis que le Tchéouelche, s'il se sent besoin, n'est retenu par aucune étiquette. Il entre dans le premier Roukah venu, en ranime le foyer et s'empare sans mot dire d'un morceau de viande qu'il fait rôtir ou mange cru selon son bon plaisir; après quoi il s'en va aussi muet qu'il est entré, sans s'inquiéter de la présence du chef de la case, qui de son[Pg 74] côté le regarde faire avec autant d'indifférence que s'il était habitué à le voir.
Les Tchéouelches paraissent être encore moins accessibles à la souffrance que les autres nomades. Ils pansent eux-mêmes avec le plus grand sang-froid leurs blessures, même les plus graves, sans jamais faire entendre aucune plainte. Les femmes s'occupent des soins du ménage et aident les hommes dans la fabrication des makounes turquets—manteaux de cuir—et des kiliankous—tapis—différant seulement les uns des autres par la grandeur. Ces objets sont faits de cuirs de guanacos et de mouffettes sanu que les femmes enduisent de foie mâché et qu'elles tannent ensuite à la main en les frottant vigoureusement. Cette opération terminée, elles assemblent artistement ces divers cuirs en supprimant toutes leurs parties défectueuses et les cousent très-finement avec des fibres extraites de la viande. Ce travail dure quelquefois plusieurs mois entiers; c'est toute une œuvre de patience. Quand il est terminé, les Indiens détirent les peaux en tous sens et aplatissent les coutures au moyen d'une[Pg 75] pierre graveleuse qui leur sert en même temps à frotter toute la pièce afin de l'assouplir complètement; ils procèdent ensuite à l'ornementation du cuir sur lequel ils tracent à l'aide de rouge et de noir des dessins bizarres et capricieux dont ils couvrent toutes les coutures. Ces manteaux, généralement recherchés par les Indiens Puelches, Patagons et Pampas, ne sont pas moins fort appréciés des Espagnols. Les Tchéouelches, les Poyuches et les Patagons qui passent la majeure partie de l'année revêtus de ces sortes de vêtements peuvent s'exposer aux froids les plus intenses sans en ressentir les atteintes.
Ainsi que l'avaient déjà fait les Poyuches, les Puelches me vendirent par esprit de spéculation à des Patagons orientaux qui se promirent bien d'agir de la même façon à mon égard. Cette succession de nouveaux maîtres était loin de m'être agréable, et le plus souvent, je perdais au change. Cependant cette fois j'éprouvai moins de répugnance, mes nouveaux maîtres me paraissaient avoir quelque chose de plus humain dans leur allure. Ils me semblèrent d'une stature approchant[Pg 76] de six pieds; leur type me parut peu différent de celui des Puelches. Je trouvai leur buste peut-être un peu plus long, comparativement à leur taille; et certainement que vus à cheval, on peut aisément les croire plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Leurs membres sont bien proportionnés; leur tête est grosse, presque carrée, leur crâne aplati, leur front fort bombé, et leur menton avançant, ce qui avec leur nez long et mince leur fait un singulier profil. Ils ont les pommettes fort saillantes, les yeux un peu horizontaux; mais la manière dont ils s'épilent les sourcils et dont ils se peignent en noir l'orifice des paupières inférieures n'a pas peu contribué à faire croire qu'ils les ont tout-à-fait horizontaux.
Ils ont la bouche grande, les lèvres un peu grosses, mais moins que celles des Tchéouelches, leurs dents sont petites, bien rangées, et d'une blancheur éclatante que la couleur brune de leur peau fait encore ressortir. Ils ont les épaules fort larges et bien effacées, la poitrine régulière, les seins très-accentués. Leurs mains et leurs pieds sont petits, comparativement[Pg 77] à leur taille, et garnis d'ongles gracieusement enracinés qu'ils portent fort longs.
J'ai continuellement été à même de juger de la force des Patagons, et, témoin de leurs nombreux exercices, je puis affirmer, sans être taxé d'exagération, qu'elle surpasse de beaucoup celle des Européens. J'ai vu ces hommes saisir habilement au lazzo un cheval indompté, l'arrêter ainsi subitement dans sa course effrénée, résister seuls au choc terrible de l'animal en s'arc-boutant et le maintenir ainsi jusqu'au moment où par suite de strangulation il roulait sur le sol; mais je n'ai jamais remarqué dans ces sortes d'exercices que leurs muscles fussent plus apparents que dans leur état normal. On ne saurait, il me semble, mettre sur le compte de l'adresse un pareil résultat. D'ailleurs, l'organisation physique des Indiens est de beaucoup supérieure à celle des hommes civilisés; ils supportent avec la plus grande facilité les fatigues et les privations prolongées, pendant des voyages de deux et trois mois qu'ils font presque sans se reposer, galopant jour et[Pg 78] nuit. Lorsqu'ils vont piller à quatre et cinq cents lieues, en plus des vingt à trente chevaux de choix qu'ils emmènent chacun, ils ne se munissent guère que de lazzos, de lances et de boléadoras dont ils se servent, tant pour se procurer les moyens d'existence que pour combattre. A peine si quelques-uns, les plus gourmands seulement, mettent entre les cuirs qui leur tiennent lieu de selles un peu d'angnime-hilo—viande découpée en feuilles minces, salée et séchée au soleil—qu'ils mangent avec de la yéouine—mélange de graisse de cheval et de bœuf.—Les plus pauvres emportent seulement un chassi-cofquet, sorte de pain de sel cuit dans la cendre de fiente après avoir été moulu et pétri avec des herbes odoriférantes, et qu'ils se passent de temps à autre pour le lécher seulement, lorsque la faim ou la soif se font trop sentir.
Le retour de ces expéditions n'a point lieu en masse, ainsi que le départ. Leur intérêt les oblige à se distancer de beaucoup les uns des autres afin de pouvoir conserver le même nombre d'animaux; car il arriverait fréquemment[Pg 79] que quelques-uns échapperaient à leur surveillance et iraient grossir le butin de leurs compagnons qui se refuseraient à les leur rendre. Il n'y a que les paresseux ou ceux qui succombent sous le poids de la fatigue qui soient exposés à perdre leur butin; mais ces cas sont rares, car leur activité et leur avarice sont telles, que même longtemps après leur retour au sein de leurs foyers respectifs, ils surveillent encore assidûment de jour et de nuit leurs troupeaux.—Sont exempts de ce surcroît de fatigue, ceux-là seulement qui ont de la famille, ou qui consentent à payer généreusement un de leurs voisins pour exercer cette surveillance. Les femmes même entreprennent ce genre d'occupation et elles obtiennent généralement une rétribution beaucoup plus forte que les hommes.
Lorsqu'un animal vient à se perdre les Indiens font d'actives recherches dans toutes les directions, et ils sont si habiles que presque toujours ils le ramènent. Quelle que soit la nature du terrain, couvert d'une épaisse couche de verdure ou de la stérilité la plus complète, fût-il même fangeux, ils reconnaissent[Pg 80] les traces de son passage au premier coup-d'œil aussi bien que dans un grand nombre d'empreintes d'animaux de même espèce. Ils sont doués d'une telle sagacité, que dans leurs explorations ils reconnaissent le passage des troupeaux des chrétiens sur les traces desquels ils s'élancent aussitôt.
Les tribus Patagones les plus importantes sont au nombre de neuf. Elles ont à leur tête des caciques de premier ordre, dont le pouvoir s'étend jusqu'aux moindres sous-tribus dont les noms varient à l'infini. Parmi ces dernières qui sont échelonnées sur le Rio-Négro je puis en citer plusieurs qui par leurs rapports avec les Hispanos-Américains sont devenues célèbres; elles sont, à vrai dire, fort affaiblies de nos jours et ne sauraient présenter d'autre intérêt que celui de leur passé.
La première est celle des Toluchets qui parcourt l'espace compris entre le Rio-Négro (limite sud), le lac Rozas et le territoire des Poyuches, mes premiers maîtres, jusqu'à une distance de cent lieues pour le moins, dans la direction sud-ouest où commence celle des Tchétchéhets avec laquelle elle fut alliée pendant[Pg 81] fort longtemps. Ces deux tribus eurent des relations avec les premiers Espagnols qui fondèrent le village de Carmen ou de Patagones, dont elles firent la prospérité pendant un certain temps. Mais bientôt Carmen, peuplé de gauchos expatriés pour crimes qui se lassèrent de la vie paisible à laquelle on les avait astreints, vit tout-à-coup son importance diminuer. Désireux de reprendre le cours de leur vie aventureuse, les Gauchos abandonnèrent la colonie pour aller chez les Indiens même échanger leurs produits contre des bestiaux. Il en résulta que ces derniers bientôt dépourvus de leur bétail et voulant s'en procurer d'autre, firent, dans les provinces de Buenos-Ayres de fréquentes razzias qui leur attirèrent de sanglantes répressions dont ils se vengèrent sur la colonie du Carmen qu'ils dévastèrent et détruisirent à plusieurs reprises. On vit donc ainsi, tour à tour, ce port s'enrichir aux dépens des estanceros ou fermiers des provinces argentines et ruiné par les Indiens CalliHétchets ou non parleurs, ainsi nommés par les autres Indiens, à cause du caractère fantasque et silencieux qu'ils ont[Pg 82] pris depuis leur décadence, qui date de la mort de plusieurs chefs considérés par eux comme invincibles.
Ces Indiens ont l'air dur et féroce, quelquefois soucieux. Ils ne parlent qu'avec nonchalance, et par monosyllabes; leur seule occupation est la chasse à laquelle ils se livrent d'un bout de l'année à l'autre. Ils paraissent peu intelligents, et ils sont d'une telle paresse, qu'ils ne se donnent même pas la peine de tresser leurs harnais qui sont des plus grossiers. Cependant cette paresse, remarquable aussi chez leurs femmes, ne les empêche pas d'être excessivement ambitieux et portés vers la coquetterie. Ils ont acquis en partie les vices des Américains, et l'on peut dire que l'orgueil et l'ivrognerie ne sont pas les moindres de ceux qu'ils professent.
Enfin, la troisième tribu, celle des Langnequétrou-tchets, dont le nom correspond à celui du cacique qui l'organisa, est fort connue dans les provinces de Buenos-Ayres et de tous les nomades, sans exception. Les Indiens qui la composent émanent de différents points: beaucoup d'entre eux furent recrutés par[Pg 83] Langnequétrou, parent de Calfoucourah—pierre bleue,—auprès de qui il remplissait les fonctions d'officier d'ordonnance mais contre lequel il entra en rébellion à la suite d'une incartade qu'il faillit payer de sa vie. Aiguillonné par ce qu'il y avait en lui de désirs de vengeance, d'orgueil et d'ambition, quoique fort jeune encore, cet Indien se sauva jusqu'au bord du Rio-Négro où il arriva escorté de tous les mécontents qu'il avait recrutés sur son passage. Sous l'impression de son profond ressentiment, il n'eut de repos que lorsqu'il fut en mesure de se déclarer ouvertement en faisant à d'autres tribus une guerre dont toute franchise et toute loyauté furent exclues. Il se vendit aux Argentins, uniquement pour conduire leurs troupes dans le camp de ses frères qu'il fit plusieurs fois surprendre nuitamment et massacrer. Il fit plus encore: habile à profiter des dissentiments qui éclataient au sein des républiques espagnoles, il trahit tour-à-tour l'un et l'autre parti et les conduisit souvent dans des guet-à-pens où il les faisait assassiner jusqu'au dernier pour s'enrichir de leurs dépouilles.
[Pg 84]
L'adresse et le courage dont cet être eut maintes fois l'occasion de donner des preuves, en firent une sorte de personnage que les Espagnols voulurent s'attacher à tout prix. Ce chef audacieux reçut leurs envoyés et ratifia les traités de paix et d'alliance qui lui étaient soumis. Il parut pendant quelque temps oublier qu'il était enfant du désert et conduisit à bien quelques expéditions de peu d'importance il est vrai, mais qui lui gagnèrent la confiance du gouvernement Buénos-Ayrien. En 1859 Langnequétrou se rendit à la Baie-Blanche pour s'entendre avec les soldats argentins au sujet de l'organisation d'une forte expédition qui devait être dirigée contre les tribus Pampéennes et Mamouelches soumises à Calfoucourah. Ainsi que le font les Indiens, tous fort amateurs des boissons alcooliques, il entra dans Huna porpéria—débit de liqueurs—pour se livrer au plaisir de boire, mais il s'y trouva face à face avec un officier argentin, qui le reconnaissant lui reprocha amèrement la mort de plusieurs de ses parents officiers comme lui et victimes de sa trahison. Les réponses inconvenantes que[Pg 85] lui fit Langnequétrou l'irritèrent tellement, que tirant soudainement un pistolet il lui fracassa la tête.
Les Indiens parmi lesquels je vivais encore à cette époque en qualité d'esclave avaient maintes fois juré la mort de Langnequétrou, qu'ils exécraient profondément: mais, chose étrange, en apprenant la fin tragique de ce chef, ils oublièrent tous leurs griefs et ne songèrent plus qu'à venger en lui la mort d'un des leurs. Dans ce but, ils organisèrent promptement une expédition formidable qui pilla et incendia la ville de Baie-Blanche dont l'héroïque défense ne laissa pas que de leur coûter beaucoup de morts et de blessés.
Selon le dire des Patagons en général, l'immense désert compris entre la chaîne des Andes, la rive sud du Rio-Négro, la côte Orientale et le détroit de Magellan, n'est pas, ainsi qu'on l'a dit jusqu'alors, d'une stérilité complète; un tiers au moins de cette étendue est d'une grande fertilité, principalement le côté oriental et l'extrême pointe de Magellan. Je puis du reste citer en toute assurance[Pg 86] à l'appui de cette opinion les divers parages où j'ai résidé, dans le voisinage des Andes et dans celui de Los Serranos et qui sont vraiment d'un aspect ravissant de pittoresque et de fertilité. A leur vue on est émerveillé, et l'on comprend facilement qu'il soit possible à l'homme d'y pourvoir complètement à son existence. Aussi, malgré le manque de chevaux et de troupeaux, les Indiens y vivent-ils dans la plus grande insouciance et du seul produit de leurs chasses. Leur terrain de parcours se divise en parties boisées d'Algarobes et de Chagnals au sein desquelles ils se retirent durant l'hiver, et en vallées sillonnées d'un grand nombre de torrents et couvertes d'étangs, sur lesquels se pavanent quantité de canards sauvages et de poules d'eau qui feraient le bonheur de nos chasseurs Européens, mais qui, habitués à n'être jamais inquiétés par les Indiens dont l'unique nourriture est la chair crue de guanacos ou d'autruche, ne redoutent aucunement l'approche de l'homme.
Quelque pénible que fût mon esclavage, je ne pouvais m'empêcher parfois d'admirer[Pg 87] cette superbe nature dont la vue m'aurait complètement réjoui si elle ne m'eût à tout instant, rappelé ma triste position. Je me serais même fait au genre d'existence de mes maîtres si les mauvais traitements auxquels j'étais constamment exposé n'eussent encore rendu plus grande ma douleur et ne m'eussent fait craindre une fin tragique.
Je perdais tout espoir d'embrasser encore ceux qui m'étaient si chers et de revoir jamais ma patrie; cependant la volonté de m'affranchir du terrible joug qui s'appesantissait sur moi, était celle qui me dominait; aussi dans mon pauvre esprit troublé, maints projets de fuite s'entrechoquaient-ils constamment. Cette pensée me donnait seule la force et la résignation nécessaires pour supporter les privations de tous genres imposées par ma condition d'esclave. Forcé de vivre à l'état de muet, ne pouvant faire un geste sans qu'on m'en demandât la raison, ou ne pouvant faire un pas sans être aussitôt suivi, j'en vins à souhaiter vivement d'être un instant seul pour me livrer à mes pensées. Les Indiens soupçonnèrent mon désir et conçurent contre moi[Pg 88] la plus grande méfiance; leur haine sembla s'accroître encore et je faillis même plusieurs fois en être victime. Souvent, lorsque je dormais près d'eux, leurs esprits étaient tellement inquiets, que s'éveillant à plusieurs reprises, ils se jetaient sur moi armés et menaçants prétendant que Vitaouènetrou—Dieu,—les avertissait de mes projets de fuite et leur ordonnait de me surveiller attentivement et de me châtier de cette criminelle pensée. Puis ils me pressaient de questions pour me sonder, et lorsqu'enfin ils s'en allaient, ce n'était jamais sans me rudoyer cruellement. Maintes fois dans ces terribles circonstances il fallut m'armer d'une bien grande résignation pour ne pas succomber aux désirs de vengeance que m'inspirait ma dignité d'homme civilisé.
Ces surprises nocturnes, fréquemment renouvelées, réagirent tellement sur moi que je devins sujet à des défaillances nerveuses à la suite desquelles j'étais souvent pris d'un tremblement convulsif qui me durait plus d'une demi-heure. Au bout de ce temps, j'étais complètement anéanti et absorbé par une sorte de spleen durant lequel j'éprouvais[Pg 89] un tel dégoût de l'existence, que j'aurais volontiers cherché ou accueilli la mort comme le plus grand des bienfaits. Etant, comme je l'ai dit, condamné à vivre à l'état de muet, les moments que me laissaient le malaise et le spleen s'écoulaient pour moi longs et tristes, car jamais les Indiens ne m'admettaient en leur compagnie, et quand le devoir m'appelait dans leurs cases j'en étais presque aussitôt chassé fort brutalement. On pense bien que je ne me faisais jamais réitérer cet ordre gracieux accompagné de gestes menaçants ou appuyé de coups de lazzos qui me labouraient le dos et la poitrine. Je m'en allais tout pensif rejoindre le troupeau confié à ma garde auprès duquel je m'installais de nouveau pour le jour et la nuit, et cela par quelque temps qu'il fît, tantôt exposé à des chaleurs insupportables, le corps brûlé par le soleil ardent durant l'été, ou bien encore essuyant toute la rigueur du mauvais temps, soit qu'il plût, ventât ou gelât; et dans ce dernier cas je souffrais horriblement de l'onglée aux pieds et aux mains. Fort souvent après plusieurs heures passées à cheval, je me suis vu contraint, pour en descendre,[Pg 90] de saisir la crinière avec mes dents afin de me laisser choir le plus doucement possible car mes pieds et mes mains ne pouvaient m'être d'aucun secours, et quand j'atteignais le sol il me semblait en y roulant, tomber sur du verre cassé. Afin de pouvoir me relever, je me livrais à une active friction des membres à la suite de laquelle je commençais une marche forcée qui se changeait bientôt en une course agile d'un très-bon résultat.
Malgré cette série de souffrances continuelles et les menaces journalières des Indiens à la vue desquels je ne pouvais me défendre d'un certain mouvement de crainte, je ne laissais pas de songer sérieusement à m'en affranchir. Quelque bonne volonté dont je fisse preuve et quelque désir que j'eusse de me familiariser complètement à tous les genres d'exercices des Patagons, il me fut impossible d'y arriver aussi vite que je le souhaitais et qu'il était nécessaire à leurs yeux. Comme ils ne pouvaient tirer de moi qu'un médiocre parti, ils me vendirent à des Pampéens qui vinrent les visiter après avoir opéré plusieurs invasions sur le territoire Buenos-Ayrien.[Pg 91] Ces sauvages leur donnèrent en échange de ma personne quelques chevaux et quelques pilkènes—pièces de drap commun rouge ou noir.
Dès qu'il fut question de ce marché à l'amiable, les Patagons devinrent tout différents à mon égard, ils affectèrent d'avoir quelques attentions pour moi, afin sans doute de donner d'eux une haute opinion aux nouveaux-venus dont les mœurs et la tenue m'inspirèrent plus de confiance. Au bout de quelques jours que je passai presque dans l'inactivité, et pendant lesquels je fus, en quelque sorte, aussi bien traité que les visiteurs Pampéens, vint enfin le moment du départ.
Malgré tous les maux que j'avais endurés chez les Patagons, je ne pus me défendre d'un peu de tristesse en contemplant une dernière fois ces lieux pittoresques, si souvent témoins de mes larmes et de ma tristesse. Je chevauchais morne et silencieux entre deux Pampéens, auxquels ce mutisme habituel chez moi déplut apparemment, car ils m'adressèrent la parole en mauvais[Pg 92] espagnol: ils m'accablaient de questions et traduisaient, non sans les avoir amplifiées, mes réponses au restant de la bande qui se divertissait beaucoup à mes dépens, et était bien éloignée de croire que leur langage m'était familier, ce qui me mettait du reste à même de les mieux juger qu'ils ne le pouvaient faire à mon égard. Ainsi s'écoula tout le temps que nous mîmes à franchir l'espace qui nous séparait du lieu de leur résidence. Ils me demandèrent d'abord quel était mon pays; s'il était bien éloigné; combien de temps j'avais mis à franchir l'espace qui sépare les deux continents; de quoi se nourrissent les hommes à bord d'un navire; par quels moyens ils se procurent de l'eau douce en quantité suffisante pour se désaltérer pendant toute la durée de ce long et périlleux voyage?
Aux diverses réponses que je leur fis, ils témoignèrent autant d'étonnement que d'incrédulité, et cherchèrent à lire dans mes yeux, l'expression de la vérité, croyant probablement à une mystification. Ils me demandèrent aussi quels motifs assez puissants avaient pu me pousser à me séparer de ma[Pg 93] famille, pour laquelle je leur montrais une si grande affection; car à la vue des portraits de mes chers parents, maintenant en leur possession, je ne pus retenir mes larmes, ni me défendre d'un geste agressif envers celui qui en était possesseur. Cependant tel spontané que fût mon mouvement, il fut prévenu par l'Indien, qui s'empressa de les soustraire à mes regards envieux et se mit sur la défensive, en même temps que ses compagnons me resserrèrent plus étroitement.
La prudence me vint en aide; je redevins maître de moi-même; aussi fut-ce avec le plus grand calme que je répondis aux nouvelles questions de l'interprète dont le ton et la contenance étaient ceux d'un homme qui veut être obéi. Je leur dis que j'avais dû quitter l'Europe, parce que j'avais quelque ambition et que dans ma patrie, l'étendue de territoire est si restreinte, comparativement à sa nombreuse population, que c'est à peine si quelques individus parviennent à s'y créer une existence indépendante, ou une certaine aisance; que l'argent étant le principal moteur de toutes choses dans les pays civilisés, chacun[Pg 94] pour en amasser le plus possible, exerce une industrie quelconque, et que, à part quelques élus, les autres suffisent à peine à leurs besoins; que de même que j'étais venu en Amérique, des centaines de mille autres Européens mûs par la même ambition s'exilent ainsi volontairement chaque année, dans l'espoir de réaliser en peu de temps des bénéfices assez grands, les uns, pour se trouver désormais à l'abri du besoin, les autres à seule fin de pouvoir se livrer à une vie de bonheur et de plaisirs. Enfin j'ajoutai que l'espérance de voir la fortune me sourire et le désir ardent d'être pour quelque chose dans le bonheur des miens, avaient suffi pour me faire quitter la mère-patrie.
Après avoir communiqué ma réponse à ses compagnons qui se prirent à rire d'un air de pitié en haussant les épaules, il me répondit que puisque le sort m'avait jeté parmi eux, toute inquiétude sur l'avenir serait superflue de ma part; que je n'aurais nul besoin de travailler pour manger, et que ma famille saurait bien se passer de moi, car je ne la reverrais jamais; que je serais heureux[Pg 95] au milieu d'eux, bien qu'ils ne me promissent pas, à vrai dire, de vêtements ni de maison pour me garantir des intempéries des saisons; que la terre, soit sèche soit détrempée, les rochers ou la verdure seraient tour à tour mon lit; qu'à ce genre d'existence je me ferais aussi bien qu'eux, car je leur paraissais fait de même; enfin qu'ils auraient pour moi des égards autant que je leur serais utile et dévoué. Et pour clore, il ajouta en manière de réflexion, que les chrétiens sont des sots—ouèsalmas,—des imbéciles—pofos,—de travailler pour de l'or et de se couvrir de la tête aux pieds de vêtements incommodes et extraordinaires autant que malsains fabriqués sans doute à grand peine, à en juger par l'étoffe.
Pendant huit jours que nous cheminâmes dans la direction du nord-ouest, à travers des parages boisés dont l'aspect me sembla ravissant comparativement à ceux que j'avais jusque-là habités, je fus continuellement l'objet de la conversation des Indiens qui me firent des milliers de questions et qui se montrèrent à mon égard d'une prévenance à[Pg 96] laquelle je n'étais guère accoutumé. Le nom de mon pays me parut, pour la première fois parvenir à leur oreille.
Parmi leurs questions, quelques-unes me convainquirent de leur intelligence. Ils s'informèrent avec les marques du plus grand intérêt, de la forme de notre gouvernement. Rien ne m'étonna tant et ne me fit plus de plaisir, je l'avoue, que d'entendre ces êtres qui ne connaissent ni lois, ni règles fixes pour le gouvernement civil, admirer ou railler tour à tour, notre civilisation dont je leur traçais un tableau si imparfait.
Je puis dire à leur honneur, que je les vis émerveillés de notre génie, et revenir naïvement de leur première opinion en disant:
—El-mey-ta-ouignecaës-pofos-gné-ouélay.
—Et mais ces chrétiens bêtes ne sont pas.
Chez les Indiens, chaque famille et même chaque homme se croit absolument libre. Ils vivent dans une entière indépendance; et cependant malgré cette manière d'être et de voir, les Poyuches, les Pampas et les Mamouelches se divisent tout aussi bien que les[Pg 97] Patagons en un grand nombre de tribus. Leurs fréquentes guerres intestines d'autrefois, celles qu'ils eurent à soutenir contre leurs voisins, comme encore de nos jours, celles qu'ils font contre les Hispanos-Américains, mettant sans cesse leur liberté en danger, ils ont appris par simple nécessité, à se former en sociétés plus ou moins nombreuses; ils se choisissent des chefs ou caciques, sorte de commandants, qu'ils considèrent bien plutôt comme leurs pères et leurs directeurs, que comme des maîtres, et avec lesquels ils restent ou dont ils se séparent selon leur gré.
Pour être élevé à la dignité de cacique, il faut avoir donné des preuves éclatantes de sa valeur, et plus les caciques sont fameux par leurs exploits, plus leurs peuplades sont grandes. C'est ainsi que de nos jours encore, les Pampéens et les Mamouelches, quoique ayant un grand nombre de caciques, relèvent volontairement d'un chef privilégié Calfoucourah—pierre bleue;—ce nom lui vient de la trouvaille qu'il fit, étant enfant, d'une petite pierre bleue ayant à peu[Pg 98] près forme humaine et dont jamais il ne s'est séparé; elle est considérée parmi les Indiens comme un talisman précieux auquel il doit ses nombreux succès.
La conversation ne fut pas la seule distraction que le langage grotesque de mon interprète m'offrit, car nous chassâmes une grande partie du temps de notre voyage, et je fus assez heureux pour faire preuve de quelqu'adresse, en prenant soit au lazzo ou à la boléadora des youèmes—gamas—et des tchoïquets—nandous ou autruches de ces parages,—ce qui fit que mes nouveaux maîtres augurant bien de mes futurs services parurent avoir pour moi une certaine considération.
Cependant, au fur et à mesure que nous approchions du lieu de résidence de la horde, je vis, non sans une certaine inquiétude, cesser tout l'empressement et les égards dont j'avais été entouré depuis notre départ. Il me fut facile de comprendre, à la conversation des Indiens, qu'ils n'en avaient agi ainsi que par ruse, et afin de me préoccuper assez pour m'ôter toute pensée de fuite, mais que dès lors suffisamment rassurés par le voisinage de[Pg 99] leurs tribus, ils se souciaient peu de me cacher plus longtemps leurs véritables intentions envers moi. C'est ainsi que j'acquis la triste certitude de n'être guère mieux traité chez eux que chez les barbares Poyuches, les fiers Puelches ou les durs Patagons; car les uns et les autres ne me considéraient que comme un ennemi devenu leur esclave, c'est-à-dire comme un être sur lequel ils avaient plein droit de vie ou de mort.
Les dernières paroles qu'ils m'adressèrent, furent des conseils équivalant presque à des menaces, au sujet de ma conduite à venir. Ils ne laissèrent pas non plus que de me répéter fréquemment qu'aussi bien qu'à mes premiers maîtres, je leur devais une grande reconnaissance de ne point m'assassiner puisque j'étais un ouignecaé—chrétien,—ce que tout indien de ces régions considère comme un crime.
Enfin, nous arrivâmes. Il était temps que ce long voyage s'achevât, car j'étais rompu de fatigue et dans un état douloureux que l'on comprendra aisément en sachant que c'était le premier trajet que je faisais de la[Pg 100] sorte, c'est-à-dire, sur des chevaux aussi nus que moi-même et fort amaigris par un galop continuel au plus fort de la chaleur.
Mon arrivée au milieu de la horde, fut comme un évènement inattendu et je devins de nouveau l'objet de la curiosité générale. Aux enfants, aux femmes qui m'entourèrent aussitôt, succéda une affluence considérable de visites avides de se graver dans la mémoire les traits du ou'sah-ouignecaé—mauvais chrétien,—uniquement afin de pouvoir en cas de besoin, s'opposer à sa fuite. Aux personnages les plus importants, mon maître n'omettait point de renouveler, avec toutes sortes d'amplifications, le récit de la terrible lutte que nous avions soutenue, mon compagnon et moi, contre nos nombreux et féroces agresseurs, les Poyuches. L'indignation de chacun d'eux semblait alors n'avoir plus de bornes, et le plus souvent, en s'éloignant, ils m'adressaient des imprécations ou me faisaient des gestes menaçants.
Au bout de quelques jours écoulés de la sorte, et lorsqu'on jugea que j'étais suffisamment connu, on me fit reprendre mes fonctions[Pg 101] de gardeur de troupeaux. Je fus soumis à une surveillance des plus rigoureuses, durant la nuit et le jour; je ne pouvais faire un pas sans être accompagné; il m'était demandé compte de ma tristesse et du moindre geste; la nuit, je fus encore exposé à être troublé dans mes courts instants de sommeil; car la superstition des Indiens leur faisait appréhender mon évasion, et poussés par cette crainte, ils se jetaient sur moi tout à coup et m'éveillaient brusquement en me menaçant. Souvent il m'arriva dans ces instants difficiles d'éprouver de grandes frayeurs qui étant toujours mal interprétées me valaient force mauvais traitements.
[Pg 102]
La Pampa et les Pampéens.
Les variations du climat de la Pampa sont des plus régulières. Elle subit une grande différence de température l'été et l'hiver. Ce dernier y est presque aussi froid que le mois de décembre en France. Il n'y neige point cependant, mais le matin la terre est toujours couverte de givre. La glace n'atteint jamais plus d'un pouce et demi d'épaisseur environ. Par contre-coup, l'été y est d'une chaleur accablante. Dès l'aube, l'horizon forme une ligne sombre et dense, qui ne s'éclaircit que petit à petit, et au fur et à mesure que le soleil se lève: l'on voit alors l'herbe touffue de ces immenses plaines se dépouiller d'une partie de la bienfaisante[Pg 103] rosée du matin, qui en s'évaporant produit les plus singuliers effets de mirage. La force du soleil se fait vivement sentir à toutes les créatures vivantes. Les chevaux et les bœufs sauvages qui peuplent ces plaines en ressentent une telle fatigue, qu'ils se livrent, ainsi que les hommes, à une sieste qui semble pour tous un repos aussi naturel que nécessaire.
On trouve dans toute la Pampa, des différences sensibles d'atmosphère. Dans les régions Mamouelches—boisées—l'air est des plus secs; et chez tous les êtres, quels qu'ils soient, on ne trouve aucune apparence de transpiration. J'ai vu même maintes fois des animaux tués par la chaleur, gisant sur la plaine aride desséchés dans leur peau; mais dans la latitude de Buenos-Ayres et de la Baie-Blanche, par les 70 et 71 degrés de latitude, régions où abonde la plus magnifique luzerne que l'on puisse imaginer, la végétation démontre clairement l'humidité du climat. La rosée dans ces parages ressemble plutôt à des pluies lentes et fines, ou à des brouillards épais. La viande et les[Pg 104] animaux morts s'y corrompent fort vite et les plaies sont très-difficiles à guérir. Cependant, qui le croirait? malgré cette humidité constante, les Indiens dorment tous presque nus sur la terre sans en être jamais incommodés.
Les Pampéens n'ont pas plus de résidence fixe que les Puelches ou les Patagons. Ils errent d'un lieu à un autre au fur et à mesure que l'herbe est consommée par leurs bestiaux; mais jamais ils n'abandonnent un parage quelconque sans avoir achevé avec le feu l'œuvre de destruction commencée par les animaux. Les Pampéens occupaient autrefois toute la partie comprise entre les différentes provinces de Buenos-Ayres, le Rio-Colorado et les Mamouelches, qui sont encore actuellement leurs limites occidentales et septentrionales; cependant ils ne s'en éloignent que fort peu. Ils se tiennent principalement dans la partie Nord, Nord-Ouest, environ par les 68 et 69e de longitude et parcourent toute l'étendue comprise entre les 33e et 38e d° de latitude. Parfois, cependant, il leur arrive de se confondre momentanément avec les Mamouelches,[Pg 105] ou d'opérer leur retraite beaucoup plus au loin surtout lorsqu'ils redoutent quelque agression. Cette alliance a lieu principalement à leur retour de ces grandes expéditions dans lesquelles ils se livrent aux plus atroces cruautés.
Il est à croire que ces êtres barbares ont comme nous, à leur insu, une conscience qui parle plus fort que leur volonté, car ils sont souvent pris de frayeurs telles, que sans autre motif qu'un cauchemar, ils se prennent à fuir soudain au beau milieu de la nuit, en jetant le cri d'alarme, et de même que des moutons fourvoyés, ils se suivent les uns les autres, délaissant la plupart du temps les parages où quelques heures encore auparavant ils se regardaient comme étant dans la plus grande sécurité. Ces fuites ressemblent absolument à une déroute pendant laquelle ils abandonnent en chemin tout le bétail qu'ils ne peuvent chasser au galop devant eux. Les points où ils dressent leurs tentes ne présentent plus à leur départ qu'un aspect dégoûtant, véritable chenil où se trouvent entassés pêle-mêle les ossements des animaux dont ils se sont nourris, des lambeaux de cuirs[Pg 106] pourris et des cardes de laine émanant une fétide odeur; au milieu de ce tout nauséabond se pavanent quelques vautours et quelques éperviers cherchant nonchalamment à y découvrir encore quelques lambeaux de chair putréfiée.
Ces oiseaux sont généralement d'une hardiesse telle que j'eus souvent mille et mille peines à les empêcher de prendre leur part des animaux que nous abattions les Indiens et moi. Je n'avais point le temps de ramasser mon couteau ni celui de retourner mon gibier pour achever d'en détacher le cuir que déjà ils étaient installés sur l'animal. Quelquefois je m'amusais à jeter en l'air des morceaux sanglants auxquels ils ne laissaient pas le temps de retomber. Je les ai vus aussi s'établir sur le dos malade des chevaux ou des mulets et les déchiqueter malgré les contorsions des pauvres victimes inquiètes et furibondes, qui les oreilles couchées et le dos tendu, sautillaient de l'arrière-train en agitant convulsivement la queue, afin de les éloigner.
Les Pampéens étaient autrefois beaucoup plus nombreux qu'ils ne le sont actuellement; mais ils sont très-affaiblis par leurs incessantes[Pg 107] guerres avec les Espagnols. Encouragés par l'impunité dans laquelle on laissait leurs sanglantes incursions, ils s'y livraient presque constamment et ne craignaient point non plus de résider dans le voisinage des provinces Argentines, à l'ouest de la Sierra-Ventana. Ils affectionnaient ces parages en raison de sa proximité des peuplades Hispanos-Américaines et de son incomparable fertilité. Ils le nommèrent Pouanemapo, ou terre de Pouane, un de leurs caciques célèbres, lequel y naquit et y mourut vaillamment dans une surprise nocturne des gauchos de Rosas. Il est véritablement à croire que les Indiens, tout habitués qu'ils fussent aux luttes sanglantes, n'en eurent jamais à soutenir d'aussi acharnée et d'aussi terrible que celle de cette nuit si fatale pour eux; car bien qu'ils soient braves et fort entreprenants, ils semblent frappés de stupeur dès que le souvenir de cette défaite est évoqué. Aucun d'entre eux n'ose s'aventurer dans le pays de Pouane, dont, disent-ils, Houacouvou—Dieu—leur a interdit l'accès à tout jamais sous peine de mort.
[Pg 108]
La taille des Pampéens est inférieure à celle des Puelches et à celle des Patagons. A quelques exceptions près, ils n'ont guère plus de cinq pieds huit à neuf pouces en moyenne. Ce sont les Indiens les plus foncés en couleur. Ils sont d'un brun olivâtre très-prononcé; quelques-uns même sont presque noirs. Leur peau est d'une grande finesse dans toutes les parties du corps; elle est douce comme du satin et même brillante. Ils exhalent une odeur particulière qui, loin d'être aussi forte que celle des nègres, l'est cependant plus que celle des Européens. Leur peau devient plus brillante et comme huileuse, à l'action du soleil; il me fut facile de m'en convaincre au toucher.
Le front des Pampéens est légèrement bombé mais non fuyant; leur figure est aplatie et longue. En général ils ont le nez court et épaté; quelques-uns l'ont aussi mince, long et recourbé, à l'instar des becs d'oiseaux de proie. Ils ont les yeux presque horizontaux, mais ainsi que les Patagons orientaux, la manière dont ils s'épilent les sourcils prête beaucoup à leur donner cet aspect. Ils ont[Pg 109] tous, sans exception, les pommettes fort saillantes, la bouche très-grande et béante, les lèvres grosses. Leurs dents sont comme celles de leurs voisins les Puelches et les Patagons, c'est-à-dire petites, fort blanches et admirablement rangées. La barbe leur pousse fort tard. Leurs cheveux sont abondants, d'un noir de jais et très-gros. Quelques-uns parmi eux les relèvent sur le sommet de la tête, mais les autres les séparent simplement en deux et les retiennent à l'aide d'un morceau d'étoffe ou d'une lannière de cuir. Mais tous dans les combats les laissent flotter sur leur figure afin de ne pas voir le danger qui peut les menacer.
Plus que jamais, on trouve maintenant chez les Pampéens des types assez réguliers: ce sont les enfants d'Indiens et de captives. Ces Indiens se font remarquer par un degré d'intelligence bien supérieur à celui de tous les autres nomades, les Araucaniens exceptés toutefois. Ils stationnent assez volontiers plusieurs mois de suite dans le même endroit. Leurs tentes sont, ainsi que celles des Puelches, confectionnées en cuir, mais elles sont[Pg 110] plus spacieuses et plus régulières. Il y règne un certain ordre et une grande propreté; ce qui n'empêche pas cependant qu'ils soient couverts de vermine.
Le type des femmes est en quelque sorte plus désagréable que celui des hommes qu'elles surpassent en laideur et auxquels elles ressemblent beaucoup. Elles sont grandes aussi, mais cependant pas autant qu'on pourrait se le figurer; il existe entre leur taille et celle des hommes de plus grandes proportions qu'on ne saurait en trouver entre les hommes et les femmes d'Europe; mais ces proportions ne sont pas assez générales pour en calculer la différence. Les plus grandes n'ont guère plus d'un mètre cinquante-quatre à cinquante-cinq centimètres. Il s'en trouve bien cependant quelques-unes qui atteignent la taille des hommes, mais la majorité d'entre elles sont en quelque sorte plus petites. Elles exercent beaucoup leurs forces physiques; elles manient le lazzo et la boleadora avec beaucoup d'adresse. Leurs épaules larges et carrées encadrent une poitrine fort bombée mais disgracieuse; car elles ont l'habitude de[Pg 111] se détirer et de se masser les seins dès qu'elles deviennent mères, afin, disent-elles, de pouvoir offrir une plus grande quantité de lait à leurs enfants. Cet usage se propage même à l'égard des vaches laitières. Très-surpris de cette coutume, je résolus de m'assurer du résultat qu'elle pouvait avoir: j'en fis l'expérience sur une jeune vache dont je mesurai le lait avant comme après l'opération. J'eus lieu de rester convaincu de la véracité du fait. Les Pampéennes ont les membres peut-être un peu courts, comparativement au tronc, mais généralement replets et arrondis.
La démarche de toutes les femmes Indiennes est des plus disgracieuses; plus particulièrement encore celle des Pampéennes qu'un certain sentiment de décence oblige à s'asseoir différemment des hommes, qui s'accroupissent à la façon Orientale, les jambes croisées sous eux. Elles doublent la jambe gauche, la pointe du pied reposant sur le sol, puis elles s'asseyent sur le talon et passent la jambe droite par-dessus la cuisse gauche, en ayant soin de mettre cet autre pied à plat à côté de l'autre afin qu'il leur soit possible de se[Pg 112] maintenir ainsi en équilibre les jambes serrées. Cette posture fatigante à laquelle elles s'habituent dès l'enfance, leur dévie extraordinairement la hanche gauche, leur tourne cette jambe en dedans, et les fait boîter de toute cette partie. Elles ont les mains petites, fort bien faites et rarement maigres. Leurs articulations ainsi que celles des hommes sont fines; leurs pieds sont petits, mais larges. Si leurs formes ne sont pas belles, du moins elles annoncent une très-grande force.
Ces femmes sauvages s'entourent la taille d'une pièce d'étoffe le plus souvent fabriquée par elles-mêmes avec la laine de leurs moutons qu'elles filent et teignent artistement. Ce vêtement les couvre depuis les épaules jusqu'au-dessus du genou seulement; on dirait un fourreau d'où sortent tête, bras et jambes, sans harmonie et sans art. Ce costume est fixé à la partie supérieure par une énorme broche ronde—toupouh—en argent, dont la tête large, plate et mal battue, rappelle assez le fond d'une casserole bien étamée. A la hauteur des hanches, elles s'entourent d'une large ceinture de cuir cru, ornée de dessins[Pg 113] de différentes couleurs et de parties velues, ou bien encore couverte de perles grossières entremêlées avec art et assujetties avec des fibres extraites de la viande. Leurs cheveux sont séparés en deux nattes fort longues qui leur pendent quelquefois jusqu'aux talons et aux extrémités desquelles elles suspendent quelques ornements de cuivre ou d'argent.
Quelques femmes se contentent d'enrouler leurs nattes autour de la tête en forme de diadême et de les attacher avec des lacets de laine rouge ou jaune de la largeur de deux doigts: toutes se suspendent des boucles d'oreilles carrées d'une si grande dimension qu'elles reposent sur leurs épaules.
Les plus riches ou les plus considérables d'entre elles portent aussi un collier de cuir de la largeur de trois doigts et très-serré, garni superficiellement de demi-perles de métal qu'elles fabriquent ainsi qu'il suit:
D'abord elles battent pour le réduire en feuilles le métal dont elles peuvent disposer; ensuite elles découpent des rondelles d'égale grandeur et les estampillent à l'aide de deux os de cheval, dont l'un creusé sert de matrice,[Pg 114] et l'autre en relief qui tient lieu de tampon. Chaque perle repoussée est perforée de deux petits trous sur le côté pour être enfilée et cousue au cuir. La largeur et la complète absence de souplesse de ce singulier ornement semblable à des colliers de chiens, les empêchent de mouvoir la tête et donne à l'air important qu'annoncent les figures de celles qui en sont parées un aspect des plus comiques.
Les plus jeunes se font des bracelets de perles de plusieurs couleurs au-dessus des chevilles et des poignets où ils restent à demeure, et toutes, jeunes ou âgées, les jours de fêtes, entremêlent à leur chevelure une sorte de bonnet ou de résille en perles bleues et blanches qui leur retombe sur le front, leur couvre les pommettes, et maintient leurs nattes séparées.
Les Pampéennes sont très-actives et très-empressées auprès de leurs maris; elles subissent sans murmurer toutes leurs exigences. Ceux-ci emploient généralement à se reposer tout le temps qu'ils ne consacrent pas à chasser ou à dompter leurs chevaux. Dans les changements de résidence, ce sont encore les[Pg 115] femmes qui prennent le soin de transporter tout ce qui concerne le ménage. Elles chargent les chevaux et sellent celui de leur mari puis le leur, sur lequel elles s'installent ensuite avec trois ou quatre enfants. Dans cet équipage, elles rassemblent le troupeau et le chassent devant elles avec la lance de leurs seigneurs et maîtres, lesquels montés sur leurs meilleurs coursiers, sans autre charge que leurs lazzos et leurs boleadoras, se livrent, chemin faisant, au plaisir de la chasse, sans paraître songer le moins du monde à leur famille, quel que soit l'attachement qu'ils aient pour leurs enfants.
Arrivés à destination, ce sont encore les femmes qui déchargent les chevaux et qui réinstallent au plus vite la tente sous laquelle viennent s'étendre leurs maris, tandis qu'elles leur préparent des aliments. Après avoir rétabli l'ordre dans le ménage et prodigué des soins à leurs enfants, pour se reposer des fatigues du jour elles filent de la laine et tissent des manteaux pour toute la famille. C'est vraiment curieux de voir l'habileté et la perfection qu'elles déploient dans[Pg 116] ces sortes de fabrications: elles n'ont d'autres métiers que ceux qu'elles se font elles-mêmes, et qui ont la forme d'un cadre dont deux des traverses parallèles supportent des fils croisés et bien tendus. Les fils destinés à servir de trame sont pelottés sur des morceaux de bois pointus qui servent de navettes; pour remplacer le peigne de nos tisserands, elles font usage d'une petite palette bizautée. Ces tissus, malgré les nombreuses imperfections des outils dont ces femmes disposent leur font vraiment beaucoup d'honneur, car on les peut comparer à ceux qui sortent de nos fabriques. Ils sont toujours enjolivés de dessins réguliers et originaux formés de laines de plusieurs couleurs. Pendant mon long séjour dans cette tribu j'en vis plusieurs de fort remarquables par leur finesse, mais un principalement sur lequel était représenté avec une rare perfection le portrait du général Urquiza auquel il fut offert; ce personnage ne sachant de quelle manière témoigner son admiration pour cette œuvre de patience la couvrit de pièces d'or.
Les Pampas pour lesquels l'exercice du[Pg 117] cheval est une obligation, s'installent le plus souvent d'un seul bond sur leurs coursiers affublés de selles en bois qui leur emboîtent parfaitement le dos et l'encolure. Les plus riches seulement ou les plus chanceux dans les pillages sellent leurs chevaux comme le font les gauchos.
Les femmes vont à cheval à l'instar des hommes, mais leurs selles diffèrent totalement. Ce sont plutôt de véritables échafaudages, composés de sept à huit cuirs de moutons superposés sur le dos du cheval et surmontés de deux rouleaux de jonc—salmas—recouverts de cuirs souples peints en rouge et en noir; le tout est solidement fixé à l'aide de deux sangles en cuir cru. Pour grimper sur cet appareil elles se servent d'un étrier passé au cou du cheval en forme de baudrier.
Les Pampéens s'épilent avec beaucoup plus de soin que les Indiens des autres tribus; ils déploient aussi plus de coquetterie dans l'art de se tatouer. Hommes et femmes s'entr'aident aussi bien dans cette occupation que pour se purger le corps et la tête des nombreux insectes[Pg 118] dont ils sont assaillis et qu'ils mangent même en prenant leur repas. Ces Indiens possèdent des ustensiles de cuisine, tels que marmites de fonte—chaïas,—des broches en fer—cangnecaouëts—provenant de pillages. Ils font en partie cuire leurs aliments. Les femmes que regarde ce soin préparent la viande d'une manière toute particulière: elles font bouillir de l'eau dans laquelle elles plongent quelques morceaux de chair qu'elles retirent aussitôt blanchis, puis elles les servent dans de petites écuelles en bois avec un peu de ce succulent bouillon—caldo—très-fortement salé et obtenu ainsi en moins d'un quart d'heure. Cependant, disons-le, parfois aussi je les ai vus manger de la viande bien rôtie; mais leur instinct naturel les porte à la préférer toute crue, bien saignante. Ils dévorent avec joie les poumons—carêtone,—le foie—quèhs—et les rognons—cousanoh—tout sanglants, et ils boivent le sang chaud ou caillé.
Les hommes sont aussi fort industrieux et patients. Leur adresse s'exerce surtout à tresser des harnais qui sont très-recherchés des[Pg 119] Hispanos-Américains. Les plus riches fermiers et les caballeros mettent un certain orgueil à en affubler leurs chevaux. Leurs rênes, leurs cordons d'étriers et leurs sangles, sont parfois aussi souples et aussi bien tressés que les objets que l'on fait chez nous avec des cheveux. Ces articles, ainsi que les manteaux de cuir de guanacos, les plumes d'autruche et les cuirs de toute espèce qu'ils auraient la faculté d'échanger, suffiraient seuls à enrichir les Pampas s'ils n'étaient pas aussi inconstants. Les ouvertures de paix qu'ils renouvellent si souvent, n'ont d'autre but que de se pourvoir gratis de tabac, de sucre, de yerba et de liqueurs fortes. Mais dès qu'ils voient leurs provisions s'amoindrir, ils rentrent de nouveau dans la voie des hostilités et recommencent leurs terribles invasions qui sont tout à la fois la ruine et la mort d'un grand nombre d'habitants.
Dans leurs expéditions les Indiens ne respectent pas plus les femmes d'âge que les hommes; ils les assassinent. Ils n'épargnent absolument que les jeunes filles dont ils font leurs femmes privilégiées sous le rapport de[Pg 120] l'affection. Les tout jeunes enfants deviennent des esclaves, à la garde desquels ils confient leurs troupeaux, quand ils ne les vendent pas aux Indiens des tribus éloignées, soit aux Mamouelches ou aux Araucanos, qui dans leurs visites annuelles leur apportent des éperons et des étriers d'argent grossièrement faits et en échange desquels ils sacrifient volontiers la plus grande partie de leurs troupeaux, jusqu'à leurs captifs et captives même. Les Araucaniens échangent généralement leurs étriers et leurs éperons dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 20 à 30 piastres (100 à 150 francs) contre quinze à seize bœufs qu'ils ne vendent pas moins de 25 à 30 piastres chaque, au Chili. Et comme jamais aucun d'eux ne se hasarde à franchir la Cordillière sans un certain nombre de ces objets, plus une pacotille composée d'indigo—anil,—de mantes—Pilquènes,—d'ustensiles nécessaires au tatouage et de perles de diverses couleurs—cuentas—à échanger, comme il est dit plus haut, on comprend quelle peut être leur richesse puisqu'ils ne regagnent jamais leur pays sans être possesseurs de 3 à[Pg 121] 400 bêtes à cornes et d'un assez grand nombre de chevaux dont la vente leur est pour le moins aussi avantageuse.
Les Araucaniens, bien qu'ayant la même origine que les Patagons, les Puelches, les Pampéens et les Mamouelches, mènent cependant une existence matériellement différente à laquelle les forcent et la restriction de leur territoire et l'impossibilité où ils se trouvent d'envahir les provinces du Chili, dont les frontières sont bien autrement gardées et défendues que celles de la République Argentine. Au lieu de vivre à l'état nomade, comme les Indiens de la côte orientale, les Araucaniens sont groupés par villages, ils habitent des maisons en bois suffisamment grandes pour plusieurs familles. Ils sont fort ingénieux et travailleurs. Ils cultivent le maïs—ouah—et le froment—cévada—ainsi que différents légumes, tels que: pommes de terre—Ponnieux,—oignons—céboyats,—haricots—Porotos.—Ils font grand cas du melon et de la pastèque qu'ils récoltent presque en aussi grande quantité que les abricots, les prunes et les pommes sauvages, ce qui les met à[Pg 122] même de faire de copieux festins. Ils mangent généralement de la viande cuite ou rôtie, du meurkeh ou farine de maïs grillée à laquelle ils adjoignent du laitage ou de la graisse de cheval. Malgré ces diverses apparences de civilisation, ils se régalent volontiers de foie et de rognons crus saucés dans du sang caillé.
Il y a en Araucanie deux groupes de population fort distincts par leur caractère, que l'on désigne généralement au Chili comme dans la province de Buenos-Ayres sous les noms de haute et basse Araucanie.
La première se compose d'Indiens et d'Espagnols. Il est à la connaissance de tous, que les Indiens qui la composent sont d'un commerce facile et agréable, qu'ils aiment à mélanger leur sang à celui des chrétiens par les liens du mariage, ce qui ne les empêche pas toutefois de vivre libres de tout joug dans le voisinage de Santiago, de Constuccion, de Nacimiento, de Las-Angles et de Talca, où ils s'introduisent encore parfois en masse à la faveur des dissensions politiques. En bons Indiens qu'ils sont, ils ont conservé le goût du pillage; néanmoins, ils sont fort hospitaliers[Pg 123] et l'on peut sans crainte aucune se hasarder chez eux. Il n'en est pas de même de la basse Araucanie qui n'est peuplée que d'êtres beaucoup plus primitifs, aux yeux desquels un chrétien, de quelque nation qu'il soit, est un ennemi contre lequel ils ne sauraient trouver trop de moyens d'exercer leur férocité. Ce sont les Patagons de l'Araucanie bien que séparés de ces derniers par les Cordillières. Ils ont la plus grande répulsion pour tout ce qui sent la civilisation.
Malheur aux pauvres chrétiens qui tombent entre leurs mains, car pour leurs familles ils peuvent être rayés du nombre des vivants. Parmi les nombreux exemples que l'on pourrait citer à l'appui de ce que j'avance, le suivant en est, par son authenticité, une preuve irrécusable.
Quelque temps avant sa mort prématurée qui a jeté le deuil dans le monde scientifique, monsieur Geoffroy Saint-Hilaire qui m'avait honoré du plus bienveillant accueil, me disait qu'il considérait comme à tout jamais perdu pour sa famille l'un de ses parents tombé entre les mains des Indiens de la basse Araucanie.[Pg 124] En déplorant ce terrible malheur il me disait combien il aurait souhaité que son parent fût retenu prisonnier dans la haute Araucanie d'où il lui aurait été facile de l'arracher.
L'Araucanie a donc, ainsi que la Patagonie, ses légendes ténébreuses.
Quant aux Pampéens ils sont essentiellement chasseurs, et ils deviennent pour ainsi dire de plus en plus nomades par l'habitude qu'ils ont de se nourrir de la chair de leurs coursiers, tout en franchissant très-rapidement les plus grandes distances. Ils n'hésitent point à faire de cinq à six cents lieues pour dévaster les peuples Hispanos-Américains. Fort riches en troupeaux, ces Indiens pourraient facilement se passer de la chasse; mais comme elle est pour eux un grand divertissement ils s'y livrent toute l'année; mais cependant avec beaucoup plus d'ardeur pendant les mois d'août et de septembre, époque du printemps dans l'hémisphère sud. C'est en cette saison qu'ils font d'amples provisions de jeunes pièces de gibier dont ils sont extrêmement friands, ou bien encore d'œufs de perdrix et d'autruches.[Pg 125] Ils prennent fort adroitement de jeunes gamas vivantes avec lesquelles se divertissent les enfants, auxquels ils donnent aussi pour nourriture les œufs de perdrix, tandis que ceux d'autruches, moins délicats, sont mangés en commun dans la famille. Ils les cassent comme nous le faisons d'un œuf à la coque et les font cuire assis dans la braise de fiente en ayant soin de mêler le jaune et le blanc à mesure que la cuisson s'opère. On trouve toujours ces œufs en très-grand nombre. Les Indiens ne mangent que ceux qui sont en nombre pair, et font fi des autres qu'ils prétendent ne pas être fécondés.
Pour chasser l'autruche et la gama les Indiens s'assemblent en grand nombre, sous la direction d'un cacique qui remplit les fonctions de grand veneur. Il fait partir les chasseurs par groupes, dans différentes directions afin de cerner un espace de deux ou trois lieues; chacun de ces groupes, arrivé à l'endroit qui lui a été assigné, brûle en forme de signal, quelques herbages secs. Quand tous sont à leur poste, à un nouveau signal donné par le cacique, ils se déploient sur un rang[Pg 126] et marchent lentement vers le centre du cercle qu'ils forment, jusqu'à ce que la distance qui les sépare les uns des autres ne soit plus que de sept ou huit longueurs de cheval. Ils s'arrêtent alors, leurs locayo—boléadoras—en main. A leurs cris, les nombreux chiens sauvages qui les accompagnent s'élancent pour harceler les autruches et les gamas ainsi cernées. Ces animaux poursuivis de près et souvent mordus, cherchent à fuir en passant entre les courts intervalles que se sont ménagés les chasseurs, afin de pouvoir leur lancer une multitude de boules qui manquent rarement leur but. Les animaux pris sont dépouillés avec une dextérité incroyable, ce qui donne aux chasseurs la facilité de continuer leur exercice, jusqu'au moment où le cercle, trop rétréci, mette en présence la masse des Indiens. Fort rarement les chasseurs reviennent près de leurs familles sans avoir pris sept ou huit pièces de gibier dont le sang qu'ils boivent avec délices est toute leur nourriture durant la chasse qui dure les deux tiers du jour.
Après la chasse, les cuirs des divers animaux[Pg 127] tués sont étendus sur le sol à l'aide de piquets en ossements; une fois séchés ils sont salés pour en préserver la fourrure de toute atteinte; les Indiens les conservent ainsi que les plumes d'autruches pour les échanger à la première occasion contre du sucre, de la yerba, du tabac et des liqueurs alcooliques dont ils sont très-friands.
La population Indienne tend à décroître d'année en année; mais cette décroissance frappe plus particulièrement les Pampéens et les tribus du Nord, chez lesquelles les femmes sont en minorité, par suite des guerres terribles que leur firent les gauchos de Rosas, ainsi que je l'ai déjà dit. En plusieurs occasions les Indiens furent réduits à fuir; ils se réfugièrent dans les contreforts des Cordillières les plus rapprochés du Chili, dans le voisinage des Araucaniens. Leurs femmes ayant perdu tout repos et se voyant, à tous moments exposées à devenir captives des Argentins, abandonnèrent leurs maris et s'en furent en Araucanie. Le petit nombre de celles qui eurent le courage de rester fidèles à leurs époux, les Pampéens, dont l'état actuel est[Pg 128] encore de guerroyer avec les Espagnols, fut bien loin de leur suffire lorsqu'ils revinrent habiter leurs anciens terrains de parcours. Et malgré le grand nombre de femmes qu'ils ont captivées depuis et celles qu'ils enlèvent encore chaque jour, la moyenne est d'une pour quatre à cinq hommes.
Chez les Araucaniens, par contre coup, le nombre des femmes est de beaucoup supérieur à celui des hommes. Les mœurs indiennes autorisant la possession de plusieurs femmes, on voit des hommes qui en ont cinq ou six, et le grand cacique Calfoucourah, avec lequel j'ai vécu en a jusqu'à trente-deux. Il résulte de cette disproportion de nombre entre les deux sexes, que la plupart des Indiens, trop pauvres pour se passer le luxe d'une compagne, sont forcés de rester célibataires. Ils n'ont de rapports qu'avec celles qui sont libres, lesquelles peuvent, sans être exposées à aucune réprimande, leur accorder des faveurs. Malgré cette étrange coutume, on ne sera pas peu étonné de savoir qu'une fois mariées, elles deviennent fidèles à leurs maris et sont de fort bonnes ménagères.
[Pg 129]
Chez tous les peuples dont je retrace les principaux traits, le mariage est, ainsi que chez nous, considéré comme un acte important, et comme la source d'une vie honnête et heureuse. Il s'opère sous forme de trafic, ou échange d'objets et d'animaux divers contre une femme.
Un Indien est toujours satisfait lorsqu'il rencontre une future à la veille d'être mère. Les parents ne livrent leur fille qu'à l'acheteur le plus riche et le plus généreux.
Lorsqu'un Indien est désireux de contracter une union et qu'il a jeté les yeux sur quelque fille du voisinage, il s'en va visiter tour à tour tous ses parents et tous ses amis; il leur fait part de son désir et les prie d'être pour quelque chose dans la réussite de son projet. Chacun d'eux, selon son degré de parenté ou d'amitié, lui donne ses conseils et son approbation dans un discours fort long approprié à la circonstance et lui vient en aide en lui faisant un don quelconque. Ces cadeaux consistent généralement en chevaux, bœufs, étriers ou éperons d'argent et quelques pièces d'étoffes provenant de leurs pillages.
[Pg 130]
Dans une réunion antérieure à la célébration du mariage, les parents et les amis du futur fixent le jour où la demande devra être faite. La veille au soir, chacun revêt ses plus beaux ornements et se réunit au prétendant afin d'aller secrètement se poster à proximité de la demeure de la jeune fille convoitée, de manière à pouvoir dès l'aube matinale entourer les parents de la jeune personne auxquels ils font la demande dans les termes les plus pressants, les plus touchants et les plus poétiques; on évite toutefois de prononcer le nom du prétendant, jusqu'au moment où ils entrevoient chance de succès. Pendant ce temps le futur époux se tient caché à l'écart avec tous ses dons, selon les règles du décorum. Après une très-longue énumération des qualités de leur fille, témoin oculaire mais invisible de cette cérémonie, dont le rôle est de verser quand même d'abondantes larmes, les parents ne manquent point de témoigner d'une grande répugnance et d'une grande peine à se séparer de leur enfant; puis ils finissent par consulter sa volonté, en se réservant le droit d'accepter ou de repousser l'ouverture qui[Pg 131] leur est faite, dans le cas où elle ne leur présenterait pas un avantage suffisant. A ce moment, l'arrivée du futur et la vue des dons qu'il leur destine arrachent presque toujours le consentement de ces êtres cupides, et leur arrogante fierté disparaît sous un demi-sourire de satisfaction. Le reste de la journée se passe en famille; chaque membre s'empare incontinent du présent qui lui est fait. Une jeune jument bien grasse, donnée et sacrifiée par le jeune époux, préparée par toutes les femmes et servie par la nouvelle mariée, fournit le menu d'un banquet succulent arrosé de nombreuses libations d'eau. Aucun des invités ne peut ni ne doit s'absenter pendant toute la durée de cette fête, à la fin de laquelle il ne doit rester de l'animal dévoré que la peau et les os. Ces derniers, bien rongés, sont assemblés par les parents des époux et enterrés par eux dans un endroit en évidence, en souvenir de l'union qui, dès ce moment, se trouve consacrée.
Après cette cérémonie obligatoire, toute l'assemblée se dispose à accompagner en grande pompe les nouveaux mariés, chez[Pg 132] lesquels doit avoir lieu dans la journée une réminiscence de festin. Les parents de la jeune femme se munissent du cuir de la jument dévorée le matin et sitôt arrivés à la demeure de leur gendre, le remettent au jeune ménage en l'aidant à se construire un abri.
Pendant les jours suivants, une foule de visiteurs poussés par la curiosité se pressent dans l'intérieur du jeune couple et les félicitent mutuellement de leur heureux choix. Chacun s'enquiert près de la femme des qualités ou des défauts du mari, et près de celui-ci de celles de sa moitié. Les questions sont fort étendues, d'une crudité et d'une indiscrétion incroyables, sans que la délicatesse en paraisse froissée. Au contraire, les jeunes époux semblent très-flattés de cette marque d'intérêt. Les Indiens sont très-dissimulés; aussi la femme, tant par politique que pour s'acquérir la réputation d'être bonne et aimable offre-t-elle à tous ses visiteurs, soit de la viande, soit de l'eau ou bien du tabac, en leur adressant quelques paroles polies et flatteuses enjolivées d'un sourire débonnaire, même à ses ennemies, lorsqu'elle en a.
[Pg 133]
S'il arrive que les époux ne peuvent sympathiser après une cohabitation plus ou moins longue, ils se séparent à l'amiable sans que les parents fassent des difficultés pour restituer les objets qu'ils ont reçus de l'épouseur. Celui-ci d'ailleurs, dans sa générosité, leur en laisse toujours une partie en dédommagement du préjudice qu'il est censé leur avoir causé en les séparant de leur fille et en la leur rendant sans enfants. Celle-ci peut de nouveau être demandée et contracter une nouvelle union.
L'habitude des Indiens est d'être d'une très-grande sévérité à l'égard de leur femme dans les premiers temps du mariage; quelques-uns poussent même la cruauté jusqu'à les frapper de leurs boléadoras pour les rendre, disent-ils, humbles et soumises. La femme doit respecter et vanter tous les actes de son mari, et se taire dès qu'il prend la parole. Quelques-unes cependant refusent de se soumettre à cette humilité et s'attirent des mauvais traitements continuels. Les plus hardies s'affranchissent de ces violences par une brusque séparation. Elles avisent leurs parents qui s'arment alors[Pg 134] et la reprennent de vive force, ce qui devient la source d'une haine implacable des deux parts; car non-seulement le mari perd sa femme, mais on lui retient encore les deux tiers de ce qu'il a donné pour l'obtenir.
Quand les mauvais traitements que l'Indien inflige à son épouse sont basés sur son infidélité, l'homme conserve tous ses droits et son autorité; il peut la mettre à mort ainsi que son complice; mais, généralement très-avare, il préfère d'abord conserver son épouse et rançonner ensuite le délinquant, lequel a le droit de racheter sa vie lorsque ses moyens le lui permettent; cependant il arrive souvent, (j'en ai été témoin) que sans rime ni raison, l'accusation a été faite par suite d'un calcul et d'une cupidité à laquelle l'accusé ne peut en aucune manière se soustraire.
A partir du moment où l'époux a reçu satisfaction, il lui est interdit de faire à sa femme aucune allusion sur sa conduite illicite; il deviendrait passible des reproches de sa famille dans le cas où il la maltraiterait encore à ce sujet.
Lorsqu'un Indien, animé du désir de[Pg 135] contracter une union, échoue dans son projet ceux qui l'accompagnent prennent fait et cause pour lui et échangent des injures avec la famille qui a refusé d'accueillir leurs ouvertures. Très-souvent, même à la suite de cette déception, il résulte une mêlée effroyable des deux parts.
Les Indiens ne dispensent leurs femmes d'aucun travail, même pendant la dernière période de leur grossesse: on voit celles-ci sans cesse occupées d'une chose ou d'une autre jusqu'au moment de leur délivrance qui a lieu avec une facilité surprenante dont les a douées cette divine Providence qui n'abandonne aucun misérable. Lorsqu'elles sentent que leur enfant va venir au monde, elles se transportent au bord de l'eau et se baignent avec lui dès qu'il a vu le jour. Elles ne se font jamais aider dans ces circonstances si difficiles pour les femmes Européennes; puis sitôt qu'elles sont délivrées, elles reprennent le cours de leurs occupations journalières sans qu'aucune indisposition résulte jamais d'un semblable traitement.
Chez ces êtres presque primitifs les enfants[Pg 136] ne sont pas à beaucoup près aussi nombreux qu'on serait porté à le croire; car l'existence d'un nouveau-né est soumise à l'appréciation du père et de la mère qui décident de sa vie ou de sa mort.
Leur superstition leur fait regarder comme des divinités les enfants phénomènes principalement ceux qui naissent avec un plus grand nombre de doigts que celui voulu par la nature, soit aux pieds soit aux mains. Selon eux c'est un présage de grand bonheur pour leur famille. Quant à ceux qui sont tout-à-fait difformes (le cas est rare) ou dont la constitution ne leur paraît pas propre à résister à leur genre d'existence, ils s'en défont en leur brisant les membres ou en les étouffant, puis ils les portent à quelque distance où ils les abandonnent sans sépulture aux chiens sauvages et aux oiseaux de proie. Si l'innocent petit être est jugé digne de vivre, il devient dès l'instant l'objet de tout l'amour de ses parents qui au besoin se soumettraient aux plus grandes privations pour satisfaire à ses moindres besoins ou à ses moindres exigences. Ils étendent leur nouveau-né sur une petite échelle qui lui tient[Pg 137] lieu de berceau. La partie supérieure de son petit corps repose sur des traverses ou échelons rapprochés les uns des autres et garnis d'un cuir de mouton, tandis que la partie postérieure s'emboîte dans une sorte de cavité que forment les autres échelons placés au-dessous des montants. L'enfant est maintenu dans cette position par des lannières fort souples enroulées en dessus des cuirs qui lui tiennent lieu de linge.
La longueur de ce berceau dépasse celle de l'enfant d'environ un pied à chaque extrémité. Aux quatre coins sont attachées d'autres lannières qui servent à le suspendre horizontalement durant la nuit au-dessus du père et de la mère auxquels un autre cordon de cuir permet de bercer cette petite créature sans se déranger. Tous les matins, ces petits êtres sont rendus à la liberté de mouvement pendant le temps nécessaire à l'entretien de leur propreté; ou bien encore, lorsqu'il fait du soleil, leur mère les étend sur une peau de mouton pour qu'ils acquièrent la force et la vigueur que leur communique cet astre bienfaisant. Lorsqu'il pleut ou qu'il[Pg 138] fait froid, ils restent emmaillottés et dans l'intérieur du roukah; ils sont placés verticalement, adossés à l'un des montants de la tente, de même qu'une échelle appuyée au long d'un mur. Leur mère se tient en face d'eux, les regardant sans cesse et leur donnant fréquemment le sein, ou bien encore des petits morceaux de viande sanglante qu'ils sucent.
Les femmes allaitent leurs enfants jusqu'à l'âge de trois ans; si pendant ce temps elles en ont d'autres, elles n'en continuent pas moins de les nourrir avec le nouveau-venu, sans qu'elles ni eux en souffrent aucunement. Les moindres caprices de ces petits êtres, sont des lois pour les parents et pour leurs amis, qui à l'exemple des père et mère se soumettent à toutes leurs volontés. A peine ces enfants commencent-ils à se traîner sur les mains, qu'on laisse déjà à leur portée couteaux et autres armes, dont ils se servent indifféremment pour frapper ceux qui les contrarient, à la grande satisfaction des parents qui, dans ses colères enfantines, se plaisent à voir le germe précoce des qualités[Pg 139] voulues pour faire un bon ennemi de la chrétienté.
Les seules indispositions communes aux enfants sont des douleurs dans les membres et une espèce de croup. Leurs douleurs sont traitées par le massage et les douches froides. Le remède qu'emploient les Indiens pour la guérison du croup est assez violent: il consiste en un mélange d'urine putréfiée au soleil, sorte d'alcali, et de poudre à tirer provenant de quelque pillage; ou bien à défaut de poudre d'alcali seul. Il n'est jamais administré plus d'une cuillerée à l'enfant. L'effet de ce remède violent se traduit promptement sous forme de vomissements, et la guérison est généralement complète au bout de quelques heures. Parfois, j'ai vu les enfants tout à coup couverts de boutons d'une cuisson et d'une démangeaison insupportables qui leur faisaient pousser d'horribles cris et verser d'abondantes larmes; alors, immédiatement leurs mères s'empressaient d'embraser quelques—mey veca—bouses de vaches sèches dont elles employaient la cendre brûlante à les frictionner en même temps qu'elles leur mouillaient le[Pg 140] corps avec de l'eau renfermée dans leur bouche. A en juger par l'inquiet empressement que déploient les Indiennes à traiter ainsi leurs enfants, j'ai tout lieu de penser qu'elles redoutent beaucoup les suites de ces éruptions subites qui ont, du reste, toute l'apparence de la petite vérole.
A quatre ans, car les Indiens comptent par années d'un hiver ou d'un printemps à l'autre, ils soumettent leurs rejetons, garçons et filles, à la cérémonie du percement d'oreilles, qui fait aussi époque dans leur vie que le baptême chez nous. Cette cérémonie a lieu comme il suit. Le père fait don à son enfant d'un cheval brun rouge, dont les allures plus ou moins douces sont en rapport avec son sexe. On le renverse sur le sol, les pieds fortement liés, au milieu de nombreux invités en costume de fête, parmi lesquels figurent au premier rang tous les parents. L'enfant dont on a orné tout le corps de peintures bizarres est couché sur le cheval, la tête tournée vers l'Orient, soit par le chef de la famille soit par le cacique de la tribu quand il lui plaît d'honorer la fête de sa[Pg 141] présence. Les femmes placées au second rang entonnent un chant criard et monotone, dont chaque strophe se termine en un ton grave et sourd ayant pour but d'implorer la protection de Dieu. Durant ce temps a lieu le percement des oreilles qui s'opère avec un os d'autruche bien effilé. Dans chaque trou le président de la fête passe un morceau de métal d'un poids suffisamment convenable pour agrandir ces trous et pour allonger les oreilles. Ensuite il s'arme du même os d'autruche et fait à chacun des assistants une incision dans la peau, soit à la naissance de la première phalange de la main droite, soit au défaut du jarret droit. Le sang qui sort de cette blessure est offert à Houacouvou—Dieu directeur des esprits malfaisants—pour le conjurer d'accorder une heureuse et longue existence au nouvel élu. Après quoi, ainsi qu'il est d'usage dans toutes leurs fêtes, une jument grasse fait le menu d'un festin offert à la réunion. Les os des côtes sont de préférence donnés aux plus proches ou aux plus intimes qui, après les avoir convenablement rongés, les déposent aux pieds de l'enfant, s'engageant[Pg 142] ainsi à lui faire un don quelconque dans le plus bref délai. Ces cadeaux consistent en chevaux, bœufs, éperons ou étriers d'argent qui lui constituent une dot.
L'éducation sérieuse des enfants commence sitôt après la cérémonie du percement d'oreilles. Lorsqu'ils atteignent leur cinquième année, ils montent seuls à cheval en se saisissant à la crinière et en appuyant tour à tour leurs petits pieds sur les jointures de la jambe droite de leurs coursiers; le plus souvent ceux-ci partent comme un trait emportant ainsi leurs cavaliers avant qu'ils n'aient pris le temps de s'installer complètement. A cet âge, les enfants se rendent déjà fort utiles et gardent le bétail. Ils deviennent bien vite experts dans l'art de jeter le lazzo et de lancer la boléadora; ensuite ils apprennent à manier la lance et la fronde; en sorte qu'à dix ou douze ans, époque à laquelle ils ont certes plus d'apparence et de force qu'un Européen de vingt à vingt-cinq ans, leur éducation étant complète, ils prennent part aux excursions des tribus et participent aux razzias dans lesquelles ils se montrent généralement[Pg 143] d'une témérité et d'une audace incroyables.
Quelques femmes suivent assez souvent leurs maris dans ces lointaines expéditions; notamment celles des caciques. Leur rôle consiste à rassembler avec l'aide de leurs enfants tous les troupeaux épars et à les entraîner avec prestesse, tandis que la horde est aux prises avec les soldats ou avec les fermiers.
On ne saurait s'imaginer quelle adresse et quelle bravoure les Indiens déploient en ces circonstances, quoique munis seulement d'armes tout-à-fait primitives. Ils ne reculent jamais devant une armée de troupes régulières; la fusillade, le canon même, ne suffisent pas toujours pour les repousser dans leurs agressions. Ils se meuvent en tous sens sur leurs chevaux avec une facilité et une promptitude telles, que maintes fois, lorsqu'on les croit atteints de blessures, on est tout étonné de les voir s'avancer de nouveau plus menaçants encore, faisant voltiger leurs lances avec une vélocité et une adresse diaboliques. Lorsqu'ils sont aux prises avec la cavalerie espagnole ils témoignent de[Pg 144] leur joie en poussant des cris féroces et effrayants. Ils lancent souvent devant eux des chevaux indomptés à la queue desquels ils attachent des lambeaux de cuirs secs ou des herbes enflammées qui leur donnent un accès de folle frayeur bientôt communiquée à ceux des soldats sur lesquels ils vont fondre comme un terrible ouragan. Profitant de ce désordre, les Indiens se ruent spontanément sur les restes épars des escadrons et les achèvent dans un sanglant carnage. Quant à l'infanterie, dont ils font fort peu de cas, car les soldats argentins sont de si mauvais tireurs qu'ils semblent avoir peur de leurs armes à feu, ils ne l'attaquent qu'en dernier lieu et l'anéantissent promptement.
Lorsque quelques Indiens tombent dans la mêlée, ils sont relevés par leurs compagnons qui les ramènent chez eux et les soignent en chemin; s'ils succombent pendant le trajet ils sont enterrés sans aucune cérémonie; mais ceux qui meurent sous la tente, au sein de leurs foyers sont inhumés avec pompe.
Quelle que soit la manière dont un Indien[Pg 145] quitte ce monde, les autres se refusent de croire à sa mort; ils prétendent que lassé de vivre toujours sur cette terre, leur compagnon désireux de visiter d'autres régions, connues de lui seul, les abandonne uniquement dans ce but. Ils le revêtent de ses plus beaux ornements et l'étendent sur le cuir qui lui a servi d'abri. A chacun de ses côtés, ils placent ses armes et ses objets les plus précieux; après quoi ils l'enroulent dans ce cuir et l'attachent fortement à de courts intervalles avec son propre lazzo. Ils placent cette sorte de momie sur son cheval favori, auquel ils rompent préalablement la jambe gauche de devant, afin que par ses génuflexions forcées il ajoute encore à la tristesse de la cérémonie. Aux veuves du défunt se réunissent toutes les femmes de la tribu; elles poussent des cris lamentables et pleurent ensemble, en s'interrompant de temps à autre pour faire entendre un chant de circonstance dans lequel elles font l'éloge du défunt et lui reprochent amèrement son ingratitude d'avoir abandonné ses femmes, ses enfants et ses amis. Les hommes, mornes et silencieux, les[Pg 146] mains et la figure peintes en noir, avec deux grandes taches blanches au-dessous des paupières, escortent à cheval le corps, jusqu'à la la plus prochaine éminence au sommet de laquelle ils creusent une sépulture peu profonde. Une fois que le corps y est enfoui, ils abattent sur l'emplacement même, d'abord le cheval porteur des dépouilles de son maître et plusieurs autres ainsi que quelques moutons destinés, selon leur superstition, à servir d'aliments au défunt pendant tout le trajet qu'il doit effectuer pour atteindre le but de son voyage. Les objets de non valeur laissés par le défunt deviennent la proie des flammes, afin d'effacer de lui tout souvenir. Les femmes, après avoir pendant plusieurs jours de suite donné des marques de la plus profonde douleur en se frappant la tête du poing et en s'arrachant les cheveux, accompagnent les veuves au domicile de leurs parents respectifs où elles sont tenues de rester plus d'un an sans contracter aucune liaison ni d'autre union, sous peine de mort pour elles et leurs complices; usage auquel elles se conforment scrupuleusement.
[Pg 147]
On comprend que ce ne fut pas, pour un esclave comme je l'étais, l'affaire de quelques jours, ni même de quelques mois, que de recueillir les diverses observations que je mets aujourd'hui sous les yeux du lecteur.
Tombé, ainsi que je l'ai dit entre les mains des Poyuches; après avoir été tout d'abord entraîné dans les plaines froides, sauvages et stériles du sud, où les vents impétueux et les révolutions subites de l'atmosphère, caractères inhérents aux extrémités polaires des grands continents, se manifestent avec plus de violence peut-être que sur un autre point péninsulaire du globe; après plusieurs mois, vendu par mon premier maître à un second, puis à un troisième, ainsi qu'on l'a vu; de vente en vente, de tribu en tribu, je fus insensiblement ramené vers le nord en deçà du Colorado. Changer de place n'était changer ni de condition ni d'occupation. Tous les jours s'écoulaient pour moi longs et tristes, et au sein des Pampas mes souffrances s'accrurent encore de la fastidieuse surveillance à laquelle j'étais soumis; de sorte que ma position devint véritablement insoutenable.
[Pg 148]
Si pendant le cours de la belle saison, le splendide coup-d'œil de la fertile Pampa, et la variété de mes occupations devenaient parfois la source de quelques distractions inespérées, bien trop vite hélas, le retour de l'hiver redonnait à ces vastes plaines, désormais nues et blanches de givre, l'aspect le plus triste et le plus désolant. Durant le jour, l'immense solitude dont j'étais entouré, n'était guère troublée que par les cris aigus de quelqu'oiseau de proie s'abattant sur un cadavre en putréfaction que lui disputaient les chiens sauvages, ou bien encore par quelques troupeaux épars et par quelques groupes de nomades que l'on reconnaissait facilement à leurs longues lances ornées de plumes de nandous. Enfin la nuit, les aboiements plaintifs et prolongés de plusieurs milliers de chiens errants, les rugissements du puma et du jaguar affamés répétés au loin par de nombreux échos, composaient avec les sourds mugissements du glacial pampéro, la seule et lugubre harmonie des Pampas.
Il y avait déjà longtemps que j'étais captif, mais je ne pouvais me faire à la vie d'esclavage[Pg 149] qui m'était imposée. J'avais des maîtres directs mais cependant chacun avait le droit de me commander dès qu'il me rencontrait au camp. Je devais même la plus entière soumission aux enfants, dont le bonheur était de me faire des cruautés de toutes sortes. Ils me lançaient des pierres avec leurs frondes, ou me jetaient leurs boléadoras à travers le corps au risque de me blesser; ou bien encore lorsqu'ils étaient à cheval, ils me prenaient au lazzo par l'un des membres et s'amusaient à me traîner au galop de leurs chevaux: tout cela à la grande satisfaction de leurs parents, fort peu préoccupés du triste état dans lequel je me trouvais à la suite de ces jeux sanglants. Lorsque les Indiens s'approchaient de moi dans de bonnes dispositions d'esprit, ils s'amusaient, par pure forme de plaisanterie à me souiller le visage avec du sang ou avec n'importe ce qu'il leur tombait sous la main; quelquefois, ils me saisissaient aux cheveux et me les tiraient en tous sens, jusqu'à ce que la douleur m'arrachât quelques plaintes, ou bien jusqu'à ce qu'il leur en restât une certaine quantité entre les mains. A la suite de ce[Pg 150] divertissement qui leur est très-commun, j'avais, souvent pendant plusieurs jours, la tête enflée et endolorie, au point de ne pouvoir toucher même à ma chevelure. L'obligation dans laquelle je me trouvais de leur sourire avec un air de contentement et de gaieté, sous peine d'être plus longtemps martyrisé de la sorte, me donnait parfois des accès d'emportement qui faillirent m'être funestes. Les femmes se livrent également, soit entre elles, ou avec les hommes, à ce plaisir de bonne compagnie, sans que cela soit au détriment de leur chevelure qui résiste parfaitement à ces brusques assauts.
[Pg 151]
De la religion des Indiens
Comme j'ai déjà eu occasion de le dire, la croyance de tous ces sauvages décorés du nom d'Indiens, est identique. Ils reconnaissent deux dieux ou êtres supérieurs: celui du bien et celui du mal; ils admettent et respectent la puissance du bon Vita Ouènetrou,—le Grand Homme,—qu'ils considèrent comme le créateur de toutes choses. Ils n'ont aucune idée du lieu où il peut résider; ils prétendent seulement que le soleil, qu'ils considèrent comme son représentant, leur est envoyé par lui autant pour examiner ce qui se passe parmi eux, que pour réchauffer leurs membres engourdis pendant l'hiver et seconder la bienfaisante rosée qui, dès le printemps, fait éclore autour d'eux le[Pg 152] magnifique tapis de verdure au milieu duquel se prélassent et se multiplient leurs troupeaux. La lune, autre représentant de Dieu, est selon eux uniquement chargée de les veiller et de les éclairer. Leur persuasion est qu'il existe autant de soleils et de lunes qu'il y a de pays et de terres différentes sur le globe.
Quant au dieu du mal—Houacouvou—ils disent que c'est lui qui, sur leurs prières journalières, rode autour du pays qu'ils habitent pour écarter d'eux tout maléfice et commander aux esprits malfaisants. Ils le désignent plus souvent encore sous le nom de Gualitchou—la cause de tous les maux de l'humanité.—On trouve encore chez eux quelques devins des deux sexes qui prédisent l'avenir et dont la vocation s'annonce par des espèces d'attaques d'épilepsie que leur occasionne l'usage d'une certaine plante dont ils gardent religieusement le secret. Ils n'ont plus, comme ceux d'autrefois, la prétention de voir jusqu'aux entrailles de la terre; car plusieurs d'entre eux furent massacrés pour avoir prédit à des chefs des faits sans accomplissement.
On ne trouve parmi les Patagons, les[Pg 153] Puelches et les Pampéens, aucun prêtre ni fétiches. Les père et mère transmettent eux-mêmes la religion à leurs descendants, qui l'observent scrupuleusement. Ce fait est d'autant plus extraordinaire que chez les Kitchois et chez les Boliviens, leurs voisins, on trouve des idoles et les preuves irrécusables d'un culte intéressant, d'une origine fort ancienne.
Enfin, quelle que soit la simplicité de leur religion, la croyance des Patagons n'en est pas moins des plus profondes, ils en donnent des preuves à tous instants. Jamais un Indien ne boit ni ne mange sans avoir préalablement prié Dieu de lui accorder toutes choses nécessaires à sa vie, ni sans lui offrir la première part: il se tourne vers le soleil, envoyé de Dieu, en déchiquetant un peu de viande, ou en renversant un peu d'eau, action qu'il accompagne des paroles suivantes dont la formule sans être fixe varie cependant peu:
oh! chachai—vita ouènetrou—reyne
oh!—Père,—Grand homme,—roi de cette
mapo, Frénéan votrey—fille aneteux
terre,—fais moi faveur-cher ami,-tous les jours,[Pg 154]
—comé que hiloto—comè que ptoco,
—d'une bonne nourriture,—de la bonne eau,
-comè què omaotu,—Povrè lagan intché,
—d'un bon sommeil,—Je suis pauvre moi,
—hiloto élaemy; tefa quinié-ouésah.—hilo
as-tu faim;—voilà-un-mauvais-manger.—
hiloto tuffignay.
—mange si tu veux.
Bien qu'ils aient rarement la facilité de se procurer du tabac, les Indiens n'en sont pas moins de grands fumeurs, car ils savent économiser celui qu'ils accaparent dans leurs chanceuses razzias. Après chaque repas, comme le matin dès leur réveil et le soir même au moment de se livrer au sommeil, ils s'adonnent à ce plaisir.
Dans chaque Roukah au nombre des objets indispensables, se trouve une pipe—quitrah—de leur fabrication, dont la forme est unique pour tous. Elle est faite le plus souvent d'une pierre rouge ou bleue provenant de la chaîne des Andes, taillée en parallélogramme fort étroit, de la longueur de dix centimètres environ, et surmontée d'une saillie en forme de cône renversé, creusée[Pg 155] fort habilement avec un couteau, seulement jusqu'à moitié de l'épaisseur du parallélogramme avec lequel ce fourneau ne forme qu'une seule pièce. A l'un des bouts, qui tient lieu de galumet, ils font un autre trou d'un très-petit diamètre qui finit presque à rien à son point de jonction avec le fourneau de la pipe. Ce meuble simple, mais curieux, est généralement enrichi d'ornements faits avec des parcelles d'argent ou de cuivre fixées avec de la résine.
Les Indiens ne fument jamais le tabac seul; ils le mélangent avec de la fiente de cheval ou de bœuf sèche. La pipe étant bourrée, tous les fumeurs se couchent sur le ventre, et fument chacun à leur tour sept ou huit bouffées coup sur coup pour ne les rendre par les narines que quand, à demi-suffoqués, ils se sentent dans l'impossibilité de les garder plus longtemps. L'effet de cette exécrable fumigation intérieure les rend effrayants à voir, car leurs yeux se retournent aux trois quarts, on n'en voit plus que le blanc; ils se dilatent à un tel point, qu'on les pourrait croire prêts à sortir de leurs orbites. La pipe, qu'ils n'ont[Pg 156] plus la force de retenir, s'échappe de leurs grosses lèvres, leurs forces les abandonnent, ils sont pris d'un tremblement convulsif et plongés dans une ivresse voisine de l'extase; ils renaclent bruyamment, en même temps la salive s'échappe à flots de leurs lèvres entr'ouvertes, et leurs pieds et leurs mains sont agités de mouvements semblables à ceux d'un chien à la nage.
Cet horrible et répugnant état d'abrutissement volontaire fait leur bonheur; il est l'objet de toutes leurs respectueuses sympathies; ils n'auraient garde de troubler les fumeurs pendant leur ivresse et considèreraient comme une insulte de leur rire au nez ou même de leur adresser la parole. Ils s'empressent de leur apporter de l'eau dans une corne de bœuf—motah—qu'ils plantent silencieusement dans le sol à côté d'eux.
Dieu, selon l'habitude, participe à cette réjouissance, car il lui a été préalablement offert par chacun trois ou quatre petites bouffées accompagnées d'une prière mentale.
Après avoir vidé tout d'un trait l'eau contenue[Pg 157] dans le—motah,—les fumeurs, encore sous l'impression de leur récent anéantissement, ne pouvant mouvoir leurs bras ni leurs jambes, font un demi-tour sur eux-mêmes et restent couchés sur le dos pendant quelques moments pour se livrer aux douceurs du sommeil.
Les femmes, les enfants mêmes, prennent part à ce plaisir sans que nul ne songe à s'y opposer.
Parmi les fumeurs que comptent les nations Européennes, beaucoup contractent l'habitude d'absorber la majeure partie de leur fumée et ne comprendraient pas sans doute comment il se fait que les Indiens puissent ressentir les effets décrits ci-dessus, c'est pourquoi je leur dirai en passant que la cause doit en être attribuée au mélange du tabac avec des herbes odoriférantes, qui, bien que réduites à l'état de fiente, n'en conservent pas moins toute leur force.
[Pg 158]
La Médecine chez les Indiens
On ne trouve point parmi les Indiens d'individus pratiquant spécialement la médecine parce d'abord ils ne sauraient avoir suffisamment de confiance dans leurs semblables, quels que puissent être leurs liens d'amitié ou de parenté; ensuite parce que la prévoyante nature les a doués d'une intelligence et d'un instinct assez grands pour faire eux-mêmes et avec succès l'application des différents remèdes qu'elle a mis à leur portée.
Il n'est pas rare de voir chez eux des enfants à la recherche de quelques simples nécessaires à leur propre guérison. Ils sont donc, ainsi qu'on peut en juger, médecins[Pg 159] d'eux-mêmes. Je les ai souvent vus faire preuve de certaines connaissances anatomiques, soit dans la manière d'opérer les animaux ou dans celle de panser de graves blessures, telles que ruptures de bras ou de jambes. Ils sont tellement durs à la souffrance, qu'à peine dans ces cas si graves font-ils entendre quelques plaintes. Ils se pansent eux-mêmes avec le plus grand sang-froid. S'ils ont la jambe cassée, ils s'étendent à plat sur le sol de manière que la fracture ait un point d'appui. Ils replacent les os, puis se font à l'aide de quelques pierres tranchantes, dont ils ont soin de raviver les arêtes anguleuses, un certain nombre d'incisions longues et profondes autour et à l'endroit même de la rupture; ils y appliquent ensuite une sorte de cataplasme composé d'herbes fraîches écrasées entre deux pierres et arrosées d'urine putréfiée qui ne leur manque jamais et remplit chez eux l'office d'alcali: enfin ils s'éclissent avec des joncs d'eau, et restent de quinze jours à trois semaines seulement immobiles. Au bout de ce temps, ils commencent à marcher, quelquefois même ils montent déjà à[Pg 160] cheval. Les propriétés des herbes qu'ils emploient sont telles que même dans les plus fortes chaleurs aucun cas de gangrêne ne se déclare, et que si la rupture n'a pas été franche et nette, les petits éclats sortent d'eux-mêmes au dehors par les incisions, sans occasionner plus de souffrances au patient dont la complète guérison ne se trouve guère retardée que de quelques jours. Pendant tout le temps nécessaire à son rétablissement, le blessé mange avec autant d'appétit et aussi fréquemment que s'il était dans son état normal.
Les Indiens sont ainsi que leurs enfants forts sujets aux douleurs dans la moëlle, mais ils se traitent plus durement. Ils se font avec un cataouet—os d'autruche en forme de poinçon—quelques piqûres d'où ils tirent le plus de sang possible, ou bien ils y apposent des petits cônes faits avec la matière cotonneuse que fournit le palmier, et les brûlent sur place. Ces sortes de moxas leur servent souvent aussi à se faire sur les deux avant-bras, des marques dont la grandeur et le nombre variables servent à distinguer entre elles les différentes tribus.
[Pg 161]
Les Indiens sont souvent sujets à de violents maux de tête; mais ils ont le talent de les faire cesser presqu'aussitôt qu'ils leur viennent, par l'application immédiate d'une macération d'herbe dont l'odeur rappelle celle de la feuille de cassis; l'effet en est presque instantané. Lorsque ce remède ne suffit pas, (cas très-rare), ils se poinçonnent, c'est le mot, la partie affectée, et selon la nature du sang qui sort de ces piqûres, ils se livrent à une foule de conjectures sur leur santé, qui, à les entendre, est toujours fort compromise.
Lorsqu'ils sont enrhumés ou lorsqu'ils sont pris d'étouffements, les Indiens font usage d'une racine fort commune dans leurs parages, et qui par ses nombreuses propriétés mérite quelque intérêt. Ils la nomment Gnimegnime ou traîtresse chatouilleuse. Sa forme est approchant celle du chiendent, mais beaucoup plus longue et plus régulière, ne présentant pas, comme celle-ci l'aspect d'une infinité de petites lignes brisées. Son enveloppe est d'un brun clair, l'intérieur blanc; en séchant elle ne conserve aucune élasticité;[Pg 162] elle est au contraire fort cassante. La plante qui ne présente aucun intérêt, et dont les Indiens ne font point usage, car ils ne lui reconnaissent aucune propriété, a généralement de quinze à vingt centimètres de hauteur; ses feuilles étroites et longues sont d'un vert foncé; le sommet de la tige est surmonté d'une petite fleur jaune. Un seul bout de cette racine de la longueur d'une épingle, écrasé entre les dents et mêlé à la salive, surexcite la fonction des organes respiratoires et mûrit le rhume à l'instant, en laissant au palais un goût acidulé qui agace les gencives, la langue et le gosier d'une démangeaison insupportable et produit une douleur dans les glandes salivaires dont elle active les fonctions outre mesure. Dès que la partie acidulée est complètement absorbée, on éprouve un véritable bien-être par tout le corps et une agréable fraîcheur dans la gorge, il semble que les poumons soient dégagés et l'on respire avec beaucoup de facilité. Cependant ce remède, ainsi que tant d'autres, devient dangereux lorsqu'il est employé sans calcul. Les Indiens m'ont affirmé qu'une petite[Pg 163] pincée suffit pour faire mourir dans les plus atroces souffrances. Je le crois en effet, car voulant en faire moi-même l'épreuve, j'avalai le jus d'un petit bout de cette racine, qui me causa dans la bouche et dans la gorge une démangeaison insipide; ma respiration devint tellement haletante et précipitée que, ne pouvant aspirer l'air dont la présence me mettait au supplice, je faillis être suffoqué. Je puis affirmer qu'on serait douloureusement asphyxié en surpassant la dose voulue. Ce ne fut qu'en me gardant bien de boire, et en retenant ma respiration, ainsi que le font les Indiens eux-mêmes, que je parvins à neutraliser les effets de ce remède violent.
Les Indiens emploient cette racine de différentes manières et dans différents cas; tant pour eux-mêmes que pour les animaux. Pour les maux d'yeux ils n'emploient que le jus. Ils s'en servent également pour détruire la vermine qui envahit les plaies de leurs chevaux ou de leurs autres bestiaux; ce qui est très-fréquent dans les parages boisés où les mouches abondent. Ils la réduisent en[Pg 164] poudre presque impalpable et la mélangent avec les feuilles brûlées d'un petit arbrisseau qu'ils nomment tchilpet; ils font de ce mélange une pâte mouillée d'urine qu'ils introduisent dans la plaie après en avoir préalablement extirpé un à un tous les vers à l'aide d'un petit bâton pointu et après l'avoir lavée à plusieurs reprises avec de l'urine putréfiée. Quelques répétitions de cette opération suffisent pour que la guérison ait bientôt lieu. Je traitai ainsi avec bonheur plusieurs chevaux confiés à ma garde lesquels s'étaient fait de simples piqûres d'épines changées le lendemain en plaies déjà aussi grandes que la main: les Indiens me surent bon gré de ces soins auxquels je me livrais journellement, sans quoi leurs troupeaux auraient sensiblement diminué; car ils sont tellement paresseux et insouciants que tout animal blessé pendant les chaleurs, devient, en deux ou trois jours à peine, la victime des insectes rongeurs.
Les Indiens se nourrissant pour la plupart du temps de viandes crues, leur sang est par cela même rempli d'âcreté, et comme ils dorment[Pg 165] fréquemment sur la terre humide ils ont presque tous des éruptions tuméreuses qui se traduisent en forme de clous ou d'entraxes dont ils souffrent beaucoup. Ils provoquent la maturité de ces abcès par l'application de cataplasmes de fiente d'animaux, toute chaude. Lorsqu'ils sont à terme, ils en extirpent le germe à l'aide d'un crin doublé, et le mangent ensuite entre deux bouchées de viande, prétendant ainsi conjurer toute récidive. N'est-il pas en vérité répugnant de trouver de si grands rapprochements entre des êtres humains et les chiens qui n'ont à leur service d'autre organe que la langue.
Quand les Indiens sont atteints de maladies contre lesquelles les remèdes sont sans effet, ils en attribuent la gravité à la malignité de quelque mauvais génie—gualiche,—qui échappant à la vigilance de Houacouvou—dieu du mal,—s'est réfugié dans le corps du patient. Afin de l'en faire déloger ils se réunissent en grand nombre, à l'insu du malade, et se précipitent tout-à-coup, armés de leurs lances, sur le roukah de celui-ci en frappant les cuirs de toute leur force et[Pg 166] poussant des hurlements de fureur qu'ils entremêlent d'invocations. Ensuite ils pénètrent dans l'intérieur en se trouant au travers des cuirs un passage, et défilent un à un au pas de course, la lance en arrêt autour du malade que le premier entré a traîné au milieu de la case. Le malheureux patient éprouve généralement une grande frayeur et succombe presque toujours à la suite de cette violente émotion. Parfois, lorsque le sujet est jeune et qu'il parvient à se rétablir, il partage l'opinion de chacun en attribuant à quelque maléfice le dérangement de sa santé, et sa guérison au diabolique assaut que lui ont livré ses compagnons. Il est toujours accablé de questions auxquelles il répond avec emphase et fort longuement. Je ne dirai pas qu'il abuse de la crédulité de ses amis en leur faisant mille contes, car ils ne sont que l'expression de sa superstitieuse croyance.
Je fus moi-même un des principaux acteurs d'une semblable scène dans laquelle je sus plus tard avoir rempli le rôle bien involontaire de faiseur de miracles que selon eux, me valait ma qualité de chrétien. Il fallait,[Pg 167] disaient-ils que je fusse véritablement un bon ouignecaë—chrétien—pour avoir si bien réussi.
Les Indiens possèdent plusieurs genres de poisons lents dont ils connaissent et savent parfaitement neutraliser les effets. Ce sont les femmes qui s'en servent; et elles les emploient aussi bien contre leurs ennemies personnelles que contre ceux de leur famille. La jalousie est pour elles la source d'une haine implacable, aussi est-ce bien plutôt entre elles que l'usage en est fréquent. Deux femmes jalouses l'une de l'autre se donneront bien de garde de dévoiler ce sentiment à qui que ce soit, et dès l'instant où elles se sentent ennemies, elles cherchent à s'attirer l'une chez l'autre dans le but de s'empoisonner mutuellement. Ces sortes de duels durent quelque fois assez longtemps, mais l'une d'elles finit toujours par succomber. Son ennemie, après avoir pris toutes les mesures propres à faire disparaître de chez elle toutes les traces du poison dont elle a fait usage, est une des premières à gémir sur le sort de la défunte dont elle fait à tous le panégyrique. Afin de se sauvegarder[Pg 168] de toute accusation, car on ne saurait trouver contre elles aucune preuve accusatrice, elles agissent toujours sans complices.
Les Indiens ont pour habitude de faire l'autopsie de tous les trépassés dont la mort, soit tardive ou prématurée, est à leurs yeux un problème qu'ils tâchent de résoudre en cherchant avec soin dans tout l'œsophage, dans les rognons et dans le fiel où ils reconnaissent facilement la trace du principe morbide, lorsque le sujet est mort empoisonné. Quand ils acquièrent ainsi la preuve qu'un des leurs est victime d'une vengeance, ils emploient tous les stratagèmes imaginables pour découvrir l'auteur du crime. Malheur aux ennemis connus du défunt, car, seraient-ils innocents, l'opinion générale les accuse aussitôt et les parents de la victime les mettent à mort s'ils ne consentent à leur payer une forte rançon.
A moins de rares exceptions, les accusés, coupables ou non, repoussent toujours fort énergiquement l'accusation portée contre eux; ils préfèrent succomber les armes à la main en se défendant à outrance, plutôt que[Pg 169] d'avouer leur crime. Le petit nombre de ceux qui ne font aucune résistance et qui font des aveux sont conduits sous bonne escorte devant le grand Cacique qui fixe lui-même le prix de leur rançon dont l'importance est toujours proportionnée au rang du défunt, car il y a chez eux comme parmi nous différents grades dans la société.
[Pg 170]
Engraissement des chevaux.—Abattage d'un cheval.—Principale nourriture des Indiens pendant la belle saison.—Du tatou.—Un évènement tragique.
Les Indiens, grands amateurs de chevaux, estiment principalement ceux dont ils se sont déjà servis dans quelque razzia. Ces malheureux animaux éprouvés par la fatigue et les privations sont, au grand désespoir de leurs maîtres, toujours fort maigres au retour de ces expéditions. Les Indiens s'y prennent d'une manière fort étrange pour les faire engraisser. Ils les renversent sur le sol, leur entr'ouvrent la bouche, pratiquent au palais plusieurs incisions, puis ils leur font avaler de force une certaine quantité de sel pulvérisé. Ils prétendent que chez le cheval, comme chez l'homme, le sang excite l'appétit. Je ne sais[Pg 171] jusqu'à quel point ce système peut être bon; mais il est toutefois compréhensible que l'emploi du sel dans cette circonstance ne peut être que favorable. Du reste j'ai observé que les chevaux traités, comme il est dit ci-dessus, engraissaient fort rapidement.
Quant aux jeunes chevaux qu'ils destinent à leur nourriture, ils leur suppriment fort habilement les parties génitales afin de les engraisser et d'en rendre la chair plus délicate. Cette opération se fait à l'aide d'un couteau. Ils prennent la précaution de nouer les nerfs après les avoir rompus le plus avant possible; ensuite ils enlèvent toute la graisse qui pourrait retarder la fermeture de la plaie et y introduisent du sel. Cette opération étant terminée ils s'efforcent de faire courir le poulain deux ou trois fois par jour afin que le sang caillé se détache de la blessure. Malgré la brutalité avec laquelle ils opèrent, les Indiens obtiennent toujours un plein succès, car la guérison de leurs animaux a lieu dans un délai de dix à douze jours.
Les Pampéens font subir la même opération aux béliers et aux bœufs qu'ils veulent[Pg 172] vendre à la chrétienté pendant la durée de leurs soumissions passagères.
Ces sauvages abattent et découpent un cheval avec la plus parfaite adresse et la plus grande promptitude. Dès qu'il l'ont étourdi d'un coup de locayo—boléadora,—ils se précipitent sur lui et le saignent aussitôt. Les femmes en recueillent le sang dans une sibille de bois où elles le laissent refroidir après en avoir retiré l'albumine en l'agitant avec la main. Pendant ce temps les hommes retournent l'animal sur le dos, lui fendent le cuir depuis la mâchoire inférieure jusqu'à la naissance de la queue, et à chaque sabot ils font d'autres coupures qui viennent rejoindre la première, les unes à la poitrine, les autres au bas de la panse. Ils commencent à détacher le cuir du cou, du poitrail et des parties maigres avec leurs couteaux, et achèvent ce travail avec les mains seulement en le saisissant fortement de la gauche et en passant la droite entre les chairs. Quand le décollage est terminé ils séparent la tête du tronc, enlèvent les épaules, ouvrent le ventre des deux côtés à la fois jusqu'à l'extrémité des côtes qu'ils[Pg 173] séparent tout d'une pièce de la colonne vertébrale après en avoir entamé la naissance avec la pointe de leurs couteaux. Enfin, sans le secours de haches ni de marteaux, ils partagent en deux parties égales le train inférieur. En moins de dix minutes tout cela est fait, et les nombreux spectateurs, installés sur l'emplacement même, dévorent avec une avidité féroce les foies chauds, le cœur, les poumons et les rognons crus, qu'ils saucent dans le sang et qu'ils boivent ensuite.
Le cuir de la tête sert à faire des enveloppes de boléadoras; la crinière est soigneusement attachée avec la queue et réservée ainsi que les plumes d'autruches et les peaux de toutes sortes pour être échangée chez les Hispanos-Américains.
Bien qu'ils aient la possibilité de tuer journellement des bestiaux, les nomades ne mangent guère durant l'été d'autre viande que celle du gibier de leurs chasses. S'ils abattent quelqu'animal pendant les chaleurs, ils en font sécher la viande en la découpant artistement en grandes feuilles minces qu'ils[Pg 174] placent sur des lazzos tendus, après les avoir salées des deux côtés. Les femmes, que ce soin regarde, en font généralement de grandes provisions, soit pour offrir aux visites ou pour donner à emporter à leurs maris lorsqu'ils vont en expédition. Quand elles servent de ce mets au sein du foyer elles l'humectent avec de l'eau mise dans leur bouche et qu'elles soufflent dessus; puis elles l'écrasent entre deux pierres et la mettent dans de petits plats de bois contenant de la graisse de cheval liquéfiée au soleil que leurs convives boivent avec grand plaisir après avoir mangé. Ces sortes de repas auxquels je pris part moins souvent que je ne l'eusse désiré me causèrent presque autant de joie que le meilleur festin; comparés à ceux de viande crue et sanglante que je faisais la majeure partie du temps, ils me parurent un vrai régal.
Dans de certains parages la chair du tatou est presque la seule nourriture des voyageurs. Dans toute la Pampa comme dans certaines régions boisées, je remarquai les quatre espèces suivantes: La première est le tatou[Pg 175] Emcombert, en espagnol kirkincho, en indien cofeurle; la seconde est le dasypus-tatouay, en espagnol péluda, dont la grosseur atteint de très-grandes proportions et dont la carapace est à toutes ses articulations plantée de longues soies. Ce quadrupède domine principalement du côté oriental, où il trouve pour se nourrir une grande quantité de racines que les Indiens nomment saqueul. Ce sont de petits tubercules blancs, demi-transparents, dont l'intérieur est farineux, demi-âcre et demi-sucré, mais dont l'âcreté disparaît à la cuisson. Ces tubercules qui ne se trouvent que dans la terre noire et grasse, à quelques pouces de profondeur, sont toujours groupés par trois ou quatre attenant à la même tige. Ils ont la forme d'ovales ou de polygones de la grosseur d'une noisette. Leur tige n'a guère plus d'un ou deux pouces de hauteur. Elle est très-frêle et garnie d'un grand nombre de petites feuilles étroites fort pressées les unes sur les autres, dont la couleur est tout à la fois mélangée de vert d'eau et de rouge jaunâtre.
Les Pampas sont aussi gourmands du saqueul[Pg 176] que les tatous eux-mêmes. Ils en récoltent parfois une grande quantité et les écrasent pour les mettre dans du lait; ils nomment cette préparation qu'ils laissent fermenter saqueul-tchaffis; c'est un mets rafraîchissant fort agréable et des plus nourrissants. Quelquefois les Indiens avant d'écraser le saqueul pour le mêler au laitage, ainsi qu'il est dit plus haut, le laissent pendant quelques secondes cuire dans de la fiente embrasée. La péluda fait un grand ravage de ce tubercule; elle le sent comme les porcs sentent les truffes.
La troisième espèce, le cachicame-mulet, que les Espagnols appellent mulita n'est aucunement garni de poil. Il diffère des deux espèces ci-dessus désignées par la forme de sa tête et de ses oreilles qui ont beaucoup d'analogie avec celle de la mule. On le trouve par quantités innombrables dans le voisinage des provinces Argentines et particulièrement au nord-ouest de Buenos-Ayres où il infeste les estancias-fermes dont les abords sont généralement jonchés de cadavres de bœufs délaissés par les fermiers qui la plupart du temps ne les tuent rien que pour en avoir le[Pg 177] cuir et dont la chair sert de pâture à ces animaux.
La quatrième espèce appelée mataco par les Espagnols est beaucoup moins commune que toutes les autres. Elle ne se trouve guère qu'à l'ouest sud-ouest de la Sierra-Ventana ou bien encore au nord des Mamouelches. Sa grosseur est presque toujours la même et n'atteint jamais de grandes dimensions. Il est fort élevé sur pattes et court tellement vite qu'on a souvent beaucoup de peine à l'attraper. Son dos est fort bombé, sa tête très-aplatie et fort petite. Ainsi que le tatouay il se nourrit de la racine du saqueul. Il est très-facile à apprivoiser. Quand il se sent serré de trop près et qu'il est éloigné de son terrier, ses naïfs moyens de défense consistent à se mettre en boule à l'instar du hérisson. La chair de tous ces genres de tatous se mange; quoique noire, elle est des plus délicates et a beaucoup de rapport avec celle du porc frais, mais elle est beaucoup plus légère. Ces animaux ont entre leur carapace et leur chair une épaisse couche de graisse jaune très-fine, d'une grande saveur et dont[Pg 178] la couleur ainsi que celle de leur chair est plus ou moins foncée selon l'espèce de l'animal et son genre de nourriture. C'est peut-être la seule viande que les Indiens fassent bien cuire car ils font rôtir les tatous dans leur carapace et sans les en détacher.
Cherchant chaque jour à m'attirer les bonnes grâces des sauvages avec lesquels je vivais déjà depuis plus d'un an et demi je parvins non sans une pénible lutte de tous les instants à faire une complète abnégation de mes habitudes d'homme civilisé et à les copier en quelque sorte. Je devins habile dans tous leurs genres d'exercices: je domptais leurs chevaux et je les leur soignais si bien quand ils étaient blessés ou malades que presque toujours ils étaient dans un état de santé très-satisfaisant. C'était du reste pour moi un véritable bonheur que de prodiguer des soins à ces pauvres animaux que mes maîtres, indolents, malgré leur sordide avarice, eussent sans doute abandonnés lorsqu'ils étaient blessés. J'éprouvais un plaisir indicible à voir avec quelle docilité, ils venaient à ma voix, au lieu de fuir précipitamment ainsi qu'ils le faisaient[Pg 179] dès que quelque autre s'approchait d'eux. D'aussi loin qu'ils m'apercevaient, ces chevaux se mettaient à hennir et venaient, au grand ébahissement des Indiens qui m'en félicitaient, se ranger à mes côtés pour recevoir mes caresses. Dans ces moments de délassement où toute affection me faisait défaut, je me sentais presque heureux de ce sentiment d'instinctive reconnaissance de leur part qui avait pour moi tout le prix de l'amitié.
Mes maîtres souvent étonnés de la facilité avec laquelle j'attrapais les chevaux à la main, chose si impossible pour eux qui les poursuivaient toujours avec le lazzo, me disaient avec une amicale considération lorsqu'ils en voulaient un: El mey-ouésah ouignécaé cone-palèh-quinié potro.—Amène-nous tel ou tel cheval, toi qui en fais ce que tu veux;—et pour me récompenser à mon retour, ils me faisaient manger quelques bouchées de viande qu'ils avaient fait cuire à mon intention. Malheureusement ces rares instants de douceur étaient de bien courte durée, car leur instinct cruel reprenait bien vite le dessus,[Pg 180] et ils me les firent plus d'une fois chèrement payer.
J'avais eu déjà successivement plusieurs maîtres depuis que j'étais chez les Pampéens, lorsqu'un incident tragique et des plus affreux vint me donner une terrible leçon de prudence et me commander la plus grande dissimulation. Dans une récente et formidable invasion qu'ils avaient faite dans la province de Buenos-Ayres et sur laquelle les journaux français donnèrent des détails (en 1858), de jeunes Argentins avaient été faits prisonniers. Leur sort devait être le mien: mais ces malheureux enfants, confiants dans leur habitude du cheval et dans leur habileté à s'orienter dans les pampas voisines de leurs provinces, conçurent la pensée de recouvrer leur liberté, sans tenir aucun compte des dangers auxquels les exposait leur inexpérience sur le caractère des Indiens. Ils s'enfuirent un beau matin, mais leurs maîtres les poursuivirent bientôt; après quelques jours d'absence ils les ramenèrent au point de départ et les condamnèrent à mourir. Ils furent placés au milieu d'un cercle d'hommes à cheval qui les assassinèrent lentement[Pg 181] à coups de lances. Forcé d'être spectateur de cette horrible scène, je vis les meurtriers, par un ignoble raffinement de cruauté, retourner leurs armes dans chacune des blessures dont ils couvrirent le corps de leurs victimes, tout en poussant des hurlements de féroce colère et en imitant les diverses expressions de souffrances de leurs figures. Ils vinrent ensuite défiler devant moi et m'apostrophèrent brutalement en m'essuyant sur le corps leurs armes rougies du sang encore fumant de ces pauvres infortunés; et me les montrant avec affectation ils me menacèrent de la même destinée s'il me prenait envie de fuir un jour. Dans l'impossibilité où j'étais de secourir mes malheureux compagnons d'infortune, force me fut de refouler au fond de mon cœur tout désir de les défendre ou de les venger; mais ma haine et mon horreur pour les Indiens s'accrurent encore de toute l'énormité du crime dont j'avais été témoin.
Dieu sans doute permit que le souvenir des miens et celui de toutes les horribles souffrances que j'endurais chaque jour raffermissent[Pg 182] mon courage et me donnassent la ferme volonté de m'affranchir du joug infâme sous lequel je ne pliais que forcément, car désormais je n'eus plus d'autre pensée. Je ne montrai plus aux Indiens qu'un visage calme et impassible, ne laissant un libre cours à ma continuelle douleur que durant la nuit et pendant les rares instants où je me trouvais seul. Ayant pensé que les Indiens continueraient leurs conversations en ma présence, tant que je paraîtrais ignorer leur langage, je feignis de ne point les entendre et je m'occupais de choses indifférentes pendant leurs entretiens dans lesquels je recueillis une foule de renseignements précieux.
[Pg 183]
La musique chez les Indiens.—Leurs divers instruments.—Jeux.
Le goût de la musique est inné chez tous les êtres humains. Le sauvage aussi bien que l'homme civilisé aime à chercher dans ses harmonieux accents et le sentiment de la poésie et les émotions que l'âme la plus perverse même ressent et sait savourer.
Rien de plus curieux et de plus intéressant que de voir les Indiens dont je parle, ignorant toutes choses, s'appliquer à façonner des instruments de musique pour charmer leur oisiveté. Ces instruments grossiers et bizarres rappellent en quelque sorte les nôtres, je les appellerai: le flageolet, le violon, la guitare, le tambour et la flûte.
Le violon se compose de deux côtes de[Pg 184] cheval en forme d'archets enchevêtrés, et dont les crins bien tendus, humectés de salive, se frottent les uns contre les autres. Ils servent indifféremment, à tour de rôle, d'archet ou de violon. Celui qui remplit l'office d'instrument s'appuie sur les dents serrées et se tient horizontalement de la main gauche. Les Indiens agitent vivement l'archet et au moyen de ce frottement obtiennent des sons étouffés qu'ils modulent avec les doigts libres de la main gauche, absolument de la même manière que le font nos dilettanti. Ils ne peuvent toutefois exécuter aucun air varié, mais ils reproduisent assez habilement quelques mots de leur langage guttural.
La guitare leur sert fort peu; elle est faite d'une omoplate de cheval sur laquelle ils tendent des cordes de crins de différentes grosseurs. Elle est généralement mise en usage dans les danses: ils la tiennent et la pincent avec autant de prétention que s'ils étaient des musiciens consommés. On peut juger par sa construction de toute l'harmonie de cet instrument bien plutôt fait pour agacer les nerfs et l'oreille que pour charmer.
[Pg 185]
Le flageolet est de quelque mérite et réclame pour sa confection une certaine dose d'intelligence et de l'adresse. C'est aussi celui que les Indiens réussissent le mieux, et avec lequel ils se divertissent le plus car il leur permet de jouer tous leurs airs favoris. Il est fait d'une tige creuse de générium-argentinus, coupée d'une longueur de cinquante à soixante centimètres, qu'ils percent superficiellement à l'un des bouts, de huit trous à égale distance les uns des autres. Le bout opposé sert d'embouchure: ils le fendent en forme d'anche dont ils maintiennent l'écartement à l'aide d'un crin transversal.
La flûte n'est autre chose qu'un morceau de jonc creux bouché à l'une de ses extrémités, dans lequel ils soufflent à pleins poumons et duquel ils tirent des sons exécrables semblables à ceux d'une formidable clé.
Enfin le tambour se compose d'une sorte de sébille de bois plus ou moins grossière sur laquelle ils tendent une peau de chat sauvage ou un morceau de panse de cheval. Cet instrument, ainsi que la flûte pour laquelle ils ont beaucoup de prédilection, est d'un[Pg 186] usage fort répandu chez eux, surtout dans les grandes fêtes réservées au culte et dans leurs danses de caractère.
Ainsi qu'on a pu en juger, les Indiens malgré leur apparence grave saisissent toutes les occasions de se distraire et se créent mille moyens de le faire. A leur passion pour la musique on peut en ajouter une autre qui n'est pas moins vive, c'est celle du jeu, auquel ils s'adonnent avec une avidité fébrile.
Dans les tribus Pampéennes, les plus rapprochées des peuples Hispanos-Américains, ils jouent aux cartes espagnoles; mais nul d'entre eux ne saurait être plus consciencieux que des grecs de profession. Ils font aux angles de chaque carte des marques presque imperceptibles, que seuls leurs yeux exercés peuvent reconnaître. Chaque partner emploie à tour de rôle son jeu ainsi préparé. En mêlant les cartes ils distinguent les bonnes des mauvaises et sont si adroits dans la manière de les donner, qu'ils se défont toujours de ces dernières aux dépens de leurs adversaires. Les parties qu'ils engagent sont toujours d'une fort longue durée[Pg 187] et des plus acharnées; celui qui a la priorité se considère toujours comme ayant loyalement gagné, en raison des difficultés qu'il lui a fallu surmonter pour extorquer la mise des autres qui consiste généralement en objets d'une certaine valeur, tels qu'éperons ou étriers d'argent.
Les autres jeux qui leur sont propres, et qui sont le plus en vogue dans toutes les tribus indistinctement, sont: la Tchouëkah ou Ouignou, les dés—Amouicah—ou de blanc et noir, et les osselets—foros.—
Dans le jeu de Tchouëkah chaque homme entièrement nu, le corps bigarré de couleurs diverses, les cheveux relevés et fixés par un bandeau d'étoffe, s'arme d'une pesante canne appelée Ouignou, recourbée à l'une de ses extrémités, et cherche pour adversaire un de ses congénères disposé à exposer un enjeu équivalant au sien; un parti dépose sa mise d'un côté et l'autre à l'opposé. La longueur de l'emplacement, calculée selon le nombre de joueurs est limitée par des lances plantées deux à deux. Les joueurs prennent place par couples de partners vis-à-vis l'un de[Pg 188] l'autre. Une petite boule de bois est placée entre les deux formant le centre de la ligne. Alors les deux champions croisent leurs cannes, la partie crochue reposant sur le sol, de manière qu'en les tirant fortement à eux, ils font rebondir la boule prise entre les parties recourbées. Une fois lancée c'est à qui la rattrapera au vol, soit pour lui donner un nouvel élan avec la canne dont ils se servent comme de raquette, soit pour la détourner et lui faire prendre une route opposée à celle que cherche à lui donner le parti contraire. Si celui qui, dans l'intérêt de son parti, doit la faire aller à droite la fait aller à gauche, il est immédiatement forcé de se tirer les cheveux avec le premier venu de ceux auxquels il a fait tort. Rarement ces divertissements se passent sans jambes ou bras cassés ou même têtes très-grièvement lésées. Encore je ne tiens pas compte des coups que les juges du camp armés de larges lannières de cuir, déchargent du haut de leurs chevaux, sur les combattants fatigués, pour leur rendre la force et la vigueur.
Le jeu de dés ou plutôt le jeu du blanc et[Pg 189] du noir se compose de huit petit carrés d'os, noircis d'un côté, et se joue deux à deux. Un cuir est placé entre les joueurs afin que leurs mains puissent facilement saisir d'une seule fois ces petits carrés qu'ils laissent retomber en criant très-fort et en frappant dans leurs mains de manière à s'étourdir mutuellement. Toutes les fois que le nombre des noirs est pair, le joueur peut recommencer jusqu'à ce qu'il devienne impair; alors l'autre prend son tour. La partie pourrait durer éternellement, mais fatigué et étourdi l'un des deux devient la dupe de l'autre qui doué de plus de sang-froid marque souvent double, à l'insu de son compagnon, et le gagne. Des rixes suivent de près la fin de la partie, car les trois quarts du temps le perdant se refuse à donner l'objet perdu.
De même que les gauchos de Buenos-Ayres, qui dans leur acharnement au jeu perdent tour à tour leurs chevaux et jusqu'à leurs propres vêtements, les Indiens jouent volontiers leur bétail en entier et jusqu'aux captifs et captives qu'ils possèdent. C'est ainsi que je vis en maintes circonstances de malheureuses[Pg 190] jeunes filles passer de mains en mains et subir les outrageantes caresses d'un grand nombre de maîtres qui pour vaincre leur résistance désespérée leur administraient force mauvais traitements.
[Pg 191]
Projets de fuite.—Désespoir.—Changement de position.—Je deviens secrétaire des Indiens.
Quel est celui qui à la vue des souffrances des malheureuses victimes dont je parle, n'aurait point, comme moi, senti ses propres douleurs s'effacer pour faire place à une profonde indignation et au désir de protéger ces pauvres femmes. Que de fois, animé de ce sentiment et tout prêt à m'élancer à leur secours, la triste réalité de ma position ne vint-elle pas en se dévoilant à mes yeux dans toute son étendue, paralyser jusqu'à ma volonté! Qu'aurais-je pu faire d'ailleurs? Quelles auraient été les suites de mon emportement? La mort d'un Indien peut-être, et j'aurais causé celle de tant de victimes, que dans notre intérêt[Pg 192] commun je considérai comme un devoir de redoubler de prudence.
Je songeai également plus d'une fois à m'enfuir en emmenant quelques-unes de ces malheureuses captives, mais forcé de reconnaître le peu de certitude qu'offrait la réussite de ces sortes de projets, je dus y renoncer. Pour moi seul, j'aurais risqué sans aucune hésitation d'affronter les périls d'une semblable entreprise, car je me sentais en état de galoper jours et nuits et de vendre chèrement ma vie en cas de poursuite, mais avec des femmes, de pauvres femmes qui ne montaient que fort rarement à cheval et que la fatigue aurait surprises dans le cours d'un semblable voyage qui réclamait la plus grande diligence, j'avais la presque certitude d'être atteint par les féroces Indiens et de causer notre mort à tous.
Toutes ces pensées me forcèrent à me soumettre au triste sort qui m'accablait. Réduit à cette impuissance je menais une vie triste et cruelle, sans cesse accablé de pensées douloureuses au sujet de ma famille chérie que je croyais de plus en plus ne jamais[Pg 193] revoir. La plupart des nuits j'étais obsédé par d'horribles rêves dans lesquels je voyais se dérouler une à une toutes les scènes sanglantes dont j'avais été tour à tour le témoin ou la victime.
Tant de souffrances physiques et morales accumulées finirent par lasser toute ma patience, mon courage se changea en une vraie frénésie et coup sur coup, au risque de me faire assassiner à mon tour, je fis plusieurs tentatives pour recouvrer ma liberté. Mais hélas, chaque fois aussi des obstacles imprévus s'opposèrent à ma réussite; peu s'en fallut même que je ne payasse de la vie ces essais infructueux, car dans plus d'une de ces occasions je dus entrer en lutte avec mes assassins. Grâce à Dieu, en ces moments solennels, le sang-froid ne m'abandonna pas, et chaque fois des subterfuges plus ou moins plausibles mais bien excusables dans ma position, me permirent d'échapper à une mort certaine. Dès que ces moments difficiles étaient passés, il se faisait en moi une grande réaction; j'étais pris de malaises insurmontables qui me rendaient comme fou.
[Pg 194]
Je renouvelai néanmoins ces tentatives dans lesquelles j'échouai comme toujours. La méfiance des Indiens s'étant accrue, ma position s'aggrava et il fut plusieurs fois question de me mettre à mort.
Enfin complètement découragé ne sachant plus que devenir, j'eus la coupable et terrible idée de couper court à mon éternel supplice en renonçant à l'existence. Je m'étais à cet effet emparé d'un couteau et des portraits de ma famille que les Indiens s'étaient appropriés, ne voulant pas en être séparé dans ce moment solennel; puis je m'étais glissé inaperçu, du moins je le croyais, dans une excavation pierreuse creusée à l'écart dans la pampa. Déjà j'avais imploré la clémence divine et je levais le bras pour accomplir mon fatal dessein lorsqu'une main ennemie saisit à l'improviste l'arme suspendue sur ma poitrine. C'était un Indien, c'était mon maître qui jugeant avec raison que la mort me paraissait plus douce que le genre d'existence auquel il me condamnait, ne vit dans ma résolution désespérée qu'un attentat à ses droits de propriétaire. Après m'avoir maltraité et repris[Pg 195] les portraits, il me déclara que pas un de mes mouvements n'échapperait désormais à sa surveillance. Les services que je lui rendais avaient probablement quelque valeur à ses yeux, et il ne voulait à aucun prix être obligé de faire lui-même ce qu'il me commandait journellement.
A quelque temps de là, une captive, femme d'un alcade, pleine de courage et de résolution tenta de s'évader. Elle avait déjà franchi nuitamment un grand espace, lorsqu'elle fut rattrapée: comme elle était jeune et belle elle ne fut pas mise à mort, mais elle fut attachée par les pieds et par les mains, puis frappée jusqu'à l'extinction de deux lannières de cuir et livrée à la brutalité d'une vingtaine d'Indiens. Devenue folle depuis, elle s'échappait parfois de la tente de son maître après lui avoir brisé toutes ses armes, et armée d'un tronçon de lance, elle en frappait avec acharnement et indistinctement tous ceux qui se trouvaient sur son passage. Les Indiens, qui la redoutaient beaucoup dans ses moments de fureur, l'empoisonnèrent pour s'en débarrasser.
[Pg 196]
Combien de traits analogues je pourrais citer si je ne craignais de trop alarmer la sensibilité du lecteur, et si je n'éprouvais moi-même à ces souvenirs émouvants des sensations réellement trop pénibles.
Les moins malheureuses parmi les jeunes filles captivées par les Indiens sont celles dont ils font leurs femmes; la majeure partie des autres sont vendues aux tribus éloignées et achèvent dans un enfer terrestre une vie commencée souvent sous d'heureux auspices. Quant aux pauvres enfants, ils se font presque tous à l'ignoble existence des nomades, oubliant souvent, jusqu'à leur langue maternelle. Ils sont, à vrai dire, assez bien traités des Indiens, qui en considération de leur extrême jeunesse, leur pardonnent d'être nés chrétiens. Chose horrible et presque impossible à croire, j'ai vu quelques femmes, devenues mères au sein de l'esclavage, qui étaient plus à redouter que les Indiennes elles-mêmes, et qui se montrèrent des plus cruelles envers d'autres captives comme elles, dont elles dénoncèrent les projets de fuite.
Malgré leur superstitieuse croyance dans la[Pg 197] réussite de toute entreprise qu'ils tentent en compagnie d'un chrétien, les Indiens, dont j'avais éveillé la méfiance au plus haut point par mes diverses tentatives de fuite, évitaient de m'emmener dans leurs expéditions. Ils prenaient même la précaution de me remettre entre les mains d'amis, qui assumaient sur eux la responsabilité de ma personne durant leur absence plus ou moins prolongée. A leur retour, le sucre, le tabac, le yerba—thé américain,—principaux objets de leur convoitise abondaient souvent. Le linge, les vêtements qu'ils avaient dérobés étaient par eux gardés précieusement pour leur servir dans les fêtes et dans les assemblées. Quant à moi, ils ne me firent pendant longtemps d'autre don qu'un lambeau de manteau de quelque pauvre soldat tombé sous leurs coups.
Une circonstance tout-à-fait imprévue, les força cependant à me faire assister à un de leurs combats. Environ deux mille cinq cents soldats Argentins sous la conduite d'Indiens soumis, qui leur servaient de guides, ayant surpris inopinément quelques tribus voisines de celle où je me trouvais alors, je dus accompagner[Pg 198] les Pampéens, qui après s'être réunis à la hâte résolurent de prendre l'offensive et de repousser leurs agresseurs en faisant chèrement payer leur trahison à ceux des leurs qui avaient servi de guides. Ceux-ci s'étaient retranchés derrière les Argentins et paraissaient peu disposés à prendre part à l'action; furieux à leur vue et voulant les atteindre au plus vite, les habitants du désert s'élancèrent tête baissée dans une formidable charge. Ebranlés par ce choc terrible, les soldats Argentins rompirent en deux bandes au milieu desquelles, continuant d'avancer, les Indiens entourèrent spontanément les traîtres et engagèrent avec eux une lutte spéciale et horrible, pendant que d'autres nomades, leurs compagnons, s'élançaient à la poursuite des soldats épars et achevaient leur déroute.
Le combat ne cessa que vers le coucher du soleil; il avait duré depuis le matin. Restés maîtres du champ de bataille, les Indiens, tout en pillant les morts et en achevant les survivants, trouvèrent parmi ces derniers trois des traîtres. Ils se gardèrent bien de les achever sur l'heure comme ils le faisaient[Pg 199] des chrétiens; ce genre de mort leur paraissant trop doux; mais afin de satisfaire leur vengeance d'une manière plus complète et plus éclatante, ils plantèrent dans le sol quatre piquets auxquels ils attachèrent fortement ces malheureux par l'extrémité des membres, puis ils les dépouillèrent chacun à leur tour, tout vivants, de leur peau ainsi qu'ils le font d'un animal quelconque, répondant par des injures aux cris arrachés à ces malheureux par l'atroce supplice qu'ils leur faisaient endurer et qu'ils terminèrent en leur enfonçant un poignard dans le cœur. Les auteurs de cette horrible vengeance, les mains et et la figure encore teintes du sang de leurs victimes, se partagèrent entre eux leurs peaux qu'ils déchirèrent par lambeaux, et dont je les vis faire plus tard différents objets tressés, destinés à être envoyés à titre de menace et de défi aux autres Indiens échappés à leur cruauté. C'était d'ailleurs là un usage immémorial dans le temps où toutes les races nomades vivaient dans un état continuel de guerres sanglantes.
Malgré leur victoire, les Indiens loin d'être complètement rassurés à l'égard de[Pg 200] leurs ennemis et redoutant encore quelque agression de leur part, opérèrent pendant plusieurs mois de journaliers changements de résidence, et toujours dans des directions opposées. Quand ceux qu'ils envoyaient en exploration revenaient nuitamment, contre leur habitude, la horde éveillée en sursaut par les aboiements des chiens, était soudain prise d'une terreur telle, que chacun s'élançait à cheval, répandait l'alarme dans le voisinage et se prenait à fuir sans oser regarder en arrière. Dans ces moments de panique, la plupart d'entre eux ne prenaient aucun souci de leurs bestiaux qu'ils eussent ainsi abandonnés à l'ennemi. Cependant le moment arriva où suffisamment rassurés, se voyant privés de toutes les choses qu'ils aiment et leurs troupeaux étant de nouveau amoindris, ils firent d'autres expéditions dont la réussite eut beaucoup d'influence sur ma destinée.
Quelques morceaux de papiers imprimés, ayant servi d'enveloppe à une grande partie des objets composant leur butin, et par eux jetés au vent, me tombèrent entre les mains. Je les lus maintes fois avec bonheur; car c'était[Pg 201] pour moi une distraction inespérée. Un jour, tandis que je recommençais en cachette, pour la vingtième fois peut-être, la lecture d'un journal de Buénos-Ayres où figurait le récit de la dernière et terrible invasion qu'ils avaient faite dans cette province d'où ils avaient enlevé plus de deux cents captives, je fus trouvé dans cette occupation par quelques Indiens qui en manifestèrent une joyeuse surprise et se hâtèrent d'informer les chefs de cette découverte. D'abord fort inquiet de cette circonstance, je ne tardai pas à être rassuré par l'accueil inusité et presque bienveillant qui me fut fait le soir, lorsque je vins, selon mon habitude, soumettre à leur vérification les animaux qui m'étaient confiés. A quelques questions que m'adressa mon maître, je compris qu'il était fier de posséder un esclave de ma valeur, et que je serais sans doute appelé à servir le cacique de la tribu.
En effet l'occasion s'en présenta bientôt, car ces êtres grossiers, lorsqu'ils se sont bien repus pendant quelques jours, se laissent tenter par le désir d'entretenir leur gourmandise et leur vanité; or, pour satisfaire[Pg 202] ces passions, ils recherchent tous les moyens imaginables. Ainsi ils vont de temps à autre offrir aux postes des frontières une apparente soumission, pendant laquelle ils font des échanges de toute nature, tels que plumes d'autruche, crins de cheval et cuirs de toute espèce contre lesquels ils rapportent les objets dont ils sont le plus avides. Ce fut en semblable circonstance que je fus mis à l'épreuve comme secrétaire du chef, qui me dit:
—Tu sais lire, tu dois savoir écrire, par conséquent, tu vas écrire la lettre que l'on va te dicter. Si tu ne trompes point ma confiance, j'aurai pour toi des égards; dans le cas contraire, tu seras mis à mort.
J'étais assis à terre, ayant devant moi quelques cuirs empilés qui me servaient de table, du papier blanc rapporté récemment d'une expédition, pour encre de l'indigo délayé avec de l'alcali, et une plume d'aiglon fort grossièrement taillée avec un mauvais couteau: entouré d'Indiens, qui la lance ou le casse-tête à la main pouvaient me tuer au moindre signe du chef, je commençai mon office.
Malgré mon désir ardent de n'écrire[Pg 203] que selon ma pensée et ma conscience, il me fut impossible de le faire. Je dus mentionner ce qu'on me dicta, car la méfiance de ces êtres est telle, qu'à plus de vingt reprises ils me demandèrent la lecture de la missive, et qu'après quelques phrases écrites ils changeaient à dessein le sens de leurs idées, mais sans paraître y prendre garde, afin de mieux éprouver ma franchise. Si j'eusse eu le malheur d'intervertir seulement l'ordre des mots, il m'eût été impossible de le leur cacher tant est fidèle leur prodigieuse mémoire.
Quoiqu'il me fût impossible de leur en imposer, ils me menacèrent par excès de prudence et me firent donner un double de la missive, destiné à être vérifié par des transfuges Argentins, vivant dans les tribus voisines. Ces gens sont des misérables souvent condamnés aux fers ou même à la mort pour leurs nombreux crimes et qui sont sûrs de trouver asile chez les Indiens. Ceux-ci, parfaitement renseignés sur la position de ces hôtes, les reçoivent comme des gens sur lesquels ils savent pouvoir compter aveuglément. Ils trouvent[Pg 204] en eux des guides pour leurs expéditions de pillage et des complices complaisants; aussi leur accordent-ils toute leur confiance.
Cette première correspondance fut portée à la frontière par deux Indiens désignés par le cacique; l'un d'eux, était mon maître. Quelques enfants les accompagnèrent pour transporter les objets destinés à être échangés. Douze ou quinze jours après leur départ, ces mêmes enfants revinrent épuisés de fatigue, la frayeur peinte sur le visage et poussant des cris de détresse. Ils racontèrent qu'après lecture de la dépêche, les deux envoyés avaient été mis aux fers en attendant la mort, et qu'il était certain que j'avais trompé la confiance générale et communiqué quelques détails sur leurs récentes invasions. Naturellement portés à croire le mal, ces barbares n'eurent plus d'autre volonté que celle de me tuer. Ce fut le cacique, qui me croyant absent, les engagea à ne pas éveiller ma défiance par des cris inaccoutumés; il leur conseilla même d'attendre au lendemain matin pour exécuter leur projet et de choisir le moment où je serais occupé à rassembler le troupeau.
[Pg 205]
Le hasard voulut que je fusse bien près en ce moment; grâce aux approches de la nuit j'entendis cette conversation sans être vu, et je pus me tenir sur mes gardes. Le matin venu, lorsque selon ma coutume j'allai faire ma ronde, je m'aperçus qu'à l'habile coursier que je montais la veille encore, on avait substitué un cheval fort lourd, mais je me gardai bien d'en témoigner aucune surprise. Je cheminais lentement sur ce maudit bidet quand j'aperçus venant à moi ventre à terre un parti d'Indiens qui faisaient retentir l'air de leurs sauvages imprécations. Cependant la distance qui me séparait d'eux était encore grande, et je fus assez heureux pour rencontrer la troupe de chevaux confiée à ma garde qui venaient d'eux-mêmes se désaltérer de mon côté. Grandes furent ma joie et mon espérance! j'abandonnai lestement mon cheval auquel je retirai la bride pour l'apposer au meilleur coureur de la troupe, qui me reconnaissant se laissa facilement approcher. En un instant je fus à cheval; puis, prenant le soin d'épouvanter les autres chevaux afin de les éparpiller pour ôter à mes ennemis toute chance de m'atteindre, je me[Pg 206] lançai à toute bride dans une direction opposée.
Après avoir galopé la journée entière, j'arrivai à la nuit tombante chez Calfoucourah—Pierre-Bleue—grand cacique de la confédération Indienne, dont la tribu de mes persécuteurs faisait partie, et qui cependant ne me connaissait pas encore. Rien à mon arrivée ne me fit deviner lequel parmi les Indiens que j'avais devant moi, pouvait être le grand cacique, car aucun signe ne le distinguait de ses sujets. Ce fut seulement lorsqu'il adressa la parole aux autres pour leur donner des ordres, qu'à son air impérieux je reconnus ce chef.
C'était un homme déjà plus que centenaire mais qui paraissait tout au plus âgé de soixante ans; sa chevelure encore noire abritait un vaste front non ridé que des yeux vifs et scrutateurs rendaient des plus intelligents. L'ensemble de la physionomie de ce chef, quoique empreint d'une certaine dignité, rappelait néanmoins parfaitement le type des Patagons occidentaux auxquels il devait son origine. Comme eux, il était d'une haute stature; il avait les épaules[Pg 207] fort larges, la poitrine bombée; son dos était un peu voûté, sa démarche pesante, presque gênée, mais il jouissait encore de toutes ses facultés; à l'exception de deux dents perdues dans un combat où il avait eu la lèvre supérieure fendue, ce vieillard les possédait encore toutes intactes.
Étonné à ma vue, et on l'eût été à moins, cet homme me demanda ce que je lui voulais, et quel motif me donnait assez de hardiesse pour venir seul le visiter.
El-mey-ouignecaë-tchéota-conne-pa-émy-
Et-mais-Chrétien-d'où-viens-tu?
tchoumétchy-kisssouh-conne-pa-émy-tchoumbé-
comment-se-fait-il-seul-tu-viens-qu'est-ce-que
émy-nay-pofso-lagane a ney-tchoumalo-kissouh-
tu-veux-tu-es-fou-je-crois?-pourquoi-seul-te
passian-intchin-meoh?
promener-chez-moi?
Je me fis connaître à lui; je lui exposai en quelques paroles les faits survenus la veille et le matin, le suppliant de prendre en considération la véracité de mon récit; je terminai en lui démontrant que si j'eusse trompé les Indiens, j'aurais immanquablement[Pg 208] cherché à m'évader dans l'intervalle, n'importe par quel moyen; qu'au contraire n'ayant rien à me reprocher, je venais lui demander appui et me confier à sa loyauté, jusqu'au jour où il aurait indubitablement une preuve quelconque, soit de ma franchise, soit de ma trahison; que de cette manière, si j'étais innocent, il n'aurait pas à se reprocher la mort d'un serviteur fidèle dont les services pourraient encore lui être de quelque utilité.
Flatté de ma confiance, ainsi que de quelques paroles à l'adresse de sa vanité, cet homme, réellement plus humain que ses semblables, me traita presque avec douceur et me promit son appui: seulement il ajouta que jamais je n'aurais de chevaux à ma disposition.
Le lendemain, une partie de la tribu que j'avais quittée, vint, son chef en tête, demander audience à Calfoucourah et réclamer instamment mon supplice, comme chose due. Pendant la durée du débat, j'étais présent, bouche close d'abord; mais enfin, inquiet de voir toute la horde si avide de mon sang, et m'apercevant que leurs instances commençaient à impressionner le chef,[Pg 209] je compris que je ne pouvais rester plus longtemps silencieux, je me levai: rappelant au grand Cacique qu'il m'avait accordé sa protection, je m'évertuai à faire comprendre mon innocence à tous en recommençant le récit exact de la veille au soir; et en évitant toutefois de froisser l'amour-propre et les préjugés d'aucun des assistants. Calfoucourah se déclara en ma faveur, reconnaissant, dit-il, qu'il était impossible qu'un coupable parlât comme je le faisais. Il défendit à qui que ce fût de me maltraiter; puis, se retournant vers moi, il me rassura, disant que je ne le quitterais pas, afin que rien de fâcheux ne me survînt, et il termina en disant à mon ancien chef que quand il lui procurerait des preuves incontestables de ma déloyauté, il me remettrait entre ses mains pour disposer de mon sort à sa volonté. Ce jugement rendu, l'assemblée se sépara et toute la horde s'enfuit en me lançant des regards de colère.
Quelques mois s'écoulèrent sans que rien ne vînt éclairer les Indiens sur la position des deux captifs retenus par les Argentins. Leur[Pg 210] animosité contre moi s'en accrut d'autant plus. Sans cesse ils venaient visiter le grand Cacique, qui lui-même influencé parfois par leurs diverses conjectures paraissait chancelant à mon égard, tantôt me rudoyant avec humeur, tantôt paraissant au contraire m'accorder la plus grande confiance. Souvent il me questionnait; et comme mes réponses concordaient constamment avec mon premier interrogatoire, il finissait toujours par me conserver sa protection. Seulement pendant les cinq mois que cet état de choses se prolongea, je fus l'objet d'une surveillance de plus en plus active. Très-souvent des troupes d'Indiens allaient roder dans le voisinage des haciendas, dans le but de recueillir des renseignements sur leurs compagnons captifs; mais chevaux et hommes se fatiguaient inutilement, ils revenaient sans rapporter le moindre indice. Lassés de tant de tentatives inutiles, ils résolurent de laisser s'écouler quelque temps sans les renouveler.
Précisément pendant cette période de repos et d'oubli apparent, les deux hommes que l'on croyait perdus à jamais reparurent enfin. Une[Pg 211] réunion extraordinaire de toutes les tribus intéressées dans l'affaire s'en suivit, et mon innocence y fut solennellement proclamée par les deux arrivants: ils déclarèrent qu'ayant été reconnus pour avoir fait partie d'une razzia précédemment opérée dans le Rio Quéquène, ils avaient été retenus captifs jusqu'à ce que le gouvernement de Buénos-Ayres, à qui on en référa eût statué sur leur sort; qu'un ordre formel arriva ensuite de la métropole de les retenir prisonniers et de les faire travailler; qu'il avait même été question de les mettre à mort, mais que l'on avait pris en considération les offres de paix contenues dans la dépêche dont ils étaient porteurs, et qu'ils devaient la vie uniquement à cette missive. Quant à leur liberté, ils l'avaient recouvrée grâce à la négligence de ceux qu'on avait préposés à leur garde.
Dès lors un revirement complet se fit en ma faveur dans tous les esprits. Mes plus grands ennemis mêmes n'eurent plus que des éloges à m'adresser. Toute leur méfiance s'évanouit en un moment; ils parurent oublier jusqu'à mes tentatives d'évasion. Il me fut[Pg 212] permis de monter à cheval et de les accompagner en toute occasion. Jugé digne de la confiance générale, je repris également mes fonctions d'écrivain de la confédération nomade.
Le Cacique de la tribu à laquelle j'appartenais avant les circonstances difficiles que je viens de relater, tenta à maintes reprises de me posséder de nouveau. Calfoucourah, en homme qui lui était supérieur et par son rang et par sa générosité, ne chercha nullement à s'opposer à son désir; mais il ne voulut point non plus agir sans m'avoir préalablement consulté. Encore sous l'impression des dangers que j'avais courus et des mauvais traitements que j'avais endurés chez mes anciens maîtres, ma réponse fut dictée par la reconnaissance que j'éprouvais pour cet homme généreux auquel je devais la vie et près duquel j'étais presqu'aussi libre qu'un Indien même. Je lui fis part du sincère et vif désir dont j'étais animé de ne point le quitter.
Touché de mon procédé il me tendit la main en me disant:
Comè-ouèntrou-à-èmy comè-piouquet-nié tah[Pg 213]
Bon-homme-tu-es-bon-cœur-tu-as
émy tefa inchine-ni mapo quinié-ouétchet
toi-tiens-dans-mon-pays-un-jeune-habitant
moulèané-émy kah-anneteux-houla-houé-
de-plus-il-y-aura-en-toi-jamais-un-jour-ou-l'au-
sah-dsomo-tchipalane intchine-ni houne.
tre-mauvais-mot-ne-sortira-de-nos-bouches.
J'appartins dès lors définitivement à la tribu des Mamouelches du nom de Calfoucouratchets. Les Indiens qui la composent sont beaucoup moins nomades que ceux des autres tribus dont j'ai entretenu le lecteur; ils forment pour la plupart une sorte de cour à Calfoucourah, grand cacique ou sorte de roi dont le pouvoir s'étend, ainsi que je l'ai déjà dit, sur toutes les autres peuplades, soit Pampéennes, Mamouelches, Puelches ou Patagones.
Les parages qu'ils habitent sont des plus accidentés et des plus pittoresques; ils se divisent en forêts épaisses, en plaines et en dunes sablonneuses naturellement creusées en forme d'entonnoirs et renfermant dans leur sein des lacs d'une eau douce et limpide autour desquels les Indiens construisent leurs tentes.[Pg 214] On chercherait en vain dans les bois ou dans la plaine d'autre eau que celle des étangs salins. Le sol presque toujours crayeux et salpêtré offre rarement une végétation comparable à celle de la Pampa, mais en revanche les bois sont tellement peuplés d'algarrobes que les fruits de ces arbres suffisent presque au besoin des nombreux troupeaux qui y fourmillent.
A part quelques animaux errants par ci par là dans la plaine, rien ne pourrait dénoncer la présence des Indiens au voyageur égaré, car ceux qui n'habitent pas l'intérieur des dunes dressent leurs tentes à la lisière des bois environnants.
Le caractère des Calfoucouratchets est plus sociable que celui des autres nomades. J'ai trouvé chez eux quelque tendance à la compassion; ils me traitèrent plus humainement. Leur sympathie sembla m'être tout-à-fait acquise à la suite de l'évènement heureux qui me fixa parmi eux. Grâce à la considération toute particulière qu'avait pour moi Calfoucourah qui ne me donnait plus d'autre nom que celui de fils—voitium,—ainsi qu'au[Pg 215] revirement complet qui s'était fait dans tous les esprits, n'ayant plus lieu de redouter aucun ennemi, je demandai et j'obtins la permission de monter de nouveau à cheval: sa bonté alla même jusqu'à m'accorder de faire d'assez lointaines excursions en compagnie de quelques Indiens qui me servaient d'escorte et d'introducteurs dans les différentes tribus que je visitai; partout je fus accueilli avec un certain empressement et avec les marques de la plus grande considération. Quelques-uns de mes hôtes ajoutaient encore quelques présents à toutes leurs bonnes grâces. Ces dons consistaient tantôt en tabac ou en provisions de bouche pour la route.
Comme je n'avais plus de raison de feindre l'ignorance, et bien que je trouvasse quelques Indiens parlant un peu l'espagnol, je ne me présentais jamais chez eux sans leur adresser la parole dans leur langage, ce qui les flattait infiniment et me gagnait toute leur confiance.
Durant l'hiver, les Calfoucouratchets sont beaucoup plus nomades que pendant l'été, car ils sont obligés de rechercher la fertilité qui leur fait alors défaut; cependant ils ne sortent[Pg 216] point des parages boisés qui sont pour eux d'une grande ressource. Les régions qu'ils habitent étant les plus chaudes, ils sont d'une couleur foncée; leur taille est inférieure à celle des Pampéens. Quoique aussi vigoureux et aussi forts que ceux-ci, ils sont beaucoup plus paresseux et d'une intelligence presque bornée.
En dehors de la chasse à l'autruche et à la gama, ils ne songent guère qu'à manger, à boire et à dormir. Ils sont généralement d'une grande malpropreté. Leur gourmandise est telle que lorsqu'ils ne peuvent plus manger, dans l'appréhension où ils sont de laisser leur mâchoire en repos, ils mâchent continuellement une sorte de résine blanche qu'ils nomment otcho. Ils la recueillent sur un petit arbrisseau connu chez eux sous le nom de motchi. Le goût de cette résine est des plus insignifiants, elle les fait beaucoup cracher. A force d'être mâchée elle devient molle et presque semblable à la gomme que machottent les enfants en pension. C'est la première chose qu'ils offrent à ceux qui leur rendent visite, et ils ne se font aucun scrupule[Pg 217] de leur donner celle qu'ils ont dans leur bouche. C'est même chez eux un honneur que de partager de la sorte.
La paresse et le sans-gêne de ces Indiens sont tels qu'alors même qu'ils sont entièrement dépourvus de bestiaux, ils refusent souvent les chevaux que leurs amis s'offrent à leur prêter, pour les engager à prendre part à quelque expédition, et qu'ils préfèrent s'installer tour à tour chez les uns et chez les autres pour vivre à leurs dépens durant l'hiver. Ils se contentent du seul produit de leurs chasses pendant l'été, ou bien de quelques racines qu'ils trouvent en abondance dans le sable fin au pied des arbres.
Nulle part, chez eux, je n'ai trouvé cette magnifique végétation que l'on voit abonder au Brésil ou au Chili. Partout dans leurs bois, aux algarobes et aux tchagnals, arbres fort bas, tortueux et armés de formidables épines aussi redoutables pour les sabots des chevaux que pour les pieds humains, s'entremêlent une foule de petits arbrisseaux également épineux qui forment avec eux des fourrés infranchissables; de nombreux pumas et jaguars[Pg 218] y établissent leurs repaires et y font leurs petits pour la nourriture desquels ils dévastent les troupeaux.
De même que les animaux, les hommes sont très-friands du fruit de l'algarobe,—Soë—qui a toute l'apparence d'une cosse de haricot, et renferme une graine fort dure. C'est une nourriture qui fortifie les bêtes de charge et donne à leur chair un goût délicat facile à distinguer et qu'apprécient beaucoup les Indiens.
Parmi les racines dont ces derniers font usage, le ponieux est peut-être la plus curieuse de celles que j'ai été à même de remarquer: sa forme et sa grandeur sont celles d'une grosse carotte; son enveloppe est épaisse et dure, d'un brun prononcé et cannelée dans le sens de la longueur. Le sommet est surmonté d'une fleur massive d'une teinte plus foncée et composée de deux parties séparées l'une de l'autre par une étamine ronde et dure qui reste dans le même état pendant toutes les phases de la maturité. L'intérieur est blanc, ferme et âcre avant sa maturité, agréable, doux et juteux quand il est mûr.[Pg 219] Une quantité incalculable de graines noires, infiniment plus petites que les pépins de figues s'entremêlent à la partie charnue. A maturité, la racine, de même qu'un bouchon mal assujetti sur une bouteille de liquide gazeux, sort lentement et à demi de de son enveloppe qui se fend circulairement à sa partie supérieure, emportant avec elle une sorte de calotte. Ce fruit répand alors une forte odeur de melon qui flatte l'odorat et engage à y faire honneur; mais on est tout étonné de lui trouver un goût tout différent de celui qu'il promet par son odeur et de sentir celui de la pomme crue. Abandonné à lui-même, ce fruit bizarre devient couleur de rouille et passe promptement à l'état de décomposition; il se couvre de vers blancs, semblables à ceux de la viande, qui l'absorbent mais respectent toutefois la graine qui se resème elle-même dans sa propre enveloppe dont la décomposition plus tardive lui sert d'engrais.
J'avais goûté maintes fois de cette sorte de racine que les Indiens appellent Ponieux—pommes de terre—sans trouver rien qui pût[Pg 220] en justifier le nom, lorsqu'un jour mes maîtres en ayant fait une ample provision et les ayant fait frire dans de la graisse de cheval, me convièrent à en manger avec eux; je les trouvai excellentes, mais je ne fus pas peu surpris de reconnaître que cette étrange racine, préparée de la sorte, n'avait réellement plus d'autre goût que celui de la pomme de terre. Je regrette bien vivement aujourd'hui de n'avoir pu, dans ma fuite précipitée et imprévue, emporter avec moi un échantillon de cette racine légumineuse inconnue certainement en Europe et dont la culture serait des plus faciles. Beaucoup d'Indiens la mangent crue; je fis souvent comme eux, mais m'étant aperçu de la propriété qu'a ce légume de provoquer à l'inflammation et à la constipation, je n'en mangeai plus qu'avec modération, et je compris pourquoi les Indiens après en avoir mangé un certain nombre avalaient tant de graisse de cheval liquéfiée.
Les occupations des femmes Mamouelches sont les mêmes que celles des Indiennes de toutes les autres tribus, c'est-à-dire qu'elles sont esclaves de leurs maris, dont la fainéantise[Pg 221] est encore, en quelque sorte, plus grande; ce qui n'est pas peu dire. Elles soignent beaucoup moins leur toilette, et sont généralement plus malpropres. Leur intelligence et leur adresse sont très-bornées; elles confectionnent aussi des manteaux de laine fort grossiers, et des Lamatras—couvertures de cheval;—mais la laine dont elles se servent est généralement mal lavée et mal filée. Ainsi que leurs maris, les femmes sont fort nonchalantes; mais comme ceux-ci sont d'autant plus exigeants par cela même qu'ils ne font rien, elles sont souvent exposées à leurs mauvais traitements. La jalousie, ver rongeur de toutes ces âmes brutes, est chez elles poussée à l'excès; aussi les vengeances y sont-elles très-fréquentes.
La superstition des Indiens se montre à tous les instants, et jusque dans les plus petites choses. Il n'est pas jusqu'aux changements de temps qui n'influent sur leurs esprits. Fort gais, lorsqu'il fait beau, ils deviennent muets et presque moroses lorsque le temps est mauvais; les visiteurs qui se présentent chez eux se ressentent toujours de ces impressions, car[Pg 222] au lieu de la politesse et des égards auxquels ils ont droit de s'attendre, ils essuient souvent des brusqueries.
Les Mamouelches sont assez doux et serviables entre eux, mais ils n'ont aucun respect pour la propriété, même pour celle de leurs meilleurs amis. Ils s'entrevolent continuellement et nuitamment des animaux qu'ils tuent au loin, en ayant soin de cacher de côté et d'autre les os et les peaux, et de faire maints détours pour en rapporter chez eux la viande. J'en ai vu beaucoup recevoir avec la plus grande assurance la visite de leurs dupes auxquelles ils servaient même à manger la chair des animaux qu'ils leur avaient volés, tout en ayant l'air de prendre une part très-vive à leur perte. Leur effronterie allait même quelquefois jusqu'à leur proposer de les accompagner dans leurs recherches: cette proposition était généralement acceptée, car les amis guidés par un certain instinct de méfiance ou même par quelques indices, savaient parfaitement être chez les délinquants, contre lesquels ils cherchaient seulement à acquérir des preuves irrécusables.
[Pg 223]
Ce genre de recherches offre bien des difficultés, mais la persévérance et la perspicacité des Indiens sont telles que souvent les préjudiciés parviennent à rassembler le cuir et les os accusateurs et à suivre une à une les traces—rastros—du chemin pris par les voleurs. Quand ils ont acquis toutes ces preuves, ils se présentent chez eux accompagnés de témoins et les accusent hautement de leur indélicatesse. Peu de coupables se rendent à l'évidence; ils accueillent presque toujours avec arrogance les réclamants qui se voient alors réduits à employer la force pour obtenir justice. Ils les traînent bon gré mal gré chez Calfoucourah, qui fixe lui-même le montant des dommages et intérêts dont le chiffre s'élève toujours très-haut; et, afin que les condamnés ne puissent se soustraire à la décision du chef, ils sont tenus de s'exécuter séance tenante.
Dans tous les parages boisés comme au sein de la Pampa, on est durant les chaleurs horriblement incommodé par les moustiques—riris—qui vous privent de tout sommeil. Les Indiens avant de s'endormir ont la précaution de se couvrir le corps avec le plus grand[Pg 224] soin et de se coucher la tête au vent, après avoir embrasé des petits tas de fiente à demi-sèche, dont la fumée épaisse leur passant au dessus du visage éloigne ces malfaisants visiteurs. Ces insectes insipides ne sont pas du reste le seul fléau à redouter, car de quelque côté que l'on s'aventure, de jour ou de nuit, on est continuellement harcelé par une sorte de taons—tavanas—qui s'acharnent après vous aussi bien qu'après les animaux et vous criblent le corps de douloureuses piqûres, d'où le sang coule en abondance. Je m'en suis vu parfois tellement couvert étant à cheval, que d'un seul revers de main j'en tuais jusqu'à plusieurs centaines à la fois, et que je paraissais m'être roulé dans des flots de sang.
Quelle que soit la nature des parages habités par les Indiens, on y trouve une grande quantité de serpents dont la longueur varie depuis cinquante centimètres jusqu'à un mètre vingt et trente centimètres, et auxquels les nomades donnent le nom de tchochia. Ils ont le dessus du corps d'un vert foncé, les flancs dorés et le ventre marbré de bleu, de rouge, de blanc et de noir. Les Indiens redoutent[Pg 225] beaucoup leur piqûre qu'ils disent être sans remède. Ces reptiles n'attaquent jamais l'homme à moins qu'ils n'en soient menacés. Ils ont pour habitude de se faufiler parmi les hautes herbes; là ils s'endorment pendant le plus fort de la chaleur, ce qui expose fréquemment les bestiaux à en être piqués, car ne les apercevant pas, ils leur marchent en plein dessus, ou bien encore il leur arrive fort souvent en paissant de plonger leur tête précisément dans les touffes qui les abritent. J'ai vu quantité de chevaux et de bœufs piqués aux naseaux, mourir en deux ou trois heures à peine, des suites de ces morsures. Le tchochia se nourrit de crapauds, d'animaux qu'il poursuit jusque dans leurs terriers, ou d'oiseaux qu'il charme en se cachant dans les buissons.
Durant l'été on peut à peine faire quelques pas sans en rencontrer et bien qu'ils ne soient pas doués d'une grande vivacité, les Indiens en ont grand peur. Ils les tuent de loin, avec leurs frondes ou bien avec leurs lances qui n'ont pas moins de quinze à vingt pieds de long.
[Pg 226]
Ayant dès les premiers temps de ma captivité, remarqué l'épouvante que ces animaux inspiraient à mes maîtres, je voulus leur donner une preuve de mon mépris du danger, et quoique je fusse complètement nu, j'en tuai un en lui écrasant la tête avec mon talon. Je n'aurais jamais pensé voir ces sauvages aussi stupéfiés qu'ils le furent à la vue de cet acte de témérité; ils s'éloignèrent aussitôt de moi en témoignant une telle frayeur et une telle colère que je jugeai prudent de ne leur plus donner pareil spectacle.
Dans une autre circonstance cependant, un de ces reptiles contribua beaucoup à donner aux Indiens une haute idée de ma personne. J'étais occupé à leur creuser un puits avec une pelle faite d'une omoplate de cheval fixée au bout d'un bâton, et comme ce travail que je faisais en plein soleil me fatiguait extrêmement, je me reposais de temps à autre en m'adossant à l'un des bords. Dans un de ces moments je fus tout à coup entouré par un tchochia qui s'enroula autour de mon corps. Malgré l'émotion que me causa son froid contact, je fus assez heureux pour ne[Pg 227] pas perdre toute présence d'esprit; saisissant prestement le reptile avec mes deux mains, je le rejetai au loin; il tomba au milieu des Indiens stupéfaits et épouvantés, qui se sauvèrent à toutes jambes en poussant des cris de détresse. Je n'avais point été piqué, mais durant le reste de la journée je craignis d'être atteint d'un malaise récemment éprouvé par un Indien qui s'était recouvert d'un manteau sur lequel j'avais vu ramper un tchochia. Fort heureusement j'en fus quitte pour la peur, et j'eus même le bonheur de voir tourner cet incident à mon profit, car j'entendis les indiens dire de moi:
El-mey-tah-tefa-quimé-comé-ouignecaè-
Et-mais-voilà-un-bon-chrétien
rouf-domo laéh-lane-comé-lagane-tchi
car-vraiment-il-n'est-pas-mort-il-est-bien-ce
ouet-chet-vita-ouènetrou-méah.
jeune-homme-avec-Dieu-sans-doute.
et ils me donnèrent des marques de la plus grande considération.
[Pg 228]
Orgies des Indiens.—Leurs différentes boissons. Je me construis une case.—Sciences des Indiens.
Sans exception de tribu, de rang, de sexe ou d'âge tous les Indiens aiment à s'enivrer.
L'ivresse est chez eux considérée comme le nec plus ultrà du bonheur, et pour une rasade de liqueur bientôt ingurgitée ils donnent volontiers jusqu'à leurs plus précieux objets. Ils n'en sont cependant point avares, car dès que l'un d'eux revient de quelque lointain voyage et qu'il apporte de l'alcool, toute la horde semble prendre à tâche de ne pas même lui laisser le temps de desseller ses chevaux; elle envahit aussitôt son domicile dans l'espoir de déguster gratis une partie de cette liqueur tant convoitée. Le propriétaire[Pg 229] du roukah contente de son mieux tous ces importuns auxquels il fait l'accueil le plus gracieux.
Les Indiens boivent souvent pendant plusieurs jours consécutifs et en plein soleil sans que leur santé en souffre aucunement; ils conservent même toute leur mémoire pendant le plus fort de leur ivresse, et si le hasard a mis entre leurs mains une bouteille, on peut être tranquillisé sur son contenu qui ne saurait se renverser par suite de l'habitude qu'ils ont de mettre un doigt dans le goulot et de la saisir fortement entre les autres.
Je n'ai jamais rien vu d'aussi dégoûtant et de plus extraordinaire que ce mélange d'hommes et de femmes sauvages entassés pêle mêle, parlant, chantant ou hurlant tour à tour, se traînant sur le siége ou sur les mains pour chercher à se dérober les uns aux autres quelques gouttes de liqueur, ou pour s'invectiver de la plus rude façon. Ces orgies s'achèvent rarement sans coup férir, car les Indiens ont ainsi que les hommes civilisés la fâcheuse habitude de choisir ces moments pour raconter leurs hauts faits. Et comme[Pg 230] au récit de leurs exploits il arrive fréquemment que le mot ouignecaé—chrétien—est prononcé, la haine qu'ils éprouvent pour ces derniers se traduit souvent par d'effroyables mêlées, dans lesquelles hommes et femmes se croyant sans doute attaqués par les Espagnols s'entretueraient immanquablement si, quelques-uns moins ivres ou plus raisonnables ne parvenaient à désarmer les mutins.
Les Indiens transportent la liqueur à dos de cheval; ils la mettent dans des peaux d'autruches ou de moutons, mais ils préfèrent généralement ces dernières comme étant plus faciles à préparer et d'une plus grande contenance. Ils en font des outres auxquelles ils donnent le nom de ounékas et qui résistent parfaitement à la pression des sangles. Ils les préparent de la manière suivante: ils égorgent les moutons, en séparent la tête et retirent la peau tout d'une pièce en pratiquant seulement une ouverture depuis le bas d'une des jambes de l'arrière-train jusqu'à la panse, par où ils trouvent moyen de faire passer le corps entier; ensuite ils font des ligatures au[Pg 231] cou et à l'arrière-train, puis ils gonflent la peau pour la tondre et la laver; enfin après l'avoir fait sécher ils l'assouplissent en la frottant entre leurs mains.
Si les Mamouelches sont moins favorisés que les Puelches et les Pampéens, car il se passe parfois bien du temps avant qu'ils puissent se procurer du Ouignecaë Poulcou—liqueur des chrétiens,—ils n'en trouvent pas moins les moyens de s'enivrer assez fréquemment durant l'été et l'automne, à l'aide de boissons de leur fabrication. La nature qui les prive de certains fruits qu'on s'attendrait volontiers à trouver dans les vastes forêts qu'ils habitent, leur en donne quelques-uns dont ils savent tirer bon parti: l'algarrobe par exemple qui sert à l'engrais de leurs troupeaux et à fabriquer de la liqueur, le piquinino—trulcaouèt,—et une espèce de figue de Barbarie dont la saveur est des plus agréables.
Les Indiens cueillent de grandes quantités d'algarrobes qu'ils écrasent entre deux pierres et qu'ils mettent dans des poches de cuir remplies d'eau, afin d'obtenir le soé-Poulcou, boisson qu'ils laissent fermenter pendant[Pg 232] plusieurs jours et sur laquelle se forme une écume qu'ils enlèvent avec soin; ils y ajoutent une autre portion d'algarrobe bouilli et mêlent le tout en l'agitant fortement. Cette préparation est assez agréable et les enivre complètement; mais ils n'en peuvent boire une grande quantité sans avoir à redouter de violentes coliques et des contractions nerveuses qui les abattent complètement. Ils mangent aussi de l'algarrobe cru mais avec beaucoup de réserve, car ce fruit quoique très-sucré contient un acide qui leur fait enfler les lèvres, les gencives et la langue, et leur occasionne en même temps une brûlante sécheresse qui empêche souvent les moins raisonnables de manger pendant un ou deux jours.
Le Trulcaouët connu des Espagnols sous le nom de piquinino est pour le moins aussi abondant que l'algarrobe, et il est beaucoup plus apprécié des Indiens qui, de même que des enfants, sont grands amateurs de toutes choses sucrées. La forme de ce fruit est ovale; il a la grosseur d'un pois. Il y en a de deux sortes: le rouge et le noir. Son goût est des plus agréables, mais ce fruit est tellement délicat[Pg 233] que sous la plus légère pression toute la partie charnue se transforme en une liqueur épaisse. L'arbrisseau qui le donne n'atteint pas plus de quatre à cinq pieds de hauteur. Il est fort touffu, a des branches délicates et flexibles hérissées d'une infinité de petites épines qui, lorsque l'on veut faire la cueillette à la main, se brisent dans les chairs où l'introduction de leur venin occasionne de petites tuméfactions douloureuses. Ses feuilles sont petites, rondes et d'une couleur vert pré. Si les Indiens étaient réduits à cueillir ce fruit à la main, malgré toute leur patience, ils ne pourraient satisfaire leur avide gourmandise; aussi emploient-ils un moyen aussi simple que commode qui les garantit de toute piqûre et leur permet d'emplir en quelques instants les petits sacs dont ils se munissent pour les transporter: ils déposent au pied de l'arbrisseau un grand cuir sur lequel ils font tomber tous les fruits en frappant légèrement chaque branche avec un petit bâton. Quand ils en ont récolté ainsi une quantité suffisante à leurs besoins, ils les vannent avec un autre cuir de mouton soigneusement pelé et parfaitement[Pg 234] tendu sur un cerceau, pour en séparer les nombreuses feuilles et les épines qui, malgré toutes leurs précautions, s'y mêlent le plus souvent. Cette opération terminée, ils se bourrent à qui mieux mieux, remplissent leurs petits sacs qu'ils suspendent de chaque côté de leurs selles, puis ils rejoignent au galop leur résidence, où de nombreux paresseux, abusant du titre de visiteurs, viennent se régaler à leurs dépens. Cependant malgré leur grande affluence, ces gourmands ne sauraient absorber toute la provision, car, la maîtresse du logis, en dépit de ses hôtes indiscrets, leur enlève résolument la plus grande portion transformée en liqueur, et la verse dans un cuir de cheval arrondi en forme de vase où elle la laisse fermenter pendant quatre à cinq jours. Au bout de ce temps, ayant ainsi obtenu une liqueur sucrée et délicieuse assez analogue à du sirop de groseille, elle réunit plusieurs amis qui la dégustent avec bonheur. L'effet de cette liqueur, fort agréable au palais, ne tarde pas à se produire, car elle enivre presque instantanément. Toutefois les entrailles n'en souffrent aucunement, tandis que le fruit[Pg 235] mangé en certaine quantité cause une irritation douloureuse et resserre tellement le corps que les Indiens avalent force graisse de cheval, leur seul remède dans ces cas.
Les Mamouelches avaient pour moi une telle considération qu'il fallait que je prisse part à tous leurs plaisirs et festins: c'est ainsi que j'eus occasion de goûter de leurs liqueurs. Malgré toutes leurs bonnes grâces, preuves évidentes du cas qu'ils faisaient de ma personne, souvent la joie que ces Indiens manifestaient en ma présence me rappelait encore plus vivement ma triste position et rendait plus cuisant le souvenir de ma famille et de ma patrie. Alors des larmes amères envahissaient mes paupières. Heureusement les Indiens se méprenaient sur leur cause; elles leur paraissaient aussi naturelles que les leurs produites par l'ivresse, et flattés à la vue de ce qu'ils croyaient n'être chez moi qu'un instinct d'imitation, ils me prodiguaient leur tabac en signe de sympathie.
Quelquefois ils me forcèrent à leur chanter quelque chose dans mon langage. Ne pouvant me soustraire à leur désir, et bien que[Pg 236] je n'en eusse aucune envie, je leur chantais ce qui me passait par la tête; puis, comme ils m'en demandaient souvent la traduction, je la leur donnais toujours à leur avantage, en sorte que je les laissais ainsi dans la conviction que je ressentais pour eux la plus sincère amitié.
Dans mon malheur, je n'avais jamais été si heureux qu'au milieu de cette peuplade, où en ma qualité de tchilca-tuvey—écrivain du grand Cacique—je jouissais de la considération générale et d'un certain crédit. Sur ma demande je fus autorisé par Calfoucourah à me construire une petite case en jonc, près de sa tente. Il prit plaisir à me voir exécuter ce travail dont il suivait journellement les progrès. Cette petite habitation était divisée de manière à m'offrir toutes les commodités possibles. Elle était carrée et partagée en trois compartiments, dont l'un me servait de chambre à coucher, l'autre de cuisine, et enfin le dernier qui correspondait à la porte d'entrée, servait à déposer ma selle et mes ustensiles de chasse. J'avais tressé une natte qui, parfaitement tendue sur un cadre, me servait de lit, et j'avais exhaussé le sol afin de me[Pg 237] garantir de l'humidité. La toiture plate et un peu inclinée me servait de terrasse; j'y montais à l'aide d'une petite échelle de jonc, dont les échelons étaient solidement fixés avec des bouts de lazzo. Dans la cuisine j'avais creusé une sorte de fourneau au-dessus duquel je suspendais la viande que je voulais faire rôtir. Comme j'étais assez éloigné des étangs je m'étais creusé un puits d'environ deux mètres dans lequel l'eau abondait. Calfoucourah m'honora souvent de ses visites, et lorsqu'il se présentait chez moi, il avait la bonté d'agir avec autant de bienveillance que lorsqu'il visitait ses amis; jamais il ne s'en retournait sans s'être enquis de tout ce dont je pouvais avoir besoin, pour me l'envoyer aussitôt.
Ses femmes alors au nombre de trente-deux, étaient chargées, à tour de rôle, de me fournir des aliments, attention que je savais reconnaître scrupuleusement du reste, par quelques prévenances qui me valaient toutes leurs bonnes grâces.
Calfoucourah consacrait généralement à sa nombreuse famille tous les instants que ne lui enlevaient pas les visiteurs et les affaires.[Pg 238] Quand il recevait, il était généralement assisté de deux de ses épouses: l'une jeune, l'autre âgée. Il partageait ses repas avec la première, tandis que l'autre était chargée d'entretenir sa pipe constamment pleine et allumée. Elle allait et venait sans cesse pour transmettre ses ordres aux uns et aux autres, et elle faisait distribuer à boire et à manger aux visiteurs. Calfoucourah était père de nombreux enfants; car chacune de ses femmes lui avait donné fils et filles; mais son grand âge ne lui permettant plus d'être assez empressé auprès de celles que le temps n'avait pas encore flétries, il en résultait qu'elles lui faisaient des infidélités qui maintenaient sa jalousie en éveil. Comme il jouissait d'une excellente vue, pendant la plupart des nuits il sortait sans bruit de sa tente et rôdait aux alentours pour tâcher de les surprendre en défaut. Lorsqu'il y parvenait, il les frappait ainsi que leurs complices, soit avec un couteau ou avec une boléadora. Quand il leur avait joué de ces sortes de tours, il rentrait se coucher aussi tranquillement que si rien d'extraordinaire ne se fût passé; mais[Pg 239] le lendemain matin il envoyait chercher les délinquants, et se les faisait amener devant lui: la femme recevait une sévère réprimande; quant à l'homme, il le condamnait à payer une forte rançon ou à mourir.
Malgré ses cent trois ans, ce vieillard montait souvent à cheval, et presque aussi lestement que les plus jeunes. Il affectionnait beaucoup la chasse où il donnait encore des preuves de la plus grande adresse, et au besoin, il maniait aussi la lance avec autant de dextérité que le premier venu de ses soldats. Lorsqu'il était entouré d'un nombreux auditoire, sa voix grave et sonore, dominant le brouhaha de la foule compacte, se faisait entendre souvent pendant plusieurs heures consécutives; il ne s'interrompait que pour recommencer encore, après avoir seulement pris le temps de humer quelques bouffées de tabac.
On a souvent supposé, ainsi que le dit lui-même d'Orbigny, et cela faute de connaissances positives, que la langue Patagone est peu étendue, grossière même; qu'elle manque de termes pour exprimer complètement une pensée, une idée fixe, ou bien encore la passion.[Pg 240] C'est une grave erreur. Il ne faut pas croire que les peuples chasseurs dont je parle, tantôt isolés dans des forêts vierges, ou jetés au milieu de plaines sans bornes, soient privés de formes élégantes de langage, de figures riches et variées; ils s'expriment au contraire, selon les circonstances, avec beaucoup de netteté et même de poésie. Qu'auraient donc pu dire d'ailleurs ces infatigables orateurs que j'ai vus chez les Patagons, chez les Puelches, et que je retrouvai encore chez les Pampéens et chez les Mamouelches et qui ainsi que Calfoucourah, dont j'ai parlé plus haut, savaient si bien émouvoir leur auditoire et l'animer de leurs discours? Leur langage n'est, il est vrai, composé que d'un nombre limité de mots, dont les uns servent à dénommer tous les objets qu'ils ont constamment sous les yeux et les autres de simples mots de convention, qui, entremêlés les uns aux autres et intercalés de telle ou telle manière, rendent l'expression de la pensée; mais ils la rendent toutefois complète, sans lacunes ni imperfections.
Les Indiens savent parfaitement bien compter;[Pg 241] ils emploient des noms de nombres qu'ils classent ainsi que nous, par dizaines. Ils arrivent ainsi jusqu'à cent, et de cent à mille etc. Leurs unités sont:
Quinié-Opouh-colah-melly-quetchou-cayou-
Un-deux-trois-quatre-cinq-six-
réulley-pourah-ailliah-Mary, Mary-quinié,-
sept-huit-neuf-dix-onze-
mary-opouh,-mary-colao,-mary-melly,-mary-quètchou,-
douze-treize-quatorze-
-mary-cayou,-mary-reulley,-mary-pourah,-
quinze-seize-dix-sept-dix-huit-
mary-ailliah,-opouh-mary.
dix-neuf-vingt.
Bien qu'ils ne sachent ni lire ni écrire, ils résolvent presque instantanément des calculs qui nous demanderaient souvent beaucoup de temps. Ils se servent pour cela, soit de brins d'herbe, de petits éclats de bois de différentes longueurs, ou bien encore de cailloux de grosseurs variées. Les uns, les plus courts ou les plus petits, représentent les unités; les autres, les plus grands ou les plus gros, représentent les dizaines; et jamais ils ne se trompent dans leurs comptes, quelque importants[Pg 242] qu'ils soient. Ils enseignent cette science à leurs enfants dès l'âge le plus tendre, de sorte que grâce à leur prodigieuse mémoire, hommes, femmes et enfants indifféremment, sont capables d'étonner nos meilleurs calculateurs.
Les années pour eux se comptent d'un hiver à l'autre; ils les nomment tchipandos et ils les subdivisent par lunes qu'ils nomment quiènes. S'ils veulent parler de la lune dans laquelle ils sont, ils disent tefa-tchi-quiène ou bien de celle à venir ils disent: quiène-oulah. A défaut d'heures, ils calculent la durée du temps parcouru ou à parcourir sur la marche du soleil: le matin ou l'aube se nomme Pouh liouène, midi ou milieu du jour renny-enneteu, la soirée épey-poune, la nuit poune. Malgré toute cette possibilité de se rendre compte exactement de la durée de leur vie, les Indiens négligent de s'en préoccuper; cela ne se fait guère que pour les caciques de chaque tribu respective. Ils ont aussi quelques connaissances en astronomie, et savent parfaitement s'orienter nuitamment, à l'aide des astres auxquels ils donnent des noms particuliers; étude qui m'a aidé dans ma fuite.
[Pg 243]
Fêtes religieuses des Indiens.
A de certaines époques de l'année les Indiens observent des fêtes religieuses. La première a lieu dans l'été, et elle est consacrée au Dieu du bien—Vita-ouènetrou—dans le but de le remercier de tous ses bienfaits passés et de le prier de les leur continuer dans l'avenir.
C'est généralement le grand Cacique qui en fixe l'époque et la durée. D'après ses ordres, tous les chefs des tribus réunissent leurs administrés, soit dans leurs parages respectifs, soit dans un endroit désigné.
Les préparatifs se font avec toute la pompe religieuse dont ils sont capables; ils se graissent les cheveux et se peignent la figure avec plus de soin que de coutume. Les vêtements[Pg 244] des riches se composent pendant ces grands jours de tous les objets volés aux chrétiens, et qu'ils ont conservés à cet effet avec le plus grand soin. Les uns sont revêtus d'une chemise qu'ils ont soin de laisser flotter au-dessus des mantes dont ils s'entourent la taille; d'autres n'ayant point de chemise étalent avec orgueil à l'admiration de tous, un mauvais manteau espagnol, ou une bien courte veste que n'accompagne pas un pantalon; d'autres enfin, couverts seulement d'un pantalon souvent mis sens devant derrière, sont coiffés d'un képi sans visière, ou d'un chapeau à haute forme, et chaussés tantôt d'une botte ou d'un soulier. Rien n'est plus comique que ces accoutrements bizarres, portés par des hommes dont la gravité habituelle se maintient même pendant le cours de cette fête durant laquelle il est expressément interdit de rire.
Dès le commencement de la cérémonie, les femmes transportent provisoirement leurs tentes au centre de l'emplacement choisi par le Cacique. Les hommes n'arrivent que quand ces préparatifs sont achevés; ils en font trois fois le tour au grand galop, en poussant le cri[Pg 245] de guerre et en agitant leurs lances. Ces trois tours terminés, ils se placent sur une seule file et plantent leurs lances sur un front dont la régularité parfaite flatte le coup-d'œil. Les femmes vont ensuite prendre la place de leurs maris, qui, après avoir mis pied à terre pour attacher leurs chevaux, s'en reviennent former un second rang derrière elles.
La danse commence alors, sans changement de place autrement que de droite à gauche. Les femmes chantent sur un ton plaintif, et s'accompagnent en frappant sur un tambour en bois recouvert de peau de chat sauvage, bigarré de couleurs et de dessins semblables à ceux qu'elles ont sur la figure. Les hommes pirouettent sur eux-mêmes en boitant de la jambe opposée à celle de la femme, et soufflent à pleins poumons dans un morceau de jonc creusé qui rend le son aigu et étourdissant d'une clé de gros calibre.
Cet ensemble est de l'effet le plus original, vu la contrariété des mouvements de part et d'autre et la raideur des danseurs. A un signal du Cacique présidant la fête, des cris d'alerte retentissent, les hommes sautent vivement à[Pg 246] cheval, interrompant ainsi brusquement la danse pour se livrer à une fantasque cavalcade autour de l'emplacement de la fête, tout en agitant leurs armes et en poussant de nouveau le sinistre cri de guerre qu'ils font retentir dans leurs pillages.
Dans les intervalles que laissent ces courses effrénées, chacun se rend visite dans l'espoir de déguster un peu de laitage pourri conservé dans un cuir de cheval; c'est un mets des plus friands selon eux, et qui leur procure cependant le doux effet d'une copieuse médecine.
Le quatrième jour, dès le grand matin, pour clore la cérémonie, un jeune cheval, un bœuf et deux moutons donnés par les plus riches d'entre eux sont sacrifiés à Dieu. Après les avoir renversés sur le sol, la tête tournée du côté du levant, le Cacique désigne un homme pour opérer l'ouverture de la poitrine de chaque victime et en extirper le cœur, qui palpitant encore est suspendu à une lance inclinée vers le levant. Alors la foule empressée et curieuse, les yeux fixés sur le sang qui coule d'une large incision faite à cet organe, tire des augures qui presque toujours[Pg 247] sont à son avantage: puis elle se retire dans son lieu d'habitation, pensant que Dieu, fort satisfait de sa conduite, lui sera favorable dans toutes ses entreprises.
La seconde fête a lieu dans l'automne; elle est célébrée en l'honneur de Houacouvou, directeur des esprits malfaisants. Elle a pour but de le conjurer d'éloigner d'eux tous maléfices.
Ainsi que dans la première fête, les Indiens se parent de leur mieux et s'assemblent par tribus seulement, chaque cacique en tête. La réunion de tout le bétail a lieu en masse. Les hommes forment alentour un double cercle, galopant sans cesse en sens contraire afin qu'aucun de ces fougueux animaux ne s'échappe. Ils invoquent Houacouvou à haute voix et renversent goutte à goutte du lait fermenté contenu dans des cornes de bœuf que leur présentent leurs femmes pendant qu'ils font le tour des animaux. Après avoir réitéré trois ou quatre fois cette cérémonie, ils jettent sur les chevaux et sur les bœufs ce qui reste de laitage, afin, disent-ils, de les préserver de toute maladie; après quoi, chacun[Pg 248] sépare son bien et le conduit à quelque distance pour revenir ensuite s'assembler de nouveau autour du cacique, qui, dans un long et chaleureux discours les engage à ne jamais oublier Houacouvou dans leurs prières, et à se préparer promptement à lui être agréable, en allant chez les chrétiens porter la désolation et augmenter leurs troupeaux. Chacun reconnaissant la sagesse d'un tel conseil, agite ses armes en priant Houacouvou de les bénir et d'en faire dans leurs mains des instruments de bonheur pour leurs tribus et de mort pour tous les chrétiens qui tenteraient de leur disputer leurs biens ou leur vie.
Ces êtres n'ont aucun sentiment de pitié. Plus ils font de victimes, plus ils s'en enorgueillissent. Ils considèrent les êtres civilisés comme des sorciers et des ennemis; ils les accusent de tous les maux qui peuvent les atteindre.
Avant l'apparition des ouignecaés, disent-ils, nous vivions paisiblement sur tous les points de cette terre qu'ils nous ont ravie par la force, sans respect pour la volonté de Dieu[Pg 249] qui nous y a fait naître et nous en a donné la propriété. A qui donc sont ces bœufs et ces chevaux, créés comme nous dans ces parages, sinon à nous? téouas-ouignecaés—ces chiens de chrétiens,—ne nous ont point épargnés; non-seulement ils nous ont ravi nos biens, mais ils n'ont pas craint de tremper leurs mains, avides d'or, dans notre sang. A tout jamais ils seront nos ennemis; nous lutterons contre eux jusqu'à la mort pour leur reprendre peu à peu ce qu'ils nous ont dérobé d'un seul coup. Pourquoi ces chiens de chrétiens sont-ils assez téméraires pour venir jusqu'ici au lieu de rester chez eux? Dieu nous ordonne de troubler leur tranquillité et de nous opposer à la réussite de leurs projets. Il nous commande de leur prendre leurs femmes et leurs enfants pour nous en servir comme d'esclaves.
Telles sont les idées de ces êtres que nous appelons sauvages.
Les Indiens croient aux talismans. Ils considèrent et conservent comme tels maints objets insignifiants, tels que: les boules de poil durci qu'ils trouvent dans le corps des[Pg 250] bœufs ou les amas graveleux qui se forment souvent dans les rognons des chevaux qui n'ont, la plupart du temps pour s'abreuver, que des eaux calcaires. Le grand Cacique Calfoucourah porte sur lui une sorte de relique assez curieuse qu'il trouva étant tout enfant. C'est une petite pierre bleue, dont le nom lui est resté, à laquelle la nature s'est plu à donner presque une forme humaine; la superstition des Indiens la leur fait regarder comme un talisman. Selon eux, Houacouvou ne l'a fait tomber entre ses mains que pour le préserver de tout danger et pour le rendre invincible. C'est à elle qu'ils attribuent tous les succès de Calfoucourah: ce qui les confirme dans cette croyance, c'est l'organisation vraiment exceptionnelle de ce chef et son intelligence très-supérieure à celle de tous les autres caciques qui s'accordent à dire que jamais ils ne pourraient le remplacer. Il n'est pas jusqu'aux Hispanos-Américains, auxquels il a fait tant de mal, qui ne se plaisent à reconnaître et à admirer sa bravoure et ses capacités hors ligne.
Cet homme, j'en suis convaincu, n'aurait[Pg 251] point été ennemi de la civilisation, car il était doué d'instincts généreux. Il avait le sentiment de la justice, mais malheureusement pour les Argentins, pour lesquels sa soumission eût été la source de grandes richesses, leur manque d'habileté et leur inconstance en politique ont détourné ses bonnes dispositions. Ce chef pour conserver toute son autorité sur les êtres farouches qu'il commandait et commande peut-être encore dut forcément refouler au fond de son cœur tous ses bons sentiments. Cependant, je lui dois la vie, et le jour où pour me la laisser il renvoya, en les déboutant de leur demande, tous ceux qui avaient juré ma mort, ne fut pas la seule preuve que j'eus de sa générosité.
Plusieurs fois, pendant mon séjour auprès de lui, quand nous nous trouvions seul à seul, il me tint un langage bien différent de celui qu'il employait devant témoins, et il me prodigua des marques de la plus grande sympathie. Il sut fort bien me faire comprendre que je ne devais pas lui en vouloir lorsqu'il me brusquait, car ce n'était souvent que le résultat de la violence qu'il se faisait à lui-même[Pg 252] pour résister au désir de m'être utile, cela étant incompatible avec sa position et avec la surveillance qu'exerçaient sur lui les autres Indiens; il ajoutait que si jamais je recouvrais ma liberté par suite de circonstances inattendues, il souhaitait vivement que je me souvinsse de lui comme d'un ami sincère. Cependant je dois dire que malgré toutes ses belles paroles et toutes ses marques de sympathie auxquelles il fallait que j'eusse l'air de croire aveuglément, je savais fort bien, que le cas échéant, la haine la plus implacable trouverait seule place dans ce cœur Indien si je lui laissais entrevoir le vif désir que j'éprouvais de m'affranchir.
Néanmoins, j'affectai de paraître très-reconnaissant de tous ses bons procédés, que je tenais du reste à mériter tant que je serais près de lui. Pour lui en donner une preuve, je lui proposai un jour de semer tout un sac de maïs provenant d'une expédition dans la province de Buenos-Ayres. Cette offre lui plut infiniment: nous choisîmes ensemble un endroit propice, et, chaque matin, dès l'aurore, je me mis à travailler. Je fis d'abord un[Pg 253] fossé assez large, pour empêcher le bétail de pénétrer dans le champ.
Calfoucourah venait jusqu'à deux et trois fois par jour, suivre des yeux mon travail et m'encourager. Il me faisait fumer sa pipe et m'appelait son fils. Quand j'achevai ce fossé qui était large d'au moins un mètre cinquante et profond de deux, il me fit venir dans un roukah et après m'avoir fait partager son repas, il me fit présent d'un manteau: quoiqu'à demi usé, cet objet me causa une grande joie car c'était le premier vêtement que je possédais depuis le commencement de ma captivité.
J'avais déjà beaucoup fait en creusant le fossé, mais l'embarras pour moi était de trouver un moyen de labourer cette terre non défrichée. Il me manquait pour cela une charrue. J'aurais sans doute été réduit à la bêcher avec mon incommode pelle et je n'aurais que fort lentement avancé dans ce travail fatiguant, si je n'eusse eu le bonheur de trouver dans le voisinage une hache que je pus affiler. A l'aide de cet instrument j'abattis un petit arbre dont une des branches formait avec[Pg 254] le tronc un angle aigu, et je taillai l'extrémité en forme de soc. Au nombre du bétail se trouvaient deux bœufs de labour que j'attelai tant bien que mal à cette charrue grossière; à force de persévérance je parvins à labourer passablement l'enclos, lequel avait environ cinq cents mètres carrés. Quand je l'eus ensemencé je chargeai de pierre un fort cuir de bœuf auquel j'attelai trois chevaux, et je m'en servis pour herser. La nature ayant pris soin de faire le reste, je vis bientôt éclore une grande quantité de tiges de maïs qui, en peu de temps donnèrent une récolte magnifique. Ce succès me captiva complètement l'amitié et les bonnes grâces de Calfoucourah et celles de ses trente-deux femmes qui parurent redoubler encore pour moi d'attentions et d'égards.
Un jour voulant, selon mon habitude, abattre un bœuf d'un seul coup de poignard au défaut de la nuque, un lazzo qui le retenait s'étant rompu, je manquai mon coup, et je fus piétiné par l'animal furieux et blessé, de dessous duquel on ne m'arracha qu'à grand peine tout sanglant et meurtri. Tandis qu'il[Pg 255] me labourait le corps de ses cornes, j'avais perdu connaissance: lorsque je revins à moi, j'étais étendu sur des cuirs de mouton, la tête reposant sur les genoux d'une des épouses du grand Cacique, qui me prodiguait les soins les plus empressés et sembla ainsi que tous les Indiens dont j'étais entouré toute joyeuse en me voyant renaître à la vie.
Je fus quelque temps à me remettre des suites de ce terrible accident, dans lequel j'avais failli perdre un œil, car j'avais eu une paupière déchirée.
Malgré toutes les prévenances des Indiens et toute ma diplomatie, je n'étais pas complètement à l'abri de leurs mauvais traitements, car la superstition et l'inconstance de ces êtres méfiants les portait souvent au contraire à me faire expier dans leurs moments de colère ce qu'ils appelaient alors leur inexcusable faiblesse à mon égard.
Bien qu'il n'entrât pas dans les habitudes de Calfoucourah de se faire accompagner autrement que par ses fils ou par moi lorsqu'il voyageait, il n'accueillait pas moins avec les marques de la plus grande satisfaction tous[Pg 256] ceux qui se présentaient pour lui servir d'escorte.
Vu son grand âge ce chef ne conduisait plus guère lui-même les Indiens au pillage. Il se contentait de leur donner ses ordres ou ses conseils pour envahir tel point plutôt que tel autre. Mais, quand parfois il se laissait entraîner par ses idées belliqueuses et qu'il conduisait ses soldats, il emportait avec lui ses principales richesses, consistant en éperons et étriers d'argent, et il emmenait la plupart de ses femmes. Là se bornait toute sa distinction d'avec le commun des Indiens, qui seuls prenaient part au combat. Ses droits n'allaient pas jusqu'à s'attribuer une part quelconque du butin; mais comme il était généralement aimé et vénéré de chacun, tous mettaient leur orgueil et leur amour-propre à lui offrir de nombreux troupeaux, composés des plus beaux animaux pillés, ou bien encore à lui faire don de quelques captives qu'il vendait généralement à vil prix aux Indiens des tribus éloignées.
Calfoucourah habitait une vaste tente abondamment pourvue de toutes choses formant[Pg 257] le confortable des Indiens. Et sous son toit fragile un Européen eût certes pu trouver bien des richesses entassées pêle-mêle.
Depuis plus de six mois je vivais près de cet homme, lorsque de nouveau les Indiens sentirent la nécessité de traiter avec l'un ou l'autre parti politique des Hispanos-américains dont la surveillance de plus en plus active s'opposait à leurs terribles invasions.
Ils hasardèrent près des uns et des autres des démarches pacifiques dont le résultat devait influer beaucoup sur ma destinée.
[Pg 258]
Comment la politique des Provinces unies de la Plata vint influer sur ma destinée.—Le général Urquiza.—Délivrance.—Orgie générale.
Les républiques unies de la Plata, pour leur bonheur, avaient alors à leur tête un homme sur lequel je vais arrêter un instant les yeux du lecteur, ne serait-ce que pour lui offrir une compensation aux figures grimaçantes, grotesques ou hideuses que j'ai décrites jusqu'ici.
Don Justo-José Urquiza, né à la Conception de l'Uraguay, dans l'Entre Rios, ne doit rien qu'à lui-même. Sorti des rangs du peuple, simple gaucho comme il aime à s'en vanter, n'ayant jamais reçu d'autres leçons que celle de sa propre expérience, il s'est peu à peu frayé un chemin par la force de son caractère[Pg 259] et la supériorité de son intelligence. Ses rares talents militaires lui valurent la faveur de Rosas, qui l'avança rapidement et en fit bientôt son bras droit. Urquiza put croire un moment que le dictateur ne s'opposait à la confédération que pour lui donner les moyens d'accomplir de grandes choses, et peut-être pour sauvegarder l'indépendance de son pays. Mais il ne tarda pas à démêler les motifs de cette politique astucieuse et méfiante. Dès qu'il s'aperçut qu'on exploitait son patriotisme au profit d'une étroite ambition personnelle, il se tourna contre le dictateur, l'accusant de fausser la Constitution et d'attenter aux libertés nationales. Rosas avait plusieurs fois feint un désintéressement qui était loin de sa pensée. Périodiquement, à des époques habilement calculées, il parlait avec une modestie vraiment touchante, tantôt de son âge trop avancé, tantôt de sa santé délabrée, et demandait à résigner un pouvoir dont il ne pouvait plus, disait-il, supporter le fardeau. Mais le vieux lion qui avait toujours vu les représentants trembler devant lui, savait bien qu'aucun d'eux n'oserait accepter sa démission.[Pg 260] L'assemblée se hâtait d'implorer son dévouement et de lui arracher, par d'ardentes supplications, un sacrifice glorieux.
Ces plates adulations passaient auprès des cours étrangères pour l'expression du sentiment public. Urquiza choisit le moment où le dictateur cherchait en 1851, à renouveler cette honteuse comédie; il lança une proclamation dans laquelle il déclarait Rosas déchu du pouvoir exécutif, et il se plaça lui-même à la tête d'un parti qui voulait à la fois la réunion des provinces en une confédération compacte et la libre navigation des eaux de la Plata.
Il était assuré d'avance de l'appui du Brésil, dont sa politique servait les plus chers intérêts. Les rivières qui prennent leur source dans le Nord de cet empire donnent accès, par l'Atlantique, à une partie considérable de son territoire, et ce sont les provinces les plus riches. Le Brésil avait souvent demandé à Rosas le passage de la Plata. Pour obtenir cette concession il avait épuisé en vain toute les ressources de la diplomatie. Urquiza venait à propos. L'antagonisme traditionnel des[Pg 261] Espagnols et des Portugais céda devant la nécessité d'ouvrir au commerce du monde le Parana, l'Uraguay, le Paraguay et leurs tributaires.
Le Brésil se rallia donc à la cause d'Urquiza et lui fournit les forces nécessaires pour la faire triompher. Le premier mouvement d'Urquiza fut dirigé contre Oribe qui, soutenu par les troupes de Rosas, bloquait depuis neuf ans Montévidéo, et n'attendait, pour s'en emparer, que le moment où cesserait l'intervention de la France et de l'Angleterre. En attendant, Oribe ruinait Montévidéo, car il avait peu à peu élevé autour de son camp une ville rivale, Restoracione, qui comptait déjà dix mille habitants. L'arrivée d'Urquiza détourna des assiégés les menaces de l'avenir. Il se présentait à la tête d'une armée d'Entre-Rios et de Corrientinois; appuyé en outre par l'escadre du Brésil et par un corps d'infanterie de cette même nation, il amena Oribe à capituler presque sans coup férir. Une adresse consommée marqua sa conduite: il mit en avant le caractère patriotique de son entreprise, montra les dispositions les plus conciliantes,[Pg 262] et proclama hautement son intention d'éviter l'effusion du sang. Des milliers de combattants grossirent bientôt ses rangs; Oribe abandonné de ses troupes et ne pouvant plus d'ailleurs recevoir ni renforts ni munitions, se rendit sans conditions.
Après ce succès éclatant, Urquiza se retira dans sa province pour s'y préparer à porter un coup décisif au pouvoir de Rosas. En 1852 il repassa le Parana avec des forces considérables et s'avança, sans rencontrer d'obstacle jusqu'à Monte-Caseros, où le dictateur accourut à la tête de vingt mille hommes. La mémorable bataille du 3 février 1852 se termina par la défaite et la fuite de Rosas, qui s'embarqua en toute hâte sur un vaisseau anglais, pendant que son vainqueur entrait dans Buenos-Ayres aux acclamations de la population. Urquiza établit son quartier-général à Palermo, et nomma gouverneur de la ville Don Vincente Lopez, homme d'un âge déjà avancé, mais généralement aimé et estimé.
Nommé dictateur provisoire le 14 mai, Urquiza réunit à San-Nicolas les gouverneurs et les délégués des quatorze provinces de la[Pg 263] Plata pour qu'ils eussent à choisir une organisation politique. Cette assemblée se prononça en faveur du système fédératif, et décida que les provinces nommeraient des représentants chargés de rédiger une constitution et d'établir les bases d'un gouvernement définitif.
Buenos-Ayres refusa de confirmer les pouvoirs que l'assemblée avait conférés à Urquiza. Le gouverneur Lopez qui était resté fidèle aux décisions de la majorité, ne réussit pas à les faire respecter et fut obligé de se démettre de ses fonctions. Urquiza n'était pas homme à hésiter; il marcha sur Buenos-Ayres, rétablit son autorité et réinstalla son gouverneur. Après cet acte de vigueur, il se montra clément et se borna à exiler cinq des principaux meneurs: dès qu'il vit l'ordre affermi, il retira ses troupes de la ville et se rendit à Santa-Fé, où devait s'assembler le congrès, qui ouvrait ses séances le 20 août. Les treize provinces de l'Entre-Rios, Corrientes, Santa-Fé, Cordova, Mendoza, Santiago de l'Estero, Tucuman, Salta, Jujuy, Catamarca, Hioja, San-Luiz et San-Juan y avaient envoyé chacune deux délégués.
[Pg 264]
Une nouvelle révolte éclata à Buenos-Ayres, suscitée par d'anciens exilés qui ne s'étaient ralliés à Urquiza que pour se débarrasser de Rosas. Comme ils étaient pour la plupart natifs de la ville, ils n'eurent pas de peine à soulever la population. Urquiza ne pouvait souffrir que Buenos-Ayres fît la loi aux treize provinces, mais il ne voulait fournir aucun prétexte à une guerre civile dont il redoutait les conséquences. Au lieu d'employer la force contre l'insurrection, il préféra lui laisser le temps de la réflexion, et se contenta de publier une proclamation dans laquelle il déclarait la province de Buenos-Ayres séparée du reste de la confédération et l'abandonnait à sa mauvaise destinée. Sa modération ne fit qu'encourager les insurgés; ils essayèrent de propager la révolution et envahirent la province d'Entre-Rios. C'était braver Urquiza jusque chez lui. Il marcha contre les envahisseurs et les rejeta sur leur territoire.
Depuis lors jusqu'à l'heure actuelle, ce n'a été entre Urquiza, représentant les intérêts de la confédération Argentine, tendant à unifier[Pg 265] son immense territoire, et les préjugés égoïstes de Buenos-Ayres rêvant un orgueilleux isolement pour sa population de cent vingt mille âmes, qu'une série de luttes plus ou moins ouvertes, suivies de concessions toujours forcées et peu sincères de la part des Portenos ou Buenos-Ayriens, toujours volontaires de la part d'Urquiza, qui s'est montré, en toute occasion désireux d'épargner à l'antique métropole de la Plata les malheureuses extrémités de la guerre.
Voici en quels termes le commandant Page, chargé par les Etats-Unis d'une mission dans la Plata, traçait en 1857 le portrait de cet homme remarquable.
Urquiza, à l'époque où je le vis était encore jeune d'apparence; son teint est brun, sa taille moyenne; admirablement proportionné, il présente tous les dehors d'une nature énergique et vigoureuse. Sa tête se fait remarquer par des contours amples, des plans solides, des traits fermes et accentués. L'ensemble respire l'intelligence, mais une intelligence qui se possède pleinement. Les yeux purs, brillants, bien ouverts, ont un regard pénétrant. La[Pg 266] bouche est à la fois fine et bienveillante. C'est une tête d'homme d'état en même temps que de héros, offrant un singulier caractère de force, de calme et d'autorité. Pour inspirer le respect Urquiza ne recourt à aucun charlatanisme, à aucun rôle d'emprunt; son air n'a rien de composé, et l'on sent qu'il est à la hauteur de sa mission. Sa noble prestance, son maintien aisé, la dignité de ses manières, sa démarche délibérée, sa parole nette et mesurée dénotent une âme fière et loyale, un esprit lucide, un jugement sûr. On subit volontiers l'influence qu'il exerce sur tous ceux qui l'entourent et l'on éprouve d'autant plus de plaisir à rencontrer en lui les rares qualités dont il est doué, que l'on sait qu'il doit tout à lui-même: son éducation comme sa haute position. (Note E.)
Maintenant quelques mots suffiront pour faire comprendre comment aux profonds calculs de la politique de cet homme d'état se rattacha fortuitement ma délivrance.
En 1859 une nouvelle scission armée de Buenos-Ayres forçait une fois encore Urquiza[Pg 267] à recourir à la décision des champs de bataille.
Les Indiens pressentant avec leur instinct de bêtes de proie que les dissensions politiques des Argentins pouvaient leur offrir quelques occasions de butin, adressèrent au général plusieurs offres d'alliance, et plusieurs lettres rédigées par moi furent portées par des membres de la famille de Calfoucourah.
Le général était trop fin politique pour ne pas faire un bon accueil à ces messagers sauvages. Possesseur d'une des plus vastes estancias de la vallée du Parana, et lui-même agronome distingué, cherchant avant tout à développer les bienfaits de l'agriculture sur la belle partie de terre confiée à ses soins, il savait trop combien les établissements agricoles de la frontière du Sud ont besoin de calme et de sécurité pour ne pas chercher à amortir par tous les moyens les tendances agressives des Indiens leurs voisins. Il ne renvoya donc les ambassadeurs de Calfoucourah que chargés de cadeaux de toutes sortes et surtout de barils d'eau-de-vie; aussi leur retour fut, dans toute la horde, sans exception de rang, d'âge et de sexe, le signal d'orgies sans fin.
[Pg 268]
Quand je les vis livrés avec frénésie à l'ivresse, jugeant de la durée qu'elle pouvait avoir je conçus l'idée de tenter encore une fois de me rapprocher des contrées d'où je pourrais opérer mon retour dans ma patrie et dans ma famille.
Au moment de prendre cette décision solennelle me souvenant que les portraits de mes chers parents étaient encore à la merci des Indiens, je résolus de tout risquer pour m'en emparer, les considérant comme un talisman qui devait me protéger au milieu des nouveaux périls que j'allais affronter. Pour exécuter ce coup hardi, je fus obligé de pénétrer en me traînant sur les mains au milieu de toute la horde de buveurs ivres et exaltés, essuyant les menaces des uns ou parant de mon mieux les coups de couteau que cherchaient à me porter les autres sans pourtant se rendre compte de ce que je cherchais ni sans me reconnaître. Quand je mis enfin la main sur le sac où ils étaient renfermés, le cœur me battit violemment; de même qu'un coupable j'eus un instant la peur d'être découvert; tout mon sang se glaça. Je ne savais plus si je devais avancer[Pg 269] ou reculer; pourtant après être resté quelques minutes dans l'immobilité la plus complète, convaincu de n'avoir pas été vu, j'entrouvris doucement et sans bruit le misérable sac de cuir de cheval dont la criante sécheresse eût pu me vendre. Et sans perdre de temps, j'y introduisis une main fébrile qui eut bien vite saisi les photographies que je cachai aussitôt dans le manteau qui m'entourait la taille. Puis, comme enhardi par ce premier exploit, en un moment je fus hors de la tente, plus que jamais décidé à m'enfuir.
J'implorai l'aide du Tout-Puissant du plus profond de mon cœur, et profitant de cette nuit où toute la tribu était plongée dans un lourd sommeil, je me glissai en rampant vers l'endroit où étaient les meilleurs chevaux du cacique, après m'être muni d'une paire de boules destinées, soit à ma défense, soit à me procurer du gibier sur ma route. Je pris aussi un lazzo pour m'emparer de trois montures et les réunir.
Ces préliminaires accomplis sans bruit, je conduisis tout doucement mes chevaux jusqu'à ce que je fusse hors de la vue du camp.[Pg 270] Alors sautant sur l'un d'eux, puis chassant les autres devant moi, je commençais palpitant d'émotion, ma dernière course, celle d'où dépendait ma vie ou ma mort.
Pendant toute la nuit je galopai sans relâche croyant voir sans cesse des ombres à ma poursuite. Le jour dissipa les ténèbres mais sans calmer mon agitation; elle était telle que le moindre souffle d'air me semblait chargé de clameurs menaçantes et que le moindre tourbillon de poussière me donnait des angoisses.
Souvent je mettais pied à terre, et, l'oreille appuyée sur le sol, j'écoutais, espérant puiser un peu de tranquillité dans le silence de la Pampa; mais loin de là, les oreilles me tintaient tellement que je croyais entendre sur ce sol dur retentir de sinistres galops, et je précipitais de nouveau ma fuite sans réfléchir aux impérieux besoins qu'éprouvait ma monture à laquelle il était impossible de prendre, à l'exemple de ses compagnons, quelques bouchées d'herbe en courant. Je suivais, autant qu'il m'était possible, les parties gazonnées du désert, afin de dépister les Indiens qui immanquablement devaient me poursuivre,[Pg 271] mais qui chercheraient en vain ma piste dans l'herbe relevée par la rosée du matin.
N'ayant pris avec moi aucune provision, je commençais à souffrir cruellement de la faim et de la soif, lorsque je pus enfin m'emparer d'une jeune gama. La terreur que j'éprouvais était telle, que pour ne point ralentir ma fuite en prenant le temps de faire cuire mon gibier, je l'attachai autour de moi à l'aide de mon lazzo et je le dévorai ainsi tout cru, mordant à même le corps tout en galopant.
Cette course désordonnée durait depuis quatre jours déjà, quand le cheval que je montais s'abattit: il était mort.
Craignant avec raison, de perdre de même les deux qui me restaient et de qui seuls dépendait mon salut, j'eus dès lors la précaution de les laisser se délasser une partie de la nuit; ce qui ralentissait extraordinairement ma marche, bien que l'idée fixe que j'avais d'être poursuivi m'animât malgré moi à les stimuler durant le jour.
Dans un de ces moments de repos, tandis que les yeux inquiets et les oreilles tendues,[Pg 272] je m'obstinais à vouloir percer l'obscurité qui m'entourait ou à saisir le moindre bruit défavorable, il me sembla entendre les aboiements d'un chien, qui devinrent bientôt de plus en plus forts et ne me laissèrent plus aucun doute. Saisi d'effroi, pensant naturellement que ce chien devait précéder les Indiens, je m'élançai à la hâte sur l'un de mes chevaux, et chassant l'autre devant moi, je partis à toute bride. Mais à quelque distance, ayant une côte à gravir, ces malheureux animaux déjà harassés se refusèrent à marcher autrement qu'au pas. Ce qui donna au chien que j'avais entendu tout le temps de me rejoindre. A peine fut-il près de moi qu'il manifesta la plus grande joie. Quelle ne fut pas ma surprise en reconnaissant en lui un pauvre chien que j'étais parvenu à apprivoiser et avec lequel j'avais souvent partagé mes repas. Son attachement était tel qu'il s'était habitué à m'accompagner dans toutes mes excursions. Il m'avait sans doute suivi dès mon départ, mais ma grande préoccupation et la vitesse de ma course m'avaient empêché de l'apercevoir[Pg 273] plus tôt. Complètement rassuré je m'arrêtai de nouveau, pour laisser cette fois, mes chevaux se reposer plus longtemps que je ne l'avais encore fait.
Quand ils eurent suffisamment mangé et bu, je repris le cours de mon dangereux voyage, pendant la durée duquel, mon chien et moi, nous fûmes condamnés à ne vivre que du produit de notre chasse, que nous dévorions tout sanglant.
Après un autre espace de temps que je ne puis préciser, car toutes les journées, toutes les heures se ressemblaient, la fatigue et le manque d'eau me privèrent d'un second cheval. J'aurais voulu ne pas l'abandonner et attendre auprès de lui son rétablissement ou sa mort, mais la désolante nature du sol, n'offrait aucune ressource, et en restant je m'exposais également à perdre ma dernière monture qui avait résisté à toutes les épreuves.
Je partis le cœur navré, décidé à ménager par tous les moyens, mon cheval et mon chien, mes derniers compagnons de misère. Je m'astreignis à n'exiger d'eux aucun effort; nous n'avancions que fort lentement, épuisés[Pg 274] de faim et de soif, quant à la tombée de la nuit, je remarquai que de lui-même mon cheval doublait le pas; à la fraîcheur du terrain qu'il foulait, et avec l'instinct propre à tous les hôtes de ces vastes déserts, le pauvre animal avait senti le voisinage de l'eau.
Peu d'instants après, nous étanchions notre soif commune dans ces lagunes que déposent dans le nord de la Pampa les filets d'eau issus des contreforts des Andes dans les provinces de Mendoza et de San Luiz. Autour de ces bassins une herbe abondante et touffue, permit à mon pauvre coursier de réparer ses forces. Grâce à cette provende inespérée, il put me porter jusqu'à Rio-Quinto, où moins heureux que mon chien, il s'affaissa tout à fait épuisé; et moi, à bout de forces, mourant de faim, de fatigues physiques et morales, je tombai à ses côtés sans mouvement et sans voix.
C'était le treizième jour de ma fuite!... Je ne puis en fixer le quantième, mais c'était vers le milieu de 1859.
Dieu, qui avait daigné me protéger jusque là permit que je fusse trouvé dans cet état[Pg 275] par une excellente famille espagnole, habitant Rio-Quinto, qui ayant pitié de ma détresse, s'empressa de me recueillir et de me transporter chez elle.
[Pg 276]
Séjour à Rio Quinto. Départ pour Mendoza.
Rio-Quinto n'est point une ville, mais simplement un petit bourg situé sur la rivière de ce nom, à mi-chemin de Rosaire à Saint-Louis, c'est à dire à 75 lieues de l'un et de l'autre. On n'y compte guère plus de cinq à six cents habitants pour la plupart abrités par des maisons informes. Ils se livrent à l'élève et au trafic du bétail. Quelques-uns sont négociants, et tiennent des porpérias ou almacènas—magasin—dans lesquels se trouvent entassés pêle-mêle toutes les choses nécessaires, à l'existence ou à la toilette: depuis des légumes jusqu'à des robes de soie. D'autres font spécialement des échanges avec[Pg 277] les Indiens, auxquels Urquiza donne le droit d'entrer dans la ville.
Dès le lendemain de mon installation chez les personnes qui m'avaient recueilli je fus atteint d'une longue et douloureuse maladie qui me retint alité pendant plus de six semaines durant lesquelles je fus plongé dans le délire.
Malgré toutes les difficultés qu'ils éprouvaient à s'approcher de moi, car mon chien encore presque sauvage ne me quittait pas un seul instant, mes hôtes me prodiguèrent les soins les plus empressés et les plus touchants. J'eusse été un parent que certes ils ne m'eussent point témoigné plus de sollicitude.
Lorsque j'entrai en convalescence, ils saisirent toutes les occasions de me procurer des distractions. Pourtant malgré leurs efforts je restais languissant et le calme ne se rétablissait point dans mon esprit pendant si longtemps surexcité et torturé. J'étais constamment comme sous l'impression d'un terrible cauchemar, dans lequel se déroulaient à mes yeux toutes les horribles phases de ma vie d'esclavage, pendant laquelle j'avais été[Pg 278] nuit et jour exposé à mourir d'une manière tragique. Tantôt c'était le souvenir des nombreux assassinats que j'avais vu consommer par les Indiens sous mes yeux, ou bien encore celui des diverses circonstances, où, aux prises avec mes assassins, j'avais dû faire preuve du plus grand sang-froid et de beaucoup d'énergie en luttant contre eux. Quand ces horribles visions s'effaçaient de ma vue, et que le calme renaissait dans mes sens abattus, je me sentais incapable de parler ou d'agir. Ma faiblesse était telle, que le seul bruit de ma voix me causait une sorte d'étonnement et de tristesse, car l'usage de la parole était pour le moins aussi nouveau pour moi que la jouissance de cette chère liberté, après laquelle j'avais gémi et pleuré tant de fois.
Lorsque je me sentis un peu raffermi moralement et physiquement, je songeai à reconnaître, autant qu'il était en mon pouvoir de le faire, la générosité de mes hôtes et à leur en prouver ma reconnaissance. Comme ils étaient négociants et que je les voyais débiter sur une assez grande échelle du savon de leur fabrication, lequel était fort grossier, je leur[Pg 279] proposai d'établir une usine semblable à celles que j'avais vues dans les environs de Buenos-Ayres et de me charger moi-même de la fabrication, à l'aide d'un procédé dont ils n'avaient jusqu'alors pu faire l'essai.
Cette offre ayant paru leur sourire infiniment, je déployai la plus grande activité pour sa réalisation.
Je fis construire par un maçon du pays un grand fourneau à deux chaudières et un bassin. Les chaudières à robinets que j'avais fait venir de Buenos-Ayres, étant fort petites, je suppléai à ce défaut par l'adjonction de fortes cuves de bois dur de même diamètre, parfaitement ajustées sur chacune d'elles, où elles furent cimentées. A moitié profondeur du bassin, construit en briques, j'organisai un filtre avec des planches non-jointes, sur lesquelles je croisai un lit de paille. Je fis venir de Cordova de la cendre d'un bois que les espagnols nomment pale de fume. Ce bois brûlé vert donne une cendre cristalline contenant une très-grande quantité de potasse, dont on opère facilement la séparation à l'aide de chaux baignée d'eau.
[Pg 280]
Quand j'eus ces matières à ma disposition, je mis sur le filtre du bassin, tantôt une couche de cendre, tantôt une de chaux, jusqu'à ce qu'il fût plein et je fis couler sur le tout assez d'eau pour le remplir. Au dessous du bassin j'avais fait faire un réservoir de la même contenance dans lequel tombait la potasse liquéfiée. A défaut de pèse-lessive, je fis usage d'un œuf pour connaître la force de ce mélange auquel les espagnols donnent le nom de lessive. Je mis dans les chaudières une quantité d'eau suffisante pour empêcher la graisse crue et en rames, dont je remplis les cuves, de s'attacher au fond. Puis je fis un grand feu. La graisse que j'agitais avec un pieu, fondit petit à petit; quand elle le fut complètement, j'éteignis le brasier pour le laisser refroidir jusqu'au lendemain matin. Avant de chauffer de nouveau, je soutirai la potasse de la veille, qui entraîna avec elle et sous forme de crasse tout le tissu fibreux de la graisse alors épurée. Je versai dans mes cuves une quantité de potasse plus grande que celle de la veille et je fis bouillir ce mélange pendant tout le jour. Grâce à l'acide,[Pg 281] je vis bientôt la graisse changer d'aspect, et prendre celui d'une compote, puis enfin celui d'une gélatine qui m'indiqua que j'avais obtenu un bon résultat. Je supprimai alors tout le feu; puis avec des seaux je mis le savon dans d'énormes moules en bois, intérieurement doublés de zinc et en forme de parallélogrammes. Quand il fut complètement refroidi, je le coupai en planches de plusieurs épaisseurs qui furent à leur tour divisées en un certain nombre de pains.
Mon premier essai surpassa l'attente de Juan-José mon hôte et celle de sa famille qui écoula promptement ce produit dont le succès fut très-grand.
Au bout de quelque temps, enchanté du service que je venais de lui rendre, mon cher et généreux hôte, comprenant qu'il lui serait facile d'augmenter sa fortune par cette nouvelle exploitation, me pressa instamment d'en conserver la direction et de m'associer avec lui. Malgré la belle perspective que cette offre fit luire à mes yeux, il me fallut y renoncer; depuis que j'habitais Rio-Quinto, j'étais constamment et avidement[Pg 282] épié par les Indiens, qui s'y succédaient sans relâche, et dont le projet était de me sacrifier à leur vengeance. Souvent j'en rencontrais dans la journée, ils ne m'adressaient la parole que pour me menacer de mort. Ils n'osaient, il est vrai, tenter d'exécuter leurs menaces en plein jour, mais souvent la nuit, ils escaladèrent les murs derrière lesquels j'étais abrité. En deux ou trois circonstances, je ne dus la vie qu'aux aboiements de mon fidèle chien, car ils forcèrent ma porte.
Séjourner plus longtemps à Rio-Quinto eût été sacrifier mon existence; aussi renonçai-je définitivement à toute idée de fortune, et malgré mon vif chagrin, je me séparai brusquement de mes bienfaiteurs, dont les instances eussent pu faire fléchir ma résolution. Je leur fis passer une lettre d'adieu, datée du village des Atchiras, deux jours seulement après mon départ. Je leur exprimais tout à la fois, ma profonde gratitude et le motif puissant qui m'obligeait à me séparer d'eux, car l'extrême bonté de ces personnes étrangères, m'a pénétré pour don Juan et pour tous les siens, d'une vive reconnaissance[Pg 283] qui ne s'effacera jamais de ma mémoire, et je serais heureux si ces humbles lignes pouvaient leur en porter le témoignage à travers l'océan.
Je m'étais mis en route presque sans ressources et pédestrement, en compagnie de Chilène, mon chien. Il me fallait faire cent trente deux lieues pour gagner la capitale des Andes, j'avais encore mille dangers à affronter; de plus j'encourais le risque d'être repris par les Indiens des mains desquels je ne m'étais tiré qu'à si grand peine.
Par mesure de précaution, je ne marchai que de nuit, me cachant le jour dans des terriers de viscachas ou bien entre des rochers. Je souffris beaucoup de la fatigue, de la soif et de la faim pendant tout ce voyage, que je n'aurais sans doute pu accomplir si je n'avais eu le bonheur de trouver sur ma route, quelques hameaux et la ville de Saint-Louis, dont les habitants m'offrirent la plus cordiale hospitalité. J'eus beaucoup à souffrir encore durant le long trajet de Saint-Louis à Mendoza, pendant lequel je trouvai à peine suffisamment d'eau pour me désaltérer, et[Pg 284] pendant lequel je ne rencontrai âme qui vive.
Enfin après seize jours d'une marche pénible j'arrivai en vue de Mendoza.
Il était temps que j'atteignisse au terme de mon voyage, car mes chaussures et mes vêtements déjà plus qu'à demi-usés à mon départ, menaçaient de me quitter tour à tour.
[Pg 285]
Mendoza
Comment dépeindre les diverses émotions qui m'assaillirent lorsque épuisé de fatigue et de besoin j'entrai un soir dans Mendoza.
Il était environ huit heures. Le plus grand calme régnait dans toutes les rues où je m'étais engagé au hasard. Je n'avançais qu'à pas lents et tout en chancelant. A ma démarche et à mon triste costume, bien des Européens m'eussent regardé comme un être vil, succombant sous le poids d'une ignoble débauche. J'étais à bout de forces: le courage et l'espoir de trouver à qui m'adresser pour demander du secours me soutenaient seuls encore.
De rue en rue j'atteignis la plus aristocratique,[Pg 286] dans laquelle la clarté s'échappant à flots de fenêtres richement tapissées guidait mes pas mal assurés. De joyeux éclats de voix frappèrent mon oreille et pénétrèrent profondément dans mon cœur brisé, éveillant tous mes souvenirs. Mû par un sentiment irrésistible, je m'approchai de la maison d'où ces voix semblaient partir. A travers les rideaux d'une mousseline riche et légère mes regards envieux purent plonger dans un somptueux intérieur où se tenait nombreuse compagnie. Je ne sais depuis combien de temps mes regards avides, se portant des uns aux autres s'obstinaient à y chercher quelques anciens amis lorsque des doigts habiles exécutèrent sur le piano le Réveil des Fées, morceau que j'avais entendu jouer bien des fois par ma sœur chérie.
Il se fit en moi une telle révolution pendant ces courts instants qui me rappelèrent tout un passé de bonheur, que les forces m'abandonnèrent; je m'affaissai sur le sol, les yeux remplis de larmes abondantes auxquelles succéda un sommeil douloureux.
Lorsque je m'éveillai, il me sembla sortir[Pg 287] d'un rêve tout à la fois joyeux et pénible. Une profonde obscurité planait autour de moi; j'étais étendu sur la terre près de la maison dont chacun était sorti sans m'apercevoir.
Anéanti, ne sachant où diriger de nouveau mes pas, j'attendis le jour, qui ne tarda pas à paraître. Je fus assez heureux pour passer devant une maison où l'on parlait français. J'y entrai. Quand j'eus fait en partie le récit de mes malheurs, hommes et femmes me firent un touchant accueil, et m'entourèrent des principaux soins que réclamait mon triste état.
Que de fois dans ma souffrance ne me suis-je pas dit: quel est le Français, au sein de sa patrie, qui pourrait croire à la vraisemblance des malheurs auxquels sont exposés nombre de ses compatriotes dans un pays comme l'Amérique, que l'on croit civilisé, exploité même?
La ville de Mendoza était située, ainsi qu'on le sait, au pied des Andes. Elle était, comme toute la contrée qui l'environnait, arrosée par une multitude de canaux alimentés par le Rio de Mendoza, rivière qui bornait[Pg 288] alors la partie occidentale de la ville. Du côté oriental de ce cours d'eau rapide, prenait naissance un petit canal ou rigole de six à huit pieds de largeur, qui alimentait toute la ville en passant par l'Alaméda, vaste boulevard, planté à chacun de ses côtés d'un double rang de peupliers, qui donnaient à cette promenade publique un aspect des plus majestueux et des plus ravissants. On y voyait affluer chaque soir, durant la belle saison une nombreuse société aristocratique, vêtue avec autant de goût que de luxe.
Ce spectacle charmant contrastait singulièrement avec le désert et silencieux aspect de toute la ville pendant le jour. Tous depuis le plus riche jusqu'au plus pauvre se livraient dans la journée aux douceurs d'une sieste qui durait généralement depuis midi jusqu'à cinq heures; et pendant ce temps on n'apercevait guère que quelques femmes, nonchalamment assises à leurs fenêtres dans le déshabillé le plus complet. Vers cinq heures seulement, lorsque le soleil commençait à perdre de sa force, la population qui semblait s'éveiller, s'animait soudain.
[Pg 289]
On voyait se mêler à la foule qui se pressait par les rues, des gauchos à cheval, vendant de côté et d'autre des fruits de toute espèce; ou bien des mendiants, également montés sur des chevaux, s'arrêtant aux portes et aux fenêtres, réclamant l'assistance publique en chantant des psaumes d'une voix nasillarde et lamentable. Enfin quelques grotesques idiots se voyaient, auxquels les enfants se plaisaient à prodiguer des gourmandises de toutes sortes pour jouir quelques instants de leurs tristes et répugnantes bouffonneries. Toutes les rues étaient d'un alignement parfait et d'une grande propreté; les maisons fort basses, de peu d'apparence à l'extérieur, mais généralement meublées avec beaucoup de luxe. On voyait aussi plusieurs églises remarquables, dans le voisinage de la place de la Victoire, au milieu de laquelle s'élevaient une fontaine et une colonne.
Mais à quoi bon essayer de dépeindre ici cette superbe cité qui après n'avoir longtemps éveillé dans mon âme que des tableaux de bonheur, des pensées de bénédiction et de gratitude, ne doit plus y évoquer désormais[Pg 290] que des images lugubres et d'amers regrets.
Là vivaient dans la sécurité la plus profonde vingt mille âmes dont le reste du monde pouvait envier la calme existence; c'était la population la plus douce, la plus heureuse, la plus hospitalière du continent Américain. Le 19 mars 1861, les poètes Argentins appelaient encore Mendoza la perle, la reine de la zone fleurie qui s'étend au pied oriental des Andes..., le lendemain la mort passait sur ce paradis. «Quelques secondes ont suffi pour convertir ses riantes habitations, ses jardins, ses églises, ses colléges fréquentés par la jeunesse des provinces voisines, l'œuvre de trois siècles enfin en une épouvantable nécropole, en un monceau hideux de décombres, en un chaos de roches, de terre, de briques et de madriers brisés (Corresp. du Journal des économ).»
Suivant les géologues, le tremblement de terre qui a fait éprouver à Mendoza le sort d'Herculanum, et dont la commotion s'est fait sentir sur toute la ligne qui s'étend de Valparaiso à Buenos-Ayres, c'est-à-dire sur plus de dix-huit cents kilomètres, n'a pas été,[Pg 291] comme le terrible phénomène de l'an 70, amené par la réouverture d'un volcan longtemps fermé, mais par la seule dilatation d'une masse de fluides élastiques, émanés du foyer central et projetés par lui dans les immenses cavités de la croute terrestre; une cause quelconque les a sans doute accumulés tout-à-coup au carrefour de plusieurs de ces sombres souterrains. Au-dessus de cette voûte ébranlée, disloquée par la pression de ces fluides était Mendoza: de là son immense ruine.
Chose étrange! on assure que sur ce monceau de débris informes, sur cet effroyable linceul qui recouvre quinze mille victimes humaines, les végétaux seuls sont restés debout, et que les fleurs continuent à prospérer et à sourire au milieu des émanations pestilentielles qu'exhale cette immense sépulture.
Le saule-pleureur était l'arbre favori des Mendozaniens; on le voyait partout chez eux; il était l'ornement de prédilection de leurs jardins, de leurs places, de leurs promenades; il ombrageait les cours de leurs demeures[Pg 292] hospitalières, toujours ouvertes à l'étranger; aujourd'hui, comme le souvenir de gratitude que je leur ai gardé, il s'incline et pleure sur les morts.
[Pg 293]
Départ de Mendoza.—Passage de la Cordillière.
Le désir de revoir ma patrie, mes inquiétudes au sujet de ma famille de laquelle je n'avais aucune nouvelle depuis mon départ de France, et le mauvais état de ma santé nécessitant des soins que je ne pouvais me donner vu l'état de complète misère dans lequel j'étais plongé, me suggérèrent l'idée de me rendre à Valparaiso.
En homme habitué aux fatigues et aux privations de toutes sortes, me sentant capable de lutter encore contre de nouveaux périls, je n'hésitai point à m'engager, à peine vêtu, presque sans chaussures et sans armes, dans le défilé des Andes qui conduit au Chili. Pour tout bagage j'avais une provision de pain.
[Pg 294]
Chilène, qui m'avait déjà donné tant de preuves de dévouement, devint de nouveau mon compagnon de route. Suivi de ce bon chien je traversai silencieusement Mendoza, en jetant à droite et à gauche un regard d'éternel adieu, tout en gravant scrupuleusement dans ma mémoire les sites les plus enchanteurs de cette superbe cité. Puis je longeai l'Alaméda à l'ombre de son quadruple rang de peupliers, et enfin la route de l'Uspaillate qui traversait une campagne superbe.
De chaque côté du chemin de magnifiques vignes étalaient à mes yeux admirateurs les monstrueuses grappes du raisin le plus beau; des quantités d'arbres surchargés de fruits de toute espèce m'apparaissaient au milieu des flots de riches moissons, ou surgissaient du sein de quelque parterre de fleurs européennes et exotiques entremêlées avec art.
Tout en contemplant ce luxueux tableau, dans lequel la nature étalait toute son opulence je n'avançais que fort lentement, plongé, sans m'en douter, dans un rêve d'admiration qui me faisait presque oublier mes maux passés.
Après avoir parcouru de la sorte un espace[Pg 295] d'environ deux lieues, les canaux artificiels se terminant, la fertilité cessa tout-à-coup. Pendant plus de dix autres lieues que je fis encore pour m'approcher des montagnes, je ne parcourus plus qu'une plaine sablonneuse, complètement sèche et aride, où de temps à autre seulement se rencontraient quelques broussailles raccornies par le soleil.
Pendant tout ce trajet fait au plus fort des grandes chaleurs et sans me reposer, mon chien et moi nous souffrîmes beaucoup de la soif. J'avais bien emporté une haspa—corne de bœuf—pleine d'eau, mais nous l'eûmes bientôt vidée tous les deux après quelques heures de marche. Chilène tirait horriblement la langue, et me regardait d'un air triste en levant tour à tour ses pattes endolories par l'incroyable chaleur du sable fin que nous foulions depuis le matin. Après maints détours nous atteignîmes le premier ravin de la Cordillière qui cachait un petit filet d'eau bientôt découvert par Chilène, et dans lequel il n'hésita pas à entrer, à seule fin de se rafraîchir aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Je suivis son exemple,[Pg 296] puis je cherchai un endroit favorable pour y passer la nuit. Une fois installé, j'atteignis un peu de pain que nous mangeâmes tous deux avec joie.
Toutefois ce premier repas en tête à tête avec mon fidèle chien m'inspira plus de prudence pour les autres; car le gaillard peu habitué à se nourrir de la sorte y prit tellement de goût, qu'il trouva tout simple de s'emparer du restant de ma part que, sans la moindre défiance, j'avais posé à côté de moi. Je reposai mais il me fut impossible de fermer l'œil, obsédé que j'étais par mille pensées et par le froid glacial qui se fit sentir.
Le lendemain je m'engageai dans l'étroit passage à pic que j'avais devant moi, et qui me conduisit à la posta de Villa Vicencia, où je fus assez heureux pour boire un peu de lait et manger un peu de viande bouillie. L'appétit de mon chien ne me parut pas très grand, et comme j'avais remarqué qu'il boîtait, je commençai à concevoir quelque inquiétude sur sa santé.
Après avoir examiné ses pattes desquelles j'extirpai quelques épines fines et longues, je[Pg 297] les lui graissai et les lui enveloppai soigneusement de petits linges qu'il eut l'instinct et la patience de conserver. Une grande partie de la journée qui suivit fut entièrement consacrée au repos si nécessaire à tous deux. La poste de Villa Vicencia était alors une habitation spacieuse et proprette où tout voyageur s'apprêtant à franchir la Cordillière pouvait sans peine compléter ou renouveler ses provisions; celui qui venait du Chili, et que dix à douze journées de marche avaient dénué de tout pouvait également s'y refaire l'estomac et soigner ses mules avant de gagner Mendoza: il m'était donc loisible de me procurer des aliments et de soigner mon malheureux chien.
Les propriétaires de cet établissement chez lesquels, la saison n'étant pas encore suffisamment propice, je ne rencontrai aucun autre voyageur, se montrèrent pour moi des plus affables et des plus hospitaliers. Ils furent aussi très surpris de me voir entreprendre seul et à pied un voyage aussi périlleux que celui de la traversée des Andes. La pénible position dans laquelle je leur parus être, piqua[Pg 298] leur curiosité, en même temps qu'elle éveillait en moi le besoin d'épanchement.
A force de questions et sans m'en douter, je leur eus bientôt tracé un tableau presque complet de mes malheurs. De confidence en confidence ils en vinrent à savoir que je n'avais dans ma pauvre bourse que cinq piastres et quatre réaux, environ 27 francs, et ils se refusèrent à recevoir la moindre rétribution pour leurs bons offices: ils me forcèrent même encore, d'accepter quelques provisions pour m'aider à gagner l'Uspaillate. J'appris d'eux que j'étais tout proche des sources thermales de Villa Vicencia, fort connues et fort appréciées des Américains, en raison de leur grande efficacité contre les rhumatismes, et où chaque année se rend un très-grand nombre de visiteurs des deux sexes. Malgré le vif désir et le besoin que j'avais de les visiter, j'y renonçai, car Chilène, bien qu'il fût extrêmement fatigué et souffrant, se fût probablement obstiné à m'y accompagner; je préférai le voir profiter du repos que j'avais résolu de lui laisser prendre.
Au bout de deux jours, son état s'étant[Pg 299] sensiblement amélioré, je pris congé de mes excellents hôtes en leur témoignant de mon mieux toute ma gratitude; mais leur délicatesse fut telle qu'ils me fermèrent pour ainsi dire la bouche en me donnant quelques renseignements sur le chemin que j'avais à parcourir encore avant d'atteindre l'Uspaillate. En les quittant je commençai à gravir la pente rapide qui conduit au Paramillo et à l'un des nombreux détours de ce difficile chemin. Sur ma droite je vis le Serro Dorado—montagne dorée—ainsi nommée en raison du reflet doré que lui donne une quantité innombrable de petites plantes jaunes dont il est entièrement recouvert depuis la base jusqu'au sommet.
Chilène me suivit tant bien que mal pendant toute la journée qui fut malheureusement très-fatigante pour l'un comme pour l'autre. Après une ascension fort difficile et presque continuelle nous atteignîmes pourtant le pittoresque et imposant sommet du Paramillo, entouré et dominé tout à la fois par d'incommensurables crêtes rocheuses criblées de fissures et sur la plupart desquelles d'immenses[Pg 300] blocs placés en équilibre menacent le voyageur de l'écraser dans leur chûte.
Trop tôt surpris par une nuit des plus profondes, il me fut impossible de me hasarder plus loin. Je m'installai donc sur le bord d'un petit filet d'eau qui m'avait servi de guide depuis mon départ de Villa Vicencia et dont la source était en cet endroit.
J'avais étendu mon puncho sur lequel je me disposais à dormir quand, avec une surprise extrême, j'aperçus une timide et tremblante lumière que j'aurais tout d'abord juré sortir du sein de quelque montagne voisine. Poussé par la curiosité et guidé par sa lueur, j'en suivis la direction. Quel fut mon étonnement de rencontrer en cet endroit si désert et si aride deux sortes de cabanes, grossièrement construites avec des éclats de rochers empilés les uns sur les autres et seulement recouvertes de branchages insuffisants à parer la chûte des énormes pierres que détachent et font pleuvoir sans cesse les vents continuels.
L'une, la plus petite, n'avait pas plus de deux mètres carrés; elle était habitée par toute une famille, composée du père, ouvrier[Pg 301] mineur, homme déjà d'un certain âge; de sa femme plus jeune que lui d'au moins une quinzaine d'années, et enfin de deux enfants, l'un de sept à huit ans environ et l'autre de deux à trois seulement, tous deux nés dans cet endroit, où malgré la tristesse du lieu et les incessants dangers dont ces bonnes gens étaient entourés, ils menaient une vie paisible. J'obtins facilement de ce pauvre homme, propriétaire des deux cases, la permission de passer la nuit dans celle qu'il n'habitait point, et qu'il me dit alors, avec une touchante bonhomie n'avoir construite que pour l'usage des voyageurs, desquels malgré sa pauvreté, il ne veut accepter que des remercîments. A mon entrée dans cette cabane, plusieurs chauves-souris effrayées par ma brusque apparition et celle de Chilène, s'enfuirent en se heurtant à mon visage, mais elles revinrent bientôt partager mon abri contre l'intensité du froid. Quoique je fusse étendu sur la terre nue, je passai une excellente nuit, ainsi que mon chien.
En quittant ce lieu hospitalier je rendis hommage à la générosité de cet excellent[Pg 302] cœur qui, si malheureux lui-même, cherchait encore à rendre service à son semblable.
Avant de franchir le Paramillo, dernier point d'où l'on put embrasser d'un seul coup d'œil, tout l'espace qui sépare de Mendoza, je ne pus résister au désir de contempler encore une fois l'aspect varié de cette belle province à laquelle tant de mes souvenirs se rattachaient. Après lui avoir adressé mentalement un de ces adieux qui ne s'effacent jamais de la mémoire, je m'éloignai à pas précipités en m'engageant dans un chemin tortueux et rapide qui ne finit qu'à l'Uspaillate, dernier établissement Mendozanien, et en même temps dernier souvenir de civilisation. Au-delà de cet endroit, les voyageurs ne doivent plus voir pendant 8 à 10 jours, que le ciel tour à tour brumeux ou éclatant d'azur, des montagnes imposantes et des gouffres effroyables.
Chilène, déjà très-fatigué de la veille, fut plus que jamais exposé à souffrir, car l'eau devait nous manquer pendant toute la journée; ses pattes devinrent tellement enflées et douloureuses que, ne pouvant supporter plus longtemps les linges dont je les lui avais enveloppées,[Pg 303] il les arracha tour à tour avec une sorte de rage. Ce ne fut qu'avec la plus grande peine qu'il me suivit jusqu'à l'Uspaillate. Je craignais d'être obligé de me séparer de ce fidèle compagnon dont la société avait si souvent charmé les longs instants de mon triste esclavage; ma peine fut d'autant plus grande que mon abandon l'exposait à mourir de faim ou à être dévoré par les animaux féroces. Si je n'eusse été aussi épuisé moi-même, j'aurais tenté de le porter de temps à autre, mais l'ayant soulevé je sentis toute l'impossibilité d'accomplir mon désir.
Pauvre Chilène, pensais-je, sera-ce là la récompense de tout ton dévouement, toi qui m'en as donné des preuves dont peu d'hommes se fussent sentis capables, et qui, malgré toutes tes souffrances, redouble encore de courage pour m'accompagner dans cette route pénible!
La chaleur était des plus accablantes: aucune source pour nous rafraîchir: pour toute vue, de malheureux chevaux et mulets, abandonnés dans le plus piteux état; les uns boîteux, les autres à demi écorchés, mourant de[Pg 304] faim et de soif; de soif surtout, car ces pauvres animaux sont habitués à un tel jeûne dans la Cordillière qu'ils se contentent la plupart du temps de manger la fiente les uns des autres. Tout autour d'eux gisaient une quantité incroyable de squelettes d'animaux de même race; les uns ayant conservé leur peau, les autres totalement dépouillés, et dont les tristes restes disaient hautement à ces pauvres estropiés quel sort les attendait.
Arrivé à un large carrefour auquel vient aboutir le chemin de Saint-Juan qui opère en cet endroit sa jonction avec celui de Mendoza, notre marche devint beaucoup plus difficile encore; le sol de ce plateau entouré de montagnes toutes crevassées et de couleurs variées, était composé d'une brûlante et épaisse poussière, tantôt rouge, tantôt jaune ou verte, formée des débris des rochers environnants, sur laquelle le soleil produisait un effet curieux et magnifique mais où j'enfonçais jusqu'aux genoux.
Mourant de fatigue et de besoin, je fus heureux d'être accueilli à la maison de poste de l'Uspaillate, par d'excellentes personnes,[Pg 305] parfaitement disposées à me procurer tout ce qui était en leur possibilité. Je fis donc un bon repas, ainsi que mon pauvre Chilène dont les souffrances furent le sujet d'une longue conversation dans laquelle je racontai comment je me l'étais attaché chez les Indiens, et avec quelle fidélité il m'avait suivi jusqu'alors. Ces excellentes gens comprirent tout le souci que me causait l'impossibilité où il était de m'accompagner jusqu'à la fin de mon voyage, et touchés de mon chagrin ainsi que du triste état de mon pauvre compagnon, ils m'offrirent de le garder. J'acceptai cette offre avec joie. Ce ne fut cependant pas sans un bien vif regret que je le quittai le lendemain matin, pensant ne plus le revoir.
Avant d'arriver aux premières montagnes, qui me paraissaient peu éloignées, je parcourus durant encore cinq à six heures une plaine aussi nue que celle qui précède l'Uspaillate, puis je franchis deux torrents rapides; en suivant les bords tortueux du second, je me trouvai positivement en chemin d'escalader la Cordillière.
Je ne devais plus voir aucune trace de verdure,[Pg 306] car je ne me trouvais plus environné que de rochers entre lesquels j'apercevais, à de rares intervalles seulement, quelques arbustes rabougris donnant une idée complète de l'aridité du sol et de la rigueur des saisons. Malgré les nombreuses difficultés du chemin, jonché pour la plupart du temps de pierres sur lesquelles mes pieds en tournant se fatiguaient horriblement, et l'état de tristesse dans lequel j'étais plongé, je ne pus m'empêcher d'admirer souvent l'effet bizarre de toutes ces montagnes échelonnées les unes sur les autres, à l'aspect infiniment varié, et dont la cîme élevée disparaît dans les nuages. Le bruit étourdissant d'un torrent impétueux dans lequel, à une profondeur immense, roulaient de monstrueux blocs de rochers, et celui du vent soufflant avec violence dont les échos répétaient les mugissements, étaient les seuls qui troublassent cette immense solitude.
Après avoir cheminé durant tout le jour sans presque m'arrêter, je me retirai à la nuit tombante dans une crevasse qui me servit de lit. Au sein de l'imposante et glaciale solitude dont j'étais entouré, mille pensées m'assaillirent[Pg 307] qui prirent la forme de rêves fiévreux; je fus éveillé bien avant le jour, tourmenté par un froid incisif contre lequel je n'avais à opposer qu'un léger puncho de coton, un pantalon de toile et une chemise à demi usée qui formaient tout mon vêtement. Ne pouvant m'engager sans danger dans cette route périlleuse avant que le jour ne fût venu, pour abréger le temps, je satisfis aux exigences de mon estomac en rompant un peu de pain sec, que j'aurais volontiers arrosé de mes larmes en pensant à mon fidèle chien absent, à la compagnie et aux caresses duquel j'étais tellement habitué qu'involontairement mes yeux s'obstinaient à le chercher dans l'obscurité.
Aussi quelles ne furent pas ma surprise, ma joie et mon admiration, quand, aux premières lueurs du crépuscule, au moment où j'allais m'éloigner, j'aperçus mon pauvre Chilène venant à moi clopin clopant.
Malgré la nécessité de poursuivre mon voyage avec diligence, je ne pus m'empêcher de lui accorder un peu de repos dont il s'empressa de profiter. Mais à la satisfaction que[Pg 308] m'avait causé son apparition inattendue, succéda bientôt un vif chagrin, persuadé que j'étais que la pauvre bête ne pourrait continuer le voyage.
J'eus un instant la pensée de le reconduire à l'Uspaillate, mais j'étais déjà très-fatigué des jours précédents; en outre, les moments me devenaient tellement précieux, qu'une journée de retard pouvait m'exposer à être surpris par les mauvais temps, et à périr dans la Cordillière.
Force me fut donc de m'engager de nouveau dans l'étroit et tortueux sentier creusé sur le flanc des montagnes à pic, tantôt les gravissant presque à angle droit, ou tantôt en descendant les pentes rapides, ayant à ma droite leurs flancs rocheux, et à ma gauche un précipice béant au fond duquel, bondissait avec fracas un torrent écumant dans lequel le moindre faux pas ou le vertige pouvaient me précipiter.
Au fur et à mesure que j'avançais, le nombre de mulets morts dont est éternellement jonchée la route depuis Mendoza jusqu'à l'Aconcagua, m'apparaissait plus considérable.[Pg 309] En plusieurs endroits, je vis sur le versant rapide de la montagne, des débris de caisses, de linge et de vêtements, mêlés à des squelettes de mules arrêtés dans leur chûte par quelques saillies anguleuses du roc.
C'est surtout à proximité del ladèra de las vacas que l'on rencontre ces restes accusateurs des scènes terribles de la Cordillière.
En cet endroit la montagne s'élève presque perpendiculairement, tandis que de l'autre côté elle descend à pic jusqu'au rapide torrent qui lutte avec sa base. J'eus toutes les peines imaginables à gravir et à descendre ce redoutable passage, et je ne pus m'empêcher de plaindre sincèrement les mules qui, chargées à l'extrême, sont appelées à le franchir, après déjà bien des jours de privation et de fatigue.
Plus loin j'atteignis une casucha dans laquelle je passai la nuit. Là encore je vis un nombre incroyable d'ossements épars, provenant sans doute de quelque troupe entière, victime d'un ouragan ainsi que cela arrive si fréquemment.
Je me trouvais dans le plus piteux état et à[Pg 310] bout de provisions. Je n'avais point encore rencontré de muletiers, et je désespérais presque de me procurer quelques aliments, quand enfin je vis une troupe de mules campée au pied de la Cambre. Je me rendis en toute hâte auprès des arrièros, qui me firent le meilleur accueil et me convièrent à prendre un peu de thé Américain et à diner avec eux. J'acceptai avec d'autant plus de joie, que mes petites provisions avaient tout au plus suffi à calmer mon appétit aiguillonné par l'air vif des montagnes. Je pris place à côté du chef de la troupe, près d'un bon feu devant lequel bouillait la casuèla,—pot au feu Américain,—et sur lequel rôtissaient des schurascos, bandes de viande desséchée, ou espèce de beefteck à l'usage des Argentins. Pendant le diner les plus jeunes de la troupe surveillèrent à tour de rôle les mules éparpillées sur la cîme des monts environnants, seuls endroits où se trouve quelque verdure. La soirée se passa fort gaiement pour tous, et chacun eut pour moi toutes sortes d'attentions délicates: ce fut à qui me prêterait de quoi me composer un bon lit dans lequel je[Pg 311] passai une excellente nuit qui, jointe au copieux repas que j'avais fait, me rendit les forces dont j'avais si grand besoin pour continuer ma route.
Ce ne fut pas sans peine que je me séparai de ces excellentes gens, qui eurent encore la bonté de me faire accepter quelques provisions.
Comme nous suivions une route toute opposée je m'en allai seul, pensant à mon pauvre Chilène, que les souffrances avaient définitivement mis hors d'état de me suivre, et que j'avais malheureusement été contraint de laisser quelques lieues plus loin, presque mourant.
Pour franchir la Cambre, au pied de laquelle j'arrivai dans l'après-midi, j'eus à grimper, c'est le mot, pendant plus d'une heure et demie un sentier tortueux et étroit creusé à même le flanc de cette montagne presque à 45 degrés; luttant contre un vent des plus violents qui m'obligea fréquemment à me servir des pieds et des mains, afin de ne pas être précipité du haut en bas.
Quand j'atteignis la cîme des Andes, le[Pg 312] froid rigoureux m'empêcha de faire une halte aussi prolongée que je l'aurais désiré, au pied de la grande croix de bois érigée en cet endroit pour marquer la séparation du Chili d'avec la république Argentine. Je descendis, non sans beaucoup de peine, environ l'espace d'une demi-lieue par un chemin rapide et bordé de neiges éternelles qui me conduisit dans un bas-fond étroit où circulait avec fracas un cours d'eau au-dessus duquel de monstrueux rochers, provenant de la cîme des Andes, formaient un amas bizarre.
Après avoir suivi pendant plus de deux heures des pentes si raides qu'il semble presque aussi impossible à l'homme qu'aux animaux de les descendre, je me trouvai enfin hors des régions glaciales. Les montagnes me parurent alors d'un aspect moins sombre. Je trouvai en différents endroits quelques algarrobes bien verts à l'ombre desquels je me reposai avec bonheur. La transition du climat me sembla si merveilleuse que je croyais rêver.
En avançant encore, je me crus réellement transporté dans un pays enchanté; la[Pg 313] nature était verte et riante autour de moi: quelques champs, et la plupart des versants de montagnes ensemencés et plantés d'arbres fruitiers, puis une route bien entretenue, annonçaient en ces lieux la présence de nombreux habitants. La joie et l'admiration de ces merveilles me faisaient oublier ma fatigue et la longueur de la route. Cependant, j'étais à bout de forces lorsque j'atteignis la guardia, habitation dans le genre de celle de l'Uspaillate, où je pus me reposer et me refaire l'estomac avec un peu de viande rôtie et de vin: ce dernier dont j'étais depuis si longtemps privé, me fit l'effet du plus excellent cordial, et me plongea dans le plus profond sommeil. C'était la première fois que je couchais dans un lit depuis mon départ de Rio-Quinto; et bien qu'il fût loin de mériter son nom, j'y passai la plus délicieuse nuit.
Le lendemain, à mon réveil, je me remis en route, avec la bien légitime impatience d'atteindre au plus vite l'Aconcagua, premier bourg Chilien, que toutes mes fatigues, et toutes mes horribles souffrances me faisaient considérer comme une véritable planche de[Pg 314] salut, comme le chemin de ma chère patrie.
Il y avait encore loin de la Guardia à l'Aconcagua, mais le trajet si long qu'il fût était bien différent du précédent; le paysage était bien plus animé; de magnifiques troupeaux épars çà et là paissaient une fraîche luzerne qui me rappelait les champs de notre belle France. La route était bordée par une grande quantité de ranchos de chétive apparence, mais entourés de charmants petits jardins dont la vue rassérénait mon esprit. Dans plusieurs de ces frêles habitations où j'eus occasion d'entrer, soit pour demander à me rafraîchir, ou pour m'abriter pendant quelques heures de la brûlante ardeur du soleil, je fus agréablement surpris de voir quel ordre et quelle propreté régnaient partout. Dans chacun de ces pauvres intérieurs, je voyais de charmants enfants qui me parurent être l'objet de la plus tendre sollicitude; leurs parents semblaient mettre leur seul luxe dans l'ajustement de ces charmantes petites créatures, dont le joli visage épanoui contrastait tant avec les traits hideux des petits[Pg 315] Indiens que j'avais eus pendant si longtemps sous les yeux.
Tous ces braves gens en voyant mon état de maigreur et de dénûment ne pouvaient s'empêcher de témoigner une surprise qui grandissait au fur et à mesure que je répondais à leurs bienveillantes questions. Ils parurent on ne peut plus étonnés d'apprendre que j'avais eu la hardiesse d'effectuer seul la traversée des Andes, sans guide, et pour ainsi dire sans nourriture, surtout après avoir déjà enduré toutes les privations auxquelles j'avais été réduit en me rendant de la même façon de Rio-Quinto à Mendoza. Dans ce premier trajet cependant j'avais eu la possibilité de chasser, mais avec mille précautions dans la crainte d'être découvert par les Indiens. Lorsque je leur dépeignis mon horrible esclavage, ainsi que l'affreuse tyrannie dont j'avais été l'objet pendant plusieurs années, ce fut avec la plus grande sensibilité qu'ils prirent part à tous mes maux, et qu'ils s'enquirent de mes projets, m'offrant généreusement un asile chez eux, ou de me procurer les moyens de subvenir à mes besoins. Quelques-uns me[Pg 316] croyant artisan, me proposaient de me faire employer dans quelque ferme, ou dans une des nombreuses fonderies de cuivre qu'il y avait dans les environs. Mais j'avais hâte de gagner l'Aconcagua; je leur témoignai ma vive reconnaissance, en m'excusant sur l'impatience que j'éprouvais de me renseigner sur ma famille dont j'avais depuis si longtemps le chagrin de ne savoir aucune nouvelle.
Ils voulurent cependant m'obliger à passer quelques jours chez eux, afin de bien me reposer avant de continuer mon voyage; mais mon empressement d'arriver au but que je me proposais, m'empêcha d'accepter. Me voyant ainsi décidé à partir quand même, ils me chargèrent d'excellentes provisions qui, j'ose le dire, flattèrent un peu mon palais déshabitué des bonnes choses.
Pendant toute cette route je fus comblé de prévenances, car à peine sortais-je d'une maison, que d'autres habitants, non moins aimables, me forçaient à céder de nouveau à leurs pressantes instances qui, bien que retardant infiniment ma marche, m'étaient[Pg 317] on ne peut plus agréables et me remontaient le moral.
Enfin après tant de haltes si consolantes j'arrivai à l'Aconcagua; j'étais au Chili!
Tout en me reposant, je formais mille projets que les circonstances seules pouvaient m'aider à réaliser. J'hésitais entre Santiago et Valparaiso. La Providence qui m'avait si bien favorisé durant ma fuite et mes deux tristes et périlleux voyages, m'inspira le choix de Valparaiso. Alors j'employai la majeure partie de mes cinq piastres à payer la dépense que je venais de faire, et l'autre à me procurer des provisions. Malheureusement je ne pus en acheter une quantité suffisante pour la fin de mon voyage, car tout était fort cher; ce qui fit que lorsque j'arrivai à Quillotte, j'étais exténué de fatigue et de besoin.
Par bonheur, la première personne que je rencontrai fut un Français occupé à donner des ordres sur les travaux du chemin de fer de Santiago. Je m'approchai de lui, et lui adressant la parole en français, je le priai instamment de vouloir bien me donner de l'occupation; mais j'osai lui dire qu'avant tout je le[Pg 318] suppliais de me donner à manger, car je mourais d'inanition. Cet excellent homme, touché de ma misère et de mon état maladif, se hâta de satisfaire à mon désir; il m'emmena avec lui à son hôtel, et me fit partager son repas.
La manière dont je répondis à toutes ses questions lui fit présumer que je n'avais point été habitué à un travail manuel. Il jugea même, au délabrement de mon costume, que j'avais dû éprouver bien des revers avant de me trouver réduit dans le triste état où il me voyait. Il employa tous les moyens de stimuler ma confiance: sa franchise et son air de bonté parfaite, m'entraînèrent à lui ouvrir mon cœur. Je lui racontai alors dans tous ses détails, ma triste histoire, depuis mon départ de France, jusqu'au moment de sa rencontre.
Durant mon récit, son émotion fut grande, et souvent des larmes, envahissant furtivement sa paupière trahirent la bonté de son cœur. Parfois aux passages les plus émouvants, sa main rencontrait la mienne, et je ne pouvais me défendre de ces marques de sympathie,[Pg 319] car je sentais avoir trouvé en lui un ami capable de me consoler et de m'aider à lutter victorieusement contre l'effroyable destin qui me poursuivait.
Monsieur Barthès, (tel était le nom de mon protecteur) m'avait promis de m'occuper; et lorsque nous sortîmes de l'hôtel j'insistai pour entrer immédiatement en fonctions; il voulait s'y opposer, à cause de l'état de fatigue et d'extrême faiblesse dans lequel je me trouvais; mais je persistai, et j'obtins ce que je voulais, car j'avais à cœur de gagner au moins l'excellent repas qu'il m'avait fait faire. Il me présenta à ses péones comme un nouveau compagnon: c'est ainsi que je devins maçon bien malgré ce cher Monsieur Barthès, qui étant convaincu que je n'avais jamais fait un semblable métier, éprouvait une véritable répugnance pour ma décision.
Pendant quelques jours cet état fatiguant ne laissa pas que de me paraître fort dur; mais le courage aidant, je parvins à m'y faire assez pour avoir la conscience de bien gagner ma rétribution. Par moments cependant, lorsqu'il me fallait ainsi que d'autres, remuer[Pg 320] de gros blocs de granit, les forces semblaient me faire défaut, et à la suite des efforts que je faisais je tombais dans un complet état de défaillance qui me valait toujours les marques de la plus grande sollicitude et les reproches amicaux de mon brave compatriote, qui taxait ma persistance d'obstination et de déraison.
Ce digne homme cherchait sans relâche à me caser plus convenablement ailleurs. Il ne cessait de faire des démarches qu'il avait soin de me cacher, se faisant le plus grand scrupule de me donner de fausses espérances. Il adoucissait mon sort par tous les moyens imaginables; il me faisait prendre mes repas avec lui, et me logeait dans sa propre chambre. En dehors des heures de travail il exigeait que je ne le quittasse pas plus que son ombre; il me présentait chez ses amis chez lesquels, vu la haute considération dont il jouissait, j'étais généralement fort bien accueilli. La bonté délicate de cet homme le poussait jusqu'à prévoir les moindres besoins que je pouvais avoir, et lui inspirait tous les moyens imaginables pour me procurer quelques distractions. Redoutant de me laisser seul le dimanche, lorsqu'il[Pg 321] se rendait chez lui à Valparaiso, où il possédait une maison, il ne partait jamais sans avoir donné quelques ordres à l'hôtelier pour que je fusse bien traité en son absence, et pour qu'il prit soin de me procurer le plaisir de sa bonne compagnie, car cet homme étant presque une copie de lui-même s'intéressait aussi beaucoup à moi.
Le dimanche soir ou le lundi matin, quand cet excellent ami revenait à ses occupations, il rapportait toujours quelques provisions, telles que friandises de toutes sortes, et quelques livres, dont la lecture me causait une grande joie. Aussi modeste que bon, mon protecteur, ayant reconnu que je possédais quelque instruction, prenait plaisir à faire naître de longues conversations sur des sujets agréables, qui charmaient nos instants de liberté.
Comblé de tant d'attentions et de tant de prévenances, mon esprit se rassénait, le voile de mes pensées lugubres se levait chaque jour un peu plus, et le soleil de l'espérance jetait une bienfaisante clarté dans mon cerveau malade. Mon bienveillant ami sachant[Pg 322] quel bonheur j'éprouvais à parler et à entendre parler de ma famille, m'entretenait fréquemment à son sujet. Afin d'avoir la certitude qu'elles parviendraient, il se chargea de quelques lettres que j'adressais en France.
Un mois s'était écoulé depuis que je possédais l'amitié de cet homme respectable, lorsque d'ouvrier que j'étais, il me fit tout-à-coup contre-maître et augmenta ma solde qu'il jugea être trop minime pour les services que je lui rendais.
Je pus dès lors penser un peu à ma toilette et, lorsque les travaux de la station de Quillotte furent terminés, j'eus le bonheur de pouvoir acheter un peu de linge et de me couvrir d'un bon puncho et d'un bon pantalon. Dire la joie que je ressentis en me voyant ainsi vêtu serait impossible. Il me semblait que j'avais l'air de quelqu'un de passable. Je m'enhardis subitement au point d'éprouver quelque plaisir à me promener par les rues de la ville que je ne connaissais pas encore, bien que je l'habitasse depuis près de trois mois.
Cependant, malgré ce changement inouï dans mon existence, ma santé était fort ébranlée;[Pg 323] la plupart de mes nuits étaient difficiles et agitées par des rêves bruyants qui troublaient souvent le sommeil de ce bon monsieur Barthès, et lui donnaient de grandes inquiétudes sur moi. Eveillé même, je ne pouvais me mettre en garde contre les funestes effets que me causait la surprise. L'apparition subite de quelqu'un ou des éclats de voix inattendus, me donnaient des soubresauts nerveux et une sorte de tremblement convulsif. Mon si brusque changement de nourriture au lieu de calmer ma disposition à ces malaises, semblait en quelque sorte l'augmenter; ce qui désolait d'autant plus monsieur Barthès, que les circonstances allaient nous séparer, du moins pour quelque temps; car n'ayant plus rien à faire à Quillotte, il allait retourner chez lui au sein de sa famille. Il me proposa de m'emmener; mais à la manière dont je refusai son offre obligeante comprenant que la délicatesse seule avait dicté mon refus, il n'osa plus insister, mais il tenta encore quelques démarches en ma faveur qui, grâce à Dieu, et loin de son attente, eurent un plein succès. Il vint tout ému et tout joyeux, m'annoncer[Pg 324] cette bonne nouvelle. Il avait obtenu un emploi de machiniste chez un des personnages les plus riches du pays, qui avait précisément besoin de quelqu'un pour surveiller et diriger les travaux de son immense récolte, pour laquelle il avait intention de n'employer que des machines.
Force me fut de me soumettre à un changement de résidence et de quitter Quillotte, où j'avais déjà fait quelques aimables connaissances chez lesquelles je passais tous mes moments de loisir; ce qui calmait un peu mes tristes pensées et par conséquent apportait quelque amélioration dans l'état de ma santé.
Je partis en compagnie de mon nouveau patron pour l'une de ses fermes appelée Las Massas, distante d'une dizaine de lieues de Quillotte. Je me trouvais ainsi rétrograder vers la route que j'avais déjà parcourue à mon arrivée, en suivant toutefois un chemin différent et des plus pittoresques.
Lorsque nous arrivâmes à destination, Don Césario (mon patron) après m'avoir présenté à sa famille me conduisit à l'immense champ dont le travail allait m'être confié. Il[Pg 325] me laissa le soin d'indiquer l'emplacement convenable pour les machines, ainsi que celui où je voulais que l'on me construisît un rancho, devant habiter ce lieu même pour y exercer une continuelle surveillance.
Je m'étais bien engagé à diriger les travaux, mais non à monter les machines, ce dont je me trouvai cependant chargé à mon grand regret, craignant de ne pouvoir m'acquitter de cette opération difficile; mais, ne trouvant personne dans le pays qui fût capable de faire cette besogne, il fallut bien me résigner à en faire l'essai. J'eus le bonheur de réussir au-delà de mon attente. Outre cette occupation, qui n'était nullement de ma compétence, il me fallut encore dresser des chevaux et des bœufs pour faire fonctionner ces machines à battre et à vanner qui, dans ces contrées, ne pouvaient être mues qu'avec le secours des animaux.
Plusieurs jours se passèrent dans cette occupation difficile autant que désagréable, qui eut pour premier résultat d'occasionner quelques avaries qu'il me fallut réparer moi-même.
[Pg 326]
Enfin, commencèrent les fonctions pour lesquelles j'étais engagé; fonctions d'autant plus difficiles, que je me trouvai tout-à-coup entouré d'une soixantaine de paysans fort grossiers, et pour la plupart très-rétifs; dès les premiers ordres que je leur donnai, ou les premières observations que je leur fis, ils entrèrent dans la voie de la rébellion et me menacèrent. Fort heureusement pour moi, j'étais habitué depuis longtemps au danger, et ma fermeté décontenança le plus grand nombre d'entre eux; quant aux autres je les chassai, après avoir avisé Don Césario de leur conduite: par mesure de prudence, et connaissant à fond le caractère traître et vindicatif de ces êtres de pure race indienne, j'empruntai les pistolets de mon patron. Bien m'en avait pris d'agir ainsi; car les mutins expulsés eurent l'effronterie de revenir avec l'intention d'ameuter les autres contre moi, contre le gavacho—l'étranger, l'homme de rien.—Jugeant à l'attitude de mes ouvriers qu'ils se laisseraient bien vite entraîner si je faiblissais, je m'élançai au-devant des meneurs, et les sommai de se retirer à[Pg 327] l'instant. L'un d'entre eux, plus hardi que ses compagnons, ayant levé la main pour me frapper, je démasquai incontinent mes pistolets, en leur disant que je tirerais sur celui qui ferait un pas de plus. La vue de ces armes qu'ils étaient loin de supposer en ma possession, bien qu'elles ne fussent point chargées, les rendit aussi lâches qu'ils s'étaient montrés arrogants. Ils s'en furent l'oreille basse, et convaincus qu'un gavacho n'était pas homme à se laisser intimider par des gens de leur espèce.
Toutefois, ce genre de triomphe qui me valut désormais la considération des plus raisonnables, me dégoûtait et me déplaisait extrêmement. Aussi écrivis-je à Don Césario, qui était alors alcade, que s'il ne trouvait moyen d'empêcher ces débordements furieux, j'abandonnerais les travaux qu'il m'avait confiés, aux risques, pour lui, de perdre sa récolte. Il s'empressa de venir me trouver pour se concerter avec moi sur les mesures à prendre. Nous réunîmes les péons auxquels il fit lui-même la paye. Il renvoya instantanément tous ceux que je lui désignai[Pg 328] comme ayant fait partie de la cabale, et les menaça de la prison en cas de récidive. Il annonça en outre aux autres, qu'il me conférait ses pleins pouvoirs pour leur commander, les chasser, ou les faire incarcérer si besoin était. Depuis ce moment aucun d'entre eux ne donna lieu à des reproches sur sa conduite.
Mais par suite, je n'eus guère lieu de me louer des procédés de Don Césario, qui après m'avoir promis une rétribution convenable, jugea à propos de la réduire considérablement. En ma qualité d'étranger, n'ayant personne pour me faire rendre justice, il fallut me résigner à perdre un gain bien mérité, et qui m'eût été d'un grand secours. Je séjournai cependant quelque temps encore à la ferme de Las Massas, sans pouvoir me rendre à Quillotte, car don Césario, piqué de ce que je lui avais reproché sa mauvaise foi, me refusait les moyens d'y retourner. Pourtant au bout de quelques jours, ayant songé que son obstination lui coûterait au moins ma nourriture et mon logement, il me fit prêter un cheval.
[Pg 329]
Je partis sans savoir ce que je deviendrais, sans asile, et presque sans argent, mais le cœur rempli d'aise en rompant toute relation avec Don Césario dont j'avais eu beaucoup à me plaindre; je n'étais resté aussi longtemps, que par considération pour son frère Don Matys-Ovaillo, qui m'avait comblé de ses bienfaits et auquel j'avais voué une grande reconnaissance.
De retour à Quillotte, je revis la plupart des connaissances que j'y avais faites; chacun me reçut à bras ouverts, et voulut me garder quelques jours; M. Barthès, ayant eu connaissance de mes ennuis, m'écrivit pour m'engager à me rendre au plus vite à Valparaiso, où il espérait, disait-il, me caser sous peu, d'une manière définitive. Je fus donc forcé de refuser toutes les offres aimables qui m'étaient faites avec tant d'instances. Il me restait heureusement une piastre, qui servit à payer ce voyage de vingt cinq lieues que je fis en chemin de fer. Deux heures suffirent pour franchir l'espace qui sépare Quillote de Valparaiso, où j'arrivai après avoir côtoyé la mer pendant plus d'une lieue.
[Pg 330]
Dans la gare, j'aperçus bientôt M. Barthès duquel j'avais été séparé pendant plus de trois mois. Grande fut ma joie de retrouver cet excellent et respectable ami qui me reçut à bras ouverts. Sa femme, son fils Paul, qui avait à peu près mon âge, et sa fille, qui étaient aussi très-désireux de me connaître, avaient aussi pris la peine de l'accompagner, et me firent l'accueil le plus touchant. Nous nous rendîmes ensemble à leur habitation, située sur les hauteurs qui dominent le port, et à laquelle nous n'arrivâmes qu'en gravissant la Quèbrada de l'Almendral—gorge de l'amandier—.
Mon ami m'engagea presque aussitôt à suivre Paul, son fils, qui m'emmena dans sa chambre où il me força bon gré mal gré à revêtir ses propres vêtements. Je fus très-touché et très-ému de cette marque d'amitié et de considération, mais vraiment gêné sous le costume élégant que j'avais endossé; car depuis mon départ de Buénos-Ayres j'en avais perdu l'habitude. Quand je redescendis, et qu'à l'aide d'une des glaces du salon je pus me rendre compte de ma subite transformation,[Pg 331] au lieu d'en être satisfait, j'éprouvai presque un coup terrible, car malgré moi, tout un monde de souvenirs douloureux m'assaillit.
Le bienveillant empressement et la sollicitude de la famille Barthès triomphèrent heureusement de cette profonde tristesse, qui faillit cependant me reprendre encore lorsque nous fûmes à table. Entouré de ces dignes personnes qui me rappelaient d'autant mieux mes chers parents, que je leur entendais fréquemment prononcer le nom de Paul qui était celui de mon frère bien-aimé, je ne pouvais détourner ma pensée de ma chère patrie et des êtres chéris que j'y avais laissés. Vers la fin du repas pourtant, je fis meilleure figure, car les efforts de mon infatigable ami m'amenèrent à partager la gaîté et l'entrain de chacun.
La délicatesse de mes amphytrions était poussée à un tel point, que malgré leur vif désir d'entendre de ma bouche même le récit de mes malheureuses aventures, il se passa plusieurs jours sans qu'ils me fissent la moindre question, dans la crainte de raviver[Pg 332] mes chagrins. Comme ces dames m'entretenaient souvent au sujet de ma famille je leur en fis voir les portraits, en leur expliquant de quelle manière j'étais parvenu à les conserver jusqu'alors; ce qui éveilla leur curiosité au plus haut point, et me procura l'occasion de leur raconter l'histoire de ma captivité.
Bien que je me trouvasse très-heureux d'être aussi choyé que dans ma propre famille, il me coûtait néanmoins beaucoup de rester dans l'inaction, où m'avait plongé depuis trois jours l'attente de l'emploi que m'avait fait espérer Monsieur Barthès, et lequel était encore à trouver; car je m'aperçus que cela n'avait été de sa part qu'une ruse délicate pour me faire accepter un asile chez lui. Ne voulant pas abuser de l'extrême bonté de cette famille, je cherchais activement à me caser. Pendant plusieurs jours, mes démarches furent infructueuses, ce qui augmenta considérablement ma tristesse.
Ces messieurs Barthès, auxquels je m'étais bien gardé de communiquer le sujet de ma vive préoccupation, firent tout au monde pour[Pg 333] me distraire. A force d'instances, ils me décidèrent à les accompagner au théâtre; c'était la première fois que j'y allais depuis mon départ de France; bien que la salle fût splendide, et que l'on jouât les Diamants de la Couronne, mon esprit était ailleurs. Lorsque le premier acte fut fini, mes amis me conduisirent au foyer, où se pressait une foule aristocratique de toutes les nations, dont la mise élégante ajoutait encore à l'éblouissante décoration de cette salle. Après avoir joui pendant quelques instants de ce magnifique coup d'œil nous retournâmes à nos places pour le lever du rideau.
Il y avait à peu près un quart d'heure que le second acte était commencé, quand s'éleva derrière nous une conversation très-animée, qui n'avait cependant rien d'hostile: les mots, c'est lui, c'est lui, fréquemment répétés par l'un de mes bruyants voisins, m'ayant fait tourner la tête, je fus très-agréablement surpris en reconnaissant une personne que j'avais connue à Mendoza, et dont toute l'attention ainsi que celle de son compagnon paraissait particulièrement fixée sur[Pg 334] moi. Je me levai aussitôt pour saluer; mais je devais marcher de surprise en surprise, car ainsi qu'elle, l'autre personne me tendit la main en me faisant toutes sortes de démonstrations amicales, et en m'appelant par mes noms. Je sus bientôt le mot de l'énigme: ce Monsieur qui m'était inconnu, était arrivé à Buenos-Ayres quelque temps après moi, et à l'instigation de sa famille qui était liée avec la mienne, n'avait cessé de s'informer à mon sujet. Il correspondait depuis longtemps avec mon excellente mère qui, six mois après ma capture par les Indiens, avait été instruite de ce fait par les bons missionnaires, et par un savant bien connu, Monsieur Bravard, auquel l'amour de la science causa une mort terrible et prématurée; il périt sous les décombres de la superbe Mendoza dont il n'avait que trop judicieusement prédit la ruine prochaine quelques jours auparavant.
Monsieur Edmond Carré, tel est le nom du charmant et obligeant compatriote avec lequel j'eus le bonheur de faire plus ample connaissance dès le lendemain, avait, par un[Pg 335] pressentiment extraordinaire, conservé quelques lettres de ma mère, dans la prévision qu'un hasard providentiel pourrait nous faire rencontrer. Mes amis Barthès, dont j'avais reçu tant de marques de sympathie, partagèrent la joie que j'éprouvais de cette heureuse rencontre, qui n'aurait sans doute pas eu lieu sans leurs pressantes instances pour me faire prendre quelques moments de distraction. Je fus d'autant plus enchanté de cette circonstance inespérée, qu'il en résulta une conversation qui ne fit que confirmer la véracité du récit que j'avais fait de mes malheurs à la famille Barthès.
Ce fut par l'intermédiaire de monsieur Carré que me parvinrent des lettres de ma famille, lesquelles me mirent dans la possibilité de revenir en France.
Pendant un séjour de plusieurs mois à Valparaiso, malgré toute l'obligeance de mes amis Barthès et Carré, je ne trouvai que de pénibles emplois qui finirent par altérer complètement ma santé. Là, cachant soigneusement à mes amis ma triste position, je me trouvai, comme à travers la Pampa et au sein[Pg 336] des Cordillières, réduit plusieurs fois à la famine. J'étais accablé de douleurs, me voyant partout et toujours, poursuivi par le même sort: au milieu d'êtres civilisés je fus souvent réduit, pour me reposer de mes fatigues du jour, à coucher dans une mansarde sans toiture, où j'étais exposé sur un grabat au vent glacial et à une pluie torrentielle qui m'engourdissait les membres, et ravivait mes blessures à un tel point que j'avais toutes les peines du monde à me remettre sur pied.
Ces tristes emplois même me manquèrent à plusieurs reprises; parfois je me vis dans l'obligation de me contenter de deux ou trois bouchées de pain pour toute ma journée, et de m'introduire furtivement dans des écuries où je partageais la litière d'animaux qui, plus heureux que moi, avaient au moins une nourriture suffisante pour calmer leur appétit.
Accablé de désespoir et de plus en plus malade, je me décidai, ainsi qu'on me l'avait conseillé, à me présenter chez M. Cazotte, consul de Valparaiso. Ce fonctionnaire me fit le plus bienveillant accueil, en me félicitant[Pg 337] sur mon heureux retour à la liberté. Il m'apprit que depuis longtemps il avait reçu du gouvernement des ordres me concernant, et il me fit voir un énorme dossier dans lequel étaient classés les différents articles qu'il avait fait publier pour moi dans tous les journaux Chiliens: c'était le résultat des démarches que ma famille avait faites près de Monsieur Limpérani, consul général de Santiago, et auprès des missionnaires. Monsieur Cazotte eut ensuite la bonté, avant de me faire embarquer sur la corvette la Constantine, de me munir de tout ce qui m'était nécessaire pour la traversée.
Huit jours après mon entrevue avec le consul, le départ du bâtiment pour la France devant avoir lieu irrévocablement, je me rendis chez mes excellents amis Barthès pour leur faire mes adieux, et leur témoigner encore une fois de ma sincère gratitude. Ce ne fut pas sans une vive émotion que je me séparai de ces excellentes personnes, dont le souvenir ne saurait s'effacer de ma mémoire, non plus que celui de Monsieur Carré qui avait agi à mon égard avec[Pg 338] autant de bienveillant intérêt que si j'eusse été un de ses parents.
Comme à Valparaiso, sur le navire qui me ramenait en Europe, mon esprit, accablé par de longues misères, n'était ouvert qu'à deux préoccupations: le besoin de revoir la France et tous ceux que j'aimais, puis une lutte incessante contre les réminiscences de ma captivité.
De même que Mungo Park, échappé à la tyrannie des Maures du Sahara, je fus longtemps à croire à ma délivrance. Il me fallut, ainsi qu'à ce grand voyageur: l'Océan traversé, le retour dans la patrie, le calme réparateur du foyer paternel, pour délivrer mon sommeil des visions, et mon cerveau des fantômes évoqués par le souvenir odieux des brigands du désert.
[Pg 339]
A
La Viscacha ou Trouly en indien est fort commune au Sud de Buenos-Ayres. Cet animal creuse des terriers comme les lapins, avec nombre d'issues rapprochées les unes des autres et le plus souvent aboutissant à des chemins. Il habite en famille, il consomme l'herbe des environs. Il n'est pas rare de le rencontrer dans des jardins où il cause de grands dégâts, ou bien encore dans des champs ensemencés. Il ne sort que de nuit, au moment[Pg 340] du crépuscule sans jamais s'éloigner beaucoup. Sa longueur varie de 20 à 25 pouces, non compris la queue, son corps est trapu, la tête grosse et jouflue, l'oreille grande, l'œil grand, le museau obtus et velu, il a la gueule et les dents du lièvre. Le train inférieur est beaucoup plus haut que le postérieur, il a des soies fort longues qui lui tiennent lieu de moustaches, et qui sont fort dures. La chair de cet animal est très-blanche, très-tendre, mais aussi très-fade, cependant bonne à manger étant bien accommodée.
B
Gnayu-u d'Azara: cervus compestris de F. Cuvier. Sorte de chevreuil qui diffère de l'espèce européenne par sa gorge blanche.
C
Le céton,—mamouël céton, ou careux céton—n'est autre chose qu'une sorte de[Pg 341] chardon auquel les Indiens donnent l'un ou l'autre de ces noms, selon qu'il est vert ou sec. Vert, il s'appelle careux céton, sec, mamouël céton.
Ce chardon, fort commun dans certains parages où il y pousse avec une très-grande rapidité, diffère totalement de celui que nous connaissons en France, c'est une tige ronde fort droite, qui atteint souvent plus de deux mètres de hauteur et dont le diamètre varie de 1 à 2 et même jusqu'à 2 pouces 1/2, et qui est armée, pour ainsi dire, dans toute sa longueur, de feuilles longues et étroites ayant forme d'angles aigus et hérissées d'une grande quantité d'épines. Le sommet de cette tige est couronné par une agglomération de petites feuilles ayant l'aspect d'une boule.
Les Indiens sont généralement très-friands de cette plante qui, dans les commencements de sa croissance, leur est d'un grand secours pour la préparation de certains mets, tels que: 1o Le Tchaffis-céton mélange de lait et de petits morceaux de tige de ce chardon, qu'ils font fermenter et dont ils se régalent [Pg 342]aussi souvent que possible. 2o Le Hilo-Céton, chardon cuit sous la cendre et toujours mêlé à de la viande crue ou bien encore à demi cuite.
Ils en mangent aussi à l'état de crudité et je m'en suis régalé quelquefois aussi; car dans son état naturel je lui trouvais beaucoup d'analogie avec le céleri.
Une fois sec, ce gigantesque chardon dont la tige est devenue creuse et fort dure, sert de bois—mamouël—aux Indiens de la plaine qui, durant les trois quarts de l'année, n'ont d'autre combustible à leur disposition que des—mey-vacas ou mey-potro fientes de bœufs ou de chevaux séchées—ou bien encore des Foros et de la yiéouine, c'est-à-dire des os et de la graisse.
D
Ou montagne à fenêtres, ainsi nommée par les Hispanos-Américains, en raison d'une brèche qui vue d'un point sud-est ressemble à une fenêtre, qui la traverse de part en part. Cette montagne a plus de cinquante lieues de[Pg 343] circonférence à sa base, mais étant placée sur un terrain ascendant, il résulte que bien qu'elle soit éloignée de plus de treize lieues du rivage, il semblerait en la voyant du large, qu'elle fait partie de la côte.
E
La Plata, the argentine confédération and Paraguay etc. Ou explorations du bassin de la Plata, exécutées dans les années 1853-56 d'après les ordres du gouvernement des États-Unis, par Thomas Page, commandant de l'expédition. Londres 1859. [Pg 347]
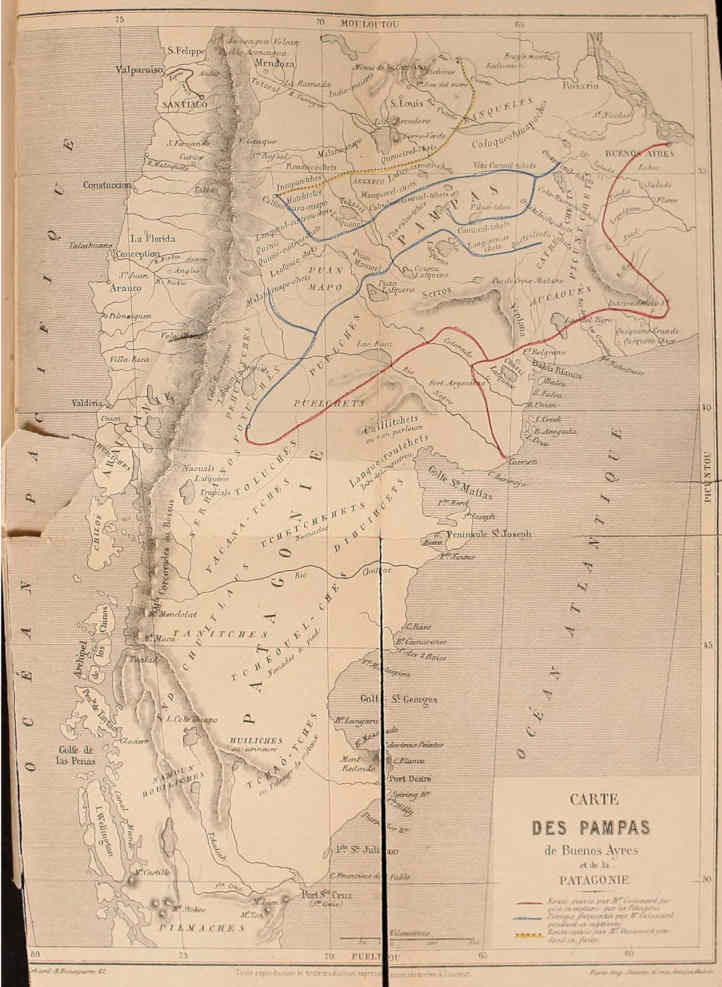
| Chapitres | pages |
| Au Lecteur | I |
| I.—Comment il se fait que je pars pour Montévidéo.—Dans quel but j'entreprends ce voyage | 1 |
| II.—En quelles mains j'étais tombé | 35 |
| III.—La Pampa et les Pampéens | 96 |
| IV.—De la religion des Indiens | 145 |
| V.—La médecine chez les Indiens | 152 |
| VI.—Engraissement des chevaux.—Abattage d'un
cheval.—Principale nourriture des Indiens pendant la belle saison.—Du tatou.—Un évènement tragique | 164 |
| VII.—La musique chez les Indiens.—Leurs divers instruments.—Jeux | 177 |
| VIII.—Projets de fuite.—Désespoir.—Changement de position.—Je deviens secrétaire des Indiens | 185 |
| IX.—Orgies des Indiens.—Leurs différentes boissons.—Je me construis une case.—Sciences des Indiens | 222 |
| X.—Fêtes religieuses des Indiens | 237 |
| XI.—Comment la politique des Provinces unies de la
Plata vint influer sur ma destinée.—Le général Urquiza.—Délivrance.—Orgie générale | 252 |
| XII.—Rio Quinto et mon départ pour Mendoza | 270 |
| XIII.—Mendoza | 279 |
| XIV.—Départ de Mendoza.—Passage de la Cordillière.—Séjour au Chili.—Retour en France | 287 |
| Notes | 333 |
Abbeville.—Imprimerie de P. Briez.