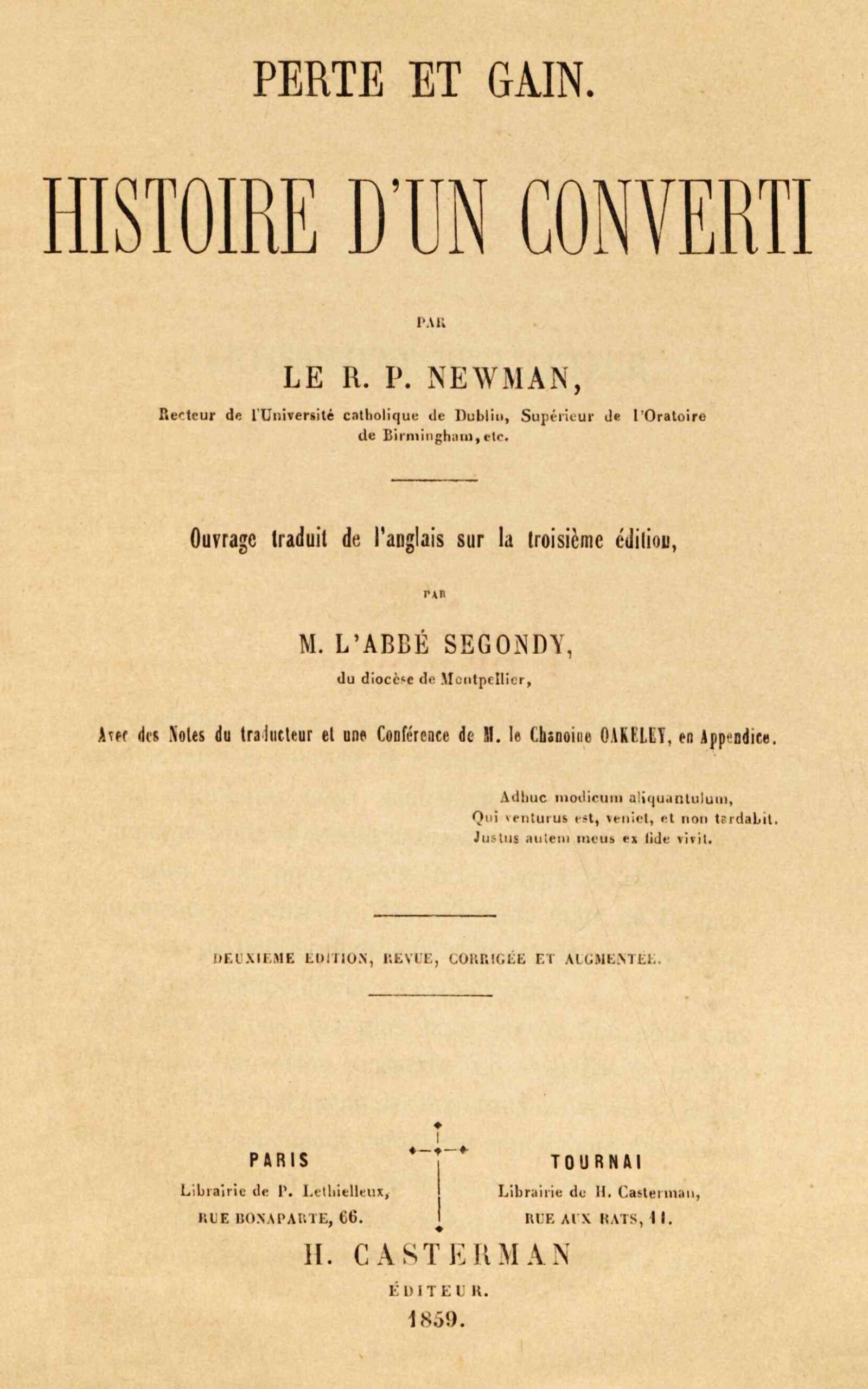
Title: Perte et gain
histoire d'un converti
Author: John Henry Newman
Contributor: Frederick Oakeley
Translator: Fulcran Segondy
Release date: August 31, 2025 [eBook #76775]
Language: French
Original publication: Paris: Casterman, 1859
Credits: Laurent Vogel (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)
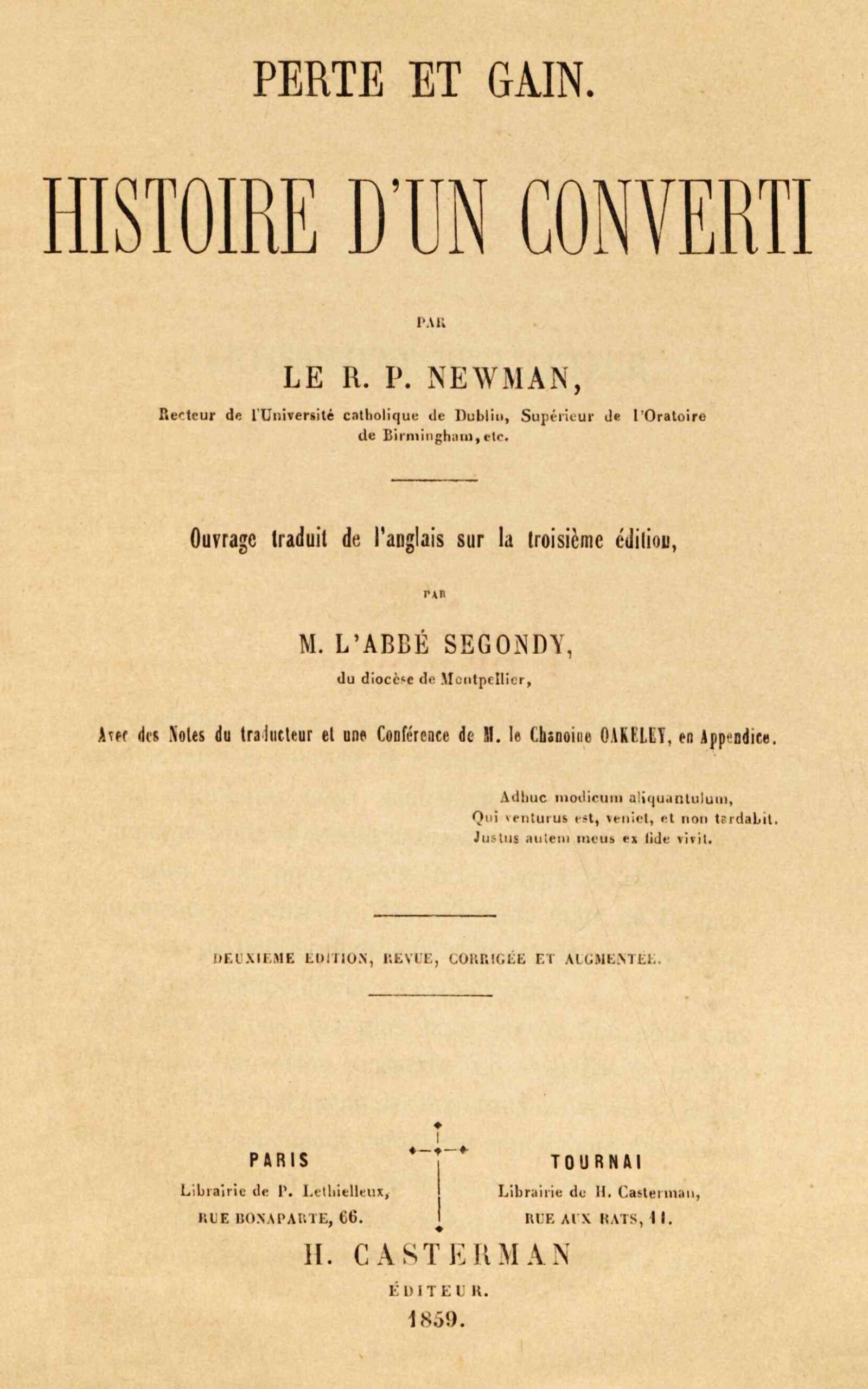
PAR
LE R. P. NEWMAN,
Recteur de l’Université catholique de Dublin, Supérieur de l’Oratoire
de Birmingham, etc.
Ouvrage traduit de l’anglais sur la troisième édition,
PAR
M. L’ABBÉ SEGONDY,
du diocèse de Montpellier,
Avec des Notes du traducteur et une Conférence de M. le Chanoine OAKELEY, en Appendice.
Adhuc modicum aliquantulum,Qui venturus est, veniet, et non tardabit,Justus autem meus ex fide vivit.
DEUXIÈME ÉDITION, REVUE, CORRIGÉE ET AUGMENTÉE
PARIS
Librairie de P. Lethielleux,
RUE BONAPARTE, 66.
TOURNAI
Librairie de H. Casterman,
RUE AUX RATS, 11.
H. CASTERMAN
ÉDITEUR.
1859.
IMPRIMATUR
Mechliniæ, 15 Marti 1856.
J.-B. VAN HEMEL, Vic. Gen.
Imprimerie de BEAU, à Saint-Germain-en-Laye, rue de Paris, 84.
En écrivant Perte et gain, l’auteur ne s’est point proposé d’en faire un ouvrage de controverse en faveur de la religion catholique. C’est seulement une peinture de ce que quelques-uns appellent la marche de la pensée et l’état d’un esprit ; ou, pour mieux dire, parmi les différentes évolutions de la pensée et les différents états de l’esprit, c’est un cas particulier dont le dénoûment est une conviction éclairée de l’origine divine du catholicisme.
Ce récit n’est pas, non plus, basé sur un fait, pour nous servir d’une expression consacrée. Ce n’est pas la propre histoire de l’esprit d’aucun des nouveaux convertis à l’Église de Rome. Les principaux caractères sont de pure invention ; et l’auteur déclare n’avoir voulu, en aucun d’eux, faire d’allusion personnelle. C’est dans ce but qu’il a créé des corps ecclésiastiques et des localités imaginaires, afin de ne pas courir le risque, ce qui autrement aurait pu arriver, de représenter, sans le vouloir, aux yeux du lecteur, des personnages réels que l’écrivain n’a pas eu du tout en vue.
Cependant il s’est emparé sans scrupule des discours et des actes qui caractérisent l’époque et le lieu où la scène se passe. Du reste, lorsque, dans un récit, une vérité générale ou un grand fait est individuellement spécifié, il est impossible que, malgré les efforts de l’auteur, la représentation idéale ne coïncide pas, plus ou moins, avec des exemples ou des personnages vivants.
Ajoutons encore, pour empêcher une autre méprise, qu’on n’a voulu faire d’aucun des acteurs de ce récit le représentant propre des opinions religieuses qui ont exercé, récemment, tant d’influence au sein de l’université d’Oxford.
21 février 1848.
L’année dernière, au mois d’août et de septembre, nous nous trouvions sous le toit hospitalier des PP. Oratoriens de Birmingham, dans le but d’ajouter quelques nouveaux renseignements à ceux que nous avions pris dans un voyage antérieur touchant le « mouvement religieux d’Oxford ». Avons-nous besoin de le dire ? dans cette admirable maison de l’Oratoire, il nous fut aisé de remplir notre dessein : n’avions-nous pas sous les yeux les fruits les plus beaux[1] de ce mouvement providentiel ? Désireux, toutefois, de poursuivre cette belle étude à notre retour sur le continent, nous demandâmes un jour à l’un des bons pères de nous indiquer les ouvrages qui pourraient nous être le plus utiles. — Bien volontiers, nous répondit-il ; mais voulez-vous avoir l’idée la plus exacte du mouvement religieux ? lisez Loss and gain (Perte et gain). Tout est là ; et les hommes, et les controverses, et l’atmosphère même d’Oxford. — Il ne nous fut pas difficile de déférer à ce conseil : la parole de notre digne interlocuteur était pour nous une autorité ; le nom de l’auteur de l’ouvrage nous était non-seulement une garantie de son mérite, mais un attrait. Nous nous empressâmes donc de lire Perte et gain. L’intérêt que nous prîmes à cette lecture fut si vif, que nous eûmes dès lors la pensée de faire connaître ce beau livre aux deux nations chrétiennes — la France et la Belgique — qui, par leurs prières, ont une si large part à ce qui se passe au delà du détroit. Le dessein que nous formions l’année dernière, nous le réalisons enfin aujourd’hui ; et, nous l’avouerons avec franchise, nous croyons que l’ouvrage du docteur Newman jettera un nouveau jour sur la question peut-être la plus importante des intérêts catholiques au XIXe siècle. — Tout le monde a lu les belles paroles que nous a laissées Bossuet[2] touchant le schisme anglican. Quel tressaillement n’eût pas été le sien, si cet immortel génie avait pu assister au spectacle qui se déroule de nos jours en Angleterre ! N’aurait-il pas cru toucher à l’heure solennelle qu’il avait entrevue de son regard d’aigle, il y a deux cents ans ?
[1] A l’exception d’un seul, tous les pères et tous les novices de l’Oratoire de Birmingham sont des convertis. — Nous voudrions que tous ceux qui sont travaillés par le doute passassent une semaine dans cette aimable retraite : nous sommes convaincu que la plupart ne la quitteraient pas sans en emporter un trésor précieux de lumière et de paix.
[2] Histoire des variations, liv. VII.
Mais qu’est-ce que Perte et gain ?
Une réponse complète à cette question exigerait de notre part certains développements relatifs au temps où la scène se passe. Nous nous étions proposé de faire ce travail ; mais, ayant obtenu de M. le chanoine Oakeley de reproduire en français une conférence que ce digne ecclésiastique a prononcée à Londres sur le livre qui nous occupe, et dans le sens que nous venons d’indiquer, nous lui avons volontiers laissé la parole[3]. L’autorité de ce savant converti aura, dans ces matières, plus de poids que la nôtre. Il nous suffira donc de donner une appréciation générale de l’ouvrage.
[3] Voy. l’Appendice. — Nous engageons nos lecteurs à lire cette conférence avant Perte et gain ; elle les aidera à mieux comprendre l’ouvrage.
Comme son titre seul le fait déjà connaître, Perte et gain est l’histoire d’une âme qui, sous la double action de la volonté privée et de la grâce, arrive des sentiers perdus de l’anglicanisme à la vraie lumière, ou, pour nous servir des paroles de l’auteur, « c’est la peinture de la marche et de l’état d’un esprit qui parvient à se convaincre de l’origine divine du catholicisme ». Une semblable question est belle, élevée, et l’on comprend tout de suite quel intérêt saisissant elle doit avoir, traitée par une main habile. Qui de nous n’aime à contempler ces nobles luttes d’une âme qui a soif de la vérité, et qui la cherche au prix des plus grands sacrifices ? Oui, ces combats secrets où ne se verse pas le sang, mais où l’on immole toujours quelque passion chérie, nous révèlent le beau côté de notre dignité humaine, et nous en sommes fiers. N’allons pas croire, toutefois, que l’analyse de cette transformation de l’homme intérieur soit un problème facile. « Savez-vous par quelle voie la lumière se propage ? » demandait Dieu à son serviteur[4] ; qui peut dire, aussi, et à plus forte raison, par quels sentiers le soleil qui n’a pas de couchant[5] arrive à faire pénétrer ses rayons dans une âme ? Il faut un œil bien exercé pour saisir tous ces fils mystérieux par lesquels une intelligence est liée à l’erreur, et pour suivre ce travail sans bruit qui fait tomber un à un les voiles épais dont ses yeux étaient couverts. Mais quelque difficile que pût être la tâche, elle n’était pas au-dessus des forces du savant oratorien : disons mieux, le R. P. Newman semblait destiné, plus que tout autre, à faire une œuvre si délicate : sa naissance et sa première éducation, sa position antérieure, à Oxford, le rôle si providentiel qu’il a joué dans le mouvement religieux, sa haute intelligence, son érudition immense, sa vie de méditation et de prière, son expérience du catholicisme, tout le rendait éminemment propre à nous tracer l’Histoire d’un converti. Aussi est-ce une heureuse pensée que l’illustre écrivain a eue, quand il a résolu d’écrire Perte et gain ; nous ne saurions trop lui en être reconnaissants.
[4] Job. XXXVIII, 24.
[5] Isaïe, LX, 20.
Autant le but de Perte et gain est élevé, autant le plan en est simple ; et cependant, comme œuvre d’art, c’est un vrai chef-d’œuvre (a master piece), nous dit M. Brownson[6]. Le R. P. Newman s’y révèle, en effet, comme un écrivain de premier ordre, il nous y montre même une nouvelle face de son talent. Tout le monde reconnaissait dans le pieux ex-fellow d’Oriel un érudit profond, un habile controversiste, un orateur éloquent, mais on n’avait peut-être pas soupçonné chez lui, du moins en France, cette science si variée, cette connaissance intime du cœur humain, ce sentiment si vrai de tout ce qui est beau. A côté du théologien et du philosophe, nous trouvons dans Perte et gain le moraliste, le poëte, le littérateur consommé. Et c’est à l’ensemble de toutes ces brillantes qualités que l’ouvrage doit la perfection qui le distingue : de là ces belles scènes où l’écrivain s’adresse tour à tour à l’esprit, à l’imagination, au cœur ; de là ces esquisses, si habilement tracées, des caractères de tout rang et de tout âge ; de là cette description si vraie des mœurs de l’université d’Oxford comme de celles de la famille anglaise ; de là ces dialogues si pleins de science et d’esprit ; de là cette logique si serrée, cette sensibilité si exquise, cet enthousiasme si pieux, cette analyse si délicate de la marche de l’esprit vers la vérité, de là, enfin, cet attrait soutenu qu’on retrouve même dans des discussions qui, sous la plume de tout autre, seraient fastidieuses ou sèches.
[6] M. Brownson est le célèbre converti des États-Unis. C’est de lui que M. Cousin écrivait en 1838 : « M. Brownson a publié une apologie de mes principes où brille un talent de pensée et de style qui, régulièrement développé, promet à l’Amérique un écrivain philosophique de premier ordre. » Après avoir expérimenté l’impuissance de la philosophie humaine à donner la vérité, comme il l’a raconté lui-même, M. Brownson s’est uni à l’Église catholique, en 1845. Aujourd’hui, il rédige la Revue qui porte son nom : Brownson’s Quarterly Review.
Mais ce n’est ici proprement que le côté littéraire de Perte et gain. Ce qui fait de ce livre une œuvre précieuse, c’est qu’il nous offre une peinture parfaite du monde religieux de l’Angleterre aux temps présents ; c’est un tableau animé où sont groupés avec art les fruits divers de la Réforme. Évangéliques, Cambdéniens, partisans de la Haute Église, Confrères de Plymouth, défenseurs des Églises-branches (branch-theorists), hommes du juste milieu, etc., etc. : toutes ces innombrables sectes, nées du libre examen, posent devant les yeux du lecteur avec leur cachet propre et distinctif ; il n’y a pas jusqu’aux fanatiques déclamateurs d’Exeter-Hall qui n’y aient leur représentant furibond, reconnaissable entre tous, comme de droit. Le talent et les ressources dont le R. P. Newman a fait preuve dans cette partie essentielle de son livre sont immenses ; aussi n’y a-t-il, peut-être, que ceux qui sont déjà au courant de la controverse anglicane qui puissent sentir tout le mérite de l’ouvrage sous ce rapport. Nous ne craignons pas de l’affirmer : Perte et gain est le résumé le plus parfait des systèmes religieux qui s’agitent à cette heure en Angleterre.
Toutefois, parmi les sectes que le savant oratorien nous peint avec tant de vérité, se dessine ce qu’on a appelé l’École d’Oxford. Une chose que nous avons souvent entendu répéter aux convertis, c’est que, en général, on a faussement jugé le mouvement religieux et qu’on ne l’a pas envisagé sous son véritable point de vue. Il n’y a rien d’étonnant en cela. Pour apprécier complétement une école, il ne suffit pas d’en connaître les doctrines ; il faut aussi avoir la clef de l’état des esprits qui ont embrassé ces doctrines. Qui ne le sait ? l’éducation, les préjugés et les traditions locales sont les éléments multiples qui, avec beaucoup d’autres encore, éclairent ou obscurcissent nos vues, nos théories, nos systèmes ; qui en déterminent, jusqu’à un certain point, le degré de bonté ou de malice. Or, c’est sans doute cette connaissance intime des hommes d’Oxford qui a fait défaut au grand nombre ; et, privé de ce flambeau nécessaire, on n’a vu les choses qu’à demi, sinon sous un faux jour. Grâce au docteur Newman, nous pensons qu’on pourra désormais se faire une idée plus juste du mouvement religieux, et qu’on en saisira mieux le caractère. Son livre, en effet, nous introduit dans le secret du mouvement lui-même ; il nous dévoile ce qu’il a eu de sérieux ou de superficiel ; il nous fait comprendre l’état des esprits ; il nous montre par quels labeurs les hommes droits se sont approchés de l’Église, dans quelles pensées ils s’y sont unis : spectacle émouvant qui, pour le philosophe comme pour le chrétien, renferme de très-graves leçons. « Cet ouvrage, a dit l’auteur que nous citions plus haut, nous explique bien des choses qui jusqu’à ce jour nous étaient inintelligibles » (which were hitherto unintelligible)[7] ; et, avec une loyauté qui l’honore, il demande pardon au R. P. Newman de l’avoir combattu pendant de si longues années. Perte et gain a fait ce qu’un autre bel et profond écrit[8] du même auteur n’avait pas su produire. La Revue de Dublin a été plus loin encore que M. Brownson : elle a positivement assuré aux catholiques du Royaume-Uni que, malgré leur cohabitation sur le même sol avec les anglicans, ils avaient à prendre dans l’Histoire d’un converti des renseignements qui leur étaient inconnus.
[7] Brownson’s Quarterly Review. Oct. 1854.
[8] Histoire du développement de la doctrine chrétienne.
Les habiles défenseurs de la foi catholique n’ont pas manqué à l’Angleterre. Milner, par exemple, a rendu, au commencement de ce siècle, de grands services à l’Église. Il était réservé au docteur Newman de résumer avec son beau talent les principales controverses, et de mettre complétement à nu ces bases d’argile sur lesquelles repose l’anglicanisme ; nous voulons dire, ses formulaires — ses XXXIX Articles, son Prayerbook. — Et qu’on ne croie pas que le savant oratorien écrase ses adversaires sous le poids de son immense érudition. Non, il cache plutôt sa science. Des citations de textes eussent embarrassé sa marche rapide ; il les a négligées, se contentant de quintessencier la doctrine des Pères et des théologiens. D’ailleurs, comme il connaît son anglicanisme à fond, il en sait tous les points les plus vulnérables, et c’est là qu’il dirige ses coups. Aussi, rien de plus intéressant que de voir comment une seule interrogation lui suffit parfois pour pousser son adversaire au pied du mur. — Il est bon de l’observer ici : l’auteur de Perte et gain parle avec dignité de son ancienne communion ; tout en la combattant, il n’a pas contre elle la moindre parole blessante. Ce qui ne l’empêche pas, et ce n’est que justice, de poursuivre de son ridicule mordant les systèmes religieux nés de cerveaux creux ou malades.
En résumé, nous dirons que ce beau livre, Perte et gain, nous offre, avec l’histoire attrayante d’un converti, un tableau des plus savants et des plus finement esquissés des doctrines de l’Église anglicane et de ses tendances actuelles. Placé déjà au premier rang de la littérature anglaise par sa forme brillante, la peinture parfaite des caractères, le bon goût de ses scènes si variées, la disposition enfin de toutes ses parties, cet ouvrage est surtout rempli d’enseignements précieux pour tous les hommes qui ont à cœur le triomphe de l’Église, ou qui aiment seulement à connaître le courant des idées religieuses à notre époque.
Quoiqu’il ait déjà huit ans de date, cet ouvrage conserve toute son actualité. Depuis 1848, ni la tendance, ni l’esprit du « mouvement » n’ont changé. A la surface, il y a moins d’agitation, mais au fond le travail est le même ; travail immense, qui doit nécessairement aboutir à un résultat magnifique[9]. « La semence est jetée, nous disait dans notre dernier voyage un des savants convertis d’Oxford ; il faudra bien qu’elle lève. » Un an s’est à peine écoulé depuis que ces paroles ont été prononcées, et, parmi beaucoup d’autres, l’Église a eu le bonheur de recevoir dans son sein trois hommes des plus recommandables par leur science, leur vertu et leur position dans l’Établissement : MM. Wilberforce, Ffoulkes et Palmer. Ces trois belles conversions ne disent-elles pas, de la manière la plus évidente, que le mouvement religieux est toujours plein de vie ?
[9] « Il semble que les meilleurs logiciens sont ceux qui franchissent le pas et vont droit à l’Église romaine, comme Gfrœrer et Hurter en Allemagne, comme Newman et les Wilberforce en Angleterre. Des âmes ardentes ne resteront jamais sur ce point entre deux abîmes où se tient le docteur Pusey. » (Journal des Débats, 5 août 1885.)
Encore quelques mots ; ils ne nous paraissent pas déplacés ici, vu la nature de l’ouvrage.
Si, par hasard, ce livre tombait entre les mains de quelqu’un de nos frères séparés, et que sa lecture lui apportât des lumières nouvelles, éveillât seulement quelques doutes, nous l’engageons à ne pas rejeter cette faveur divine, mais à se retirer dans la solitude de son âme et à prier. Quiconque se sent assez grand pour aspirer à la vérité doit rechercher tous les moyens qui peuvent lui en assurer la possession. Et quel homme, faisant profession de christianisme, ne se sentirait cette noble ambition au cœur ? La vérité n’est-elle pas l’aliment de l’intelligence humaine ici-bas ? et, au delà du temps, n’est-ce pas elle qui est le fondement de la joie des élus[10] ? Or, la prière est le sine quâ non de cette précieuse conquête. On a beau fouiller dans les livres, se renfermer dans le silence du cabinet : si l’on ne demande à Dieu le pain de l’âme, comme on lui demande, tous les jours, la nourriture du corps, on peut être sûr de mourir d’inanition, après des luttes désespérées. L’étude est bonne sans doute pour quelques-uns, mais la prière est indispensable pour tous. L’étude ne peut faire que des demi-philosophes : à la prière seule, le droit de former les vrais sages. La prière, c’est le soleil qui vivifie dans l’âme le grain de la vérité, qui en développe la tige délicate, en féconde les fleurs et en mûrit les fruits. Au reste, le conseil que nous donnons, nous semble-t-il, n’a rien de captieux. S’il est un acte libre, un acte qui échappe à toute séduction, c’est bien la prière. Et quel protestant sincère pourrait craindre de s’adresser avec confiance au Souverain Dispensateur de tout don parfait ? Qui est l’homme qui donne une pierre à son fils, lorsqu’il lui demande du pain ? Ou, s’il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent[11] ?
[10] « Gaudium de veritate. » S. Aug., Conf. Liv. X, ch. XXIII.
[11] S. Matth, VII, 9 et 10.
P. S. Ce n’est pas à nous de parler de notre traduction ; on nous permettra seulement de dire que nous avons tâché qu’elle ne fût pas trop indigne de l’illustre écrivain que nous admirons comme génie, et dont les aimables vertus ont éveillé dans notre cœur la plus profonde reconnaissance et le plus respectueux attachement. Les notes que nous avons mises, soit au bas des pages, soit à la fin du livre, nous ont paru indispensables. Jointes à l’Appendice, elles jetteront, croyons-nous, assez de jour sur l’ouvrage pour en faire comprendre le fond à tous nos lecteurs[12].
[12] Les personnes qui, après avoir lu Perte et gain, désireraient étudier plus à fond la question du « mouvement religieux », feront bien de consulter les excellents ouvrages publiés sur cette matière par M. J. Gondon, un des rédacteurs de l’Univers.
Pour toute récompense de notre modeste travail, nous ne demandons qu’une obole, celle qui vient du cœur : que toute âme aimante fasse l’aumône d’une prière à la malheureuse patrie du glorieux martyr saint Thomas.
Novembre 1858.
PERTE ET GAIN
Charles Reding était le seul fils d’un ministre anglican qui jouissait d’un gros bénéfice dans un comté du centre. Son père, le destinant aux ordres, l’envoya, à l’âge ordinaire, à une école publique. Longtemps M. Reding avait pesé dans son esprit les avantages et les inconvénients de l’éducation publique et de l’éducation privée, et il avait enfin opté pour la première. — L’isolement, se disait-il à lui-même, n’est pas une sauvegarde pour la vertu. Qui peut dire les sentiments intimes d’un enfant ? Expansif et heureux, bon et soumis, tel il peut toujours paraître, alors cependant que le mal fait en lui de grands ravages. Au Créateur seul appartient le secret des cœurs, et personne ici-bas ne peut espérer d’en sonder les abîmes, d’en effleurer même la surface. Je suis pasteur des âmes ; mais quelle connaissance, en vérité, ai-je de mes paroissiens ? Aucune. Leurs cœurs sont des livres scellés pour moi. Quant à ce cher enfant, il est toujours à mes côtés, il se suspend à mon cou ; et pourtant son âme est aussi loin de ma vue que s’il était aux antipodes. Je ne l’accuse pas de réserve, ce cher petit ; mais son amour et son respect pour moi le tiennent dans une espèce de solitude enchantée. Vainement j’essayerais de le connaître à fond.
Et tel est notre sort en ce monde. Nul ne peut connaître les secrètes pensées de Charles. Alors même que je le garderais ici veillant sur sa conduite avec la même sollicitude, il viendrait néanmoins un jour où je trouverais qu’un serpent s’est glissé dans le cœur de son innocence. Les enfants n’ont pas une connaissance pleine et entière du bien et du mal ; ne commettent-ils pas d’abord, presque innocemment, des actions mauvaises ? Éblouis par la nouveauté, ils ne voient pas la laideur du vice ; abandonnés à eux-mêmes, ils n’ont personne auprès d’eux pour les avertir ou leur tracer des règles de conduite ; aussi deviennent-ils les esclaves du mal, tandis qu’ils sont encore à apprendre quelle en est la nature. Ils vont à l’Université, et, à peine arrivés, ils se livrent à des excès dont l’énormité est proportionnée à leur inexpérience. Et puis, après tout, je ne suis pas, moi, de taille à former un esprit aussi actif et aussi investigateur que le sien. Il me pose déjà des questions auxquelles je ne sais que répondre. Il ira donc à une école publique. Là, il se formera au moins à la discipline, dût-il y trouver plus d’épreuves qu’ici ; là, il apprendra à se vaincre, à avoir de l’énergie, à être circonspect ; là, il commencera à acquérir l’esprit d’observation au milieu des mille petits événements qu’il aura sous les yeux : et de la sorte, il sera préparé à cette liberté dont il doit inévitablement jouir quand il ira à Oxford.
Cette décision était nécessaire ; car à d’excellentes qualités Charles joignait une timidité naturelle, une certaine réserve et une sensibilité excessive. Quoique d’un caractère gai, il y avait néanmoins dans sa nature une teinte de mélancolie qui parfois le rendait un peu maussade.
Charles fut donc envoyé à Eton[13]. Là, il eut la bonne fortune de tomber entre les mains d’un excellent maître, qui, l’élevant dans les principes de la vieille église d’Angleterre, d’après Mant et Doyley, laissa dans son esprit une profonde impression religieuse. Grâce à elle, il fut à l’abri de tous les entraînements des mauvaises sociétés, soit à l’école, soit, plus tard, à Oxford. Quand l’époque en fut venue, il alla dans cette dernière ville, ce siége célèbre de la science, et il entra au collége Saint-Sauveur. Six mois sont déjà écoulés depuis son inscription, et quatre depuis sa résidence, au moment où commence notre histoire.
[13] Eton dans le comté de Buckingham. Le collége de cette ville est un des plus remarquables d’Angleterre ; il fut fondé par Henri VI, en 1441. Soixante et dix élèves y sont entretenus gratuitement ; on les appelle les écoliers du roi, ou simplement collégiens. Mais il y a, en outre, deux ou trois cents jeunes gens des meilleures familles. Parmi les hommes célèbres qui ont fait leurs études dans cette belle institution, on peut citer Pitt, Fox, Canning, Wellington…
A Oxford, il n’est pas nécessaire de le dire, Charles avait rencontré un grand nombre de ses anciens condisciples : mais parmi eux il trouva peu d’amis. Les uns étaient trop légers pour son caractère, et il s’en était éloigné ; d’autres, amis intimes à Eton, ayant maintenant de hautes relations, l’avaient ouvertement méconnu à leur arrivée à l’Université[14], ou, étant entrés dans d’autres colléges, l’avaient perdu de vue. En fait de connaissances, à Oxford, presque tout dépend de la proximité des chambres. C’est la situation de l’escalier, plutôt que l’inclination, qui décide le choix des amis. Cela nous rappelle l’histoire de ce commerçant de Londres qui perdit un jour toute sa clientèle, parce qu’en embellissant sa maison il avait exhaussé d’une marche la porte d’entrée ; et, d’ailleurs, ne savons-nous pas tous quelle énorme différence il y a pour nous-mêmes entre des portes ouvertes et des portes fermées, quand nous parcourons une rue bordée de boutiques ? Dans une Université, toutes les heures de l’étudiant sont réglées. Un jeune homme exact se lève et va à la chapelle, il déjeune, s’occupe de ses études, assiste au cours, se promène, dîne. Dans toutes ces actions, qui ne le voit ? il n’y a rien qui puisse l’engager à monter un escalier autre que le sien ; et, s’il le fait, dix fois pour une il trouve absent l’ami qu’il cherche. Inutile d’ajouter qu’il est tout naturel que les étudiants de première année, qui ont des sentiments et des intérêts communs, occupent le même escalier. C’est ainsi que Charles Reding fut amené à faire la connaissance de William Sheffield, arrivé à l’Université en même temps que lui.
L’esprit des jeunes gens est souple et facile ; aisément ils s’accommodent du premier venu. Pour eux, les causes d’attraction de l’un vers l’autre sont aussi bien dans les ressemblances que dans les contrastes ; la similitude des goûts crée la sympathie ; l’admiration et l’estime naissent de la bienveillance dans les rapports ou d’une supériorité reconnue. Des liaisons ainsi formées durent souvent toute la vie, et cela par la seule force de l’habitude et la puissance du souvenir. Ainsi il arrive fréquemment, lorsque nous cherchons un ami, que le hasard nous sert autant qu’aurait pu le faire le choix le plus étudié. Quels étaient le caractère et le degré de l’amitié qui se forma entre nos jeunes étudiants, Reding et Sheffield, ce n’est pas ici le lieu de l’expliquer à fond. Qu’il nous suffise de dire que ce qu’ils avaient de commun, c’était d’être également tous deux novices, d’avoir des talents remarquables et de fréquenter le même escalier. La différence entre eux portait sur ceci : Sheffield avait longtemps vécu avec des gens plus âgés que lui. Il avait lu beaucoup, mais sans méthode ; opinions et faits, spécialement par rapport aux controverses du jour, il avait tout recueilli, sans prendre toutefois aucune chose fort à cœur. Vif, clairvoyant, jamais embarrassé, et quelque peu suffisant, tel était Sheffield. Charles, au contraire, n’avait jusqu’alors qu’une connaissance imparfaite des principes ou de leurs rapports ; mais il avait une compréhension plus profonde et traduisait davantage dans la pratique ce qu’il avait une fois acquis ; il était aimable, affectueux, et cédait facilement aux autres, excepté quand la voix du devoir se faisait clairement entendre. Ajoutons encore, que dans la paroisse de son père il avait eu l’occasion de voir différentes communions religieuses, et d’acquérir par là une connaissance générale, mais non formulée en système, de leurs doctrines. La suite de notre récit fera mieux connaître nos deux étudiants.
Il était une heure de l’après-midi ; Sheffield, passant devant la chambre de Charles, en vit la porte ouverte. Le domestique du collége venait d’apporter la demi-ration ordinaire du lunch[15], et il était occupé à faire le feu. Notre jeune étudiant entra. Nonchalamment appuyé sur les bras de son fauteuil, la toque sur la tête et revêtu de sa toge, Charles mangeait son pain et son fromage. Sheffield, le voyant dans cette situation, lui demanda s’il dormait aussi bien qu’il paraissait manger et boire, accoutré de cette manière. « J’étais sur le point d’aller faire un tour au Meadow[16], répondit Charles. Nous voici à l’époque de l’année qui fait mes délices : Nunc formosissimus annus. A cette heure, tout dans la nature est beauté : les aubours ont déjà fleuri, et l’aubépine a étalé ses blanches corolles. Ce pays possède vraiment une admirable variété d’arbres. Je n’en vis jamais de semblable. Comme ils sont délicieux les platanes avec leurs feuilles à demi ouvertes, si nombreuses et si verdoyantes ! Comme ils sont beaux, ces deux ou trois saules qui déploient leur verdure sombre sur le Cherwell[17] ! Je m’imagine que quelques dryades les habitent. Revenez-vous sur vos pas, vous avez à votre droite le Long Walk, et devant vos yeux s’étalent les admirables monuments d’Oxford[18], vus entre les ormes. On dit qu’il y a ici des dons[19] qui se souviennent du temps où cette avenue ne formait qu’un berceau, et où l’on pouvait s’y promener à l’abri de l’orage. Quant à moi, je sais bien que j’y ai été trempé l’autre jour. »
[15] Le lunch, ou luncheon, est une collation entre le déjeuner et le dîner. Le lunch des étudiants d’Oxford se compose ordinairement de pain et de fromage (bread and cheese).
[16] Le Meadow, délicieuse promenade, plantée d’arbres magnifiques. Elle a 50 ares de superficie.
[17] Le Cherwell, charmante petite rivière.
[19] Dans l’argot des étudiants d’Oxford, le mot don veut dire grand seigneur universitaire.
Sheffield se prit à rire ; il invita Charles en même temps à mettre son castor, pour faire une course avec lui d’un autre côté. Il avait besoin d’une longue promenade ; les cours lui avaient brisé la tête. Le vieux Jennings avait commenté Paley d’une manière si épouvantable qu’il en était tout malade. L’ennuyeux professeur avait parlé des Apôtres comme n’étant « ni trompeurs, ni trompés », de leurs « miracles visibles et de leur mort comme témoignage » ; mais de telle sorte que lui, Sheffield, ne savait plus s’il était un ens physiologicum ou un totum metaphysicum, lorsque Jennings avait eu la cruauté de lui demander de redire l’argument de Paley. L’élève n’ayant pas reproduit les paroles du maître, l’ami Jennings s’était pincé les lèvres et avait recommencé sa thèse. Dans son enthousiasme froid, il s’était appliqué si fortement à sa propre analyse, qu’il n’avait pas entendu sonner l’heure. En vain toute la classe avait frappé des pieds, usé de ses mouchoirs, regardé ses montres, notre professeur avait poursuivi sa marche vingt minutes au delà du temps prescrit. « Il continuerait même encore, ajouta Sheffield, s’il n’avait été interrompu par un incident qui n’eut de pareil que celui des oies du Capitole. Car, au moment qu’il avait à peu près répété la moitié de sa thèse, et que, parvenu à la fin d’une période, il s’arrêtait pour juger de son impression sur l’auditoire, ne voilà-t-il pas que cet original de Lively, poussé on ne sait par quelle heureuse inspiration, a subitement rompu le silence, à propos de rien, fait un signe de tête, et d’un ton dégagé : « S’il vous plaît, monsieur, s’est-il écrié, quelle est votre opinion touchant l’infaillibilité du Pape ? » A ces mots tout le monde est parti d’un grand éclat de rire, Jennings excepté ; au contraire, notre professeur commençait à froncer le sourcil, et l’on ne peut même dire ce qu’il en serait advenu, lorsque, par hasard, ses yeux sont tombés sur sa montre. Troublé à cette vue, il a fermé son livre et sur-le-champ congédié l’auditoire. »
« La chose est assez comique, repartit Charles en riant. Toutefois je vous assure, Sheffield, que Jennings, malgré sa roideur et son air si froid, est au fond, à mon avis, un très-bon enfant. Dernièrement, il m’a témoigné beaucoup d’intérêt dans une conversation ; il est même sorti de ses habitudes pour me faire quelques faveurs. Sa charité envers les pauvres est inépuisable ; et l’on s’accorde à dire que ses discours à Sainte-Croix sont excellents. » Sheffield répliqua qu’il aimait que les gens eussent des manières naturelles, et qu’il avait en horreur ces façons affectées et pompeuses. Quel bien cela pouvait-il faire ? Et quelle portée cela avait-il ? « Voilà ce que j’appelle du puritanisme, répondit Charles ; ma manière de voir, c’est de prendre chacun pour ce qu’il est, et non pour ce qu’il n’est pas : l’un a cette qualité, l’autre celle-là ; mais nul n’est parfait. Pourquoi ne pas fermer les yeux sur ce qu’on n’aime point, et ne pas admirer ce qui nous plaît ? Voilà la science du savoir-vivre, la seule vraie sagesse, et certainement notre devoir, par-dessus le marché. » Sheffield jugea cette réponse prosaïque et fausse. « Nous devons avoir un système arrêté, ajouta-t-il ; sans cela, une chose est aussi bonne qu’une autre. Mais je ne puis rester ici toute la journée, et nous devrions déjà être à la promenade. » Ce disant, il ôta à Charles sa toque et lui mit à la place son chapeau. « Allons, sortons. — Il faut donc que je renonce au Meadow. — Sans doute ; vous devez vous promener en castor. J’ai besoin de vous pour aller jusqu’à Oxley, village qui n’est pas loin de notre route, et dont, au reste, tous les ministres, tôt ou tard, deviennent évêques. Peut-être cette promenade nous portera-t-elle bonheur. »
Les deux amis sortirent, équipés de la tête aux pieds selon la tenue la plus irréprochable d’Oxford, d’une recherche et d’une élégance exquises. Sheffield entrait dans High Street[20], lorsque Charles l’arrêtant : « Ça m’ennuie toujours, dit-il, d’aller en chapeau dans cette rue ; on est sûr de rencontrer un Censeur. — Tous ces costumes d’Université sont du pur charlatanisme, répliqua Sheffield ; est-ce qu’ils nous rendent meilleurs ? A dire vrai, ce sont des masques et pas autre chose. Et puis, notre robe est si affreusement laide ! — Je ne souscris pas à une condamnation si entière, reprit Charles. Oxford est un siége important, et il convient qu’on y ait un costume spécial. Je vous l’avoue, lorsque, pour la première fois, je vis la procession des Chefs à Sainte-Marie, j’en fus profondément touché. D’abord… — Naturellement les massiers », dit Sheffield en l’interrompant. « D’abord, l’orgue se fait entendre, et chacun se lève ; puis, le vice-chancelier s’avance dans son costume rouge, et, par une inclination, salue le prédicateur, qui se dirige vers la chaire ; viennent ensuite les différents Chefs rangés en ordre, et, enfin, après eux, les Censeurs. Cependant, vous apercevez la tête du prédicateur qui monte posément l’escalier de la chaire ; arrivé à son siége, il ferme la porte, jette un regard à la tribune de l’orgue pour saisir le psaume, et aussitôt les chants commencent. » A cette description, Sheffield se mit à rire. « Eh bien, Charles, j’approuve votre exemple. Le prédicateur est, ou est supposé être, un homme de talent ; il va commencer son discours : théologiens et étudiants d’une grande université sont là pour l’entendre. La parade ne fait que me représenter exactement le grand fait moral qui est devant nous. Ceci, je le comprends ; je ne l’appelle pas du charlatanisme ; mais ce que je qualifie de ce nom, ce sont les formes extérieures sans âme. Or, je dois le dire, le sermon lui-même et la prière qui le précède… Mais comment l’appelle-t-on cette prière ? — La prière de demande[21]. — Eh bien, et sermon et prière, tout ça n’est souvent que du charlatanisme. Je vais rarement aux discours de l’Université, mais je les ai assez suivis pour ne plus y assister, à moins de contrainte. Le dernier prédicateur que j’y ai entendu était de la campagne. Oh ! ce fut merveille ! Il commença d’abord en criant du ton le plus aigu : « Vous prierez. » Quelle rapsodie ! « Vous prierez. » Parce que le vieux Latimer ou Jewell a dit : « Vous prierez », il ne faut donc plus dire : « Prions. » Puis il nous jeta ces mots, continua Sheffield, en prenant un ton pompeux qu’il élevait et baissait tour à tour : « Spécialement pour cette branche pure et apostolique de l’Église établie (ici notre homme se leva sur la pointe des pieds), établie dans ces États. » Vint ensuite : « Pour notre Souveraine et Reine, Lady Victoria, défenseur de la foi ; dans toutes les causes et sur toutes les personnes tant civiles qu’ecclésiastiques, dans l’étendue de ce royaume, juge suprême. » A ce mot, silence imposant ; on entend clairement la chute de l’étui à sermon[22] sur le coussin de la chaire ; on dirait que la nature ne peut créer, ni l’esprit humain soutenir une pensée plus forte. Après cette pause, toujours sur le même ton nasillard : « Pour les pieux et bienfaisants fondateurs des colléges de Tous les Saints et de Leicester. » Mais son chef-d’œuvre fut l’énumération emphatique « de tous les docteurs, ainsi que des deux Censeurs[23] », comme si l’antithèse des nombres avait la puissance du burin, et devait nous reproduire tous ces excellents personnages en un délicieux tableau vivant. — Cette description originale amusa Charles ; il répliqua néanmoins que, pour lui, il n’avait jamais entendu un sermon sans en retirer quelque profit, à moins qu’il n’y mît de la mauvaise volonté ; et à ce sujet, il cita la réponse que lui fit un jour son père à cette demande, s’il ne lui était pas arrivé quelquefois de faire un sermon médiocre : « Mon cher fils, lui avait-il dit, tous les sermons sont excellents. » Paroles qui, à cause même de leur simplicité, s’étaient profondément gravées dans sa mémoire.
[20] Cette rue, large et se développant en forme de courbe, présente une perspective admirable. En se plaçant non loin du collége de la Madeleine, on saisit dans un seul coup d’œil les bâtiments de l’Université, le Collége de la Reine, l’Église de Sainte-Marie, le Collége de toutes âmes et celui de tous saints.
[21] Au commencement du service anglican, le ministre engage l’assistance à prier pour les différents besoins qu’il énumère.
[22] Les ministres anglicans ont l’habitude de porter en chaire leurs discours écrits qu’ils enferment dans une espèce d’étui.
[23] Les Censeurs ont principalement pour charge de veiller à l’observation des règles universitaires. Il n’y a que deux Censeurs ; leurs fonctions sont annuelles. Tous les colléges, à l’exception d’un seul, ayant droit d’élection à tour de rôle, chaque année il y a deux de ces établissements qui nomment, chacun, un censeur.
Cependant nos deux étudiants avaient parcouru High Street, cette rue prohibée, et traversaient le pont[24], lorsque sur le côté opposé ils virent devant eux un homme de haute taille et d’une contenance roide. Sheffield n’eut pas de peine à le reconnaître ; c’était un bachelier de Nun’s Hall, et un importun, au moins de second ordre. Quoique revêtu de sa toge et coiffé de sa toque, il paraissait avoir l’intention de faire une promenade dans les champs. Comme il prit le sentier qu’ils devaient suivre eux-mêmes, ils essayèrent de marcher derrière lui ; mais leur pas était trop rapide et celui du bachelier trop lent pour qu’ils ne l’atteignissent pas bientôt.
[24] Le pont de la Madeleine.
Peindre un importun dans un récit n’est pas chose facile, et cela, parce que c’est un importun. Un conte doit tendre vite à son dénoûment : un importun, au contraire, traîne toujours en longueur. Ce n’est que dans une course de longue haleine qu’on peut le reconnaître, et alors on sent qui il est : on le trouve oppressif ; semblable au sirocco, que l’indigène devine tout de suite, tandis que l’étranger s’y trompe souvent. Tenet, occiditque. Si vous n’entendez de lui qu’un seul discours, peut-être le jugerez-vous un homme instruit et agréable ; mais si à son bavardage il n’y a jamais de fin ; s’il vous débite une seule et même prose toutes les fois qu’il vous rencontre ; s’il vous tient sur vos jambes jusqu’à défaillance ; s’il vous garde sans pitié, quand vous voudriez remplir un engagement, ou assister à une conversation intéressante, alors il n’y a pas à s’y tromper : la vérité vous saute aux yeux, apparent diræ facies, vous êtes sous les griffes d’un importun. Vous pouvez céder, vous pouvez fuir, mais vous ne sauriez vaincre. De là n’est-il pas évident qu’un importun ne peut être représenté dans un récit, sans quoi le récit serait aussi importun que notre individu lui-même ? Donc, lecteur, vous devez croire sur parole que cet homme à la taille roide, ce M. Bateman, est réellement ce que vous ne sauriez découvrir d’une autre manière, et nous savoir gré du motif qui nous a fait affirmer plutôt que démontrer notre proposition.
Sheffield salua poliment notre bachelier, et eût voulu poursuivre sa route ; mais Bateman, entraîné par sa nature, ne le permit pas. Le saisissant par la main : « Seriez-vous disposé, dit-il, à jeter un coup d’œil dans la jolie chapelle que nous faisons restaurer dans les champs ? C’est une vraie perle, dans le style le plus pur du quatorzième siècle. Elle était dans un bien triste état, on eût dit d’une étable ; mais nous avons ouvert une souscription, et nous allons mettre tout en ordre. — Nous nous rendons à Oxley, répondit Sheffield, vous nous entraîneriez hors de notre route. — Pas du tout, répliqua Bateman ; ce n’est pas à un jet de pierre du chemin. Vous ne pouvez me refuser cette faveur. Je suis sûr que notre œuvre aura toutes vos sympathies. » Il s’empressa ensuite de leur faire l’histoire de la chapelle : tout ceci a existé ; tout ceci aurait pu être ; tout ceci n’existait pas ; tout ceci devait se faire. « Ce sera, continua-t-il, un vrai spécimen de chapelle catholique ; nous avons même l’intention de tenter une démarche auprès de l’évêque, afin qu’il la dédie au Royal Martyr. Pourquoi n’aurions-nous pas notre saint Charles, aussi bien que les catholiques romains ? Quel doux plaisir ne sera-ce pas, d’ailleurs, d’entendre la cloche jeter, chaque soir, ses tintements sur la bruyère sombre, par tous les temps, et à travers toutes les péripéties et les hasards de cette vie mortelle ! » Sheffield lui demanda quelle assemblée il pensait réunir à cette heure. « Voilà une idée peu élevée, répondit Bateman ; ce n’est pas une question. Dans les véritables églises catholiques, le nombre des assistants ne fait rien à la chose ; le service divin se célèbre pour ceux qui y viennent et non pas pour ceux qui sont dehors. » Cette réponse, répliqua Sheffield, je la comprends dans la bouche d’un catholique romain, parce que dans son Église on suppose un sacrifice offert par un prêtre, avec ou sans assistance. Et puis, les chapelles catholiques sont bâties souvent sur les corps des martyrs, ou dans un lieu remarquable par quelque miracle, mais notre service, à nous, est la prière en commun ; et comment pouvons-nous le célébrer sans une assemblée ? »
Bateman répondit que, alors même que les membres de l’Université n’y viendraient pas, ce à quoi il s’attendait, au moins la cloche serait un mémento de loin comme de près. « Ah ! je vois, reprit Sheffield, son usage sera l’inverse de ce que vous disiez tout à l’heure : elle servira, non pour ceux qui viendront, mais pour ceux qui seront dehors. L’assemblée sera au dehors, et non au dedans ; c’est une affaire d’extérieur. Je me rappelle avoir vu autrefois une haute tour d’église ; c’est ainsi, du moins, qu’elle paraissait de la route ; mais quand on la regardait sur le côté, on ne voyait qu’une mince muraille, bâtie pour simuler une tour ; et cela, afin de donner un aspect imposant à l’édifice. Élevez aussi un bout de muraille, et placez-y la cloche. — Il y a un autre motif qui nous a fait entreprendre cette restauration, repartit Bateman, motif tout à fait indépendant du culte. C’est que cette chapelle date d’un temps immémorial, et qu’elle fut consacrée par nos ancêtres catholiques. » Sheffield objecta qu’il y aurait autant de raison pour y dire la messe que pour conserver le bâtiment. « La messe, nous la conservons, répondit Bateman ; nous offrons la nôtre, tous les dimanches, selon le rite de celui que l’honnête Pierre Heylin appelle le Cyprien[25] de l’Angleterre ; que pouvez-vous désirer de plus ? » Cette réponse fut-elle comprise de Sheffield ? Qui le sait ? Mais au moins elle était hors de la portée de Charles. Cette messe anglaise était-ce la Prière Commune, ou le service de la communion, ou la litanie, ou le sermon, ou une partie quelconque de ces choses ? Ou bien les paroles de Bateman étaient-elles un véritable aveu qu’il existait des ministres qui, à cette époque, célébraient la messe papiste une fois la semaine ? La pensée précise de Bateman est perdue pour la postérité ; car ils étaient arrivés, en causant ainsi, à la porte de la chapelle. Cet édifice avait été autrefois une aumônerie ; à côté se trouvait une petite ferme. Quant à la population, on voyait évidemment que la restauration de la chapelle ne lui était pas nécessaire. Au moment d’entrer, Charles resta en arrière et dit tout bas à son ami qu’il ne connaissait pas Bateman[26]. Une présentation eut donc lieu. — Reding de Saint-Sauveur. — Bateman de Nun’s Hall. La cérémonie étant faite, en guise d’eau bénite, ils entrèrent tous ensemble dans la chapelle.
[25] Il s’agit de Laud. P. Heylin a écrit la vie de ce théologien anglican.
[26] Deux Anglais, surtout deux gentlemen, ne s’adressent jamais la parole jusqu’à ce qu’ils aient été présentés l’un à l’autre (introduce). Une semblable réserve, c’est, dit-on, de la liberté individuelle. Quant à la forme de la présentation, elle n’est pas plus difficile que celle qui est dans le texte.
L’édifice était aussi beau que les paroles de Bateman avaient pu le faire supposer ; la restauration en avait été faite avec beaucoup de goût. On y remarquait un autel de pierre du meilleur style, une crédence, une piscine qui ressemblait à un tabernacle, et une paire de chandeliers de cuivre. Charles demanda à quoi servait la piscine, dont il ignorait même le nom. On lui répondit qu’il y avait toujours, autrefois, une piscine dans les vieilles églises d’Angleterre, et qu’on ne pouvait faire une restauration intelligente sans la replacer. Il s’informa ensuite de l’objet de ce coffre, ou espèce d’armoire, si admirablement travaillé, qu’on apercevait sur l’autel ; et il apprit que « nos sœurs, les églises de l’obédience de Rome, avaient toujours un tabernacle pour garder le pain consacré. » Après cette réponse, Charles se tut. Profitant de ce silence, Sheffield demanda à connaître l’usage des niches ; et Bateman lui dit que les images des saints étaient sans doute prohibées par les canons, mais que ses amis en ces matières faisaient ce qu’ils pouvaient. Interrogé enfin sur l’emploi des chandeliers, notre bachelier répondit que, vu les dispositions de leur évêque à l’égard des catholiques, ils avaient quelque crainte que ce prélat ne mît opposition à l’emploi du luminaire dans le service, au moins tout d’abord ; mais qu’il était évident que les chandeliers étaient faits pour porter des cierges. Ayant eu le temps convenable pour voir et admirer, Reding et Sheffield se disposèrent à reprendre leur course. Ils ne purent, toutefois, esquiver une invitation à déjeuner, sous peu de jours, au domicile de Bateman, dans le Turl[27].
[27] Si le lecteur s’est donné la peine de parcourir la conférence de M. le chanoine Oakeley ayant de lire Perte et gain, il comprendra facilement que Bateman appartient à la coterie des amateurs catholiques, selon l’expression caractéristique du digne ex-fellow de Balliol. Ce jeune bachelier est un des représentants du côté superficiel du mouvement religieux. Aussi ne doit-on pas être étonné s’il ne se convertit pas.
Aucun des deux amis n’avait encore, en fait de religion, ce qu’on appelle des vues. Par ce mot, nous n’entendons pas dire qu’ils n’eussent déjà une opinion arrêtée sur cette importante matière, les juger ainsi serait une erreur ; mais nous voulons faire comprendre qu’aucun d’eux (et comment l’auraient-ils pu à leur âge ?) n’avait fait reposer sa religion sur une base intellectuelle. Aussi bien, expliquons d’une manière plus claire ce que sont des vues, ce qu’on entend par un homme à vues, et quel est l’état de ceux qui n’ont pas de vues. Lors donc que des personnes jettent les yeux, pour la première fois, sur le monde de la politique ou de la religion, tout ce qu’elles voient produit sur leur esprit le même effet qu’un paysage qui s’offrirait, également pour la première fois, à un homme jusqu’alors aveugle. Tout leur paraît à égale distance ; il n’y a pas de perspective. La relation d’un fait avec un fait, d’une vérité avec une vérité, le rapport entre un fait et une vérité, entre une vérité et un fait, comment telle chose mène à telle autre, quels sont les principes premiers et les principes secondaires : tout cela elles ont à l’apprendre. C’est pour elles une science nouvelle, et elles ignorent leur ignorance même sur ce point. Dans leur esprit, le monde d’aujourd’hui n’a aucun rapport avec le monde d’hier ; le temps n’est pas le torrent qui se précipite, mais il s’immobilise devant elles, rond et plein comme la lune. Elles ne connaissent pas l’histoire de dix ans, encore moins celle d’un siècle ; pour elles le passé ne vit pas dans le présent ; elles ne comprennent pas l’intérêt des questions qui s’agitent ; les noms ne font naître en elles aucune association d’idées, et les individus n’éveillent dans leur mémoire aucun souvenir. Elles entendent bien parler et des hommes, et des choses, et des projets, et des luttes, et des principes ; mais tout va et vient comme le vent ; rien ne fait impression, rien ne pénètre, rien ne se fixe dans leur esprit. Elles ne savent pas ranger leurs idées ; elles n’ont pas de système. Elles entendent et elles oublient, ou tout au plus elles se rappellent ce qu’elles ont entendu autrefois, mais sans pouvoir dire en quel lieu. De là nulle consistance dans leur argumentation ; aujourd’hui elles raisonneront d’une manière et demain d’une autre, au moins indirectement, c’est-à-dire à l’aventure. Les fils de leur raisonnement divergent ; rien ne vient à sa place ; il n’y a pas d’idée mère sur laquelle s’appuie leur esprit, d’où procèdent leurs jugements sur les hommes et les choses. Et tel est l’état de bien des gens, pendant toute leur vie. Aussi quels misérables politiques, ou hommes d’Église ne font-ils pas, à moins que leur bonne fortune ne les ait mis entre des mains sûres, et qu’ils ne soient menés par d’autres, ou qu’ils ne soient engagés dans un parti. Autrement, voyez-les, ils sont à la merci des vents et des vagues ; et, sans être radicaux, whigs, tories, ou conservateurs, partisans de la haute ou de la basse Église[28], ils agissent, ou comme un whig, ou comme un tory, ou comme un catholique, ou comme un dissident, selon que le caprice les pousse, que les événements ou les partis les mènent. Si parfois leur amour-propre est blessé, ils se consolent dans la pensée que leur conduite est la preuve qu’ils sont des hommes libres, modérés, sans passions, des hommes du juste-milieu, et non des hommes de parti ; tandis que, dans le fait, ils sont les plus malheureux des esclaves ; car notre force, en ce monde, c’est d’être les sujets de la raison, et notre liberté d’être les captifs de la vérité.
[28] La haute Église, ou les partisans de l’Église et de l’État (the church and state) ; l’Église basse, ou le parti puritain, qui ne reconnaît que la Bible pour règle de foi.
Et maintenant, qu’y a-t-il d’étonnant que Charles, jeune imberbe d’une vingtaine d’années, n’eût pas des vues profondes en fait de religion ou de politique ? Toutefois un homme d’intelligence ne se permet pas de juger des choses à l’aventure et au hasard. Par une espèce de respect qu’il se doit, il est obligé de se tracer une règle de conduite quelconque, vraie ou fausse ; et Charles goûtait beaucoup la maxime qu’il a déjà émise, savoir : qu’il faut estimer les gens d’après ce qu’ils sont, et non d’après ce qu’ils ne sont pas. Il considérait comme un premier devoir d’aimer tous les hommes, de les regarder tous d’un œil de bonté ; son cœur était fortement pénétré du sentiment que le poëte a exprimé dans ces vers populaires :
Quand il rencontrait dans ses promenades un laboureur ou un cavalier, un gentilhomme ou un mendiant, il aimait à se dire : « Voilà un chrétien. » Et lorsqu’il vint à Oxford, il y entra avec un enthousiasme si simple et si chaleureux, qu’on eût dit presque celui d’un enfant. Son respect, il le portait jusqu’à honorer même le velours du vice-Censeur ; que dis-je ? le bonnet à cornes qui précède le prédicateur avait aussi des droits à sa déférence. Sans être poëte, il était dans la saison de la poésie, à l’époque du délicieux printemps, alors que l’année est dans toutes ses splendeurs, tout y étant nouveau. La nouveauté était la beauté elle-même pour un cœur aussi ouvert et aussi aimant que le sien ; non pas seulement parce que c’était de la nouveauté, et que comme telle, elle a ses propres charmes, mais bien parce que, quand les objets nous apparaissent pour la première fois, nous les voyons dans une aimable confusion, qui est le principal élément de la poétique. Mais à mesure que le temps marche et que nous arrivons à énumérer, à classer et à apprécier les choses, à mesure que nous agrandissons nos vues, nous avançons vers la philosophie et la vérité ; mais nous nous éloignons de la poésie.
Dans notre jeunesse, nous allâmes un jour par un soleil brûlant d’été nous promener sur la route qui va d’Oxford à Newington, route fort triste, comme le savent bien tous ceux qui l’ont parcourue. Cependant, c’était du nouveau pour nos yeux, et nous vous l’assurons, lecteur, croyez-le ou ne le croyez pas, riez ou non, comme il vous plaira, cette route, dans cette circonstance, nous parut d’une beauté touchante. Elle éveilla dans notre cœur une douce mélancolie, mélancolie dont la vague sensation nous émeut encore quand nous jetons un regard en arrière sur ce voyage accompagné de tant de poussière et de fatigue. Et pourquoi ? Parce qu’alors chaque objet que nous rencontrions était inconnu et plein de mystère. Un arbre ou deux, à distance, nous semblaient le commencement d’une grande forêt ou d’un parc d’une étendue sans limites : une colline cachait derrière elle un vallon, et ce vallon avait son histoire ; les sentiers eux-mêmes, avec leurs haies verdoyantes aux mille détours capricieux, frappaient notre imagination. Telles furent les impressions du premier voyage ; mais quand nous eûmes fréquenté souvent la même voie, alors l’esprit ne se prêta plus à l’action, la scène cessa d’être enchanteresse, la triste réalité seule resta, et nous demeurâmes convaincu que cette route d’Oxford à Newington était la plus ennuyeuse et la plus détestable que nous eussions jamais parcourue.
Mais revenons à notre histoire. Nous avons fait le portrait de Reding. Quant à Sheffield, sans avoir dans l’esprit plus de vues réelles que Charles, néanmoins à cette époque il cherchait à en acquérir, mais il était bien plus en danger d’en accueillir de fausses. En d’autres termes, c’était un homme à vues, dans le mauvais sens de l’expression. Il n’était pas satisfait des choses telles qu’elles sont ; il était censeur, impatient de réduire tout en système ; il exagérait les principes, aimait la discussion, soit pour le plaisir de l’exercice, soit parce que son esprit était inquiet : au fond, il n’avait rien fortement à cœur.
Aucun de nos deux amis ne prenait un vif intérêt aux controverses qui s’agitaient alors à l’Université et dans le pays touchant la haute et la basse Église. Sheffield avait une espèce de mépris pour cette polémique, et Reding trouvait de mauvais goût de se montrer original ou de se faire distinguer en quoi que ce fût. Une de ses connaissances d’Eton l’avait engagé un jour à venir entendre un des meilleurs prédicateurs du parti catholique, et lui avait offert de le présenter ; mais il avait décliné cet honneur. Il n’aimait pas, disait-il, à se mêler aux partis ; il était venu à Oxford pour prendre ses grades et non pour y embrasser des opinions. En agissant autrement, il aurait craint la désapprobation de son père ; et puis, il sentait de la répugnance à épouser de telles idées et à se faire l’ami de telles personnes, par cela seul que les autorités de l’Université étaient opposées à tout ce mouvement. A ses yeux, les chefs de l’agitation étaient des démagogues, et les démagogues, il les avait en grande horreur, il les méprisait. Il ne pouvait pas comprendre comment des ecclésiastiques, hommes respectables d’ailleurs, travaillaient à grouper auteur d’eux de jeunes sous-gradués ; plus d’une histoire même qu’il entendit sur leurs intrigues le blessa. En outre, il n’aimait pas les spécimens de leurs partisans qu’il avait eu l’occasion de voir ; c’étaient des hommes présomptueux ou qui « parlaient haut », comme on disait alors. Ils faisaient des actions ridicules, extravagantes, et parfois négligeaient leurs devoirs de collége pour des choses qui ne les regardaient en aucune façon. Charles avait eu sans doute du malheur ; car cette appréciation n’est pas le vrai portrait des hommes les plus remarquables de cette époque qui, certainement, font encore aujourd’hui, comme ecclésiastiques ou comme laïques, la force de l’Église anglicane. Mais dans toutes les réunions d’hommes, la paille et les immondices (selon les paroles de Bacon) flottent sur l’eau, tandis que l’or et les pierreries tombent au fond et demeurent cachés ; ou, pour mieux dire encore, bien des hommes, la plupart des hommes, sont un mélange de qualités précieuses et de défauts : les défauts surnagent, les bonnes qualités restent dans l’abîme.
Bateman était un de ces caractères complexes dont nous venons de parler. Il y avait du bon chez lui, il ne manquait pas de mérite ; mais il était absurde ; aussi servit-il de thème à la conversation de nos deux amis pendant le reste de leur promenade. « J’aimerais qu’on vît moins de charlatanisme et de grimaces en tout lieu, dit Sheffield ; on pourrait en emporter d’ici des charretées, et même sans que rien y parût. — Si l’on faisait à votre goût, répondit Charles, vous useriez les routes au point qu’on ne pourrait plus se promener. Nous sommes obligés de marcher dans cette voie que vous nommez charlatanisme. Nous la foulons aux pieds, mais enfin nous nous en servons. — Je ne puis admettre un tel système ; c’est tout simplement faire le mal pour arriver au bien. Oui, je vois partout la comédie. Je vais à Sainte-Marie, et là j’entends des hommes qui débitent des lieux communs, tantôt d’une voix sépulcrale, tantôt d’un ton aigu, d’autres fois avec une certaine emphase mesurée, claire, calme, et un regard étudié, comme, par exemple, ce prédicateur de Bampton qui, il n’y a pas longtemps, nous soutenait, à propos de la résurrection des corps, que tous les essais pour ranimer un cadavre, au moyen de méthodes naturelles, avaient complétement échoué. Si je pénètre dans la salle où se donnent les grades, dans la salle de la Convocation, là, pendant des heures entières, je suis obligé de subir un latin ridicule, d’entendre accorder des grâces, des dispenses, de voir les Censeurs monter, descendre pour rien absolument ; et tout cela, afin de conserver l’esprit de choses vieillies depuis des siècles, alors que le travail réel pourrait se faire en un quart d’heure. Je rencontre Bateman, et voilà mon homme qui me parle de jubés sans crucifix, de piscines sans eau, de niches sans statues, de chandeliers sans lumières, de messes sans pape ; et, moi, je dis avec Shakespeare : « Le monde est un vrai théâtre. » Ce n’est pas tout : je m’adresse à Shaw, à Turner, à Brown, hommes de caractères bien différents, élèves de Gloucester (vous comprenez de qui je parle), et ils nous prêchent qu’il faut placer des crucifix aux carrefours, afin d’exciter chez les passants des sentiments religieux. »
« — Pour ma part, je pense que vous êtes trop sévère envers tous ces hommes-là, dit Charles ; votre discours ressemble beaucoup à de la déclamation ; si l’on vous croyait, il faudrait abolir toutes les formes extérieures. Vous me faites l’effet de cet homme qui, dans un des romans de miss Edgeworth, ferme ses oreilles à la musique, afin de pouvoir rire à son aise des danseurs. — A quelle musique fermé-je les oreilles ? — A la signification de tous les divers actes dont nous venons de parler ; les sentiments pieux qui accompagnent la vue des images, voilà la musique. — Sans doute, pour ceux qui déjà ont ces sentiments ; mais rétablir les images en Angleterre pour faire naître des sentiments, c’est tout juste danser pour créer la musique. — Je crois que vous ne rendez pas justice à notre pays, mon cher Sheffield ; nous sommes un peuple religieux. — Eh bien, je vais vous présenter la chose d’une autre manière : Aimez-vous la musique ? — Avez-vous donc oublié la frayeur que j’occasionnai à une certaine personne avec mon violon ? — Aimez-vous la danse ? — A dire vrai, je ne l’aime pas du tout. — Ni moi non plus, reprit Sheffield, et je ne puis penser sans rire à ce que je fis, étant encore enfant, pour y échapper. La danse est quelque chose de si absurde ; et puis, il fallait se montrer poli et aimable envers des jeunes filles légères ou précieuses. Je me conduisis parfois à leur égard avec tant de grossièreté, que je fus humilié de mon impolitesse ; aussi ne savais-je plus comment me tirer d’embarras. — J’ignorais, mon cher ami, que nous eussions entre nous un point de ressemblance aussi frappant. Oh ! quelle humiliation j’eus à souffrir, lorsqu’il fallut se tenir debout, prêt à danser, et figurer avec une dame ! Tous les yeux tournés sur moi qui étais si gauche ! Bien des jours avant, comme après, ce me fut un martyre. »
Cependant, ils étaient arrivés au pied d’une pente roide qui mène à une espèce de plateau sur le bord duquel se trouve Oxley, et ils s’arrêtèrent un instant pour voir des cavaliers qui sautaient des barrières. Ils montèrent ensuite la colline et se retournèrent vers Oxford. « Peut-être, dit Charles, appellerez-vous toutes ces flèches et ces tours un magnifique simulacre, parce que vous en apercevez le faîte sans en découvrir la base ? — Où en étions-nous de notre discussion ? » reprit Sheffield, se rappelant qu’ils s’en étaient écartés pendant les dix dernières minutes : « oh ! je m’en souviens, j’y suis. Je disais donc que vous aimiez la musique, mais que vous détestiez la danse. Pour d’autres, la musique est l’aiguillon qui les pousse à danser ; pour vous, c’est le contraire ; la danse même diminue le sentiment de plaisir que vous cause la musique. Eh bien, pareillement, c’est un acte de pédantisme de vouloir rendre une nation religieuse, comme l’Angleterre, plus religieuse encore, en plaçant des images dans les rues. Un tel procédé n’est pas anglais, et il ne peut que nous blesser. S’il était dans le génie de ce peuple, il serait venu naturellement, sans qu’on nous y eût engagés. Comme la musique entraîne à la danse, ainsi la religion nous eût fait adopter les images. Mais de même que la danse n’ajoute rien aux charmes de la musique pour ceux qui n’aiment pas à danser, de même, les cérémonies n’agrandiront pas le sentiment religieux chez ceux qui détestent les cérémonies. — Donc, à vos yeux les catholiques romains sont des charlatans, puisqu’ils emploient des crucifix ? — Halte-là ; vous sortez maintenant de la question. Les catholiques romains croient que les images possèdent une certaine vertu. Sans doute c’est absurde, mais en les honorant ils sont conséquents avec leurs principes. Ils n’exposent pas les images pour en faire des montres d’apparat, pour éveiller des sentiments dans le cœur de ceux qui les contemplent, ainsi que le voudrait Gloucester, mais ils les honorent d’un culte solide, naturel et ardent : à leurs yeux, elles disent plus qu’elles ne paraissent ; ce ne sont pas de simples représentations. Ils leur rendent des honneurs religieux, soit parce que de grands saints les ont autrefois vénérées, soit parce qu’en temps de peste on s’est adressé à elles, soit parce qu’elles ont opéré des miracles, soit parce qu’elles ont remué leurs yeux, incliné leur tête ; ou, au moins, parce qu’elles ont été bénites par la main du prêtre, et qu’elles ont des relations mystérieuses avec la grâce invisible. Tout cela, je l’avoue, est superstitieux ; mais tout cela a une réalité. »
Charles n’était pas satisfait de cette argumentation. « Une image est un mode d’enseignement, répliqua-t-il. Voulez-vous donc dire qu’un homme est un saltimbanque parce qu’il se méprend sur le mode d’enseignement le plus convenable à son pays ? — Cette qualification, je ne l’ai pas donnée à Gloucester, repartit Sheffield ; j’ai seulement soutenu qu’un pareil mode d’enseignement, chez des protestants, était du charlatanisme et une farce. — Mais votre principe vous conduira trop loin, et, d’ailleurs, il se détruit lui-même. Ne vous rappelez-vous pas le passage d’Aristote que nous cita, l’autre jour, Thompson, passage qu’il avait rencontré dans une de ses leçons avec Vincent, et qui nous paraissait si subtil, savoir : que les habitudes sont créées par ces mêmes actes dans lesquels elles se manifestent lorsqu’elles sont produites ? C’est en s’essayant à nager qu’on apprend à bien nager. J’en viens à Bateman. Il désire, sans aucun doute, introduire dans nos églises les piscines et les tabernacles ; or, attendre, avant de commencer, qu’on ait accepté cette réforme, c’est agir comme un homme qui ne va pas à l’eau sans savoir nager. — Soit ; mais quel bien en reviendra-t-il à Bateman, quand l’usage de la piscine sera devenu universel ? Qu’est-ce que cela signifie ? Dans l’Église romaine, la piscine a son emploi, je le sais, quoique j’ignore lequel ; on s’en sert pendant la messe. Mais que Bateman rende universel l’usage des piscines, et qu’aura-t-il créé, sinon le règne d’un charlatanisme universel ? — Mais, mon cher Sheffield, combien de choses n’y a-t-il pas qui, dans le cours des âges, ont changé leur destination première, et toutefois en conservent encore une, quoique différente ? La perruque d’un juge n’est pas du charlatanisme, cependant elle a déjà son histoire. La reine, à son couronnement, porte un vêtement qu’on dit être catholique romain ; est-ce du charlatanisme ? Ne vous figure-t-il pas, en traits ineffaçables, « la divinité qui entoure un roi », quoique ce vêtement ait perdu la signification qu’y attachait l’Église de Rome ? Ou seriez-vous du nombre de ceux qui, selon un vieux calembour sur le mot Majesté[29], estiment la chose elle-même une farce ? — Vous prohibez donc l’introduction des piscines et des chandeliers qui n’ont aucun but ? — Je pense, mon ami, qu’il y a une grande différence entre faire revivre une chose et la conserver : la conserver paraît naturel, même quand son emploi a cessé ; la faire revivre, quand elle est déjà morte, c’est contre nature. Mais ceci est une question de prudence et de jugement. — Ainsi donc, vous condamnez Bateman », conclut Sheffield.
[29] Dépouillez majesty — la majesté — de ses dehors (of its externals), c’est-à-dire enlevez à ce mot sa première et sa dernière lettre, que reste-t-il ? ajest, a jest, — une farce. — Ce calembour, qui existe dans l’original, ne peut, comme on le voit, se traduire en français.
Il y eut un moment de silence. Charles reprit ensuite : « Mais peut-être ces hommes désirent actuellement introduire les réalités aussi bien que leurs formes extérieures ; peut-être désirent-ils employer la piscine aussi bien que l’avoir… Sheffield, continua-t-il brusquement, pourquoi les costumes de cérémonie dans l’église ne sont-ils pas du charlatanisme, si les piscines méritent ce nom ? — Ces costumes… » répondit Sheffield paraissant réfléchir, « non, ces costumes ne sont pas du charlatanisme ; car prêcher, je suppose, est la fonction la plus haute dans notre Église, et l’on y consacre les plus riches vêtements. Les robes d’un grand prédicateur, je le sais, coûtent bien des livres ; j’en ai connu un, près de chez nous, qui, à son départ, reçut en présent, de certaines dames, un assortiment complet, et une douzaine de pantoufles brodées, par-dessus le marché. Mais tout cela est convenable, si la prédication est le principal office du clergé. Vient ensuite le sacrement[30], et il exige le surplis et le capuchon. Et le capuchon, répéta-t-il tout pensif… mais à quoi sert-il ? Non, c’est l’écharpe. Le capuchon ne se porte que dans la chaire de l’Université. Qu’est-ce que l’écharpe ? Elle appartient aux chapelains, c’est-à-dire aux personnes… Je n’en sors pas. — Mon cher Sheffield, vous vous êtes vous-même coupé la gorge. Vous avez essayé d’expliquer le symbolisme des vêtements du clergé, et vous ne l’avez pu. Seriez-vous encore disposé à appeler cela du charlatanisme ? Répondez-moi à cette seule question : Pourquoi un ecclésiastique porte-t-il un surplis quand il lit les prières ? Mieux encore, je vous poserai la question plus simplement : Pourquoi un ecclésiastique seul a-t-il le pouvoir de lire les prières dans l’église ? pourquoi ne le puis-je pas moi-même ? » Sheffield hésita et parut sérieux. « Savez-vous bien, dit-il ensuite, que vous avez tout juste posé une objection de Jérémie Bentham ? Dans son Église d’Angleterre, cet écrivain propose, si ma mémoire est fidèle, d’enseigner à un enfant de la paroisse à lire la liturgie ; et il demande pourquoi on envoie un jeune homme à l’Université, pendant trois ou quatre ans, à frais énormes ; pourquoi on lui apprend le latin et le grec, et cela pour faire une simple lecture qu’un enfant aurait appris à faire chez une maîtresse d’école. Quelle est la vertu d’une lecture faite par un ministre ? Voilà à peu près les paroles de Bentham. Et, ajouta Sheffield avec lenteur, à dire vrai, je ne sais que lui répondre. » Cette dernière réflexion étonna Reding ; il en fut même choqué et embarrassé ; il ne savait que dire, lorsque, peut-être heureusement, la conversation fut interrompue.
[30] La cène.
Chaque année amène des changements et des réformes. Nous ignorons l’état actuel de l’église d’Oxley ; elle peut avoir jubé, piscine, sedilia[31], toutes choses nouvelles, comme aussi avoir subi une réforme en sens contraire, c’est-à-dire le dossier des bancs tourné par principe vers la table de communion, et la chaire placée au milieu des bas-côtés. Mais à l’époque où nos jeunes gens traversèrent le cimetière, il n’y avait rien, en bien ni en mal, qui pût les attirer dans l’intérieur de l’édifice, et ils passaient outre, lorsqu’ils aperçurent, en s’éloignant de l’église, ce que Sheffield appelait un vieux don. C’était un fellow[32] connu de Charles, un homme de bonne famille et possesseur d’un petit patrimoine. Il avait fait ses études à l’Université en même temps que M. Reding, et parfois il avait été son hôte au presbytère. Aussi Charles le connaissait depuis son enfance ; et maintenant qu’il était à Oxford, il en avait reçu, comme c’était naturel, plusieurs petites attentions. Un jour qu’il s’était trop attardé pour son dîner, le bon fellow l’avait invité à sa table ; une autre fois, il l’avait emmené à une partie de pêche à Faringdon ; il lui avait également promis des billets pour des dames de sa connaissance, qui devaient venir à la Commémoration[33]. C’était un homme clairvoyant, d’un caractère facile, à la parole libre, aux désirs bornés, d’une sensibilité assez calme, d’une délicatesse peu romanesque, et sans ostentation dans ses croyances religieuses : en d’autres termes, irréprochable dans sa conduite, il détestait néanmoins toute parade de religion et ne pouvait souffrir les prétentions en ce genre. Connaissant l’Université depuis trente ans, il pouvait en porter un jugement équitable sur la plupart des choses. Il était venu à Oxley pour faire des funérailles à la place d’un ami, et il retournait chez lui. Il appela Charles de loin. Celui-ci, embarrassé tout d’abord de se trouver avec deux amis si différents et dans des rapports si opposés, ne tarda pas à se remettre un peu, en voyant l’indifférence de M. Malcolm ; et tous les trois rentrèrent ensemble dans la ville. Reding, toutefois, jusqu’au dernier moment, garda un reste de gêne et de malaise, surtout aux approches d’Oxford, où il rencontra des personnes de différents partis, qui le saluaient en passant.
[31] Siéges gothiques en pierre, pour le célébrant, le diacre et le sous-diacre. Ils sont construits dans l’épaisseur de la muraille du sanctuaire, du côté de l’épître. On en voit des modèles, en Angleterre, dans les églises et les chapelles bâties par le célèbre Pugin.
[32] Le fellow est un membre de l’Université qui jouit d’un legs (fellowship) fondé au profit d’un collége. Tous les colléges ont leurs fellows ; le nombre de ces sortes de bénéficiers s’élève quelquefois jusqu’à trente pour un seul établissement. Les revenus des fellowships varient entre 2,500 et 8,750 francs. Les fellows ne peuvent se marier ; ils ont cependant la liberté de le faire ; mais dans ce cas ils perdent leur fellowship, qui, au reste, est remplacé ordinairement par un bénéfice dans l’intérieur du pays, s’ils sont ministres.
[33] La fête de la Commémoration est d’origine catholique. Jadis elle était consacrée à prier pour les bienfaiteurs de l’Université : on disait une messe pour eux ; aujourd’hui on se contente de faire prononcer un discours en leur honneur. — Nous nous dispensons de toute réflexion ; le lecteur n’aura pas de peine à tirer la conclusion de ce fait. Qu’il nous suffise de dire qu’à Oxford la plupart des monuments et des usages ont conservé leur cachet catholique… Peut-être est-ce à ces restes de respect pour la religion de ses pères que cette ville doit le privilége d’avoir donné naissance au grand Mouvement religieux.
Par forme d’observation, Charles dit qu’ils avaient vu dans la campagne une jolie petite chapelle qui était en voie de restauration. M. Malcolm se prit à rire. « Ainsi, Charles, répliqua-t-il, vous mordez aux nouveautés du jour ? » « Quelles nouveautés ? » s’écria le jeune étudiant, qui, troublé à ce reproche, ajouta pour s’excuser que c’était seulement par hasard qu’un ami les avait conduits à cette chapelle. « Vous me demandez quelles nouveautés ? reprit M. Malcolm ; eh bien, la plus nouvelle, la dernière. Oxford est le lieu des nouveautés ; elles ne manquaient pas non plus de mon temps. La plus grande partie des résidents, les élèves, changent tous les trois ans ; les fellows et les tuteurs, tous les six ; et chaque génération a sa nouveauté. Non, il n’y a pas de principe de stabilité dans cette ville, excepté pour les chefs, qui s’y fixent et qui restent les mêmes jusqu’à la fin de leur carrière. Quel est le caprice du moment parmi vous autres les nouveaux venus ? continua-t-il : est-ce la bouteille ou le cigare ? » Charles sourit modestement ; J’espère, ajouta-t-il, que l’habitude de la boisson a entièrement disparu. « Des choses plus mauvaises peuvent s’introduire, repartit M. Malcolm ; mais la mode est de tous les pays. Autrefois, nous avions ici le club de la Déclamation, peut-être est-il encore en faveur ; auparavant c’était la Société Philharmonique. Nous avons vu la géologie faire fureur ; maintenant, c’est la théologie : et bientôt ce sera l’architecture, ou les antiquités du moyen âge, ou les éditions, ou les manuscrits. Chaque mode s’use à son tour. Tout dépend d’un ou de deux hommes d’action. Mais le secrétaire se marie, ou le professeur obtient un canonicat ; de là des réunions moins régulières, des réunions sans conséquence, et ainsi peu à peu la chose dépérit et meurt. »
Sheffield demanda si le mouvement actuel n’était pas trop général dans le pays pour lui assigner une telle chute. Il n’en savait pas long sur ce point ; mais les journaux en étaient tout remplis, et dans le voisinage c’était le sujet de toutes les conversations : le mouvement ne s’arrêtait pas à Oxford.
« J’ignore ce qui se passe dans l’intérieur du pays, répondit M. Malcolm ; la question est vaste ; mais le mouvement n’a pas ici des éléments de durée. Ces messieurs obtiendront des bénéfices et se marieront, et ce sera la fin de l’histoire. Je ne parle pas contre eux, je les crois des hommes très-respectables ; mais ils sont emportés par le flux de la mode. »
Charles fit observer qu’il était fâcheux que cette agitation alimentât l’esprit de parti. « Oxford, ajoutait-il, devrait être un lieu de calme et d’étude ; la paix et les Muses sont des compagnes inséparables ; et à cette heure on parle, on discute dans chaque quartier. Les étudiants ne peuvent plus remplir leurs devoirs comme à l’ordinaire, ni accepter chacun comme il se présente ; mais ils sont obligés de prendre part aux questions, d’avoir égard à de certaines choses qu’au fond ils rejettent, et d’affecter des opinions quand ils n’en ont réellement aucune.
M. Malcolm donna son assentiment d’un air distrait, occupé d’un point de vue qui s’offrait à ses yeux, et qu’il paraissait considérer avec plaisir. « On trouve laide cette partie du pays, dit-il, et peut-être avec raison ; mais, soit habitude ou non, quant à moi, ce comté me plaît et je lui trouve toujours des charmes. Les effets de lumière y changent à tout instant, de sorte que le paysage, si l’on peut parler ainsi, varie à chaque pas. J’ai vu là-bas Shotover prendre les nuances les plus opposées, quelquefois pourpres, d’autres fois couleur de safran brillant ou orange foncé. » Et il s’arrêta. « Oui, vous parlez de l’esprit de parti ; en vérité, il y en a beaucoup ici… Non, je ne crois pas qu’il y en ait beaucoup, continua-t-il, sortant de sa distraction. Certainement il y a des divisions à Oxford, mais les divisions et la rivalité y sont à l’état de permanence. Les sociétés diverses ont chacune leurs intérêts et leur honneur à maintenir, et elles se querellent, comme les ordres religieux dans l’Église de Rome. Je me trompe, la comparaison est exagérée. Oxford ressemble plutôt à une aumônerie pour les veuves des ministres. La vanité, la jalousie, les bavardages y sont à l’ordre du jour. C’était de même en mon temps. Les deux grandes ladies, dame Vice-Chancelier et dame Théologien-Professeur ne peuvent être d’accord, et elles ont chacune leurs adeptes. Un jour, c’est le Vice-Chancelier lui-même qui, d’un coup de balai, met à la porte de la Convocation[34] tous les jeunes maîtres ; et de là grande colère parmi ceux-ci. Un autre jour, c’est M. Slaney, doyen de Saint-Pierre, qui ne se fait pas scrupule de dire dans une diligence que M. Wood n’est pas un savant, sur quoi Wood, à son tour, l’appelle « le calomniateur Slaney ». Ici, c’est le vieux M. Barge, ex-doyen fellow de Saint-Michel, qui s’imagine que sa jolie fiancée n’a pas été reçue avec les honneurs convenables. Là, c’est le docteur Crotchet, qu’une influence funeste écarte, pendant bien des années, de l’évêché qui lui est destiné. D’un autre côté, c’est M. le professeur Carraway qui a été peint d’une manière infâme, dans la Revue d’Edimbourg, par un élève paresseux qu’il avait humilié aux examens. Mais, voici (majora movemus) que trois colléges forment mutuellement le vœu d’une mortelle opposition à un quatrième ; ou enfin, que les jeunes maîtres, hommes de labeur, trament une conspiration contre les chefs. Maintenant, toutefois, nous sommes en progrès ; si nous nous querellons, que ce soit une rivalité d’intelligence et de devoir, et non une rivalité d’intérêts matériels ou de caractères ; combattons pour des réalités et non pour des ombres. »
[34] La Convocation est le grand conseil, et la suprême autorité de l’université. Tous les docteurs et tous les maîtres en font partie. A lui seul le collége de Christ church (église du Christ) fournit environ 500 membres. En 1845, lors de l’affaire de M. Ward touchant son livre : Ideal of a christian church, on vit arriver à Oxford 1300 membres de la Convocation.
Ces réflexions plurent à Sheffield, et il fit observer que l’état actuel des choses était plus réel que ce qu’on avait vu jusqu’alors, et qu’il avait par conséquent plus d’éléments de vie. M. Malcolm ne parut pas l’entendre, car il ne répliqua point. Aux approches du pont, la conversation tomba. Tandis qu’ils s’avançaient dans High Street, Sheffield lança furtivement un regard à Charles. Pour eux, c’était un triomphe et un amusement tout à la fois de se voir hors des traits d’un Censeur, qui parcourait la même rue, grâce au maître[35] sous la protection duquel ils marchaient.
[35] Maître. Ce grade répond à celui de licencié, en France.
Avant leur promenade à Oxley, Charles avait déjà eu plusieurs fois l’occasion de voir, sous une forme ou l’autre, les pensées de Sheffield touchant les réalités et le charlatanisme ; et les discours de son ami avaient commencé à faire impression sur lui. Il sentait qu’au fond il y avait du vrai, et ce vrai était nouveau à ses yeux. Reding n’était pas d’un caractère à laisser une vérité dormir dans son esprit. Elle ne s’y épanouissait pas très-vite, mais on pouvait être sûr qu’à la fin elle porterait des fruits, et qu’elle modifierait ses opinions acquises. Dans le cas présent, il vit que le principe de Sheffield était plus ou moins opposé à sa maxime favorite, savoir : que c’est un devoir d’être content de tout le monde. Deux contradictions, se dit-il, ne sauraient être vraies en même temps : lorsque l’affirmative est vraie, la négative doit être fausse. Toutes les doctrines ne peuvent être également fondées : il y a une vérité et une erreur. La théorie de la vérité dogmatique, comme opposée au latitudinarisme, s’était ainsi graduellement établie dans son esprit pendant ces premiers trimestres. Il ne connaissait rien pourtant ni du nom, ni de l’histoire de ces deux théories ; il ne soupçonnait pas même le travail qui se faisait en lui. Laissons-lui voir toutefois développer sous ses yeux les absurdités du principe latitudinaire, et il est probable qu’il lui fera une opposition plus forte encore.
Parmi d’autres singularités, Bateman croyait que mettre ensemble des personnes de sentiments contraires, c’était le meilleur moyen de créer une société agréable ou au moins utile. Il avait fait de son mieux pour donner cet élément de perfection à son déjeuner, auquel assistaient nos deux amis. Il n’avait pas toutefois atteint complétement son but, n’ayant pu réunir, malgré tous ses efforts, que trois convives, outre Charles et Sheffield. On remarquait d’abord M. Freeborn, jeune maître évangélique, avec qui Sheffield était en connaissance. Venait ensuite un jeune étudiant intelligent, mais non très-circonspect, qui, après avoir été gâté dans sa famille et ayant toujours bourse pleine, se proclamait amateur de l’esthétique : au collége, toutes les autorités vivaient constamment dans la crainte de le voir devenir papiste un beau matin. Le troisième, enfin, était un de ses amis, jeune homme au maintien aimable et modeste, qui avait des yeux vifs et perçants comme une souris, et mangeait son pain et son beurre dans un profond silence.
Nos convives venaient de se mettre à table. Sheffield versait le café ; une assiette de muffins courait à la ronde, et Bateman, une casserole en main, en retirait les œufs déjà cuits. Tout à coup notre jeune imprudent, dont le nom était White, fit observer combien était belle la coutume catholique de prendre les œufs pour l’emblème de la fête Pascale. « C’est vraiment catholique, dit-il ; car cet usage est conservé dans certaines parties de l’Angleterre, se retrouve en Russie, et est en vigueur à Rome même, où un œuf accompagne chaque plat pendant la semaine de Pâques, après, je crois, avoir été bénit. Cet usage, d’ailleurs, est aussi expressif et aussi significatif que catholique. — Magnifique, en vérité ! reprit leur hôte : un usage si charmant et si délicieux ! Je m’étonne que nos réformateurs n’y aient pas songé, ni le profond Hooker, qui aimait tant les figures, ni Jewell. Vous n’avez pas sans doute oublié le bâton que celui-ci donna à Hooker : c’était une figure, tout comme l’envoi du bâton d’Élisée, par son serviteur, à l’enfant mort. — Oh ! mon cher Bateman, s’écria Sheffield, vous faites de Hooker un Giézi. — C’est bien la conclusion d’une pareille plaisanterie, dit M. Freeborn ; vous ne pourrez jamais voir où mène un symbole. Un symbole prouve tout et ne prouve rien. — Sans doute jusqu’à ce qu’il ait une sanction, reprit White ; mais quand l’Église catholique l’a sanctionné, nous sommes sûrs d’être dans le vrai. — Oui, certes, dit Bateman ; en d’autres termes, c’est bon parce que c’est catholique. — Oui, continua White, les choses changent de nature entre les mains de l’Église catholique : on nous permet de faire le mal pour arriver au bien. — Qu’est-ce à dire ? s’écria Bateman. — Eh bien, reprit White, l’Église fait du mal le bien. — Mon cher White, reprit notre hôte d’un ton grave, c’est aller trop loin. » M. Freeborn suspendit son opération gastronomique et se rejeta sur le dos de sa chaise. « L’idolâtrie, continua White, n’est-elle pas une erreur ? cependant le culte des images est légitime. » M. Freeborn était dans un état de consternation. « Votre exemple est mal choisi, White, dit Sheffield ; il y a dans le monde des gens assez peu catholiques pour penser que le culte des images est aussi mauvais que l’idolâtrie elle-même. — Distinction jésuitique ! s’écria Freeborn avec émotion. — Eh bien », répliqua White, qui ne paraissait pas avoir grand’peur du jeune maître ès-arts, quoique celui-ci fût plus âgé que lui, « je prendrai un meilleur exemple : qui ne sait que le baptême confère la grâce ? cependant il y avait, chez les païens, des rites baptismaux, et naturellement ils étaient diaboliques. — Je ne serais pas disposé, monsieur White, à vous faire toutes les concessions que vous voudriez touchant la vertu du baptême, dit Freeborn. — Ni même touchant le baptême chrétien ? demanda White. — Il est facile, répondit Freeborn, de prendre le signe pour la chose signifiée. — Ni même touchant le baptême catholique ? répéta White. — Le baptême catholique est une vraie supercherie et une illusion, répondit Freeborn. — Oh ! mon cher Freeborn, s’écria Bateman, à votre tour vous allez trop loin, en vérité. — Catholique, catholique ; j’ignore ce que vous voulez dire, reprit Freeborn. — J’entends par là, dit White, cette Église Une et Catholique dont parle le Symbole ; c’est très-intelligible. — Mais qu’entendez-vous par l’Église catholique ? demanda Freeborn. — L’Église Anglicane, répondit Bateman. — L’Église Romaine », répondit White, tous deux parlant en même temps. Il y eut un éclat de rire général. « Il n’y a pas de quoi rire, reprit Bateman, l’Église Anglicane et l’Église Romaine ne sont qu’une même Église. — Une même Église ? Impossible ! s’écria Sheffield. — Bien plus qu’impossible, ajouta M. Freeborn. — Je ferais une distinction, dit Bateman ; je dirais qu’elles sont une même Église, mis à part les corruptions de l’Église Romaine. — En d’autres termes, elles forment une même Église, excepté ce en quoi elles diffèrent, dit Sheffield. — Précisément, comme vous dites, reprit Bateman. — Je dirais plutôt, ajouta M. Freeborn : Elles sont deux, excepté ce en quoi elles s’accordent. — Voilà la vraie conclusion, dit Sheffield. Bateman soutient que l’Église anglicane et l’Église romaine sont une même Église, excepté ce en quoi elles sont deux ; et Freeborn, qu’elles sont deux, excepté ce en quoi elles sont une. »
Par bonheur, en cet instant, le garçon de cuisine entra avec un plat de saucisses ; mais cet incident n’amena pas de diversion ; la controverse continua. Deux personnes ne l’aimaient point : Freeborn, qui tout simplement détestait la doctrine en discussion, et Reding, qui la jugeait inopportune. Mais c’était la mauvaise fortune du premier d’indisposer Charles contre lui aussi bien que les autres, et d’être obligé de vaincre sa répugnance à prendre part à la dispute. Dans le fait, Freeborn pensait que la théologie elle-même est une duperie, comme substituant, à son avis, des notions intellectuelles sans valeur aux vérités fondamentales de la religion. C’est pourquoi il continua à faire observer, en posant son couteau et sa fourchette, que pour lui c’était un mystère qu’on fît reposer la religion véritable sur des distinctions métaphysiques ou sur des observances extérieures ; que l’Écriture avait un enseignement tout à fait contraire ; que l’Écriture parlait beaucoup de foi et de sainteté, mais ne disait pas un mot sur les Églises et leurs formes. Il continua, disant que c’était la grande et malheureuse tendance de l’esprit humain, de mettre entre lui et son Créateur un médiateur de son invention, et qu’il importait peu que ce médiateur fût un rite, ou un symbole, ou une forme de prière, ou les bonnes œuvres, ou la communion avec des Églises particulières : toutes ces choses étaient des « baumes trompeurs pour l’âme », si on les regardait comme nécessaires. Le seul moyen légitime d’en user, c’était de s’en servir avec la conviction qu’on pouvait s’en passer. Freeborn ajoutait qu’aucune de ces choses n’allait à la racine de la religion ; car la foi, c’est-à-dire la ferme croyance que Dieu nous a pardonné, était le seul objet indispensable ; que là où ce seul objet se trouvait, tout autre était superflu, et que là où il faisait défaut, aucun autre ne pouvait le remplacer. Ce point, il le défendait si fort, qu’à ses yeux (et il avoua que c’était non-seulement sa conviction, mais une vérité certaine), quand on avait la foi on pouvait professer toute espèce de religion : être arminien, calviniste, épiscopal, presbytérien, swendenborgien, voire même unitaire, aller plus loin encore, ajouta-t-il en jetant un coup d’œil sur White, être papiste même, et cependant être dans la voie du salut.
Freeborn s’était laissé aller à des concessions plus larges qu’il ne l’eût fait dans ses moments de calme ; mais il était un peu irrité, et il désirait profiter de la parole à son tour. D’ailleurs, c’était pour lui une occasion favorable de faire une grande profession de foi. « Merci pour votre libéralité à l’égard de ces pauvres papistes, dit White. D’après vous, ils sont sauvés, s’ils sont hypocrites ; ils peuvent extérieurement professer le catholicisme, et rester protestants dans le cœur. — Les Unitaires aussi, dit Sheffield, sont vos obligés. Il paraît qu’on n’a pas besoin de craindre que l’on croie trop peu, pourvu qu’on sente beaucoup. — Mieux encore, reprit White ; si l’on se croit pardonné, on n’a pas à croire autre chose. » Reding ajouta son mot : il fit observer que, dans le Prayer-Book[36], la croyance à la Sainte-Trinité est représentée, non comme une chose indifférente, mais comme une vérité, « avant tout », nécessaire au salut. « Votre réponse, Reding, n’est pas directe, répliqua Sheffield. La remarque de M. Freeborn est qu’il n’y a pas de Symbole dans la Bible ; et vous, vous répondez qu’il y en a un dans le Prayer-Book. — Alors la Bible enseigne une chose, et le Prayer-Book en enseigne une autre, objecta Bateman. — Non, répondit Freeborn ; le Prayer-Book tire seulement une déduction de la Bible. Le Symbole d’Athanase est une création humaine ; il est vrai, mais c’est une œuvre d’homme ; et il doit être admis, selon les expressions formelles des Articles, parce qu’il est « fondé sur l’Écriture. » Les Symboles sont utiles, à leur place, de même que l’Église ; mais ni Symbole ni Église ne sont la religion. — Mais alors, pourquoi prônez-vous si haut votre doctrine touchant « la foi seule » ? demanda Bateman ; car ces mots ne sont pas dans l’Écriture, et ils ne sont qu’une déduction humaine. — Ma doctrine ! s’écria Freeborn ; mais elle est dans les Articles. Les Articles disent positivement que nous sommes justifiés par la foi seule. — Les Articles ne sont pas l’Écriture, pas plus que le Prayer-Book, repartit Sheffield. — Ils ne disent pas non plus, ajouta Bateman, que la doctrine qu’ils enseignent soit nécessaire au salut. »
Tout ceci ne plaisait pas beaucoup à Freeborn, quoiqu’il l’eût provoqué. Il avait à la fois quatre adversaires ; et le cinquième convive, qui gardait le silence, paraissait sympathiser avec eux. Sheffield parlait par malice ; White par habitude ; Reding était entré dans la discussion parce qu’il n’avait pu s’en dispenser ; et Bateman raisonnait d’après un principe : il croyait qu’il allait perfectionner les vues de Freeborn par ce cours de controverse. Au moins ne perfectionna-t-il pas son caractère qui, en ce moment, subissait une dure épreuve. La plupart des convives n’étaient pas gradués ; lui, Freeborn, était maître : c’était trop fort de la part de Bateman. Il acheva en silence sa saucisse qui était devenue froide. La conversation languit ; il y eut recrudescence de rôties et de muffins ; on enleva les tasses à café, et le thé coula à pleins flots.
Freeborn n’aimait pas à être battu ; il revint à la charge. La religion, d’après lui, était une affaire de cœur : celui dont le cœur n’était pas droit ne pouvait interpréter convenablement l’Écriture. Jusqu’à ce que nos yeux fussent éclairés, disputer sur le sens de l’Écriture, essayer d’en tirer des déductions, c’était battre la campagne : c’était comme des aveugles disputant sur les couleurs. « Si ce que vous dites est vrai, reprit Bateman, nul ne peut absolument raisonner sur la religion ; cependant, vous avez été le premier à le faire, Freeborn. — Naturellement, répondit celui-ci, ceux qui ont trouvé la vérité sont les seules gens capables de raisonner sur cette matière, car ils ont le don. — Et ils sont les derniers à pouvoir en convaincre les autres, repartit Sheffield ; car le don n’est que pour eux. — C’est pourquoi les vrais chrétiens devraient discuter entre eux, et pas avec d’autres, dit Bateman. — Mais ce sont précisément ceux-là qui n’en ont pas besoin, reprit Sheffield. Raisonner appartient à ceux qui ne sont pas convertis, et non aux convertis. La discussion est le moyen ordinaire des recherches. » Freeborn continua à soutenir que la raison d’un homme non converti était charnelle, et que dans cet état on ne pouvait comprendre l’Écriture. « J’ai toujours pensé, dit Reding, que la raison est un bienfait général, tandis que la foi est une grâce spéciale et personnelle. Si la foi est vraiment rationnelle, tout le monde doit voir qu’elle a ce caractère ; autrement, d’après la nature du cas, elle n’est pas rationnelle. — Mais saint Paul nous prêche, répondit Freeborn, que « pour l’homme charnel les choses de l’esprit sont folie ». — Mais, après tout, repartit Reding, comment arriver à la vérité, si ce n’est par la raison ? C’est elle qui nous doit servir de guide : aux brutes de se diriger par l’instinct, à l’homme de se conduire par la raison. »
Ils étaient tombés sur un sujet difficile ; tous éprouvaient une sorte d’embarras, excepté White, qui n’avait pas pris part à cette dernière controverse, et qui était simplement fatigué. Mais il voulut prendre sa revanche : « Le monde serait bien triste, dit-il, si les hommes se conduisaient par la raison. Ils peuvent croire qu’il en est ainsi, mais au fond il n’en est rien. Dans le fait, ils sont dirigés par leurs sentiments, leurs affections, par le sentiment du beau, du bon, du saint. La religion est le beau ; les nuages, le soleil et les cieux, les champs et les bois sont la religion. — D’après vous, repartit Freeborn, toutes les religions seraient vraies, les bonnes comme les mauvaises. — Non, répondit White, les rites du paganisme sont sanguinaires et impurs, ils ne sont pas beaux ; et le mahométisme est aussi froid et aussi sec que toute assemblée calviniste. Les mahométans n’ont ni prêtres ni autels, rien absolument, sinon une chaire et un prédicateur. — Comme à Sainte-Marie, fit observer Sheffield. — Précisément. Dans notre Église d’Angleterre nous n’avons ni vie ni poésie ; l’Église Catholique seule est belle. Vous verriez ce à quoi je fais allusion, si vous visitiez les cathédrales du continent, ou même seulement une église catholique de nos grandes cités. Célébrant, diacre et sous-diacre, acolytes avec leurs chandeliers, encens et plain-chant, tout concourt à une même fin, au même acte religieux. On voit que c’est un vrai culte ; les yeux, les oreilles, l’odorat, chaque sens en un mot reconnaît cette vérité. Les fidèles à genoux, récitant leur chapelet ou faisant leurs actes ; le chœur chantant le Kyrie ; le prêtre et ses ministres inclinant profondément la tête et disant alternativement le Confiteor ; voilà un culte, et il est bien supérieur à la raison. » Ces paroles furent prononcées avec âme ; mais elles ne s’harmonisaient pas avec la conversation qui les avait précédées, et la poésie de White fut presque aussi désagréable à l’assemblée que la prose de Freeborn. « White, dit Sheffield, vous deviendrez catholique à ne plus en revenir. — Mon cher ami, ajouta Bateman, pensez à ce que vous dites ; certainement vous n’êtes jamais entré dans une chapelle schismatique. Oh, fi donc ! » Freeborn fit observer gravement que si les deux Églises étaient une, comme on l’avait soutenu, il ne voyait pas, malgré tout ce qu’on pourrait dire, pourquoi c’était mal de passer d’une Église à l’autre. « Vous oubliez, dit Bateman à White, que vous avez ou que vous pourriez avoir toutes ces choses dans notre propre Église, sauf les corruptions de Rome. — Les corruptions de Rome, répliqua White, je ne sais trop ce que vous entendez par là. » Freeborn murmura d’une manière sensible. « Oui, je ne sais trop ce que vous entendez par là, répéta White avec vivacité ; mais quel rapport cela a-t-il avec le sujet ? Il faut prendre les choses comme on les trouve. Je n’aime pas dans l’Église Catholique ce qui est mauvais, si toutefois il y a du mauvais, mais j’y aime ce qui est bon. Je ne la recherche pas pour ce qui est mauvais, mais pour ce qui est bon. Vous ne pouvez contester que ce que j’y admire est excellent et très-beau. Vous faites vous-même des efforts pour l’introduire dans votre Église. Vous donneriez vos deux oreilles, vous le savez bien, pour entendre le Dies iræ. » A ce mot éclata un rire général. White était Irlandais. Ce fut une interruption heureuse. L’assemblée se leva de table, et au même instant un coup, qui retentit à la porte, vint à propos couper le fil de la conversation.
C’était un marchand de gravures portant sous le bras un grand livre de planches. « Soyez le bienvenu, monsieur Baker, dit Bateman ; déposez votre portefeuille, ou plutôt donnez-le-moi. Messieurs, je voudrais avoir votre opinion sur un point que j’ai à cœur. Vous savez, Freeborn, que je désire vous montrer ma chapelle ; Sheffield et Reding l’ont déjà visitée. Eh bien, maintenant, regardez. » Bateman ouvrit le portefeuille ; il contenait des vues du Campo Santo, à Pise. Les feuilles étaient tournées lentement et en silence. Parmi les spectateurs, les uns admiraient, les autres ne savaient que penser, d’autres étaient curieux de savoir ce qu’il adviendrait de tout cela. « Quel plan me prêtez-vous ? continua Bateman. Vous me blâmiez, Sheffield, de ce que ma chapelle serait inutile. Or, j’ai l’intention d’y joindre un cimetière ; le terrain n’y manque pas ; et la chapelle deviendra une chantry[37]. Mais qu’allez-vous dire, quand nous aurons reproduit en sculpture et en peinture, autour du cimetière, tous ces magnifiques monuments du moyen âge ? Eh bien, Sheffield, monsieur le critique, que dites-vous de tout cela ? — Un plan vraiment admirable ! répondit Sheffield ; il renverse toutes mes objections… Une chantry ! qu’est-ce que c’est que ça ? N’y dit-on pas la messe pour les morts ? — Oh, non, non, non, s’écria Bateman, qui avait peur de Freeborn ; nous n’aurons rien de votre papisme. Ce sera une simple et innocente chapelle où l’on fera le service. » Cependant Sheffield examinait les planches avec attention. Il s’arrêta à l’une d’entre elles. « Que voulez-vous faire de cette figure ? demanda-t-il, indiquant une image de la Madone. — Ah ! le mieux, le plus sûr sera de ne pas s’y arrêter ; certainement, certainement. » Sheffield reprit bientôt : « Mais voyez donc ! mon bon ami, que faites-vous de ces saints et de ces anges ? Regardez, il y a ici une légende complète. Avez-vous l’intention d’avoir cela ? Voici encore : c’est une série de miracles et une femme invoquant un saint qui est au ciel. » Bateman jeta sur la planche un regard circonspect et ne répondit pas, il aurait voulu fermer le livre ; mais Sheffield désirait en voir davantage. Il ajouta cependant : « Oh ! oui, c’est vrai, il y a là certaines choses ; mais j’ai un expédient pour tout cela, j’ai l’intention de rendre toutes ces figures allégoriques. La Sainte Vierge sera l’Église, et les saints deviendront les vertus cardinales et les autres ; et quant à la vie de ce saint, saint Ramieri, elle représentera le voyage d’un pèlerin catholique. — Bien ; mais alors, il vous faut enlever tous ces papes et évêques, ces chapes et calices, reprit Sheffield, et mettre leurs noms nouveaux sous les autres figures, afin qu’on ne puisse pas les prendre pour des saints et des anges. Peut-être feriez-vous mieux de faire sortir de leurs bouches des légendes en vieil anglais. Ce saint Thomas est vigoureux ; faites-lui dire : Je suis M. Sans-Peur, ou, Je suis le géant Désespoir ; et, puisque cette belle sainte porte une espèce de plat, faites-en madame Comfort. Mais regardez ici, continua-t-il, toute une bande de démons ; est-ce que vous allez les faire peindre aussi ? » Bateman essaya de fermer le livre de force. Sheffield continua : « La tentation de Saint Antoine ; qu’est-ce que ceci ? voilà le diable sous la forme d’un chat assis sur un baril de vin. — En vérité, en vérité, s’écria Bateman, poussé à bout et s’emparant du livre, vous êtes méchant, oui, très-méchant. Nous y reviendrons quand vous serez plus sérieux. » Il faut l’avouer, Sheffield était agaçant, et son ami, de meilleure humeur que bien des personnes ne l’eussent été à sa place. Cependant Freeborn, qui s’était emparé de sa toge dans l’intervalle, fit un signe de tête à son hôte et s’en alla tout seul. Il fut bientôt après suivi de White et Willis.
[37] Chapelle dans laquelle le bénéficier dit la messe à certains jours.
« Mon cher, je vous l’assure, dit Bateman à Sheffield, lorsque ces derniers furent sortis, vous et White, chacun à votre manière, vous êtes très-hardis dans votre façon de parler, et cela devant les autres également. Je voulais apprendre à Freeborn un peu du bon Catholicisme, et vous avez tout gâté. J’espérais que quelque chose serait sorti de ce déjeuner ; mais pensez seulement à White ! Tout est perdu ; Freeborn racontera la chose à sa coterie. C’est très-mal. Et vous, mon cher, vous ne valez pas beaucoup mieux ; vous n’êtes jamais sérieux. Que vouliez-vous donc dire, en affirmant que notre Église n’est pas une avec l’Église de Rome ? c’était donner un grand avantage à Freeborn. » Sheffield prit un certain air d’aisance provocateur, et, le dos appuyé contre la cheminée, tandis que le bout de son habit jouait avec le tuyau de la bouilloire, il répliqua : « Vous aviez un très-singulier attelage à tirer. » Puis lançant un regard de côté à son hôte, et rejetant sa tête en arrière : « Et pourquoi, ajouta-t-il, avez-vous eu, vous, le plus réglé des hommes, l’audace de dire que l’Église d’Angleterre et l’Église Romaine ne faisaient qu’une même Église ? — Il doit en être ainsi, répondit Bateman. Il n’y a qu’une Église ; le Symbole l’affirme. Voulez-vous en faire deux ? — Je ne parle pas de doctrine, répliqua Sheffield, mais d’un fait. Je ne voulais pas soutenir qu’il y eût deux Églises, ni contester qu’il n’y en avait qu’une. Je niais seulement ce fait, que ce qui évidemment forme deux corps n’en fasse qu’un. » Bateman réfléchit un instant, tandis que Charles s’amusait avec le tisonnier à gratter la suie dans le fond de la cheminée. Notre jeune étudiant n’avait pas l’envie de parler, mais il n’était pas fâché d’entendre un argument de ce genre.
« Mon bon ami, reprit Bateman d’un ton magistral, vous faites une distinction entre une Église et un corps ; cette distinction, je ne la comprends pas tout à fait. Vous dites qu’il y a deux corps, et cependant rien qu’une Église. Si c’est ainsi, l’Église n’est pas un corps, mais quelque chose d’abstrait, un pur nom, une idée générale. Est-ce bien là votre pensée ? Avec une pareille doctrine, vous êtes un honnête calviniste. — Vous en êtes un autre, répliqua Sheffield, car si de deux Églises visibles, celle d’Angleterre et celle de Rome, vous n’en faites qu’une, cette Église une doit être invisible, et non pas visible. Ainsi, si je crée une Église abstraite, vous en faites une invisible. — Je ne vois pas cela. — Prouvez que les deux Églises n’en font qu’une, et je prouverai, à mon tour, quelque autre chose. — Quelque paradoxe, sans doute. — Naturellement, c’en est un fameux, mais il vous appartient, et non à moi. Prouvez que les Églises d’Angleterre et de Rome n’en font qu’une, en un sens quelconque, et je prouverai par des arguments semblables que nous et les Wesleyens nous ne faisons qu’un. »
Le défi était beau. Bateman toutefois prit soudain un air grave, et resta silencieux. « Nous traitons des sujets sacrés, dit-il enfin d’un ton calme, nous traitons des sujets très-sacrés ; nous devons être respectueux » ; et son visage s’allongea démesurément. Sheffield partit d’un éclat de rire ; Reding ne put y résister. « Qu’est-ce donc ? s’écria Sheffield ; ne soyez pas si sévère ; qu’ai-je fait ? Où avons-nous touché au sacré ? Je rétracte mes paroles. — Oh ! il n’a pas d’intention mauvaise, ajouta Charles, non. Il est plus sérieux qu’il ne paraît ; répondez-lui ; j’y suis intéressé. — Croyez-le, mon ami, je désire traiter ce sujet sérieusement, reprit Sheffield, je recommencerai. Je suis très-peiné, oui, vraiment. Laissez-moi faire mon objection d’une façon plus respectueuse. » Bateman laissa tomber son sérieux. « Mon brave Sheffield, dit-il, c’est la chose qui est inconvenante, et non la manière. Comparer votre sainte Mère aux schismatiques Wesleyens, c’est manquer complétement de respect. — Eh bien, je me repens, repartit Sheffield ; c’était de l’indécision touchant la foi ; c’était très-inconvenant, je l’avoue. Que voulez-vous de plus ? Regardez-moi ; cela suffit-il ? Et maintenant dites-moi, dites-moi, je vous prie, comment ne faisons-nous qu’un seul corps avec les Papistes, tandis que les Wesleyens n’en font pas un avec nous ? » Bateman le regarda et fut satisfait de l’expression de sa figure : « C’est une étrange question de votre part, répondit-il ensuite ; je vous croyais plus fin. Ne voyez-vous pas que nous avons la succession apostolique aussi bien que les Catholiques Romains ? — Mais les Papistes, répliqua Sheffield, soutiennent que ce n’est pas assez pour l’unité ; ils disent que nous devrions être en communion avec le Pape. — Là est leur erreur, reprit Bateman. — Eh, c’est justement ce que les Wesleyens disent de nous, repartit Sheffield. Lorsque nous refusons de reconnaître leur succession, ils disent que c’est là notre erreur. — Leur succession ! de succession, ils n’en ont pas. — Certainement, ils en ont une : ils ont la succession ministérielle. — Elle n’est pas apostolique. — Sans doute, mais elle est évangélique ; c’est une succession de doctrine, dit Sheffield. — Doctrine ! évangélique ! qui jamais entendit ces mots ? Ce n’est pas assez ; la doctrine sans les évêques ne suffit pas. — Et la succession non plus sans le Pape. — Ils agissent contre les évêques, répliqua Bateman, ne voyant pas trop où il se jetait. — Et nous aussi nous agissons contre le Pape, repartit Sheffield. — Nous soutenons que le Pape n’est pas nécessaire. — Et ils soutiennent que les évêques ne le sont pas non plus.
Nos combattants étaient hors d’haleine, et ils se reposèrent pour voir où ils en étaient venus. Bateman reprit là parole : « Mon bon monsieur, ceci est une question de fait et non l’affaire d’une argumentation subtile. La question est de savoir s’il n’est pas vrai, d’une part, que les évêques sont nécessaires à la notion de l’Église, et s’il n’est pas faux, de l’autre, que les Papes le soient. — Non, non, repartit Sheffield, la question est celle-ci : L’obéissance à nos évêques n’est-elle pas nécessaire pour faire des Wesleyens et de nous un seul corps ? et l’obéissance à leur Pape n’est-elle pas nécessaire pour faire un même corps de nous et des Catholiques Romains ? Vous admettez un point et vous niez l’autre ; je les maintiens tous les deux. Admettez-les ou rejetez-les ensemble ; je suis conséquent, vous ne l’êtes pas. » Bateman était embarrassé. « En un mot, ajouta Sheffield, la succession n’est pas l’unité, pas plus que la doctrine. — N’est pas l’unité ? Qu’est-ce donc que l’unité ? — C’est un gouvernement UN. »
Bateman se prit à réfléchir. « L’idée est déraisonnable, dit-il. Nous, nous avons la possession ; nous, nous sommes établis depuis le temps du roi Lucius, ou depuis que saint Paul a prêché dans ce pays, occupant l’île, ayant une Église qui se perpétue, et possédant le même territoire, la même succession, la même hiérarchie, la même position civile et politique, les mêmes églises. Oui, continua-t-il, nous avons les mêmes établissements, des souvenirs de dix siècles, une doctrine gravée et perpétuée sur la pierre ; tout l’enseignement mystique des saints anciens. Que peuvent comparer les Méthodistes à nos rites catholiques, aux autels, au sacrifice, aux jubés, aux fonts baptismaux, aux niches ? Ils nomment tout cela superstition. — Ne vous fâchez pas contre moi, Bateman, reprit Sheffield, mais avant d’aller plus loin, je veux vous proposer une allégorie. Ici, nous avons l’Église d’Angleterre ; c’est un établissement protestant autant qu’il puisse l’être : évêques et peuple, tous, excepté votre petit parti, l’appellent protestant ; le corps vivant s’appelle lui-même ainsi. Le corps vivant rejette le Catholicisme, repousse le nom et la chose, déteste l’Église de Rome, se moque de la puissance sacramentelle, méprise les Pères, est jaloux du sacerdoce, est une réalité protestante, un simulacre de Catholicisme. Cette réalité existante, qui est pleine de vie et non un fantôme, vous prétendez l’éclipser avec vos œuvres dentelées de jubés, de dorsals[38], de bâtons pastoraux, de crosses, de mitres et d’autres choses semblables. Or, voulez-vous entendre mon apologue ? N’en seriez-vous pas fâché ? » Ayant pris le silence de son hôte pour un assentiment, Sheffield continua : « Eh bien, il y avait une fois un petit nègre qui, voyant son maître sorti, se glissa furtivement dans sa garde-robe et voulut se faire beau garçon aux dépens de son seigneur. Qu’arriva-t-il ? on le vit alors dans les rues, nu comme auparavant ; mais il allait et venait se pavanant de haut en bas, affublé d’un chapeau à cornes et ayant aux mains une paire de gants blancs de chevreau. — Loin de moi ! sortez d’ici, homme pervers et désespérant ! » s’écria Bateman, tout en lui jetant le coussin du sofa à la tête. Dans l’intervalle, Sheffield gagnait la porte à la course, et il se trouva bien vite dans la rue avec Charles.
[38] Ouvrage gothique derrière le maître-autel, au fond de l’abside ; il se compose ordinairement d’une suite de niches renfermant des statues de saints. Un grand nombre des églises nouvellement bâties, en Angleterre, offrent des dorsals admirables.
Laissons Sheffield et Charles aller leur chemin, et suivons White et Willis. C’était un jour de fête, et ils n’avaient pas eu de cours ; ils se promenaient bras dessus bras dessous dans Broad street, avec beaucoup d’intimité. Willis sortit de son mutisme : « Je ne puis, dit-il, supporter ce Freeborn ; il est si fat ! et je l’aime d’autant moins que je suis obligé de le voir. — Vous l’avez connu ailleurs, je suppose ? reprit White. — Grâce à cette connaissance, il m’a mené quelquefois prendre le thé dans ses réunions spirituelles, et il m’a présenté au vieux M. Grimes, bon fogie[39], au cœur excellent, mais un évangélique terrible, moins méchant toutefois que sa femme. Grimes est proprement le créateur des Pieux Buveurs de thé, et Freeborn en fait son modèle. Ils réunissent autant de personnes qu’ils peuvent, une vingtaine peut-être, étudiants de première année, bacheliers et maîtres, qui s’asseyent en cercle, la tasse et la soucoupe en main, et l’agenouilloir aux pieds. Un ennuyeux personnage de Capel Hall[40] ou de Saint-Marc, qui parle à peine anglais, sous prétexte de faire une question théologique à M. Grimes, pérore sur le péché originel, sur la justification, sur l’assurance du salut, et monopolise la conversation. Cependant le cabaret est enlevé, et une lecture de la Bible le remplace. Le vieux Grimes commente ; pour un laïque, ce qu’il dit est excellent sans doute. C’est une bonne vieille âme ; mais nul dans le salon ne peut y résister. Madame Grimes elle-même s’endort sur son tricot, et quelques-uns des bien-aimés frères ronflent très-distinctement. Le commentateur, toutefois, n’entend rien que lui-même. Enfin il s’arrête ; ses auditeurs se réveillent, et l’on use des agenouilloirs. Après quoi l’on se retire ; et M. Grimes et l’homme de Saint-Marc appellent cela une soirée profitable. Je ne puis comprendre qu’on assiste deux fois à pareille réunion. Il en est pourtant qui n’y manquent jamais. — Ils y vont sur la foi, dit White ; sur la foi en M. Grimes. — La foi dans le vieux Grimes ! répliqua Willis, un vieux lieutenant à demi-solde ! — Voici une église ouverte, reprit White, c’est étonnant ; entrons-y. »
[39] Dans l’argot des étudiants d’Oxford, ce mot désigne un caractère complexe : le fogie est un homme ennemi des nouveautés, aimant le comfortable, et prêtant en outre au ridicule.
Ils entrèrent. Une vieille femme nettoyait les bancs, comme si le service allait avoir lieu. « Tout sera mis en ordre, dit Willis. Nous n’aurons pas de femmes, mais des sacristains et des servants. — Puis, tous ces bancs s’en iront où ils voudront. Avez-vous jamais vu une église plus belle pour le service ? — Où voudriez-vous placer la sacristie ? demanda Willis ; ce cabinet doit servir de vestiaire, mais il ne sera jamais assez grand. — Tout dépend du nombre d’autels que l’église peut admettre. Chaque autel doit avoir sa table et son armoire dans la sacristie. — Un d’abord, dit Willis se mettant à compter, là où se trouve la chaire ; ce sera le maître-autel ; un second, derrière, pour Notre-Dame ; deux ensuite : un de chaque côté du sanctuaire. En somme, déjà quatre. A qui les dédierez-vous ? — L’église n’est pas assez large pour ces deux derniers, objecta White. — Oh ! elle l’est suffisamment ; j’ai vu, à l’étranger, des autels avec une seule marche, et ils n’exigeaient pas beaucoup d’espace. Je pense aussi que cette muraille admettrait une arche. Voyez la profondeur de la fenêtre ; on pourrait gagner du terrain. — Non, répliqua White ; le sanctuaire est trop étroit. » Et il se mit à mesurer le pavé avec son mouchoir. « Quelle est, à votre avis, la largeur d’un autel en dehors du mur ? » ajouta-t-il.
En levant les yeux, il aperçut dans l’église des dames de leurs connaissances, les jolies misses Bolton, demoiselles très-catholiques, vraiment bonnes et charitables, en outre. Nous ne pouvons pas ajouter qu’à cette époque elles fussent beaucoup plus prudentes que les deux jeunes gens qu’elles rencontraient en ce moment ; et si quelque belle lectrice prend notre rapport sur leur compte pour une appréciation générale des dames favorables au catholicisme, nous demandons de dire ouvertement que nous ne les proposons, d’aucune manière, comme des types d’une classe. Dans de telles personnes on devait retrouver, comme nous le savons bien, de l’amabilité et des cœurs très-tendres ; mais nous ne saurions, sans manquer à la vérité historique, parer les misses Bolton de cette prudence ni de ce bon sens qui brillaient chez tant d’autres dames de leur part. Toutefois, elles n’avaient pas une forte tête, ces deux sœurs avaient les mains toujours ouvertes, et leur but, en entrant dans l’église (qui n’était pas celle de leur paroisse), était de voir la vieille femme, l’objet et l’instrument, à la fois, de leur bienfaisance. Elles avaient à lui dire un mot sur ses petits enfants, auxquels elles portaient de l’intérêt. Comme on peut le supposer, elles n’en savaient pas long sur les matières ecclésiastiques : elles en savaient encore moins sur leur propre compte. Ce dernier défaut, White ne pouvait le corriger, quoi qu’il eût fait et quoi qu’il fît ; le mieux, pour lui, c’était de remédier au premier, et il y travaillait un peu à chaque rencontre.
Les deux sociétés quittèrent l’église en même temps, et nos gentlemen reconduisirent ces dames chez elles. « Nous nous figurions, miss Bolton, dit White se tenant à une distance respectueuse ; nous nous figurions l’église Saint-Jacques déjà catholique, et nous tachions d’arranger les choses comme elles devraient l’être. — Quelle était votre première réforme ? demanda miss Bolton. — Je crains qu’elle ne fût très-dure pour votre protégée, la vieille femme qui nettoie les bancs. — Sans doute, parce qu’il n’y aurait plus de bancs à nettoyer ? — Ce ne serait pas seulement à cause de son office, mais de sa personne, ou plutôt de son sexe, qu’elle devrait quitter l’église. — Impossible ! les femmes devront donc rester protestantes ? — Oh ! non, la bonne vieille femme reparaîtra, mais sous un autre caractère, ce sera une veuve. — Et qui remplira son emploi actuel ? — Un sacristain : un sacristain en cotta[41]. Aimez-vous la cotta longue ou la courte ? continua White en se tournant vers la plus jeune demoiselle. — Moi ? répondit miss Charlotte ; je l’oublie toujours ; mais je crois que vous nous avez dit que celle de Rome était la courte ; je suis pour celle-là. — Vous savez, Charlotte, reprit la sœur aînée, qu’à cette heure il se poursuit en Angleterre une grande réforme dans les vêtements ecclésiastiques. — Je déteste toutes les réformes, répliqua Charlotte, depuis celle de Luther jusqu’à celles d’aujourd’hui. Au reste, nous avons déjà avancé un peu notre chape ; vous l’avez vue, monsieur White ? c’est un si joli modèle ! — Avez-vous déterminé ce que vous en ferez ? demanda Willis. — Nous avons du temps pour y penser, répondit la plus jeune sœur ; elle nous prendra quatre années pour la finir. — Quatre années ! s’écria White ; d’ici là nous serons tous de vrais catholiques, l’Angleterre sera convertie. — Elle sera faite à temps pour l’évêque, dit Charlotte. — Oh ce n’est pas assez bon pour lui, reprit miss Bolton ; mais cela peut servir dans l’église pour l’Asperges me. Que les choses seront changées ! continua-t-elle ; cependant l’idée d’un cardinal à Oxford ne me sourit guère. Faut-il que nous soyons Romains jusque là ? Je ne vois pas ce qui nous empêcherait d’être de vrais catholiques sans le Pape. — Il n’est pas nécessaire de s’effrayer, répondit White avec sagesse ; les choses ne vont pas si rapidement. Les cardinaux ne sont pas à si bon marché. — Les cardinaux ont une tenue si splendide, et tant d’apparat ! dit miss Bolton ; j’ai ouï dire qu’ils ne marchent jamais sans avoir deux domestiques derrière eux, et qu’ils quittent toujours le salon avant que la danse commence. — Eh bien, je crois qu’Oxford est précisément fait pour des cardinaux, dit miss Charlotte ; peut-il y avoir quelque chose de plus triste que les soirées du Président ? Je m’imagine voir le docteur Bone cardinal, quand il se promène au parc. — C’est là le génie de l’Église Catholique, reprit White ; vous comprendrez mieux cela en son temps. Nul n’est son propre maître. Le Pape lui-même ne peut faire ce qu’il veut ; il dîne tout seul, et, s’il parle, c’est d’après ses prédécesseurs. — Naturellement, dit Charlotte, car il est infaillible. — Bien plus, s’il commet des fautes dans l’exercice de ses fonctions, continua White, il est obligé de les coucher par écrit et de s’en confesser, de peur qu’elles ne servent de précédents. — Et il est obligé, pendant les solennités, d’obéir au maître des cérémonies, contre son propre jugement, ajouta Willis. — Ne disiez-vous pas que le Pape se confesse, monsieur White ? demanda miss Bolton ; cela m’a toujours intriguée de savoir si le Pape est soumis à la confession comme un autre homme. — Oh ! certainement, répondit White, il n’y a d’exception pour personne. — Eh bien, dit Charlotte, je ne puis me représenter au pied d’un confessionnal M. Hurst de Saint-Pierre, qui vient nous chanter des romances, ni aucun des chefs si graves de nos établissements, eux qui saluent avec tant de hauteur. — Ils auront tous à se confesser, reprit White. — Tous ? demanda miss Bolton ; mais non pas les convertis ? Je croyais que c’était seulement les anciens catholiques. » Il y eut un moment de silence.
[41] Mot italien pour désigner le surplis.
« Que deviendront les chefs de nos établissements ? demanda miss Charlotte. — Des abbés ou des supérieurs, répondit White. Ils porteront des crosses ; et quand ils diront la messe, il y aura, par surcroît, un cierge allumé. — Quel majestueux et excellent abbé va faire le Vice-Chancelier ! s’écria miss Bolton. — Oh ! non ; il est trop petit pour un abbé, reprit sa sœur. Mais vous avez oublié le Chancelier lui-même ; vous avez pourvu tous les autres, ce me semble : qu’allez-vous faire de lui ? — Le Chancelier est tout mon embarras, répondit White avec gravité. — Faites-en un chevalier du Temple, dit Willis. — Le duc[42] est un personnage gênant, reprit White, toujours sérieusement ; je ne sais ce qu’il deviendra. Un chevalier du Temple… oui ; Malte est aujourd’hui une possession anglaise ; il pourrait ressusciter l’ordre. » Les deux demoiselles se mirent à rire. « Mais vous n’avez pas complété votre plan, monsieur White, dit miss Bolton. Les chefs des établissements sont des femmes : comment peuvent-ils se faire moines ? — Oh ! leurs femmes iront au couvent, dit White ; Willis et moi, nous avons déjà fait des recherches dans High street, et les résultats sont on ne peut plus satisfaisants. Certaines maisons de cette rue étaient autrefois des établissements de l’Université, et il sera facile de les convertir en couvents. La seule chose qui manquera, c’est de mettre des grilles aux fenêtres. — Avez-vous déjà une idée de l’ordre auquel elles s’uniront ? demanda miss Charlotte. — Cela dépend d’elles-mêmes, répondit White ; aucune contrainte ne leur sera faite. A elles de faire leur choix. Mais il sera utile d’avoir deux couvents : l’un d’un ordre actif, et l’autre contemplatif ; les Ursulines, par exemple, et les Carmélites de la réforme de sainte Thérèse. »
[42] le duc de Wellington qui, à cette époque, était chancelier de l’université d’Oxford.
Jusqu’alors la conversation s’était tenue sur la limite de la plaisanterie et du sérieux ; à ce moment, elle prit un ton plus réfléchi et plus doux : « Les nonnes de sainte Thérèse ont une règle très-rigide, ce me semble, monsieur White ? dit miss Bolton. — Oui, répondit celui-ci, j’aurais des craintes pour mesdames les Présidentes et mesdames les Principales qui feraient ce sacrifice. — Peut-être de plus jeunes personnes, dit-elle timidement, pourraient mener l’affaire avec plus d’assurance. » On était arrivé à la maison, et White agita poliment la sonnette. « Des personnes plus jeunes, reprit-il, sont trop délicates pour un tel sacrifice. » Miss Bolton se tut. « Et que deviendrez-vous, monsieur White ? dit-elle ensuite. — Je n’en sais rien. J’ai songé aux Cisterciens : ils ne parlent jamais. — Oh ! les chers Cisterciens ! s’écria-t-elle : Saint Bernard n’en était-il pas un ? le délicieux homme, le céleste, et si jeune ! J’ai vu son portrait : quels yeux ! » White était un gentleman de bonne mine. La nonne et le moine échangèrent un coup d’œil très-respectueux, et se saluèrent ; l’autre couple exécuta la même cérémonie ; puis le salut se donna en diagonale. Les deux demoiselles étant rentrées chez elles, nos jeunes gens se retirèrent.
Suivons les misses Bolton à l’étage supérieur. En entrant dans le salon, elles trouvèrent leur mère assise près de la fenêtre, en chapeau et en châle ; elle feuilletait un livre de cet air vague qui annonce qu’une personne est occupée, si toutefois cette expression est permise, à attendre plutôt qu’à faire toute autre chose. « Mes chères enfants, dit-elle à leur apparition, où avez-vous été ? Les cloches ont cessé depuis un bon quart d’heure ; je crains qu’il ne vous faille renoncer à l’église ce matin. — Impossible, chère maman, répondit la sœur aînée ; nous sommes sorties à neuf heures et demie précises ; nous n’avons pas dépensé deux minutes chez le mercier, et nous voici de retour. — La seule chose que nous ayons faite, en outre, ajouta Charlotte, a été de jeter un regard dans Saint-Jacques, dont la porte était ouverte, pour dire un mot ou deux à la pauvre vieille Wiggins. M. White était là, ainsi que M. Willis ; et ces messieurs nous ont ramenées. — Oh ! je comprends, reprit madame Bolton ; c’est l’habitude, lorsque des jeunes gens et des demoiselles se rencontrent. Mais, dans tous les cas, il est trop tard pour aller à l’église. — Non, dit Charlotte, partons immédiatement ; nous arriverons pour la première leçon. — Ma chère enfant, comment pouvez-vous me proposer une pareille chose ? je ne voudrais pas le faire pour tout au monde ; c’est si honteux ! Mieux vaut ne pas y aller du tout. — Oh ! très-chère maman, repartit la sœur aînée, cela est très-certainement un préjugé. Pourquoi aller à l’église toujours au même moment ? C’est une règle si gênante que de s’y rendre tous à la fois et de s’attendre les uns les autres ! Évidemment, il est plus raisonnable d’y aller quand on le peut : tant de choses peuvent vous retarder ! — Eh bien, ma chère Louisa, reprit la mère, j’aime la vieille méthode. On nous disait toujours : Soyez à vos places avant les paroles « Lorsque le méchant », et au plus tard avant celles-ci : « Bien-aimés frères ». Voilà la bonne vieille méthode. M. Jones et M. Pearson avaient d’ailleurs l’habitude de s’asseoir, au moins cinq minutes, dans la chaire pour nous donner le temps d’arriver ; et puis, avant de commencer, ils jetaient un regard autour d’eux. M. Jones avait même la coutume de prêcher contre les retardataires. Je ne puis discuter, mais il me paraît raisonnable que les bons chrétiens entendent l’office en entier. Sans cela, ils pourraient aussi bien déserter l’église avant qu’il soit fini. — Mais, maman, dit Charlotte, c’est l’usage des pays étrangers : on va à l’église et l’on en sort à volonté. C’est si bien selon la dévotion ! — Ma chère fille, reprit madame Bolton, je suis trop vieille pour comprendre tout cela ; c’est au-dessus de mon esprit. Je suppose que M. White vous a débité cette doctrine, C’est un excellent jeune homme, fort aimable et très-poli ; je n’ai rien à dire contre sa personne, sinon qu’il est jeune, et qu’en vieillissant il modifiera ses idées. — Tandis que nous parlons, le temps marche, dit Louisa ; il est absolument impossible maintenant d’aller à l’église. — Ma chère Louisa, je ne voudrais pas remonter le bas-côté pour tout au monde ; positivement, je m’enfoncerais sous terre ; quel mauvais exemple ! Comment avez-vous pu y penser ? — Dès lors, je crois qu’il n’y a rien à faire, reprit Louisa en ôtant son chapeau ; mais, en vérité, c’est bien triste de rendre le culte si froid et si gênant. L’assistance serait double, si l’on pouvait y aller tard. — Eh bien, ma chère, toutes choses sont changées à présent : dans ma jeunesse, les catholiques étaient les gens à règles strictes, et nous, nous étions les personnes de dévotion ; aujourd’hui, c’est l’inverse. — Mais n’est-il pas vrai, chère maman ? dit Charlotte ; ce concours continuel, ce flux et ce reflux, ce changement, et pourtant cette affluence, n’est-ce pas quelque chose de plus beau que cette manière de prier aussi sèche que le pupitre ? Il y a tant de liberté et de naturel ! — Liberté et aisance, je crois, repartit la mère ; fi donc, Charlotte ! comment pouvez-vous parler contre le magnifique service de l’église ! Vous m’affligez. — Je ne blâme pas, maman ; je critique seulement cette coutume puritaine qui ne fait pas plus partie de notre église que les bancs eux-mêmes. — La prière commune est offerte pour ceux qui peuvent venir, ajouta Louisa ; aller à l’église serait dès lors un privilége et non un simple devoir. — Eh bien, ma chère enfant, de pareils principes je ne saurais les comprendre. Il y avait un jeune homme du nom de Georges Ashton qui sortait toujours de l’église avant le discours ; et lorsqu’on le reprenait là-dessus, il répondait qu’il ne pouvait supporter un prédicateur hérétique. Un enfant de dix-huit ans ! — Mais, maman, que doit-on faire lorsque le prédicateur est hérétique ? Quel autre moyen employer ? C’est si affligeant pour un esprit catholique ! — Catholique, catholique ! s’écria madame Bolton avec humeur ; donnez-moi le bon vieux George II et la religion protestante. C’était le bon temps. Tout alors marchait en règle. Pas de disputes, pas de divisions, pas de différends dans les familles. Mais aujourd’hui, tout va autrement. Ma tête est bouleversée, je le déclare ; tant de choses étranges, extravagantes, arrivent à mes oreilles ! »
Les deux sœurs ne répondirent pas ; l’une jeta un coup d’œil par la fenêtre, l’autre se disposa à sortir du salon. « Eh bien, c’est un contre-temps réciproque, reprit la mère ; vous m’avez les premières empêchée d’aller à l’église, et moi ensuite je vous ai retenues. Mais je soupçonne, chère Louisa, que mon désappointement est plus grand que le vôtre. » Louisa s’éloigna de la fenêtre. « J’estime le Prayer-Book plus que vous ne pouvez le faire, ma chère enfant, continua-t-elle ; car j’ai expérimenté ce qu’il vaut dans une affliction profonde. Puisse-t-il s’écouler de longs jours, chères filles, avant que vous le connaissiez dans de pareilles circonstances ! mais si l’affliction vient vous visiter, sachez-le, toutes ces nouvelles fantaisies et ces modes s’évanouiront à vos yeux, comme le vent, et le bon vieux Prayer-Book sera seul votre refuge. » Ces paroles émurent nos deux demoiselles. « Approchez, mes enfants ; je vous ai parlé trop sérieusement, ajouta-t-elle. Allez, emportez vos effets, revenez ensuite, et occupons-nous à un ouvrage paisible avant le lunch. »
Il est des personnes qui en présence de difficultés intellectuelles se tourmentent, et font pour les résoudre de continuels efforts que ne couronne pas toujours le succès. Charles était d’une autre trempe de caractère ; une idée nouvelle n’était pas perdue pour lui, mais elle ne l’inquiétait pas. Si elle était obscure ou opposée à son appréciation habituelle des choses, il la laissait aller son chemin, trouver d’elle-même sa place, et se formuler en lui par l’action lente, mais spontanée, de son esprit. En soi, pourtant, la perplexité est un état peu agréable, et volontiers il s’en serait défait, si c’eût été possible.
Au moyen de conversations semblables à celles que nous avons citées, et de beaucoup d’autres dont nous faisons grâce au lecteur ; en outre, d’après la diversité de vues qu’il avait rencontrée à Oxford, Charles en était venu, au bout d’une année, à quelques conclusions, peu nouvelles sans doute, mais très-graves : d’abord, qu’il y a une infinité d’opinions dans le monde touchant les matières les plus importantes ; secondement, que toutes choses ne sont pas également vraies ; troisièmement, que c’est un devoir d’embrasser les opinions vraies ; et quatrièmement, qu’il est bien difficile d’arriver à la connaissance de ces dernières. Comme nous l’avons dit, il s’était accoutumé, dans le principe, à fixer son esprit sur les personnes et non sur les opinions, à aimer dans chacun ce qui était bon ; mais il était alors arrivé à sentir qu’il n’était pas honorable, pour ne pas dire plus, d’embrasser des opinions fausses. Peu importait qu’on crût sincèrement à ces opinions ; il ne pouvait avoir pour une personne qui embrassait ce que Sheffield appelait du charlatanisme le même respect qu’il éprouvait pour celle qui embrassait une réalité. White et Bateman en étaient des preuves vivantes : ils étaient certainement d’excellents garçons, mais comment souffrir leur langage chimérique, quoique eux-mêmes ne le crussent pas tel ? Pareillement, si le système catholique de Rome était faux, il n’était pas moins clair (laissant de côté des considérations plus hautes) qu’un homme qui croyait au pouvoir des saints et les invoquait était acteur d’une grande comédie, quelque sincère qu’il fût. Il prenait des mots pour des choses, et jusque là, lui, Charles, ne pouvait le respecter, pas plus qu’il ne respectait White et Bateman. De même de l’Unitaire : si celui-ci croyait que la puissance de la nature humaine abandonnée à ses propres forces est ce qu’elle n’est pas ; si dès son origine l’homme est un être tombé, et que lui le crût debout, il s’attachait à une absurdité. Il pouvait racheter ou couvrir cette tache par mille qualités précieuses, la tache resterait toujours ; justement comme nous regarderions un bel homme défiguré par la perte d’un œil ou d’une main. De plus, si un chrétien de profession faisait du Très-Haut un être simplement miséricordieux, et que cet être, au contraire, selon la doctrine de l’Église Anglicane, fût un Dieu qui punît par amour de la justice, ce chrétien faisait une idole ou une chimère de l’objet de sa religion et (à part des idées plus sérieuses sur son compte) lui, Charles, ne pouvait le respecter. Et c’est ainsi que, graduellement, le principe du dogmatisme devint un élément essentiel dans les vues religieuses de Reding.
Graduellement, et d’une manière imperceptible à lui-même, disons-nous ; car les pensées que nous avons exposées ne lui vinrent qu’à des époques différentes ; mais il les reprenait toujours au point où il les avait quittées en dernier lieu. Ses cours et ses autres devoirs particuliers, ses amis et ses récréations étaient le principal objet de la journée ; il y avait néanmoins, chez lui, un secret courant qui était toujours en action, et qui venait retentir à l’oreille de son esprit dès que les autres bruits se calmaient. S’il faisait sa toilette le matin, s’il s’asseyait sous les hêtres du jardin du collége, lorsqu’il errait dans la prairie, lorsqu’il allait en ville payer une note ou faire une visite, lorsque le soir il se jetait sur son sofa, après avoir fermé sa porte, des pensées analogues à celles que nous avons décrites s’agitaient dans sa tête.
Cependant les discussions et les travaux, dont Oxford était le théâtre, touchaient à leur fin ; car le temps de la Trinité était déjà passé, et la Commémoration approchait. Or, il arriva, le dimanche avant cette dernière fête, que le sermon de l’Université fut prêché par un personnage de distinction, venu à la ville pour prendre part à cette solennité. Ledit personnage n’était rien moins que le très-révérend docteur Brownside, nouveau doyen de Nottingham, pendant quelque temps professeur Huntingdonien de théologie, et l’un des plus subtils penseurs universitaires du jour, sinon le plus profond. Une taille plus que médiocre, un nez affublé de lunettes, un front chauve, des cheveux noirs aux boucles arrondies, des lèvres souriant avec affectation, un certain air compassé dans les formes, tel était au physique notre prédicateur. Ajoutons en outre qu’il savait donner de la pompe à son geste, et qu’il maniait avec facilité une prononciation distincte et musicale, de sorte que tout son auditoire pouvait l’entendre sans efforts. Comme théologien, le docteur Brownside paraissait n’avoir jamais eu de difficulté sur n’importe quel sujet. Il était si clair ou si superficiel, qu’il voyait au fond de toutes ses pensées ; aussi bien, puisque le docteur Johnson nous assure que « toutes les eaux peu profondes sont claires », peut-être pouvons-nous le désigner par les deux épithètes. Pour lui, la Révélation, au lieu d’être l’abîme des conseils de Dieu, avec ses ébauches obscures et ses grandes ombres, était une plaine ouverte et brillante, sillonnée par des routes droites et macadamisées. Sans doute, il ne niait pas l’incompréhensibilité divine elle-même, comme quelques hérétiques anciens ; mais il soutenait que dans la Révélation tout ce qui était mystérieux avait été laissé de côté, et que Dieu ne nous avait fait connaître que ce qui était pratique et ce qui nous regardait directement. Toutefois, c’était pour lui un prodige que tout le monde ne fût pas de son avis, en acceptant cette manière de voir simple et naturelle qui, à ses yeux, était l’évidence elle-même ; et il attribuait ce phénomène, qui n’était pas rare, à quelque défaut d’intelligence ou au manque de quelque fil de l’esprit, comme il peut advenir. Le docteur Brownside était un prédicateur populaire, c’est-à-dire que, quoiqu’il eût peu de partisans, il avait toujours un très-bel auditoire ; et à l’occasion dont il s’agit ici, l’église pouvait à peine contenir les nombreux étudiants venus pour l’entendre.
Il commença son discours en faisant observer que c’était une chose étonnante de voir si peu de bons dialecticiens dans le monde, alors que la faculté du raisonnement était un des apanages de la nature humaine, celui qui la distinguait des brutes. On avait dit, il est vrai, que les brutes raisonnaient ; mais c’était dans un sens analogique du mot raison et un exemple de cette ambiguïté de langage ou de la confusion d’idées dont il parlait en ce moment. Pareillement, nous disons que la raison pour laquelle le vent souffle, c’est qu’il y a un changement de température dans l’atmosphère ; et que la raison pour laquelle les cloches sonnent, c’est qu’un sonneur les balance ; mais qui oserait dire que le vent raisonne ou que les cloches raisonnent ?
Il y avait, croyait-il, un fait (et il appuya fortement sur ce mot), non parfaitement constaté, de brutes qui raisonnent. On avait soutenu que si, en cherchant son maître, le chien, cet animal si intelligent, rencontrait trois routes, après en avoir flairé deux, il prenait hardiment la troisième, sans autre investigation préalable ; ce qui, en supposant le fait vrai, était un exemple d’un syllogisme disjonctif et hypothétique. Dugald Stewart avait aussi parlé d’un singe qui cassait des noix derrière une porte, ce qui, n’étant pas une imitation stricte d’une chose que l’animal aurait pu voir actuellement, impliquait un acte d’abstraction par lequel cette brute intelligente s’était d’abord élevée à la notion générale des casse-noisettes, qu’elle avait pu voir dans un cas particulier, en argent ou en acier, sur la table de son maître, et qu’ensuite, descendant de cette idée générale, elle lui avait donné un corps, et l’avait obtenu sous la forme d’un expédient de sa propre invention. Les brutes raisonnent : telle avait donc été l’assertion ; toutefois, le docteur Brownside pouvait présentement admettre que la faculté du raisonnement était le caractère propre de l’espèce humaine, et que, tel étant le cas, il était vraiment étrange de trouver si peu de personnes qui raisonnassent bien.
Après cette introduction, notre prédicateur en vint à attribuer à ce défaut le nombre des différences religieuses qui sont dans le monde. Il dit que les questions les plus célèbres en religion n’étaient que des questions de mots ; que les combattants ignoraient leur propre dessein ou celui de leurs adversaires ; et qu’une teinte de bonne logique aurait mis fin à toutes les discussions qui avaient troublé le monde pendant des siècles, aurait empêché bien des guerres sanglantes, bien de furieux anathèmes, bien des exécutions cruelles et nous eût épargné bien de lourds in-folio. Il alla jusqu’à supposer que, dans le fait, il n’y avait ni vérité ni erreur dans les dogmes reçus en théologie ; que c’étaient des modes, ni bons ni mauvais en eux-mêmes, mais personnels, nationaux ou périodiques, manifestant seulement le travail de l’intelligence sur les grandes vérités religieuses ; que le tort consistait non à les admettre, mais à appuyer fortement sur eux : en d’autres termes, que c’était vouloir absolument habiller un Hindou en Finnois, et donner le boomarang[43] à un régiment de dragons.
[43] Petit bâton recourbé par un bout, dont se servent dans leurs jeux, avec beaucoup d’adresse, des sauvages d’une tribu d’Australie.
Il continua, faisant observer que, d’après les assertions précédentes, on pouvait voir clairement sous quel point de vue les formulaires anglicans devaient être acceptés : c’était notre mode d’exprimer des vérités éternelles, qu’on aurait pu aussi bien traduire d’une autre manière, comme tout penseur dialecticien le comprendrait sans peine. Dès lors, on ne devait leur faire subir aucune altération ; il fallait les conserver dans leur intégrité, sans oublier toutefois qu’ils étaient la théologie anglicane, et non la théologie abstractivement prise ; et que, quoique le Symbole d’Athanase fût bon pour nous, il ne s’ensuivait pas qu’il le fût aussi pour nos voisins : bien plus, que ce qui, à nos yeux, était l’opposé de ce Credo, pouvait convenir mieux à d’autres, être leur mode d’exprimer les mêmes vérités.
Il termina son discours par un mot en faveur de Nestorius, deux pour Abeilard, trois pour Luther, « ce grand génie », qui vit que, Églises, symboles, rites, personnes n’étaient rien en religion, et que l’esprit intérieur, « la foi », selon son expression, « était absolument tout en tout ». Il avertit enfin ses auditeurs que les choses n’iraient bien à l’Université que lorsque ce grand principe serait tellement admis qu’ils en viendraient, non pas à rejeter leurs formulaires propres et distinctifs, mais à regarder leurs contradictions directes comme étant également agréables au divin auteur du Christianisme.
Charles ne comprit pas tout l’ensemble du sermon ; mais il en saisit assez pour être convaincu que ce discours était différent de tous ceux qu’il avait entendus dans sa vie. Il fit plus que douter si, après l’avoir ouï, son père n’en aurait pas fait une exception à sa maxime favorite. Il se retira, cherchant en lui-même ce que le prédicateur avait pu vouloir exprimer, et se demandant s’il l’aurait mal compris. — Voulait-il dire que les Unitaires étaient seulement de mauvais dialecticiens, mais qu’ils pouvaient être d’aussi bons chrétiens que les croyants orthodoxes ? C’était bien là sa pensée. Mais, quoi donc ! si, après tout, il était dans le vrai ? — Un instant Charles s’abandonna à cette idée. — Dès lors tout homme est, plus ou moins, ce que Sheffield appelle un comédien, et nous n’avons pas à nous inquiéter de qui que ce soit. Donc, j’avais raison dans le principe de vouloir accepter chacun pour ce qu’il est. Réfléchissons. Tout homme un comédien… Les comédiens sont respectables, ou plutôt personne n’est respectable. Nous ne pouvons agir sans quelque forme extérieure de croyance ; l’une n’est pas plus vraie que l’autre ; c’est-à-dire toutes sont également vraies… Toutes sont vraies. C’est bien le meilleur côté par où l’on puisse prendre la question ; aucune n’est comédie, toutes sont vraies. Toutes sont vraies ? impossible ! l’une aussi vraie que l’autre ? Eh bien, donc, il est aussi vrai que notre Seigneur est un pur homme qu’il est certain qu’il est un Dieu. Impossible qu’il ait voulu exprimer cela ; que voulait-il dire ?
Ainsi pensait Charles, troublé d’une manière pénible. Cependant, malgré cet état de perplexité, deux convictions naquirent en lui : la première, bien triste sans doute, était qu’il ne pouvait recevoir pour évangile tout ce qui était prêché du haut de la chaire, même par les autorités d’Oxford et les théologiens de renom ; la seconde, que son aimable disposition d’autrefois d’accepter chacun pour ce qu’il est offrait des dangers, conduisant, sans beaucoup de peine, à la tolérance de toutes sortes de croyances, et arrivant, par une déduction légitime, au sentiment exprimé dans la Prière universelle de Pope, prière que son père lui avait toujours présentée comme un modèle achevé du philosophisme superficiel :
Charles consacra ce trimestre à son premier examen, ce qui l’obligea à rester encore quelques jours à Oxford après le départ de ses condisciples pour les grandes vacances. Ainsi vint-il à faire la connaissance de M. Vincent, un des plus jeunes tuteurs[44], lequel fut assez bon pour l’inviter à dîner, le dimanche, au réfectoire, et qui plusieurs fois lui fit faire, le matin, quelques tours de promenade, avec lui, dans l’allée des Fellows.
[44] Le tuteur (tutor) n’est autre que le professeur du collége. Le nom de professeurs (professors) ne se donne qu’aux professeurs eux-mêmes de l’Université. Au lieu de se rendre dans sa classe pour donner ses leçons, le tuteur reçoit les élèves chez lui.
Peu d’années suffisent, à Oxford, pour mettre une grande différence dans la position des personnes. C’est ainsi que M. Vincent devint ce qu’on appelle un don aux yeux de quelques étudiants qui avaient presque son âge. Au reste, Vincent paraissait plus âgé qu’il n’était en réalité. D’une constitution forte, il avait le teint fleuri et de grands yeux bleus ; sa poitrine et ses poignets étalaient un grand luxe de linge. Quoique homme d’intelligence, lecteur intrépide, travailleur infatigable, et un des premiers tuteurs, il était également bon convive ; il mangeait et buvait, il se promenait et montait à cheval avec autant d’ardeur qu’il en mettait à expliquer Aristote ou à bourrer ses élèves de théâtre grec. Ce qui est plus étrange encore, avec tout cela, Vincent avait quelque chose du valétudinaire. Il avait quitté l’école, grâce à la participation à une bourse, et partout, à l’école comme à l’Université, il s’était acquis la réputation d’être un érudit de premier ordre. Strict observateur de la discipline, à sa manière, il avait sous ses ordres les élèves du collége. Comme il y avait de la bonhomie dans sa nature, ceux-ci le regardaient avec des sentiments mêlés de crainte et de bon vouloir. Ils riaient de lui, mais ils lui obéissaient ponctuellement. Aussi bien, notre tuteur savait faire un bon discours, lire les prières avec onction, et parfois, dans la conversation, il trouvait l’accent d’une spiritualité évangélique. Les jeunes étudiants déclaraient même qu’ils pourraient dire combien de porto il avait bu au réfectoire, comme récompense de ses pieuses réponses à la prière du soir ; et l’on se rappelait qu’une fois, pendant le Confiteor, dans la chaleur de sa contrition, il avait poussé l’énorme coussin de velours où s’appuyaient ses coudes sur la tête des gentlemen commoners[45] qui étaient assis plus bas que lui.
Vincent avait juste assez d’originalité d’esprit pour se donner une excuse de former « son propre parti » en religion ; ou comme il le disait lui-même, de « n’être pas homme de parti » ; il en avait en même temps assez peu pour prendre toujours des fictions pour des vérités et changer des riens pompeux en oracles. Ses manières étaient celles d’un augure ; il dénonçait les partis et l’esprit du parti, et croyait se garder libre en évitant tout le monde, et en embrassant toutes les opinions. Il était persuadé que la vérité se trouvait dans le via media, et, pour l’acquérir, il pensait que c’était assez de s’éloigner des extrêmes, sans avoir une connaissance exacte de ce juste-milieu. Il n’avait pas assez de pénétration d’esprit pour pousser une vérité jusqu’à ses dernières limites, ni assez de hardiesse pour l’embrasser dans sa simplicité ; mais il était sans cesse affirmant une chose, la niant ensuite, balançant ses idées dans une position impossible, et noyant ses paroles dans un déluge d’exceptions inintelligibles. Quant aux hommes et aux opinions du jour et du lieu, il aurait voulu en général les suivre, s’il avait été libre ; mais il était obligé d’avoir un esprit à lui, et cela le poussait à de terribles expédients lorsqu’il voulait se distinguer des autres. S’il avait été plus âgé qu’eux, il aurait parlé « des jeunes têtes, des têtes chaudes » ; mais vu que ces messieurs étaient des hommes graves et froids, et qu’ils le dépassaient de quatorze ou quinze ans, il ne trouvait rien de mieux que de secouer la tête, de murmurer contre l’esprit de parti, de refuser de lire leurs ouvrages par crainte d’être d’accord avec eux, et de se faire une gloriole de son aversion pour leur société. En ce moment, il était sur le point de partir pour faire un voyage sur le continent, dans le but de se remettre de ses travaux de l’année ; il tenait, toutefois, salles et chapelles ouvertes pour les étudiants qui attendaient l’époque de leur examen ou la note de leur pension à payer. C’est dans ces circonstances que Vincent remarqua Charles comme un jeune homme intelligent et modeste, dont on pourrait faire quelque chose. Dans cette pensée, parmi d’autres politesses, il l’avait invité à déjeuner un ou deux jours avant son départ.
Un déjeuner de tuteur est toujours une affaire délicate pour l’hôte, comme pour les convives ; et Vincent se piquait du tact avec lequel il se tirait d’embarras. La partie matérielle était assez facile : petits pains, rôties, muffins, œufs, agneau froid, fraises, formaient le menu, et, au moment convenable, le servant du collége apporta des côtelettes de mouton et du jambon grillé ; et chacun satisfait mangeait de tout cœur ou plutôt selon son appétit. C’était une plus dure tâche d’entretenir un courant d’idées, ou au moins de paroles, ce sans quoi le déjeuner n’eût guère été meilleur qu’une auge immonde. La conversation, ou plutôt le mono-polylogue, comme l’appelle un grand artiste, se déroula à peu près ainsi qu’il suit :
« Monsieur Bruton, quelles nouvelles du Straffordshire ? Les poteries marchent-elles bien maintenant ? Nos poteries gagnent de l’importance. Vous n’avez pas besoin de regarder la tasse et la soucoupe qui sont devant vous, monsieur Catley : elles viennent du Derbyshire. Aujourd’hui, on voit partout de la faïence anglaise sur le continent. J’ai trouvé moi-même, dans le cratère du Vésuve, une demi-soucoupe sur laquelle était dessiné un saule. Monsieur Sikes, je pense que vous avez été en Italie ? — Non, monsieur, j’étais sur le point d’y aller ; ma famille est partie, il y a une quinzaine ; mais j’ai été retenu ici par ces maudites bêtises. — Vos responsiones, reprit le tuteur sur un ton de reproche ; ce délai est bien fâcheux pour vous ; car la saison sera extraordinairement belle, si les météorologistes de la sœur[46] de notre Université ne se trompent point dans leurs prédictions. Quels sont les examinateurs, monsieur Sikes ? — Butson de Leicester est un des plus sévères, monsieur ; il rejette un candidat sur trois. La semaine dernière, il a refusé Patch de Saint-Georges, et Patch a juré de le tuer ; depuis lors, Butson ne se promène qu’accompagne d’un bouledogue. — Ces bruits sont de ceux qui courent souvent, mais il ne faut pas y croire. Si c’est vrai, M. Patch n’aurait pas pu donner une meilleure preuve que son rejet était mérité. »
[46] L’université de Cambridge.
Ici, un moment de silence, pendant lequel le pauvre Vincent avala à la hâte deux ou trois bouchées de pain et de beurre, tandis que les fourchettes et les couteaux de ses convives résonnaient sur les assiettes. « Monsieur, est-il vrai, s’écria enfin quelqu’un, que le vieux Principal va se marier ? — Ce sont des matières dont il faut toujours s’assurer à la source, monsieur Atkins, répondit Vincent ; antiquam exquirite matrem, ou plutôt patrem ; ha, ha ! Un peu plus de thé, monsieur Reding ; cela n’agitera pas vos nerfs. Je suis quelque peu recherché dans mon thé ; celui-ci est venu par voie de terre à travers la Russie ; l’air de la mer détruit l’arome de notre thé ordinaire. A propos d’air, monsieur Tenby, je crois que vous êtes chimiste. Avez-vous remarqué les nouvelles expériences sur la composition et la décomposition de l’air ?… Non ? J’en suis surpris ; elles méritent votre plus sérieuse attention. C’est maintenant assez bien établi qu’en aspirant des gaz on obtient la guérison de toute espèce de maladies. On commence à parler de cures par le gaz comme on a parlé des cures par l’eau. Le grand chimiste étranger, le professeur Scaramouche, a le mérite de la découverte. Les effets sont étonnants, tout à fait étonnants ; et il y a plusieurs coïncidences remarquables. Vous savez que les médecines sont toujours désagréables : eh bien, ces gaz, également, sont fétides. Le professeur guérit par les mauvaises odeurs et il a poussé sa science à une telle perfection qu’il a pu les classer d’une manière positive. Il y a six mauvaises odeurs élémentaires, lesquelles se partagent en une grande variété de subdivisions. Que dites-vous, monsieur Reding ?… Distinctif ? Oui, il y a quelque chose de très-distinctif dans les odeurs. Mais ce qu’il y a de plus beau, la merveilleuse coïncidence dont je parle, c’est que la décomposition dernière des gaz fétides leur assigne précisément le même nombre que celui des maladies reconnues d’après les plus récents traités de pathologie. Chaque maladie a son gaz ; et ce qu’il y a de plus singulier, un récipient où l’on a fait le vide est un spécifique pour certains cas désespérés. Par exemple, on a opéré ainsi plusieurs cures d’hydrophobie. Monsieur Seaton, continua-t-il en s’adressant à un étudiant de première année, qui, son déjeuner fini, était assis tristement sur sa chaise, les yeux baissés, et jouait avec son couteau ; monsieur Seaton, vous regardez ce tableau (le tableau était presque derrière Seaton) ; je ne m’en étonne pas ; il m’a été donné par ma bonne vieille mère qui mourut il y a plusieurs années. Il représente une belle vue d’Italie. »
Vincent se leva, et tout le monde après lui. Les convives se groupèrent autour du tableau. « Je préfère le vert de l’Angleterre, dit Reding. — L’Angleterre n’a pas cette brillante variété de couleurs, reprit Tenby. — Mais il y a quelque chose de si agréable dans le vert. — Vous savez probablement, monsieur Reding, dit le tuteur, que le vert est abondant en Italie, et qu’en hiver même il y en a plus qu’en Angleterre ; seulement, il y a aussi d’autres couleurs. — Mais je ne puis m’empêcher de croire que ce mélange de couleurs n’offre pas le calme du paysage anglais. — Le calme, par exemple, de Binsey ou de Port-Meadow, en hiver, reprit Tenby. — Dites en été, répliqua Charles ; si vous choisissez le lieu, je choisirai la saison. L’Université entre en vacances au moment qu’Oxford commence à étaler tous ses charmes. Les promenades et les prairies sont maintenant si odorantes et si splendides, le foin est presque enlevé, et le nouveau gazon commence à paraître. — Reding devrait passer ici les grandes vacances, dit Tenby : reste-t-on à Oxford pendant ce temps, monsieur ? — Voulez-vous dire qu’on y meurt avant qu’elles se terminent, monsieur Tenby ? répliqua Vincent. Il est vrai toutefois, continua-t-il, que bien des jeunes gens, comme M, Reding, croient que c’est la plus agréable saison de l’année. J’aime Oxford ; mais ce n’est pas ma demeure en dehors du temps de mes études. — Eh bien, quant à moi, j’aimerais à y rester, reprit Charles. Mais je pense qu’on ne le permet pas aux sous-gradués. » M. Vincent répondit, avec plus de gravité qu’il n’était nécessaire : « Non. » C’était l’affaire du Principal ; mais, selon lui, celui-ci n’y consentirait pas. Vincent ajouta que certainement il y avait des partis qui restaient à Oxford pendant les grandes vacances. Ceci fut dit avec mystère. Charles répliqua que si c’était contre les règles du collége, il n’y avait rien à espérer ; autrement, puisqu’il étudiait pour prendre ses grades, rien ne lui plairait tant que de passer ses grandes vacances à Oxford, à en juger par le charme des dix derniers jours. « C’est un compliment à l’adresse de vos compagnons, monsieur Reding », dit Vincent.
En ce moment, la porte s’ouvrit, et le pourvoyeur entra avec le menu du dîner, sur lequel M. Vincent devait jeter un coup d’œil : « Watkins, dit-il, en lui remettant la note, je suis presque sûr qu’aujourd’hui c’est un des jeûnes[47] de l’Église. Allez voir, Watkins, et donnez-moi un mot de réponse. » Le pourvoyeur, qui n’avait jamais eu de semblable commission à remplir durant toute sa carrière, fut étonné, et il sortit à la hâte du salon pour chercher dans son esprit le meilleur moyen de s’acquitter de son devoir. La question du tuteur parut frapper aussi la compagnie, car il y eut un prompt silence, qui fut suivi d’une agitation de pieds et de saluts d’adieu. On eût dit que, quoique au déjeuner ces messieurs eussent mis en lieu sûr jambon, mouton et le reste, ils ne voulaient pas risquer leur dîner. Watkins revint plus tôt qu’on ne pouvait s’y attendre. Il dit à M. Vincent qu’il avait raison : d’après le calendrier, ce jour-là, c’était la fête des Apôtres. « Vous voulez dire la vigile de Saint-Pierre, Watkins, reprit M. Vincent : c’est ce que je pensais. Alors, donnez-nous un bon bifteck et un filet de mouton : pas d’oignons de Portugal, Watkins, ni de gelée ; ajoutez-y un simple pouding, une charlotte, Watkins : et cela suffit. »
[47] Le jeûne proprement dit n’existe plus parmi les anglicans. Les plus sévères d’entre eux, les hommes de la vieille école, se contentent, quand vient un de ces jours de pénitence d’après leur calendrier, de joindre du poisson salé à leur dîner, qui est toujours gras. — Nous n’entendons pas parler ici des Puséistes ; ils forment une honorable exception ; mais, en cela comme dans leurs doctrines, ils diffèrent des principes et des pratiques de l’Église anglicane.
Watkins disparut. Charles se trouva alors seul avec l’autorité du collége, qui commença à lui parler d’un ton plus confidentiel. « Monsieur Reding, dit Vincent, je n’aimais pas à vous interroger en présence des autres convives ; je comprends toutefois que vous n’ayez pas d’intention particulière dans l’éloge que vous faites d’Oxford, comme séjour pendant les vacances. Dans la bouche de certains autres, ce langage aurait été suspect. » Charles était tout surpris. « A dire vrai, monsieur Reding, les choses allant comme elles vont, c’est souvent une marque de parti que cette résidence à Oxford à pareille époque, quoique, sans doute, il n’y a rien dans la chose elle-même qui ne soit naturel et légitime. » Charles redoubla d’attention. « Mon bon monsieur, continua le tuteur, évitez les partis, je vous y engage fort. Vous êtes jeune encore parmi nous. J’ai toujours été inquiet par rapport aux jeunes gens de talent ; à l’Université, le plus grand danger pour le talent, c’est d’être absorbé dans un parti. » Reding répondit qu’il espérait n’avoir jamais donné lieu à l’observation de son tuteur. « Non, répliqua M. Vincent ; non, ajouta-t-il avec une légère hésitation ; non, je ne sais rien là-dessus. Mais j’ai jugé que certaines de vos remarques et de vos questions au cours indiquaient une personne qui pousse les choses trop loin, et qui désire se créer un système. » Charles fut tellement confondu par ce reproche que le mystère inexpliqué des grandes vacances s’échappa de sa tête. Il répondit qu’il était très-peiné et très-obligé ; et il tâcha de se rappeler ce qu’il aurait pu dire qui prêtât un fondement à l’observation de son tuteur. Ne pouvant s’en souvenir en ce moment, il continua : « Je vous l’assure, monsieur ; je connais si peu les partis de cette ville, que c’est à peine si j’en connais les chefs. J’ai entendu citer quelques personnes ; mais, si j’essayais de me les rappeler, je pense que je confondrais les noms et les opinions. — Je le crois, dit Vincent ; mais vous êtes si jeune, je vous mets en garde contre les tendances. Vous pouvez vous trouver subitement absorbé, avant de savoir où vous en êtes. »
Charles crut l’occasion favorable pour faire quelques questions sur des points qui le tourmentaient. Il demanda si le docteur Brownside était regardé comme un théologien bon à suivre. « Je soutiens, voyez-vous, répondit Vincent, que toutes les erreurs sont des contrefaçons de la vérité. Les hommes intelligents disent des choses vraies, monsieur Reding, vraies dans leur substance, mais (parlant à voix basse) ils vont trop loin. On pourrait même montrer que toutes les sectes, en un sens, ne sont que des portions de l’Église Catholique. Je ne dis pas des portions vraies, ceci est une autre question ; mais elles renferment de grands principes. Les Quakers représentent le principe de la simplicité et de la pauvreté évangélique ; ils ont même un costume à eux comme les moines. Les Indépendants représentent les droits des laïques ; les Wesleyens chérissent le principe de la dévotion ; les Irvingites, le symbolisme et le mysticisme ; la Haute Église, le principe de l’obéissance ; les Libéraux sont les gardiens de la raison. Nul parti dès lors, à mon avis, n’est entièrement vrai, ni entièrement faux. Quant au docteur Brownside, il y a eu certainement bien des opinions soutenues sur sa théologie ; cependant, c’est un homme habile, et je pense que vous acquerrez du bon, oui, du bon, dans son enseignement. Mais, souvenez-vous-en, je ne vous le recommande pas. Pourtant je le respecte ; et je crois qu’il dit bien des choses très-dignes de votre attention. Je vous conseillerais donc de prendre dans ses discours ce qui est bon, et de ne pas vous attacher à ce qui est mauvais. Ceci, croyez-le, monsieur Reding, est, dans ces matières, la règle la plus claire, et la règle d’or en même temps. ».
Charles répondit que M. Vincent l’estimait à une trop haute valeur, qu’il sentait fort bien qu’il avait à apprendre avant de pouvoir porter des jugements ; et qu’il désirait fort connaître si son tuteur pourrait lui recommander un ouvrage où il vît d’un coup d’œil quelle était la vraie doctrine de l’Église d’Angleterre sur un certain nombre de points qui le tourmentaient. M. Vincent répliqua qu’il devait prendre garde à ne pas dissiper son esprit dans de telles lectures. A une époque où ses devoirs de l’Université avaient un droit réel sur lui, il devait s’éloigner de toutes les controverses et de tous les hommes du jour. Il lui conseillerait de ne pas lire d’auteurs vivants. « Lisez seulement les auteurs morts, continua-t-il. Les auteurs morts sont sûrs. Nos grands théologiens (et il se leva debout) étaient des modèles. Il y avait des géants sur la terre en ce temps-là, comme l’a dit un jour au docteur Johnson George III, en lui parlant de ces hommes. Ils avaient la profondeur, et la puissance, et la gravité, et la plénitude du talent, et l’érudition. Et il y avait en eux de la substance, cette substance réelle que l’on pouvait appeler vraiment anglaise. Ils avaient cette richesse aussi, une mine si féconde de pensées, un tel monde d’opinions, une telle activité d’esprit, des ressources si inépuisables, une telle variété aussi. Et puis, ils étaient si éloquents ! le majestueux Hooker, Taylor à l’imagination si belle, le brillant Hall, la science de Barrow, le jugement droit de South, la logique serrée de Chillingworth, l’honnête et le bon vieux Burnet, etc., etc. »
En le prenant sur ce ton, Vincent pouvait parler sans fin ; il lui plut pourtant de s’arrêter. C’était de la prose, mais cette prose était agréable à Charles. Il en connaissait assez sur ces écrivains pour trouver de l’intérêt à entendre parler d’eux, et, pour lui, Vincent semblait dire bien des choses, tandis que, dans le fait, son discours était fort pauvre. Lorsque le tuteur s’arrêta, notre jeune étudiant répondit qu’il croyait que certaines personnes de l’Université poussaient à l’étude de ces auteurs. M. Vincent prit un air grave. « C’est vrai, répliqua-t-il ; mais, mon jeune ami, je vous ai déjà donné à entendre que les choses indifférentes elles-mêmes sont employées comme instruments de parti. En ce moment, les noms de nos plus grands théologiens ne sont que le mot d’ordre qui sert à indiquer les opinions des personnes vivantes. — Ces opinions, je suppose, reprit Charles, ne doivent pas se trouver dans ces auteurs. — Je ne dis pas cela, répondit M. Vincent. J’ai le plus grand respect pour les personnes en question, et je ne nie pas qu’elles n’aient fait du bien à notre Église en ramenant l’attention, en ces jours de relâchement, sur l’ancienne théologie de l’Église d’Angleterre. Mais c’est une chose que d’être d’accord avec ces messieurs, et c’en est une autre (frappant sur l’épaule de Charles), c’en est une autre d’embrasser leur parti. Ne faites d’aucun homme votre maître ; acceptez de tous ce qui est bon ; pensez bien de tous, et vous serez un homme sage. »
Reding demanda, avec une certaine timidité, si cette doctrine ne ressemblait pas à celle que le docteur Brownside avait prêchée du haut de la chaire de l’Université ; mais peut-être M. Vincent soutenait-il une tolérance d’opinions dans un sens différent ? Le tuteur répondit d’une manière un peu brève, qu’il n’avait pas entendu le sermon du docteur Brownside ; mais que, pour lui, il avait parlé seulement des personnes de notre communion. « Notre Église, ajouta-t-il, admet dans son sein une grande liberté de pensées. Nos plus grands théologiens même diffèrent entre eux à beaucoup d’égards ; bien plus, l’évêque Taylor diffère de lui-même. C’est là un grand principe dans l’Église d’Angleterre. Ses véritables enfants s’accordent à différer d’opinions. En vérité, continua-t-il, c’est là cette indépendance vigoureuse, forte et noble de l’esprit anglais, qui refuse de s’assujettir à des formes artificielles, et qui ressemble, dirai-je, à une grande et magnifique production de la nature ; c’est un arbre riche dans son feuillage et aux branches capricieuses ; un arbre qui n’est pas languissant dans une serre chaude ou sous la dépendance malheureuse d’un mur de jardin, mais qui, dans une magnificence négligée, répand ses fruits sur une terre libre pour l’oiseau de l’air, la bête des champs et toute espèce d’animaux, afin qu’ils s’en nourrissent et qu’ils y trouvent tous des jouissances. »
Lorsque Charles sortit, il essaya de résumer ce qu’il avait gagné à la conversation de M. Vincent. Il n’avait pas obtenu précisément ce qu’il avait demandé (quelques règles pratiques pour guider son esprit et le faire marcher droit), mais seulement quelques conseils utiles. Déjà il s’était éloigné des partis, et ce qu’il avait vu des hommes qui y étaient attachés avait scandalisé sa conscience. Vincent l’avait confirmé dans sa résolution de les éviter et de s’appliquer à ses devoirs de collége. Il était satisfait d’avoir eu cette conversation avec lui ; mais que signifiait ce soupçon de sa tendance à pousser les choses trop loin, et à se mêler par là aux partis ? Il fut obligé de se résigner à l’ignorance sur ce sujet et de se contenter d’être sur ses gardes à l’avenir.
L’occasion ne s’est pas offerte d’informer le lecteur que, pendant la dernière ou l’avant-dernière semaine, Charles avait, par hasard, rencontré plusieurs fois Willis, l’ombre de White au déjeuner de Bateman. Le jour où il l’avait vu chez celui-ci, il avait aimé son air quand il gardait le silence. Il avait été moins content de sa personne quand il l’avait entendu parler ; il ne pouvait, toutefois, s’empêcher de lui porter de l’intérêt, vu surtout que Willis paraissait l’avoir pris en affection. Évidemment, ce dernier aimait Charles et semblait désireux d’entretenir avec lui de bons rapports. Charles, pourtant, goûtait aussi peu sa manière de parler que celle de White ; et lorsqu’il visita pour la première fois son logement, il y trouva bien des choses qui choquèrent son bon sens et ses principes religieux. Un grand crucifix d’ivoire, enfermé sous verre, se faisait remarquer entre les fenêtres ; une gravure représentant la Sainte-Trinité, selon l’usage des pays catholiques, était suspendue au-dessus de la cheminée ; vis-à-vis était un tableau de la Madone et de saint Dominique ; sur la cheminée elle-même, se voyaient un rosaire, un encensoir et d’autres signes de catholicisme dont Charles ne connaissait pas l’usage ; un missel, un rituel et quelques traités catholiques étaient sur la table ; et, comme il arriva chez Willis d’une manière inattendue, il le trouva dans son fauteuil, revêtu d’un habit qui ressemblait plutôt à une soutane qu’à une robe de chambre, et occupé à lire le bréviaire. Virgile et Sophocle, Hérodote et Cicéron paraissaient s’être cachés dans les coins, comme d’impurs païens ; ou avoir fui devant la terrible présence de l’ancienne Église. Charles avait pris sur lui de protester contre quelques-unes de ces singularités, mais tous ses efforts étaient restés inutiles.
La veille de son départ pour rentrer dans sa famille, il dut aller à Folly Bridge payer une note. A son retour, il passait près d’une chapelle qu’il avait toujours regardée comme appartenant à des dissidents ; quelle ne fut pas sa surprise d’en voir sortir Willis ! A peine s’il put en croire ses yeux ; il savait bien que ce jeune étudiant avait été retenu à Oxford comme lui, mais quel motif l’avait poussé à une visite aussi extraordinaire que celle qu’il venait de faire ? c’est ce que Charles ne pouvait décider. « Willis ! » cria-t-il, comme il s’arrêtait. A cet appel, Willis rougit tout en s’efforçant de paraître à l’aise. « Faites quelques pas avec moi, ajouta Charles. Qu’avez-vous donc à faire dans cette chapelle ? N’est-ce pas une assemblée de dissidents ? — Une assemblée de dissidents ! s’écria Willis, surpris et offensé à son tour ; et quel motif a pu vous faire croire que je fréquentais une assemblée de dissidents ? — Pardon, reprit Charles, je m’en souviens, maintenant ; c’est une salle d’exposition. Cependant c’était autrefois une chapelle ; c’est ce qui m’a trompé. N’est-ce pas ce qu’on appelait l’ancienne Chapelle Méthodiste ? Jamais je n’y ai mis les pieds ; on y montrait le Dio-astro-doxon ; c’est le nom, je crois, qu’on donnait à cette exposition. » Charles tirait en long son discours, afin de faire oublier sa méprise, car il était honteux du reproche qu’il avait fait. Willis ne savait s’il voulait plaisanter, ou s’il parlait sérieusement. « Reding, lui dit-il, ne continuez pas ; vous m’offensez. — Qu’est-ce donc ? repartit Charles. — Vous en savez bien assez ; vous vous plaisez cependant à me tourmenter. — Pas du tout. — Eh bien, c’est l’église catholique. » Un instant Charles ne répliqua pas : « Mon ami, dit-il ensuite, à mes yeux votre explication ne vous justifie guère ; appelez-la comme vous voudrez, cette assemblée est une assemblée dissidente ; pourtant elle n’est pas de l’espèce que je m’imaginais. — Laquelle voulez-vous dire ? — Plutôt, dites-moi vous-même quelle était votre intention en allant dans un tel lieu ? car sachez-le, vous avez agi contre votre serment. — Mon serment ! Quel serment ? — Il n’y a pas de serment à cette heure, mais vous en avez fait un, il y a peu de temps encore ; c’est, du reste, un engagement solennel que tout étudiant est obligé de prendre. Ne vous rappelez-vous pas votre inscription chez le Vice-Chancelier, ni quelles déclarations et quels serments vous avez faits ? — J’ignore ce que j’ai fait ; mon tuteur ne m’a rien dit sur cela. J’ai apposé ma signature sur un ou deux livres. — Vous avez fait plus, j’en ai été informé très-exactement, vous vous êtes solennellement engagé à garder les Statuts. Or, un des Statuts défend d’aller dans toute espèce de chapelle ou d’assemblée de dissidents. — Les catholiques ne sont pas dissidents. — Oh ! ne parlez pas ainsi ; vous savez que la pensée du Statut est de les regarder comme tels. Il veut nous tenir éloignés de toute espèce de culte, le nôtre excepté. — Mais c’est une déclaration ou un vœu illégal ; donc il ne lie pas. — Où avez-vous trouvé ce faux-fuyant ? C’est sans doute le prêtre de cette chapelle qui vous l’a mis dans la tête. — Ce prêtre, je ne le connais pas ; je ne lui ai jamais adressé la parole. — En tout cas, cette réponse n’est pas de vous, et elle ne vous sert de rien. Je ne suis pas casuiste, mais si notre engagement est illégal, vous ne devriez pas continuer à jouir des avantages auxquels il donne droit. — Quels avantages ? — Votre toque et votre toge ; l’éducation de l’Université ; la chance d’un scholarship[48] ou d’un fellowship. Renoncez à toutes ces choses, et puis déclarez, si vous voulez, et selon les règles, que vous êtes libéré de votre engagement ; mais ne voguez pas sous un faux pavillon. N’acceptez pas le bienfait, et brisez la stipulation. — Vous le prenez trop au sérieux ; il y a une cinquantaine de statuts que vous ne gardez pas vous-même plus que moi. Vous êtes très-inconséquent. — Si nous ne les suivons pas, c’est sur des points, je suppose, dont les autorités ne pressent pas l’exécution : par exemple, on ne nous oblige pas à nous vêtir d’habits bruns, quoique les Statuts l’ordonnent. — Mais on a bien l’intention de vous défendre de vous promener en castor dans High Street, répliqua Willis, cela est si vrai que les Censeurs montent et descendent constamment la rue, et vous renvoient au collége, s’ils vous prennent en flagrant délit. — Mais ceci est une autre affaire, répartit Charles changeant de terrain ; votre cas à vous est matière de religion. Il ne peut être permis de se rendre à des assemblées ou à des endroits de culte étranger. — Mais, répliqua Willis, si nous ne faisons qu’une même Église avec les Catholiques Romains, je ne puis comprendre, sur mon honneur, comment c’est mal pour nous d’aller à eux, ou pour eux de venir à nous. — je ne suis pas théologien, je ne comprends pas ce qu’on entend par l’Église une, dit Charles ; mais je sais bien qu’il n’y a pas dans le pays d’évêque, d’ecclésiastique, ni d’homme d’Église sensé qui ne tournât cet argument contre vous. C’est une pure absurdité. — Ne parlez pas de la sorte, je vous prie, je me sens entraîné de tout mon cœur vers le culte catholique : notre service est si froid ! — C’est précisément la raison de tout opiniâtre dissident, répondit Charles. Chaque pauvre paysanne, qui, n’en sachant pas plus long, court après les Méthodistes, ou après le cher M. Spoutaway, ou après le prédicateur savetier, vous dit (je l’ai entendu de mes oreilles) : « Oh ! monsieur, je suppose que nous devons aller là où nous trouvons le plus de bien. M. tel et tel va à mon cœur, il m’attendrit. » Willis se mit à rire. « Eh bien, par le temps où nous sommes, dit-il, la raison n’est pas mauvaise, je crois. Pauvres âmes ! quels meilleurs moyens ont-elles pour juger de leur religion ? Comment pouvez-vous espérer qu’elles goûteront ces paroles : « L’Écriture nous touche ? » Quant à ma démarche, vous y donnez réellement trop d’importance. C’est seulement la seconde fois que j’ai visité la chapelle catholique, et, je vous le dis sérieusement ; je m’y trouve l’âme pleine de respect et de piété ; comme vous voudriez être aussi, je pense. J’en sors vraiment meilleur : je ne puis prier dans notre église ; il y a là une mauvaise odeur qui m’indispose ; et puis, les bancs masquent tout : comment voir à travers une planche de sapin ? Mais ici, quand je suis entré, je trouve tout silencieux et calme ; l’espace est ouvert, et, dans un demi-jour, se montre le tabernacle, indiqué par la lampe. » Charles paraissait mal à l’aise. « Willis, dit-il, vous m’embarrassez. Que le ciel me garde de rien dire contre les Catholiques Romains : je ne sais rien sur leur compte. Mais ce que je sais, c’est que vous n’êtes pas membre de leur communion, et que vous n’avez rien à faire chez eux. S’ils ont dans leur église les choses sacrées dont vous parlez, il est certain, cependant, que ces choses ne sont pas les vôtres ; vous êtes un intrus. Je suis très-ignorant sur cette matière ; je n’aime pas à porter un jugement. Mais, laissez-moi vous le dire, c’est se faire un jeu des choses saintes que de courir ici et là, de toucher aux objets et de les goûter, de les accueillir et de les rejeter ensuite. Je n’aime pas ces manières, ajouta-t-il avec véhémence ; c’est prendre des libertés avec Dieu. — Oh ! mon cher Reding, ne parlez pas si sévèrement, repartit le pauvre Willis ; qu’ai-je fait de plus que vous ne fussiez prêt à faire, si vous étiez en France ou en Italie ? Est-ce donc que vous n’entreriez pas dans les églises sur le continent ? — Je veux seulement décider un cas qui est devant mes yeux, répondit Charles ; quand j’irai à l’étranger, alors ce sera le moment de résoudre votre question. C’est bien assez de connaître ce qu’on doit faire présentement ; or, il est clair pour moi que vous avez mal fait. Comment êtes-vous arrivé à cette chapelle ? — White m’y a conduit. — Alors, il y a dans le monde un homme plus irréfléchi que vous. Y a-t-il beaucoup d’étudiants qui la fréquentent ? — Je l’ignore ; un ou deux y sont venus par curiosité ; ils n’ont pas l’habitude d’y venir, au moins d’après ce qu’on m’a dit. — Eh bien, reprit Charles, il faut que vous me promettiez de ne pas y retourner. Allons, je ne vous lâche pas que vous ne m’ayez fait cette promesse. — C’est trop demander », dit Willis avec douceur. Dégageant alors son bras des mains de son ami, il s’éloigna subitement, en criant : « Au revoir, au revoir ; à notre prochaine partie de plaisir, au revoir ! »
[48] A son origine, c’est-à-dire au moyen âge, le scholarship était une bourse fondée au profit des étudiants pauvres ; aujourd’hui il consiste simplement dans le prix d’un concours auquel tous les étudiants peuvent prendre part, pourvu qu’ils aient dix-neuf ans.
Il n’y avait rien à faire. Charles revint lentement au collége, se disant à lui-même : « Mais, après tout, si l’Église catholique de Rome est la véritable Église ? Je voudrais savoir ce qu’il faut croire, nul ne sait me satisfaire sur ce point, et me voilà ainsi abandonné à moi seul. » Il lui vint ensuite à l’esprit : « Je suppose que j’en sais assez pour ma direction personnelle, plus même que je ne pratique, et je devrais certainement être content et plein de reconnaissance. »
Charles était un fils affectueux, aussi trouvait-il un bonheur ineffable à vivre au sein de sa famille pendant les grandes vacances. Levé de bonne heure, il travaillait jusqu’au lunch, et, dès ce moment, il était tout entier à son père, à sa mère et à ses sœurs, pour le reste de la journée. Il aimait le calme de la campagne ; il aimait le cours monotone du temps, alors qu’un jour n’est pas différent d’un autre ; et après avoir respiré l’atmosphère brûlante d’Oxford, le presbytère avec sa solitude lui était comme un port après l’agitation des vagues. Les mille opinions et les perplexités diverses qui l’avaient envahi de toutes parts au collége étaient à cette heure comme le bruit lointain de l’Océan ; elles le rappelaient à la jouissance de sa sécurité présente. Les prairies ondoyantes, les haies vertes, la vaste bruyère, les champs de vaine pâture avec leur développement profond d’ormes sombres, la haute futaie qui frange le sentier de l’horizon d’un village à l’autre, et qui, coupée de temps en temps, se dessine en groupes ou se perd dans les taillis, la porte elle-même, et la barrière[49] et la grand’route ; tout cela avait des charmes pour notre jeune ami, non pas sans doute ceux de la nouveauté, mais ceux des vieilles connaissances ; c’était toute la poésie des souvenirs. Malgré son état de dilapidation et de délabrement, avec son escalier extérieur, ses galeries disgracieuses, ses fenêtres profondes, ses bancs incommodes, sa table basse, son vestiaire abandonné et son odeur humide et terreuse, l’église, elle aussi, éveillait des pensées agréables dans l’homme intérieur ; car c’était là que, pendant plusieurs années, il avait entendu son père, tous les dimanches, faire la lecture et prêcher ; là se trouvaient les tombeaux antiques avec leurs inscriptions latines et leurs devises étranges, les écriteaux noirs avec des lettres blanches, les Resurgam, les crânes grimaçants, les seaux à incendie, les couleurs fanées de la milice, et le vieux clerc, brave homme, presque passé à l’état d’immeuble, portant toujours sa perruque galloise sur les oreilles et disant ses répons à tort et à travers. Toutes ces choses avaient frappé l’imagination de Charles dans son enfance et elles lui avaient laissé un profond sentiment de respect. Et puis d’ailleurs, il était là désormais dans sa maison ; là il retrouvait son appartement bien connu, la routine avec ses délices, son propre arrangement, son comfort : en un mot, son chez lui, vieil et véritable ami, d’autant plus cher à son cœur que maintenant il en connaissait d’autres. — Où serai-je dans un temps à venir ? se dit-il un jour à lui-même ; je l’ignore. Je ne suis qu’un enfant ; bien des événements, auxquels je n’ai pas songé, que mon imagination ne saurait mesurer, peuvent m’arriver avant que je meure, si toutefois je vis. Mais ici, au moins, et en ce moment, je suis heureux, et je veux jouir de mon bonheur. Certaines personnes disent que le plus beau temps de la vie est celui de l’école ; cela n’exclut pas le collége. Je suppose que ce sont les soucis qui rendent la vie si lourde. Pour le moment, je n’ai ni soucis, ni responsabilité ; j’en aurai bien sans doute un peu pour prendre mes grades. Les soucis sont une terrible chose ; j’en ai eu quelque idée autrefois, à l’école. Que c’est curieux à penser : un jour j’aurai vingt-cinq ou trente ans ! Comme les semaines s’écoulent vite ! les vacances touchent déjà à leur terme ! Oh ! je suis si heureux ! cela me fait peur. Mais j’aurai de l’énergie au jour venu.
[49] La barrière d’enclos ou de haie (the style). La forme en est très-variée et très-ingénieuse.
Parfois cependant les pensées de Charles prenaient une tournure plus triste, et il anticipait sur l’avenir d’une manière plus vive qu’il ne jouissait du présent. Un ami de la maison, M. Malcolm, était venu les voir après une absence de plusieurs années. Sa visite fit plaisir à Reding ; et le bon fellow partagea ce bonheur. Un nouveau pays et un cercle de famille avaient pour lui des charmes ineffables, après sa vie de garçon au collége. M. Malcolm avait été un grand ami de Charles et de ses sœurs pendant leur enfance. Mais à cette heure, l’affection que ceux-ci lui conservaient ne vivait, en grande partie, que de souvenirs. Lorsqu’il leur racontait des histoires amusantes, ou qu’il leur permettait de grimper sur ses genoux et de lui enlever ses lunettes, il faisait tout ce qu’il faut pour gagner des cœurs d’enfants ; mais c’est avec d’autres armes qu’on parvient à conquérir le cœur de la jeunesse. Qu’y a-t-il donc de surprenant que M. Malcolm ne vécût dans leur esprit que par prescription ? Le brave homme ne savait rien de cela, et il n’y aurait pas, au reste, beaucoup songé, si toutefois il s’en était aperçu ; car, semblable à bon nombre de personnes avancées en âge, il se faisait trop lui-même son propre centre, ne se donnait pas la peine de pénétrer dans l’esprit des autres, ne s’inquiétait pas de leur faire plaisir, ni de trouver en eux sa satisfaction. Il était bon et affable envers Charles et ses sœurs comme il l’aurait été à l’égard d’un serin ou d’un bichon ; c’était une espèce d’amour externe ; et quoique les enfants de M. Reding fussent très-bien avec lui, ils ne sentaient pas son absence quand il partait, ils n’auraient pas été peinés d’apprendre qu’il ne devait plus revenir. Charles le conduisait dans la campagne, il lui timbrait ses lettres, avait soin de lui faire arriver les journaux de la ville voisine ; il écoutait ses histoires sur Oxford et sur les hommes d’Oxford. Il l’aimait vraiment, il désirait même lui être agréable ; mais quant à le consulter sur des matières sérieuses, ou à s’adresser à lui pour demander des consolations dans ses peines, il aurait plutôt eu la pensée de se confier à Daniel le colporteur ou au vieil Isaac qui, le dimanche, jouait du basson.
« Comment vos pêches se trouvent-elles cette année, monsieur Malcolm ? » demanda un jour M. Reding à son hôte, après le dîner. — Vous devriez savoir que nous n’avons pas de pêches à Oxford, répondit M. Melcolm. — Alors, ma mémoire me trompe ; mais, il me semble y avoir vu des pêches d’octobre, et de très-belles pêches même. — Ah ! vous voulez parler des pêches du vieux Tom Spindel, le jockey », reprit M. Malcolm. « C’est vrai, il avait un pan de mur de briques, et il en était très-fier. Mais quand les pêches arrivent, il n’y a personne à Oxford pour les manger ; aussi, l’arbre comme le fruit y est une grande rareté. Oxford n’était pas si dépourvu autrefois, il y reste les vieux mûriers, en souvenir de jours meilleurs. — A cette époque également, je le suppose, dit Charles, les fruits les plus coûteux n’y étaient pas cultivés. Les mûriers sont le témoignage non-seulement d’un collége nombreux, mais des goûts simples. — Charles fait secrètement la guerre à nos serres chaudes, dit M. Reding, comme si notre premier père ne préférait pas les fruits et les fleurs au bœuf et au mouton. — Pas du tout, répliqua Charles, je regarde les pêches comme une chose excellente ; et quant aux fleurs, j’aime passionnément leurs odeurs. — Charles a dès lors quelque théorie sur les odeurs, je le parierais, reprit son père ; je ne connus jamais d’enfant qui décidât ainsi de ses goûts et de ses répugnances selon la fantaisie. Il commença à aimer les olives dès qu’il lut l’Œdipe de Sophocle, et je crois vraiment que bientôt, par dégoût du roi Guillaume, il ne mangera plus d’oranges. — Tout le monde agit ainsi, repartit Charles. Qui ne voudrait être à la mode ? Notre tante Catherine appelle une année son chapeau délicieux, et le traite d’épouvantail l’année suivante. — Vous avez raison, papa, dans cette circonstance, dit la fille ; sans savoir quel est son motif, je sais que Charles en a un pour savourer le parfum de la rose ou distiller la lavande. — Quel est-il, ma chère Marie ? — Vous êtes des restes des berceaux d’Éden », répondit la fille. — Eh bien, papa, c’était précisément la raison que vous donnez. — Il y a plus que celle-là, reprit M. Reding, si toutefois je connus jamais ce que c’était. — Il pense que l’odorat est un sens plus spirituel que les autres, ajouta Marie en souriant. — Quel enfant né pour les paradoxes ! s’écria sa mère. — Cependant, c’est ainsi d’une certaine façon, reprit Charles ; mais je ne puis l’expliquer. Les odeurs et les sons sont plus aériens, moins matériels ; ils n’ont pas de forme, de même que les anges. » M. Malcolm se mit à rire. « Soit, je vous l’accorde, Charles, dit-il ; les anges ont de la longueur sans largeur. — Avez-vous jamais ouï pareille chose ? » s’écria madame Reding riant à son tour ; « ne l’encouragez pas, monsieur Malcolm ; vous êtes pire que lui. Des anges longs sans largeur ! — Ils passent d’un lieu à l’autre ; ils vont, ils viennent, continua M. Malcolm. — Les odeurs évoquent le passé si vivement ! ajouta Charles.
« Mais les sons, assurément, éveillent ce passé plus que les odeurs, dit M. Malcolm. — Pardon, c’est l’inverse, à mon avis, répliqua Charles. — C’est un paradoxe, mon jeune ami ; l’odeur du rosbif n’a jamais eu d’autre puissance que d’éveiller chez un homme le souvenir du dîner ; mais les sons émeuvent et inspirent les âmes. — Mais, monsieur, reprit Charles, songez que les odeurs sont complètes en elles-mêmes, sans être formées de parties. Songez combien différente est l’odeur entre une rose et un œillet, entre un œillet et un pois de senteur, entre un pois de senteur et une giroflée, entre une giroflée et le lilas, entre le lilas et la lavande, entre la lavande et le jasmin, entre le jasmin et le chèvre-feuille, le chèvre-feuille et l’aubépine, l’aubépine et la jacinthe, la jacinthe… — Grâce ! grâce ! Charles, vous allez nous donner tout le catalogue de Loudon. — Et ce ne sont que les odeurs des fleurs ; quelle différence d’odeur entre les fleurs et les fruits, les fruits et les épices, les épices et le rosbif ou les côtelettes de porc, et ainsi de suite ! Voici maintenant ma conclusion : ces odeurs sont parfaitement distinctes les unes des autres et sui generis ; elles ne peuvent jamais être confondues ; cependant, chacune se communique à la perception en un instant. La perspective demande un grand espace, un air est une succession de sons ; mais les odeurs sont d’un seul trait spécifiques et complètes, quoique indivisibles. Qui jamais a pu partager en deux une odeur ? Elles ne demandent ni temps ni espace ; ainsi elles sont immatérielles ou spirituelles. — Charles n’a pas été à Oxford pour rien », dit sa mère en riant et en jetant un coup d’œil à Marie ; « voilà ce que j’appelle de la vigoureuse logique ! »
« Bien terminé, Charles, s’écria M. Malcolm ; et maintenant, puisque vous avez des notions si claires sur la puissance des odeurs, vous devriez, comme un certain homme, être satisfait en flairant votre dîner, et engraisser par ce moyen. C’est une honte de vous voir assis à table. — Eh bien, monsieur, il est au moins des gens qui paraissent s’engraisser avec le tabac. — Fi donc ! Charles ; vous m’avez vu user de ma boîte au réfectoire pour me tenir éveillé après le repas ; mais certainement jamais autre part. Je prends ma tabatière avec moi simplement comme un jouet ; j’y tiens, parce qu’on m’en a fait cadeau. Il vous aurait fallu vivre au temps de ma jeunesse. Vous auriez vu alors le vieux docteur Troughton de Nun’s Hall qui tenait son tabac dans sa poche, et la vieille Vice-Principale, madame Daffy, qui avait l’habitude d’en mettre une traînée sur son bras et de l’aspirer bravement. Les docteurs en médecine, eux aussi, non moins que leurs confrères en théologie, en usaient avec largesse ; ceux-là, comme un préservatif contre les infections, ceux-ci contre le sommeil dans l’église. — Maintenant, ils prennent du vin contre les infections, dit M. Reding ; c’est un préservatif plus sûr. — Du vin ! s’écria M. Malcolm, oh ! ils n’en buvaient pas moins jadis, l’avez-vous donc oublié ? En certaines occasions solennelles, ils se faisaient même un point d’honneur d’enivrer tout le collége, depuis le Vice-Principal jusqu’aux domestiques. Grâce à leurs femmes, les chefs des établissements restaient dans les bornes du devoir ; néanmoins, je vous l’assure, le Dieu de la gaieté s’approchait très-près de M. le Vice-Chancelier lui-même. Vivait alors le vieux docteur Sturdy, de Saint-Michel, le grand martinet de son temps. Un jour, le roi passait à Oxford ; Sturdy, homme de haute taille, à la contenance roide et à la face de fer, devait aller à sa rencontre, en procession, à Magdalen-Bridge, et il descendait, précédé de ses masses d’or et d’argent, de ses porte-verges, des chapeaux à cornes et du reste. Or, parmi les gens de sa suite, pas un qui ne fût ivre. Je vous laisse à penser l’effroi du bon vieil homme : Sa Majesté dans le lointain, et sous son propre nez tout son monde chancelant de droite et de gauche, et le menaçant de le quitter pour le ruisseau avant la fin de la marche. — Personne ne peut s’enivrer avec du tabac, je vous l’accorde, reprit M. Reding ; mais si le vin a fait du mal à quelques-uns, il a fait tant de bien à d’autres ! — La poudre pour les cheveux n’est pas meilleure que le tabac, ajouta Marie, qui préférait le premier sujet de conversation. Vous connaissez le vieux M. Butler, de Cooling ; sa perruque est si grande et si couverte de poudre, que toutes les fois qu’il remue la tête, je suis sûre d’éternuer.
— Ah ! mais ce ne sont là que des accidents, mademoiselle », repartit M. Malcolm, troublé par ce coup porté à la conversation et s’échappant, de mauvaise grâce, d’un autre côté ; « des accidents après tout. Les vieilles gens sont toujours les mêmes ; et les jeunes aussi. Chaque âge a ses caprices. Si M. Butler ne portait pas perruque, il y aurait néanmoins chez lui quelque chose de singulier et d’étrange pour de jeunes yeux. Charles, ne devenez pas vieux garçon. Personne ne s’inquiète des vieilles gens. Mariez-vous, mon cher ; choisissez de bonne heure une femme jeune et vertueuse, qui aura pour vous de douces attentions. » Charles rougit légèrement, et sa sœur se mit à rire, comme si sur ce point il y avait quelque mystère entre eux. M. Malcolm continua : « N’attendez pas jusqu’à l’âge où vous aurez besoin de quelqu’un qui vous achète de la flanelle pour votre rhumatisme ou la goutte ; mariez-vous de bonne heure. — Vous voulez bien, toutefois, qu’auparavant je prenne mes grades ? — Certainement, prenez votre titre de maître ès-arts, si vous voulez ; mais ne devenez pas vieux fellow. N’attendez pas la quarantaine ; on fait souvent d’étranges bévues. — Lorsque le temps viendra, notre bien-aimé Charles fera, j’en suis sûre, un bon et affectueux mari, répondit la mère ; et ce temps viendra, mais pas encore. Oui, mon cher enfant, ajouta-t-elle en lui faisant un signe de tête, vous ne pourrez échapper à votre destinée quand l’heure sera venue. — Il faut que vous le sachiez, dit M. Reding à son hôte, Charles, en ce moment, est romanesque dans ses idées ; à ses yeux, je le crois, personne n’est assez bon pour lui. Oh ! mon cher fils, que je ne vous inquiète pas : je ne fais allusion à rien de sérieux ; mais, quoi qu’il en soit, notre jeune étudiant ne s’est pas bien tiré d’affaire auprès de quelques demoiselles qui s’attendaient à plus d’attention de sa part. — Je vous assure, papa, reprit Marie, que Charles est plein d’attentions quand il y a lieu, et qu’il épie toujours le moment de rendre service ; seulement, il se tire mal du babillage féminin. — Tout viendra en son temps, ma chère, reprit madame Reding ; un bon fils fait un bon mari. — Et un tendre papa, ajouta M. Malcolm. — Oh ! grâce, monsieur, s’écria le pauvre Charles ; comment ai-je mérité tout ceci ? — Soit, continua M. Malcolm ; et les demoiselles, également, doivent se marier de bonne heure. — Allons, Marie, voici votre tour », s’écria Charles ; et prenant sa sœur par la main, il releva le châssis et s’échappa avec elle dans le jardin.
Ils traversèrent la pelouse et vinrent se réfugier dans un bosquet. « Que c’est étrange ! » dit Marie comme ils parcouraient l’allée tortueuse, « nous aimions tant M. Malcolm dans notre enfance ; aujourd’hui, je l’aime encore, sans doute, mais il ne me paraît plus le même. — Nous sommes plus âgés, lui répondit son frère ; d’autres objets nous préoccupent. — Il était si bon ! continua Marie ; avec quelle impatience n’attendions-nous pas le jour où il devait venir ! « Faites en sorte d’être sages quand M. Malcolm sera ici », nous disait alors maman ; et l’on pouvait être sûr que le brave homme nous apportait ou un gâteau des rois, ou une arche de Noé, ou quelque chose de semblable. Et puis il jouait avec nous, et nous permettait de lui faire des niches. — Ce n’est pas lui qui est changé, reprit Charles, mais nous ; nous avons déjà changé, et nous changerons encore. — Quelle bénédiction n’est-ce pas, dit sa sœur, que nous soyons si heureux comme famille ! Si nous changeons, changeons tous ensemble, comme les pommes d’un même arbre : quand l’une tombe, les autres tombent également. Et c’est ainsi que nous resterons toujours les mêmes les uns à l’égard des autres. — C’est une bénédiction, vraiment, repartit Charles ; nous sommes comblés de tant de faveurs que parfois j’en suis effrayé. » Sa sœur le regarda fixement. Il fit un léger sourire pour faire oublier le côté trop sérieux de ses paroles. « Vous sauriez ce à quoi je fais allusion, chère Marie, si vous aviez lu Hérodote. Un tyran de la Grèce, redoutant son excessive prospérité, voulut faire à la fortune le sacrifice de l’objet qu’il estimait le plus ; il prit donc un anneau de son doigt et le jeta dans la mer. Il s’imposait ce sacrifice pour prévenir les terribles coups du ciel. — Mais, mon très-cher ami, si nous ne faisons que jouir avec reconnaissance des bienfaits de Dieu, et que nous prenions garde d’y attacher nos cœurs ou d’en abuser, pourquoi craindrions-nous d’en voir tarir la source ? — Eh bien, bonne Marie, il y a un texte qui pèse toujours sur mon esprit : « Réjouissez-vous avec tremblement. » Je ne puis prendre à rien un plaisir complet et sans limites. — Pourquoi pas, si vous considérez tout comme un bienfait de Dieu ? — Je ne puis m’en défendre ; c’est ma manière de voir ; cela peut être de la prudence égoïste, pour ce que j’en sais, mais je suis sûr que si je donnais mon cœur à une créature, je la ravirais à Dieu. Qu’il me serait facile d’idolâtrer ces délicieuses promenades que nous connaissons depuis tant d’années ! »
Ils se promenèrent en silence. « Eh bien, reprit Marie, quelque malheur qui arrive, comme famille nous ne serons affectés par aucun changement. Tant que nous serons nous, nous serons les uns à l’égard des autres ce qu’aucune chose étrangère ne pourrait être pour nous, le bonheur lui-même comme l’infortune. » Charles ne répondit pas. « Qu’avez-vous donc, Charles ? dit-elle en s’arrêtant et en fixant les yeux sur lui ; puis elle écarta doucement ses cheveux, et caressant son front, elle ajouta : « Vous êtes si triste aujourd’hui ! — Très-chère Marie, il n’y a rien vraiment ; je pense que c’est M. Malcolm qui m’a dérangé. C’est si stupide de parler de l’avenir d’un garçon comme moi. Ne prenez pas cet air inquiet, je n’ai rien en tête : seulement, cela m’ennuie. » Marie laissa échapper un sourire. « Ce que je voulais dire, continua Charles, c’est que nous ne pouvons compter sur rien ici-bas, et que c’est folie d’édifier sur l’avenir. — Mais nous pouvons nous reposer les uns sur les autres, répéta sa sœur. — Ah ! chère amie, ne parlez pas ainsi, cela m’effraie. » Marie considéra son frère avec surprise et fut presque effrayée elle-même : « Très-chère, continua-t-il, je n’ai rien en tête ; mais toutes choses sont si incertaines en ce monde ! — Nous sommes sûrs l’un de l’autre, Charles. — Oui, Marie », et il l’embrassa avec affection, « c’est vrai, très-vrai ». Puis il ajouta : « Tout ce que je voulais dire, c’est qu’il y a de la présomption à parler de la sorte. David et Jonathas furent séparés ; n’en fut-il pas de même de saint Paul et de saint Barnabé ? » De grosses larmes roulèrent dans les yeux de Marie. « Oh ! quel imbécile je suis, reprit Charles, de vous tourmenter ainsi pour rien ! Non, je veux seulement dire qu’il n’y a qu’un être seul qui ne puisse pas mourir, qui ne change jamais : un seul ! Il n’y a pas de mal à se le rappeler. Vous souvenez vous des beaux vers de Cooper ? Je les sais sans les avoir appris ; ils me frappèrent si fort la première fois que je les lus ! » Et il se mit à les réciter :
Cependant le mois d’octobre venait de s’ouvrir, et naturellement les pensées de Charles se tournèrent de nouveau vers Oxford. Les dernières semaines des vacances écoulées, notre jeune étudiant s’empressa de faire ses malles. M. Reding vit partir son fils avec peine ; son émotion fut plus grande même que lorsqu’il l’envoya pour la première fois à l’école. Il voulut, malgré la goutte qui le tourmentait, le conduire lui-même en phaéton à la ville voisine, d’où l’omnibus se rendait au chemin de fer. Mais lorsque le moment de la séparation arriva, il ne pouvait laisser aller sa main, comme s’il avait eu à dire quelque chose qu’il ne pût se rappeler, ou exprimer une pensée qui le tourmentât. « Allons, dit-il enfin, nous serons bientôt à Noël. Il faut nous quitter ; à quoi bon retarder davantage ? Écrivez-nous dans peu de jours, cher enfant, et dites-nous bien tout ce qui vous concerne, vous et vos maîtres. Parlez-nous de vos amis ; ce sont sans doute d’excellents garçons ; mais j’ai grande confiance dans votre sagesse ; vous en avez plus que certains d’entre eux. Votre tuteur paraît un homme estimable, d’après ce que vous m’avez dit. » Il continua, rappelant les conversations qu’il avait eues souvent avec Charles. « C’est un homme solide, d’un jugement sain, que ce M. Vincent. Sheffield a trop d’esprit ; il est jeune : vous avez une tête plus mûre. Il n’est pas nécessaire que j’aille plus loin ; je vous ai déjà dit tout cela et vous pourriez, d’ailleurs, arriver trop tard pour le chemin de fer. Allons, que Dieu vous bénisse, mon bon Charles, et qu’il fasse de vous une bénédiction pour nous tous. Puissiez-vous être encore plus heureux et meilleur que votre père ! J’ai toujours été béni pendant ma vie, prodigieusement béni. Les bénédictions ont été répandues sur moi bien au delà de mes mérites, puissiez-vous en obtenir deux fois plus ! Au revoir, mon bien-aimé Charles, au revoir. »
Charles, avant de rentrer au collége, devait passer un ou deux jours chez un de ses parents qui demeurait tout près de Londres. Pendant son séjour dans cette maison, il lui arriva une lettre transmise de chez lui, et datée de cette dernière ville. C’était Willis qui lui écrivait pour lui annoncer qu’il avait pris une résolution importante, et qu’il ne reviendrait pas à Oxford. Charles se retrouvait subitement dans le monde, plongé dans le tourbillon des opinions. Quel triste contraste avec sa vie calme de famille ! Il n’y avait pas à se tromper sur le vrai sens de la lettre ; et notre jeune ami partit tout de suite avec l’espérance d’en trouver l’auteur à la maison d’où elle était datée. C’était un logement au bout du quartier ouest de la ville. Il y arriva vers midi.
Il trouva Willis en compagnie d’un personnage qui paraissait plus âgé que lui de deux ou trois ans. A la vue de Charles, Willis tressaillit : « Qui l’aurait pensé ! Qu’est-ce qui vous amène ici ? s’écria-t-il, je vous croyais dans votre famille » ; et s’adressant à son compagnon : « C’est l’ami dont je vous ai entretenu, Morley. Quelle heureuse réunion ! Asseyez-vous, cher Reding ; j’ai bien des choses à vous dire. » Charles s’assit tout en suspens, et ses yeux se fixèrent sur Willis avec une si vive anxiété, que celui-ci fut forcé de s’expliquer brièvement : « Reding, dit-il, je suis catholique. » Terrifié à ces mots, Charles se jeta en arrière sur sa chaise et pâlit. « Mon cher Reding, qu’avez-vous donc ? Pourquoi ne me parlez-vous pas ? » Vaines demandes ; Charles gardait le silence ; à la fin, se penchant en avant, les coudes appuyés sur ses genoux, et la tête dans ses mains, il dit à voix basse : « O Willis, qu’avez-vous fait ! — Ce que j’ai fait ? Ah ! ce que vous devriez faire, vous, ainsi que la moitié d’Oxford. O Reding, si vous connaissiez mon bonheur ! — Hélas ! hélas ! mais quel bien fait ici ma présence ? Soyez heureux, Willis ; adieu ! — Non, mon cher Reding, vous ne me quitterez pas si vite, étant venu me trouver si inopinément. Vous avez fait d’ailleurs une longue course. Asseyez-vous, vous êtes un brave garçon. Nous prendrons notre lunch, et vous ne nous quitterez pas sans y participer. » Tout en parlant, il prit le chapeau de Charles, et celui-ci, sous le poids de sentiments divers, le laissa faire. « O Willis, vous voilà donc séparé de nous pour toujours ; vous avez choisi votre chemin ; pour nous nous gardons le nôtre ; nos voies sont différentes. — Non, mon ami ; il faut que vous me suiviez, et nous serons encore unis. » Charles fut presque offensé. « Je dois absolument vous quitter, si vous parlez de la sorte, reprit-il, et il se leva. — Pardon, Charles, je vous prie, je ne le ferai plus ; mais je ne pouvais m’en empêcher. Je ne suis pas dans un état normal ; je suis si heureux ! »
Il vint une pensée à Reding. « Racontez-moi, Willis, votre véritable position ; en quel sens êtes-vous catholique ? Qu’est-ce qui vous empêche de revenir avec moi à Oxford ? » Le compagnon de Willis s’interposa : « Je prends peut-être une trop grande liberté, dit-il ; mais M. Willis a été régulièrement reçu dans l’Église catholique. — Je ne vous ai pas présenté, mon cher, reprit Willis. Reding, permettez-moi de vous présenter M. Morley ; Morley, monsieur Reding. Oui, Reding, je dois à monsieur d’être catholique. Nous avons fait ensemble un tour sur le continent, et nous avons rencontré en France un excellent prêtre qui a consenti à recevoir mon abjuration. — Je pense que ce prêtre aurait bien fait d’examiner l’état de votre esprit avant d’agir ainsi, reprit Charles ; Willis, vous n’êtes pas homme à devenir catholique. — Que voulez-vous dire ? — Que vous êtes plutôt un dissident qu’un catholique. Je vous demande pardon, ajouta-t-il, voyant le regard animé de Willis, mais permettez-moi d’être franc. Vous vous êtes attaché à l’Église de Rome, non comme un enfant à sa mère, mais comme un esprit fantasque et vagabond. Vous en avez fait une affaire d’imagination, de goût ; ou bien, excusez-moi, vous avez agi comme un enfant gourmand vis-à-vis d’un objet qui le tente, et vous avez poursuivi votre but en désobéissant aux autorités établies. » Poussé à bout par ce langage, Willis répliqua qu’il croyait se rappeler un texte qui proclamait qu’il vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes. « Je vois que vous avez désobéi aux hommes, repartit Charles ; j’espère que vous avez obéi à Dieu. » Willis le trouva brusque et ne voulut pas répondre.
M. Morley prit la parole : « Si vous connaissiez mieux les circonstances, dit-il, vous jugeriez différemment sans doute. Je regarde M. Willis comme étant précisément l’homme pour qui c’était un devoir de se réunir à l’Église, et il fera un très-bon catholique. S’il y a quelqu’un qui mérite des reproches, c’est moi que vous devez blâmer, et non le vénérable prêtre qui a reçu son abjuration. L’excellent homme voyait sa piété, ses larmes, son humilité, son désir ardent ; mais il n’a connu l’état de son esprit que par moi qui parlais mieux le français que Willis. Il a eu, toutefois, assez de conversations avec lui en français et en latin. Il ne pouvait rejeter une âme qui lui demandait de la sauver ; c’était impossible. Si vous aviez été à sa place, vous auriez agi de même. — Soit, monsieur ; peut-être ai-je été injuste à son égard et envers vous, reprit Charles ; néanmoins, je n’augure pas bien de cette conduite. — Vous jugez, monsieur, permettez-moi de vous le dire, de choses que vous ne connaissez pas, répondit M. Morley. Vous ignorez ce que c’est que la Religion Catholique ; vous ne savez pas ce qu’est la grâce ou le don de la foi. » L’interlocuteur était laïque ; il parlait avec une force d’autant plus pénétrante qu’elle était calme. Charles sentit un blâme indirect dans le ton de M. Morley. Sa bonne éducation lui fit comprendre qu’il avait été trop violent en présence d’un étranger ; cependant, il ne se sentait pas moins sûr de sa cause. Il se tut avant de répondre ; puis il ajouta en peu de mots, qu’il ne connaissait pas l’Église Romaine, mais qu’il connaissait M. Willis. Il ne pouvait s’empêcher d’exprimer son opinion sur le funeste résultat de cette affaire. « J’ai toujours été catholique, reprit M. Morley ; ainsi, je ne puis porter un jugement sur les membres de l’Église anglicane ; mais ce que je sais, c’est que l’Église Catholique est la seule véritable. Je puis me tromper en bien des choses, je ne puis errer sur ce point. D’autre part, je sais que la foi catholique est une, et qu’aucune autre Église n’a la foi. L’Église d’Angleterre n’a pas la foi. La foi, vous ne l’avez pas non plus, mon cher monsieur. »
M. Morley venait de frapper un grand coup. Les controverses d’Oxford revinrent en ce moment à l’esprit de Charles ; mais il retrouva aussitôt son aplomb. « Vous ne vous attendez pas, je pense, dit-il en souriant, que moi, qui suis encore un enfant, je sois en état d’argumenter avec vous, de défendre mon Église, ou d’expliquer sa foi. Je suis content de garder cette foi, de croire ce qu’elle croit, sans faire profession d’être théologien. Cette doctrine est celle que j’ai apprise à Oxford. N’étant qu’un simple étudiant, quel peut être mon bagage scientifique ? Peu de chose. Excusez-moi donc, monsieur, si je refuse la controverse avec vous. Il était naturel que j’argumentasse avec Willis ; nous sommes égaux, et nous nous comprenons l’un l’autre ; mais, je le répète, je ne suis pas théologien. — Mon cher Reding, s’écria Willis à ces mots, je vous dis seulement, venez et voyez. Ne restez pas à la porte, occupé de syllogismes ; mais pénétrez dans la grande demeure de l’âme, entrez et adorez. — Mais, répliqua Charles, certainement, Dieu veut que nous nous laissions guider par la raison. Je ne veux pas dire que la raison est tout, mais du moins elle est quelque chose. Évidemment, nous ne pouvons agir sans elle ou contre elle. — Mais le doute n’est-il pas un état épouvantable ? un état très-périlleux ? Oui, il n’y a de sûr que l’état de foi. Or, avez-vous la foi, dans votre Église ? Je vous connais assez pour affirmer que vous ne l’avez point : où donc en êtes-vous ? — Willis, vous m’avez très-mal compris ; dix mille pensées traversent l’esprit, et en admettant même qu’il soit sage de tourner contre un homme quelques-unes de ses paroles, peut-on regarder comme des convictions tout ce qui sort de sa bouche ? Cela, me semble-t-il, ne serait pas juste. Vous devez faire allusion à quelques mots que j’ai oubliés, et qui n’étaient pas l’expression réelle de mes sentiments. Voulez-vous dire que je n’ai pas de culte ? Et le culte ne suppose-t-il pas la foi ? J’ai beaucoup à apprendre, j’en suis convaincu ; mais c’est auprès de l’Église qui protégea mon berceau et qui répond à mes besoins, que je veux m’instruire des choses divines. — Il avoue qu’il n’a pas la foi ; il avoue qu’il est dans le doute. Mon cher Reding, pouvez-vous, consciencieusement, soutenir que vous êtes dans une ignorance invincible après ce qui s’est passé entre nous ? Or, supposez, pour une seconde, que le Catholicisme est vrai, n’est-il pas certain que vous avez présentement une occasion de l’embrasser ? Et si vous ne le faites pas, êtes-vous dans un état où vous pourriez mourir en sûreté ?
Reding était embarrassé, c’est-à-dire qu’il ne pouvait analyser et traduire assez promptement en paroles la réponse que sa raison lui suggérait aux interrogations rapides de Willis. M. Morley avait gardé le silence, de peur que Charles n’eût à la fois deux adversaires à combattre. Mais voyant que Willis se taisait et que Charles ne répliquait pas, il prit la parole. Il dit que, dans l’Écriture, tous ceux qui avaient été appelés avaient obéi promptement, et que Notre-Seigneur n’avait pas voulu même permettre à un jeune homme d’aller ensevelir son père. Charles répondit que dans ce cas la voix du Christ s’était fait positivement entendre ; il était sur la terre dans un corps visible ; mais, maintenant, la question véritable était : Quelle est la voix du Christ ? et puis, l’Église de Rome parle-t-elle, oui ou non, la parole du Christ ? Évidemment nous devions agir avec prudence ; le Christ ne pouvait désirer que nous agissions autrement. Quant à lui, il n’avait pas de doute qu’il ne fût où la Providence le voulait ; mais alors même qu’il aurait des doutes pour savoir si le Christ l’appelait autre part (pure hypothèse pour le moment), il avait la conviction que le divin maître l’appellerait par la voix et la méthode d’un examen sérieux. Cette prudence était le moyen divinement établi pour arriver à la vérité. — Prudence ! s’écria Willis, une prudence comme celle de saint Thomas, je suppose, lorsqu’il voulut voir avant de croire. » Charles hésitait pour répondre. « Je le vois », continua Willis ; et, se levant debout, il saisit le bras de Reding : « Venez, mon cher ami, venez avec moi tout de suite ; allons trouver un bon prêtre qui demeure à deux pas d’ici. Vous serez reçu aujourd’hui même. Mettez votre chapeau. » Et avant que Charles pût montrer de la résistance, il était déjà à moitié hors de la chambre. Il ne put s’empêcher de rire, malgré cette vexation. Il dégagea son bras, et s’assit résolument : « Pas si vite, dit-il, nous ne sommes pas tout à fait de cette espèce de gens. » Willis parut un moment embarrassé. « Soit, dit-il ensuite, du moins vous devez aller en retraite ; vous devez y aller sur-le-champ. Morley, savez-vous quand M. de Mowbray ou le père Augustin donnera sa prochaine retraite ? Reding, c’est précisément ce qui vous manque, et ce dont tout Oxford a besoin. J’espère que vous ne me refuserez pas. » Charles le regarda en face et sourit. « Ce n’est pas ma ligne de conduite, dit-il enfin. Je me rends à Oxford ; rien ne peut m’empêcher d’y aller. Je suis venu ici pour vous rendre service ; je ne puis y réussir, je m’en vais donc. Si je pouvais vous être utile… mais il n’y a plus d’espoir. Oh ! cela me fait mal au cœur. » Et il se mit à frotter son chapeau avec ses gants, comme s’il était sur le point de se lever, tout en ayant de la peine à le faire.
Morley entra alors en lice. Il parla tout le temps comme un homme de bonne éducation et d’une vraie piété, mais avec une grande ignorance des protestants, ou de la manière dont on doit les traiter. « Excusez-moi, monsieur Reding, dit-il, si, avant votre départ, j’ajoute encore un mot. Je suis très-sensible à la lutte qui assiégé votre esprit, et je vous assure que ce n’est pas à moi de vous parler avec sévérité ou rigueur. La lutte entre une conviction et les motifs terrestres est souvent très-longue ; puisse-t-elle avoir bientôt une heureuse fin en vous ! Ne vous offensez point si je vous rappelle que les plus chers et les plus forts liens, tels que ceux qui vous rattachent à l’Église protestante, peuvent être dans certains cas sur la lisière des motifs terrestres. C’est une espèce de martyre d’avoir à rompre de tels nœuds ; mais ceux qui ont ce courage reçoivent la récompense des martyrs. Et puis, à l’Université vous respirez une atmosphère qui sert à entretenir le cours habituel de vos pensées ; l’avenir, les succès dans sa carrière, la bonne opinion des amis, voilà ce qui préoccupe à Oxford ; et toutes ces choses conspirent contre vous. Elles doivent étouffer la bonne semence. Eh bien, j’aurais désiré que vous eussiez été capable de suivre d’un seul coup le dictamen de la conscience. Mais la lutte doit se prolonger tout le temps marqué ; espérons que tout finira bien. »
— Je ne puis persuader à ces braves gens, pensait Charles, en fermant la porte d’entrée, que je ne suis pas dans un état de conviction ni de lutte contre cette conviction ; quelle absurdité ! Je viens ici pour rappeler un déserteur, et je suis moi-même appréhendé au corps, et, contre ma volonté formelle, on me pousse à la hâte à une profession de foi. Est-ce que ces choses arrivent tous les jours, ou est-ce ma destinée, à moi, d’être ainsi jeté au milieu de controverses pour lesquelles je ne suis pas prêt ? Moi ! Catholique Romain ! Quel contraste avec la quiétude de Hartley (c’était le nom de la demeure paternelle) ! » A mesure qu’il continuait à penser à la scène qui venait d’avoir lieu, il en était moins satisfait, ou pour mieux dire, moins content de lui-même. Il était venu pour faire la leçon à Willis, et c’était lui qu’on avait sermonné ; il avait d’ailleurs laissé entrevoir l’état secret de son esprit ; mais non, il n’avait rien dévoilé. Sans doute, il avait donné à entendre qu’il cherchait la vérité religieuse, mais tout Protestant cherche ; il n’aurait pas été Protestant s’il n’avait pas agi de la sorte. Naturellement il cherchait la vérité ; c’était là son devoir ; il se rappelait parfaitement que son tuteur lui avait démontré, dans une certaine circonstance, le devoir du jugement privé. C’est en cela que consiste la différence entre les Protestants et les Catholiques ; les Catholiques commencent par la foi, les Protestants par l’examen ; et voilà ce qu’il aurait dû dire à Willis. Il était fâché de ne l’avoir pas dit ; cela aurait simplifié la question, et démontré combien il était loin d’être chancelant. Chancelant ! quelle extravagance ! Il aurait bien voulu que cette pensée lui fût venue pendant la conversation ; c’était, toutefois, un adoucissement qu’elle lui vînt à cette heure : elle justifiait sa position.
Le premier jour du trimestre de la Saint-Michel est le plus brillant de l’année, pour un étudiant, en ce qui touche à l’ameublement de sa chambre. Quoique Charles regrettât la maison paternelle, il se réjouissait de revoir le vieil Oxford. A son entrée au collége, le portier l’avait reconnu, et son domestique lui avait souri, en le saluant comme il montait l’escalier aux marches usées. Pour lui souhaiter la bienvenue, un feu magnifique brûlait dans le foyer ; le charbon pétillait, se divisait et lançait une flamme blanche qui contrastait avec les barres et les plaques de la grille, nouvellement noircies. Une bouilloire de cuivre toute luisante sifflait et gémissait sous l’action intérieure de l’eau en ébullition. La glace de la cheminée avait été nettoyée, le tapis battu, les rideaux fraîchement lustrés. Un plateau à thé et ses accessoires étaient sur la table ; on y voyait en outre la note du trimestre, deux ou trois cartes de marchands qui désiraient sa pratique et une lettre d’un ami qui l’avait précédé à Oxford. Le portefaix arriva avec ses malles, et il venait de recevoir une large rétribution, lorsque, au moment que la porte se fermait, Sheffield s’élança dans la chambre en habit de voyage.
« Eh bien, mon vieux, comment va la santé ? » s’écria-t-il, en secouant de toutes ses forces les deux mains de Charles, ou plutôt ses bras. « Nous voici donc de retour ; j’arrive à l’instant, comme vous. Où avez-vous passé vos vacances ? Allons, racontez-nous toute votre histoire. Mais donnez-moi d’abord du thé, et devisons ensuite de bonne et joyeuse humeur. » Charles aimait Sheffield, il aimait Oxford, il était content d’être revenu ; toutefois, il lui restait un peu de mal du pays, et il n’était pas en train de s’harmoniser à la turbulence de la bonne nature de Sheffield ; d’ailleurs, la conversation avec Willis pesait encore sur son esprit. « Avez-vous appris les nouvelles ? continua Sheffield : j’ai déjà passé assez de temps dans le collége pour les recueillir. Jack, mon ami, Jack le marmiton, en était tout occupé au moment que j’entrais, et Jack est un brave et honnête garçon qui sait tous les cancans de la ville. J’ignore ce que cela signifie, mais Oxford, à cette heure, a un très-vilain intérieur. Le bruit court que quelques personnes se sont converties à l’Église de Rome, et l’on dit qu’il y a dans ces murs des étrangers sur le compte desquels plane le mystère. Jack, qui est lui-même un peu théologien, rapporte qu’il a entendu le Principal donner pour certain qu’au fond de tout ceci il y avait des Jésuites ; et je ne sais ce qu’il veut dire, mais il déclare qu’il a vu de ses propres yeux le Pape se promener dans High Street avec un prêtre. Je lui ai demandé comment il l’avait reconnu. Il m’a répondu qu’il avait connu le Pape à son chapeau rabattu et à sa longue barbe ; et d’ailleurs, le portier lui avait assuré que c’était le Pape. A ce qu’il paraît, les dons se sont réunis plusieurs fois ; on raconte que certains tuteurs seront privés de leur droit à la ration, et que leurs noms seront affichés à la porte du magasin à beurre. On assure encore que le Maréchal[50] monte la garde devant la chapelle catholique avec deux bouledogues[51]. Enfin, pour compléter les nouvelles, on rapporte malicieusement, que ce vieil ivrogne de Topham, ayant été appelé pour couper les cheveux au gardien de Sainte-Marie, lui a fait sur le sommet de la tête une belle et blanche tonsure.
[50] Espèce d’huissier.
[51] Dans l’argot des étudiants d’Oxford, deux domestiques des Censeurs.
— Mon cher Sheffield, comme vous y allez ! repartit Charles. Eh bien, moi, je puis vous donner quelques vraies nouvelles qui se rapportent à ces bruits, et elles ne sont pas des plus agréables. Avez-vous connu Willis de Saint-George ? — Je pense l’avoir vu une fois chez vous ; c’est un jeune homme modeste, au regard doux, et qui ne lâchait jamais une parole. — Oh ! je vous assure qu’il a assez de langue quand ça lui convient, reprit Charles ; je crois, cependant, ajouta-t-il d’un ton réfléchi, qu’il est fort changé, mais ce n’est pas en mieux. — Eh bien, quel est le fin mot ? — Il s’est fait catholique. — Quel fou ! » Il y eut un moment de silence. Charles se sentit embarrassé. « Je ne puis pas dire, reprit-il ensuite, que j’aie été surpris ; cependant, je l’aurais été moins, si c’eût été White. — Oh ! White ne deviendra pas catholique ; ce n’est pas dans son sang. C’est un poltron. — Des fous et des poltrons ! c’est donc ainsi que vous divisez le monde, Sheffield ? Pauvre Willis ! on doit cependant respecter un homme qui agit selon sa conscience. — Sa conscience ! mais qu’en sait-il de sa conscience ? repartit Sheffield. Quoi ! l’idée d’absorber librement le tas de vieilleries que tout catholique doit croire ! De sang-froid se mettre un collier autour du cou, et déposer poliment sa chaîne entre les mains d’un prêtre… Et puis le confessionnal ! C’est merveilleux ! » Et il se mit à briser le charbon avec le tisonnier. « Tout cela est très-bien, continua-t-il, si l’on est né catholique ; quoique je ne suppose pas que les Papistes croient réellement tout ce qu’ils sont obligés de professer ; mais qu’un Anglais, un gentleman, un homme d’Oxford, jouissant de tant de prérogatives, puisse se nourrir ainsi d’immondices, remuer et ramasser les mensonges morts des siècles de ténèbres : c’est un prodige ! »
« — Eh bien, s’il y avait une chose qui pût me faire estimer la Religion Romaine, reprit Charles, c’est précisément ce que vous détestez si fort : je donnerais deux pence[52], si un homme en qui je puisse avoir confiance voulait me dire : Ceci est la vérité. Nous serions délivrés de ces éternelles disputes. Ne seriez-vous pas heureux si saint Paul pouvait revivre ? Je me suis souvent dit à moi-même : Oh ! si je pouvais demander ceci ou cela à ce grand Apôtre ! — Mais l’Église Catholique n’est pas tout à fait saint Paul, j’imagine, reprit Sheffield. — Certainement non ; mais en supposant que vous crussiez qu’elle a l’inspiration d’un Apôtre, comme tout Catholique Romain le pense, quelle consolation ne serait-ce pas pour vous de savoir, hors de tout doute, ce que vous devez croire sur Dieu et de quelle manière vous devez l’honorer et lui plaire ! Je vous comprends, vous dites : Je ne puis croire ceci ou cela ; or, vous auriez dû dire plutôt : Je ne puis croire que le Pape a réellement le pouvoir de décider ceci ou cela ; car, s’il a ce pouvoir, il ne vous reste qu’à accepter sa décision, et ne pas dire : Je ne saurais la croire. » Sheffield regarda fixement son ami : « Nous vous verrons papiste un de ces beaux jours, reprit-il. — Sottise, repartit Charles ; vous ne devriez pas dire de pareilles choses, même en plaisantant. — Je ne plaisante pas ; je parle sérieusement : vous allez en plein sur cette route. — Eh bien, si j’y suis, c’est que vous m’y avez amené, répliqua Reding, désirant écarter au plus tôt ce sujet de controverse ; car c’est vous qui m’avez toujours parlé contre le charlatanisme, et qui vous moquiez du roi Charles et de Laud, de Bateman et de White, des jubés et des piscines. »
[52] Vingt centimes.
« Maintenant vous voilà Puséiste, repartit Sheffield un peu déconcerté. — Vous me donnez là, mon cher ami, le nom d’un excellent homme que je connais à peine de vue ; mais ce que je veux dire, c’est que personne ne sait ce qu’il faut croire, personne n’a une foi définie, excepté les Catholiques et les Puséistes ; personne ne dit : Ceci est vrai, cela est faux ; ceci vient des Apôtres, cela n’en vient pas. — Alors, vous croiriez des Turcs qui viendraient à vous avec leur « seul Allah et Mahomet son prophète ? » — Je n’ai pas dit qu’un symbole fût tout, ni qu’une religion ne pût être fausse avec un symbole ; mais une religion qui n’a pas de symbole ne peut être vraie. — Eh bien, cela ne me frappe aucunement », repartit Sheffield. Charles reprit : « Après votre départ, à la fin du trimestre, nous avons été sous la direction de Vincent ; vous savez que j’étais resté pour mon examen ; le tuteur, je dois l’avouer, s’est montré fort honnête ; oui, très-honnête. Or, j’eus un jour un entretien avec lui sur les différents partis d’Oxford, et dans le moment même il me plut beaucoup ; mais ensuite, plus je réfléchis à ses paroles, moins je fus satisfait ; en d’autres termes, je n’avais reçu de lui rien de défini. Il ne disait pas : Ceci est vrai, cela est faux, mais : « Soyez franc, soyez franc ; soyez bon, soyez bon ; n’allez pas trop loin, tenez-vous dans un juste milieu, soyez sur vos gardes, évitez les partis, suivez nos théologiens, suivez-les tous. » Ce qui se réduisait à dire : Mettez un grain de sel sur la queue de l’oiseau. J’avais besoin d’une direction pratique, et non de vérités abstraites. — Vincent est un farceur, s’écria Sheffield. — Le docteur Pusey, au contraire, continua Charles, est, assure-t-on, toujours affirmatif. Il dit : « Ceci est apostolique, cela est dans les Pères ; saint Cyprien affirme ceci, saint Augustin nie cela ; ceci est bien, cela est mal ; je vous ordonne, je vous défends. » Ce langage je le saisis ; mais je ne comprends pas qu’on m’impose des devoirs qui sont trop lourds pour mes épaules. Je ne comprends pas, je n’aime pas, qu’ayant une volonté propre, je n’aie pas les moyens de m’en servir légitimement. Dans un tel cas, me dire d’agir par moi-même, c’est imiter Pharaon qui commandait aux Israélites de faire des briques sans paille. M’ordonner de chercher, de juger, de décider, vraiment c’est absurde : qui me l’a appris ?
— Mais les Puséistes ne sont pas toujours si affirmatifs, répliqua Sheffield ; Smith, par exemple, ne parle jamais d’une manière décisive sur les questions épineuses. J’ai connu une personne qui allait passer quelques années en Italie et devait forcément se trouver à une grande distance de toute chapelle anglaise. Avant de partir, elle vint demander à Smith si elle pourrait se rendre aux églises catholiques, mais ce fut en vain ; elle ne put jamais obtenir de réponse ; notre Puséiste ne voulut pas lui donner un oui ou un non. — Dès lors, Smith n’aura pas eu beaucoup de partisans, et voilà tout. — Mais il en a plus que le docteur Pusey. — Eh bien, je ne puis le comprendre ; il ne devrait pas en avoir. Peut-être ne lui resteront-ils pas fidèles. — La vérité est, reprit Sheffield, que je le soupçonne d’être au fond un peu sceptique. — J’honore l’homme qui édifie, repartit Reding, et je méprise l’homme qui détruit. — Je suis porté, mon cher ami, à croire que vous avez une notion fausse de ces deux mots, édifier, détruire. Coventry, dans ses Dissertations, prouve d’une manière claire que le Christianisme n’est pas une religion de doctrines. — Qu’est-ce que Coventry ? — Vous ne connaissez pas Coventry ? C’est un des écrivains les plus remarquables de cette époque : il est Américain, et, je crois, congrégationaliste. Oh ! je vous l’assure, Coventry est un auteur à lire, malgré ses erreurs sur le gouvernement de l’Église. Vous ne serez bien au courant de la littérature du jour, que lorsque vous aurez fait connaissance avec lui. Ce n’est pas un homme de parti ; il correspond avec les premiers personnages de l’époque. Lorsqu’il était en Angleterre, il a logé chez le doyen d’Oxford, qui a publié une édition anglaise de ses Dissertations, avec préface. Lui et lord Newlights étaient regardés comme les deux hommes les plus spirituels au meeting de l’Association Britannique, il y a deux ans. — Je n’aime pas lord Newlights, dit Charles ; il me semble qu’il n’a pas de principes, de principes religieux fixes et définis. On ne sait où le saisir. Telle est l’opinion de mon père ; je l’ai entendu souvent parler de Newlights. — Il est étrange que vous vous serviez du mot principes, reprit Sheffield ; car c’est précisément le point sur lequel Coventry insiste avec force. Il dit que le Christianisme n’a pas de symbole ; que c’est là le caractère principal par où il se distingue des autres religions ; que vous chercheriez en vain un symbole dans le Nouveau Testament ; mais que l’Écriture est pleine de principes. L’idée est très-ingénieuse, et m’a paru vraie, quand j’ai lu son livre. D’après lui, donc, le Christianisme n’est pas une religion de doctrines ni de mystères ; et si vous cherchez du dogmatisme dans l’Écriture, vous êtes dans l’erreur. » Charles était troublé. « Certainement, dit-il, à première vue, il n’y a pas de symbole dans l’Écriture… Pas de symbole dans l’Écriture ? répéta-t-il lentement, comme s’il eût pensé tout haut. Pas de symbole dans l’Écriture, donc il n’y a pas de symbole. Mais le Symbole d’Athanase, ajouta-t-il avec empressement, est-il dans l’Écriture ? Il est dans l’Écriture ou il n’y est pas ; voyons. Que soutenait Freeborn le trimestre dernier ?… Dites-moi, Sheffield, le doyen d’Oxford affirme-t-il que le symbole se trouve dans l’Écriture ou qu’il n’y est pas ? Peut-être n’exposez-vous pas bien l’idée de Coventry ; quel est votre sentiment ? — Eh bien, je vous avouerai avec franchise que mon opinion, à en juger par sa préface, est que le doyen ne se ferait pas scrupule de dire que le symbole n’est pas dans l’Écriture, mais que c’est une addition scolastique. — Mais quoi ! mon cher ami, voudriez-vous donner à entendre que lui, dignitaire de l’Église, tiendrait le Symbole d’Athanase pour une erreur, parce qu’il représente le Christianisme comme une révélation de doctrines ou de mystères qu’on doit accepter par la foi ? — Je puis me tromper, répondit Sheffield ; mais c’est ainsi que je l’ai compris. — Après tout, reprit Charles tristement, ce n’est pas beaucoup plus étrange que ce qu’un autre doyen, dont j’ai oublié le nom, prêchait à Sainte-Marie avant les vacances ; cela fait partie du même système. Le fait eut lieu après votre départ, ou vers la fin du trimestre. Vous n’allez pas aux sermons ; j’ai envie de ne pas y aller, non plus. Je ne puis entrer dans l’argumentation du doyen ; cela n’en vaut pas la peine. Eh bien, ajouta-t-il en se levant et en étirant ses bras, je suis fatigué ; en soi, pourtant, la journée n’a pas été très-dure ; mais Londres est une ville si bruyante ! — Vous désirez que je vous souhaite le bonsoir », dit Sheffield. Charles ne rejeta pas le compliment, et les deux amis se séparèrent.
Pour la tranquillité de l’esprit de Charles, il ne pouvait y avoir de cours plus fâcheux que celui auquel il assista pendant ce trimestre ; cependant, telle est notre ignorance de l’avenir, qu’il le salua avec bonheur, comme s’il devait lui apporter une réponse à toutes les perplexités dans lesquelles avaient concouru à le jeter, chacun à leur manière, Sheffield, Bateman, Freeborn, White, Willis, M. Morley, le docteur Brownside, M. Vincent et l’état général d’Oxford. Notre jeune ami avait fait preuve de tant de moyens dans la première partie de l’année, et il avait étudié avec tant de zèle, que ses tuteurs l’envoyèrent prématurément au cours des Articles. Ce cours était de premier ordre, vu surtout que le tuteur qui le donnait était parfaitement maître de sa matière. Il savait toute l’histoire des Articles[53] ; il pouvait dire comment ils étaient arrivés à la forme actuelle, par quelles vicissitudes ils étaient passés, les additions qu’on y avait faites, l’époque de ces additions, et enfin ce qu’on en avait retranché. A cette érudition se joignait naturellement une explication du texte déduite, autant que possible, de l’exposé historique ainsi donné. Le professeur faisait intervenir, en outre, dans le cours tous les Réformateurs anglais et étrangers ; et rien n’y manquait, au moins dans sa pensée, pour fortifier un jeune étudiant dans la croyance et la discipline de l’Église d’Angleterre.
[53] Les XXXIX Articles furent rédigés en 1562 et confirmés par la reine et les évêques en 1571.
Or, tel ne fut pas l’effet produit sur Reding. Soit qu’il eût formé des espérances exagérées, soit pour toute autre cause, il arriva qu’il n’éprouva que plus vivement le sentiment du vieux père de la comédie, après la consultation des avocats : Incertior sum multo quam ante. Il vit que la profession de foi contenue dans les Articles n’était qu’un amalgame de morceaux d’orthodoxie, de luthéranisme, de calvinisme, de zwinglianisme, et tout cela ne reposant sur aucun principe. Il vit que cette profession n’était que l’œuvre du hasard, si toutefois le hasard existe ; qu’elle avait revêtu cette forme particulière dans laquelle l’Église d’Angleterre la reçoit aujourd’hui, alors qu’elle aurait pu en prendre toute autre ; et qu’il n’y avait pas de raison pour que les Anglicans de ce jour ne fussent pas Calvinistes, Presbytériens, ou Luthériens aussi bien qu’Épiscopaux. Ce fait historique ne faisait que centupler la difficulté, ou plutôt l’impossibilité de dire quelle était la foi de l’Église d’Angleterre. Presque sur chaque point de la controverse, le texte de la doctrine était vague ou contradictoire, et il y avait un poids imposant de témoignages extérieurs en faveur d’interprétations opposées. Il s’arrêta une ou deux fois, après le cours, pour demander des renseignements à M. Upton, le tuteur, qui était très-disposé à les lui fournir ; mais ses démarches n’aboutirent à rien, en ce qui regarde l’objet qu’il avait en vue.
Une difficulté particulière tourmentait Charles ; c’était de savoir, si, selon les Articles, la vérité divine nous était transmise directement, ou si nous avions à la chercher nous-mêmes dans l’Écriture. Plusieurs Articles éveillaient en lui ce doute. Il le proposa à son tuteur, et M. Upton, ecclésiastique de la Haute Église, lui répondit que la doctrine du salut ne nous était pas transmise, que nous n’avions pas à la chercher, non plus, mais qu’elle nous était proposée par l’Église, et que c’était à l’individu à se la prouver. Charles ne comprenait pas cette distinction entre chercher et prouver ; car comment pouvons-nous prouver, sinon en cherchant les raisons (dans l’Écriture) ? Il présenta sa proposition sous une autre forme. Il demanda si la Religion Chrétienne permettait le jugement privé ? Ce n’était pas là une question abstraite, mais bien pratique. S’il avait fait la même question à un Wesleyen ou à un Indépendant, il aurait obtenu une réponse absolue dans le sens affirmatif ; s’il l’avait faite à un Catholique, celui-ci lui aurait dit que nous usons de notre jugement privé pour trouver l’Église, et qu’ensuite l’Église le remplace ; mais il ne put obtenir une réponse claire de ce théologien d’Oxford. D’abord, on lui dit que certainement nous devons user de notre jugement privé dans la détermination de la doctrine religieuse ; mais ensuite on lui assura que c’était un péché (comme indubitablement c’en est un) de mettre en doute la doctrine de la Sainte-Trinité. Or, tandis que, d’une part, on lui disait que douter de cette doctrine c’était un péché, dans une autre conversation on lui soutenait que notre état le plus haut, ici-bas, c’est l’état de doute. Qu’est-ce que cela voulait dire ? Assurément la certitude était de toute nécessité sur quelques points, comme par exemple sur l’objet du culte ; comment pouvons-nous honorer d’un culte ce dont nous doutons ? Les deux actes étaient d’ailleurs mis en contraste par l’Évangéliste : « Lorsque les disciples virent Notre-Seigneur après sa résurrection, il l’adorèrent, mais quelques-uns doutaient. » Toutefois, malgré ce fait, on disait à Charles qu’il y avait de « l’impatience » dans la seule idée de désirer la certitude.
Dans une autre circonstance, notre jeune étudiant demanda si les anathèmes du Symbole d’Athanase s’appliquaient à toutes ses clauses ; par exemple, s’il était nécessaire au salut de croire qu’il y a « unus æternus », comme porte le latin ; ou « tel le Père… tel le Saint-Esprit » ; ou que l’Esprit-Saint est « par lui-même Dieu et Seigneur » ; ou que le Christ est Un « par l’assomption[54] de l’humanité en Dieu ». Il ne put obtenir de réponse. M. Upton lui dit qu’il n’aimait pas les questions poussées à l’extrême ; qu’il ne pouvait et qu’il ne désirait pas y répondre ; que le Symbole avait été écrit comme une espèce de protestation contre des hérésies qui n’existaient plus. Reding demanda si cela voulait dire que le Symbole ne contient pas une manière de voir distincte, à lui propre, qui seule est sûre, ou si cela voulait dire qu’il est simplement une négation de l’erreur. « Les clauses, observa-t-il, en sont positives et non négatives. » Il ne put obtenir d’autre réponse, sinon que ce Symbole enseigne que les doctrines de « la Trinité » et de « l’Incarnation » sont « nécessaires au salut », tout en laissant évidemment incertain ce en quoi consistent ces doctrines.
[54] Il faut prendre ce mot dans le sens du latin, assumptio.
Un autre jour il demanda comment les péchés graves commis après le baptême étaient pardonnés. Était-ce par la foi, où ne l’étaient-ils pas du tout en cette vie ? On lui répondit que les Articles n’en disaient rien ; que la doctrine papiste sur le pardon et sur le purgatoire était erronée, et qu’il ferait bien d’écarter et les questions curieuses et les réponses subtiles.
A un autre cours, une nouvelle question se présenta, savoir : si, par la présence réelle on entendait une présence du Christ dans les éléments, ou dans l’âme, c’est-à-dire dans la foi du communiant ; en d’autres termes, si la présence était réellement telle, ou si elle n’était qu’un simple nom. M. Upton déclara que c’était une question en litige. Un jour, Charles demanda si le Christ était présent en fait, ou seulement par ses effets. M. Upton répondit sans hésiter : « Par ses effets », ce qui, aux yeux de Reding, signifiait qu’il n’y avait pas du tout de présence réelle.
Charles avait eu quelque peine à accepter la doctrine des châtiments éternels ; elle lui paraissait le point le plus ardu de la Révélation. Puis il se dit à lui-même : « Mais qu’est-ce que la foi dans sa véritable notion, si ce n’est une acceptation de la parole de Dieu, alors que la raison semble lui être opposée ? Comment la foi existerait-elle, s’il n’y avait rien pour l’éprouver ? » Cette pensée le satisfit complétement. La seule question à résoudre était : Ce dogme fait-il partie de la parole révélée ? « Je puis l’accepter, se dit-il, s’il est certain pour moi que je suis obligé de le croire : mais si je n’étais pas tenu de le croire, je n’aurais pas la force de l’admettre. » C’est pourquoi il demanda à M. Upton si c’était une doctrine de l’Église d’Angleterre ; si la croyance en était exigée par les Articles. Il ne put obtenir de réponse. Cependant s’il ne croyait pas ce dogme, il sentait tout l’édifice de sa foi trembler sous ses pieds. Immédiatement après vint la doctrine de l’expiation.
Il est difficile d’apporter des exemples de ce genre, sans faire naître dans l’esprit du lecteur cette idée que Charles était hardi et captieux dans ses questions. M. Upton, néanmoins, tout en gardant son opinion sur Reding, n’attribua jamais cette manière d’agir à l’orgueil, ni à l’oubli du respect qui lui était dû à lui-même.
Naturellement Charles était préoccupé de son sujet, et il aurait voulu faire part de ses perplexités à Sheffield, s’il n’avait fortement redouté de rendre ainsi la chose pire. Il pensa que Bateman pourrait lui être de quelque utilité, et il s’ouvrit à lui dans une promenade qu’ils firent ensemble à la campagne. Que devait-il faire ? A son arrivée à Oxford, on lui avait dit que lorsqu’il prendrait ses grades il aurait à signer les Articles, non sur la foi, mais sur la raison ; les Articles, pourtant, étaient incompréhensibles : et comment pouvait-il se prouver ce qu’il ne pouvait s’expliquer ?
Bateman paraissait peu disposé à entamer cette matière : « Oh ! mon cher ami, dit-il enfin, vous êtes vraiment dans un état de surexcitation d’esprit ; je n’aime pas à vous parler maintenant, vous ne verrez pas les choses d’une manière droite et claire, vous ne les prendrez pas dans leur sens naturel. Quel fantôme allez-vous évoquer ! Vous assistez, dans votre seconde année, au cours des Articles, et à peine avez-vous commencé, que vous songez à ce que vous penserez ou ne penserez pas à la fin de vos études. Ne demandez rien sur les Articles présentement : attendez, au moins, que vous ayez fini le cours. — Je n’ai pas l’habitude de faire de l’embarras ni de me tourmenter, repartit Charles, quoique, je l’avoue, je ne sois pas tranquille comme je devrais l’être. J’entends exprimer tant d’opinions différentes dans les conversations ! Et si je suis à l’église, que vois-je ? le prédicateur attaquer violemment son confrère ; en dernier lieu, je me mets à l’étude des Articles, et, en vérité, je ne puis voir ce qu’ils enseignent. Par exemple, je ne puis saisir leur doctrine sur la foi, les sacrements, la prédestination, l’Église, l’inspiration de l’Écriture. Et, d’ailleurs, leur langage est si en désaccord avec le Prayer-Book ! Upton a démontré tout cela de la manière la plus évidente, dans son cours. — Mon très-respectable ami, reprit Bateman, songez un instant aux grands hommes qui ont signé les Articles. Peut-être le roi Charles lui-même, Laud bien certainement, tous les grands évêques de l’époque, et ceux de la génération suivante. Songez au très-orthodoxe Bull, au savant Pearson, à l’éloquent Taylor, à Montague, à Barrow, à Thorndike, au bon évêque Horne et à Jones de Nayland. Ne pouvez-vous pas faire ce qu’ils ont fait ? — L’argument est très-fort, répondit Charles ; je l’ai senti ; vous voulez donc dire que je dois signer sur la foi ? — Oui, sans doute, si c’est nécessaire. — Et comment dois-je signer quand je passerai maître, ou lorsque je recevrai les ordres ? — Voilà ce que j’appelle se tourmenter gratuitement. Vous n’êtes pas content de votre jour présent, vous vous transportez à cinq années en avance. » Charles se mit à rire. « Ce n’est pas tout à fait cela, dit-il, je voulais seulement connaître votre opinion ; toutefois, il y a là du vrai. » Et il changea de sujet.
Pendant quelque temps, ils parlèrent de choses insignifiantes, mais, après une pause, les pensées de Charles revinrent aux Articles. « Dites-moi, Bateman, reprit-il, comme simple sujet de curiosité, de quelle manière vous avez souscrit, quand vous avez pris vos grades. — Oh ! je n’eus pas du tout d’embarras, répondit Bateman ; les exemples de Bull et de Pearson : me suffisaient. — Alors vous avez signé sur la foi. — Pas précisément, mais ce fut cette pensée qui aplanit toutes les difficultés. — Auriez-vous pu signer sans cela ? — Comment pouvez-vous me faire cette question ? Évidemment. — Eh bien, dites-moi alors quel était votre motif. — Oh ! des motifs ! j’en avais beaucoup. Mais je ne puis me rappeler à la minute de choses déjà passées depuis quelque temps. — Avouez-le, c’était une matière de difficulté ; vous venez de le dire tout à l’heure. — Pas du tout ; ma difficulté ne tombait pas sur mon opinion personnelle, mais sur la manière de présenter la matière à d’autres. — Quoi ! est-ce qu’on vous tenait pour suspect ? — Non, non, vous êtes complétement dans l’erreur. Voici ma pensée : par exemple, un Article dit que nous sommes justifiés par la foi seule. Or, le sens protestant de ce passage est un point contraire à la doctrine de nos grands théologiens. La question était de savoir ce que je devais répondre quand on me demanderait mon opinion sur cet Article. — Je comprends, dit Charles ; à présent, expliquez-moi comment vous avez résolu le problème. — Eh bien, je ne nie pas que le sens protestant ne soit hérétique, répondit Bateman, ni que tel ne soit le caractère de beaucoup d’autres choses dans les Articles ; mais il n’est pas nécessaire de les prendre dans le sens protestant. — Alors, dans quel sens ? — Eh bien, d’abord, il n’est pas nécessaire de les prendre dans un sens quelconque. Ne riez pas ; écoutez. De graves autorités, comme Laud et Bramhall, paraissent avoir admis que nous signons les Articles seulement comme des articles de paix ; non pas comme les acceptant en réalité, mais comme n’y étant pas opposés. C’est pourquoi, lorsque nous signons les Articles, nous ne faisons que nous engager à ne pas prêcher contre eux. » Reding réfléchit. « Bateman, dit-il ensuite, est-ce que cette manière d’interpréter la signature des Articles ne permettrait pas aux Unitaires d’entrer dans l’Église ? » Bateman l’avoua, mais la Liturgie les en tiendrait éloignés. Charles fit observer qu’ils pourraient prendre également la Liturgie comme une Liturgie de paix.
Bateman reprit de nouveau : « Si vous avez besoin d’un principe palpable pour l’interprétation des Articles et de la Liturgie, je puis vous en donner un. Vous savez, continua-t-il après un court silence, ce que nous acceptons ? eh bien, nous donnons aux Articles une interprétation catholique. » Charles prit un air attentif. « Il est clair, continua Bateman, qu’aucun écrit ne peut être une lettre morte ; il doit être l’expression de la pensée de quelqu’un ; et la question est de savoir de qui est ce qu’on peut appeler la voix qui s’exprime par les Articles. Or, si les évêques, si les chefs des établissements, les autorités et autres dignitaires étaient unanimes dans leurs vues religieuses, et que tous, comme un seul, dissent : « Les Articles signifient ceci et non cela », en vertu de leur position, ils en seraient les interprètes légitimes ; et les Articles auraient le sens que ces messieurs leur donneraient. Mais ceux-ci ne sont pas d’accord entre eux ; quelques-uns même sont diamétralement opposés aux autres. L’un rejette la succession apostolique, l’autre la soutient ; celui-ci repousse la justification luthérienne, celui-là l’admet ; un premier nie l’inspiration de l’Écriture, un second regarde Calvin comme un saint, un troisième considère la doctrine de la grâce sacramentelle comme une superstition, un quatrième se fait le partisan de Nestorius contre l’Église, un cinquième est Sabellien. Il est donc évident que les Articles n’ont aucun sens, si l’on doit tenir compte de la voix collective des évêques, des doyens, des professeurs et autres. Ceux-ci ne peuvent suppléer ce que les scolastiques appelleraient la forme des Articles. Mais peut-être les auteurs eux-mêmes des Articles pourront suppléer cette forme ? Nullement ; car, d’abord, nous ne connaissons pas d’une manière certaine ces auteurs ; et puis, les Articles ont passé par tant de mains et par tant de corrections, que quelques-uns au moins des auteurs primitifs ne voudraient pas en prendre la responsabilité aujourd’hui. Venons-en aux assemblées qui les ratifièrent. Mais elles aussi étaient de sentiments différents ; le dix-septième siècle ne soutint pas la doctrine du seizième. Tel est l’état de la question. D’autre part, nous, nous disons que si l’Église Anglicane est une portion de l’Église Une et Catholique, elle doit nécessairement garder la doctrine catholique. C’est pourquoi, tout le Symbole Catholique, la doctrine connue des Pères, de saint Ignace, de saint Cyprien, de saint Augustin, de saint Ambroise, est la forme, le seul véritable sens et l’interprétation des Articles. Ceux-ci peuvent être équivoques en eux-mêmes ; ils peuvent avoir été rédigés avec des intentions différentes par les personnes qui les composèrent, mais ce sont des accidents : l’Église ne connaît pas les individus, elle s’interprète elle-même. »
Reding prit quelque temps pour réfléchir à ce qu’il venait d’entendre. « Tout ceci, dit-il ensuite, repose sur le principe fondamental que l’Église d’Angleterre est une partie intégrante de ce corps visible dont saint Ignace, saint Cyprien et les autres Pères étaient évêques, suivant les paroles de l’Écriture, « un seul corps, une seule foi ». Bateman en convint. Charles continua : « Dès lors les Articles ne doivent pas être considérés dans le principe comme enseignement ; en eux-mêmes, ils n’ont pas de sens ; de l’aveu général, ils sont ambigus ; ils ont été extraits de sources hétérogènes ; mais tout cela n’est rien, car tous doivent être interprétés par l’enseignement de l’Église Catholique. » Bateman approuva en somme, tout en faisant observer que Charles avait présenté la thèse d’une manière trop forte. « Mais si les Articles contredisent une doctrine des Pères, dois-je forcer la lettre ? — Si un tel cas arrivait, la théorie ne se soutiendrait pas, répondit Bateman ; ce serait seulement une farce grossière. Vous ne pourrez jamais signer un Article dans un sens que ses paroles ne comporteraient pas. Mais, heureusement, ou plutôt providentiellement, telle n’est pas notre position : nous avons simplement à expliquer des ambiguïtés et à harmoniser des divergences. L’interprétation catholique ne fait pas au texte une violence plus grande que toute autre règle ne pourrait le faire. — Je ne connais rien des Pères, reprit Charles, et je ne suis pas le seul ; comment apprendre à interpréter les Articles d’une manière pratique ? — Par le Prayer-Book ; le Prayer-Book est la voix des Pères. — Comment donc ? — Parce que le Prayer-Book est ancien, de l’aveu de tout le monde, et que les Articles sont récents. »
Charles garda de nouveau le silence : « C’est très-plausible », dit-il enfin ; et il réfléchit encore. Il demanda ensuite : « Cette manière de voir est-elle reçue ? — Aucune manière de voir n’est reçue, répondit Bateman ; les Articles seuls sont reçus, mais il n’existe absolument pas d’autorité pour leur interprétation. C’est ce que je disais tout à l’heure : évêques et professeurs ne s’accordent pas entre eux. — Mais est-ce une manière de voir tolérée ? — On l’a certainement combattue avec force ; mais elle n’a jamais été condamnée. — Ceci n’est pas une réponse, répliqua Charles, qui, à la tournure de Bateman, voyait où gisait la vérité. Y a-t-il un seul évêque aujourd’hui qui admette cette règle ? Y a-t-il jamais eu un seul évêque qui l’admît ? A-t-elle jamais été admise formellement comme soutenable par un seul évêque ? Est-ce une règle établie pour aplanir les difficultés qu’on rencontre ? A-t-elle une existence historique ? » Bateman ne put que donner une réponse à ces questions à mesure qu’elles lui étaient adressées. « Je le croyais ainsi, reprit Charles après avoir entendu cette réponse. Je connais, au reste, la personne dont vous m’avez exposé la manière de voir ; quoique je n’aie jamais entendu, avant cette heure, développer cette théorie devant moi. C’est spécieux, je l’avoue ; je ne vois pas que cette règle n’eût pu suffire, si on l’avait sanctionnée d’une manière quelconque ; mais vous n’avez pas de sanction à me montrer. Telle que la chose existe, c’est une pure théorie mise en avant par quelques individus. Notre Église pourrait avoir adopté ce mode d’interpréter les Articles : mais, d’après ce que vous dites, elle ne l’a pas fait certainement. Je suis où j’en étais. »
La pensée vint à Reding que peut-être, après tout, ce qu’on appelait la Religion Évangélique était le vrai Christianisme. Ses professeurs, il le savait, étaient des hommes actifs et influents, et avaient été beaucoup persécutés autrefois. Freeborn l’avait surpris, offensé même au déjeuner de Bateman, avant les vacances, mais Freeborn avait dans sa personne quelque chose de sérieux, et peut-être s’était-il fait mal comprendre. Cette pensée, toutefois, passa aussi vite qu’elle était venue, et il peut se faire qu’elle ne se serait plus présentée à l’esprit de notre jeune étudiant, lorsque le hasard vint lui fournir quelques données pour résoudre la question.
Une après-midi, il était à flâner au parc, en extase devant un de ces remarquables effets de lumière qui, à cette époque de l’année, sont fréquents dans le voisinage d’Oxford : tandis que le soleil descendait vers l’horizon, la lumière colorait d’une teinte or pale et brun Marston, Elsfield et leurs petits bosquets à demi dépouillés de leur feuillage. Tout à coup Charles se trouva surpris et abordé par ledit Freeborn in propriâ personâ. Freeborn préférait de beaucoup la causerie du tête-à-tête à une controverse dans une réunion ; il se sentait plus fort dans de longues conversations faites à loisir, et il était bientôt hors d’haleine lorsqu’il avait à émettre et à aiguiser ses paroles au milieu des voix toujours variées d’une table de déjeuner. Il jugea l’occasion favorable pour faire du bien à un pauvre jeune homme qui ne distinguait pas la craie du fromage, et qui, grâce à ses lumières, pourrait être, selon ses expressions, « converti au salut ». Ils entrèrent donc en conversation ; ils parlèrent de la démarche accomplie par Willis. Freeborn la qualifia de déplorable. Charles ne savait pas encore où il en était, lorsqu’il lui arriva de demander à Freeborn ce qu’il entendait par la foi.
« La foi, répondit Freeborn, est un don divin et l’instrument de notre justification dans la pensée de Dieu. Par nature, nous lui sommes tous odieux, jusqu’à ce qu’il nous justifie librement à cause du Christ. La foi est comme une main qui nous applique personnellement les mérites du Christ, elle est notre justification. Or, de quoi pouvons-nous avoir besoin, ou que pouvons-nous posséder qui soit plus précieux que ces mérites ? Donc, la foi est tout, et accomplit tout pour nous. Vous voyez par là combien il importe d’avoir une idée exacte de la justification par la foi seule. Si nous sommes bien établis sur ce point capital, le reste ne doit pas nous préoccuper ; d’un seul trait, nous verrons la folie des querelles touchant les cérémonies, touchant les formes du gouvernement de l’Église, touchant, dirais-je même, les Sacrements ou les Symboles ; et alors les choses extérieures seront négligées, ou n’obtiendront tout au plus qu’une place secondaire. » Reding fit observer que sans doute Freeborn ne voulait pas dire que les bonnes œuvres ne fussent pas nécessaires pour obtenir la faveur de Dieu ; mais si elles l’étaient, comment la justification existait-elle par la foi seule ? Souriant à une pareille question, Freeborn répondit qu’il espérait que Charles aurait, dans peu de temps, des vues plus claires. C’était une affaire très-simple : la foi ne justifiait pas seulement, elle régénérait aussi. Elle était la racine de la sanctification, aussi bien que du divin accueil. Le même acte qui servait à nous conduire à la faveur de Dieu nous rendait également propres à recevoir cette faveur. Ainsi les bonnes œuvres étaient assurées, parce que la foi ne serait pas véritable, si elle n’avait la certitude de produire de bonnes œuvres en temps opportun.
Reding jugea cette manière de voir simple et claire, quoiqu’elle lui rappelât désagréablement le docteur Brownside. Freeborn ajouta que cette doctrine était précieuse pour le pauvre, qu’elle renfermait tout l’Évangile dans une coque de noix, qu’elle dispensait de critique, de la connaissance des âges primitifs, des professeurs ; en un mot, de toute autorité sous une forme quelconque. Elle faisait table rase de la théologie. Il n’était pas nécessaire de faire remarquer cette dernière conséquence à Charles ; mais il la laissa passer, parce qu’il désirait éprouver le système dans ses propres mérites. « Vous parlez de la vraie foi, dit-il, comme produisant les bonnes œuvres ; vous dites que ce n’est pas la foi qui justifie, mais la vraie foi, et que la vraie foi produit les bonnes œuvres. En d’autres termes, je suppose, la foi, qui est certaine d’être féconde, ou la foi féconde, justifie. Or, raisonner ainsi, c’est comme si l’on disait : La foi et les œuvres sont les moyens réunis de la justification. — Oh ! non, non, s’écria Freeborn, cela est une doctrine déplorable : c’est complétement opposé à l’Évangile, c’est antichrétien. Nous sommes justifiés par la foi seule, en dehors des bonnes œuvres. — Je me trouve précisément au cours des Articles, reprit Charles, et Upton nous a dit que nous devons faire une distinction de ce genre : par exemple, le duc de Wellington est Chancelier de l’Université, mais quoiqu’il soit aussi bien Chancelier que duc, cependant il ne siége à la Chambre des Lords que comme duc, et non comme Chancelier. Ainsi, quoique la foi soit aussi véritablement féconde qu’elle est la foi, cependant elle ne justifie pas comme étant féconde, mais comme étant la foi. Est-ce là votre pensée ? — Nullement, répondit Freeborn ; c’était là la doctrine de Mélanchthon. A force d’explications, il réduisit une vertu cardinale à une simple question de mots ; il fit de la foi un pur symbole : mais c’est s’écarter du vrai Évangile. La foi est l’instrument et non un symbole de la justification. Elle n’est vraiment qu’une simple appréhension[55] et pas autre chose : c’est l’acte qu’un mendiant pourrait hasarder sur un roi qui passe, en le saisissant, et en se cramponnant à lui. La foi est aussi pauvre que Job sur les cendres ; comme ce Patriarche dépouillé de tout orgueil, de faste et de bonnes œuvres, elle est couverte d’ignobles haillons : elle est sans aucun bien. Je le répète, c’est une simple appréhension. Maintenant, vous voyez, n’est-ce pas, quelle est ma pensée ? — Je ne sais si je vous comprends bien, répondit Charles : vous dites qu’avoir la foi c’est saisir les mérites du Christ, et que nous les possédons, ces mérites, pourvu que nous arrivions à les saisir. Mais évidemment tous ceux qui les saisissent ne les obtiennent pas ; car les hommes corrompus qui ne songent jamais à se repentir entièrement, ou qui n’ont pas une véritable haine du péché, seraient heureux de s’en saisir et de se les approprier, s’ils pouvaient le faire. Ils voudraient bien gagner le ciel pour rien. La foi, dès lors, doit être une espèce particulière d’appréhension. Quelle est cette espèce ? On ne peut se tromper sur de bonnes œuvres ; mais on le peut sur une appréhension. Qu’est-ce qu’une véritable appréhension ? Qu’est-ce que la foi ? — Quelle nécessité, mon cher ami, repartit Freeborn, de connaître métaphysiquement ce que c’est que la vraie foi, si nous la possédons et si nous en jouissons ? j’ignore ce que c’est que le pain, mais je le mange ; pour en user, vais-je attendre qu’un chimiste en ait fait l’analyse ? Non, je le mange, et ensuite j’en éprouve les bons effets. Et de même, soyons contents de connaître, non ce que c’est que la foi, mais ce qu’elle produit, et jouissons de notre bonheur en la possédant. — Je n’ai pas envie de faire intervenir la métaphysique, répliqua Charles, j’accepte votre propre exemple. Supposez que je suspecte le pain qui est devant moi de renfermer de l’arsenic ou d’être simplement malsain, serait-il étonnant que je cherchasse à connaître le fait avec certitude ? — Avez-vous agi ainsi, ce matin, à votre déjeuner ? — Je ne puis suspecter mon pain. — Mais alors pourquoi suspectez-vous la foi ? — Parce qu’elle est, pour ainsi parler, une nouvelle substance (Freeborn soupira), parce que je n’y suis pas habitué, bien plus, parce que je la suspecte. Je dois dire que je la suspecte ; car, bien que je connaisse peu cette matière, je sais parfaitement, d’après ce qui s’est passé dans la paroisse de mon père, à quels excès peut conduire cette doctrine, si l’on n’y prend garde. Vous dites que c’est une doctrine précieuse pour les pauvres ; eh bien, ils vont très-vraisemblablement prendre une chose pour une autre, et tout le monde fera de même. Si donc, on nous dit que nous n’ayons qu’à saisir les mérites du Christ, et qu’il n’est pas nécessaire de nous tourmenter pour le reste ; que, si la justification a eu lieu, les bonnes œuvres viendront ensuite ; que tout est fini et que le salut est parfait, pourvu que nous continuions à avoir la foi, je pense que nous devrions être passablement sûrs que nous avons la foi, une foi réelle, une réelle appréhension, avant de fermer nos livres et de nous reposer. »
[55] Il faut prendre cette expression dans le sens du mot latin apprehensio.
Freeborn était contrarié d’avoir entamé cette discussion ; il était peiné (comme il aurait voulu le dire), de voir s’éveiller dans Charles l’orgueil de l’homme naturel, ou l’aveuglement de sa raison charnelle ; mais il n’y avait pas moyen de reculer, il fallait donner une réponse. « Il y a, je le sais, plusieurs sortes de foi, dit-il, et sans doute il vous faut être sur vos gardes pour ne pas prendre une foi fausse à la place de la vraie foi. Bien des personnes, comme vous l’observiez très-exactement, commettent cette faute, et le plus important, tout ce qu’il y a d’important, dirai-je, c’est d’aller droit. D’abord, il est clair que la foi n’est pas la simple croyance aux faits, à l’existence d’un Dieu ou à l’événement historique de la venue du Christ en ce monde et de son départ ; elle n’est pas la soumission de la raison aux mystères, ni cette espèce de confiance, non plus, qui est requise pour exercer le don des miracles ; elle n’est ni la connaissance ni l’acceptation du contenu de la Bible. Je dis, elle n’est pas la connaissance, elle n’est pas l’assentiment de l’intelligence, elle n’est pas un fait historique, elle n’est pas une foi morte : la vraie foi justifiante n’est rien de tout cela, elle est établie dans le cœur et les affections. » Après un court silence il ajouta : « Maintenant, ce me semble, j’ai assez bien décrit ce que c’est que la foi justifiante pour l’usage pratique. — En décrivant ce que la foi n’est pas, vous voulez dire ? répliqua Charles après un moment d’hésitation. La foi justifiante dès lors est, je le suppose, la foi vivante. — N’allez pas si vite, monsieur Reding. — Eh bien, si ce n’est pas la foi morte, c’est la foi vivante. — Elle n’est ni la foi vivante, ni la foi morte, mais la foi, la simple foi qui justifie. Mélanchthon causa bien du chagrin à Luther pour avoir soutenu que la foi vivante et efficace justifie. Allez, mon jeune ami, j’ai étudié cette question avec le plus grand soin. — Alors, dites-moi, reprit Charles, ce que c’est que la foi, puisque je ne puis l’expliquer clairement. Par exemple, si vous disiez (ce que vous ne dites pas) que la foi est la soumission de la raison aux mystères, ou l’acceptation de l’Écriture comme document historique, je comprendrais parfaitement votre pensée ; cela est une donnée claire. Mais quand vous venez dire que la foi qui justifie est une appréhension du Christ, qu’elle n’est ni la foi vivante, ni la foi féconde, ni la foi active, mais un quelque chose qui, dans le fait et en réalité, est distinct de toutes ces sortes de foi, je l’avoue, je ne sais à quoi m’en tenir. »
Freeborn désirait sortir de l’argumentation. « Oh ! s’écria-t-il, si, un seul jour, vous éprouviez réellement la puissance de la foi ! comme elle change le cœur, ouvre les yeux, donne un nouveau goût spirituel, un sens nouveau à l’âme ! Si, un seul jour, vous connaissiez ce que c’est que d’être aveugle, et puis de voir, vous ne demanderiez pas de définition. Les étrangers ont besoin de descriptions verbales, mais les héritiers du royaume se contentent de jouir. Oh ! si vous pouviez seulement parvenir à rejeter les folles imaginations, à vous dépouiller de votre amour-propre, et à expérimenter en vous-même le merveilleux changement, vous ne voudriez plus vivre que de louanges et d’actions de grâces, au lieu d’argumentations et de critique. » Charles était touché de cette parole ardente : « Mais, dit-il, c’est la raison qui doit nous conduire, et je ne vois pas que j’aie plus de motifs, ni même autant, pour vous écouter que pour écouter l’Église romaine, qui m’enseigne qu’il ne m’est pas possible d’avoir véritablement cette certitude de la foi avant de croire, mais que cette certitude me sera divinement accordée quand je croirai. — Sans doute, reprit Freeborn d’un air grave, vous ne voulez pas comparer le chrétien spirituel, Luther, par exemple, croyant sa doctrine cardinale sur la justification, à ce dévot formaliste, esclave de la loi et superstitieux, tel que le Papisme peut le faire, avec ses rites charnels et ses remèdes empiriques, qui jamais ne peuvent purifier l’âme complétement, ni la réconcilier avec Dieu ? — Je n’aime pas à vous entendre parler ainsi, répliqua Charles : le Papisme m’est bien peu connu ; mais, dans mon enfance, j’entrai un jour par hasard dans une chapelle catholique romaine, et vraiment je n’ai jamais vu, dans ma vie, une dévotion semblable : quel respect dans l’assistance prosternée à genoux ! quelle profonde attention de la part de tous à l’action qui se passait sous les yeux ! Cette action, je ne la compris pas, mais, j’en suis sûr, si vous aviez été présent, vous n’auriez jamais appelé la Religion Catholique, à tort ou à raison, une pure forme extérieure ou un culte charnel. » Freeborn répliqua qu’il était profondément peiné de l’entendre exprimer de tels sentiments, et de le voir infecté à ce point des erreurs du jour ; et il se mit maladroitement à parler du Pape comme de l’Antechrist ; il aurait même poussé jusqu’à la prophétie, si le jeune étudiant avait dit une seule parole pour alimenter la controverse. Comme il garda le silence, le zèle de Freeborn se consuma et la conversation fut interrompue.
Quelque temps après, Charles se hasarda à reprendre le même sujet. « Si je vous comprends, dit-il, la foi apporte avec elle sa propre évidence. De même que je mange mon pain au déjeuner sans hésitation sur sa salubrité, ainsi, quand j’ai réellement la foi, je le sais d’une manière certaine, et je n’ai pas besoin de faire des épreuves pour m’en assurer ? — Précisément, comme vous dites, répondit Freeborn ; vous commencez à saisir ma pensée ; vous progressez. L’âme est éclairée pour voir qu’elle a réellement la foi. — Mais comment, demanda Charles, pouvons-nous tirer de leur dangereuse méprise ceux qui croient avoir la foi, alors qu’ils ne l’ont point ? N’y a-t-il pas un moyen qui leur permette de découvrir qu’ils sont dans l’illusion ? — Il n’est pas étonnant, répondit Freeborn, que ce moyen manque ; il y a bien des personnes, dans le monde, qui se trompent elles-mêmes. Certains hommes s’attribuent leur propre justice, ils sont confiants dans leurs œuvres, et ils se croient sauvés, alors qu’ils sont dans un état de perdition ; on ne peut donner des règles formelles qui puissent aider leur raison à découvrir leur méprise. Ainsi en est-il de la foi fausse. — Eh bien, il me paraît étonnant, repartit Charles, qu’on n’ait pas établi une règle naturelle et facile pour découvrir cette illusion ; je suis étonné que la foi fausse ressemble si exactement à la vraie foi, que l’événement seul indique la différence entre elles. Tout effet implique une cause : si une appréhension du Christ produit les bonnes œuvres, et qu’une autre ne les produise pas, il doit y avoir dans l’une une chose qui n’existe pas dans l’autre. Qu’est-ce qui se trouve dans une vraie appréhension qu’on ne puisse pas trouver dans une fausse ? Le mot appréhension, d’ailleurs, est si vague ; il n’éveille chez moi aucune idée bien définie, et pourtant la justification en dépend. Est-ce, par exemple, le besoin senti de repentir ou d’amendement ? — Non, non, la vraie foi est complète sans conversion ; la conversion vient après ; mais la foi est la racine. — Est-ce l’amour de Dieu qui distingue la vraie foi de la fausse ? — L’amour ? reprit Freeborn ; vous devriez lire ce que Luther dit dans son célèbre commentaire sur les Galates. Il appelle une pareille doctrine : pestilens figmentum, diaboli portentum ; et il s’écrie contre les Papistes : Pereant sophistæ cum suâ maledictâ glossâ. — Donc elle ne diffère en rien de la foi fausse. — Ce n’est pas cela, elle en diffère par ses fruits : « C’est à leurs fruits que vous les connaîtrez. » — Cela revient encore au même point ; les fruits viennent après ; mais un homme, paraît-il, doit trouver sa consolation dans sa justification avant que les fruits viennent, avant qu’il sache que sa foi produira ces fruits. — Les bonnes œuvres sont les fruits nécessaires de la foi ; ainsi parlent les Articles. » Charles ne fit pas de réponse, mais il se dit à part lui : « Mon bon ami, en ce point, n’a pas certes la plus lucide des têtes. » Puis à haute voix : « Eh bien, je désespère de pénétrer au fond de ce sujet. — C’est naturellement un principe très-simple, répondit Freeborn d’un air de supériorité, quoique d’un ton doux : Fides justificat ante et sine charitate ; mais la foi requiert une lumière divine pour l’embrasser. » Ils marchèrent un moment en silence ; et comme le jour tombait, ils regagnèrent leur demeure. Arrivés aux bâtiments de Clarendon, ils se séparèrent.
Freeborn n’était pas d’un caractère à laisser aller un jeune homme comme Charles sans tenter un nouvel effort pour le gagner ; et peu de jours après il l’invita à venir prendre le thé chez lui. Charles s’y rendit à l’heure indiquée, par une soirée humide et froide du triste novembre. Il trouva cinq ou six personnes déjà réunies. C’était tout un monde nouveau pour notre étudiant : figures, manières, discours ; tout lui était étranger et ne rappelait ni l’école d’Eton, ni Oxford lui-même. Il fut présenté ; et la conversation qui continuait ne fit qu’ajouter à l’embarras causé par ces nouvelles connaissances. C’était un feu mesuré de remarques sérieuses, entrecoupées de silences que relevaient seulement des « hem » accidentels, l’absorption lente du thé, le bruit des cuillers tombant sur les soucoupes et le mouvement machinal des chaises, quand la servante affairée de la maison venait subitement apporter la bouilloire pour la théière ou des rôties pour la table. Dans la réunion, il n’y avait pas de naturel ni de laisser-aller, mais une grande intention d’être utile.
« Avez-vous vu le dernier Journal Spirituel ? » demanda à voix basse no 1 à no 2. No 2 venait de le lire. « C’est un très-remarquable article sur l’agonie du Pape, dit no 1. — Il ne faut désespérer de personne, répondit no 2. — J’en ai entendu parler, dit no 3, mais je ne l’ai pas vu. » Silence. « De quoi s’agit-il ? demanda Reding. — Du dernier Pape Sixte XVI, répondit no 3 ; il paraît qu’il est mort croyant. » Sensation. La figure de Charles exprima le désir d’en savoir davantage. « Le journal donne cette nouvelle d’après une excellente autorité, reprit no 2. M. O’Niggins, l’agent de la branche de la Société des Traités pour la conversion des prêtres catholiques, se trouvait à Rome pendant la dernière maladie du Pape. Il sollicita une audience, qui lui fut accordée. Arrivé près du malade, il commença tout de suite à lui parler de la nécessité du changement du cœur, de la croyance au seul espoir des pécheurs et du renoncement à tous les médiateurs créés. Il lui annonça la Bonne Nouvelle, et lui garantit qu’il y avait un pardon pour tous. Il le mit en garde contre la fiction de la régénération baptismale ; et puis, continuant à lui apporter la parole, il le pressa, quoique à la onzième heure, de recevoir la Bible, toute à Bible et rien que la Bible. Le Pape écouta avec une attention marquée et fut profondément ému. L’exhortation finie, Sixte XVI répondit à M. O’Niggins, qu’il espérait ardemment que tous les deux ne mourraient pas sans se trouver ensemble dans la même communion, ou quelque chose de ce genre. Il déclara en outre, ce qui est étonnant, qu’il mettait sa seule confiance dans le Christ, « source de tous les mérites » ; phrase bien remarquable dans sa bouche. — En quelle langue s’est faite la conversion ? demanda Charles. — On ne le dit pas, répondit no 2 ; mais je suis à peu près certain que M. O’Niggins sait parfaitement le français. — Il ne me semble pas, repartit Charles, que les concessions du Pape soient plus grandes que celles que font, tous les jours, des membres de notre propre Église, lesquels néanmoins sont accusés de papisme. — Mais les concessions de ces messieurs leur sont arrachées par force, répliqua Freeborn, tandis que celles du Pape étaient volontaires. — Ce parti rétrograde vers les ténèbres, ajouta no 2 ; le Pape marchait vers la lumière. — On doit interpréter tout pour le mieux chez un vrai Papiste, reprit Freeborn, et tout pour le pire chez un Puséiste. C’est à la fois de la charité et du sens commun. — Ce ne fut pas tout, continua no 2 ; le Pape rassembla les cardinaux, leur protesta qu’il désirait ardemment la gloire de Dieu, dit que la religion intérieure était tout en tout et que les formes n’étaient rien sans un cœur contrit, enfin qu’il avait la confiance d’être bientôt au ciel, ce qui, vous le comprenez, était le rejet de la doctrine sur le purgatoire. — C’est un brandon tiré du feu, je l’espère, dit no 3. — On l’a observé souvent, ajouta no 4, et cela m’a frappé moi-même : le moyen de convertir les Catholiques Romains, c’est de convertir d’abord le Pape. — La méthode, au moins, est sûre », repartit Charles avec timidité, craignant d’en avoir trop dit ; mais son ironie passa inaperçue. « L’homme ne peut faire ces choses, reprit Freeborn ; mais la foi a cette puissance. La foi peut descendre même jusqu’aux plus grands pécheurs. Vous voyez maintenant, peut-être mieux que par le passé, ajouta-t-il en se tournant vers Charles, ce que j’entendais par la foi l’autre jour. Ce pauvre vieillard pouvait n’avoir pas de mérites ; il avait passé une longue vie en opposition avec la croix. Vos difficultés continuent-elles ? »
Charles avait souvent pensé sérieusement à sa première conversation avec Freeborn : « Eh bien, répondit-il, je ne crois pas qu’elles soient aussi grandes. » Freeborn parut satisfait. « Je veux dire, ajouta Reding, que l’idée se soutient mieux que je ne le croyais d’abord. » Freeborn eut l’air contrarié. Charles, rougissant un peu, fut obligé de continuer au milieu d’un silence général. « Vous disiez, il vous en souvient, que la foi justifiante existe sans l’amour ou sans aucune autre grâce qu’elle-même, et que personne ne peut absolument expliquer ce qu’elle est, si ce n’est plus tard, d’après ses fruits ; qu’il n’y a pas de critérium au moyen duquel on s’examine soi-même pour voir si on se trompe, lorsqu’on croit avoir la foi ; de sorte que le bon et le méchant peuvent prendre chacun, également, pour soi les promesses et les priviléges propres à l’Évangile. Cette doctrine, je la trouvai certainement dure tout d’abord ; mais ensuite cette idée me frappa, que peut-être la foi est le résultat d’un état d’esprit antérieur, résultat béni d’un état béni ; et c’est pourquoi elle peut être considérée comme la récompense d’une obéissance antérieure ; et la foi trompeuse, ou ce qui simplement ressemble à la foi, être un juste châtiment. » Autant l’expression de la première partie de ce discours était vague, autant la conclusion en était claire. Personne ne s’y trompa, et l’émotion de tous fut sensible. « Il n’y a rien de semblable à un mérite antérieur, dit no 1 : tout est grâce. — Pas de mérite, je le sais, reprit Charles, mais… — Nous ne devons pas nous jeter dans la doctrine de condigno ou de congruo, dit no 2. — Mais, évidemment, répliqua Charles, c’est une cruauté de dire aux ignorants et à la foule : « Croyez, et d’un seul coup vous serez sauvés ; n’attendez pas les fruits, réjouissez-vous tout de suite », sans accompagner cette doctrine d’une description claire de ce que c’est que la foi, et sans prémunir ces pauvres gens contre leur propre illusion par une éducation religieuse. — C’est là, répondit Freeborn, la véritable gloire de cette doctrine d’être prêchée aux plus misérables des hommes. Elle leur dit : « Venez tels que vous êtes. N’essayez pas de vous rendre meilleurs. Croyez que vous êtes sauvés, et le salut est à vous ; les bonnes œuvres viendront après. » — Au contraire, reprit Charles continuant sa thèse, lorsqu’on dit que la justification suit le baptême, il y a là quelque chose d’intelligible, de précis, dont tout le monde peut s’assurer. Le baptême est un signe extérieur et non équivoque ; tandis que si un homme a ce sentiment secret appelé la foi, nul autre que lui ne peut en rendre témoignage ; or, cet homme ne peut être un témoin impartial. »
Reding avait enfin réussi à mettre cette sombre assemblée dans un état de grande excitation. « Mon cher ami, dit Freeborn, je m’attendais à mieux que cela ; dans peu de temps, je l’espère, vous verrez les objets sous d’autres couleurs. Le baptême est un rite extérieur. Qu’y a-t-il, que peut-il y avoir de spirituel, de saint ou de céleste dans le baptême ? — Mais vous me dites vous-même que la foi, non plus, n’est pas spirituelle, répliqua Charles. — Je vous le dis ! et quand donc ? — Eh bien, répondit Charles un peu déconcerté, au moins vous ne la croyez pas sainte. » Freeborn fut embarrassé à son tour. « Si elle est sainte, continua Charles, elle a quelque chose de bon en elle ; elle a quelque valeur ; elle ne porte pas d’ignobles haillons. Tout bien, dites-vous, arrive ensuite. Vous dites que ses fruits sont saints, mais que la foi n’est elle-même absolument rien. » Il y eut un silence momentané, et un peu d’agitation dans les esprits. « Oh ! la foi est certainement un sentiment saint, dit no 1. — Non, il est spirituel, mais non pas saint, repartit no 2 ; c’est un simple acte, l’appréhension des mérites du Christ. — Il a son siége dans les affections, dit no 3 ; la foi est un sentiment du cœur ; c’est la confiance, c’est la croyance que le Christ est mon Sauveur : tout cela est distinct de la sainteté. La sainteté éveille l’idée d’une justice relevant de soi. La foi est paix et bonheur, mais elle n’est pas la sainteté. La sainteté vient ensuite. — Rien ne peut produire la sainteté, si ce n’est ce qui est saint, reprit Charles ; c’est une espèce d’axiome : les fruits étant saints, la foi, qui en est la racine, doit être sainte. — Vous pourriez aussi bien soutenir que la racine de la rose est rouge, et celle du lis blanche, répliqua no 3. — Pardon, s’écria Freeborn ; c’est, comme dit mon ami, une appréhension. L’appréhension, c’est l’acte de saisir ; il n’y a pas plus de sainteté dans la foi justifiante que dans l’acte d’une main qui s’empare d’une substance qu’elle trouve devant elle. C’est là la grande doctrine de Luther dans son commentaire sur les Galates. La foi n’est rien en elle-même ; c’est un simple instrument : voilà ce qu’il enseigne, lorsqu’il s’élève avec tant de force contre la notion de la foi justifiante comme étant accompagnée de l’amour. »
« Je ne puis souscrire à cette doctrine, reprit no 1. Elle peut être vraie en un certain sens ; mais elle jette des pierres d’achoppement dans la voie de ceux qui cherchent. Luther ne pouvait vouloir dire ce que vous soutenez, j’en suis convaincu. La foi justifiante est toujours accompagnée de l’amour. — C’est ce que je croyais, dit Charles. — C’est tout à fait la doctrine de Rome, reprit no 2 ; c’est la doctrine de Bull et de Taylor. — Dans le sens que Luther l’appelle venenum infernale, repartit Freeborn. — C’est précisément la doctrine que prêchent en ce moment les Puséistes, dit no 3. — Au contraire, repartit no 1, c’est celle de Mélanchthon. Regardez, continua-t-il en tirant de sa poche son portefeuille, j’ai noté ses paroles, lorsque Shuffleton les cita l’autre jour dans la salle de théologie : « Fides significat fiduciam ; in fiduciâ inest dilectio ; ergo etiam dilectione sumus justi. » Trois membres de la réunion s’écrièrent que c’était impossible ; le papier passa de main en main dans un silence solennel. « Calvin dit la même chose », ajouta no 1 d’un air de triomphe.
« Je pense », reprit no 4, d’une voix basse, douce et soutenue, qui contrastait avec l’animation qui s’était subitement manifestée dans la conversation, « je pense que la controverse (hem) peut aisément se vider. C’est une question de mots entre Luther et Mélanchthon. Luther dit : (hem) « La foi existe sans l’amour », voulant exprimer que « la foi justifie sans l’amour ». Mélanchthon, d’autre part, dit : (hem) « La foi existe avec l’amour », voulant exprimer que « la foi justifie avec l’amour ». Or, tous les deux sont dans le vrai : Car (hem) « la foi-sans-l’amour justifie, cependant la foi justifie non-sans-l’amour. » Il y eut un moment de silence, tandis que les deux partis élaboraient cette explication. « Au contraire, ajouta-t-il, c’est la doctrine papiste que la foi-avec-l’amour justifie. » Freeborn exprima son dissentiment ; il croyait que C’était là la doctrine de Mélanchthon condamnée par Luther. « Vous voulez dire, reprit Charles, que la justification est donnée à la foi avec l’amour, et non à la foi et à l’amour. — Vous avez exprimé ma pensée, répondit no 4. — Et quelle différence mettez-vous entre le mot avec et le mot et ? » No 4 répondit sans hésiter : « La foi est l’instrument, l’amour le sine quâ non. » Nos 2 et 3 se récrièrent en l’interrompant ; ils croyaient que c’était en revenir au légal[56] que d’introduire la phrase sine quâ non ; c’était introduire des conditions. La justification était inconditionnelle. « Mais la foi n’est-elle pas une condition ? demanda Charles. — Certainement non, répondit Freeborn ; condition est un mot légal. Comment le salut peut-il être libre et entier, s’il est conditionnel ? — Il n’y a pas de condition, dit no 3 ; tout doit venir du cœur. Nous croyons avec le cœur, nous aimons avec le cœur, nous obéissons avec le cœur ; non que nous y soyons obligés, mais parce que nous avons une nouvelle nature. — N’y a-t-il pas obligation d’obéir ? demanda Charles étonné. — Pas d’obligation pour les régénérés, répondit no 3 ; ils sont au-dessus de toute obligation ; ils sont dans un nouvel état. — Mais, certainement, les Chrétiens sont sous une loi », reprit Charles. — Certainement non, repartit no 2 ; la loi est abolie sous le Christ. — Prenez-y garde, dit no 1, vous êtes sur la lisière de l’Antinomianisme. — Pas du tout, répondit Freeborn ; un Antinomien soutient ouvertement qu’il peut briser la loi, un croyant spirituel dit qu’il n’est pas tenu de l’accomplir. »
[56] Allusion à la loi judaïque.
Il s’éleva alors au sein de l’assemblée une nouvelle discussion. Comme il paraissait qu’elle serait aussi interminable qu’elle était ennuyeuse, Reding saisit l’occasion de souhaiter le bonsoir à son hôte et de s’en aller à la dérobée. Il n’avait jamais eu beaucoup de penchant pour la doctrine évangélique, et Freeborn et ses amis, qui connaissaient leur propre croyance mieux que le reste de leur secte, lui avaient démontré qu’il n’avait pas grand’chose à gagner en étudiant davantage cette doctrine. Ces messieurs, en conséquence, ne figureront plus dans notre livre.
Lorsque Charles entra dans sa chambre, il vit sur la table une lettre de chez lui, et, à sa grande terreur, elle avait une large bordure noire. Il s’empressa d’en briser le cachet. Hélas elle annonçait la mort subite de son père. La goutte, après l’avoir tourmenté pendant plusieurs semaines, avait fini par lui attaquer l’estomac et elle l’avait emporté en quelque heures.
O mon pauvre Charles, laissez-moi partager toutes vos douleurs ! quelle longue nuit ! quel indicible réveil ! et puis quelle triste journée ! Dans l’après-midi, vous étiez déjà chez vous : ô cruel changement, depuis les quelques semaines que vous aviez quitté cette demeure tant aimée ! que vos sentiments étaient différents alors ! Et qu’était devenu celui qui vous avait accompagné jusqu’à l’omnibus du chemin de fer ? Pour peindre une telle douleur, la parole est impuissante… Et puis trouver sa mère, ses sœurs et le mort…
Les funérailles ont eu lieu depuis plusieurs jours. Charles doit passer à la maison le reste du trimestre, et il ne retournera pas à Oxford avant la fin de janvier. Les signes de douleur ont disparu ; la maison paraît joyeuse comme auparavant ; le feu est aussi brillant, les miroirs aussi purs, l’ameublement aussi bien rangé ; les tableaux sont les mêmes, les ornements de la cheminée sont là comme toujours, et la pendule imperturbable continue à sonner les heures. Les habitants du presbytère, il est vrai, portent les marques d’une séparation cruelle ; mais ils conversent comme de coutume et sur les sujets ordinaires ; ils se livrent aux mêmes occupations, ils travaillent, ils lisent, ils se promènent dans le jardin, ils dînent. Au dehors, il n’y a pas de changement, mais dans le cœur quelles angoisses sous le coup d’une perte déchirante ! Lui, en effet, il n’est pas là aujourd’hui, il n’y sera pas demain non plus ; il n’est pas simplement absent, mais, comme ils le savent bien, il est parti pour ne plus jamais revenir… Son absence du moment est à leur esprit un signe et un souvenir qu’il sera absent toujours. Mais c’est surtout au dîner que cette pensée les frappe ; car Charles doit désormais occuper à table une place qu’il n’a remplie parfois jusqu’à ce jour que comme délégué, et en présence de celui auquel il succède : son père, n’ayant guère au delà de l’âge mûr, avait l’habitude de découper lui-même. Et lorsque, au repas principal, Charles levait les yeux, il rencontrait le regard troublé d’une personne qui, de la chaise qu’elle occupait, avait devant elle un mémento encore plus vivant de leur perte commune : Aliquid desideraverunt oculi…
M. Reding avait laissé sa famille dans une bonne position de fortune. Quoique ce fût pour elle un adoucissement à sa perte, peut-être en ce moment sa douleur en fut-elle augmentée. N. Reding avait toujours été un père bon et indulgent. C’était un très-respectable ecclésiastique de la vieille école, un ministre aux sentiments pieux, un gentleman par l’éducation, un homme exemplaire dans ses relations sociales. Il n’était pas grand lecteur et n’avait jamais été dans une situation à acquérir la science théologique ; il croyait sincèrement tout le contenu du Prayer-Book, mais ses sermons étaient rarement dogmatiques. C’étaient des discours pleins de raison, le langage d’un homme mûr sur les devoirs moraux. M. Reding distribuait la communion aux trois grandes fêtes, voyait son évêque deux ou trois fois l’an, vivait en bons termes avec les gentilshommes campagnards du voisinage, était charitable envers le pauvre, hospitalier dans sa demeure, et, sans être exagéré, il se montrait ferme partisan des intérêts tories dans son comté. Il était incapable de toute action blessante, mesquine, basse ou impolie. Il mourut estimé des grandes maisons d’alentour et pleuré par ses paroissiens.
La mort de son père était la première dure épreuve que Charles eût subie, et il sentit qu’elle était réelle. Comme s’évanouissaient, en présence de cette infortune palpable, les petites anxiétés qui l’avaient tourmenté récemment ! Il comprit alors la différence qui existe entre ce qui est réel et ce qui ne l’est point. Tous les doutes, les recherches, les conjectures, les idées qui l’avaient agité à propos des matières théologiques lui parurent autant de fantômes qui voltigeaient devant ses yeux aux heures brillantes, mais qui n’avaient pas de racines dans son âme, et qui, semblables aux feuilles mortes de décembre, s’envolaient loin de lui au jour de l’affliction. Il sentit alors où habitait son cœur, où était sa vie. Sa naissance, sa famille, son éducation, le toit paternel étaient de grandes réalités ; à ces réalités son être se trouvait uni ; il avait grandi à leur ombre. Il comprit qu’il devait rester ce que la Providence l’avait fait. Ce qu’on appelle la poursuite de la vérité lui paraissait un vain rêve. Il avait de grands devoirs, des devoirs évidents à remplir envers la mémoire de son père, envers sa mère, envers ses sœurs et sa position ; et c’est à les accomplir religieusement qu’il devait désormais s’appliquer. Comme si elles l’avaient trompé, il se sentit dégoûté de toutes les théories, et il résolut secrètement de n’avoir plus rien à démêler avec elles. Que le monde allât comme il pourrait, quoi qu’il arrivât, pour lui sa place et son chemin étaient clairement indiqués. Il reviendrait à Oxford, il s’appliquerait avec ardeur à ses études, il écarterait toute distraction, il s’éloignerait des routes de traverse, et il ferait de son mieux pour bien passer son examen. L’Église d’Angleterre telle qu’elle était, ses Articles, ses évêques, ses prédicateurs avaient suffi à des personnes meilleures que lui ; pourquoi ne s’en contenterait-il pas ? Au reste, il ne pouvait mieux faire que d’imiter la vie et la mort de son père bien-aimé : une existence paisible à la campagne, loin de toutes les agitations, un cercle de personnes pieuses, un travail utile parmi les pauvres, le soin de l’école du village, et, à la fin, la mort du juste, tels devraient être ses rêves.
En ce moment, et pour quelque temps encore, il avait des devoirs spéciaux à remplir envers sa mère ; il désirait, autant que possible, remplacer auprès d’elle celui qu’elle avait perdu. Pauvre mère ! que de grandes épreuves lui restaient à subir ! Si lui, Charles, éprouvait tant de peine à quitter Hartley, que serait-ce pour elle ? Encore quelques mois, et elle devrait s’éloigner d’un lieu qui lui avait toujours été cher, mais qui maintenant était sacré pour son cœur ; encore quelques mois, et elle devrait démeubler sa vieille habitation et s’occuper du travail si rude d’un déménagement : quelle situation ! Une tête fatiguée et un cœur malade, au moment où elle avait le plus besoin de sang-froid et d’énergie…
Telles furent les pensées qui assiégèrent l’esprit de Charles, pendant ces semaines de tristesse. La mort avait tourné une feuille de sa vie : il ne pouvait plus être ce qu’il avait été. Les hommes arrivent à l’âge viril à des époques différentes. Dans une famille, les plus jeunes, comme les moines dans un monastère, peuvent rester enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge mûr ; mais les aînés, si leur père vient à mourir prématurément, passent tout à coup à la virilité, alors qu’ils arrivent à peine à l’adolescence. Charles était un jeune homme intelligent, mais à peine formé, quand il avait quitté Oxford ; il y revint homme fait.
A quatre milles environ d’Oxford, sur le penchant d’un coteau long et escarpé, se trouve un village fortement boisé qui donne sur les forêts du Berkshire, et d’où l’œil peut jouir d’une belle vue de la ville aux nombreuses tours[57]. Sur le large sommet de ce coteau s’étendait autrefois un bois de châtaigniers ; aujourd’hui, il est couvert de racines d’arbres, de genêts et d’un doux gazon. En dessous se voit du sable rouge qui contraste avec la verdure et en fait ressortir davantage l’éclat. La pluie n’y séjourne pas longtemps, de sorte que la promenade y est toujours possible. On y respire également un air frais et salutaire, bien différent de l’atmosphère lourde de l’Université, qui se trouve plus bas. Le genêt était encore en fleur, à la fin du mois de juin, lorsque Reding et Sheffield fixèrent leur séjour à l’extrémité de ce village, dans une petite chaumière, si bien cachée par les arbres et tellement environnée de prairies, qu’il eût été difficile à un étranger de la découvrir. C’est dans ce lieu qu’ils voulaient passer leurs dernières vacances, avant de se présenter pour leur examen.
[57] Oxford.
Dix-huit mois s’étaient écoulés depuis la grande infortune de Charles, et le temps n’avait pas été inutilement employé par nos deux amis. Ils avaient étudié avec beaucoup de persévérance. Sheffield avait même obtenu le prix de poésie latine. Charles, de son côté, avait fait taire ses perplexités religieuses. Naturellement, il connaissait un plus grand nombre de personnes de tous les partis, il connaissait mieux leurs principes et leurs caractères ; mais il ne s’appesantissait sur rien ; il n’essayait pas de déterminer la valeur ou les difficultés de telle ou telle question. Il prenait les choses comme elles venaient, et, tout en s’appliquant à ses études, il profitait avec reconnaissance des priviléges religieux que lui offrait le système du collége. Une année environ lui restait avant son examen, et comme sa mère et ses sœurs n’avaient pas encore arrangé leurs plans, allant d’un ami chez l’autre, il avait accédé à une proposition que lui avait faite Sheffield de prendre un tuteur pendant les vacances et de chercher un site pour étudier dans le voisinage d’Oxford. Ils avaient tous les deux beaucoup de motifs d’espérer les plus grands honneurs que décerne l’Université : c’étaient des jeunes gens pleins de savoir et d’intelligence ; ils avaient étudié avec suite, et avaient eu l’avantage d’assister à des cours excellents.
Le flanc de la colline forme une large et longue excavation ou amphithéâtre sur un des côtés du village d’Horsley. Les deux points extrêmes peuvent se trouver à un demi-mille en ligne directe ; mais la distance est plus grande quand on suit le sentier qui serpente sur la crête, à travers le gazon et la bruyère. Leur tuteur n’avait pu trouver un logement dans le village, et tandis que les deux jeunes gens demeuraient à une extrémité de l’endroit que nous avons décrit, M. Carlton, à peine leur aîné de trois ans, s’était établi dans une ferme à l’extrémité opposée. La ferme, d’ailleurs, lui convenait davantage ; elle le rapprochait d’un hameau qu’il avait à desservir pendant les vacances.
Une après-midi, nos deux étudiants étaient couchés sur l’herbe, attendant l’heure du dîner et considérant leur ami qui venait à leur rencontre : un petit volume classique était dans leurs mains. « Je ne crois pas, disait Reding à Sheffield, que vous avez pour Carlton la même estime que moi. Je le trouve si attrayant, d’un caractère si uniforme, si aimable, si bienveillant ! Je ne connais personne qui plus que lui ait le talent de rapprocher les cœurs, de leur inspirer de la confiance et d’éveiller en eux des sentiments d’amitié réciproque. — Vous vous trompez, répondit Sheffield, si vous croyez que je ne l’estime pas et que je ne l’aime point ; il est impossible de ne pas l’aimer. Mais ce n’est pas l’homme qui pourrait avoir de l’influence sur moi. — Il est trop anglican pour vous, reprit Charles. — Pas du tout, si ce n’est d’une façon indirecte. Le reproche que je lui fais, c’est que tout en ayant beaucoup de pensées remarquables, beaucoup de pensées profondes en détail, il soit complétement incapable de saisir les liens qui les unissent entre elles et d’en tirer des conséquences. Il ne voit jamais une vérité à moins qu’il ne la touche du doigt. Il est toujours à chercher, à tâtonner, et, comme au jeu de cache-cache, il brûle constamment sans rien découvrir. Au reste, je sais qu’il y a des milliers de personnes qui ne voient pas un pouce au delà de leur nez, et qui digèrent parfaitement des contradictions. Mais Carlton est vraiment un homme d’intelligence ; ce n’est pas un penseur ordinaire, et c’est ce qui m’agace. Je sais que j’écris d’une manière obscure et que souvent je ne dispose pas dans un ordre convenable la suite de mes idées ; mais si je fais un travail pour lui, on peut être sûr qu’il laissera de côté la pensée ou le trait que je prise le plus, sur lequel repose toute l’argumentation, qui lie toutes les parties ensemble, et puis, il viendra me dire froidement : C’est extravagant, ou c’est cherché ; ne voyant pas qu’en effaçant ce trait il fait une absurdité du reste. C’est un homme à enlever à un arceau sa clef de voûte, et à bâtir ensuite tranquillement sa maison dessus. — Ah ! vous voilà revenu encore à votre ancienne faiblesse : un désir immodéré de vues positives. Pour moi, ce que j’aime dans Carlton, c’est son calme ; disant toujours assez, jamais trop ; jamais ne vous importunant, ne vous surchargeant jamais de questions ; toujours pratique, jamais dans les nuages. Gardez-moi d’un homme à vues, je ne saurais vivre une semaine avec lui (j’excepte toujours les personnes présentes). — Si vous considérez avec quelle ardeur j’ai étudié, et combien peu j’ai parlé cette année-ci, votre reproche est sévère, Charles. N’ai-je pas été l’un des seize élèves du vieux Thruston, les vacances passées ? Le brave homme ! Tout en nous attelant aux Moralistes et à Agamemnon, il nous donnait de gros dîners et fumait son cigare avec nous. Il sait ses livres par cœur, peut répéter ses pièces au rebours, et connaît à un gramme près ce que pèse Aristote ; mais quant à la synthèse, aux idées, à la poésie, oh ! c’était désolant ; on n’y sentait que ténèbres. — Et sur quatre mois, repartit Charles, vous y êtes resté six semaines, Sheffield. »
Carlton venait de les rejoindre, et après les salutations réciproques il s’assit avec eux sur l’herbe. « Reding et moi, dit Sheffield, nous débattions si Nicias était un homme de parti. — Naturellement, reprit Carlton, vous avez d’abord défini vos termes. — Eh bien, répondit Sheffield, j’entends par un homme de parti celui qui non-seulement appartient à un parti, mais qui en a l’animus. Nicias ne créa pas un parti, il le trouva formé ; il se trouva à la tête de ce parti. Nicias n’était pas plus homme de parti qu’un prince qui est né souverain de ses États. — Je partage votre idée, reprit Carlton ; toutefois, je voudrais savoir ce que c’est qu’un parti, et ce que c’est qu’un homme de parti. — Un parti, répondit Sheffield, est simplement un corps extra-constitutionnel ou extra-légal. — L’action d’un parti, ajouta Charles, est l’exercice d’une influence à la place de la loi. — Mais, Reding, en supposant qu’il n’y ait pas de loi existante là où l’influence s’exerce ? demanda Carlton. » Charles avait à s’expliquer : « Certainement, dit-il, l’État n’a pas fait de lois pour tous les cas possibles. — Par exemple, continua Carlton, un premier ministre, ainsi l’ai-je compris, n’est pas reconnu dans la constitution ; il exerce son influence en dehors de la loi, mais non pas, conséquemment, contre aucune loi existante ; et il serait absurde de parler de lui comme d’un homme de parti. — Les partis parlementaires sont également reconnus chez nous, quoique extra-constitutionnels, dit Sheffield. Nous les appelons des partis ; mais qui voudrait appeler le duc de Devonshire ou lord John Russell un homme de parti, dans le mauvais sens du mot ? — Il me semble, reprit Carlton, que la formation d’un parti est simplement le retour au mode primitif de la formation de la société. Rappelez-vous Déjocès ; il forma un parti ; il obtint de l’influence ; et il jeta les fondements de l’ordre social. — La loi commence certainement par une influence, dit Reding ; car elle présuppose un législateur ; puis elle se substitue à cette influence. A partir de ce moment, l’exercice de l’influence est un signe de parti. — Vous parlez d’une manière trop large, comme vous venez de le reconnaître vous-même, reprit Carlton, vous devriez dire que la loi commence par se substituer à l’influence et que, à proportion qu’elle s’y substitue, l’exercice de l’influence implique l’action d’un parti. Par exemple, la couronne n’a-t-elle pas une influence personnelle immense ? Nous parlons du parti de la cour ; cependant ce parti n’entre pas en conflit avec la loi, il est établi pour concilier le peuple à celle-ci. — Mais il est reconnu par la loi et par la constitution, comme le fut la dictature, fit observer Charles. — Eh bien, prenez l’influence du clergé, reprit Carlton ; nous faisons grand cas de cette influence comme principe supplémentaire à la loi et comme lui prêtant un appui ; pourtant ce principe n’a pas été créé ni défini par la loi. La loi ne reconnaît pas, dans chaque paroisse, le personnage qu’un écrivain appelle, avec justesse, un « gentleman résident ». L’influence, dès lors, à la place de la loi, n’est pas nécessairement l’action d’un parti. — De même, dit Sheffield, le caractère national est une influence distincte de la loi, selon cet aphorisme : Quid leges sine moribus ? — La loi, reprit Carlton, ne se forme et ne s’étend que graduellement. Or, donc, tant qu’il n’y a pas de loi, il y a le règne de l’influence ; il y a un parti sans qu’il y ait nécessairement ce qu’on appelle l’action d’un parti. Ceci est la justification des whigs et des tories, au temps présent. Ils suppléent, comme le dit Aristote traitant d’une autre matière, au défaut de la loi. — Charles Ier exerça une influence royale, Walpole une influence ministérielle ; mais l’influence, et non la loi, était le principe d’action dans les deux circonstances. L’objet et les moyens pouvaient être mauvais, mais la marche elle-même ne pouvait être appelée l’action d’un parti. — Vous voudriez donc justifier, répliqua Charles, les associations et les sociétés qui existaient, par exemple, à Athènes, non pas dans le cas où « elles se faisaient justice à elles-mêmes », comme on dit, mais dans celui où il n’y avait pas d’autorité établie pour faire justice. C’était un retour au précédent de Déjocès. — Manzoni, dit Sheffield, nous fournit un exemple frappant de la chose, au commencement de ses Promessi sposi, lorsqu’il fait voir qu’au XVIe siècle la protection due au faible par la loi ne se trouvait presque exclusivement que dans les factions et les compagnies. Je ne puis me rappeler les faits en particulier, mais il montre le clergé occupé à étendre ses immunités, la noblesse ses priviléges, l’armée ses exemptions, les commerçants et les artisans leurs corporations. Les juristes eux-mêmes ainsi que les médecins formaient un corps à part. »
« Ainsi, reprit Carlton, les constitutions ont été moulées et perfectionnées graduellement par des corps extra-constitutionnels, soit qu’ils se réunissent sous la protection de la loi, soit qu’ils fussent remplacés par une disposition sage de la loi relative au but qu’ils se proposaient. Au moyen âge, l’Église était un immense corps extra-constitutionnel. Les rois germains et anglo-normands voulurent soumettre son action à la loi ; les parlements modernes l’ont remplacée par celle-ci. A cette époque, l’État revendiquait le droit des investitures ; aujourd’hui, l’État marie, enregistre, régit les pauvres, exerce la juridiction ecclésiastique à la place de l’Église. — Cette manière de voir fait de la Réforme ou de la Révolution un véritable ostracisme, dit Sheffield ; il y a une lutte d’influence contre influence, et l’un des combattants finit tôt ou tard par se débarrasser de l’autre. Ni la loi ni la Constitution ne sont mises en question, mais la volonté du peuple ou de la cour rejette soit l’individu trop privilégié, soit le monarque, soit la religion. Ce qui n’est pas sous la loi n’a rien à faire avec la loi, et n’a pas le droit d’invoquer son intervention. — Une pensée m’a frappé quelquefois, dit Charles, elle s’accorde avec ce que vous avez dit. Dans la seconde moitié du siècle dernier, il s’est formé graduellement dans l’État un parti populaire qui tend aujourd’hui à se faire reconnaître comme constitutionnel, ou qui déjà est ainsi reconnu. Mon père n’a jamais pu souffrir les journaux (je veux dire leur système) ; il soutenait que c’était un nouveau pouvoir dans l’État. Certes, je ne veux pas défendre ce qu’il condamnait : un tas de vilaines choses, des principes funestes, l’arrogance et la tyrannie des rédacteurs, mais je contrôle le sujet par l’application de votre théorie. La grande masse du peuple est imparfaitement représentée dans le Parlement ; la Chambre des Communes n’est pas sa voix, mais la voix de quelques grands intérêts. En conséquence, la Presse vient pour faire ce que la Constitution n’a pas fait, pour former le peuple en une vaste association de protection mutuelle. Et cela a lieu en vertu du même droit dont usa Déjocès pour réunir le peuple autour de lui, cette association ne vient pas empiéter sur le domaine de la loi, elle bâtit sur un terrain auquel la Constitution n’a pas pourvu. Elle tend, dès lors, à être ultérieurement reconnue par la Constitution.
— Il y a, reprit Carlton, un autre phénomène remarquable du même genre qui se développe en ce moment ; je veux dire, l’influence de l’agitation. Je ne suis pas assez homme politique pour en parler en bien ou en mal ; notre instinct naturel s’oppose à cette influence ; mais elle peut être nécessaire. Cependant l’agitation parvient chaque jour à se faire accepter comme l’instrument légitime par lequel les masses manifestent leurs désirs et en assurent l’accomplissement. De même qu’un bill passe au Parlement, après des lectures, des discussions, des discours, des votes et autres choses semblables ; de même la marche par laquelle un acte de la volonté populaire devient loi est une longue agitation qui se traduit par des pétitions nombreuses, et qui, antérieure à l’action parlementaire, se développe avec elle. Le premier exemple de ce genre a eu lieu, il y a environ cinquante ou soixante ans, lorsque… Holà ! qui est-ce qui galope ainsi vers nous ? — Tiens, c’est le vieux Vincent, dit Sheffield. — Il vient juste à temps pour dîner, reprit Charles. — Comment allez-vous, Carlton ? s’écria Vincent : comment vous portez-vous, monsieur Sheffield ? Monsieur Reding, votre santé est-elle bonne ? Vous justifiez toujours votre nom[58], je suppose ; je vous ai connu, en tout temps, homme d’étude. Quant à moi, continua-t-il, je suis à cette heure un homme disposé à manger, et je viens pour dîner avec vous, si vous me le permettez. Avez-vous une place pour mon cheval ? » Il y avait tout auprès l’écurie d’une ferme. Charles y conduisit le cheval, et le cavalier, sans aucun retard, à cause de l’heure avancée, entra dans le cottage pour faire une courte toilette.
[58] Jeu de mots. Reding se prononce comme reading (liseur, studieux).
Quelques instants après, ils étaient tous à table dans un petit salon qui était la pièce omnibus du cottage. Nos deux étudiants n’avaient pas toute la maison à leur service, quoiqu’elle ne fût pas bien grande ; elle servait aussi d’habitation à un jardinier, qui portait ses légumes au marché d’Oxford et dont la femme faisait, comme on dit, le ménage de ses locataires.
Le dîner était en rapport avec l’appartement, l’appartement avec le dîner. La table de travail avait été débarrassée à la hâte pour mettre la nappe, qui n’était pas d’une blancheur irréprochable ; et sur une seconde table, la seule qui restât, s’étalait un grand luxe d’assiettes, de couteaux et de fourchettes au milieu de livres de toute espèce, in-octavo et in-douze, reliés et brochés, qui se dressaient, rangés en piles, ou étaient jetés çà et là en désordre. Les autres ornements dudit meuble étaient un encrier, quelques mains de papier grand format, un chapeau de paille, une montre d’or, une brosse à habits, quelques bouteilles de gingerbeer, une paire de gants, un porte-cigares, une cravate, un chausse-pied, une petite ardoise, un grand couteau à fermoir, un marteau et un joli pupitre marqueté.
« J’aime ces courses dans la campagne, dit Vincent dès qu’ils furent à table ; la campagne n’a plus d’effet sur moi lorsque je l’habite comme vous faites ; mais je la trouve délicieuse comme excitant. Visitez-la ; ne l’habitez point, si vous voulez en jouir. L’air de la campagne est un stimulant. Les stimulants, monsieur Reding, doivent se prendre avec modération. Vous, vous êtes du parti de la campagne ; moi, je ne suis d’aucun parti. Je vais ici, là, comme l’abeille ; je goûte de chaque objet, je ne m’arrête à aucun. » Sheffield lui fit observer que de cette manière il appartenait plutôt à tous les partis qu’à aucun. « C’est impossible, répliqua Vincent ; je soutiens que c’est entièrement impossible. On ne peut être à la fois de deux partis. Croyez-le bien ; il serait aussi facile de se trouver simultanément en deux endroits. Être uni à deux, c’est n’être uni à aucun. Tenez-le pour certain, mon jeune ami, les principes antagonistes se corrigent les uns les autres. C’est un morceau de philosophie dont vous me saurez gré un jour, quand vous serez plus âgé. — J’ai entendu rapporter, reprit Sheffield, un fait remarquable qui a lieu en Amérique, et qui confirme évidemment ce que vous dites, monsieur. Aux États-Unis les professeurs sont parfois de deux ou trois religions en même temps, suivant qu’on les considère historiquement, personnellement ou officiellement. De cette manière, peut-être arrivent-ils au juste-milieu. » Vincent provoquait souvent le rire chez les autres, mais il ne comprenait pas lui-même la plaisanterie, et il ne pouvait jamais voir la différence entre l’ironie et le sérieux. Il ne sut donc que répondre. Charles vint à son secours. « Avant le dîner, dit-il, nous nous amusions à développer une question que vous regarderez, je le crains, comme un grand paradoxe. Nous soutenions que les partis sont des choses bonnes, ou plutôt nécessaires. — Vous ne me rendez pas justice, répondit Vincent, si vous croyez que telle est ma pensée. Je partage en deux vos paroles : Les partis ne sont pas choses bonnes, mais choses nécessaires ; ils ressemblent aux limaçons ; je ne leur envie pas leurs étroites coquilles ; je n’essaierai pas de m’y loger. — Vous voulez dire, reprit Carlton, que les partis font notre sale besogne ; ils sont nos bêtes de somme ; nous ne pourrions avancer sans eux, mais nous n’avons pas besoin de nous y identifier ; nous pouvons nous tenir à l’écart. — Cela, dit Sheffield, ressemble à la doctrine de ces dévots qui soutiennent que c’est un péché de se livrer à des occupations terrestres, quoiqu’elles soient nécessaires ; c’est aux méchants à s’y adonner et à travailler pour les élus. — Il y aura toujours assez de gens qui aimeront à s’enrôler sous le drapeau d’un parti sans qu’il soit nécessaire de le leur prescrire, répliqua Vincent ; notre affaire, à nous, c’est de les mettre à profit, de nous en servir, mais en même temps de nous tenir à distance. Je crois que tous les partis renferment du bon, seulement ils vont trop loin. Pour moi, je fais des emprunts à chacun en particulier, je coopère à tous en tant qu’ils sont dans le vrai, mais je ne vais pas au delà. Ainsi je tire le bien de tous, et je fais à tous du bien ; car je les favorise en ce que chacun a de vrai.
— M. Carlton va plus loin que vous, monsieur, reprit Sheffield. Il soutient que l’existence des partis n’est pas seulement nécessaire et utile, mais encore légitime. — M. Carlton n’est pas homme à soutenir des paradoxes, repartit Vincent. Je suppose qu’il ne voudrait pas défendre les opinions extrêmes qui, hélas ! existent chez nous en ce moment, et qui font tous les jours de nouveaux progrès. — Je parlais des partis politiques, reprit Carlton ; mais je suis disposé à étendre ma proposition aux partis religieux également. — Mais, mon brave Carlton, répliqua Vincent, l’Écriture condamne les partis religieux. — Certainement, je ne veux pas m’opposer à l’Écriture, répondit Carlton, et je parle sauf correction du livre sacré ; mais je soutiens que, lorsque, n’importe où, une Église ne décide pas certains points religieux, jusque là elle en laisse la décision aux individus ; et puisque vous ne pouvez espérer que tout le monde soit du même sentiment, vous devez vous attendre à des différences d’opinions. Or, l’expression de ces différentes opinions par les différentes personnes qui les soutiennent est ce qu’on appelle un parti. — M. Carlton s’est montré supérieur, monsieur, sur la thèse générale, avant le dîner, dit Sheffield ; et maintenait il tire la conséquence que toutes les fois qu’il y a des partis dans une Église, cette Église ne doit s’en prendre qu’à elle-même. Ils sont le résultat logique du jugement privé ; et plus vous avez de personnes qui usent du jugement privé, plus vous avez de partis. Vous êtes donc réduit à cette alternative : Pas de tolérance, ou pas de partis ; et il vous faut admettre les partis, à moins de refuser la tolérance. — Sheffield exprime mes idées d’une manière plus forte que je ne le ferais, reprit Carlton ; mais j’admets assez ce qu’il dit. Prenez, par exemple, l’Église de Rome ; elle a décidé bien des points de théologie ; mais il y en a plusieurs qu’elle n’a pas résolus. Or, sur toutes les questions où il n’y a pas de décision ecclésiastique, il y a tout de suite un parti chez les Catholiques Romains ; la décision est-elle enfin portée, dès ce moment le parti cesse. De là la célèbre dispute des Dominicains et des Franciscains sur l’Immaculée Conception ; les deux ordres ont continué à controverser parce que l’autorité n’avait pas donné de décision dès le principe du débat ; d’autre part, au contraire, lorsque les Jésuites et les Jansénistes se disputaient sur la grâce, le Pape décida en faveur des premiers, et la controverse finit sur-le-champ. — Sans doute, répondit Vincent, mon bon et digne ami le révérend Charles Curlion, fellow de Leicester, et jadis lauréat au concours du prix Irlande, ne préfère pas l’Église de Rome à l’Église d’Angleterre ? » Carlton se mit à rire : « Vous ne me suspectez pas sur ce point, je pense, répondit-il. Tout ce que je dis, c’est que notre Église, d’après sa constitution, admet, approuve le jugement privé ; et que le jugement privé, tel qu’on l’applique, renferme nécessairement des partis. Dans l’Église de Rome, vous trouvez un mince jugement privé qui admet des partis occasionnels ou locaux ; mais le vaste jugement privé, qui est en usage chez nous, reconnaît les partis comme un élément même de l’Église. — Bien, bien, mon cher Carlton… » répliqua Vincent en fronçant le sourcil et en prenant un air d’importance, quoiqu’il n’eût rien de particulier à répondre. « Vous voulez dire, reprit Sheffield, si je vous comprends, que c’est un acte de sotte hypocrisie de secouer la tête et de faire de grands yeux à monsieur tel ou tel, parce qu’il est chef d’un parti religieux, tandis que nous rendons au Ciel des actions de grâces pour le bienfait de notre Église pure et réformée. La pureté, en effet, la réforme, l’apostolicité, la tolérance, toutes ces gloires, tous ces orgueils de l’Église d’Angleterre font de l’action des partis et de l’esprit de parti un second bienfait qui devrait également exciter notre reconnaissance. Les partis forment un de nos plus beaux ornements, monsieur Vincent. — Une opinion ou un argument ne perd rien entre vos mains, monsieur Sheffield, reprit Carlton ; mais ma pensée était simplement que les chefs de parti ne déshonorent pas l’Église, à moins que lord John Russell ou sir Robert Peel n’occupent un poste déshonorant dans l’État. — Mon jeune ami », dit Vincent, en achevant son mouton et en repoussant son assiette, « mes deux jeunes amis (vu que Carlton n’est guère plus âgé que Sheffield), puissiez-vous acquérir un peu plus de jugement. Lorsque vous aurez atteint mon âge (c’est-à-dire deux ou trois ans de plus que Carlton), vous apprendrez à mettre de la sobriété en toutes choses. Monsieur Reding, encore un verre de vin. Voyez cette pauvre enfant, comme elle chancelle sous son pouding de groseilles ! allez à son secours, monsieur Sheffield. La vieille femme fait mieux la cuisine que je ne m’y attendais. Comment votre viande de boucherie vous arrive-t-elle ici, Carlton ? J’avais envie de vous apporter un beau brochet que j’ai vu dans notre cuisine, mais je croyais que vous n’aviez pas les moyens de le faire cuire. »
Le dîner fini, la société se leva de table. On alla se promener dans la prairie. Un autre sujet fut entamé. « Willis de Saint-George n’était-il pas de vos amis, monsieur Reding ? » demanda Vincent. Charles tressaillit : « Je l’ai connu un peu… je l’ai vu plusieurs fois. — Vous savez qu’il nous a quittés, continua Vincent, et qu’il s’est uni à l’Église de Rome. On assure maintenant qu’il nous revient. — Triste histoire en tout cas, reprit Charles ; oui, très-triste, si ceci est vrai. — Vous voulez dire, repartit Vincent, en le reprenant comme s’il eût commis une erreur de paroles, vous voulez dire plutôt : dénoûment heureux ; la seule chose qui lui restât à faire. Vous savez qu’il a été sur le continent. Tous ceux qui ont du penchant à se faire papistes devraient faire ce voyage : Carlton, nous vous y enverrons bientôt. D’ici, les choses paraissent sous un jour favorable ; là, l’Église de Rome se voit sous son vrai jour. J’ai fait moi-même ce voyage, et je sais ce qu’il en est. Quel tas de mendiants dans les rues de Rome et de Naples ! Quelle saleté ! quelle misère ! Nulle propreté ; absence complète de comfort ; et puis, quelle superstition ! quel abus de la véritable gravité évangélique ! Ils se poussent, ils se battent pendant la messe ; ils bredouillent leurs prières avec la vitesse du railway ; ils adorent la Vierge comme une déesse ; et ils voient des miracles à tous les coins de rue. Leurs images sont épouvantables, et leur ignorance prodigieuse. Eh bien, Willis a vu toutes ces choses, et je tiens d’autorité sûre, dit-il mystérieusement, qu’il est entièrement dégoûté de toute cette boutique et qu’il revient à nous. — Est-il en ce moment en Angleterre ? demanda Charles. — On dit qu’il est dans le Devonshire auprès de sa mère, qui, vous le savez peut-être, est veuve, et à laquelle il a causé bien du chagrin. Pauvre sot, qui ne voulait pas suivre l’avis de têtes plus mûres que la sienne ! Un ami me l’envoya un jour ; mais je ne pus rien en obtenir. Je ne pouvais saisir ses arguments, ni lui les miens. L’entrevue n’eut aucun résultat. Il a voulu absolument tenter l’épreuve, et il en est puni. »
Il y eut un moment de silence ; puis Vincent ajouta : « Je suppose que Carlton pense que de telles perversions sont aussi nécessaires que les partis dans l’Église protestante pure ? — Je ne puis dire, Carlton, que vos paroles me satisfassent, reprit Charles, et je suis heureux d’avoir la sanction de M. Vincent. Si les partis politiques rendaient les hommes rebelles, tout parti politique serait dès lors inexcusable ; ainsi en est-il d’un parti religieux, s’il mène à l’apostasie. — Les Whigs, vous le savez, repartit Sheffield, furent accusés, dans la dernière guerre, d’être pour Bonaparte ; les accidents de ce genre ne peuvent atteindre les règles générales ni les coutumes établies. — Eh bien, malgré cela, reprit Charles, je ne puis croire que les motifs qui justifient les partis politiques excusent les partis religieux. A mon avis, se faire chef d’un parti religieux, c’est quelque chose de méprisable. — Loyola et saint Dominique étaient-ils méprisables ? demanda Sheffield. — Ils avaient, eux, la sanction de leurs supérieurs, répondit Charles. — Reding, vous êtes certainement sévère pour les partis, dit Carlton ; un homme, individuellement, peut écrire, prêcher et publier ce qu’il croit être la vérité sans commettre de faute ; pourquoi donc commence-t-il à avoir tort lorsqu’il fait cela avec d’autres ? — Les manœuvres d’un parti, répondit Charles, déshonorent la vérité. — Ne vous rappelez-vous plus l’histoire ? reprit Carlton ; n’y voyons-nous pas Athanase en lutte contre le monde entier, et le monde entier luttant contre Athanase ? — Alors, répliqua Charles, je dirai seulement qu’un homme de parti doit se tenir bien au-dessus ou bien au-dessous du vulgaire. — Ici encore, je ne saurais partager votre idée ; vous supposez qu’un chef de parti a la conscience de ce qu’il fait, et qu’ayant cette conscience il peut être, selon vos paroles, bien au-dessus ou bien au-dessous du vulgaire ; mais quel besoin a-t-il de se dire à lui-même qu’il forme un parti ? — Voilà qui est plus difficile à concevoir, s’écria Vincent, que toute autre opinion qui ait été avancée cette après-midi. — Il n’y a pas de difficulté, répondit Carlton. Prétendriez-vous qu’il n’y eût qu’un seul moyen d’obtenir de l’influence ? Évidemment, il y a une influence qui n’a pas conscience d’elle-même. — Je croirais aussi volontiers, repartit Vincent, que la beauté ignore ses charmes. — C’est là une pensée mesquine. Un homme est assis dans sa chambre et il écrit ; ne peut-il pas ignorer ce qu’on pense de lui ? — Je croirais ceci encore moins, appuya Vincent ; la beauté est un fait ; l’influence est un effet. Les effets supposent des agents ; une action suppose une volonté, une conscience. — Il y a différents modes d’influence, fit observer Sheffield ; l’influence est souvent spontanée et presque fatale. — Comme la lumière sur la face de Moïse, ajouta Carlton. — On dit que Bonaparte avait un sourire irrésistible, reprit Sheffield. — Qu’est-ce que la beauté elle-même, sinon une influence spontanée ? continua Carlton ; ne vous rappelez-vous pas « la jeune et aimable Lavinia » de Thompson ? — Eh bien, messieurs, s’écria Vincent, lorsque je serai chancelier, je donnerai un prix pour un essai sur « l’Influence morale, ses espèces et ses causes », et c’est à M. Sheffield qu’il sera décerné ; quant à Carlton, il sera mon professeur de poésie lorsque je serai la Convocation. »
Vous allez dire, cher lecteur, que nos amis firent une bien courte promenade sur la colline, si nous vous annonçons qu’ils rentraient déjà, en baissant la tête, sous la petite porte du cottage. Mais la littera scripta, dans sa précision, abrége merveilleusement la vagabonde vox emissa, et il y eut peut-être d’autres choses dites dans la conversation, dont l’histoire n’a pas daigné fixer le souvenir. En tout cas, nous sommes obligé d’introduire de nouveau nos amis dans la salle où ils avaient pris leur repas, et où ils trouvèrent le thé tout préparé et la bouilloire déjà sur la table. Le pain et le beurre étaient excellents, et ils en firent justice comme s’ils ne venaient pas de dîner. « Je vois que vous conservez votre thé dans des boîtes d’étain, dit Vincent ; je préfère le cristal. N’épargnez pas le thé, monsieur Reding : généralement les hommes d’Oxford n’ont pas de reproche à se faire sur ce point. Lord Bacon dit que le premier et le meilleur jus du raisin, de même que le premier, le plus pur et le meilleur commentaire sur l’Écriture, n’est pas pressé ni extrait par force, mais qu’il provient d’une exsudation naturelle. C’est ce qui a lieu en Italie de nos jours ; et l’on appelle ce jus lagrima ; ainsi en est-il du thé et du café. Prenez-en une grande quantité, versez-y de l’eau, retirez la liqueur ; retirez-la tout de suite, ne la laissez pas se reposer, elle devient un poison. Je suis grand amateur de thé ; le poëte l’a dit avec raison : « Il réjouit, mais il n’enivre pas. » Il a parfois un singulier effet sur mes nerfs ; il me fait siffler ; c’est ce que l’on m’assure ; mais je ne m’en suis jamais aperçu. Parfois aussi il a un effet dyspeptique. Je trouve qu’il ne faut pas le prendre trop chaud. Nous autres Anglais, nous buvons nos liqueurs trop chaudes. Ce n’est pas le défaut des Français ; non, certes. En France, dans l’intérieur du pays, on ne peut avoir pour son déjeuner que du vin acide et des raisins ; c’est un autre extrême, et il m’a jadis terriblement éprouvé. Cependant les acides ont également sur certaines personnes un effet agréable et sédatif, la limonade surtout. Mais rien ne me va aussi bien que le thé. Carlton, continua-t-il mystérieusement, connaissez-vous le remède préventif de feu le docteur Baillie contre la flatulence que produit le thé ? Et vous, monsieur Sheffield ? » Tous les deux répondirent négativement. — Des fleurs de camomille : un peu de camomille, pas beaucoup. Quelques personnes mâchent de la rhubarbe, mais un peu de camomille dans le thé n’est pas perceptible. Ne faites pas la grimace, monsieur Sheffield ; je dis un peu ; un peu de chaque chose, et c’est parfait : ne quid nimis. Évitez les extrêmes. Ainsi en doit-il être du sucre. Monsieur Reding, vous en mettez trop dans votre thé. J’établis cette règle : le sucre ne devrait pas être un élément substantif dans le thé, mais un adjectif ; le thé a une âpreté naturelle : le sucre n’a pour but que de la faire disparaître ; son emploi est négatif. Quand il y entre au delà, c’est trop. Eh bien, Carlton, il est temps que je voie après mon cheval. Je crains que pour lui cette après-midi n’ait pas été aussi agréable que pour moi. Je me suis fort amusé dans votre villa suburbaine. Quelle délicieuse lune ! mais j’ai un bout de chemin assez dur à parcourir. Je n’ose pas galoper sur les ornières à cause des carrières de sable qui sont près de la route. Monsieur Sheffield, faites-moi le plaisir de me montrer le chemin de l’écurie. Au revoir, Carlton ; bonsoir, monsieur Reding. »
Lorsqu’ils furent seuls, Charles demanda à Carlton, s’il croyait réellement que les chefs actuels du Mouvement d’Oxford fussent exempts de l’esprit de parti. « Il ne faut pas vous méprendre sur mon opinion, répondit le tuteur ; je ne connais pas très-bien ces messieurs, mais je sais que ce sont des hommes d’un grand mérite et d’un caractère élevé ; et je veux les juger avec toute la faveur possible. Ils sont attaqués déloyalement, c’est un fait. Ainsi, ils sont accusés de vouloir faire de la parade, de viser à l’influence et au pouvoir, d’aimer l’agitation, et que sais-je ? Je ne puis nier que certains de leurs actes n’aient une apparence fâcheuse et ne donnent un caractère plausible à ces reproches. Je voudrais qu’en certaines occasions ils eussent agi autrement. Je pense, toutefois, qu’il est de toute justice de se dire que l’existence des partis n’est pas leur faute. Ils ne font que revendiquer leurs droits de naissance comme Protestants. Lorsque l’Église ne parle pas, d’autres veulent parler à sa place ; et les hommes instruits ont plus que personne le droit de le faire. De même, lorsque des hommes instruits prennent la parole, d’autres veulent les entendre ; et c’est ainsi que la formation d’un parti est plutôt le fait de ceux qui suivent, que de ceux qui sont à la tête. »
Sheffield avait quelques amis à Chalton, village voisin, chez un scholar de Saint-Michel, qui y possédait une petite cure et un presbytère. L’un d’entre eux était également connu de Charles ; c’était notre ami White, qui préparait son examen, et qui, durant les six derniers mois, s’était efforcé de regagner le temps qu’il avait gaspillé pendant ses premières années à Oxford. Charles, depuis leur première rencontre, l’avait perdu de vue, ou à peu près, et à cette époque de leur vie, un temps si considérable ne pouvait s’écouler sans modifier leurs caractères en bien ou en mal, peut-être aussi des deux manières à la fois. Carlton et Charles, qui étaient souvent restés seuls à cause des courses fréquentes de Sheffield à Chalton, rentraient un soir de leur promenade, lorsqu’ils trouvèrent sur leur chemin White, qui revenait d’Oxford, où il avait été faire une visite à M. Bolton. A peine avaient-ils fait quelques pas qu’ils furent rejoints par Sheffield et le ministre de Chalton, M. Barry ; et la société se trouva alors composée de cinq personnes.
« Ainsi vous allez perdre Upton ? disait Barry à Reding ; c’est un excellent tuteur ; vous aurez de la peine à vous en passer. Qui le remplace ? — Nous l’ignorons, répondit Charles ; le Principal fera, probablement, venir de l’intérieur du pays un des jeunes fellows. — Oh ! mais vous ne retrouverez pas un homme comme Upton, dit Carlton ; il connaissait si parfaitement sa matière ! Son cours sur Agricola, de l’avis de vos messieurs, aurait pu être publié. C’était un commentaire magistral, minutieux et vif sur le texte, qu’il envisageait sous tous les rapports. — Oui, c’était là qu’il brillait, reprit Charles ; cependant il ne surchargeait pas ses cours, et il ne disait rien qui ne fût utile et nécessaire. — Il a obtenu un gros bénéfice, dit Barry, et de plus un presbytère parfaitement approprié et tout neuf, qui n’est qu’à une heure de Londres par le chemin de fer. — Et 500 livres sterling, ajouta White ; c’est ce que m’a dit M. Bolton, qui a été voir la cure. C’est dans le voisinage de ma future résidence ; le pays est fort beau, et il y a plusieurs bonnes maisons aux alentours. — On dit qu’il va épouser la fille du doyen de Selsey, reprit Barry ; Miss Juliette, la treizième, une fort jolie personne. Connaissez-vous la famille ? — Oui, répondit White, je les connais tous ; c’est une famille charmante ; madame Bland est une délicieuse femme, pleine de distinction. C’est une bonne fortune pour moi d’être sous la juridiction du doyen. Je pense que nous nous entendrons. — C’est un homme instruit, ajouta Barry ; ses discours sont toujours bien écrits. En son temps, il avait un nom connu à Cambridge. — Mais dites donc, White, s’écria Sheffield, est-ce qu’il n’a pas écrit dernièrement contre vos amis d’Oxford ? — Mes amis ! répondit White, qui voulez-vous dire ? Il a écrit contre les partis et les chefs de parti ; et c’est avec raison, je pense. Oh ! oui, il faisait allusion au pauvre Willis et à certains autres. — Il y avait plus que cela, reprit Sheffield ; il s’est élevé contre certains discours et certaines pratiques qui ont eu lieu à Sainte-Marie. — Eh bien, quant à moi, franchement, je ne saurais approuver tout ce qu’on prêche du haut de cette chaire, dit White. Je sais, comme un fait positif, que Willis se plaît à rapporter à ce qu’il a entendu dans cette chapelle ses penchants au Papisme. — Je voudrais que prédicateurs et auditeurs, reprit Barry, s’en allassent tous ensemble une bonne fois ; alors, nous aurions enfin le calme nécessaire pour nous livrer aux véritables études de l’Université. — Prenez garde à vos paroles, Barry, dit Sheffield ; vous exceptez sans doute les personnes présentes ? Vous, White, vous êtes bien, je pense, dans la catégorie des auditeurs ? — Moi ! s’écria White ; pas du tout. Je suis allé jadis, comme la plupart des étudiants, à Sainte-Marie pour entendre le prédicateur ; mais je crois qu’il est souvent peu judicieux, qu’il frise même l’erreur. La tendance de ses discours, c’est de nous faire prendre en aversion notre propre Église. — Si ma mémoire ne me trompe, reprit Sheffield, il me semble qu’un de mes amis m’a soutenu contre notre Église des propositions dix fois aussi fortes qu’un prédicateur quelconque l’ait jamais fait dans Oxford. — Vous voulez parler de moi, répliqua White avec chaleur ; vous m’avez très-mal compris. J’ai toujours été fort dévoué à l’Église d’Angleterre. Vous ne m’avez jamais entendu dire la moindre chose qui ne s’alliât pas avec l’attachement le plus ardent pour elle. C’est vrai, je n’ai jamais nié les droits de l’Église romaine à être une branche de l’Église catholique, je ne le nierai jamais ; cela est tout à fait une autre question ; il y a bien des choses que nous pouvons emprunter avec beaucoup d’avantage aux Papistes ; mais j’ai toujours aimé et j’espère vénérer toujours ma propre mère, l’Église de mon baptême. »
La figure de Sheffield prit une singulière expression, et personne ne dit mot. White continua, tâchant de garder un air d’indifférence : « Il est remarquable que M. Bolton, qui, quoique laïque et non théologien, est un homme sensé, pratique et clairvoyant, n’a jamais aimé cette chaire ; il a toujours prophétisé qu’il n’en sortirait rien de bon. » Comme le silence continuait, White se mit à attaquer Sheffield. « Je vous défie, dit-il avec une affectation de gaieté, de prouver ce à quoi vous avez fait allusion ; c’est honteux ! Il est aisé de parler contre les autres, de les appeler des hommes peu judicieux, extravagants, et que sais-je ? Vous êtes la seule personne… — Bien, bien, très-bien, mon ami, répliqua Sheffield ; nous ne faisons que vous canoniser, et je représente l’avocat du diable. »
Charles désirait avoir quelques renseignements sur Willis ; il détourna donc le courant des idées de White, en lui demandant, après s’être approché de lui, s’il y avait quelque chose de vrai dans ce que Vincent lui avait raconté plusieurs semaines auparavant. White avait-il eu récemment des nouvelles de Willis ? White ne savait presque rien de positif sur ce jeune homme, et ne pouvait affirmer si ce bruit était vrai ou faux. Ce qu’il y avait de sûr, c’est que Willis était de retour du continent et qu’il vivait dans sa famille. Il ne s’était donc pas livré à l’Église de Rome, soit comme étudiant en théologie, soit comme novice ; mais White ne pouvait en dire davantage. Autre chose cependant : il avait appris, et le fond d’une lettre qu’il avait reçue de Willis lui-même corroborait ce rapport ; il avait appris qu’il était très-prononcé sur ce point, que l’Église de Rome et l’Anglicanisme forment deux religions différentes ; que ces deux religions, nous ne pouvons les amalgamer ensemble ; qu’il nous faut être ou Romains ou Anglicans, mais que nous ne pouvons être ni Anglo-Romains, ni Anglo-Catholiques. « Voilà ce qu’un ami m’a rapporté, continua White. Quant à la lettre que Willis m’a écrite, je ne puis comprendre tout à fait sa pensée ; mais il y parle longuement de la nécessité de la foi pour devenir catholique. Il dit que personne ne devrait passer à l’Église de Rome pour ce seul motif, qu’il croit l’aimer davantage ; que lui, Willis, a vu par expérience que nul ne peut vivre rien que de sentiment ; que tout le système du culte dans l’Église romaine est différent du nôtre ; bien plus, que la véritable idée du culte, l’idée de la prière, que la doctrine de l’intention elle-même, considérée dans toutes ses parties, constitue une nouvelle religion. Il ne parle pas de lui-même d’une manière positive ; mais il dit, en général, que tout cela pourrait être cause d’un grand découragement pour un converti et le faire revenir sur ses pas. En somme, le ton de sa lettre est celui d’un homme désappointé, et qu’on pourrait ramener aisément : au moins telle a été mon impression. — J’admets bien qu’il est plus triste ; mais il est aussi plus sage, reprit Charles ; j’ignorais qu’il eût en lui cette qualité. Il y a dans tout cela plus de bon sens qu’une personne aussi excitable qu’il me paraissait être ne peut ordinairement en montrer ; mais en même temps, il n’y a rien qui prouve de sa part le regret de s’être converti. — Je vous l’ai accordé, répondit White ; toutefois l’effet de sa lettre est d’empêcher d’autres de le suivre, en mettant des obstacles dans leur chemin ; et d’ailleurs, il nous faut rattacher tout ceci au fait de son retour dans sa famille. » Charles réfléchit un instant. « Le témoignage de Vincent, reprit-il, est la confirmation ou la simple exagération de ce que vous venez de dire ; cela dépend de la source où il a puisé ses renseignements. » Il se dit ensuite à lui-même : « White, également, a plus de sagesse que je n’aurais cru ; il a parlé de Willis avec beaucoup de bon sens. Que lui est-il arrivé ? »
Nos voyageurs parvinrent bientôt à un endroit où la route formait deux sentiers, et tandis que les deux habitants de Chalton prenaient à droite, Carlton et ses élèves tournèrent à gauche. Un peu plus loin, le tuteur se sépara de Charles et de Sheffield, et les deux amis atteignirent leur cottage juste à temps pour voit le coucher du soleil.
Quelques jours après, Carlton, Sheffield et Reding s’entretenaient en plein air, après le dîner, sur le compte de White. « Comme il est changé, disait Charles, depuis que je l’ai vu pour la première fois ! — Changé ! s’écria Sheffield ; il était jadis enjoué comme un petit chat, il est devenu triste et ennuyeux comme une vieille chatte. — Il est changé en mieux, reprit Charles ; sa conversation a maintenant quelque chose de sensé et de ferme, mais il n’était guère sage il y a deux ans. Il étudie aussi avec beaucoup d’ardeur. — Il a quelque raison de le faire, mon cher, car il est terriblement en retard. Mais il y a une autre cause à son ardeur ; peut-être la connaissez-vous ? — Moi ? non, en vérité. — Je croyais que vous la saviez, reprit Sheffield. Vous avez certainement entendu dire qu’il est fiancé à une demoiselle d’Oxford ! — Fiancé ! quelle absurdité ! — Je ne vois pas cela du tout, mon cher Reding, repartit Carlton. White en a bien le moyen ; il a une bonne cure en perspective ; et, de plus, il ne perd pas son temps, de cette manière, ce qui est important dans la vie, où on le prodigue si souvent. White se trouvera bientôt établi, selon toute la force du mot, dans ses idées, dans sa vie, dans sa carrière. ».
Charles ne put s’empêcher d’exprimer sa surprise. Il se rappelait que lors de sa première rencontre avec White, celui-ci s’était montré un très-ardent défenseur du célibat ecclésiastique. Carlton et Sheffield se mirent à rire. « Eh ! pensez-vous, dit le premier, qu’un jeune homme de dix-huit ans puisse avoir une opinion sur un tel sujet, ou qu’il se connaisse assez pour prendre une résolution dans son propre cas ? En toute justice, peut-on regarder un homme comme invinciblement lié à toutes les opinions et à toutes les paroles extravagantes qu’il a émises au sortir de l’école ? — White avait lu quelque livre exalté, reprit Sheffield, où il avait vu quelque belle nonne sculptée sur le jubé d’un sanctuaire, et il avait été séduit par le roman, comme d’autres l’ont été et le sont encore. — Ne croyez-vous pas, dit Carlton, que tous ces braves garçons qui, à cette heure, sont si pleins de « la pureté sacerdotale », de la « béatitude angélique » et du reste, seront tous, depuis le premier jusqu’au dernier, mariés d’ici à dix ans ? — J’accepterais le pari, reprit Sheffield, que l’un se prononcera de bonne heure, un autre plus tard, mais qu’il y a un temps marqué pour tous. Dix ou douze années écoulées, comme dit Carlton, et nous trouverons A. B. dans un vicariat, l’heureux père de dix enfants ; C. D. faisant une cour assidue à un objet chéri, jusqu’à ce qu’un bénéfice lui arrive ; E. F. dans sa lune de miel ; G. H. favorisé de deux jumeaux par Mme H ; I. K. tout transporté de bonheur, parce qu’il vient d’être accepté ; quant à L. M., il peut rester ce que Gibbon appelle « une colonne au milieu des ruines », et colonne très-chancelante. — Croyez-vous donc, répliqua Charles, que les hommes pensent si peu ce qu’ils disent ? — Vous prenez les choses trop au sérieux, Reding, repartit Carlton ; qui ne change pas d’opinions de vingt à trente ans ? Un jeune homme entre dans la vie avec les idées de son père ou de son tuteur ; mais il finit par les changer, tôt ou tard, pour les siennes propres. Plus il est modeste et timide, plus il est crédule, et plus longtemps il parle le langage des autres ; mais la force des circonstances ou la vigueur de son esprit l’oblige infailliblement, à la fin, à avoir un esprit à lui, supposé qu’il ait quelque valeur. — Mais je soupçonne, dit Reding, que la dernière génération, celle des pères comme celle des tuteurs, n’avait pas des idées très-exaltées sur le célibat ecclésiastique. — Souvent les circonstances, répondit Carlton, nous imposent des opinions que nous suivons pendant un temps. — Eh bien, j’honore les hommes qui portent leurs habits de famille ; je ne respecte pas du tout ceux qui commencent par les modes étrangères, et qui ensuite les abandonnent. — Quelques années de plus, reprit Carlton en souriant, rendront votre jugement moins sévère. — Je n’aime pas les bavards, continua Charles ; je crois, j’espère ne les aimer jamais. — Je sais bien ce qu’il y a au fond de tout ceci, reprit Sheffield ; mais je ne puis rester plus longtemps ; il faut que je rentre pour étudier. Reding aime trop le commérage. — Qui bavarde autant que vous ? répliqua Charles. — Mais je parle vite, quand je bavarde, riposta Sheffield, et je fais beaucoup de besogne ; puis je me tais. Mais vous, vous parlez fastidieusement, et vous rêvez, et vous soupirez, et vous parlez encore. » Ce disant, il les quitta.
« Qu’est-ce que cela signifie ? » demanda Carlton. Charles rougit un peu et se mit à rire : « Carlton, répondit-il, vous êtes un homme à qui je confie des choses que je ne dirais pas à d’autres ; quant à Sheffield, il s’imagine qu’il a trouvé cela de lui-même. » Son tuteur le regarda vivement et avec un air de curiosité. « Je suis honteux de moi-même, continua Charles en riant et paraissant confus ; je vous ai fait croire que j’avais quelque chose d’important à vous communiquer, tandis que, en réalité, je n’ai rien. — Alors, parlez ouvertement. — A dire vrai… Non, réellement, c’est trop absurde. Je me suis moqué de moi-même. » Il fit quelques pas pour s’en aller ; puis il revint. « Eh bien, reprit-il, voici le fait : Sheffield s’imagine que j’ai moi-même un secret penchant pour… le célibat. — Un penchant pour qui ? demanda le tuteur. — Un penchant pour le célibat. » Il y eut un moment de silence, et la figure de Carlton changea un peu. « Oh ! mon cher ami, dit-il avec bienveillance, vous êtes donc un des leurs ; mais tout cela passera. — Peut-être, répondit Charles : je n’insiste pas sur cette matière. C’est Sheffield qui m’en a fait parler. » Une différence réelle de sentiments et de vues venait évidemment d’être exprimée par les deux amis, très-sympathiques d’ailleurs, et très attachés l’un à l’autre. Il y eut un silence de quelques secondes.
« Vous êtes ordinairement un jeune homme très-sensé, Reding, reprit Carlton ; je suis surpris que vous adoptiez cette opinion. — Ce n’est pas chez moi une opinion nouvelle, répondit Charles ; vous allez sourire, mais je l’avais dès l’école, n’étant encore qu’un enfant, et j’ai toujours pensé depuis lors que je ne me marierais jamais ; non que ce sentiment n’ait pas eu d’intermittence, mais c’est l’état habituel de mon esprit. Mes pensées, en général, sont tournées de ce côté-là. Si je me mariais, je redouterais le châtiment de Thalaba[59]. » Carlton mit sa main sur l’épaule de Charles et la secoua doucement : « Reding, dit-il, cela me surprend. » Puis, après un court silence : « J’ai toujours pensé que le célibat et le mariage étaient bons chacun à sa manière. Dans l’Église de Rome, je le vois, le célibat produit un grand bien ; mais, soyez-en convaincu, mon cher ami, vous faites une grosse bévue si vous voulez introduire le célibat dans l’Église anglicane. — Il n’y a rien contre le célibat dans le Prayer-Book, ni dans les Articles, répliqua Charles. — C’est possible ; mais l’esprit, l’organisation et le travail de notre Église y sont entièrement contraires. Par exemple, nous n’avons pas de monastères pour secourir les pauvres ; et si nous en avions, je pense que dans l’état où sont les choses, une femme de ministre serait, par son utilité pratique et réelle, infiniment supérieure à tous les moines qui ont jamais porté tonsure. Je vous l’avoue, je crois que l’évêque d’Ipswich est presque justifié lorsqu’il établit que nul, sinon les ministres mariés, n’aura, de sa part, des chances pour son avancement. J’approuve aussi l’évêque d’Abingdon, qui s’est fait une règle d’accorder en dot ses meilleurs bénéfices aux demoiselles les plus vertueuses de son diocèse. » Carlton avait parlé avec plus d’énergie qu’à l’ordinaire.
[59] Dans un poëme de Southey intitulé Thalaba, ce héros trouve sa femme morte le jour même de ses noces.
Charles répondit qu’il n’avait pas envisagé l’à-propos ou la possibilité de la chose, qu’il avait seulement songé à ce qui lui avait paru le meilleur en soi, et à ce qu’il ne pouvait s’empêcher d’admirer. « Je n’ai pas parlé du célibat ecclésiastique, fit-il observer, mais du célibat en général. — Le célibat n’a pas de place dans nos idées ni dans notre système de religion, croyez-moi, dit le tuteur. Il est indifférent qu’il y ait quelque chose de contraire dans les Articles ; la question ne roule pas sur des règles formelles, mais sur ceci : l’esprit de l’Anglicanisme n’est-il pas tout à fait en désaccord avec cette discipline ? L’expérience de trois siècles est certainement suffisante comme preuve ; si nous ne connaissons pas le caractère de notre religion au bout de ce temps, quand le connaîtrons-nous ? Il y a des formes de religion dont toute l’existence n’a pas eu cette durée. Or, examinez les cas de célibat par amour du célibat dans cette période, et quelle en sera la somme totale ? Il y a quelques exemples ; mais Hammond lui-même, qui mourut célibataire, fut sur le point de se marier pour répondre au désir de sa mère. D’autre part, si vous cherchez les types de notre Église, pouvez-vous en désigner de plus vrais que leurs excellences mariées, le profond Hooker, le pieux Taylor et Bull le controversiste ? Le premier de tous les primats réformés était marié. Pole et Parker personnifient d’une manière frappante les deux systèmes, le romain et l’anglican. — Eh bien, répondit Charles, il me paraît qu’il est aussi tyrannique de contraindre au mariage que d’obliger au célibat, et c’est ce à quoi vous poussez réellement. Vous me dites que quiconque ne se marie pas est une brebis noire. — Ce n’est pas pour vous une difficulté pratique en ce moment ; personne ne vous demande d’aller précisément, à cette heure, entreprendre le voyage du Célibataire[60] avec Aristote en main et la liste de classe[61] en perspective. — Excusez-moi, mon cher Carlton, si je vous ai dit quelque folie ; vous ne supposez pas que je discute avec d’autres sur de pareils sujets. »
[60] Roman anglais dont le héros court le monde à la recherche d’une femme.
[61] La liste de classe (class-list) c’est-à-dire la liste de ceux qui ont réussi dans leur examen ; elle est divisée en quatre catégories, selon le mérite des candidats reçus.
Tout en causant, ils étaient arrivés à l’habitation de Carlton, où se trouvaient précisément les livres que Charles avait plus particulièrement à étudier alors ; et ils firent, avant d’entrer, deux ou trois tours sous de beaux hêtres plantés devant la maison. « Expliquez-moi, Reding, car je ne vous comprends pas, dit le tuteur, quelles sont vos raisons pour admirer un état qui, évidemment, est contre nature. — N’en parlons pas davantage, mon cher Carlton, répondit Charles, j’arriverais à faire rire de moi. Laissons, je vous prie, toutes choses en paix, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. » Il était clair qu’un sentiment pénible s’agitait en lui ; les paroles et le ton étaient trop sérieux pour la circonstance. Carlton comprit également que la question qui, tout d’abord, lui avait paru secondaire, était au fond plus importante ; sans cela, il n’y aurait pas mis tant d’insistance, selon le désir de Charles. « Non, reprit-il ; puisque nous sommes sur cette matière, permettez-moi de connaître votre opinion. Il a été dit, dès l’origine : « Croissez et multipliez » ; donc le célibat est contre nature. — Surnaturel, repartit Charles en souriant. — N’est-ce pas là un mot vide de sens ? objecta Carlton. Butler nous apprend qu’il y a une analogie entre la nature et la grâce ; autrement, vous pourriez comparer le paganisme à la nature ; et, partout où le paganisme lui est contraire, soutenir qu’il est surnaturel. Les convulsions des Wesleyens sont en dehors de la nature ; pourquoi ne pas les appeler surnaturelles ? — Je crois, répliqua Charles, que nos théologiens, ou au moins quelques-uns d’entre eux, sont ici pour moi : Jérémie Taylor, par exemple. — Vous ne m’avez pas expliqué ce que vous entendez par le mot surnaturel, Charles, j’ai besoin, vous le savez, de connaître votre pensée. — Il me paraît que le christianisme, étant la perfection de la nature, lui ressemble et en diffère en même temps ; il lui ressemble là où il est le même et autant qu’elle ; il en diffère là où il est autant et plus qu’elle. J’entends par surnaturel la perfection de la nature. — Donnez-moi des exemples. — Des exemples, en voici : Notre-Seigneur dit : « Vous avez appris qu’il a été dit des temps anciens… mais moi je vous dis » ; ce contraste entre les deux membres de phrase indique la voie plus parfaite, ou l’Évangile… « Il est venu non pour détruire la loi, mais pour l’accomplir… » Je ne puis me rappeler tout de suite… Ah ! voici encore un cas applicable au sujet ; Notre-Seigneur abolit la permission qui avait été donnée aux Juifs à cause de la dureté de leurs cœurs. — Cet exemple ne va pas tout à fait à la question, mon ami ; car les Juifs, dans leurs divorces, étaient tombés au-dessous de la nature. « Que l’homme ne sépare pas… » telle fut la règle dans le paradis. — Cependant, il est certain que l’idée d’un Apôtre non marié, chaste, vivant dans le jeûne et le dénûment, et à la fin martyr, est une idée plus haute que celle d’un des anciens Israélites, assis sous sa vigne et son figuier, regorgeant de biens temporels, et entouré de ses enfants et de ses petits-enfants. Je ne condamne ni Gédéon ni Caleb ; je développe saint Paul. — Le cas de saint Paul est un cas tout particulier. — Mais il établit lui-même la maxime générale qu’il est « bon » pour tout homme de demeurer comme il était lui-même. — Nous arrivons maintenant à une question de critique : que veut dire le mot « bon » ? Je puis croire qu’il signifie « avantageux », et ce que dit l’Apôtre touchant « les misères présentes » confirme cette interprétation. — Je n’en viendrai pas à une question de critique, reprit Charles ; mais prenez ce texte : « Ma mère m’a conçu dans l’iniquité. » Ces paroles ne montrent-elles pas que, en dehors et par-dessus la doctrine du péché originel, il y a, pour ne pas dire pis, grand risque que le mariage ne conduise au péché les personnes engagées dans cet état ? — Mon cher Reding, répondit Carlton étonné, vous donnez dans le Gnosticisme. — Non pas sciemment. Comprenez ce que je veux dire ; ce n’est pas un sujet sur lequel je puisse parler ; mais, sans vouloir soutenir que les personnes mariées doivent pécher (ce qui serait du Gnosticisme), il me paraît qu’il y a danger de pécher. Permettez-moi de ne rien ajouter sur cette matière.
— J’ai toujours eu pour principe, reprit le tuteur, après avoir réfléchi un moment, de considérer le Christianisme comme ayant pour fin la perfection de l’homme tout entier, en tant que corps, âme et esprit. Ne vous méprenez pas sur le sens de mes paroles. Les Panthéistes disent le corps et l’intelligence, laissant de côté le principe moral ; mais, moi, je dis l’esprit aussi bien que l’intelligence. L’esprit, principe de la foi religieuse ou de l’obéissance, doit être le principe maître ; l’hegemonicon. A l’esprit sont soumis l’intelligence et le corps, mais comme cette suprématie n’implique pas le mauvais usage, l’esclavage de l’intelligence, elle n’implique pas non plus celui du corps ; l’intelligence et le corps doivent être bien traités. — Pour moi, au contraire, répliqua Charles, je pense que cette suprématie implique, dans un certain sens, l’esclavage de l’intelligence et celui du corps en même temps. Qu’est-ce que la foi, sinon la soumission de l’intelligence ? Et, de même que « toute haute pensée est retenue captive », ainsi il nous est expressément recommandé de réduire le corps en servitude. L’intelligence et le corps sont bien traités, lorsqu’ils sont traités de manière à devenir les instruments du principe souverain lui-même. — Voilà ce qui, pour moi, est contre nature, dit Carlton. — Et c’est ce que j’entends par surnaturel, répliqua Charles avec un peu de vivacité. — Mais comment donc est-ce une chose surnaturelle, ou une addition à la nature, que d’en détruire une partie ? demanda Carlton. » Charles était embarrassé. C’était, dit-il, une voie vers la perfection ; mais il croyait que la perfection n’aurait lieu qu’après la mort. Notre nature ne pouvait être parfaite avec un corps corruptible ; le corps était traité ici-bas comme un corps de mort. « Eh bien, Charles, reprit Carlton, d’après moi, vous faites du Christianisme une religion très-différente de celle que notre Église admet. » Et il se tut un moment.
« Voyez donc, continua-t-il, comment pouvons-nous nous réjouir dans le Christ, comme ayant été rachetés par lui, si nous sommes dans cette espèce d’état de tristesse et de pénitence ? Que n’a pas dit saint Paul sur la paix, l’action de grâces, la confiance, le bonheur, et le reste ! Les choses anciennes sont passées ; la loi judaïque est détruite ; le pardon et la paix sont venus : voilà l’Évangile. — Ne pensez-vous donc pas, dit Charles, que nous devons nous attrister pour les fautes dans lesquelles nous sommes entraînés chaque jour, et pour les péchés plus graves que nous pouvons avoir commis de temps à autre ? — Sans doute ; c’est ce que nous faisons dans les prières du matin et du soir, et dans le service de la communion. — Bien ; mais supposez qu’un jeune homme, comme il arrive si souvent, ait négligé ses devoirs religieux, et qu’il ait en même temps sur la conscience tout un fardeau de péchés, de péchés abominables ; pensez-vous, lorsqu’il revient à un nouveau genre de vie et qu’il va à la communion, qu’il soit pardonné tout de suite en disant tout simplement son Confiteor, en le disant même avec cette contrition que les grands pécheurs devraient avoir ? Pensez-vous qu’il n’ait plus rien à craindre touchant ses fautes passées ? — Je dirais oui, répondit Carlton. — Vraiment ? reprit Charles tout pensif. — Il va sans dire, ajouta Carlton, que je le suppose réellement contrit ou pénitent. Sa conduite future prouvera s’il l’est ou s’il ne l’est pas. — Je ne puis en aucune manière admettre ce sentiment ; je pense que des hommes très-sérieux s’affligeraient même pour une faute légère, et qu’ils ne croiraient pas avoir obtenu leur pardon pour l’avoir simplement demandé. — Sans doute ; mais Dieu pardonne à ceux qui ne se pardonnent pas à eux-mêmes. — C’est-à-dire, repartit Charles, à ceux qui n’éprouvent pas tout de suite la paix, l’assurance et la consolation ; à ceux qui ne jouissent pas de la joie parfaite de l’Évangile. — Ces personnes s’affligent, mais elles se réjouissent en même temps. — Mais, dites-moi, Carlton, ce chagrin, ce trouble, cette crainte de se pardonner à soi-même, tout cela est-il agréable à Dieu ? — Assurément. — Donc une pénitence volontaire pour le péché commis lui est agréable ; et s’il en est ainsi, qu’importe que la pénitence tombe sur l’âme ou sur le corps ? — Mais ce n’est pas proprement une pénitence volontaire, la pénitence volontaire implique une intention ; la douleur du péché est quelque chose de spontané. Lorsque vous vous affligez vous-même à dessein, vous vous éloignez sur-le-champ du pur Christianisme. — Eh bien, je m’imaginais que le jeûne, l’abstinence, le travail et le célibat pouvaient être regardés comme une expiation du péché. Ce n’est pas là une idée extravagante ; rappelez-vous le docteur Johnson, devenu homme, se tenant à la pluie au milieu du marché de Lichfield, pour expier une désobéissance de son jeune âge commise envers son père. — Mon cher Reding, reprit Carlton, laissez-moi vous ramener à ce que vous disiez au début de cet entretien, et à la réponse que je vous faisais : ce que vous soutenez en ce moment ne sert qu’à rendre ma réponse plus exacte. Vous avez commencé par dire que le célibat était une perfection de la nature ; maintenant, vous en faites une pénitence ; d’abord c’est un état excellent et glorieux, puis c’est un remède et une punition. — Peut-être, la pénitence est-elle notre plus haute perfection en ce monde, répondit Charles ; mais, je l’ignore, je ne prétends pas avoir des idées claires sur la question. J’ai parlé plus que je n’aime à le faire en général. Renonçons enfin à ce sujet. »
Ils passèrent donc aux matières qui étaient en rapport avec les études de Charles. Rentrés ensuite à la maison, ils travaillèrent sur Polybe. On ne peut nier, toutefois, que le reste du jour les manières de Carlton n’eussent quelque chose de singulier, comme s’il avait été contrarié. Le lendemain matin, il avait repris son air habituel.
Arrêter la marche de l’esprit est chose impossible. Pendant deux ans, Charles avait éloigné ses pensées de controverses religieuses ; vains efforts : ses vues sur la religion avaient progressé tous les jours à son insu. Cela devait être ainsi, supposé qu’il dût vivre d’une vie quelque peu religieuse. S’il devait honorer son créateur et lui obéir, des actes intellectuels, des conclusions et des jugements devaient accompagner ce culte et cette obéissance. Il pouvait ne pas formuler sa propre croyance jusqu’à ce que les questions lui eussent été posées ; mais, le cas échéant, une seule discussion avec un ami, comme par exemple celle qu’il avait eue avec son tuteur, devait produire au jour ce qu’il regardait comme sa propre opinion, préciser les limites de chaque opinion telle qu’il la croyait, et déterminer les rapports de ces opinions entre elles. Il n’avait pas encore donné de nom à ces opinions, encore moins avaient-elles pris dans son esprit la forme scientifique ; elles ne pouvaient, non plus, dans son état, être exprimées dans le langage de la théologie. Charles était tout simplement un jeune homme de vingt-deux ans, qui professait, dans une heure de conversation avec un ami, ce qui était réellement la doctrine et les usages du Catholicisme sur la pénitence, le purgatoire, les conseils de perfection, la mortification personnelle et le célibat ecclésiastique. Il n’était donc pas étonnant que tout cela tourmentât Carlton, quoiqu’il ne vît, pas plus que Charles, que tout ce Catholicisme était en fait caché sous les aveux de son élève. Mais il sentait, dans les principes avancés par celui-ci, se révéler une « chose très-différente de l’Église d’Angleterre », selon ses propres expressions ; une chose nouvelle pour lui, et peu agréable, qui en même temps avait un corps, une vie, qui ne pouvait disparaître comme un son vague et rapide, comme une nuée fugitive, mais qui, reposant sur un fondement réel, se faisait sensiblement reconnaître et manifestait son existence avec force.
Ici, nous voyons ce qu’une personne entend quand elle dit que le système catholique va à son esprit, qu’il réalise ses idées sur la religion, qu’il répond à ses sympathies, et autres choses semblables ; et que là-dessus elle se fait catholique. On dit souvent d’une telle personne qu’elle procède par la voie du jugement privé, qu’elle choisit sa religion d’après l’idée qu’elle s’est faite de sa nature. Or, on ne peut nier que ceux qui sont étrangers à l’Église ne doivent commencer par le jugement privé ; ils s’en servent d’abord, mais ils s’en passeront plus tard : comme un homme, dans la rue, se sert d’une lampe pendant une nuit obscure et l’éteint en rentrant dans sa maison. Que penserait-on de lui, s’il l’apportait tout allumée dans le salon ? Que lui dirait l’heureuse société de dames élégantes et de gentlemen en grande toilette qui est réunie là, devant un ardent foyer, et à la lumière des lustres étincelants, s’il entrait dans la salle avec un gros paletot, le chapeau sur la tête, un parapluie sous le bras, et une grande lanterne d’écurie à la main ? D’autre part, quelle idée donnerait-il de sa personne, s’il allait en toilette de bal se jeter au milieu d’une nuit épouvantable et des éléments de la nature en furie ? « Lorsque le roi entra pour voir les convives, il vit un homme qui n’avait pas la robe nuptiale » : il vit un homme qui était déterminé à vivre dans l’Église comme il vivait avant de lui être uni, qui voulait conserver ses priviléges, qui ne voulait pas échanger la raison pour la foi, qui ne voulait pas harmoniser ses pensées et ses actes à la scène glorieuse qui l’environnait, qui cherchait à tâtons le trésor caché et fouillait pour trouver la perle de prix dans le temple même du Dieu des armées, temple majestueux, éclatant, tout orné de pierreries ; un homme qui fermait ses yeux et méditait, quand il pouvait les ouvrir et voir. Il n’y a donc pas d’absurdité ni d’inconséquence dans une personne qui use d’abord du jugement privé, et qui, ensuite, le condamne. Les circonstances changent les devoirs.
Cependant, après tout, la personne dont il s’agit, à parler strictement, ne juge pas avec ses propres idées le système extérieur qui lui est offert ; mais elle prend les données de ce système pour confirmer et pour justifier des jugements privés, des sentiments personnels et des dispositions déjà existantes. Charles, par exemple, éprouvait une difficulté à déterminer comment et quand les péchés du chrétien sont pardonnés ; dans sa pensée, également, le célibat était un état meilleur que le mariage. Certainement il n’était pas la première personne de l’Église d’Angleterre qui eût eu de semblables idées ; sans doute elles s’étaient présentées à bon nombre d’autres avant lui ; ces personnes, toutefois, ayant regardé autour d’elles, n’avaient rien vu qui autorisât leurs sentiments, et, en conséquence, ces sentiments s’étaient corrompus ou éteints dans leurs cœurs. Mais lorsqu’un homme, dans cet état d’esprit, vient à rencontrer autour de lui l’ombre du Catholicisme, immédiatement le puissant Symbole produit son influence sur son âme. Cet homme voit que ce Symbole justifie ses pensées, qu’il explique ses sentiments ; qu’en outre il les nombre, les corrige, les harmonise, les complète ; et il est amené à demander aussitôt sur quelle autorité s’appuie cet enseignement étranger. Or, quand il découvre que cet enseignement est celui qui était reçu autrefois en Angleterre, du nord au sud, depuis les premiers temps où le Christianisme y avait fait son apparition ; que, en remontant aux souvenirs historiques les plus anciens, Christianisme et Catholicisme sont synonymes ; quand il voit que cet enseignement forme encore la foi de la plus grande partie du monde chrétien, tandis que la foi de son propre pays n’est admise que dans les bornes de son territoire et dans celles de ses colonies ; bien plus, qu’il est difficile de dire quelle est la foi de l’Angleterre, ou même si elle a une foi ; quand cet homme, disons-nous, découvre ces vérités, alors il se soumet à l’Église Catholique Romaine, non par la voie de la critique, mais comme un disciple à son maître.
En parlant ainsi, sans doute, on ne peut nier, d’une part, qu’il peut y avoir des hommes qui s’unissent à l’Église catholique sur des motifs imparfaits ou par une route fausse ; qui choisissent cette Église avec l’esprit de critique, et qui, non subjugués par sa majesté ou sa grâce, conservent ce malheureux esprit lorsqu’ils en sont déjà membres. Ces hommes, s’ils persistent dans ce travers, et n’apprennent pas à être humbles, courent le danger de retomber dans l’abîme. D’autre part, on ne peut nier, non plus, que d’autres hommes non catholiques peuvent choisir, par exemple, le Méthodisme, de la manière que nous avons expliquée plus haut, et cela, parce qu’il confirme et justifie le sentiment intérieur de leurs cœurs. Ceci est certainement possible spéculativement, quoiqu’il soit embarrassant de dire ce qu’il y a de si vénérable, de si imposant, de si surhumain dans les conférences Wesleyennes pour persuader à quelqu’un de les accepter comme un prophète ; cependant, après tout, nous concevons que le fait repose sur une autre base ; savoir, que les Wesleyens et autres sectaires se placent au-dessus de leur système ; et quoiqu’ils puissent physiquement se trouver « assis au-dessous » de leur prédicateur, néanmoins, par l’état de leurs âmes, de leur esprit, de leur intelligence et de leur jugement, ils sont élevés bien au-dessus de lui.
Mais revenons au héros de notre histoire. Quel mystère que l’âme humaine ! Voilà Charles occupé d’Aristote et d’Euripide, de Thucydide et de Lucrèce, et toutefois, pendant ce travail, il s’avance toujours vers l’Église, « vers la mesure de la plénitude de l’âge du Christ ». Sa mère lui avait dit qu’il ne pouvait échapper à sa destinée : c’était vrai, quoique cette parole dût s’accomplir d’une manière qu’elle ne pouvait imaginer, ni même rêver dans son cœur aimant. Il ne pouvait échapper à la destinée de devenir un élu de Dieu ; à cette sublime destinée que la grâce de son Rédempteur avait imprimée dans son âme au baptême, que son bon ange y avait vue tracée en caractères lumineux, et pour laquelle il avait déployé un zèle ardent afin de la conserver pure et brillante ; cette destinée que sa propre coopération aux bénédictions du ciel avait fortifiée en lui et mise hors de péril ; il ne pouvait échapper à la destinée, au temps marqué par Dieu, de devenir catholique. Ce temps sans doute pouvait tarder encore, les anges pouvaient être inquiets, l’Église aurait peut-être à supplier, comme si elle eût été frustrée de la promesse qui lui annonçait un étranger de plus, un enfant déjà ; mais le fait devait s’accomplir : c’était écrit au ciel, et la marche lente du temps le faisait avancer plus près à chaque minute. Et même avant cette heure bénie, telle qu’une fleur éclose répand ses parfums en tout lieu, ainsi des odeurs étranges, inconnues, délicieuses pour les uns, désagréables pour d’autres, s’échappaient de sa personne sur les ailes des vents, et l’on se demandait avec surprise la cause de ce phénomène mystérieux, et l’on considérait Charles avec anxiété et inquiétude, tandis que lui-même n’avait pas conscience de son propre état. Soyons patients comme son Créateur est patient, et supportons qu’il fasse avec lenteur un ouvrage qu’il fera bien.
Hélas ! tandis que Charles s’était avancé d’un côté, Sheffield avait marché dans une autre voie. Quelle route avait-il suivie ? c’est ce que nous verrons au chapitre suivant, dans une conversation qui eut lieu entre les deux amis.
Carlton avait ouvert pour la fête des Saints la petite église qu’il desservait pendant les grandes vacances. N’étant pas à même d’y réunir une assemblée, et l’église d’Horsley étant fermée toute la semaine, sauf le dimanche, il avait demandé à ses élèves de l’y accompagner le jour de Saint-Matthieu. Comme la saison était belle et la promenade agréable, ils acceptèrent volontiers. Lorsque le service de l’église fut terminé, Carlton eut à visiter un malade qui demeurait un peu plus loin, et les deux jeunes gens revinrent ensemble.
« J’ignorais que Carlton fût un homme de parti si avancé, dit Sheffield, est-ce que sa lecture du Symbole d’Athanase ne vous a pas frappé ? — Ce n’est pas une marque de parti, assurément, répondit Charles. — Lire ce symbole dans des jours comme les nôtres est une marque de parti, je pense ; c’est marcher hors de la voie commune. » Charles ne voyait pas comment ce pouvait être un acte de parti, que d’obéir, dans une matière si évidente, à la direction formelle[62] du Prayer-Book. « La direction ! reprit Sheffield ; mais la question est de savoir si cette direction oblige maintenant. C’est le sentiment, l’interprétation de l’Église d’aujourd’hui qui doit en déterminer l’obligation. — La vue primâ facie de la matière, repartit Charles, est que ceux-là sont les plus éloignés de l’esprit de parti, qui ne font que suivre les ordonnances du Prayer-Book. — Pas du tout ; l’adhésion stricte à des coutumes anciennes peut certainement être la marque d’un parti. Il y a dix ans, avant que l’étude de l’histoire ecclésiastique fût remise en vigueur, l’Arianisme et l’Athanasianisme étaient complétement laissés dans l’oubli, ou, tout au plus, étaient-ils regardés comme des questions de mots, au moins par le plus grand nombre : l’un paraissait aussi bon que l’autre. — Je dirai comme vous, en un sens ; j’admettrai que bon nombre de personnes, par exemple, les illettrés, qui vivaient dans les communautés ariennes parlaient le langage arien, et cependant n’avaient pas d’intention mauvaise. Je crois avoir entendu raconter qu’un ancien missionnaire des Goths ou des Huns était arien. — Eh bien, je parlerai d’une manière plus précise. Un savant d’Oxford, il y a environ dix ans, allait publier une histoire du concile de Nicée. Le libraire lui proposa de mettre en tête de son livre un portrait de saint Athanase, qu’il avait trouvé dans un ancien volume ; mais l’auteur en fut fortement dissuadé par un de ses confrères ecclésiastiques qui parlait, non d’après son propre sentiment, mais d’après ce motif, que saint Athanase était un nom très-impopulaire parmi nous. — Une hirondelle ne fait pas le printemps. — Cet ecclésiastique, continua Sheffield, était un ami des écrivains actuels les plus dévoués à la Haute Église. — Il y a toujours eu dans notre Église, répondit Charles, une école hétérodoxe, je ne l’ignore pas, mais elle n’a jamais été puissante. Votre ami peu scrupuleux en était membre. — Je ne le crois pas ; il vivait en dehors de la controverse et s’occupait de littérature ; c’était un ministre accompli et un homme de piété. Il n’exprima pas un sentiment personnel ; il ne fit que témoigner d’un fait, de l’impopularité du nom d’Athanase, fait que personne ne conteste. — Qu’y a-t-il là d’étonnant ? On connaissait si peu l’histoire. Saint Athanase, vous le savez, n’a pas écrit le symbole qui porte son nom. On peut bien penser que cet auteur exagère parfois, sans croire cependant que le symbole soit erroné. — Ce n’est pas tout, reprit Sheffield : vous connaissez le professeur de théologie nommé Beatson : on ne l’appellera, en aucun sens, un homme de parti ; ce sont les tories qui l’ont nommé professeur, et jamais on ne l’a vu se compromettre par aucune théorie libérale en matières théologiques. Or, un étudiant qui assistait à ses cours particuliers m’a assuré qu’il avait dit à son auditoire : « Je crois, messieurs, que l’ancienne interprétation du Symbole par l’Église d’Angleterre a fini avec Bull. Après que Locke eut pris la plume, la vieille phraséologie orthodoxe tomba en discrédit. » — Peut-être voulait-il dire, répliqua Charles, que l’érudition s’éteignait, ce qui est vrai. Le vieux langage théologique est tout à fait un langage savant ; naturellement on dut l’abandonner quand on n’étudiait pas les Pères ni les scolastiques ; mais lorsque les études ont porté de nouveau sur ces auteurs, ce langage a été ressuscité. — Non, non, Beatson s’est exprimé beaucoup plus clairement dans une autre circonstance. Parlant des symboles et autres choses semblables : « Je crois, a-t-il dit, que tous les laïques instruits de notre Église sont en général Sabelliens. »
[62] Il est prescrit aux ministres de l’Église anglicane de lire ou de chanter le Symbole d’Athanase dans treize des principales fêtes de l’année.
Charles était silencieux et savait à peine que répondre. Sheffield continua : « Il y a quelques années, n’étant encore qu’un enfant, j’assistais à une conversation dans laquelle un de mes précepteurs communiquait un plan d’histoire des conciles à un théologien des plus savants et des plus orthodoxes, à un homme dont le nom n’a jamais été associé à aucun parti, et qui compte de hauts dignitaires dans sa famille. Cet homme, bon et intelligent, écouta avec politesse, il applaudit au projet ; puis, il ajouta en riant : « Savez-vous bien que vous avez choisi précisément le plus ennuyeux sujet de l’histoire de l’Église ? » Les conciles, en effet, commencent au Symbole de Nicée et embrassent à peu près tous les points doctrinaux. — Mon cher Sheffield, laissez-moi vous le dire, vous êtes tombé dans un cercle particulier ou dans un parti d’hommes, très-respectables, excellents, je n’en doute pas, mais qui ne sont pas précisément les purs modèles de notre Église. — Je ne les cite pas comme des autorités, mais comme des témoins. — Pourtant, je sais très-bien qu’à la fin du dernier siècle il s’éleva entre certains savants et l’évêque Horsley une controverse dans laquelle celui-ci expliqua, d’une manière claire, une partie au moins de la doctrine d’Athanase. — Vous vous trompez, sa controverse n’était pas une défense du Symbole d’Athanase, je le sais pertinemment ; car ce sujet s’est présenté au cours d’Upton sur les Articles. Ce fut avec Priestley qu’il eut cette polémique. Mais, quoi qu’il en soit, nos théologiens se contentent de penser que tout cela est très-beau, comme les sermons du même auteur sur les prophéties. C’est une autre question de savoir s’ils reconnaissent le mérite de l’un ou de l’autre de ces ouvrages. Ils acceptent les termes scolastiques sur la Trinité, de la même manière qu’ils acceptent la doctrine que le Pape est l’Antechrist. Lorsque Horsley parle du Pape, ou de quelque chose de semblable, les bons vieux ecclésiastiques s’écrient : « Certainement, certainement ; oh ! oui, c’est la doctrine de l’ancienne Église d’Angleterre », croyant qu’il est bon de maintenir cette idée, ou au moins d’en faire profession, lorsqu’il en est question ; mais s’en souciant fort peu eux-mêmes, et n’y pensant même pas d’un bout de l’année à l’autre. Et ainsi en est-il de la doctrine sur la Trinité. Ils disent : « le grand Horsley, le puissant Horsley », et voilà tout. Ils ne discutent pas sa doctrine ; ils ne s’en inquiètent guère non plus ; ils le regardent comme un preux champion, armé de pied en cap, qui a terrassé son adversaire, qui a coupé la tête à quelque insolent non protectionniste, à un chartiste insensé, où à quelque novateur en religion, qui, sous le couvert de la théologie, avait fait une charge contre les dîmes et les taxes pour l’entretien de l’Église. »
— Je ne puis avoir une si mauvaise idée de nos théologiens actuels, repartit Charles. Je sais qu’ici même, à Oxford, il y a des écrivains orthodoxes que personne ne peut appeler des hommes de parti. — Arrêtez, mon ami, comprenez-moi bien, je ne parlais pas contre eux, je disais seulement que ces idées anti-athanasiennes n’étaient pas rares. J’ai été à même d’entendre bien des choses sur la matière chez mon précepteur particulier, et j’ai toujours été sur mes gardes depuis mon arrivée à Oxford. L’évêque de Derby était un ami de Sheen, mon précepteur. Lors de sa promotion, je me trouvais avec celui-ci, et Sheen me confia que l’évêque élu lui avait écrit à cette occasion : « Quel auteur lirai-je ? je ne connais rien en fait de théologie. » Je crois qu’on lui recommanda, ou qu’on lui proposa de lire la Bible de Scott. — Il est facile de citer des exemples, quand on a ses coudées franches. Ce que vous dites est évidemment un exposé à votre manière. — Prenez encore Shipton, qui est mort dernièrement, continua Sheffield ; quelle magnifique position n’avait-il pas dans l’Église ? cependant tout le monde sait très-bien qu’il regardait comme une erreur d’employer le mot « personne » dans la doctrine sur la Trinité. Ce qui rend ceci plus étonnant, c’était sa grande sévérité envers les ecclésiastiques (les Tractariens par exemple), qui esquivaient le sens des Articles. Or, Shipton était parfaitement équitable et juste ; il méprisait l’argent ; l’opinion publique le préoccupait peu ; et toutefois il était Sabellien. Aurait-il mangé le pain de l’Église, comme on disait, même un seul jour, s’il n’avait pas cru que ses opinions n’étaient pas incompatibles avec sa charge de doyen de Bath et de Dorchester ? N’est-il pas évident qu’il croyait que la pratique de l’Église avait modifié, avait réinterprété ses propres formulaires ? — Cependant, mon cher ami, la pratique de l’Église ne peut rendre noir ce qui est blanc, ni faire dire oui à un texte qui dit non. Je ne nierai pas que les paroles sont souvent vagues et incertaines dans leur sens, et qu’elles ont besoin fréquemment de commentaires ; à cet égard, l’enseignement du jour a une grande influence pour fixer la valeur des termes ; mais la question est de savoir si l’enseignement opposé de chaque doyen, de chaque prébendier, de chaque ecclésiastique, de chaque évêque dans notre Église, pourrait rendre Sabellien le Symbole d’Athanase ; pour moi, je ne le pense pas. — Certainement, non, répondit Sheffield ; mais les ecclésiastiques dont je parle soutiennent simplement qu’ils ne sont pas tenus à tous les détails du Symbole, mais seulement à la grande idée qu’il y a une Trinité. — Grande idée ! s’écria Charles, grande sottise ! Un Unitaire ne répudierait pas cette doctrine. N’admet-il pas le Père, le Fils et l’Esprit-Saint, bien qu’il croie que le Fils est une créature et l’Esprit une influence ? — Eh bien, quant à moi, je ne vois pas pourquoi, si le doyen Shipton fut un membre saint de l’Église, le docteur Priestley ne l’aurait pas été également. Mais mon doute est de savoir, si, supposé que les Tractariens n’eussent point paru, Priestley n’aurait pas été, s’il avait vécu dans ce temps-ci, je ne dirai pas un membre parfait, mais assez digne pour mériter des bénéfices dans notre Église. — Si les Tractariens n’eussent point paru ! c’est-à-dire si notre Église était autre qu’elle n’est. Qu’est-ce que cette école, sinon un enfantement, un produit de l’Église ? Et si l’Église n’avait pas donné le jour à un parti qui prît sa défense, elle en aurait fait naître certainement un autre. Non, non, Charles ; je vous garantis que la vieille école doctrinale était tout à fait tombée, lorsque les Tractariens parurent, et je vous avoue que j’aurais aimé qu’ils eussent laissé les choses tranquilles. Il y avait encore, à cette époque, la doctrine de la succession Apostolique ; mais quelques bons vieux hommes étaient ses seuls apôtres restants dans l’Église. Il leur arriva même, dans une occasion, qu’un grand personnage se moqua complétement de leur persistance à conserver ce point. Il leur soutint que leur doctrine s’en allait avec les non-jureurs[63]. « Vous êtes si peu nombreux, leur dit-il, que nous pouvons vous compter. »
[63] Les non-jureurs sont ceux qui soutiennent la doctrine primitive de l’Église anglicane, contenue dans les Homélies, sur l’obéissance passive et la non résistance, et qui adhèrent au premier rituel d’Édouard VI.
La conversation ne plaisait pas à Charles, et cela pour plusieurs motifs. Il n’aimait pas ce qui lui paraissait une attaque de la part de Sheffield contre l’Église d’Angleterre ; et, d’ailleurs, il commençait à éprouver des doutes et des craintes pénibles que cette attaque ne reposât sur de solides fondements, craintes et doutes auxquels il ne voulait pas être exposé. Il garda donc le silence, et, après un court intervalle, il essaya de changer de sujet ; mais Sheffield avait engagé la partie, il ne voulait pas la perdre ; il commença de nouveau : « J’ai parlé, dit-il, du parti libéral de notre Église. Dans l’Église, il y a quatre partis. Parmi eux, le vieux parti tory, ou le parti de la campagne, qui évidemment est le plus nombreux, n’a pas du tout d’opinion ; il se contente d’accepter la théologie ou la non-théologie du jour, et l’on ne peut pas dire proprement qu’il ait ce que le Symbole appelle la foi Catholique. » Il ne la répudie pas ; il peut être incroyant à son insu ; mais, en tout cas, il ne donne aucun signe positif qu’il ait vraiment cette foi ; il ne fait que la traiter avec respect. J’ose dire qu’il n’y a pas dans tout ce parti un ministre de campagne, qui, d’un bout de l’année à l’autre, fasse un seul jour ce que les Catholiques appellent « un acte de foi », touchant le mystère spécial et très-distinct contenu dans les clauses du Symbole d’Athanase. » Voyant que Charles paraissait froissé, Sheffield ajouta : « Je ne parle pas de tel ou tel ecclésiastique en particulier, mais de la grande majorité d’entre eux. Après le parti tory vient le parti libéral, qui n’aime pas non plus le Symbole d’Athanase, comme je vous l’ai déjà dit. En troisième lieu, nous avons le parti évangélique. Je sais que vous possédez un des numéros des Traités sur la foi objective. Or, ce Traité paraît prouver que les évangéliques sont implicitement Sabelliens, et qu’ils tendent à avouer cette croyance. La même marche a déjà été effectivement suivie par leurs confrères du continent et de l’Amérique. Les protestants de Genève, de Hollande, d’Ulster et de Boston sont tous devenus, je crois, Unitaires, ou chose semblable. Le docteur Adam Clarke, le célèbre Wesleyen, admettait, lui aussi, le principe distinctif du Sabellianisme, comme Doddridge, dit-on, l’avait fait antérieurement. Toutes choses considérées, je pense que j’ai bien prouvé ma thèse touchant ma première assertion : savoir, qu’en ce temps-ci c’est une marque de parti que de sortir de la voie commune pour lire le Symbole d’Athanase. — Je ne suis nullement d’accord avec vous là-dessus, mon cher Sheffield ; vous discutez sans preuves suffisantes, et vous tirez de terribles conclusions de bien faibles prémisses. Voilà, du moins, ce qu’il me semble. Je voudrais aussi que vous n’eussiez pas parlé de prouver une thèse, comme si de pareils sujets étaient de simples matières à discussion. Je n’aime pas non plus que vous preniez le mauvais côté des choses ; c’est en général votre tendance. — Reding, je dis ce que je pense, et il en sera toujours de même. Je ne veux pas être un homme de parti. Je n’essaie pas, comme Vincent, de concilier les choses opposées. Il est de tous les partis ; je ne suis d’aucun. Je crois voir assez bien le vide de tous. — O mon cher ami, s’écria Charles en détresse, songez à ce que vous dites ; vous n’avez pas certainement envie de maintenir vos paroles. A vous entendre, on supposerait qu’à vos yeux la croyance au Symbole d’Athanase n’est qu’une simple opinion de parti. » Sheffield resta d’abord silencieux ; il reprit ensuite : « Eh bien, je vous demande pardon, si j’ai dit quelque chose qui pût vous contrarier, ou si je me suis exprimé trop vivement ; mais, évidemment, il n’est pas nécessaire de croire ce que tant de gens ne croient pas, ou traitent avec indifférence. »
La conversation tomba, et peu d’instants après Carlton vint à leur rencontre sur un poney qu’il avait emprunté à la ferme.
Pendant deux ans environ, Reding avait banni ses doutes touchant les Articles ; mais c’était différer le paiement d’une dette : c’était un sursis, et non une quittance. Les deux conversations que nous avons rapportées, l’ayant fait s’expliquer sur des matières très-importantes, d’abord avec l’un, ensuite avec l’autre de ses amis, tous deux également liés par les Articles, lui rappelèrent tristement son obligation envers l’Université et l’Église. L’époque d’ailleurs de son examen et de l’obtention de ses grades, approchant de plus en plus, le fit penser que le temps venait où il devrait être prêt à acquitter cette dette.
Un jour, c’était vers la fin des vacances, Charles se promenait avec Carlton ; tout en devisant, il avait été amené à parler du nombre des opinions religieuses et des partis d’Oxford qui produisaient de si mauvais effets, en donnant lieu à tant de discours, à tant de critiques, et peut-être aussi à un peu de scepticisme. « Évidemment, dit-il ensuite, tout cela est un mal dans une ville d’éducation ; je craindrais cependant, Carlton, que ce mal ne soit inévitable, si votre doctrine sur les partis est vraie ; car s’il était un lieu où les différences des opinions religieuses doivent se produire, c’est bien au sein d’une Université. — Je suis loin de le nier, répondit Carlton ; mais tous les systèmes ont leurs défauts : constitution politique, théologie, rituel, rien n’est parfait. Un seul système vient directement et simplement du ciel, c’est le système judaïque ; encore même a-t-il été aboli à cause de sa stérilité. Ceci n’est pas une atteinte à la perfection de la Révélation divine, car cette stérilité provient du sujet sur lequel et par lequel elle opérait. » Il y eut un moment de silence : « C’est le défaut de la plupart des jeunes penseurs, continua Carlton, d’être impatients, s’ils ne trouvent pas la perfection en toutes choses ; ils ont le zèle de tous les novices. » Autre silence. Il reprit de nouveau : « Quelle forme de religion est moins controversable que la nôtre sous tous les rapports ? Vous voyez les inconvénients de notre propre système, parce que vous les expérimentez, mais vous n’avez pas senti, vous ne pouvez même connaître ceux des autres. » Charles ne répondait pas ; il marchait, arrachant et broyant les feuilles des arbustes et des buissons à travers lesquels tournait le sentier. Rompant enfin son mutisme : « Carlton, dit-il, laissez-moi vous faire une confidence que je ne ferais pas à tout autre. Vous savez qu’il y a environ deux ans j’étais très-inquiet par rapport aux Articles ; réellement, je ne pouvais pas les comprendre, et leur histoire ne faisait qu’aggraver la difficulté. Je rejetai alors loin de moi ce sujet d’études ; mais voici venir mon examen et mon grade, et ces matières vont m’occuper encore. — Il faut que vous ayez été admis de bonne heure au cours des Articles. — Peut-être n’étais-je pas à la hauteur du sujet. — Loin de moi une pareille pensée ; mais quant à la chose elle-même, mon bon ami, sachez-le, c’est ce qui arrive chaque jour, et spécialement aux jeunes gens réfléchis comme vous. Cela ne devrait pas vous tourmenter. — Mais mon inquiétude, reprit Charles, naît de la crainte que j’ai que mes anciennes difficultés ne reviennent, et que je ne sois pas capable de les repousser. — Vous devriez prendre toutes ces choses avec calme, répliqua Carlton ; toutes choses, comme je l’ai dit, ont leurs difficultés. Si vous attendez jusqu’à ce que chaque objet soit comme il devrait être, ou pourrait être d’après vos idées, vous ne ferez rien et vous perdrez votre temps. Le monde moral n’est pas un pays de plaine ; il a aujourd’hui ses points tracés, sa géographie, ses routes. Vous ne pouvez marcher à travers champs ; si vous tentez un steeple-chase, Vous vous casserez le cou pour vos peines. Les formes de religion sont des faits ; elles ont chacune leur histoire. Elles étaient avant vous, elles vous survivront. Il vous faut faire un choix, vous ne pouvez créer. — Je sais que je ne puis créer une religion ; peut-être, non plus, ne puis-je en trouver une meilleure que la mienne. Je n’ai pas besoin de tenter l’entreprise ; mais ma difficulté n’est pas là. Prenez votre propre figure. Je m’en vais au petit trot, le long de ma route ; tout à coup, voilà une haute barrière solidement fermée à clef, et mon pauvre poney ne peut la franchir. Que faire ? Je ne me plains pas ; mais tel est le fait, ou du moins tel il peut être. — Le poney doit franchir la barrière, ou, s’il ne le peut, il faut qu’il y ait une autre voie. Autrement, à quoi sert une route ? En religion, toutes les routes ont leurs obstacles ; l’une a une porte solide qui la coupe, l’autre se déroule à travers un marais. Ne doit-on pas aller en avant ? La religion doit-elle aboutir à une barrière infranchissable ? Le Christianisme doit-il s’éteindre ? Mais où irez-vous ? Non pas certainement au Méthodisme ni à la Confraternité de Plymouth. Quant à l’Église Papiste, je soupçonne qu’elle présente plus de difficultés que la nôtre. Il faut sacrifier son jugement privé. — Tout cela est très-bien, reprit Charles ; mais ce qui est très-utile peut cependant être tout à fait impossible. Les plus belles paroles sur la nécessité d’arriver à la maison avant la nuit ne rendront pas mon pauvre petit poney capable de franchir la porte. — Non, certainement ; mais si vous aviez l’ordre de la part d’un prince bienveillant, votre souverain et votre bienfaiteur, de suivre la route sans broncher jusqu’au soir, et que vous dussiez le rencontrer au bout de votre voyage, vous seriez bien sûr que celui qui vous a marqué la fin vous a également indiqué les moyens. Et quant à la difficulté présente, vous devriez chercher un expédient quelconque d’ouvrir la porte, ou de passer à travers la haie, ou, d’une manière ou d’une autre, de trouver un chemin, en sorte que vous pussiez tourner l’obstacle. »
Charles répondit qu’en aucun cas il n’aimait ce mode d’argumentation ; il lui semblait dangereux, il ne voyait ni où il menait, ni où il aboutissait. — Eh ! pourquoi, dit-il ensuite brusquement, pourquoi pensez-vous qu’il y a plus de difficultés dans l’Église de Rome ? — Évidemment, il y en a davantage ; s’il est difficile de mordre aux Articles, ne l’est-il pas plus de digérer le Symbole du Pape Pie ? — Le Symbole du Pape Pie ? Je ne le connais pas ! Je suis peu versé dans cette matière. Que dit ce symbole ? — Oh ! il parle d’infaillibilité, de transsubstantiation, de culte des Saints, et que sais-je ? je suppose que vous ne pourriez souscrire complétement à toute cette doctrine. — Pourquoi pas ?… Tout dépend, reprit Charles avec lenteur, de la valeur de l’autorité qui me la transmettrait. » Il s’arrêta, puis continuant : « Naturellement, je pourrais y souscrire, si elle m’était transmise par la même autorité qui m’enseigne la Sainte Trinité. Quant aux Articles, ils ne me parviennent sur aucune autorité, ce sont des vues particulières à des personnes du XVIe siècle ; et d’ailleurs, il n’est pas clair jusqu’à quel point ils sont ou ne sont pas modifiés par les vues sans autorité du XIXe. Je suis donc obligé d’exercer mon propre jugement, et je puis vous dire avec franchise que mon jugement est au-dessous d’une si grande tâche. Au moins, c’est ce qui me trouble, toutes les fois que ce sujet se présente à mon esprit ; car je l’ai rejeté loin de moi. — Alors, dit Carlton, recevez les Articles sur la foi. — Vous voulez dire, repartit Charles, que je dois considérer notre Église comme infaillible. » Carlton sentit la difficulté. « Non, répondit-il ; mais il vous faut agir comme si elle était infaillible, par un sentiment de devoir. » Charles sourit ; puis, soudain devenant grave, il resta immobile et baissa les yeux : « Si je dois me créer une Église infaillible, dit-il, si je dois renoncer à mon jugement privé, si je dois procéder par la foi, il existe une Église qui a sur nous tous des droits plus grands que l’Église d’Angleterre. — Mon cher Reding, répliqua Carlton avec émotion, où avez-vous pris ces idées ? — Je l’ignore ; quelqu’un a dit qu’elles étaient dans l’air. Je n’en ai parlé à personne. Il m’est arrivé seulement, la première année, d’avoir une ou deux discussions sur cette matière. J’ai banni ce sujet de mon esprit, mais quand une fois je commence, vous le voyez, je parle malgré moi. »
Ils se promenèrent un moment en silence. « Voulez-vous dire, reprit Carlton, qu’il est très-difficile de comprendre et d’admettre les Articles ? Pour moi, ils sont assez clairs, et ils parlent le langage du sens commun. — Eh bien, quant à moi, repartit Reding, il me semble parfois qu’ils sont en contradiction avec eux-mêmes, d’autres fois avec le Prayer-Book ; de sorte que je les suspecte. Je ne sais ce que je vais signer, quand il faudra poser cet acte. Cependant, je dois signer ex animo. Une soumission aveugle, je pourrais la faire ; mais une déclaration aveugle, je ne puis la donner. — Citez-moi quelques exemples. — Ainsi, les Articles admettent positivement la doctrine luthérienne de la justification par la foi seule ; et cette doctrine est rejetée implicitement par le Prayer-Book dans chacun de ses offices. Ils en appellent aux Homélies comme autorité ; or, les Homélies parlent des livres apocryphes comme étant inspirés ; ce que nient implicitement les Articles. Les Articles sur l’ordination sont contraires dans leur esprit au service de l’ordination. Un article sur les sacrements exprime la doctrine de Mélanchthon, un autre celle de Calvin. Tel Article parle de l’autorité de l’Église dans les controverses de foi, tel autre fait de l’Écriture un juge sans appel. Voilà les points qui, en ce moment, se présentent à mon esprit. — Assurément beaucoup d’entre eux, reprit Carlton, ne sont que de simples difficultés de mots ; et toutes ces difficultés apparentes peuvent être surmontées avec un peu de peine. — D’autre part, continua Charles, ce qui m’a frappé, c’est que l’Église de Rome est incontestablement conséquente dans ses formulaires ; c’est même le reproche que lui adressent quelques-uns de nos écrivains : ils la trouvent trop systématique. Cela peut être un système dur, un système de fer, mais il est logique. » Carlton ne voulut pas l’interrompre, jugeant qu’il était mieux de l’entendre exposer sa difficulté entière. Charles continua donc : « Lorsqu’un système est logique, au moins il ne se condamne pas lui-même. La logique n’est pas la vérité, mais la vérité est logique. Or, je ne suis pas capable, je l’avoue, de décider si tel système est vrai, mais je puis bien juger s’il est conséquent avec lui-même. Quand un oracle équivoque, il porte avec lui sa propre condamnation. Je suis porté à croire qu’il y a dans l’Écriture quelque chose sur ce sujet, une comparaison, sous ce rapport, entre les prophéties païennes et les prophéties inspirées. Ce qui m’a également frappé, c’est que saint Paul donne ce caractère de l’hérétique, qu’il « se condamne lui-même », portant sa condamnation sur sa figure. En outre, je me trouvais un jour dans la société de Freeborn (que vous connaissez peut-être) et d’autres personnes du parti évangélique, et ces messieurs démontrèrent, s’il fallait les en croire, que Luther et Mélanchthon ne s’accordent pas sur le point capital de la justification par la foi : circonstance qui ne nous a pas été expliquée au cours des Articles. J’ai lu aussi quelque part, ou j’ai entendu prêcher, que les anciens hérétiques étaient toujours inconséquents ; qu’ils ne pouvaient jamais exposer clairement leurs idées, encore moins s’accorder entre eux ; et ainsi, qu’ils le voulussent ou non, ils ne pouvaient s’empêcher de faire connaître aux simples leur vrai caractère par leur bavardage. »
Charles s’arrêta ; puis continuant : « Ceci m’a encore frappé : Il n’y a pas de prophète de la vérité sur la terre, ou bien l’Église de Rome est ce prophète. Appelez-le apôtre, messager, maître, comme il vous plaira, il est évident pour moi, d’après notre croyance à une Église visible, qu’il existe encore un prophète ; et le sens commun nous dit ce que doit être le messager de Dieu. D’abord, il ne doit pas se contredire, comme je viens de le soutenir. Secondement, un prophète de Dieu ne peut souffrir de rival, mais il condamne tous ceux qui ont des prétentions particulières, comme font les prophètes dans l’Écriture. Or, il est impossible de dire si notre Église reconnaît ou non le Luthéranisme de l’Allemagne, le Calvinisme de la Suisse, les sectes Nestoriennes et Monophysites de l’Orient. Elle ne nous expose pas non plus, d’une manière claire, sa pensée sur l’Église de Rome. Le seul endroit où elle reconnaisse son existence, c’est dans les Homélies, et là, elle en parle comme de l’Antechrist. La position de l’Église Grecque, non plus, n’est pas bien définie dans la doctrine anglicane. D’autre part, l’Église de Rome primâ facie a cette marque d’un prophète, d’un prophète tel que l’Écriture nous le dépeint : elle n’admet pas de rivaux, et anathématise toute doctrine qui est contraire à la sienne propre. Autre chose : Un prophète de Dieu est naturellement à l’aise avec son message ; il n’est pas impuissant et sans vie au milieu des erreurs et de la lutte des opinions. Il sait ce qu’on lui a donné à faire connaître, jusqu’où s’étend sa doctrine ; il peut agir comme un arbitre ; il est à la hauteur des événements. Or, cela parle encore en faveur de l’Église de Rome. A mesure que les siècles se déroulent, elle est toujours sur le qui-vive ; elle interroge tout nouveau venu ; elle sonne l’alarme, brise toute doctrine étrangère, revendique, détermine et perfectionne ce qui est nouveau et vrai. L’Église de Rome m’inspire la confiance, je sens que je puis me fier à elle. C’est une autre question de savoir si elle est vraie : pour le moment, je ne prétends pas le décider. Mais je n’ai pas la même confiance en notre propre Église. Je l’aime plus que je n’ai confiance en elle : elle me laisse sans foi. Maintenant, vous voyez l’état de mon esprit. » Il laissa échapper un profond soupir, comme s’il se fût débarrassé d’un fardeau.
« Eh bien, dit Carlton, lorsque Charles eut cessé, tout cela est une théorie fort belle ; savoir si elle s’accorde avec les faits, c’est une autre question. Pour nous, nous avons toujours cru jusqu’à présent que Chillingworth avait raison quand il nous montre Papes contre Papes, Conciles contre Conciles, et ainsi de suite. Soyez sûr, mon ami, que les controversistes protestants ne vous laisseront pas admettre cette parfaite harmonie de la doctrine papiste ; ce qui est certain, c’est que vous avez étudié fort peu, et que vous jugez de la vérité, non d’après les faits, mais d’après des idées ; je veux dire que pour vous c’est assez si des idées se soutiennent mutuellement. Quoique vous ne vouliez pas le reconnaître, cependant, en matière de faits, l’harmonie, à vos yeux, est la vérité. Les faits répondent-ils aux théories, vous n’en savez rien, et vous ne vous en informez pas. Je ne suis pas très-versé dans le sujet ; mais j’en sais assez pour être sûr que les Papistes auraient plus de peine que vous ne vous l’imaginez à prouver l’enchaînement logique de leur système. Par exemple, ils en appellent aux Pères, et cependant ils placent le Pape au-dessus de ceux-ci ; ils maintiennent l’infaillibilité de l’Église et la prouvent par l’Écriture, et puis ils prouvent l’Écriture par l’Église. Ils croient qu’un Concile général est infaillible lorsque le Pape l’a confirmé, mais pas avant cette sanction. Bellarmin, il me semble, donne la liste des Conciles généraux qui ont erré. Jamais, non plus, je n’ai pu m’expliquer la doctrine de Rome sur les indulgences. » Charles réfléchit sur ces paroles : « Peut-être avez-vous raison, dit-il ensuite ; je devrais connaître les faits plus exactement avant de porter un jugement sur ces matières. Mais, mon cher Carlton, je vous proteste, et vous pouvez vous imaginer avec quelle peine je vous fais cet aveu, je vous proteste que si l’Église de Rome est aussi ambiguë dans son enseignement que la nôtre, je serais en voie de devenir sceptique sur ce fondement, que je n’ai pas d’autorité compétente pour me fixer ma croyance. L’Éthiopien disait : « Comment puis-je le savoir, à moins que quelqu’un ne me l’apprenne ? » et saint Paul : « La foi vient par l’ouïe. » Si personne ne réclame ma foi, comment puis-je l’exercer ? Du moins, je courrai le risque de devenir Latitudinaire ; car si l’Écriture seule est mon guide, évidemment il n’y a pas de Symbole écrit pour nous dans le livre sacré. — Notre affaire, répondit Carlton, est de prendre le meilleur côté des choses, et non le pire. Retenez bien ceci, Charles, c’est qu’il faut vous mettre en garde contre toute vue forcée ou maladive des choses. Soyez gai, soyez naturel, et tout sera facile. — Carlton, vous êtes toujours bon et plein de bienveillance, repartit Charles ; mais après tout (et je voudrais pouvoir vous le faire comprendre), vous n’avez pas un mot à dire relativement à ma difficulté sur la signature des Articles. Comment dois-je sauter par-dessus le mur ? Que m’importe, à moi, que les autres communions aient aussi leurs murailles à franchir ! »
Ils s’approchaient alors de la maison, et ils finirent leur promenade en silence, chacun d’eux absorbé dans les pensées que la conversation avait fait naître.
Cependant les vacances s’écoulaient avec une douce et charmante rapidité. Les jours succédaient tranquillement aux jours ; et dans leurs occupations habituelles, nos deux étudiants ajoutaient insensiblement, mais d’une manière certaine, à la somme de leurs connaissances et à leur progrès intellectuel. Avant de les mettre de côté, ils avaient lu une dernière fois historiens et orateurs ; ils avaient approfondi la philosophie, parcouru les commentaires, complété les analyses et les résumés. Tout cela était un travail de solitude. Tandis que d’autres peut-être voguaient de Londres à Bombay, ou à la Havane, et que les mois pouvaient, rétrospectivement, leur paraître comme des années, pour Reding et Sheffield la semaine était à peine commencée qu’elle touchait à sa fin. Lorsque octobre arriva et qu’ils revirent leurs amis d’Oxford, tout d’abord ils crurent qu’ils avaient bien des choses à leur raconter ; mais, dès leur première conversation, ils trouvèrent qu’ils n’avaient à parler que de leurs études et de leurs affaires personnelles ; ils furent donc réduits au silence, malgré leur désir de causerie.
La saison avait changé. Ce changement leur rappela que Horsley convenait à un séjour d’été et non à une habitation permanente. Déjà des brouillards lourds et gris s’attachaient aux flancs de la colline ; les gros vents et les orages étaient venus ; le gazon s’était flétri, et lorsque Charles et son ami restaient dans le cottage, ils avaient remarqué que les portes et les fenêtres ne fermaient pas bien, et que la cheminée fumait. Vinrent ensuite ces fruits qui sont la fête funèbre de l’année, la mûre et la noix ; la noix, insipide et sans jus ; la mûre, noire, juteuse, mais âpre et moisie en même temps, comme si on la cueillait sur la terre humide et non sur l’arbre. Ainsi ce lieu si frais, s’étant dépouillé de ses charmes, semblait les inviter lui-même à le quitter. Reding jeta un coup d’œil autour de lui, et se prépara au départ comme un « conviva satur ». Ces mots : « Edisti satis, tempus abire » lui semblaient écrits sur tous les objets. Les hirondelles étaient parties ; les feuilles étaient pâles ; le soleil effleurait à peine l’horizon. Aux espérances du printemps, à la paix et au calme de l’été avaient succédé les tristes réalités de l’automne. Charles allait se précipiter au milieu d’un monde qui l’avait laissé tranquille sur la montagne ; là, il avait vécu sans querelles, sans distractions, sans désappointements, et, à cette heure, toutes ces misères allaient faire partie de son existence. Hélas ! il n’était qu’un enfant d’Adam ; Horsley avait été seulement un répit ; et il avait encore vivant dans sa mémoire le grand revers qui l’avait frappé deux années auparavant : Quel été enchanteur ! Quel triste automne ! Plein de ces pensées, il ramassa ses livres et ses papiers, et se dirigea vers Saint-Sauveur.
Oxford aussi avait perdu à ses yeux presque tout son prestige. La fraîcheur de son admiration pour cette ville était passée ; maintenant, il voyait des défauts là où d’abord tout lui avait paru bon, excellent ; le merveilleux des choses et des personnes s’était évanoui. Aussi bien, il y avait des changements : parmi ses condisciples, les uns avaient déjà pris leurs grades et étaient partis ; d’autres étudiaient dans l’intérieur du pays ; d’autres habitaient de nouveaux colléges pour y jouir d’un Fellowship. Une foule de figures plus jeunes se faisaient remarquer au réfectoire et à la chapelle, et Charles savait à peine leurs noms. Les chambres où autrefois il venait se récréer familièrement étaient occupées aujourd’hui par des inconnus qui prétendaient avoir sur elles le droit qui, dans sa pensée, ne pouvait appartenir qu’à leurs anciens possesseurs. Le collége lui paraissait déchu ; il y avait une troupe remuante qui n’y était pas auparavant : un certain nombre de petits garçons, une grande quantité de gamins.
Mais la vraie peine de Charles, ce qui devenait de plus en plus évident à son cœur alarmé, c’était de voir que son intimité avec Sheffield était un peu refroidie. Ils avaient bien passé leurs vacances ensemble, ils avaient pu se connaître mieux que jamais ; néanmoins, leur sympathie mutuelle n’était plus aussi forte, ils ne partageaient ni les mêmes goûts ni les mêmes répugnances ; en un mot, leurs esprits n’étaient pas aussi homogènes qu’ils l’avaient cru, alors qu’ils étaient étudiants de première année. Il n’y avait pas autant d’abandon de cœur dans leurs conversations, et ils souffraient plus aisément de se trouver séparés l’un de l’autre. Ils étudiaient tous les deux pour les honneurs, ils étudiaient ardemment ; mais Sheffield était tout entier à son œuvre, et la religion pour lui ne venait que sur le second plan. Il n’avait ni doutes, ni difficultés, ni anxiétés, ni chagrins qui l’affectassent beaucoup. Ce n’était pas la certitude de la foi qui ôtait le soleil de son âme et qui dissipait chez lui les nuages de la faiblesse humaine ; disons mieux, il n’éprouvait pas le besoin de cette contemplation de l’Invisible qui est la vie du chrétien. Sa réputation était pure, sa conduite exemplaire ; mais il se contentait de ce que lui offrait ce monde périssable. Pour Charles, au contraire, son trait caractéristique, peut-être au-dessus de tout, était un sentiment habituel de la présence divine. Ce sentiment, sans doute, ne lui assurait pas une conformité constante de pensées et d’actions : il était cependant la colonne de feu qui marchait devant lui et lui servait de guide. Charles sentait qu’il était la créature de Dieu, qu’il aurait un compte à lui rendre, qu’il lui appartenait sans réserve. Il désirait beaucoup réussir dans son examen ; il ne pouvait y songer sans tressaillement ; mais l’ambition n’était pas sa vie ; quelques minutes lui auraient suffi pour se remettre d’un insuccès. Dans cet état de choses, les seuls objets sur lesquels nos deux amis parlassent librement étaient ceux qui avaient rapport à leurs études. Ils travaillaient ensemble, ils s’examinaient l’un l’autre, ils se prêtaient leurs cahiers et se les corrigeaient réciproquement, ils se résolvaient mutuellement leurs difficultés. Peut-être Sheffield, quoique très-fin, s’aperçut-il à peine qu’il y avait un certain relâchement dans leur intimité. La controverse religieuse, dans sa nouveauté, avait été la nourriture de son intelligence active ; maintenant, elle avait perdu son charme, et les livres l’avaient remplacée. Pour Reding, c’était le contraire ; il avait trouvé de l’intérêt aux questions religieuses pour l’amour d’elles-mêmes, et lorsqu’il se les était interdites, il s’était imposé un vrai sacrifice. Aujourd’hui donc qu’elles venaient de nouveau se présenter forcément à son esprit, il ne pouvait espérer de Sheffield cette assistance d’ami dont il avait un si grand besoin.
Une épreuve plus forte encore lui était réservée. Nous devons dire au lecteur qu’il y avait à cette époque un système d’espionnage poursuivi par différents hommes, bien intentionnés d’ailleurs, qui croyaient rendre un véritable service à l’Université en signalant les jeunes membres qui étaient enclins, comme on disait, au Papisme. Système erroné. Ces messieurs ne s’apercevaient pas qu’une telle marche renfermait le danger de disposer au Catholicisme ces esprits ardents en leur faisant de faux rapports sur la religion romaine, et celui de les forcer à aller plus loin ensuite, en leur montrant l’incompatibilité de leurs opinions avec leur position dans l’Église Anglicane. Des idées qui auraient reposé tranquilles dans leurs têtes, ou se seraient évanouies tôt ou tard, étaient, par là même, fixées, définies, établies en eux ; et la crainte de la censure du monde ne servait plus à les retenir, lorsqu’une fois elle avait été encourue. Quand Charles se rendit à la soirée de Freeborn, c’était à la barre qu’on le traduisait. On l’admit non-seulement pour lui faire la leçon, mais pour le soumettre à un examen inquisitorial ; et n’ayant pas promis d’être un sujet pour l’impression spirituelle, il fut un sujet pour la censure spirituelle. Il devint un homme signalé dans les cercles de Capel-Hall et de Saint-Marc. Ses rapports avec Willis, les questions qu’il avait faites au cours des Articles, quelques remarques isolées dans certaines réunions ; tout avait été recueilli et avait aggravé le cas contre lui. Un jour, en rentrant dans son appartement, il trouva Freeborn, qui était venu lui rendre visite, occupé à fouiller dans ses livres : un volume de sermons de l’école du jour, emprunté à un ami pour éclaircir Aristote, reposait sur sa table, et dans les rayons de sa bibliothèque un des plus philosophiques « Traités pour le temps[64] » était placé entre un Hermann de Metris et un Thucydide. Un autre jour, la porte de sa chambre à coucher était ouverte, et no 2 de la réunion au thé vit une gravure religieuse d’Overbeck appendue à la muraille.
[64] Série de publications dans lesquelles plusieurs des hommes qui ont créé le Mouvement Religieux d’Oxford traitaient des questions de doctrine et de discipline ecclésiastique. Voy. l’Appendice.
Les faits de ce genre étaient souvent rapportés au chef de la maison à laquelle appartenaient les jeunes étudiants pris en flagrant délit. Gardien vigilant de la pureté du Protestantisme de ses sous-gradués, le chef recevait les informations avec reconnaissance ; on dit même qu’il y ajoutait parfois une invitation à dîner. Que, dans quelques cas, cette manière d’agir ait réussi à effrayer et à refroidir ceux qui en étaient l’objet, c’est ce qu’on ne saurait nier ; ce fut ainsi qu’on put faire de White un fils dévoué et un ministre utile de l’Église d’Angleterre ; mais c’était un remède propre à tuer ou à guérir, et il ne pouvait convenir à des intelligences plus nobles et plus élevées. La suite nous apprendra quel effet cette conduite produisit sur Charles. Il nous suffira pour le moment de rapporter les entrevues qu’il eut à ce sujet avec le Principal et le Vice-Principal de son collége.
Lorsque Charles se présenta chez le Vice-Principal, le révérend Josué Jennings, pour lui demander la permission de loger dans un appartement particulier, pendant les deux trimestres qui lui restaient jusqu’à l’époque de son examen, il lui fut répondu par un refus courtois, mais net. Sa surprise fut grande ; il avait considéré cette démarche comme une simple affaire de forme. Interdit, il resta un moment silencieux ; puis se levant, il allait se retirer. La rougeur colorait ses joues ; un pareil refus était une punition infligée seulement aux étudiants paresseux, sur lesquels on ne pouvait pas compter dès qu’ils échappaient à l’œil du doyen du collége.
Le Vice-Principal paraissait attendre que Charles lui demandât la raison de ce procédé ; comme le jeune étudiant, dans sa confusion, ne semblait pas disposé à le faire, il condescendit à ouvrir lui-même la conversation. Ce n’était pas, dit-il, qu’on voulût infliger un blâme à la conduite morale de M. Reding, non ; il avait toujours été un jeune homme de mœurs irréprochables, et il avait soutenu la réputation qu’il avait apportée de l’école ; mais les chefs avaient des devoirs à remplir à l’égard de la communauté, et parmi ces devoirs, l’un des plus impérieux leur commandait de mettre les sous-gradués à l’abri de la contagion des malheureux principes qui dominaient dans Oxford. La surprise de Charles, s’il est possible, fut encore plus grande, et il balbutia qu’il devait y avoir un malentendu, s’il avait été signalé à M. le Vice-Principal comme ayant des rapports avec aucun soi-disant parti de l’Université. « Par cette forme d’expression, monsieur Reding, repartit l’autorité du collége, vous n’entendez pas nier qu’il n’existe des partis ? » Jennings était un homme maigre et pâle, au nez aquilin et portant lunettes : quoique libéral dans sa croyance, on l’eût pris réellement pour un nourrisson de ce temps primitif de la Réforme, où les Anabaptistes allumèrent les bûchers de Smithfield. Par son âge, son talent exercé et sa position, il pouvait facilement déconcerter un infortuné jeune homme qui avait encouru sa disgrâce, et quoique au fond il eût un bon cœur, il usait assez souvent de son pouvoir. Charles ne savait que répondre à sa question, et comme il se taisait, elle lui fut répétée. A la fin, il dit que réellement, dans sa position, il n’avait pas le droit de parler contre personne, et que s’il avait prononcé ces paroles : « soi-disant parti », c’était afin de ne point paraître irrespectueux envers certains hommes qui pouvaient être meilleurs que lui. M. le Vice-Principal gardait le silence, sans être satisfait. « Qu’appelez-vous un parti, monsieur Reding ? Quelle serait votre définition de ce mot ? » Charles réfléchit : « Les personnes, répondit-il, qui de leur propre autorité se liguent ensemble pour la défense de vues personnelles. — Et voulez-vous dire que ces messieurs n’ont pas des vues qui leur soient propres ? demanda M. Jennings. Charles fut de son avis.
« Quelles sont vos vues relativement aux Trente-neuf Articles ? reprit le Vice-Principal ex abrupto. « Mes vues ! pensa Charles ; que veut-il dire ? Mes vues sur les Articles ! est-ce mon opinion des choses en général ? Veut-il demander s’ils sont en anglais ou en latin, longs ou courts, bons ou mauvais, utiles ou dangereux, Catholiques ou non, Calvinistes ou Érastiens ? » Cependant Jennings tenait ses regards attachés sur le pauvre étudiant, dont la confusion augmentait de plus en plus. « Je pense, répondit Charles, faisant un effort suprême pour saisir les paroles de l’autorité, je pense que les Articles contiennent une doctrine divine, saine, et nécessaire pour ces temps-ci. » — C’est du second livre des Homélies que vous parlez, monsieur Reding, et non des Articles ? D’ailleurs, j’ai besoin de connaître votre opinion sur la matière. » Après un moment de silence, il continua : « Qu’est-ce que la Justification ? — La Justification… » répéta Charles d’un air réfléchi ; puis répondant d’après le texte des Articles : « Nous sommes, dit-il, réputés justes devant Dieu par la foi, à cause seulement des mérites du Christ, et non par nos bonnes œuvres et nos propres mérites. — Bien, dit Jennings ; mais vous n’avez pas répondu à ma question : Qu’est-ce que la Justification ? » La demande était ardue, car c’était précisément une des difficultés de Charles de savoir en quoi consiste la Justification, vu que les Articles ne la définissent pas plus que la foi. Il répondit, en conséquence, que les Articles n’en donnent pas la définition. Le Vice-Principal parut mécontent.
« Les Conciles généraux peuvent-ils errer ? — Oui », répondit Charles. C’était bien. « Qu’en disent les Catholiques Romains ? — Ils pensent aussi qu’ils errent. » Ceci était complétement faux. « Non, reprit Jennings ; ils les croient infaillibles. » Charles gardait le silence ; Jennings essaya de lui imposer sa décision. A la fin, Charles répondit qu’il n’y avait que quelques Conciles généraux qui fussent admis comme infaillibles par l’Église de Rome, et qu’il croyait que Bellarmin donnait une liste de ceux qui avaient erré. Nouveau silence ; le front de Jennings se couvrit de nuages.
Il revint à son premier sujet : « Dans quel sens entendez-vous les Articles, monsieur Reding ? » demanda-t-il. C’était plus que Charles ne pouvait dire ; il désirait seulement beaucoup connaître leur vrai sens ; aussi s’efforça-t-il de trouver dans sa tête la réponse admise. « Dans le sens de l’Écriture », dit-il. C’était vrai, mais insuffisant. « Ou plutôt, reprit Jennings, vous entendez l’Écriture dans le sens des Articles. » Par amour de la paix, Charles en convint. Mais cette concession fut en pure perte ; le Vice-Principal poursuivit son avantage : « Ils ne doivent pas s’interpréter l’un l’autre, monsieur Reding, autrement, vous roulez dans un cercle vicieux. Laissez-moi vous répéter ma question : Dans quel sens interprétez-vous les Articles ? — Je veux les admettre, répondit Charles, dans le sens généralement reçu de notre Église, comme les acceptent nos théologiens et nos évêques actuels. » Le Vice-Principal parut satisfait. Charles ne put s’empêcher d’être candide, et il ajouta d’un ton plus bas comme corollaire : « c’est-à-dire sur la foi ». Ceci dérangea tout encore ; Jennings ne voulait pas admettre ce mot ; c’était une confiance aveugle, papiste. C’était très-bien de la part de Charles, lorsqu’il vint pour la première fois à l’Université, avant qu’il eût étudié les Articles, de les admettre sur parole ; mais un jeune homme qui avait eu tant d’avantages, qui avait passé trois années à Saint-Sauveur et qui avait suivi le cours sur ces matières, devait accepter l’interprétation reçue, non-seulement parce qu’elle était reçue, mais comme la sienne propre, par un assentiment libre de son intelligence. Il continua à lui demander par quels textes il prouvait la doctrine protestante de la justification. Charles cita deux ou trois passages avec tant de bonheur que le Vice-Principal commençait à se calmer, lorsque malheureusement, en faisant une dernière question comme chose de pure forme, il eut une réponse qui le confirma dans tous ses premiers soupçons.
« Quelle est la doctrine de notre Église touchant l’intercession des saints ? » Charles répondit qu’il ne se rappelait pas qu’elle eût exprimé une opinion sur ce sujet. Jennings l’invita à réfléchir ; Charles réfléchissait en vain. « Eh bien, quelle est votre opinion là-dessus, monsieur Reding ? » Charles, croyant que c’était un point tout à fait libre, jugea qu’il serait sage d’imiter la modération « de notre Église ». « Il y a différentes opinions sur cette matière, dit-il : certaines personnes croient qu’ils intercèdent pour nous, d’autres pensent le contraire. Il est facile de se jeter dans les extrêmes, peut-être serait-il mieux d’écarter de telles questions et de s’en tenir à l’Écriture ; le livre de la Révélation parle de l’intercession des saints, mais il ne dit pas expressément qu’ils intercèdent pour nous, etc., etc. » Jennings se redressa dans son fauteuil ; la colère lui monta au front. A la fin son visage s’assombrit complétement. — C’est là votre opinion, monsieur Reding ? — Charles commençait à être effrayé. — S’il vous plaît, prenez le Prayer-Book et cherchez le 22e Article. Maintenant lisez. — « La doctrine romaine, dit Charles, la doctrine romaine touchant le purgatoire, le pardon, le culte et l’adoration tant des images que des reliques, et également l’invocation des saints. » — Arrêtez-vous, dit le Vice-Principal ; relisez encore ces paroles. — « Et également l’invocation des saints. » — A vous maintenant, monsieur Reding. » Charles était embarrassé ; il croyait avoir fait une bévue qu’il ne pouvait découvrir, et il restait silencieux. « Eh bien, monsieur Reding ? » Charles hasarda une réponse ; il dit qu’il pensait que M. le Vice-Principal avait parlé de l’intercession des saints. « C’est vrai, répondit celui-ci. — Et le Prayer-Book, reprit Charles timidement, parle de l’invocation. » Jennings fit un mouvement dans son fauteuil et rougit un peu. « Eh ! dit-il, donnez-moi le livre. » Il lut l’Article lentement, et jeta un œil scrutateur sur la page qui précédait et sur celle qui suivait le texte. Ce fut en vain. Il reprit : « Ainsi donc, monsieur Reding, vous prétendez vous justifier par cette subtile distinction entre l’invocation et l’intercession, comme si les Papistes n’invoquaient pas les saints pour obtenir leur intercession, et comme s’ils ne supposaient pas que ces bienheureux intercèdent pour répondre à leur invocation ? Les termes sont corrélatifs. L’intercession des saints, au lieu d’être seulement un extrême, comme vous l’entendez, est une abomination papiste. Je rougis pour vous, monsieur Reding ; je suis peiné de voir qu’un jeune homme d’un si bel avenir, de grands talents et d’une moralité parfaite, ait commis la faute d’employer un faux-fuyant si palpable pour éluder l’autorité des formulaires de notre Église ; qu’il soit coupable d’un tel outrage au sens commun, d’une violation si grossière des termes sur lesquels seuls il lui a été permis d’inscrire son nom sur les registres de ce collége. Je ne pouvais avoir une preuve plus manifeste que votre esprit a été perverti, je dirai plus, pour me servir de l’expression vraie, que votre esprit a été débauché par les sophismes et le jésuitisme, qui, malheureusement, ont trouvé accès parmi nous. Bonjour, monsieur Reding. »
Ainsi, c’était chose arrêtée : Charles devait être renvoyé chez lui. Le bannissement était supportable.
Avant de descendre, il fit une visite de politesse au vieux Principal, digne homme en son temps. Le docteur Bluett, en effet, avait créé jadis une paroisse dans un lieu sauvage du pays ; il avait instruit les ignorants et nourri les pauvres ; mais aujourd’hui, à la fin de sa carrière, arrivant à des jours mauvais, on lui permettait, pour des raisons impénétrables, de donner une preuve de ce malheureux levain puritain, qui était un élément secret de sa religion. Il avait jusque là témoigné de la bienveillance à Charles, et son air froid, dans cette circonstance, fut très-sensible à notre ami. « Nous avions espéré, monsieur Reding, dit-il, qu’un jeune homme aussi bien pensant que vous l’étiez jadis aurait obtenu ici un fellowship, qu’il s’y serait établi, et qu’il aurait été utile à son siècle, monsieur. Nous pensions que vous auriez été une colonne, un arc-boutant de l’Église d’Angleterre, monsieur. Eh bien, monsieur, voici mes vœux les plus ardents pour vous, monsieur : lorsque vous reviendrez pour votre grade de maître, monsieur… Non, je pense que c’est pour votre grade de bachelier… Quel grade est-ce, monsieur Reding ? Êtes-vous déjà bachelier ? Oh ! je vois votre toge. » Charles répondit qu’il n’avait pas encore passé son examen. « Eh bien, monsieur, lorsque vous reviendrez pour votre examen, dis-je… pour votre examen…, nous espérons que dans l’intervalle la réflexion et l’étude, et peut-être l’éloignement de compagnons dangereux, vous auront ramené à une situation d’esprit plus sage, monsieur Reding. » Charles était blessé du ton qu’on prenait à son égard. « Réellement, monsieur, dit-il, si vous me connaissiez mieux, vous comprendriez que je ne suis pas dans le cas ni d’éprouver ni de faire du mal en restant ici jusqu’à Pâques. — Quoi ! rester ici, monsieur, avec tous les étudiants ? s’écria le docteur Bluett stupéfié, avec tous nos jeunes étudiants ? » Charles ne trouvait pas un mot à répondre ; il ne se reconnaissait pas dans une situation si nouvelle. « Je ne puis comprendre, monsieur, dit-il enfin, pourquoi je serais un compagnon dangereux pour les habitants au collége. » Le menton du docteur Bluett s’allongea, et ses yeux prirent un aspect sombre. « Vous corrompriez leur esprit, monsieur, répondit-il ; vous corrompriez leur esprit. » Puis il ajouta d’une voix sépulcrale, qui vint des dernières profondeurs de ses entrailles : « Vous les mèneriez, monsieur, à quelque subtil jésuite… à quelque subtil jésuite, monsieur Reding. »
Cependant madame Reding s’était fixée auprès de vieux amis dans le Devonshire. C’est là que Charles passa l’hiver et les premiers jours du printemps avec elle et ses trois sœurs, dont l’aînée avait deux ans de plus que lui.
« Allons, fermez enfin tous ces livres, Charles », disait Caroline, la plus jeune des demoiselles, âgée seulement de quatorze ans ; « faites place pour le thé ; certainement, vous avez assez étudié. Parfois vous passez une heure entière sans prononcer un mot ; au moins, vous devriez nous dire ce que vous étudiez. — Ma chère Caroline, vous ne seriez pas plus savante, si je vous le disais, répondit Charles ; c’est de l’histoire grecque. — Oh ! reprit Caroline, j’en sais plus que vous ne pensez ; j’ai lu Goldsmith, une bonne partie de Rollin, et l’Homère de Pope en outre. — Bravo ! eh bien, j’étudie l’histoire de Pélopidas ; savez-vous qui il était ? — Pélopidas, je dois le connaître. Oh ! je m’en souviens ; il avait une épaule d’ivoire. — Bien dit, Caroline ; mais cela ne me donne pas une idée exacte de sa personne. Était-ce une statue, ou un homme en chair et en os, avec cette épaule dont vous parlez ? — Oh ! il était en vie ; quelqu’un le mangea, je crois. — Eh bien, était-ce un dieu, ou un homme ? — Je me suis trompée ; c’était une déesse, aux pieds d’ivoire… Non, c’était Thétis. — Ma chère enfant, dit madame Reding, ne parlez pas ainsi au hasard ; réfléchissez avant de parler ; vous savez mieux que vous ne dites. — Maman, elle a, reprit Charles, ce que M. Jennings appellerait un esprit très-inexact. — Je m’en souviens très-bien maintenant, s’écria Caroline ; c’était un ami d’Épaminondas. — Quand vivait-il ? » demanda Charles. Caroline se taisait. « Oh ! Caroline, reprit Élisa, avez-vous donc oublié la mnémotechnie ? — Jamais je n’ai pu l’apprendre ; je la déteste. — Je ne puis non plus la retenir, dit Marie ; donnez-moi les nombres naturels ; ils sont doux et bons comme des fleurs dans un carré ; mais je n’aime pas les fleurs artificielles. — Mais, évidemment, reprit Charles, la mnémotechnie aide à se rappeler un très-grand nombre de dates dont, sans cela, on ne pourrait se souvenir. — Ces noms baroques sont même plus difficiles à prononcer que les nombres à apprendre, dit Caroline. — C’est parce que vous avez peu de dates à retenir, répliqua Charles ; mais l’écriture ordinaire elle-même est une mnémotechnie. — Cela est au-dessus de l’intelligence de Caroline, dit Marie. — Que sont les mots, sinon les signes artificiels des idées ? continua Charles ; ils sont plus harmonieux, mais tout aussi arbitraires. Il n’y a pas plus de raison pour que le son « chapeau » signifiât l’objet particulier ainsi nommé que nous mettons sur la tête, qu’il n’y en a pour que « abuldistof » s’écrivît pour 1520. — O mon cher enfant, s’écria madame Reding, comme vous y allez ! Ne soyez pas paradoxal. — Ma bonne mère, répondit Charles en se rapprochant du feu, je ne veux pas être paradoxal ; c’est seulement une généralisation. — Gardez-la donc pour votre examen, mon cher ; j’ose dire que là elle vous sera utile, continua-t-elle en travaillant à son ourlet ; la pauvre Caroline sera tout aussi embarrassée en logique qu’en histoire. »
— Me voilà entre deux feux, reprit Charles, en s’asseyant sur un petit tabouret aux pieds de sa mère : Caroline m’appelle stupide si je garde le silence et vous vous m’appelez paradoxal si je parle. — Le bon sens, reprit sa mère, est la monnaie d’or. — Et qu’est-ce que le sens commun ? demanda Charles. — C’est la monnaie d’argent, reprit Élisa. — Bien trouvé, dit Charles ; c’est de la monnaie courante pour chaque heure. — Ou plutôt, reprit Caroline, c’est de la monnaie de cuivre ; car nous en avons besoin pour distribuer sans cesse, comme des aumônes pour les pauvres. On m’en demande toujours. Si je ne puis trouver quel était le père d’Isaac, Marie me dit : « O Caroline, où est votre sens commun ? » Si je sors, Élisa court après moi : « Caroline, crie-t-elle, vous n’avez pas le sens commun ; votre châle est mis tout de travers. » Et lorsque je demande à maman de prendre par les champs le plus court chemin pour aller à Dalton, elle me dit : « Faites usage de votre sens commun, ma chère. » — Il n’est pas étonnant que vous en ayez si peu, pauvre enfant, reprit Charles ; il n’y a pas de banque qui pût soutenir un pareil cours. — Pas ainsi, dit Marie ; cela rentre dans sa banque dix fois plus vite que ça n’en sort. Elle en reçoit beaucoup de nous, et ce qu’elle en fait, personne ne peut le comprendre ; ou elle amasse, ou elle spécule. — Comme le grand Océan, qui reçoit les fleuves, et qui n’est jamais plein, dit Charles. — Cela se trouve quelque part dans l’Écriture, reprit Élisa. — Dans l’Ecclésiaste », répondit Charles ; et il continua le texte : « Toutes les choses du monde sont difficiles ; l’homme ne peut les expliquer par ses paroles. L’œil ne se rassasie point de voir, et l’oreille ne se lasse point d’écouter. »
Sa mère soupira. « Prenez ma tasse, mon enfant, dit-elle ; je n’en veux pas davantage. — Je sais pourquoi Charles aime tant l’Ecclésiaste, reprit Marie ; c’est parce qu’il est fatigué de l’étude : « De longues études sont une lassitude pour la chair. » Je voudrais pouvoir vous aider, Charles. — Mon cher enfant, je crois en vérité que vous travaillez trop, dit sa mère ; songez seulement au nombre d’heures que vous avez consacrées à l’étude aujourd’hui. Vous êtes toujours levé deux heures avant le soleil ; et je ne pense pas que vous vous soyez promené de toute la journée. — C’est si triste de se promener seul, chère mère ; et quant à la promenade avec vous, ou avec mes sœurs, c’est assez agréable, mais ce n’est pas un exercice. — Mais, Charles, dit Marie, c’est absurde de votre part ; nous avons un temps délicieux et que nous ne pouvions pas espérer à cette époque, vous devriez en profiter pour faire de longues promenades. Pourquoi ne vous décidez-vous point à aller droit aux plantations, ou sur les hauteurs de Hart-Hill, ou à faire une course d’ici à Dun-Wood ? — Parce que les bois ne sont plus verts, mais tristes et sombres, chère sœur ; ils inspirent la mélancolie. — Précisément la plus belle époque de l’année, reprit sa mère ; c’est généralement reconnu ; tous les peintres disent que l’automne est la saison pour voir les paysages. — Tout est alors couleur or et rouge brun, ajouta Marie. — Cela me rend triste, reprit Charles. — Quoi ! le bel automne vous rend triste, s’écria sa mère. — Oh ! chère mère, Vous allez dire encore que je suis paradoxal ; je ne puis m’en défendre, j’aime le printemps ; mais l’automne m’attriste. — Charles parle toujours ainsi, reprit Marie ; il ne compte pour rien les riches couleurs dans lesquelles se métamorphose le vert si calme ; il aime l’ennuyeuse uniformité de l’été. — Non, ce n’est pas cela ; je n’ai jamais rien vu, par exemple, de plus magnifique que le Water-Walk de la Madeleine, en octobre ; c’est une prodigieuse variété de couleurs. J’admire et je suis émerveillé ; mais je ne puis affectionner ni aimer ce spectacle. La raison en est que je ne saurais séparer, dans mon esprit, la vue de ces choses de la fin qu’elles présagent ; cette riche variété n’est que le signal de la maladie et de la mort. — Assurément, repartit Marie, les couleurs ont leur beauté propre, intrinsèque ; nous pouvons les aimer pour elles-mêmes. — Non, non ; nous ne procédons que par association d’idées ; autrement, pourquoi ne pas admirer un morceau de bœuf cru, ou un crapaud, ou d’autres reptiles, qui sont aussi beaux et aussi brillants que les tulipes et les cerises, et qui pourtant nous révoltent, parce que nous considérons ce qu’ils sont et, non ce qu’ils paraissent ? — Quelle est cette nouvelle idée ? dit sa mère, en levant les yeux de dessus son ouvrage. Mon cher enfant, vous plaisantez en comparant les cerises à de la viande crue ou à des crapauds. — Non, ma bonne mère, répondit Charles en riant, non ; je disais qu’ils paraissent leur ressembler. — Un crapaud ressembler à une cerise, Charles ! insista madame Reding. — Oh ! chère mère, je ne puis m’expliquer ; mais réellement je n’ai rien dit d’extraordinaire ; Marie ne le pense pas. — Mais, reprit celle-ci, pourquoi ne pas associer des pensées agréables avec l’automne ? — C’est impossible ; chère sœur, l’automne, c’est la saison malade et l’agonie de la nature. Je ne puis contempler avec plaisir le dépérissement de la mère de tout ce qui vit. Les couleurs si variées du paysage ne sont que les marques de la dissolution. — Charles, vous avez une manière de voir outrée et peu naturelle, repartit Marie ; remuez-vous, et vous aurez de meilleures idées. N’aimez-vous pas à voir un beau coucher de soleil ? cependant c’est le moment où le soleil nous quitte. » Charles demeura un moment silencieux, puis il dit : « Oui, mais il n’y avait pas d’automne dans l’Éden ; le Paradis avait ses levers et ses couchers de soleil, mais les feuilles y étaient toujours vertes et ne se fanaient point. Il s’y trouvait un fleuve pour les nourrir. L’automne c’est la « chute ».
« Ainsi, mon cher fils, reprit madame Reding, vous n’allez pas vous promener par ces belles journées, parce qu’il n’y avait pas d’automne dans l’Éden ? — Oh ! répondit Charles en riant, c’est cruel de me pousser ainsi à bout. Ce que je voulais dire, c’est que mes études sont un obstacle direct à la promenade, et que le beau temps ne me tente pas assez pour me les faire quitter. — Je suis heureuse de vous posséder ici, dit sa mère, car nous pouvons vous forcer à sortir de temps en temps ; je soupçonne qu’au collége vous ne vous promeniez pas du tout. — Ce n’est que pour un certain temps, maman, répondit Charles ; lorsque j’aurai subi mon examen, je ferai des promenades aussi longues que celles que je faisais avec Edward Gandy, l’hiver que je quittai l’école. — Ah ! vous étiez alors si gai, Charles ! dit Marie ; que vous étiez heureux de la pensée d’aller à Oxford ! — Mon cher, reprit madame Reding, vous vous promènerez trop alors, comme aujourd’hui vous vous promenez trop peu. Oui, Charles, vous êtes trop ardent en tout. — Ce n’est pas bien de lui faire un reproche d’être laborieux, dit Marie : vous le savez, maman, vous désirez qu’il étudie pour les honneurs, mais s’il doit les obtenir, il faut qu’il étudie beaucoup. — C’est vrai, ma fille, répondit madame Reding ; Charles est un bon garçon, je le sais. Que nous serons heureuses de le voir établi dans un bon vicariat ! » Charles soupira. « Allons, Marie, dit-il, faites-nous un peu de musique, maintenant le thé est enlevé. Jouez-moi cet air si beau de Beethoven, celui que j’appelle « la voix des morts ». — Oh ! Charles, vous donnez aux objets des noms si tristes ! s’écria Marie. — L’autre jour, reprit Élisa, comme nous nous promenions, le vent nous apporta un délicieux parfum, et il l’appela « l’esprit du passé » ; il dit aussi que le son de la harpe éolienne est « plein de remords ». — Vous trouveriez tout cela fort joli, repartit Charles, si vous le lisiez dans un poëte ; mais vous l’appelez triste, lorsque c’est moi qui le dis. — Sans doute, répondit Caroline, parce que les poëtes ne pensent jamais ce qu’ils disent, et pourtant ils ne seraient pas poëtes s’ils n’étaient mélancoliques. — Eh bien, dit Marie, je vous ferai de la musique, Charles, mais à la condition que vous me permettrez, un de ces matins, de vous donner une bonne leçon sur cette mélancolie qui, je vous l’assure, se développe chez vous tous les jours. »
Les perplexités de Charles avaient bientôt pris une forme définie à son arrivée dans le Devonshire. Le fait seul de sa présence dans sa famille, et non à Oxford, où il aurait dû être, les avait ramenées dans son esprit ; l’approche du temps où il devait passer son examen et prendre son grade justifiait sa préoccupation à cet égard. A dire vrai, ces perplexités n’avaient pas acquis un développement plus grand que celui que nous avons dépeint ; mais elles n’étaient plus vagues ni indistinctes ; il les saisissait entièrement ; il ne les croyait pas non plus insurmontables, voyant alors d’une manière évidente les derniers obstacles à vaincre. La forme particulière dans laquelle elles se fixèrent, en se résumant, fut déterminée par les circonstances qui surgirent pour lui, à cette époque. Il se demanda d’abord comment il pourrait souscrire aux Articles ex animo, sans avoir une foi quelconque dans son Église comme autorité ayant droit à les lui imposer ; et, en second lieu, comment il pourrait avoir foi dans son Église, vu son histoire et sa situation présente. Le fait de ces difficultés était une grande source de chagrins pour notre jeune ami. Ce qui aggravait son état, c’est qu’il n’avait personne avec qui il pût parler ou sympathiser sur cette matière. Le comble enfin de son malheur, c’était la nécessité de garder devers lui un secret qu’il n’osait confier à d’autres, et qui pourtant, d’après ses prévisions, devait être révélé un jour. Telles étaient les causes cachées de l’abattement que ses sœurs remarquaient dans Charles.
Un jour, il était assis tout pensif devant le feu, un livre à la main, lorsque Marie entra. « Je voudrais, dit-elle, que vous m’apprissiez l’art d’étudier le grec dans des charbons ardents. — Les pierres ont leur langage, et il y a du bon en toutes choses, répondit Charles. — Vous faites bien de vous comparer au mélancolique Jacques. — Non pas à Jacques, mais au bon duc Charles, qui fut banni dans la forêt verte. — C’est fâcheux pour nous, répliqua Marie, puisque nous sommes les êtres sauvages avec lesquels vous êtes forcé de vivre. Mon bon Charles, continua-t-elle, j’espère que la triste affaire qui a été la cause de votre renvoi ne vous chagrine plus. — En vérité, Marie, il n’est pas agréable, après avoir vécu dans les meilleurs termes avec tout le collége, et en particulier avec le Principal et Jennings, d’être à la fin chassé comme un mauvais étudiant qu’on envoie conduire la charrette. Vous n’avez pas d’idée combien le vieux Principal et Jennings ont été sévères. — Mon cher ami, vous ne devez plus vous en préoccuper, comme je soupçonne que vous le faites. — Je ne sais pas où cela finira ; le Principal a dit expressément que mon avenir à l’Université était brisé. Je suppose qu’ils ne voudraient pas me donner un certificat, si je désirais un fellowship partout ailleurs. — Oh ! c’est une méprise momentanée ; je suis sûre que maintenant ils sont mieux informés. Aussi bien c’est pour nous une si bonne fortune de vous avoir ici, que nous leur en devons de la reconnaissance. — Je crois pourtant avoir agi avec prudence, Marie ; je ne suis jamais allé aux réunions du soir, ni aux sermons des célèbres prédicateurs du jour. Je me demande ce qui a pu leur mettre ces idées dans la tête. Au cours des Articles, je faisais de temps en temps une question, mais c’était vraiment parce que je désirais comprendre et saisir les matières. A mon entrée dans sa chambre, Jennings tomba sur moi ; je ne puis dire autrement. Il fut d’abord poli dans ses formes, mais il y avait dans son regard quelque chose qui m’annonçait l’orage. Il est étrange qu’un homme d’un caractère fort comme lui n’ait pas su mieux dissimuler ses sentiments ; j’ai toujours pu deviner ses pensées. — Croyez-moi, Charles, vous aurez oublié tout cela l’année prochaine. Ce sera comme un nuage d’été qui vient et disparaît. — Et puis, cela me décourage, et interrompt forcément mes études. J’y pense toujours, et c’est en vain que je veux fixer mon esprit sur mes livres, je ne sais plus retrouver mon énergie. C’est très-dur. — Marie soupira ; — je voudrais pouvoir vous aider, dit-elle, mais les femmes peuvent si peu ! Allons, laissez-moi prendre le chagrin, et gardez l’étude ; ce sera un excellent partage. — Et d’ailleurs, continua Charles, que va penser ma mère, quand la chose arrivera à ses oreilles, et il faut bien qu’elle lui parvienne ! — Laissez donc ! ne faites pas une montagne d’une taupinière. Vous reviendrez à Oxford, vous prendrez votre grade, et personne ne saura rien de tout cela. — Non, il n’en peut être ainsi », répondit Charles sérieusement. « Que voulez-vous dire ? — Ces choses ne se dissipent pas de cette manière ; ce n’est pas un nuage d’été : cela pourrait bien tourner à la pluie, à mon avis. »
Marie le regarda avec étonnement. « Je veux dire, reprit-il, que je n’ai pas l’espoir qu’ils me laissent prendre mon grade, pas plus qu’ils ne m’ont permis la résidence à Oxford. — C’est très-absurde, mon ami, voilà ce que j’entends par se préoccuper d’enfantillages et faire des montagnes de taupinières. — Ma bonne Marie, reprit-il en lui prenant la main affectueusement, ma seule vraie confidente et mon unique consolation, je voudrais vous faire encore une confidence, si vous pouviez la supporter. » Marie était effrayée, et son cœur battait fort. « Charles, répondit-elle en retirant sa main, souffrir une peine quelconque me serait moins dur que de vous voir dans cet état. Il est trop évident pour moi que quelque chose vous tourmente. » Charles mit ses pieds sur le garde-feu, et baissa les yeux. « Je ne puis vous le confier », dit-il enfin avec effort. Puis voyant à la physionomie de sa sœur combien il l’affligeait, il ajouta, souriant à demi comme pour atténuer l’effet de ses paroles : « Ma chère Marie, quand un pareil témoignage est porté contre quelqu’un, on ne peut s’empêcher de craindre qu’il n’ait été peut-être dicté par des motifs plausibles. — Impossible, Charles : vous corrompre les autres ! vous falsifier le Prayer-Book et les Articles ! Impossible. — Marie, de nous deux qui serait le meilleur juge, si ma figure était sale et mon habit râpé, vous ou moi ? Eh bien, peut-être Jennings, ou au moins l’opinion publique, en sait plus sur ma personne que moi-même. — Ne parlez pas ainsi, répliqua Marie très-émue ; vraiment, vous me faites de la peine en ce moment. Que voulez-vous dire ? » Charles couvrit son visage de ses mains : « Il n’y a rien à faire, répondit-il, vous ne pouvez m’aider ici ; je ne fais que vous chagriner. Je n’aurais pas dû aborder ce sujet. » Il y eut un moment de silence.
« Mon bien-aimé Charles, reprit Marie avec tendresse, allons, je supporterai tout tranquillement. Rien ne peut m’affliger autant que de vous voir aller de ce train-là. Mais, en vérité, vous m’effrayez. — Eh bien, répondit-il, quand plusieurs personnes viennent me dire qu’Oxford n’est pas ma place, que ma position n’est pas là, qui sait, si elles ont tort ou raison ? — Mais, réellement, est-ce tout ? et qui exige que vous passiez votre vie à Oxford ? Ce n’est pas nous, certainement. — Non, mais Oxford implique la nécessité d’obtenir un grade… de prendre les ordres. — Maintenant, mon cher ami, parlez d’une manière claire ; ne me donnez pas des demi-mots ; faites-moi tout connaître. » Et elle s’assit, le regard plein d’anxiété. « Eh bien, soit, dit-il faisant un effort ; cependant, je ne sais par où commencer. Tout ce que je puis dire, c’est que bien des choses me sont arrivées de différentes manières pour me montrer que je n’ai ni lieu, ni position, ni demeure ; que je ne suis pas fait pour l’Église d’Angleterre, que j’y suis un étranger. » Il y eut un silence terrible ; Marie devint très-pâle ; puis, tirant précipitamment une conclusion : « Vous voulez dire, Charles, reprit-elle avec vivacité, que vous allez vous réunir à l’Église de Rome. — Non, ce n’est pas cela. Vous m’avez mal compris ; je ne veux dire que ce que j’exprime ; je vous ai tout révélé ; ma confession est complète. Voici ma pensée entière : je ne me sens pas à ma place. — Cela ne suffit point, vous devez m’en révéler davantage ; car, comme je l’appréhende, vous voulez dire ce que j’ai exprimé moi-même, rien de moins. — Je ne saurais raconter les choses avec suite : mais quelque part que j’aille, avec quelque personne que je parle, je me sens une autre sorte d’homme que je ne suis. Je ne puis vous communiquer ce sentiment intime ; vous ne me comprendriez pas. La meilleure idée de mon état véritable se trouve dans ces paroles du Psalmiste : « Je suis un étranger sur la terre. » Nul ne pense et ne sent comme moi. J’entends des sermons, je cause de sujets religieux avec des amis, et tout le monde me condamne. Le collége enfin vient, lui aussi, rendre son témoignage contre moi, et il me chasse hors de ses murs. — Oh ! Charles, reprit Marie, que vous êtes changé ! » Et les larmes lui vinrent aux yeux. « Vous étiez si gai, si heureux autrefois ! Vous trouviez tant de plaisir auprès de tout le monde et en toutes choses ! Nous aimions tant à rire et à répéter : « Les oies de Charles sont des cygnes. » Que vous est-il arrivé ? » Elle se tut. « Ne vous rappelez-vous pas, continua-t-elle ensuite, ces paroles de l’Année chrétienne[65] ? Je ne puis les citer textuellement ; nous vous les appliquions. Il s’agit de l’espérance ou de l’amour « qui rend tous les objets radieux par son sourire magique ». Charles fut ému en se rappelant ce qu’il était trois années auparavant. « Je suppose, dit-il, que je sors des ombres pour entrer dans les réalités. — Il y a eu bien des choses pour vous attrister, repartit Marie en soupirant ; et maintenant ces vilains livres vous fatiguent trop. Pourquoi concourir pour les honneurs ? quel bien en reviendra-t-il ? » Nouveau silence.
[65] Recueil de poésies religieuses par M. Keble. Il contient des hymnes et autres compositions pour chaque fête du calendrier anglican. L’auteur y célèbre, à la date du 25 mars, la bienheureuse mère de Dieu.
— Je voudrais vous rapporter, reprit Charles, le nombre des avis indirects qui m’ont été donnés sur mon antipathie, comme on pourrait l’appeler, pour les choses telles qu’elles vont. Ce qui, peut-être, m’a le plus frappé, c’est un entretien que j’eus avec Carlton, ce tuteur avec qui j’ai étudié pendant les dernières vacances ; évidemment si je ne pouvais m’entendre avec lui, ou plutôt s’il me condamnait comme les autres, de qui devais-je attendre une parole en ma faveur ? D’ailleurs, je ne puis supporter le faste et les faux-semblants que je vois partout. Je ne parle pas contre les individus ; ce sont de très-bonnes personnes, je le sais ; mais, réellement, si vous voyiez Oxford tel qu’il est ! les chefs surtout avec leurs gros revenus, je ne sais trop ce que vous en penseriez. Sans doute ces messieurs sont généreux, leurs femmes sont souvent simples et modestes, on se plaît à le dire ; elles font aussi beaucoup de bien dans la ville, je me garderais de les attaquer sur ce point ; mais je parle du système. Reconnaît-on des ministres du Christ dans des hommes qui jouissent de revenus énormes, qui vivent dans des maisons richement meublées, qui ont femme et enfants, qui se font servir par des sommeliers et de magnifiques valets en livrées, qui donnent des dîners splendides, affectent des airs protecteurs et gracieux, arrondissent leurs gestes, et mesurent leurs paroles comme s’ils étaient la crème de la terre, mais qui n’ont rien de l’ecclésiastique, si ce n’est l’habit noir et la cravate blanche ? Puis viennent les évêques et les doyens qui, eux aussi, traînent une femme au bras, et qui ne peuvent entrer dans l’église sans être précédés d’un valet bien poudré, portant un coussin et une peau de mouton chaude pour préserver leurs pieds du froid des pierres. » Marie se mit à rire. « Eh bien, mon cher ami, dit-elle, je ne croyais pas que vous eussiez vu tant d’évêques, de doyens, de professeurs et de chefs d’établissements à Saint-Sauveur ; vous avez eu bonne compagnie. — Mes yeux sont constamment en éveil, et les occasions ne m’ont pas manqué ; je ne puis entrer dans les détails. — Je crois que vous avez été sévère envers ces messieurs, reprit Marie ; quand un pauvre vieillard souffre d’un rhumatisme (et elle soupira un peu), il serait dur qu’il ne pût garantir ses pieds du froid. — Ah ! Marie, je ne saurais vous expliquer tout ! mais pénétrez-vous, je vous prie, de ce que je dis, et ne critiquez pas mes exemples ou mes paroles. Ce que je veux faire entendre, c’est qu’il y a à Oxford une atmosphère mondaine qui est aussi éloignée que possible de l’esprit de l’Évangile. Je n’accuse pas les dons d’ambition ni d’avarice ; il n’en est pas moins vrai, toutefois, que la fin que se proposent les chefs d’établissements, les Fellows et tous ces messieurs, c’est de jouir d’abord de la terre, et puis de servir Dieu. Sans doute ils font du ciel l’objet final de leurs désirs ; mais leur objet immédiat, c’est d’être dans l’aisance, de se marier, d’avoir de beaux revenus, une position, de l’honorabilité, une maison commode, une campagne agréable et un aimable voisinage. Il n’y a rien de surnaturel chez eux. Je l’avoue, je crois que les Puséistes sont les seules personnes de l’endroit qui aient des vues élevées ; je devrais dire les seules personnes qui en fassent profession, car je ne les connais pas assez pour en parler. » Il pensait à White. « Vous m’entretenez là de choses que j’ignore, Charles, mais je ne pense pas que toute cette jeunesse intelligente d’Oxford ne recherche que ses aises et le bien-être ; je ne crois pas non plus que dans l’Église de Rome l’argent ait toujours été employé à la meilleure fin. — Je ne disais rien de l’Église Romaine, pourquoi me la nommer ? C’est tout à fait une autre question. Mon unique pensée, c’est qu’il y a à Oxford une atmosphère mondaine que je ne puis souffrir. Je n’emploie pas le mot « mondaine » dans sa plus mauvaise acception. Les gens y sont religieux et charitables ; mais (je n’aime pas à citer des noms propres), mais je connais plusieurs dons qui ne paraissent pas faire entrer dans le caractère de leur religion, à eux, la notion de la pauvreté évangélique, le danger des richesses, l’abandon de toutes choses pour le Christ : idées qui sont les premiers principes de l’Écriture telle que je la lis et la comprends. Je l’avoue, je crois que c’est la raison pour laquelle les Puséistes sont si impopulaires. — Eh bien, repartit Marie, je ne vois pas pourquoi vous êtes si dégoûté du monde, ainsi que de la place et des devoirs que vous devez y remplir, parce qu’il s’y trouve des hommes mondains.
— A propos, je parlais de Carlton, reprit Charles. Certes c’est un excellent garçon que j’aime, que j’admire et que je respecte beaucoup ; eh bien, savez-vous qu’il a posé en axiome qu’un ecclésiastique de l’Église d’Angleterre doit se marier ? Il disait que le célibat peut être chose très-bonne dans d’autres communions, mais qu’un homme se rendait ridicule et n’était pas du siècle, s’il restait célibataire dans notre Église. » Le pauvre Charles était si sérieux, et la proposition qu’il énonçait était si monstrueuse, que Marie, malgré sa profonde tristesse, ne put s’empêcher de rire aux éclats : « Je ne puis m’en défendre, dit-elle. En vérité, c’était une assertion très-extraordinaire. Mais, mon cher ami, ne craignez-vous pas que Carlton ne vous enlève un beau jour par violence, et qu’il ne vous marie à quelque gentille demoiselle avant que vous sachiez où vous en êtes ? — Ne parlez pas sur ce ton, Marie, répliqua Charles ; à cette heure, je ne puis supporter la plaisanterie. Ce que je veux dire, c’est que, considérant le bon sens de Carlton et son coup d’œil si juste en toutes choses, je restai convaincu que l’Église d’Angleterre est réellement, d’après les déclarations implicites de mon répétiteur, une forme de religion très-différente de celle des Apôtres. »
Ces paroles rendirent Marie sérieuse. « Hélas ! dit-elle, nous voici sur un nouveau terrain, il s’agit maintenant, non de ce que l’Église pense de vous, mais de ce que vous pensez de notre Église. » Il y eut un moment de silence. « Je soupçonnais que cela reposait au fond, continua-t-elle ; je n’ai jamais pu croire qu’une poignée de gens, dont quelques-uns n’étaient rien pour vous, venant vous dire que vous n’étiez pas à votre place, vous auraient fait penser ainsi, à moins que vous, le premier, n’eussiez eu ces sentiments. Voilà la vérité réelle ; et puis vous interprétez dans votre sens ce que les autres viennent vous dire. » Il y eut encore un moment de silence pénible. « Je vois, reprit-elle, comment tout cela ira. Quand vous prenez une chose à cœur, Charles, je sais bien que vous ne l’abandonnez plus. Oui, vos idées sont déjà arrêtées. Nous vous verrons Catholique Romain. — Marie, répliqua le frère avec tristesse, voulez-vous, vous aussi, vous élever contre moi ? » Elle vit sa méprise. « Non, Charles ; tout ce que je dis, c’est que cela dépend de vous, et non des autres. Si votre esprit l’a résolu, il n’y a plus rien à faire. Ce ne sont pas les autres qui vous mènent, qui s’élèvent contre vous ; mon cher ami, ne vous méprenez pas sur mes paroles, et ne vous faites pas illusion. Vous avez une volonté de fer. »
En ce moment, Caroline entra dans la chambre. « Je ne pouvais m’imaginer où vous étiez, Marie, dit-elle ; il y a une éternité que Perkins vous demande. Il s’agit de quelque chose pour le dîner ; je ne sais quoi. Nous avons cherché en haut et en bas, sans pouvoir deviner que vous aidiez Charles dans ses études. » Marie poussa un profond soupir et sortit de la chambre.
L’entretien que nous venons de rapporter n’avait donné aucune satisfaction ni aucun soulagement aux anxiétés du frère et de la sœur. « Je ne puis trouver nulle part de sympathie, se disait Charles. Marie ne me comprend pas plus que les autres. Je ne puis manifester mes pensées et mes sentiments ; et si j’essaie de le faire, mes propositions et mes arguments me paraissent absurdes à moi-même. Ç’a été un grand effort de me confier à elle ; et, en un sens, c’est autant de gagné, car c’est une épreuve surmontée ; mais autrement je n’ai rien obtenu par mon initiative, et j’aurais aussi bien fait de me taire. Je n’ai réussi qu’à la chagriner sans soulager mon cœur. Par parenthèse, elle est partie croyant le cas deux fois plus grave qu’il ne l’est. J’allais la remettre dans le vrai, lorsque Caroline est entrée. Ma seule difficulté regarde les ordres, et elle croit que je vais me faire Catholique Romain. Quelle absurdité ! Mais les femmes vont vite en besogne ; donnez-leur un pouce, et elles prennent une aune. Je ne connais pas les Catholiques Romains. Toute la question est de savoir si je m’attacherai au barreau ou à l’Église. J’avoue que je me suis exagéré beaucoup les choses à moi-même ; j’aurais dû commencer par ceci avec elle : « Savez-vous, aurais-je dû lui dire, que j’ai sérieusement envie d’étudier le droit ? » J’ai tout embrouillé.
La pauvre Marie, de son côté, était dans un trouble d’esprit et de cœur aussi pénible que nouveau pour elle ; cependant les affaires du ménage et ses devoirs obligés envers ses plus jeunes sœurs détournèrent un moment ses pensées. A dire vrai, elle avait été prise au mot ; elle s’attendait peu à ce qui allait lui arriver, quand elle s’était engagée à accepter le chagrin, tandis qu’elle laissait les livres à Charles. La douleur, elle l’avait connue naguère ; mais jusqu’alors, elle ne connaissait pas l’anxiété. L’état de l’esprit de son frère avait été pour elle jusque là un simple sujet d’étonnement ; mais dès que cet état lui eut été manifesté clairement, elle en fut effrayée et révoltée. C’était comme si Charles avait perdu son identité et se fût changé en un autre homme ; c’était comme si jusque là il avait trompé sa confiance. Elle avait vu dans les journaux qu’il s’agissait beaucoup du « parti d’Oxford » et de ses actes. Dans différents lieux où elle avait été en visite, elle avait entendu parler d’églises qui suivaient la nouvelle mode, et d’ecclésiastiques accusés, en conséquence, de Papisme, reproche dont elle s’était moquée. Mais maintenant on lui apprenait dans sa maison même qu’il y avait quelque chose de vrai dans ces bruits. La chose toutefois restait incompréhensible à son esprit, et elle savait à peine où elle en était. Et que, de toutes les personnes du monde, son frère, son propre Charles, avec qui de tout temps elle n’avait fait qu’un cœur et qu’une âme, que ce frère, jadis si aimable, si religieux, si bon, si sensé, si prudent, pût être le premier qui jetât sur sa voie les nouvelles opinions ; cela la mettait hors d’elle-même.
Et où Charles avait-il puisé ses idées ? Des idées ! elle ne pouvait les appeler de ce nom ; il n’avait rien à donner pour excuse ; c’était un enivrement. Lui, si intelligent, d’un esprit si perçant, comment ! il n’avait rien de mieux pour sa justification que de dire que la femme de l’évêque de Monmouth était trop jolie, et que le vieux docteur Stock s’asseyait sur un coussin ! Oh ! tout cela était bien triste, en vérité ! Et comment se faisait-il qu’il fût insensible aux bienfaits de son Église, bienfaits dont il avait joui toute sa vie ! Que lui manquait-il ? Pour elle, tout était selon ses désirs : aller à l’église faisait son bonheur. Elle aimait à entendre les leçons et les collectes revenant chaque année et marquant les différentes saisons. Les livres historiques et les prophètes, en été ; la collecte : « Levez-vous » pour annoncer l’Avent ; les belles collectes de l’Avent lui-même avec les leçons d’Isaïe, qui se prolongent jusque dans le temps de l’Épiphanie : tout cet ensemble était une vraie musique à son oreille. Les psaumes, à leur tour, variant tous les dimanches, étaient pour son cœur une consolation perpétuelle, toujours ancienne, et cependant toujours nouvelle. Les additions de circonstance aussi : le Symbole d’Athanase, le Benedictus, le Deus misereatur et l’Omnia opera, que son père avait coutume de lire aux grandes fêtes ; et la belle litanie ; toutes ces choses n’étaient-elles pas ravissantes ? Que pouvait-il désirer de plus ? où pourrait-il en trouver autant ? C’était un mystère pour sa raison, et elle ne pouvait que se sentir pénétrée de reconnaissance de n’être pas exposée aux tentations, quelles qu’elles pussent être, qui avaient agi sur l’esprit si solide de ce frère bien-aimé !
Puis, elle s’était bercée de la douce pensée de voir Charles ministre et de l’entendre prêcher ; d’avoir quelqu’un à qui elle aurait le droit d’adresser des questions, de demander des conseils quand elle le désirerait. Ce rêve était fini ; elle ne pouvait plus compter sur son frère ; il avait fait à sa confiance une blessure que le temps ne pourrait cicatriser : cette confiance avait disparu pour toujours. Charles était le seul homme de la famille ; il était son seul soutien, maintenant que le père était mort. Qu’allaient-elles devenir, elles pauvres femmes ? Être délaissée par son propre frère, oh ! que c’était dur !
Et comment allait-elle préparer sa mère à ce coup terrible ? Car il fallait bien que, tôt ou tard, cette triste affaire fût connue. Elle ne pouvait se faire illusion ; elle connaissait assez son frère pour être sûre que lorsqu’il s’était mis réellement une chose en tête, il ne l’abandonnait point sans des raisons convaincantes, et elle ne voyait pas celles qui pourraient le détourner de ces idées s’il avait des motifs pour les garder. Le moyen de résoudre le problème confondait toute raison, tout calcul. Mais enfin, comment devait-elle apprendre ce malheur à sa mère ? Valait-il mieux le lui laisser soupçonner et le lui faire arriver ainsi, ou fallait-il attendre jusqu’à l’accomplissement du fait ? La question était trop difficile à résoudre pour le présent, et elle préféra l’abandonner.
Telle fut la situation de Marie pendant plusieurs jours jusqu’à ce que l’excitation de son esprit se changeât en un état dont une anxiété triste était l’élément latent et habituel. Cette anxiété la quittait d’ordinaire à l’heure de ses occupations, mais elle se trahissait de temps à autre par des soupirs subits et profonds, ou par l’égarement de ses pensées. Ni le frère ni la sœur, tout en s’aimant autant que jamais, n’avaient cette douceur et cette égalité de caractère qui leur étaient naturelles ; il fallait maintenant veiller sur soi, et, sans qu’on pût en dire la cause, le cercle du soir était plus triste qu’autrefois, Charles était plus attentif envers sa mère ; pour être davantage avec elle, il n’apportait plus ses livres dans le salon. Il faisait la lecture à haute voix, mais il causait peu ; aussi Élisa et Caroline désiraient que son examen fût passé, afin qu’il pût reprendre sa gaîté naturelle.
Quant à Mme Reding, ses observations allaient simplement à constater que son fils était un étudiant intrépide, et qu’il se refusait une promenade ou une course à cheval, quelque beau temps qu’il fît. C’était une personne douce et tranquille, aux sentiments vifs et aux habitudes réglées, mais d’un esprit peu observateur. Elle avait vécu toute sa vie à la campagne, et jusqu’à sa récente infortune ayant à peine connu le chagrin, elle était entièrement incapable de comprendre comment les choses peuvent marcher, sinon d’une seule manière. Charles ne lui avait pas dit le motif réel de son séjour à la maison pendant l’hiver, jugeant que c’eût été l’affliger en pure perte ; encore moins avait-il songé à la fatiguer par l’exposé de ses difficultés religieuses, qu’elle n’aurait pu apprécier ; c’eût été, également, sans résultat positif. Quant à sa sœur, il essaya de lui donner une explication de sa conversation antérieure, dans la pensée d’adoucir les craintes extrêmes qu’il avait fait naître dans son esprit. Marie reçut l’explication avec reconnaissance, et déclara qu’elle était consolée. Mais le coup était porté, le soupçon était profondément entré dans son âme ; c’était toujours Charles, son bien-aimé Charles comme auparavant, mais elle ne pouvait bannir de son esprit le cruel pressentiment qu’elle avait exprimé dans son entretien.
Un matin on vint annoncer à Charles qu’une personne, qu’on avait fait entrer dans la salle à manger, le demandait. En ouvrant la porte, il se trouva en face du long et maigre Bateman, qui, promu aux ordres, venait d’être nommé ministre d’une paroisse voisine. Charles ne l’avait pas vu depuis dix-huit mois, et il lui serra la main avec beaucoup d’affection, en le félicitant sur sa cravate blanche qui, comme il le lui dit, le transformait plus qu’il ne s’y serait attendu. Évidemment les manières de Bateman étaient changées ; cela pouvait être le fait de la circonstance, mais il ne paraissait pas à son aise ; peut-être était-ce le résultat de sa présence dans une maison étrangère et de la préoccupation de ce qu’il allait vraisemblablement être présenté à des dames qu’il n’avait jamais vues. L’épreuve devait bientôt commencer pour le jeune ministre ; car Charles l’invita au même moment à venir voir sa mère et à dîner ensuite avec eux. « Le ciel est pur, ajouta-t-il, et il y a un excellent sentier entre Boughton et Melford. » Bateman répondit qu’il ne pouvait accepter la dernière invitation, mais qu’il serait heureux d’être présenté à madame Reding. Il suivit donc Charles dans le salon, et peu d’instants après il était en conversation avec la mère et ses filles.
« Quel charmant coup d’œil on a de la maison, madame ! dit Bateman. Du dehors on ne croirait pas à une vue si spacieuse. — Non, elle est cachée par les arbres, répondit madame Reding. Le flanc de la colline change si fort sa direction que, dans le principe, je croyais que le point de vue devait être des fenêtres opposées. — Quelle est cette haute colline ? demanda Bateman. — C’est Hart-Hill, répondit Charles ; il y a un camp romain sur le sommet. — Nous pouvons apercevoir huit clochers de nos fenêtres, reprit madame Reding. Sonnez pour le lunch, ma chère. — Ah ! madame Reding, repartit Bateman, nos ancêtres songeaient plus que nous à bâtir des églises, ou pour mieux dire, plus que nous ne l’avons fait ; car, en ce moment, on exécute des travaux prodigieux pour ajouter à nos constructions ecclésiastiques. — Nos ancêtres ont également fait beaucoup, reprit madame Reding. Ma chère, combien d’églises furent bâties dans Londres, sous la reine Anne ? Saint-Martin en était une. — Cinquante, répondit Élisa. — Cinquante étaient projetées, reprit Charles. — Oui, madame, dit Bateman ; mais par ancêtres j’entends les saints évêques et autres membres de notre Église Catholique, antérieurement à la Réforme. Car, quoique la Réforme ait été un grand bienfait (et il jeta un coup d’œil vers Charles), cependant, nous ne pouvons, sans injustice, oublier ce qui a été accompli avant cette époque par les Catholiques Anglais. — Ah ! les pauvres gens, reprit madame Reding, ils ont fait une bonne chose, en bâtissant des églises ; cela nous a épargné beaucoup de peine. — Restaure-t-on beaucoup d’églises dans ce pays ? demanda Bateman, un peu déconcerté. — Ma mère ne fait que d’arriver ici, comme vous, répondit Charles ; oui, on en restaure quelques-unes ; l’église de Barton que vous connaissez, ajouta-t-il en s’adressant à Marie. — Avez-vous poussé vos promenades jusqu’à Barton ? demanda celle-ci à Bateman. — Pas encore, miss Reding, pas encore ; sans doute, on enlève les bancs. — On en fait des siéges, dit Charles, et même d’un très-joli modèle. — Les bancs sont détestables, reprit Bateman ; toutefois, la dernière génération des titulaires les supportait sans se plaindre ; c’est étonnant ! »
Un silence très-naturel succéda à ces paroles. Charles le rompit en demandant au jeune ministre s’il se proposait de faire quelques améliorations à Melford. Bateman prit un air modeste. « Rien d’important, dit-il, quelques petites choses ont été déjà faites. Malheureusement, j’ai un recteur de la vieille école, un pauvre homme, qui est l’ennemi de toute espèce de nouveauté. » Ce fut avec un sentiment de malice, par suite de son attaque contre le clergé du dernier siècle, que Charles engagea son ami à faire un exposé de ses réformes. Eh bien, continua Bateman, il faut beaucoup de prudence dans ces matières, sans cela on fait autant de mal que de bien : on marche dans l’eau chaude avec tout le monde, les marguilliers, le comité paroissial, les vieux recteurs, la gentry de l’endroit, et l’on ne satisfait personne. C’est pour cette raison, que je n’ai pas encore essayé d’introduire le surplis dans la chaire, excepté aux grandes fêtes, me proposant de familiariser peu à peu mes paroissiens avec ce costume. Cependant, je mets l’écharpe ou l’étole, et j’ai eu soin qu’elle fût de deux pouces plus large qu’à l’ordinaire. Je porte aussi, toujours, la soutane dans ma paroisse. J’espère que vous approuvez la soutane, madame Reding ? — C’est un costume très-froid, monsieur, à mon avis, quand elle est de soie ou d’alépine ; elle habille aussi très-mal, quand elle est portée seule. — Spécialement par derrière, dit Charles, la soutane est tout à fait difforme. — J’ai remédié à cela, reprit Bateman. Vous avez remarqué miss Reding, j’en suis sûr, la soutane courte de l’évêque. Elle ne vient qu’aux genoux, et paraît être une continuation du gilet, le frac étant porté comme toujours. Eh bien, mademoiselle, j’ai adopté le même costume avec ma longue soutane ; je mets mon habit par-dessus. » Marie eut de la peine à s’empêcher de rire ; Charles éclata. « Impossible, Bateman, s’écria-t-il ; vous ne voulez pas dire que vous portez votre habit français à basques par-dessus votre longue soutane qui descend jusqu’aux chevilles ?? — Mais, oui, répondit Bateman d’un ton grave : j’ai par là avisé à la chaleur et à l’apparence extérieure, et je suis sûr que tous mes paroissiens me reconnaissent. Je pense que c’est un grand point, miss Reding. Quand je passe, j’entends les petits enfants se dire : Voilà le ministre ! — Je le crois bien ! reprit Charles. — En vérité, s’écria madame Reding, oubliant sa dignité habituelle, qui jamais entendit choses semblables ? » Bateman la regarda avec surprise et stupeur.
« Vous alliez parler de vos améliorations dans l’église, reprit Marie, voulant détourner l’attention du jeune ministre des paroles de sa mère. — Ah ! c’est vrai, miss Reding, c’est vrai, répondit Bateman. Je vous remercie de me le rappeler ; j’ai fait une digression sur mon costume… J’aurais voulu abattre les galeries et diminuer la hauteur des bancs ; mais je n’ai pu exécuter ce projet. J’ai cependant abaissé de six pieds la chaire à prêcher. Or, en faisant ainsi, d’abord j’ai donné dans ma personne l’exemple de la condescendance et de l’humilité que je voudrais inspirer à mes paroissiens. Mais ce n’est pas tout ; comme conséquence de cet abaissement de la chaire, nul dans les galeries ne peut me voir ni m’entendre prêcher ; et cela est un avantage que j’ai l’air d’accorder aux auditeurs de la nef. — Évidemment, c’est une idée heureuse, dit Charles. — Mais c’est aussi un avertissement pour les auditeurs eux-mêmes de la nef, continua Bateman ; car on ne peut me voir ni m’entendre dans les bancs, jusqu’à ce que les côtés en soient diminués — Une seule chose vous manque encore, ajouta Charles avec un air d’amabilité, de crainte d’aller trop loin ; puisque vous avez une haute taille, il vous faut prêcher à genoux, sans quoi vous détruiriez vos propres perfectionnements. » Bateman parut satisfait. « Je vous ai prévenu, mon ami ; je prêche assis. Il est plus conforme à l’antiquité et à la raison, d’être assis que d’être debout. — Avec ces précautions, je pense que vous pourriez arriver à mettre le surplis tous les dimanches. Vos paroissiens sont-ils contents ? — Oh ! pas du tout, loin de là, mais ils n’ont rien à dire : le changement est si simple ! — Y a-t-il encore autre chose ? — Rien en ce qui regarde l’architecture ; mais j’ai opéré une réforme dans les observances. J’ai été assez heureux pour recueillir un très-bel exemplaire de Jewell en lettres gothiques, et je l’ai placé dans l’église, en l’attachant à la muraille avec une chaîne ; il servira aux personnes pauvres qui voudront le lire. Notre église est proprement « l’église du pauvre », madame Reding. — Eh bien, se dit Charles à part lui, je soutiendrai toujours les vieux ministres contre les jeunes, si telle doit être la réforme de ceux-ci.
Puis il reprit à haute voix : « Allons, Bateman, il faut que vous voyiez notre jardin ; prenez votre chapeau, et faisons un petit tour de promenade. Nous avons au bout du jardin une jolie terrasse. » Après avoir ainsi fait poser Bateman pour l’amusement de sa mère et de ses sœurs, Charles l’emmena, et bientôt ils se trouvèrent sur la terrasse, l’arpentant en long et en large, et livrés à une conversation des plus chaleureuses.
« Reding, mon cher ami, dit le jeune ministre, que signifient les bruits qui courent en tout lieu sur votre compte ? — Je n’en sais rien, répondit Charles brusquement. — Eh bien, voici, reprit Bateman ; mais je désire toucher à ce sujet avec toute la délicatesse possible. Ne me répondez pas, si cela vous plaît ainsi, ou ne me répondez que ce que vous voudrez : veuillez toutefois excuser un vieil ami. On dit que vous allez quitter l’Église de votre baptême pour l’Église de Rome. — Ce bruit est-il bien répandu ? demanda Charles froidement. — Oh ! oui, je l’ai appris à Londres : une lettre d’Oxford m’en faisait également mention, et un de mes amis l’a entendu raconter dans le pays de Galles comme une chose positive, à un dîner qui se donnait à l’occasion de la visite de l’évêque. » — Ainsi, pensa Charles, vous venez à votre tour porter témoignage contre moi. « Eh bien, mon bon Reding, continua Bateman, pourquoi gardez-vous le silence ? Est-ce vrai ? — Quoi donc ? que je suis catholique romain ? Oh ! certainement ; ne comprenez-vous pas que c’est pour cela que je prépare mon examen avec tant d’ardeur ? — Allons, parlez sérieusement, Reding ; voulez-vous m’autoriser à contredire ce bruit, et à le nier jusqu’à un certain point, ou sous tous les rapports ? — Sans doute, contredisez-le de toute manière, contredisez-le entièrement. — Puis-je y donner un démenti absolu, sans réserve, sans condition, catégorique, net ? — Sans doute, sans doute. » Bateman ne pouvait pénétrer la pensée de Charles, et il ne se figurait pas à quel point il le tourmentait. « Je ne sais comment vous déchiffrer », dit-il. Ils se promenèrent en silence.
Bateman reprit de nouveau. « Vous voyez, Charles, que ce serait un si prodigieux aveuglement qu’une telle démarche, un aveuglement tout à fait inexcusable, dans un homme comme vous, qui avez connu ce que c’est que l’Église d’Angleterre ; vous, qui n’êtes ni un dissident, ni un laïque illettré ; mais qui avez vécu à Oxford, qui avez fréquenté tant d’hommes supérieurs, qui avez vu ce que peut être l’Église d’Angleterre, sa beauté grave, son activité réglée et convenable ; vous qui avez vu les églises décorées comme elles devraient l’être avec des chandeliers, des ciboires, des prie-Dieu, des lutrins, des antependium[66], des piscines, des jubés et des sedilia ; vous qui, dans le fait, avez vu le service de l’église parfaitement célébré, et qui ne pouvez rien désirer au delà. Dites-moi, mon cher Reding, continua-t-il en le prenant par sa boutonnière, que vous manque-t-il ? Qu’est-ce ? Dites. » Que vous alliez vous promener, aurait répondu Charles s’il avait parlé d’après sa pensée ; mais il se contenta de dire qu’il ne désirait rien, sinon qu’on le crût quand il affirmait qu’il n’avait pas l’intention de quitter son Église. Bateman restait incrédule et croyait à un secret. « Peut-être ignorez-vous, reprit-il, jusqu’à quel point sont connues les circonstances de votre renvoi. Le vieux Principal était tout préoccupé de cette affaire. — Eh bien ! probablement qu’il en a parlé à tout le monde ? — Oh ! oui, répondit Bateman ; un de mes amis, qui le connaît et qui lui fit visite peu de temps après votre départ, a appris toute l’histoire de sa bouche. Le Principal parla de vous avec beaucoup de bienveillance et dans les termes les plus flatteurs ; mais il ajouta que c’était déplorable de voir combien votre esprit avait été perverti par les opinions du jour, et qu’il n’aurait pas été étonné si vous eussiez fini par être catholique romain, même pendant votre séjour à Saint-Sauveur ; qu’en tout cas, vous le deviendriez certainement tôt ou tard, parce que vous souteniez que les Saints qui règnent avec le Christ intercèdent pour nous dans le ciel. Mais ce qui est plus étrange, c’est que lorsque cette histoire se répandit au dehors, Sheffield assura qu’il n’en était pas surpris, qu’il avait toujours prévu ce résultat. — Je lui en suis très-reconnaissant. — Cependant vous m’autorisez à contredire la nouvelle (ainsi l’ai-je compris), à la contredire péremptoirement ? cela me suffit. C’est un grand soulagement, une grande satisfaction, pour mon esprit. Mais il faut que je vous quitte. — Je ne voudrais pas avoir l’air de vous renvoyer, reprit Charles ; mais, évidemment, vous devez partir, si vous voulez arriver chez vous avant la nuit. J’espère que vous ne sentez pas trop la solitude, ou que vous n’avez pas trop d’occupation dans votre paroisse. Quand vous vous ennuierez, où que vous serez fatigué, venez sans cérémonie dîner avec nous ; nous pouvons même vous offrir un lit, si cela vous convient. »
[66] Devants d’autel.
Bateman le remercia, et ils se dirigèrent vers la porte d’entrée. Au moment de sortir, le jeune ministre s’arrêta : « Je désirerais vous prêter quelques livres, dit-il. Permettez-moi de vous envoyer Bramhall, Thorndike, Barrow sur l’unité de l’Église, et les dialogues de Leslie sur la Religion romaine. Je pourrais vous en nommer d’autres, mais je me contente de ceux-ci pour le présent. Ils traitent parfaitement leur matière ; vous ne pourrez vous empêcher d’être convaincu. Je n’ajoute pas un mot ; adieu, au revoir. »
Quoique Charles estimât et aimât beaucoup la société de sa mère et de ses sœurs, il n’était pas fâché d’avoir des relations d’hommes ; aussi accepta-t-il avec plaisir une invitation que lui envoya Bateman de venir dîner à Melford. Il désirait également montrer à son ami, ce que ses protestations ne pouvaient faire, combien étaient exagérés jusqu’à l’absurde les bruits qui couraient sur son compte ; et comme Bateman, malgré le manque complet de sens commun, était, au fond, très instruit et très-versé dans les théologiens anglais, Charles pensait qu’il pourrait par occasion recueillir auprès de lui quelques idées dont il ferait son profit. Lorsqu’il arriva à Melford, il y trouva un M. Campbell, qu’on avait invité à son intention. C’était un jeune homme sorti de Cambridge, et actuellement recteur d’une paroisse voisine ; il professait les mêmes sentiments religieux que Bateman, et, bien qu’un peu positif, il se faisait remarquer par l’éclat de son intelligence et la vigueur de son esprit.
Nos deux invités et leur hôte avaient été voir l’église, et naturellement au dîner, la conversation roula sur la renaissance de l’architecture gothique, événement qu’ils accueillaient tous avec une vraie satisfaction. Le sujet aurait été épuisé presque aussitôt que mis sur le tapis, à cause de leur parfait accord sur cette matière, si par bonheur Bateman n’avait déclaré, d’un ton très-affirmatif, que, s’il le pouvait, il n’y aurait pas d’autre architecture que la gothique dans les églises d’Angleterre, ni d’autre musique que le chant grégorien. La thèse était bonne, clairement posée, et elle fournissait carrière à une très-jolie discussion. Reding commença par dire que tous ces accessoires du culte, soit musique, soit architecture, étaient nationaux ; que c’était le mode dans lequel les sentiments religieux se traduisaient dans des temps et dans des lieux particuliers. D’après lui, sans doute, il n’était pas défendu de diriger l’expression extérieure de la religion dans un pays, mais on ne pouvait la rendre obligatoire, et à ses yeux, il était aussi déraisonnable d’imposer au peuple une seule forme de culte, qu’il l’était de le contraindre à s’amuser d’une seule manière. « Les Grecs, continua-t-il, se coupaient les cheveux en signe de deuil, les Romains les laissaient croître ; les Orientaux voilaient leur tête quand ils priaient, les Grecs la découvraient ; les Chrétiens ôtent leur chapeau dans l’église, les Mahométans leurs souliers ; un long voile est une marque de modestie en Europe, d’immodestie en Asie. On peut aussi bien essayer de changer la taille d’un peuple que les formes de son culte. Bateman, laissez-nous vous raccourcir d’un pied, et puis vous commencerez vos réformes ecclésiastiques. — Mais assurément, mon digne ami, répondit l’amphitryon, vous ne voulez pas dire qu’il n’y a pas de connexion naturelle entre un sentiment intérieur et son expression extérieure, de sorte qu’une forme ne soit pas meilleure qu’une autre ? — Non, loin de là ; mais laissez ceux qui restreignent leur musique au chant grégorien élever des crucifix sur les grandes routes. Chaque forme est la représentation d’une localité ou d’une époque particulière. — C’est ce que je dis du frac et de la longue soutane de notre ami, reprit Campbell ; c’est une confusion de temps différents, de l’ancien et du moderne. — Ou d’idées différentes, ajouta Charles ; la soutane est catholique, le frac est protestant. — C’est l’inverse, repartit Bateman ; la soutane est l’habit anglican du vieux Hooker, le frac vient de la France catholique. — En tout cas, c’est ce que M. Reding appelle une confusion d’idées, dit Campbell ; et c’est la difficulté que j’éprouve à unir ensemble le gothique et le grégorien. — Oh ! pardon, répliqua Bateman, c’est une même idée ; elles sont toutes les deux éminemment catholiques. — Vous ne pouvez pas être plus catholique que Rome, je suppose, repartit Campbell ; pourtant il n’y a pas de gothique dans cette ville. — Rome est une ville à part, répondit Bateman. En outre, mon cher ami, si nous nous rappelons seulement que Rome a corrompu la pure doctrine apostolique, pouvons-nous être surpris qu’elle ait corrompu son architecture ? — Pourquoi donc s’adresser à Rome pour le grégorien ? répliqua Campbell ; car ce chant, sans doute, tire son nom de Grégoire Ier, évêque de Rome, que les Protestants regardent comme le premier spécimen de l’Antechrist. — Eh ! que nous importe ce que pensent les Protestants. — Ne nous disputons pas pour des mots, Bateman ; nous pensons l’un et l’autre que Rome a corrompu la foi, qu’elle soit l’Antechrist ou non. C’est ce que vous venez de dire vous-même. — C’est vrai ; mais je fais une petite distinction. L’Église de Rome n’a pas corrompu la foi, mais elle a admis des corruptions dans son sein. — Cela ne suffit pas ; croyez-le, nous ne pouvons avoir une base solide dans la controverse, à moins que dans nos cœurs nous ne pensions mal de l’Église de Rome. — Eh ! que nous importe Rome ? nous descendons de l’ancienne Église Britannique ; nous ne nous occupons pas de Rome, et nous désirons que Rome ne s’occupe pas de nous ; mais cela ne fait pas son affaire. — Eh bien, reprit Campbell, lisez seulement une page de l’histoire de la Réforme, et vous y verrez que l’âme du mouvement était cette doctrine, que le Pape est l’Antechrist. — Pour les ultra-Protestants, et non pour nous, repartit Bateman. — Oui, des ultra-Protestants comme ceux qui ont écrit les Homélies. Mais, je le répète, je ne dispute pas pour des mots. Voici ma pensée : de même que cette doctrine était la vie de la Réforme, de même la croyance, commune à nous deux, qu’il y a quelque chose de mauvais, de corrompu et de dangereux dans l’Église de Rome ; qu’elle renferme un esprit d’Antechrist, vivant en elle, l’animant et la dirigeant ; cette croyance, dis-je, est nécessaire pour être bon Anglican. Il vous faut croire cela, ou vous devez vous réunir à l’Église de Rome. — Impossible ! mon cher ami ; nous avons toujours soutenu que Rome et nous, nous sommes deux Églises sœurs. — Je dis, reprit Campbell, que sans cette forte répulsion, vous ne pouvez écarter les droits nombreux, l’attraction puissante de l’Église de Rome. Elle est notre mère… Oh ! quel mot !… Notre puissante mère ! Elle ouvre ses bras. Quel parfum s’exhale de son sein ! Elle est pleine de grâces. Je le sens, je l’ai senti depuis longtemps. Pourquoi ne me précipité-je pas dans ses bras ? Parce que je sens aussi qu’elle est conduite par un esprit qui n’est pas elle. Mais si cette méfiance que j’éprouve à son égard et si la certitude que j’ai de sa corruption m’étaient démontrées fausses, j’irais demain m’unir à sa communion. » Ceci n’est pas une doctrine édifiante pour Reding, pensa Bateman. « Mon bon Campbell, dit-il, vous êtes paradoxal aujourd’hui. — Pas le moins du monde ; nos Réformateurs ont compris que le seul moyen de rompre le lien de fidélité qui nous unissait à Rome, c’était de l’accuser d’une profonde corruption. Il en est de même pour nos théologiens. S’il est une doctrine sur laquelle ils se trouvent d’accord, c’est que Rome est l’Antechrist ou un Antechrist. Croyez-le bien, cette doctrine est nécessaire pour légitimer notre position. »
— Je ne comprends pas tout à fait ce langage, que je vois aussi employé dans différentes publications, dit Reding. Il fait supposer que la controverse est un jeu, et que les adversaires ne cherchent pas la vérité, mais des arguments. — Il ne faut pas vous méprendre sur mes paroles, monsieur Reding, repartit Campbell ; ma pensée est que vous ne pouvez pas jouer avec votre conviction que Rome est antichrétienne, si telle est votre croyance ; car si c’est ainsi, il faut parler ainsi. Un poëte a dit : « Parlez doucement de la chute de notre sœur. » Non, si c’est une chute, nous ne devons pas en parler doucement. Tout d’abord on s’écrie : « Une si grande, Église ! eh, qui suis-je pour parler contre elle ? » Oui, vous le devez, si c’est vrai. « Dites la vérité, et moquez-vous du diable. » Rappelez-vous que vous n’employez pas vos propres paroles ; vous avez la sanction et l’appui de tous nos théologiens. Vous le devez ; sans cela, vous ne pouvez donner des raisons suffisantes pour rester en dehors de l’Église de Rome. Vous devez proclamer haut, non ce que vous ne pensez pas, mais ce que vous pensez, si réellement vous avez une conviction. » « Voici au moins une doctrine, se dit Charles à lui-même, c’est placer la controverse dans une coque de noix. » Bateman répliqua : « Mon cher Campbell, vous n’êtes pas du progrès. Nous avons renoncé à toutes ces criailleries contre Rome. — Dès lors, le parti n’est pas aussi habile que je le croyais, repartit Campbell. Soyez-en sûr, ceux qui ont renoncé à leurs protestations contre Rome, ont déjà leurs regards tournés vers elle, ou n’ont pas d’yeux pour voir. — Tout ce que nous disons, reprit Bateman, c’est que, comme je l’ai déjà exprimé, nous ne voulons pas nous occuper de Rome. Nous ne disons pas : Anathème à Rome ! mais Rome nous anathématise. — Cela ne suffit point ; ceux qui sont résolus à rester dans notre Église, et qui emploient des paroles douces à l’égard de Rome seront repoussés sur leur propre terrain, en dépit d’eux mêmes, et n’obtiendront pas de remercîments pour leurs peines. « Nul ne peut servir deux maîtres » : unissez-vous à Rome, ou condamnez-la. Quant à moi, j’avoue que l’Église Romaine a d’excellentes choses que je ne puis nier ; mais en pensant de la sorte, et tout en l’admirant dans certains points, je ne saurais vraiment m’empêcher de parler comme je le fais. Cela ne serait ni loyal, ni logique. »
« Il a mieux fini qu’il n’avait commencé », pensa Bateman ; et il parla dans le même sens. « Oh ! oui, c’est vrai, trop vrai ; c’est pénible à voir, mais il y a dans l’Église de Rome bien des choses contre lesquelles doit nécessairement s’élever tout homme raisonnable, tout lecteur des Pères et de l’Écriture, tout membre véritable de l’Église Anglo-Catholique. » Ces paroles couronnèrent la discussion, et le reste du dîner se passa très-agréablement, sinon d’une manière très-spirituelle.
Après le dîner, nos convives se rappelèrent qu’ils n’avaient fait qu’effleurer la question du grégorien et du gothique. « Comment cela s’est-il fait ? demanda Charles. — En tout cas, nous y voilà de nouveau, dit notre hôte ; et je vous l’avoue, Campbell, j’aimerais à entendre ce que vous avez à dire sur la matière. — A vrai dire, Bateman, répondit celui-ci, je suis fatigué du sujet ; tout le monde me paraît exagéré. A quoi bon discuter là-dessus ? vous ne serez pas d’accord avec moi. — Je ne vois pas ça du tout, répliqua Bateman ; on croit souvent être en désaccord, simplement parce qu’on n’a pas le courage de s’expliquer. » « Excellente remarque, pensa Charles ; quel dommage que Bateman, avec tant de bonnes idées, ait si peu de sens commun ! » « Eh bien, donc, dit Campbell, mon objection au gothique et au grégorien réunis, c’est qu’ils représentent, non pas une, mais deux idées. Ayez de la musique dans les églises gothiques, et gardez pour les basiliques le grégorien. — Mon bon Campbell, repartit Bateman, vous paraissez oublier que les hymnes et les chants grégoriens ont toujours accompagné les nefs, les chapes, les mitres et les calices gothiques. — Nos ancêtres faisaient ce qu’ils pouvaient, reprit Campbell ; ils étaient grands en architecture, petits en musique. Ils ne pouvaient employer ce qui n’était pas encore inventé. Ils chantaient le grégorien, parce qu’ils n’avaient point Palestrina. — Paradoxe ! paradoxe, s’écria Bateman. — On ne peut le nier, continua Campbell : il y a une étroite relation entre l’origine et la nature de la basilique et celles du chant grégorien. Tous les deux existaient avant le Christianisme ; tous les deux sont d’origine païenne ; et plus tard l’Église s’en est emparée pour les consacrer à son service. — Pardon, dit Bateman ; le grégorien est juif et non païen. — Je vous l’accorde par égard pour l’argumentation, répondit Campbell ; mais, au moins, ils n’étaient pas d’origine chrétienne. D’ailleurs, l’ancienne musique et l’ancienne architecture étaient simples et limitées dans leurs moyens de montrer leur art respectif. On ne voit pas un vaste temple grec, on ne trouve pas un seul long Gloria grégorien. — Pas un seul ! s’écria Bateman, et le pauvre Willis, qui se plaignait sans cesse de l’ennui que lui causaient sur le continent les vieux chants grégoriens ! — Je m’explique mal, reprit Campbell ; naturellement, on peut rendre un morceau de plain-chant aussi long que l’on veut, mais simplement par addition et non pas en développant la mélodie. On peut en mettre deux ensemble et en avoir ainsi un deux fois plus long que l’autre ; mais je parle d’une pièce musicale qui, évidemment, doit être le développement naturel d’idées arrêtées et dont toutes les parties s’enchaînent. Pareillement, on peut faire un temple ionique deux fois aussi long et aussi large que le Parthénon ; mais on perd la beauté des proportions en agissant ainsi. Voici donc ma pensée sur l’architecture et la musique primitives : c’est qu’elles atteignent vite leurs bornes, qu’elles sont bientôt épuisées et qu’elles ne peuvent rien au delà. Tenter davantage, c’est forcer un instrument musical au delà de ses moyens.
« Bateman, ajouta Reding, essayez seulement de faire jouer des quadrilles à un violoncelle, et vous verrez ce qu’on veut dire par forcer un instrument. — Eh bien, repartit notre hôte, j’ai entendu Lindley jouer toutes sortes d’airs légers sur son violoncelle, et c’est fort extraordinaire. — Extraordinaire, c’est bien le mot, reprit Charles ; c’est fort extraordinaire. Vous dites : « Comment peut-il produire cet effet ? c’est prodigieux pour une basse », mais, avouez-le, ce n’est pas agréable en soi. De même, j’éprouve toujours une sensation pénible lorsque monsieur tel ou tel se présente pour faire bêler et braire sa délicieuse flûte comme un hautbois ; c’est forcer le pauvre instrument à faire ce pourquoi il ne fut pas créé. — C’est vrai à la lettre en ce qui regarde le chant grégorien, dit Campbell ; les instruments qui existaient primitivement ne pouvaient pas jouer autre chose. Mais je parle sauf correction. Monsieur Reding, vous paraissez posséder le sujet mieux que moi. — J’ai toujours ouï dire, comme vous l’affirmez, répondit Charles, que la musique moderne n’a pris naissance qu’après que l’on a connu la puissance du violon. Corelli lui-même, qui écrivait il n’y a pas encore deux siècles, a traité à peine du démanché. Le piano, également, je l’ai entendu assurer, a presque donné naissance à Beethoven. — La musique moderne ne pouvait donc exister dans les temps anciens, faute d’instruments, reprit Campbell ; et, de même aussi, l’architecture gothique ne pouvait exister avant que la construction des voûtes n’eût atteint à la perfection. De grandes inventions mécaniques ont eu lieu, soit en architecture, soit en musique, depuis l’époque des basiliques et du grégorien ; et chaque science y a gagné. — C’est assez curieux, dit Reding : une chose que j’ai souvent répétée s’applique parfaitement à votre opinion. Quand des gens qui ne sont pas musiciens ont accusé Haendel et Beethoven de n’être pas simples, j’ai toujours répondu : Et l’architecture gothique est-elle simple ? Une cathédrale exprime une idée, mais variée à l’infini et travaillée dans toutes ses parties ; il en est de même d’une symphonie ou d’un quatuor de Beethoven.
— Évidemment, Bateman, reprit Campbell, vous devez tolérer l’architecture païenne, ou il vous faut logiquement exclure le grégorien, qu’il soit païen ou juif ; vous devez tolérer la musique ou réprouver les fenêtres à style flamboyant. — Et pour quoi optez-vous ? demanda notre hôte ; pour le gothique avec Haendel, ou pour l’architecture romaine avec le grégorien ? — Pour tous les deux à leur place. Je préfère de beaucoup l’architecture gothique à la classique. A mes yeux, elle est un vrai produit et une expansion du Christianisme ; mais je ne voudrais pas, pour cette raison, exclure le style païen qui a été sanctifié par dix-huit siècles, par l’amour exclusif de plusieurs pays chrétiens, et par la sanction d’une foule de saints personnages. Je suis pour la tolérance. Faites dominer le gothique, mais ayez du respect pour le classique. »
La conversation se ralentit. « Quoique j’aime la musique moderne, reprit Charles, je ne saurais cependant aller jusqu’à la dernière conséquence où me conduirait votre doctrine. Je ne puis m’empêcher d’aimer Mozart, mais assurément sa musique n’est pas religieuse. — Je n’ai pas pris la défense de compositeurs particuliers, répliqua Campbell ; la musique peut être bonne, et Mozart et Beethoven étaient inadmissibles. Pareillement, vous ne supposez pas, parce que je tolère l’architecture romaine, que j’aime à voir des cupidons tout nus représenter des chérubins, et des femmes mollement couchées figurer les vertus cardinales. » Il s’arrêta. « D’ailleurs, reprit-il, comme vous venez de le dire, nous devons consulter le génie de notre pays et les appréciations religieuses de notre époque. — Eh bien, dit Bateman, je pense que la perfection de la musique sacrée, c’est le grégorien combiné avec l’harmonie ; on a ainsi les célèbres chants d’autrefois et un peu de la richesse moderne. — Et moi, je pense que ce serait le pire de tout, repartit Campbell ; c’est un mélange de deux choses dont chacune est bonne en soi, mais qui sont incompatibles. C’est le mélange du premier et du second service à table. C’est comme l’architecture de la façade de Milan, moitié gothique, moitié grecque. — C’est, je crois, ce qui a toujours lieu, dit Charles. — Nous ne devons pas lutter contre notre siècle, continua Campbell ; ce serait absurde. Je parlais seulement de ce qui est bien ou mal d’après les principes généraux ; et, à vrai dire, je ne saurais moi-même ne pas aimer le mélange, quoique je manque de bonnes raisons pour le défendre. »
Bateman sonna pour le thé ; ses amis désiraient retourner chez eux de bonne heure ; on était au mois de janvier, saison peu favorable pour les promenades après dîner. « Eh bien, Campbell, dit notre hôte, vous êtes plus indulgent pour le siècle que pour moi ; vous lui permettez d’ajouter une basse chiffrée aux tons grégoriens, et vous riez de moi si je mets un frac par-dessus ma soutane. — Il n’y a pas de gloire, repartit Campbell, à être l’auteur d’un type mixte. — Un type mixte ! s’écria Bateman ; c’est plutôt un état de transition. — A quel état passez-vous ? demanda Charles. — A propos de transition, dit Campbell, savez-vous que votre ami Willis (je ne connais pas son collége, celui qui s’est fait catholique) demeure dans ma paroisse, et que j’ai l’espérance de lui voir faire une nouvelle transition, en arrière. — L’avez-vous vu ? demanda Charles ? — Non, j’ai été pour lui faire visite ; malheureusement il était sorti. J’ai appris qu’il va encore à la messe. — Mais où trouve-t-il une chapelle ? reprit Bateman. — A Seaton. — A sept bons milles de chez vous, dit Charles. — Oui, répondit Campbell, et il fait à pied cette longue course, tous les dimanches. — Cela ne ressemble pas à une transition, fit observer Charles, sinon qu’elle est physique. — Il faut bien aller quelque part, repartit Campbell ; je pense qu’il a continué de fréquenter notre église jusqu’à la semaine où il s’est fait catholique. — Terribles sont ces défections, reprit Bateman ; mais c’est très-consolant, c’est une satisfaction triste (jetant un coup d’œil à Charles) que les victimes de l’illusion soient enfin recouvrées. — C’est très-triste, en vérité, dit Campbell. Je crains qu’il ne nous faille en attendre bien d’autres encore. — Pour moi, je ne sais qu’en penser, reprit Charles. Le droit que l’Église a sur notre esprit est si puissant ; c’est un si cruel tourment de la quitter, que je ne puis m’imaginer qu’un lien de parti fasse agir contre elle. Humainement parlant, il est, croyez-moi, infiniment plus difficile de retenir ces hommes que de les ramener. — Oui, s’ils changeaient par esprit de parti, reprit Campbell ; mais tel n’est pas le cas. Ils ne changent pas simplement parce que d’autres changent ; mais, les malheureux ! parce qu’ils ne peuvent s’en empêcher… Bateman, auriez-vous l’obligeance de dire qu’on avance ma voiture devant la porte ?… Comment peuvent-ils s’en empêcher ? continua-t-il, en se levant devant le feu ; leurs principes catholiques les poussent, et il n’y a rien pour les faire revenir à nous. — Pourquoi leur amour pour notre Église, qui est la leur, ne le ferait-il pas ? dit Bateman ; c’est déplorable, c’est impardonnable. — Ils s’en iront l’un après l’autre, à mesure qu’ils seront mûrs, reprit Campbell. — Avez-vous entendu dire (je ne crois pas beaucoup moi-même à ce bruit) que Smith a des tendances vers Rome ? dit Charles. — Ce n’est pas possible, répondit Campbell tout pensif. — Impossible, tout à fait impossible, s’écria Bateman ; un tel triomphe pour nos ennemis ! je n’y croirai que lorsque je le verrai de mes yeux. — Ce n’est pas impossible, répéta Campbell tout en boutonnant et en arrangeant sa redingote ; Smith a changé sa manière de voir… » On annonça la voiture. « Monsieur Reding, je crois que je puis vous épargner une partie de la route, si vous voulez accepter une place dans mon cabriolet. » Charles ne refusa pas l’invitation, et peu d’instants après Bateman se trouvait seul.
Campbell laissa son compagnon de voyage à mi-chemin de Melford à Boughton. Après avoir remercié son nouvel ami de son obligeance, Charles franchit une barrière sur le côté de la route, et fut tout de suite engagé dans l’ombre d’un taillis, le long duquel se déroulait le sentier. C’était par un beau clair de lune. Au bout de quelques instants, il se trouva en vue d’une grande croix de bois. En des jours meilleurs, cette croix avait été un emblème religieux, mais elle avait servi, dans les derniers temps, à marquer la limite entre deux paroisses contiguës. La lune l’éclairant en face, le symbole sacré se dessinait majestueusement sur le ciel pâle, qui se reflétait dans une nappe d’eau, vénérée encore dans le voisinage pour sa vertu miraculeuse. Charles, à sa grande surprise, vit distinctement un homme à genoux sur un petit monticule d’où s’élançait la croix ; il entendit même des coups. Armé d’une discipline, cet homme frappait ses épaules nues, en récitant des paroles qui parurent à Reding être une prière. Notre jeune ami s’arrêta, ne voulant pas l’interrompre, embarrassé toutefois pour passer outre ; mais l’étranger avait entendu le bruit de sa marche, et en quelques secondes il disparut. Charles fut frappé d’une émotion soudaine qu’il ne put maîtriser. « O temps béni, s’écria-t-il, alors que la foi était une ! O heureux pénitent, admirable chrétien, qui avez une croyance, qui savez comment obtenir votre pardon, et qui pouvez commencer là ou d’autres finissent ! Me voici, moi, avec mes vingt-deux ans, incertain sur tout, parce que je ne sais à quoi donner ma confiance. » Il se rapprocha de la croix, ôta son chapeau, mit un genou en terre, baisa le bois sacré, et il pria un instant afin que quelles que fussent les conséquences, quelle que fût l’épreuve, quel que fût le sacrifice, il obtînt la grâce d’aller partout où Dieu l’appellerait. Puis il se leva et s’approcha de la source froide ; il prit un peu d’eau dans le creux de sa main et la but. Il se sentit disposé à prier le saint, protecteur de cette fontaine (saint Thomas martyr, croyait-il), d’intercéder pour lui et de l’aider dans la recherche de la vraie foi, mais quelque chose lui murmura à l’oreille : « C’est mal » ; et il réprima ce désir. Remettant donc son chapeau, il passa outre, et il continua son chemin d’un pas rapide.
Sa mère et ses sœurs s’étaient retirées pour dormir, et il monta sans délai à sa chambre. En passant dans son cabinet, il trouva sur sa table, sans timbre de poste, une lettre qu’on lui avait apportée pendant son absence. Il en brisa le cachet ; c’était un écrit anonyme qui commençait ainsi :
« Questions pour celui à qui il appartient.
» 1. Qu’entend-on par l’Église une dont parle le Symbole ? »
« C’est trop pour cette nuit, se dit Charles, il est déjà tard. » Il replia la lettre et la jeta sur sa toilette. « C’est sans doute quelque personne bien intentionnée, qui pense me connaître. » Il remonta sa montre, bâilla et mit ses pantoufles. « Qui, dans le voisinage, peut m’adresser cet écrit ? » Il rouvrit la lettre. « Cela vient certainement d’un catholique », continua-t-il. Son esprit se porta sur la personne qu’il avait vue au pied de la croix ; peut-être alla-t-il plus loin. Il s’assit, et lut le papier in extenso.
« Questions pour celui à qui il appartient.
» 1. Qu’entend-on par l’Église une dont parle le Symbole ?
» 2. Est-ce une généralisation ou une réalité ?
» 3. Appartient-elle à l’histoire du passé ou au temps présent ?
» 4. L’Écriture n’en parle-t-elle pas comme d’un royaume ?
» 5. Et comme d’un royaume qui doit durer jusqu’à la fin ?
» 6. Qu’est-ce qu’un royaume ? Et que veut dire l’Écriture lorsqu’elle appelle l’Église un royaume ?
» 7. Est-ce un royaume visible ou invisible ?
» 8. Un royaume peut-il avoir deux gouvernements, surtout agissant dans des directions contraires ?
» 9. L’identité des institutions, des opinions ou de la race est-elle suffisante pour faire de deux nations un seul royaume ?
» 10. La forme de l’Épiscopat, la hiérarchie, ou le Symbole des Apôtres est-il suffisant pour faire une seule Église des Églises de Rome et d’Angleterre ?
» 11. Là où il y a des parties, l’unité ne demande-t-elle pas l’union, et une unité visible ne requiert-elle pas une union visible ?
» 12. Comment peuvent-elles être les mêmes, deux Religions qui ont un culte tout à fait différent et des idées différentes sur le culte ?
» 13. Deux religions peuvent-elles n’en former qu’une, lorsque ce que l’une regarde comme l’acte le plus sacré et le plus caractéristique de son culte est appelé par l’autre un mensonge blasphématoire et une tromperie dangereuse ?
» 14. L’Église une du Christ n’a-t-elle pas la foi une ?
» 15. Une Église qui n’a pas la foi une peut-elle appartenir au Christ ?
» 16. Qu’est-ce qu’une Église qui se contredit dans ses formulaires ?
» 17. Et dans différents siècles ?
» 18. Et dans ses formulaires comparés avec ses théologiens ?
» 19. Et dans ses théologiens et dans ses membres comparés les uns aux autres ?
» 20. Quelle est la foi de l’Église d’Angleterre ?
» 21. Combien de conciles admet l’Église d’Angleterre ?
» 22. L’Église d’Angleterre considère-t-elle les Églises actuelles des Nestoriens et des Jacobites comme étant sous l’anathème, ou comme formant une partie de l’Église visible ?
» 23. Est-il nécessaire ou possible de croire quelqu’un, sinon un véritable envoyé de Dieu ?
» 24. L’Église d’Angleterre est-elle un envoyé de Dieu ? Revendique-t-elle ce titre ?
» 25. Nous enseigne-t-elle la vérité, ou nous ordonne-t-elle de la chercher ?
» 26. Si elle laisse à nous-mêmes de rechercher la vérité, les membres de l’Église d’Angleterre la cherchent-ils avec cette ardeur que l’Écriture nous prescrit ?
» 27. Est-elle en état de sécurité une personne qui vit sans foi, quoiqu’elle paraisse avoir l’espérance et la charité ? »
Charles était accablé de sommeil avant d’arriver à la vingt-septième question. « Cela ne suffit pas, se dit-il ; je perds seulement mon temps. Ces questions paraissent bien posées ; mais elles doivent rester là. » Il déposa le papier, dit ses prières, et fut bien vite endormi.
Le lendemain, en s’éveillant, le sujet de la lettre se présenta à son esprit, et pendant quelque temps il se prit à y réfléchir. Certainement, dit-il, je désire beaucoup être fixé soit dans l’Église d’Angleterre, soit partout ailleurs. Je voudrais savoir ce que c’est que le Christianisme ; je suis prêt à ne reculer devant aucune difficulté pour le chercher ; si je le trouvais, je l’accepterais avec empressement et reconnaissance. Mais c’est une œuvre de temps ; tous les arguments écrits du monde sont insuffisants pour donner à quelqu’un une vue claire des choses en un quart d’heure. Il doit y avoir une marche à suivre ; on peut l’abréger, comme la médecine abrége la marche de la nature, mais on doit en subir la nécessité. Je me rappelle comment tous mes doutes religieux et mes théories s’évanouirent à la mort de mon pauvre père. Ils ne faisaient pas partie de moi, et ils ne purent supporter l’orage. La conviction est la vue de l’esprit et non une conclusion déduite de prémisses ; c’est Dieu qui la travaille, et ses opérations sont lentes. Au moins, en est-il ainsi pour moi. Je ne puis croire tout d’un coup ; si je l’essaye, je prendrai des mots pour des choses, et je suis sûr de m’en repentir. Si j’agis autrement, je marcherai droit, simplement par hasard. Je dois me mouvoir dans la voie qui semble celle de Dieu ; je ne puis que me mettre sur la route ; une puissance plus haute doit m’atteindre et me pousser en avant. Maintenant, j’ai vis-à-vis de moi un devoir direct que mon père m’a laissé à remplir, c’est de faire de bonnes études. C’est là le sentier du devoir. Je n’abandonnerai pas mes recherches, mais je les ferai marcher dans ce sens. Dieu peut bénir mes études, et m’y faire trouver la lumière spirituelle, aussi bien qu’en toute autre chose. Saül cherchait les ânesses de son oncle, et il trouva un royaume. Tout vient en son temps. Quand j’aurai pris mon premier grade, ce sujet me reviendra à propos. » Il soupira. « Mon grade ! ces odieux Articles ! plutôt, quand j’aurai passé mon examen. Mais à quoi bon rester ici. » Et il se leva à la hâte de son lit, tout en faisant sur lui le signe de la croix. Ses yeux rencontrèrent la lettre. « Elle est bien écrite ; mieux que Willis ne pourrait le faire ; non, elle n’est pas de Willis. Il y a quelque chose que je ne puis comprendre par rapport à ce jeune homme. Je voudrais bien savoir comment il s’entend avec sa mère. Je ne pense pas qu’il ait des sœurs. »
Campbell avait été enchanté de Reding, et son intérêt pour ce jeune homme n’avait pas diminué, quoique Bateman lui eût fait entendre que l’attachement de Charles pour l’Église d’Angleterre était en péril. Peu de temps après, il lui fit une visite et l’invita à dîner. Lorsque Charles lui eut rendu la même politesse, il commença à s’établir entre le recteur de Sutton et la famille de Boughton une liaison qui devint de l’intimité avec le temps. Campbell était un vrai gentleman, qui avait beaucoup voyagé : d’une intelligence vive, d’un esprit ardent, d’une franchise loyale, il était versé dans la théologie anglicane et plein de dévouement pour son Église ; quant à sa position matérielle, il jouissait d’une grosse cure dont les revenus faisaient de lui presque un dignitaire de l’Établissement. Marie était charmée de cette connaissance, parce qu’elle plaçait son frère sous l’influence d’un esprit qu’il ne pouvait point ne pas estimer ; d’ailleurs, comme Campbell avait une voiture, naturellement il épargnerait à Charles, en venant lui-même à Boughton, la perte d’une journée d’étude et la fatigue d’une promenade dans la boue pour aller au presbytère. Il arriva ainsi que Campbell venait deux fois chez madame Reding, tandis que Charles n’allait qu’une fois à Sutton. Mais quel que fût le résultat de ces visites, rien de particulier ne mérite d’en être noté dans notre récit ; nous n’en parlerons donc pas.
Un jour Charles allait voir Bateman. A son entrée dans le salon, il fut étonné de trouver son ami et Campbell occupés à leur collation et s’entretenant avec un troisième personnage. Il y eut un moment de surprise et d’hésitation à son arrivée. En jetant les yeux sur l’étranger, il sentit lui-même un léger embarras qu’il ne put maîtriser. C’était Willis, et, selon toute probabilité, on travaillait à le reconvertir. Charles, évidemment, était de trop ; mais il n’y avait rien à faire ; il échangea donc une poignée de main avec Willis, et accepta la pressante invitation que lui fit Bateman de se mettre à table et de partager leur pain et leur fromage.
Charles s’assit en face de Willis, et pendant quelque temps il ne put le quitter des yeux. Tout d’abord, il eut quelque peine à croire qu’il eût devant lui ce jeune homme impétueux qu’il avait connu deux ans et demi auparavant. Dans une société nombreuse, Willis avait toujours gardé le silence ; mais à cette heure, il était complétement changé en cela comme en tout le reste. Il ne parlait pas plus qu’il ne fallait, mais sa parole était libre et aisée. Le changement toutefois le plus remarquable était dans son air et ses manières. Il avait perdu son teint de fraîcheur et de jeunesse ; l’expression de sa figure était à la vérité plus douce qu’auparavant et très-calme, mais on remarquait une légère contraction de chaque côté de la bouche ; ses joues étaient maigries, et il avait l’air d’un homme de trente ans. Quand il entra en conversation et qu’il fut animé, l’ancien Willis reparut.
« Voilà un plat qui doit nous étonner tous dans cette saison, dit Charles en se servant de crème, car aucun de nous n’appartient au Devonshire. — Cette crème n’est pas particulière à ce comté, répondit Campbell ; on la trouve sur le continent. A Rome, il y a une espèce de crème ou de fromage qui y ressemble et qui est très-commune. — Comment le beurre et la crème peuvent-ils se conserver dans un climat si chaud ? demanda Charles ; je croyais qu’on y substituait l’huile. — Il ne fait pas à Rome aussi chaud que vous vous l’imaginez, repartit Willis, excepté pendant l’été. — L’huile ? c’est vrai, dit Campbell ; c’est pourquoi l’Écriture nous parle de la multiplication de l’huile et de la farine, qui semblent répondre au pain et au beurre. A Rome, l’huile est excellente, très-limpide et très-claire ; on peut la prendre comme du lait. — Elle a, je suppose, un goût particulier, dit Charles. — Tout d’abord, répondit Campbell ; mais on s’y accoutume bientôt. Les substances telles que le lait, le beurre, le fromage et l’huile ont dans le principe un goût spécial que l’usage fait disparaître. Le beurre de la fertile Guernesey est trop fort pour les étrangers, tandis que les Russes savourent l’huile de baleine. La plupart de nos goûts sont artificiels jusqu’à un certain point. — C’est certainement ainsi par rapport aux légumes, dit Willis ; dans mon enfance, je ne pouvais manger les fèves, les épinards, les asperges ni les panais. — C’est pourquoi, reprit Campbell, votre menu d’ermite est non-seulement le plus naturel, mais le seul naturellement agréable : « une croûte de pain et de l’eau du torrent », je suppose. — Ou les pois chiches du Clerc de Copmanhurst, dit Charles. — Le macaroni et les raisins de Naples sont tout aussi naturels et plus agréables au goût, reprit Willis. — C’est plutôt du luxe, dit Bateman. — Non, répondit Campbell, ce n’est pas du luxe ; le luxe, dans son idée vraie, est quelque chose de recherché. Ainsi Horace parle de la peregrina lagoïs. Ce que la nature produit sponte suâ autour de nous, quoique délicieux, n’est pas du luxe. Les canards sauvages ne sont pas du luxe dans votre ancien voisinage, au milieu de vos marais d’Oxford, Bateman ; il en est de même des raisins à Naples. — Alors, repartit notre hôte, les vieilles femmes d’ici donnent dans le luxe pour leur six pence de thé, car ce produit vient de la Chine. » Campbell se tut un instant. Ni lui ni Bateman ne paraissaient à leur aise ; on les eût dit également gênés l’un vis-à-vis de l’autre ; cela pouvait provenir de l’arrivée inattendue de Charles, ou de tout autre incident survenu auparavant. A la fin, Campbell répondit que les bateaux à vapeur et les chemins de fer opéraient d’étranges changements ; que le temps et l’espace disparaissaient, et que bientôt le prix serait la seule mesure du luxe.
« Le prix paraît être également la mesure du grasso et du magro en Italie, dit Willis ; car je crois qu’il y a des dispenses pour la viande de boucher en carême, à cause de la cherté du pain et de l’huile. — Cela prouve, remarqua Campbell, que le siècle de l’abstinence et du jeûne est passé ; car il est absurde de faire le carême avec du bœuf ou du mouton. — Oh ! Campbell, que dites-vous ? s’écria Bateman : Passé ! sommes-nous liés par leurs pratiques relâchées d’Italie ? — Eh bien, quant à moi, mon cher, je crois que le jeûne ne convient pas à notre siècle, en Angleterre comme à Rome. » « Prenez-y garde, mes bons amis, pensa Charles ; serrez vos rangs, ou votre prisonnier vous échappe. » « Quoi ! s’écria Bateman, ne pas jeûner le vendredi ! Nous observions toujours cette loi très-sévèrement à Oxford. — Cela vous fait honneur, répliqua Campbell, mais je suis de Cambridge. — Mais que pensez-vous des Rubriques et du Calendrier ? reprit Bateman. — Ils n’obligent pas, répondit Campbell. — Ils obligent, riposta Bateman. » Il y eut un moment de silence, comme parmi les spectateurs d’un combat de boxeurs. Charles s’interposa : « Bateman, donnez-moi un morceau de votre excellent pain, fait ici, je suppose ? — Mille pardons ! Reding… Ils n’obligent pas ?… S’il vous plaît, Willis, passe-le-lui, Oui, il vient de la ferme, la porte voisine. Je suis heureux que vous l’aimiez… Je le répète, ils obligent, Campbell. — Singulière obligation, quand ils n’ont jamais obligé, repartit celui-ci ; ils existent depuis deux ou trois cents ans ; quand ont-ils été mis en vigueur ? — Mais ils se trouvent dans le Prayer-Book. — Oui, et laissez-les-y reposer, et ne les en faites jamais sortir ; ils y resteront jusqu’à la fin de l’histoire. — Oh ! fi donc ! vous devriez venir en aide à votre mère dans ses difficultés, et ne pas ressembler au prêtre et au lévite. — Ma mère ne désire point être aidée. — Quel langage ! que ferai-je ? que peut-on faire ? s’écria le pauvre Bateman. — Que faire ? Rien, répondit Campbell ; n’est-ce pas ici comme une loi tombée en désuétude ? Or, une loi ne cesse-t-elle pas d’obliger quand on n’en presse pas l’accomplissement ? J’en appelle à M. Willis. » Willis, ainsi interpellé, répondit qu’il n’était pas un théologien de morale ; mais il avait assisté à quelques cours, et il croyait que c’était la règle catholique, que lorsqu’une loi, après sa promulgation, n’était pas observée par la majorité, si le législateur, connaissant cet état de choses, gardait le silence, il était censé révoquer la loi ipso facto. « Quoi ! dit Bateman à Campbell, vous en appelez à l’Église de Rome ? — Non, répondit celui-ci ; j’en appelle à toute l’Église catholique, dont, pour ce cas particulier, Rome, par hasard, a exposé la doctrine. C’est un principe de sens commun, que, si une loi n’est pas pressée dans son exécution, à la fin elle cesse d’obliger. Autrement, ce serait une vraie tyrannie ; nous ne saurions plus où nous en sommes. L’Église de Rome ne fait qu’exprimer cette donnée du sens commun. — Eh bien donc, reprit Bateman, j’en appellerai également à l’Église Romaine. Rome est une partie de l’Église Catholique, aussi bien que notre Église ; puis donc que l’Église de Rome a toujours maintenu les jeûnes, la loi n’est pas abolie ; « la plus grande partie » de l’Église Catholique l’a toujours observée. — Mais elle ne l’observe pas, répliqua Campbell ; aujourd’hui, elle dispense du jeûne, vous l’avez entendu. »
Willis s’interposa pour faire une question. « Voulez-vous donc dire, Bateman, que l’Église d’Angleterre et l’Église de Rome ne font qu’une même Église ? — Très-certainement, répondit notre hôte. — Est-ce possible ? dit Willis ; quel sens attachez-vous au mot une ? — Je le prends en tout sens, excepté celui d’inter-communion. — C’est-à-dire, je suppose, qu’elles sont une, excepté qu’elles n’ont aucun rapport entre elles. » Bateman en convint. Willis continua : « Pas de rapport, c’est-à-dire pas de relations sociales, pas de consultations ni d’entente, pas de commandement ni d’obéissance, pas de support mutuel, en un mot pas d’union visible. » Bateman approuva encore. « Eh bien, voici ma difficulté, ajouta Willis : je ne puis comprendre comment deux parties peuvent faire un seul corps visible, si elles ne sont pas visiblement unies ; l’unité implique l’union. — Je ne vois pas cela du tout repartit Bateman ; je ne le vois pas du tout. Non, Willis ; ne vous attendez pas à ce que je vous cède là-dessus ; c’est un de nos principes. Il n’y a qu’une seule Église visible, et c’est pourquoi les Églises d’Angleterre et de Rome en forment toutes deux des parties. »
Campbell vit clairement que Bateman s’était jeté dans une difficulté, et il vint lui porter secours à sa façon. « Il nous faut poser le cas, dit-il, d’une manière plus définie. Un royaume peut être divisé, il peut être déchiré par des partis, par des dissensions, et cependant être encore un royaume. Telle est, je le comprends, la condition réelle de l’Église, et c’est de la sorte que les Églises d’Angleterre, de Rome et de Grèce n’en forment qu’une. — Je suppose que vous m’accorderez, répondit Willis, que plus un parti rebelle est fort, plus l’unité du royaume est menacée ; et si la rébellion triomphe, ou si les partis, dans une guerre civile, s’entendent pour partager entre eux l’autorité et le territoire, alors sur-le-champ, au lieu d’un royaume, vous en avez deux. Il y a quelques années, la Belgique était une partie du royaume des Pays-Bas ; l’appelleriez-vous encore maintenant une partie de ce même royaume ? Or, tel paraît être le cas pour les Églises de Rome et d’Angleterre. — Mais un royaume peut être en état de décadence, répliqua Campbell ; voyez l’Empire Turc en ce moment. L’union entre les parties séparées est si faible, que chaque pacha peut être appelé souverain ; pourtant, c’est un seul royaume. — Donc l’Église, en ce moment, objecta Willis, est un royaume qui tend à sa dissolution ? — Certainement. — Et elle finira par tomber ? — Sans doute : lorsque la fin arrivera, selon la parole de Notre-Seigneur : « Quand le Fils de l’Homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Précisément comme dans le cas du peuple élu : le sceptre sortit de Juda quand vint le Messie. — Eh bien, j’ose l’affirmer, répliqua Willis, l’Église a déjà failli avant la fin, d’après l’idée que vous vous faites de sa chute. Peut-il y avoir une séparation plus complète que celle qui existe aujourd’hui entre l’Église de Rome, celle de Grèce et celle d’Angleterre ? — Elles pourraient s’excommunier l’une l’autre, repartit Campbell. — Vous voulez donc assigner à l’avance quelque chose de défini dont l’accomplissement constituera une séparation réelle. — Ne faites pas cela, Campbell, dit Reding, c’est dangereux. Ne vous jetez pas dans une question morale ; car alors, si la chose spécifiée arrivait, il deviendrait difficile de voir notre chemin. — Non, reprit Willis ; vous seriez certainement dans l’embarras ; mais vous vous retrouveriez, je le sais. Dans ce cas, vous choisiriez un autre ultimatum pour votre marque de schisme. Ce serait, ajouta-t-il avec une certaine émotion, dans le plus profond abîme un abîme plus profond encore. »
Ces dernières paroles étaient loin de s’harmoniser avec le ton de la conversation qui avait régné jusque-là, et elles firent éclater notre hôte, qui, pendant quelque temps, était resté auditeur impatient. « En vérité, Campbell, votre marche est dangereuse, dit-il ; je ne puis vous suivre. Il ne sera jamais bien de dire que l’Église va à sa chute ; non l’Église ne peut faillir. Elle est toujours forte, pure, et parfaite, selon le langage des prophètes. Voyez ses cathédrales, les églises de ses abbayes et les autres sanctuaires ; voilà le type de l’Église. — Mon cher Bateman, répondit Campbell, je veux, comme vous, maintenir l’accomplissement des prophéties faites à l’Église ; mais il nous faut admettre le fait que les branches de l’Église sont divisées, tout en soutenant la doctrine que l’Église doit être une. — Je ne suis pas de votre avis, mon cher ami. Non, il n’est pas nécessaire d’admettre cela. Il n’y a pas plusieurs Églises ; il n’y a en tous lieux qu’une seule Église, et elle n’est pas divisée. Ce sont simplement les formes extérieures, les apparences, les manifestations de l’Église qui sont différentes. L’Église est une autant que jamais. C’est comme dans le pain consacré, la substance matérielle est brisée, mais la présence du Christ reste une et la même. « Cette doctrine n’est pas admissible », répondit Campbell ; et il se leva devant le feu, évidemment mal à l’aise. « La nature ne vous a pas créé controversiste, mon cher Bateman », se dit-il à lui-même. « C’est comme je le pensais, reprit Willis ; Bateman, vous décrivez une Église invisible. C’est l’indéfectibilité de l’Église invisible, et non celle de l’Église visible, que vous soutenez. »
« Les voilà embourbés, pensa Charles ; mais je ferai de mon mieux pour sortir de là ce pauvre Bateman. » « Non, reprit-il ; Bateman veut dire qu’une Église présente dans quelques points particuliers une apparence différente d’une autre Église : mais il ne s’ensuit pas que dans le fait elles n’aient pas aussi un accord visible. Toute différence implique un accord ; les Églises d’Angleterre et de Rome s’accordent visiblement et diffèrent de même. Songez, Willis, aux différents styles d’architecture, et vous verrez quelle est sa pensée. Une église est une église partout ; elle est visiblement une et la même, et cependant que de différences il y a d’église à église ! Nos églises sont gothiques, celles du Midi sont grecques. Quelle différence entre une basilique et la cathédrale d’York ! Pourtant elles s’accordent visiblement ensemble. Personne ne les prendra, ni l’une ni l’autre, pour une mosquée ou un temple juif. Mais on peut discuter pour savoir quel est le meilleur style ; l’un aime la basilique, l’autre appelle ce style païen. — C’est mon opinion, dit Bateman. — Un peu d’exagération, comme de coutume, reprit Campbell. La basilique est belle en son lieu. Il y a deux choses que le gothique ne peut produire, la ligne ou la forêt de colonnes rondes et polies, et le dôme gracieux s’arrondissant sur la tête du spectateur comme le bleu firmament. »
Tout le monde fut satisfait de cette diversion à la controverse religieuse. On continua donc avec beaucoup d’entrain la conversation plus légère qu’on venait d’ouvrir. « Je dois l’avouer, dit Willis ; les églises de Rome ne m’impressionnent pas comme les églises gothiques ; je les respecte, elles me pénètrent d’une sainte terreur, mais j’aime l’arcade gothique, sa vue me fait plaisir. — Il y a d’autres raisons de ce sentiment, reprit Campbell ; à Rome, les églises sont incomplètes et malpropres. Rome est une ville de ruines ; les temples chrétiens sont bâtis sur des ruines, et ils sont eux-mêmes, en général, délabrés ou près de s’écrouler ; ce sont, passez-moi l’expression, des ruines de ruines. » Campbell était sur un sujet plus facile que celui de l’Anglo-Catholicisme, et, comme personne ne l’interrompait, il continua à son aise : « A Rome, d’énormes et hauts contre-forts remplacent les colonnes, et sont revêtus de plâtre froid ou de peintures, au lieu de marbre, ce qui donne aux églises un air indescriptible d’abandon. » Willis ajouta qu’il s’était souvent demandé ce qui pouvait amener à Rome tant d’étrangers, c’est-à-dire tant de Protestants. « C’est une ville si solitaire, si triste ! continua-t-il ? Qu’y trouve-t-on, en effet ? Un amas de décombres, un terrain inégal, des chaussées droites, enfermées dans de hautes et monotones murailles ; les monuments antiques se perdant au milieu de solitudes immenses ; des palais ternis par le temps, des arbres sans verdure, des rues où l’on enfonce dans la boue jusqu’à la cheville, d’épais nuages de poussière et de paille qui vous aveuglent et vous étouffent, un climat très-variable, l’air du soir très-dangereux. Naples est bien un paradis terrestre, mais Rome n’est qu’une ville de foi. Chercher les reliquaires qu’elle contient serait une vraie pénitence, comme cela doit être pour un vrai Chrétien. Je comprends l’attrait des Catholiques pour cette ville ; mais je suis surpris d’y voir des Protestants. — Il y a un charme auprès des limina Apostolorum, dit Reding, Saint-Pierre et Saint-Paul ne sont pas là pour rien. — Il y a une raison plus palpable, reprit Campbell ; c’est que cette ville est un rendez-vous universel de toutes les parties du monde. Il n’y a pas de société aussi variée que celle de Rome. Vous allez à un bal ; votre hôte, que vous saluez dans le premier salon, est Français ; vous avancez, vos yeux aperçoivent la petite fille de Masséna en conversation avec Mustapha-Pacha ; bientôt vous vous trouvez assis entre un chargé d’affaires yankee et un colonel russe ; et en face de vous un Anglais se fait remarquer par son excentricité. »
Ici Campbell, après avoir regardé sa montre, jeta un coup d’œil à Willis, qu’il avait amené à Melford pour rendre sa visite à Bateman. Il était temps pour eux de partir, s’ils ne voulaient être surpris par la nuit. Notre hôte, qui se trouvait fort mécontent depuis qu’il avait parlé, c’est-à-dire depuis environ un quart d’heure, n’était pas d’humeur à faire des instances pour les retenir, non plus que Reding ; il se trouva donc bientôt seul. Il approcha son fauteuil du feu. Pendant quelques instants, il n’éprouva que le sentiment d’un profond dégoût. A la fin, pourtant, ses pensées commencèrent à se dérouler, et elles prirent la forme suivante : « C’est dommage, c’est dommage, se dit-il ; Campbell est un homme très-habile, bien plus habile que moi ; c’est même un homme instruit ; mais il n’a pas de tact. C’est déplorable ; l’arrivée de Reding a été un malheur ; nous aurions pu, toutefois, la faire tourner à notre avantage ; mais employer les arguments dont il s’est servi ! Comment pouvait-il espérer de le convaincre ? Il nous a rendus simplement la risée des autres… Comment s’est-il tiré d’affaire ? Il a dit que les Rubriques ne lient pas. Qui jamais entendit pareil langage, au moins de la part d’un Anglo-Catholique ? Comment prétendre être bon Catholique avec de telles idées ? Mieux vaudrait s’appeler Protestant ou Erastien tout d’un coup ; on saurait au moins à quoi s’en tenir. Quelle fâcheuse impression cela doit avoir faite sur Willis ! Je m’en suis bien aperçu ; il avait de la peine à contenir un sourire ; mais Campbell n’a aucun tact. Il va, il va son chemin, jetant ses pensées, qui sont très-subtiles, très-originales, certainement, mais il ne tient jamais compte de la société présente. Et puis, il est si positif, si tranchant ; c’est très-désagréable, je ne sais parfois comment je puis supporter tout cela. Oh ! voici une cruelle affaire, l’effet doit en être désastreux. Pauvre Willis ! je suis certain que nous ne l’avons pas fait avancer d’un pouce. Il m’a paru même, à un moment, qu’il riait de moi… Qu’a-t-il dit ensuite ? Il y avait quelque autre chose, je le sais. Ah ! je me souviens. L’Église Catholique est en ruines, elle est brisée en morceaux !… Quel paradoxe ! qui le croira, si ce n’est lui ? J’avoue que je suis si vexé, que je ne sais que faire. » Il se leva brusquement et se mit à se promener en long et en large. « Et tout cela, parce que les évêques n’interviennent point. On ne peut le dire, et c’est ce qu’il y a de plus triste, mais ils sont au fond la cause du mal. Ils n’auraient qu’à montrer leur petit doigt et à rendre obligatoires les Rubriques, dès lors toute controverse serait finie… Mais je croyais qu’il y avait encore autre chose. Eh ! oui, il a dit qu’il n’était pas nécessaire de jeûner ! Mais les étudiants de Cambridge sont toujours singuliers, ils ont toujours quelque caprice. Il aurait dû venir à Oxford ; nous en aurions fait un homme. On ne peut le nier, il a plusieurs bons principes ; mais il court les théories, caresse sa marotte et pousse les conséquences à l’extrême. »
Notre hôte fut interrompu au milieu de ses réflexions par son clerc, qui venait lui dire que John Tims avait juré que sa femme ne ferait pas ses relevailles à l’église devant l’assemblée, et qu’il était presque décidé à faire baptiser son enfant par les Méthodistes. Cet incident donna une nouvelle direction aux pensées de Bateman.
L’hiver avait été en général sec et agréable. En février et en mars, les pluies furent si abondantes et les vents si forts que Bateman ne vit guère Charles ni Willis. Il n’avait pas renoncé, pourtant, à ses projets sur ce dernier, mais le difficile pour lui était de trouver le meilleur moyen de les faire réussir. Quant à Campbell, il était résolu à l’exclure de toute participation à son œuvre ; il hésitait, au contraire, à l’égard de Charles. Il l’avait trouvé beaucoup moins catholique romain qu’il ne s’y attendait, et il pensait qu’en se confiant à lui, et en le faisant son agent auprès de Willis, il parviendrait peut-être à lui donner une direction anglicane. En conséquence, il lui fit part de sa sollicitude pour ramener Willis à « l’Église de son baptême ». Charles lui conseilla de laisser les choses en paix, ajoutant qu’il pourrait réussir à éloigner de Rome le jeune converti sans le ramener à l’Anglicanisme. Cet avis ne découragea pas Bateman. Le temps s’étant amélioré, celui-ci les invita tous deux à dîner, un des derniers dimanches du carême. Il voulait ce jour-là livrer bataille, et, dans ce dessein, il avait lu avec soin les ouvrages les plus populaires contre l’Église de Rome. Après y avoir beaucoup réfléchi, il se décida à diriger son attaque sur quelques-uns des « maux pratiques », d’après lui, « de l’Église Romaine », comme étant plus faciles à prouver que des points de doctrine ou d’histoire ; matières d’ailleurs dans lesquelles Willis pouvait bien être plus versé que lui à cette époque. Il considérait, en outre, que si Willis avait jamais été ébranlé dans sa nouvelle foi sur le continent, c’était par les exemples pratiques qu’il avait eus sous les yeux du résultat des doctrines particulières de sa croyance, lorsqu’elles étaient librement suivies. Enfin, à dire vrai, notre ami n’avait pas une idée très-claire du nombre des principes qui lui étaient communs avec l’Église de Rome, ni du point où il devait s’arrêter dans les différents détails du Symbole du pape Pie. C’est pourquoi il était évidemment plus sûr de borner son attaque à des matières de pratique.
« Vous voyez, Willis, dit-il quand ils furent à table, que je vous ai servi du maigre, ignorant si vous avez une dispense. Nous ferons gras, nous autres ; mais ne pensez pas que nous ne jeûnions à certains jours. Je ne suis nullement de l’avis de Campbell ; toutefois nous ne jeûnons pas le dimanche. Telle est notre règle, et je crois qu’elle remonte aux premiers siècles. » Willis répondit qu’il ignorait les usages de la primitive Église : « mais je pense, ajouta-t-il, que tout le monde admet que les matières de discipline peuvent être modifiées par l’autorité compétente. — Sans doute, repartit Bateman, pourvu que tout soit d’accord avec le texte inspiré de l’Écriture » ; et il s’arrêta, dévoré du désir d’aborder quelque grand sujet, si c’était possible. Ne sachant comment s’y prendre, il vit qu’il devait se jeter in medias res, et il ajouta : « Tout ce qu’on trouve dans les églises du continent ne s’accorde pas, je présume, avec le texte inspiré. — Vous voulez parler, je suppose, dit Willis innocemment, des antependia, des dorsals, des autels de pierre, des chapes et des mitres ; sans doute, ces choses ne se trouvent pas dans l’Écriture. — C’est vrai, dit Bateman ; mais quoiqu’elles ne se trouvent pas dans l’Écriture, ces choses ne sont pas en contradiction avec la Bible. Elles sont toutes très-légitimes ; mais le culte des Saints, spécialement celui de la Sainte Vierge, le culte des Reliques, les prières marmottées dans une langue inconnue, les Indulgences et les Communions rares sont, je le crois, en contradiction directe avec l’Écriture. — Mon cher Bateman, repartit Willis, vous paraissez vivre dans une atmosphère de controverse ; c’est comme à Oxford, il y avait toujours chez vous quelque argument sur le tapis. La religion nous est octroyée pour jouir de ses charmes, et non pour en faire un objet de dispute. Donnez-moi une autre tranche de ce gigot. — Oui, Bateman, ajouta Reding, laissez-nous savourer votre dîner. Willis le mérite, car je crois qu’il a fait une bonne promenade aujourd’hui. N’avez-vous pas été à pied à Seaton ? Une route de quatorze milles, et un terrain accidenté. En certains endroits, le chemin doit être encore boueux. — C’est vrai, dit Bateman. Prenez un verre de ce vin, Willis ; il est bon ; c’est du madère que j’ai reçu d’une de mes tantes. — Willis nous fait honte, reprit Charles, à nous qui n’avons eu qu’un pas à faire de notre chambre jusqu’à l’église, tandis que, lui, il a fait un pèlerinage à la sienne. — Je n’attaque pas notre ami, répondit Bateman ; il s’agissait seulement d’un point sur lequel je le croyais d’accord avec moi ; savoir, qu’il y a bien des corruptions de culte dans les églises du continent. » Voyant que son silence commençait à être remarqué, Willis répondit qu’il pensait que les personnes non catholiques ne peuvent indiquer ce qui est corruption et ce qui ne l’est pas. Ici la controverse s’arrêta encore ; Willis ne paraissait pas d’humeur à la poursuivre, peut-être aussi était-il trop fatigué. Ils mangèrent donc et ils burent, se contentant d’assaisonner le repas de quelques lieux communs, jusqu’à ce que la nappe fût levée. Le dîner fini, on recula un peu la table, et les trois amis se placèrent devant le feu que Bateman ranima. Deux d’entre eux au moins avaient mérité quelque relâche, et c’était précisément les deux qui, se posant en mutuels adversaires, allaient se battre dans la prochaine controverse. L’un avait fait une longue course ; l’autre avait eu deux services entiers, un baptême et un enterrement. L’armistice dura un grand quart d’heure. Charles et Willis employèrent ce temps à une causerie amicale. Bateman, de son côté, profita de ce répit pour combiner ses moyens d’attaque. Se trouvant enfin prêt pour l’assaut, il l’ouvrit selon les règles.
« Allons, mon cher Willis, dit-il, je ne puis vous lâcher de la sorte ; je suis sûr que ce que vous avez vu sur le continent vous a scandalisé. » L’attaque était presque grossière : Willis répondit que s’il eût été protestant, il aurait été facilement choqué ; mais il était catholique ; et un soupir presque imperceptible s’échappa de sa poitrine. D’ailleurs, s’il avait été tenté de se scandaliser, il se serait souvenu qu’il appartenait à une Église qui ne peut errer dans aucune matière importante. Il ne s’était pas joint à l’Église pour critiquer, mais pour apprendre. « J’ignore, ajouta-t-il, ce qu’on entend quand on dit que nous devons avoir la foi, que la foi est une grâce, que la foi est le moyen de notre salut, s’il n’y a aucun point sur lequel nous ayons à l’exercer. La foi marche contre la vue : donc, à moins qu’il n’y ait des choses qui vous heurtent, il n’y a rien contre quoi vous ayez à marcher. » Bateman cria au paradoxe. « S’il en est ainsi, répliqua-t-il, pourquoi ne pas nous faire Mahométans ? Nous aurions alors assez de matières pour exercer notre foi. »
— Eh bien, repartit Willis, supposons que votre ami, homme honorable, est accusé de vol, et que les apparences lui sont contraires ; admettriez-vous de prime abord l’accusation ? Ce serait une belle épreuve pour votre foi en lui ; et si par la suite il était en mesure de montrer son innocence, je ne crois pas qu’il vous fût très-reconnaissant, dans le cas où vous auriez attendu son explication pour prendre son parti ; la connaissance que vous aviez de sa personne ne vous permettait pas de le suspecter. Si donc, je m’unis à l’Église ayant foi en elle, quoi que je puisse voir qui me surprenne, ce n’est qu’une épreuve pour ma foi. — C’est vrai, dit Charles ; mais la foi doit avoir un fondement ; nous ne pouvons pas croire sans raison ; et la question est de savoir si certains actes de l’Église ne sont pas un sujet légitime de former un jugement en sa faveur, ou contre elle. — Un catholique, comme je l’étais sur le continent, répondit Willis, a déjà trouvé ses motifs de crédibilité, car il croit ; mais pour celui qui ne l’est pas, un protestant par exemple, je tiens pour certain qu’il aura probablement des idées fausses touchant le culte catholique. Il peut facilement arriver qu’il ne le comprenne pas. — Cependant il y a des gens qui ont autrefois été convertis par la seule vue de ce culte, objecta Reding. — Certainement, répondit Willis ; Dieu opère de mille manières. Dans le culte catholique, il y a bien des choses capables de frapper un protestant, mais il y en a aussi beaucoup qui doivent l’embarrasser ; par exemple, la dévotion à la Sainte Vierge, dont parlait notre ami.
— Vous ne pouvez le nier, reprit Bateman ; cela est évident ; il est impossible que le culte rendu par les Catholiques Romains à la Sainte Vierge ne porte pas atteinte à la suprême adoration due au Créateur seul. — Voilà précisément un exemple de ce que je disais, répondit Willis, vous jugez a priori ; vous ne connaissez pas la chose par expérience, mais vous dites : « Cela doit être, il ne peut en être autrement. » Telle est la manière dont un protestant juge et tire ses conclusions ; mais un catholique, qui pratique et ne s’en tient pas à des idées spéculatives, sent la vérité du contraire. — Il est des choses, repartit Bateman, qui ressemblent tellement à des axiomes qu’elles dispensent de l’épreuve. D’ailleurs, l’usage journalier est très-propre à cacher au peuple le mal réel de certaines pratiques. — Étrange aveuglement que le vôtre ! répliqua Willis ; vous ne voyez pas que cet argument est celui-là même que les différentes sectes emploient contre vous autres Anglicans. L’Unitaire, par exemple, dit que la doctrine de l’Expiation doit nous conduire à considérer le Père, non comme un Dieu d’amour, mais seulement comme un Dieu de vengeance ; et il appelle immoral le dogme de l’éternité des peines. De même le Wesleyen ou le Baptiste déclare qu’il est absurde de supposer qu’un homme puisse admettre la doctrine de la régénération baptismale et être en même temps un homme spirituel, et il dit que cette doctrine doit avoir un effet engourdissant sur l’esprit et détruire sa simple confiance dans l’expiation du Christ. Je prendrai un autre exemple. Beaucoup d’excellents Catholiques, qui n’ont jamais vu d’Anglicans, sont aussi incapables de se faire une idée exacte de votre position que vous l’êtes, vous, de vous représenter la leur. Ils ne peuvent s’expliquer comment vous êtes assez illogiques que de ne pas marcher en avant ou reculer. Bien plus, ils soutiennent que l’état de votre esprit, tel que vous le manifestez, est impossible ; ils ne croient pas à sa réalité. Quant à moi, je puis déplorer votre état ; je puis croire que vous êtes illogiques, et quelque chose de pis ; mais je sais que c’est un état qui existe. De même donc que j’admets qu’une personne peut reconnaître une Église Catholique, sans croire cependant que cette Église est celle de Rome ; de même, je vous demande, sous forme d’argumentum ad hominem, si vous ne devez pas croire que nous pouvons honorer la Sainte Vierge comme la première des créatures, sans porter atteinte à l’honneur dû à Dieu. Tout au plus, devriez-vous nous appeler illogiques ; mais vous ne devriez pas nier que nous faisons ce que nous vous affirmons. — J’établis une distinction, repartit Bateman : il est bien possible, je vous l’accorde, qu’un Catholique instruit mette une différence entre la dévotion à la Sainte Vierge et le culte rendu à Dieu ; mais je soutiens seulement que la multitude ne fera pas cette différence. — Je sais que c’est votre pensée, répondit Willis ; et cependant, je le répète, vous parlez, non d’après l’expérience, mais sur une raison a priori. Vous ne dites pas : « Cela est ainsi », mais, « Cela doit être ainsi. »
Il y eut un moment de silence ; puis Bateman reprit la parole. « Vous nous donnerez peut-être quelque peine, dit-il en riant, mais nous sommes résolus de vous ramener à nous, mon bon Willis. Or, je vous le demande, à vous qui aimez la vérité : vient-elle du ciel cette Église qui enseigne des mensonges ? — Il nous faut définir les mots vérité et mensonge, répondit Willis en riant aussi. Mais cette définition nous étant à tous deux connue, je n’ai pas de peine à déclarer comme proposition évidente qu’une Église qui enseigne des mensonges ne vient pas du ciel. — Naturellement, vous ne pouvez nier la proposition, reprit Bateman ; eh bien, donc, n’est-il pas certain qu’à Rome même il y a des reliques que rejettent aujourd’hui tous les hommes instruits, et lesquelles cependant sont encore vénérées comme reliques ? Par exemple, Campbell m’a dit que les têtes réputées de saint Pierre et de saint Paul, dans une des grandes basiliques de Rome, ne sont pas certainement celles des apôtres, puisque la tête de saint Paul fut trouvée avec son corps, après l’incendie qui, il y a quelques années, dévora son église. — Je ne connais pas ce cas particulier, mon cher ami ; mais vous posez une vaste question, qui ne peut être résolue en quelques mots. Si je devais parler, voici comment j’établirais ma thèse. Je commencerais par cette proposition, que l’existence des reliques n’est pas invraisemblable ; m’accordez-vous ce point ? — Je n’accorde rien ; continuez. — Eh bien, il y a un grand nombre de reliques païennes que vous admettez. Qu’est-ce que Pompéi et tout ce qu’on y trouve, sinon un immense reliquaire païen ? Pourquoi n’y aurait-il pas, à Rome et ailleurs, des reliques chrétiennes, comme il y en a de païennes ? — C’est juste. — Bien ; et les reliques peuvent avoir un caractère d’authenticité. On voit encore de nos jours le tombeau des Scipion, sur lequel se lisent les noms de ces grands hommes. Supposez qu’on y eût trouvé des cendres, n’admettriez-vous pas que ce sont les cendres d’un Scipion ? — A la question ! Plus vite. — Saint Pierre, continua Willis, parle de David « dont le tombeau est au milieu de vous jusqu’à ce jour ». Il n’y a donc rien d’étonnant qu’une relique sacrée soit conservée onze siècles et reconnue pour être telle, lorsqu’une nation se fait un devoir de la garder. — Vous battez les buissons, s’écria Bateman avec impatience ; allez plus vite. — Laissez-moi suivre ma route ; donc, il n’y a rien d’invraisemblable, en considérant que les chrétiens ont toujours traité avec soin les monuments des choses sacrées… — Vous ne l’avez pas prouvé, repartit Bateman, qui craignait une manœuvre cachée sous ces paroles. — Eh bien, reprit Willis, vous n’en doutez pas, je suppose, au moins depuis le quatrième siècle, alors que sainte Hélène apporta de la Terre Sainte les monuments de la Passion de Notre-Seigneur et les enferma à Rome dans la basilique, qui, pour ce motif, fut appelée Santa-Croce. Quant aux temps antérieurs à l’époque de la persécution, les chrétiens eurent naturellement peu d’occasions de montrer une dévotion semblable, et les souvenirs historiques y sont moins nombreux ; toutefois, l’existence de ce respect est aussi sûre et aussi certaine qu’aucun fait de l’histoire. On ramassa les os de saint Polycarpe, disciple de saint Jean, après qu’il eut été brûlé, comme on avait fait de ceux de saint Ignace avant lui, après son exposition aux bêtes ; et l’on en fit autant des os et du sang de tous les martyrs. Personne ne doute de ce fait ; je n’ai jamais rencontré de dissidence sur ce point. De même encore, les disciples prirent le corps de saint Jean-Baptiste (et il serait bien étrange qu’ils ne l’eussent pas fait), et ils l’ensevelirent « dans le tombeau », selon l’expression de saint Marc, qui en parle comme d’une chose connue. Or, pourquoi n’aurait-on pas de la même manière, et même à plus forte raison, pris soin des corps de saint Pierre et de saint Paul, quand ce n’eût été que pour les ensevelir avec décence ? Mais si l’on a pris soin de ces corps au moment de leur martyre, est-il étonnant qu’on les ait ensuite conservés ? — Mais ils ne peuvent se trouver en deux endroits à la fois, objecta Bateman. — Écoutez-moi, mon ami : s’il existe une tradition que dans un certain lieu se trouve une relique d’un apôtre, de prime abord il y a une probabilité qu’elle est là ; la présomption est en sa faveur. Pouvez-vous le nier ? Eh bien, si l’on dit que la même relique se trouve en deux endroits, alors l’une ou l’autre des deux traditions est fausse, et prima facie leur valeur respective en est affaiblie. Cela, je l’admets, mais je me garderai bien de rejeter ces deux traditions à la fois ; chacune d’elles a encore sa valeur, quoique individuellement diminuée. Or, supposez qu’il existe des circonstances qui confirment l’une, l’autre s’en trouve d’autant plus affaiblie, et à la fin la probabilité de sa vérité peut disparaître ; et quand, un long temps s’étant écoulé, les témoignages lui restent toujours contraires, alors cette tradition est complétement abandonnée. Mais tout cela est l’œuvre du temps. D’ailleurs ce n’est pas plus une objection contre la doctrine et la pratique de la vénération des reliques d’entendre dire qu’un corps se trouve dans deux endroits, que ce n’est une accusation contre l’histoire profane de voir, à propos de Charles Ier, certains historiens nous soutenir qu’il fut enseveli à Windsor, et d’autres à Westminster ; problème qui a été résolu dans ces derniers temps[67] ; c’est une question de témoignage, et elle doit être traitée comme telle. — Mais si la tête de saint Paul a été trouvée sous l’église qui porte son nom, repartit Bateman, il est assez clair qu’elle n’a pas été conservée dans l’autre basilique. — C’est vrai ; mais les questions graves de ce genre ne peuvent se décider en un instant. Quant à moi, j’ignore les circonstances de ce fait, et je ne prends que votre relation. Il faut donc prouver que c’est la tête de saint Paul qu’on a trouvée avec son corps ; car, puisqu’il fut décapité, la tête et le corps ne sauraient être joints ensemble. Voilà une question ; et combien d’autres surgiraient ! Il n’est pas facile d’établir une question d’histoire. On voit tous les jours revivre des controverses de ce genre qui semblaient résolues. C’est très-bien pour des historiens profanes de renoncer tout d’un coup à une tradition ou à un témoignage, et pour une génération de s’en moquer ; mais l’Église ne peut faire ainsi. Elle a une responsabilité religieuse, et elle doit procéder lentement. Supposez qu’il arrive que les têtes qui se trouvent à Saint-Jean de Latran sont, après tout, celles des Apôtres, et que l’Église les ait rejetées ; est-ce admissible ? On voit tous les jours revivre des questions historiques, disais-je. Walpole ne prouva-t-il pas admirablement que les deux petits princes assistaient à la procession du couronnement du roi Richard ? Cependant, il y a quelques années, deux squelettes d’enfants furent trouvés dans la Tour à la place même où l’on disait que les enfants d’Édouard avaient été assassinés et enterrés par le duc de Gloucester. Je parle de mémoire, mais le fait général que je cite est incontestable. Ussher, Pearson et Voss prouvèrent que les petites Épîtres de saint Ignace étaient authentiques ; et aujourd’hui, après un laps de deux siècles, la question est encore débattue d’une manière assez plausible. »
[67] Il est parfaitement établi maintenant que Charles Ier a été enseveli au château de Windsor, dans la magnifique chapelle de Saint-George. C’est en 1813 que les doutes sur la sépulture de ce roi ont été éclaircis. La cérémonie de l’exhumation eut lieu sous les yeux de George IV et d’un petit nombre de témoins.
Il y eut un nouveau silence, pendant lequel Bateman réfléchit à ses faits et à ses arguments ; mais rien ne se présentait pour l’heure. Willis continua : « Vous devez remarquer aussi que les reliques comme celles que vous avez mentionnées sont ordinairement sous la garde de corps religieux. Or, naturellement, ceux-ci sont jaloux de toutes les tentatives faites pour prouver qu’elles sont fausses, et, dans un esprit de corps bien pardonnable, ils les défendent de toute leur puissance et soulèvent des obstacles contre toute décision opposée. C’est ainsi que votre société défend, à très-juste titre, la réputation de sa fondatrice, la reine Boadicée. Si un jugement était porté contre elle par tous les tribunaux du pays, votre brave et loyal président l’abandonnerait-il ? Non. Un pareil fait briserait son cœur magnanime, et comme un preux chevalier il voudrait mourir au service de sa dame. Donc, et d’après le devoir religieux et d’après le sentiment humain, c’est une chose très-difficile de faire désavouer une relique reconnue. — Eh bien, reprit notre hôte, d’après mon pauvre jugement, il me semble que c’est une honte de conserver, par exemple, des inscriptions que tout le monde sait être fausses. — Mon cher Bateman, répliqua Willis, vous tournez dans un cercle vicieux ; tout le monde ne sait pas cela ; c’est un point qui est en voie d’être établi, mais qui ne l’est pas encore. Vous pouvez dire que des individus l’ont établi, ou qu’il peut être établi, mais, je le répète, il ne l’est pas encore. Des cas semblables arrivent fréquemment en matières civiles, sans que pour cela personne parle mal des individus ou des corps existants. Jusque dans ces dernières années, le Monument de Londres[68] portait une inscription attestant que cette ville avait été brûlée par nous, pauvres Papistes. Déjà, il y a un siècle, Pope, le poëte, appelait la colonne « un grand matamore » qui « relève sa tête pour mentir » ; et cependant l’inscription n’a été enlevée que depuis peu de temps. Ce fut, je crois, à l’époque de la restauration du Monument. L’occasion était favorable pour faire disparaître une calomnie sur laquelle jusqu’alors on ne s’était pas prononcé définitivement, et sur laquelle on ne se prononça pas, non plus, par égard primâ facie pour l’autorité de la relation contemporaine de la calamité que la colonne rappelait. Il n’y a jamais un point fixe du temps où l’on puisse dire : Maintenant la tradition est prouvée fausse. Lorsqu’une croyance reçue a été ostensiblement exposée, la question reste dormante jusqu’à ce que l’on trouve de nouvelles preuves. Si aucune ne se produit, une cause accidentelle, comme la restauration d’un monument, la fait à la fin disparaître. »
« Nous sommes un peu sortis du sujet », pensa Bateman ; et il s’agitait sur sa chaise tâchant de rattraper le fil de son raisonnement. Reding fit une objection. Il dit que personne ne connaissait l’inscription du Monument, ni ne s’en inquiétait, tandis que l’on rendait un culte religieux aux deux têtes qui se trouvent à Saint-Jean de Latran. « C’est cela, s’écria notre hôte, c’est précisément ce que j’allais dire. — Eh bien, répondit Willis, quant à ce cas particulier, rappelez-vous que j’accepte votre relation, puisque j’ignore le fait. Mais considérons l’étendue de cette erreur. On ne doute nulle part qu’au moins ce ne soient des têtes de martyrs. La seule et l’unique question est donc celle-ci : Sont-elles les véritables têtes des Apôtres ? Depuis un temps immémorial elles ont été conservées sur ou sous l’autel comme les têtes de saints ou de martyrs ; et il suffit d’une légère connaissance des antiquités chrétiennes pour être parfaitement certain qu’elles sont réellement de saintes reliques, lors même qu’elles seraient inconnues. La seule erreur, donc, est que les Catholiques ont vénéré, sous un faux nom, ce qui, après tout, était digne de vénération. Peut-être en ont-ils attendu des miracles, confiance bien légitime ; peut-être encore ont-ils été les témoins de ces miracles, et cette hypothèse est bien naturelle, vu que, quoiqu’on se trompât sur leur vrai nom, ces reliques étaient néanmoins des reliques de saints ; mais enfin tout cela n’est certainement pas une si grande affaire. — Vous avez avancé gratuitement trois propositions, répliqua Bateman : 1o qu’on n’a placé sous les autels que des reliques de saints ; 2o que ces reliques ont toujours été là ; 3o… Je sais qu’il y avait un troisième point ; voyons… — C’est très-vrai, repartit Willis en l’interrompant, et je vous aiderai encore pour quelques autres. J’ai avancé qu’il y a dans le monde des Chrétiens appelés Catholiques ; de plus, qu’ils pensent que c’est bien de vénérer les reliques ; mais, mon cher Bateman, ces propositions étaient les principes et non le sujet de notre discussion, et si l’on devait les démontrer, il faudrait une controverse particulière ; je pense, toutefois, que nous avons assez de controverse pour aujourd’hui. — Oui, Bateman, reprit Charles ; il se fait tard. Je dois songer à mon retour. Donnez-nous du thé, et laissez-nous partir. — Partir ? s’écria Bateman ; mais nous venons à peine de dîner, et nous n’avons encore rien fait jusqu’à présent. J’avais beaucoup de choses à dire. » Il sonna cependant pour le thé, et la table fut dégarnie.
La conversation se ralentit. Bateman était encore affairé avec sa mémoire, et il devenait, aussi, impatient. Le temps s’écoulait, et aucun coup n’avait été frappé. Willis, de son côté, commençait à bâiller, et Charles paraissait désireux d’en finir. « Ces Papistes, se disait Bateman à part lui, établissent leurs propositions d’une manière fort plausible, mais de très-mauvaise foi certainement ; on doit être à la hauteur de leurs ruses. J’ose le dire, si la vérité était connue, on saurait que Willis a pris des leçons ; il paraît si grave ; je suis convaincu qu’il tient en réserve bien des choses, et qu’il se joue de mon ignorance. Qui sait ? Peut-être est-ce un jésuite déguisé… » Cette pensée était terrible, et elle arrêta pendant quelques secondes le cours de ses réflexions. « Si je pouvais savoir ce qu’il pense réellement ! Il est si difficile de les déchiffrer ! Ils ne disent rien de ce qui se passe chez eux, et ils sont sous l’obéissance. On ne sait quand il faut les croire. Je soupçonne qu’il a été cruellement désappointé par le Romanisme ; il est si maigre… Mais naturellement il ne l’avouera pas. Un tel aveu blesse l’amour-propre, et il veut être conséquent. Il ne veut pas qu’on se moque de lui, il tire donc le meilleur parti des choses. Je voudrais savoir comment il faut le traiter. J’ai eu tort d’inviter Reding ; évidemment Willis ne peut être expansif devant un tiers. Il ressemble au renard qui a perdu sa queue. J’ai manqué de tact en cela, je le vois maintenant. Chose très-importante que d’avoir du tact ! Ceci en demande beaucoup. J’avais tant de choses à lui dire sur les indulgences, et sur la rareté des communions ! Je pense que je dois lui parler de la messe. » Ainsi se tourmentait notre hôte intérieurement, tout en faisant le thé. Il tenta enfin son dernier assaut.
« Eh bien, Willis, dit-il, nous vous ramènerons parmi nous à la Noël prochaine. Je ne puis vous accorder un plus long terme ; je suis certain de mon fait ; cela demande du temps, cela ira avec lenteur, mais c’est sûr. Quelle joie alors ! je ne sais pas ce qui vous arrête. Vous ne faites rien à cette heure ; vous êtes relégué dans un coin ; vous dissipez votre existence. Qu’est-ce qui vous retient ? » Willis, prenant un air étrange, répondit simplement : « Ce qui me retient ? La grâce. » Bateman fut ébahi de cette réponse, mais il se remit bientôt : « Me préserve le ciel, reprit-il, de traiter ces choses à la légère, ou de m’occuper de vous indûment ! Je sais, mon cher ami, que vous êtes un jeune homme sérieux ; mais, dites-moi, je vous prie, avec quelles raisons vous justifiez la messe telle qu’on la célèbre sur le continent. Comment peut-on l’appeler un « culte raisonnable », alors que tous les prêtres conspirent pour la marmotter au galop, comme s’il ne leur importait absolument pas qu’on y assistât, ou qu’on en comprît le sens ? Parlez, mon brave, parlez, ajouta-t-il en le frappant doucement sur l’épaule. — Ce sont des questions difficiles, répondit Willis ; dois-je m’expliquer ? Des questions très-difficiles, répéta-t-il d’un ton plus animé et s’échauffant à mesure qu’il parlait ; je veux dire qu’on les considère très-diversement. Il est difficile de faire passer dans l’esprit d’une personne l’idée d’une autre. L’idée du culte, dans l’Église Catholique, est différente de celle que vous en avez dans votre Église ; car, en vérité, les religions sont différentes. Ne vous y trompez pas, mon cher Bateman, continua-t-il avec douceur, notre religion n’est pas la vôtre un peu plus ou un peu trop développée, comme il vous plaît de le dire. Non, elles diffèrent dans l’espèce et non pas dans la valeur. La religion Romaine est une religion, l’Anglo-Catholicisme en est une autre. Et quand le temps viendra (et il viendra) pour vous, étranger comme vous êtes aujourd’hui, de vous soumettre au joug aimable du Christ, alors, mon cher ami, ce sera la foi qui vous rendra capable de supporter les manières et les usages des Catholiques, lesquels sans cela pourraient vous surprendre. Autrement, vos habitudes dès longtemps contractées, les rapports de certains actes extérieurs avec les vrais actes intérieurs de dévotion pourraient vous embarrasser, lorsque vous auriez à vous conformer à d’autres habitudes et à vous créer d’autres associations d’idées. Mais cette foi dont je parle, le grand bienfait de Dieu, vous rendra capable alors de vous surmonter vous-même, de soumettre votre jugement, votre volonté, votre raison, vos affections, vos goûts et vos penchants aux règles et aux usages de l’Église. Ah ! pourquoi faut-il que la foi soit nécessaire en une telle matière, et que ce qui est si naturel et si évident quand on est catholique ait besoin d’une explication ! Quant à moi, je vous le déclare », et il joignit ses mains sur ses genoux, et, le regard fixe, comme s’il se fût parlé à lui-même, il dit : « Quant à moi, rien ne me paraît si consolant, si touchant, si saisissant, si capable de subjuguer l’âme entière que la messe telle qu’on la célèbre parmi nous. Je pourrais y assister toute une longue vie, sans éprouver jamais de fatigue. La messe, elle n’est pas une simple forme de paroles ; c’est une grande action, la plus grande action qui puisse être accomplie sur la terre. C’est, non une pure invocation, mais, si j’ose employer le mot, l’évocation même de l’Éternel. Il descend sur l’autel en chair et en sang, Celui devant qui les anges s’inclinent et les démons tremblent. C’est ce majestueux événement qui est la fin et l’explication de toutes les parties de la solennité. Des paroles sont nécessaires, non comme fin, mais comme moyen ; ce ne sont pas de simples supplications au trône de la grâce, ce sont les instruments de ce qui est beaucoup plus haut, de la consécration, du sacrifice. Comme si elles étaient impatientes d’accomplir leur mission, elles se hâtent. Elles se suivent rapidement ; car toutes sont des parties d’une action intégrale. Rapidement elles vont ; car elles sont les paroles terribles du sacrifice, elles sont une œuvre trop grande pour s’y appesantir ; selon ce qui fut dit au commencement : « Ce que vous faites, faites-le rapidement. » Rapidement elles passent ; car le Seigneur Jésus va avec elles, comme il passa sur le lac aux jours de sa vie terrestre, appelant vite d’abord l’un, puis l’autre. Rapidement elles passent, parce que tel l’éclair brille d’un bout à l’autre du ciel, telle est la venue du Fils de l’Homme. Rapidement elles passent ; car elles sont comme les paroles de Moïse, lorsque le Seigneur descendit dans la nue, appelant le nom du Seigneur quand il passait : « Le Seigneur, le Seigneur Dieu, miséricordieux et aimable, patient et riche en bonté et en vérité. » Et comme Moïse sur la montagne, nous aussi « nous nous hâtons, nous inclinons nos têtes, et nous adorons ». Et de même encore, tous rangés autour de l’autel, chacun à sa place, nous tenons nos yeux fixés sur le grand avénement, « attendant l’agitation de l’eau » ; chacun à sa place, avec son cœur, ses besoins, ses pensées, son intention, ses prières ; chacun à sa place, attentif à l’action qui s’opère, attentif à ses progrès, s’unissant à sa consommation. C’est ainsi que, du commencement à la fin, suivant sans peine et d’un cœur plein d’espoir des prières magnifiques et suaves, nous formons comme un concert de divers instruments qui concourent à une douce harmonie, dont le prêtre de Dieu est l’âme et le soutien. Là se trouvent des petits enfants et des vieillards ; des laboureurs au cœur simple et des lévites du sanctuaire ; des prêtres qui se préparent pour cet auguste sacrifice, et d’autres faisant leurs actions de grâces ; là sont des vierges pures et des hommes pénitents. Mais de toutes ces âmes s’élève une seule hymne eucharistique, dont la grande action est la mesure et l’essor. Et vous me demandez, mon cher Bateman, ajouta-t-il en se tournant vers lui, si un tel culte n’est pas de pure forme et déraisonnable ! Il est merveilleux, ce culte ! s’écria-t-il en se levant, prodigieusement merveilleux !!! Quand donc ce cher et bon peuple sera-t-il éclairé ? O Sapientia, fortiter suaviterque disponens omnia, o Adonaï, o Clavis David et Exspectatio gentium, veni ad salvandum nos, Domine Deus noster. »
Il n’y avait plus à se tromper sur Willis. Bateman était immobile, et presque effrayé de cet élan d’enthousiasme auquel il était loin de s’attendre. « Eh bien, mon ami, dit-il, ce n’est donc pas vrai, alors, ce qu’on nous a rapporté sur vos hésitations dans votre attachement à l’Église de Rome ? Je vous en prie, excusez-moi. Pour rien au monde, je ne vous aurais tourmenté, si j’avais connu la vérité. — La figure de Willis était encore animée, et il paraissait aussi jeune et aussi radieux qu’il l’était deux années auparavant. Il n’y avait rien de dur dans sa vivacité ; un sourire, de la joie presque, était sur son visage. On eût dit toutefois qu’il était honteux de son propre enthousiasme ; mais cela n’ôtait rien à la sincérité évidente de ses paroles. Il prit les deux mains de Bateman avant que celui-ci s’en aperçût, le souleva de son siége, et, approchant sa bouche de son oreille, il lui dit à voix basse : « Plût à Dieu que non-seulement vous, mais tous ceux qui m’entendent en ce jour fussiez tout à fait tels que je suis, à la réserve de ces chaînes ! » Puis rappelant à son hôte que leur controverse s’était prolongée fort tard, et lui souhaitant une bonne nuit, il sortit avec Charles.
Quand la porte fut fermée, Bateman resta quelques minutes le dos tourné vers le feu, et il se laissa aller au cours de ses pensées. « En vérité, s’écria-t-il, Willis est tout à fait un homme ; il m’a presque touché moi-même. Quels moyens ont ces gens-là en leur pouvoir ! Je l’avoue, son contact a fait battre mon cœur : que l’enthousiasme est contagieux ! Tout autre que moi aurait été ébranlé. C’est vraiment un excellent garçon ; quel dommage que nous ne l’ayons pas gagné ! c’est précisément l’homme qu’il nous faudrait. Il aurait fait un Anglican admirable ; il aurait converti la moitié des dissidents de ce pays. Eh bien, nous les aurons un jour ; il ne faut pas perdre patience. Mais cette idée de parler de me convertir ! « complétement », selon sa parole ! A propos, que voulait-il dire par ces mots « à la réserve de ces chaînes » ? Il s’assit, réfléchissant sur cette difficulté. D’abord il fut porté à croire qu’après tout son ami pourrait bien avoir quelque crainte sur sa position ; puis il pensa que peut-être il avait un cilice ou une chaînette sur le corps. Il finit par conclure que Willis n’avait voulu rien dire du tout, et qu’il n’avait fait que terminer la citation du texte[69].
[69] Act. des Ap. XXVI, 29.
Après avoir passé quelque temps dans cet état, il jeta les yeux sur la théière, se versa une dernière tasse de thé et mangea un morceau de rôtie. Il retira ensuite le charbon du feu, éteignit une des bougies, et, s’emparant de l’autre, il quitta le salon et se précipita, comme un vélocipède, au haut du rude escalier tournant qui conduisait à sa chambre.
Cependant Willis et Charles s’avançaient vers leurs demeures respectives. Pendant quelque temps ils parcoururent en silence le même sentier. Charles avait été beaucoup plus ému que Bateman, ou, pour mieux dire, il avait été touché de l’enthousiasme de son ami. Il avait toutefois gardé en lui ses impressions, éprouvant de la difficulté à exprimer ses sentiments, et craignant d’être emporté hors des bornes. Quand ils furent sur le point de se séparer, Willis lui dit avec douceur : « Vous irez bientôt à Oxford, mon très-cher Reding ; oh ! si vous étiez un des nôtres ! Vous avez cela en vous. J’ai souvent pensé à vous pendant la messe. Notre vénéré pasteur a célébré l’auguste sacrifice à votre intention. Oh ! mon cher ami, ne rejetez pas la grâce ; écoutez sa voix. Vous avez reçu des bienfaits que d’autres n’ont pas eus. Ce qui vous manque, c’est la foi. Je pense que vous avez assez de preuves pour être converti. Mais la foi est un don ; priez pour obtenir ce grand bienfait, sans lequel vous ne pouvez vous unir à l’Église, sans lequel… » Et il s’arrêta, « vous ne pouvez marcher droit quand vous appartiendrez à notre communion. Et maintenant, adieu ; hélas ! nos sentiers se divisent. Tout est facile à celui qui croit : que Dieu vous accorde ce don de la foi, comme il me l’a accordé à moi-même ! Adieu encore ; qui sait quand et où je vous reverrai ! Fasse le Seigneur que cela soit dans le sein de la Jérusalem véritable, de la reine des élus, de la sainte Église Romaine, de notre mère à tous ! » Il attira Charles vers lui, l’embrassa, et il était déjà loin avant que celui-ci eût pu trouver une parole.
Charles pourtant n’aurait point parlé, quand même il l’aurait pu, tant son émotion était forte ! Il s’éloigna d’un pas rapide, abattant avec sa canne les ronces et les petites branches que le pâle crépuscule lui montrait dans son chemin. On eût dit que le baiser de son ami avait fait couler dans son âme l’enthousiasme de ses paroles. Il se sentait possédé, sans savoir comment, par un pouvoir supérieur et surnaturel qui semblait le rendre capable de transporter les montagnes et de marcher à travers l’Océan. Avec l’hiver autour de lui, il éprouvait dans tout son être comme un parfum de printemps, alors que tout est nouveau et radieux. Il voyait qu’il avait trouvé ce qu’il n’avait vraiment jamais cherché, parce qu’il n’en avait pas même soupçonné l’existence, l’objet toutefois dont il avait toujours éprouvé le besoin : une âme sympathique à la sienne. Il sentait qu’il n’était plus seul en ce monde, quoiqu’il perdît cette âme vraiment sœur de son âme au moment même qu’il l’avait trouvée. « Est-ce là, se demanda-t-il, la communion des Saints ? Hélas ! comment cela se pourrait-il, étant, moi, dans une communion et Willis dans une autre ? O puissante Mère ! » Ces mots s’échappèrent de ses lèvres, et il précipita davantage sa marche, escaladant les montées rudes et courant dans les vallées qui le séparaient encore de Boughton. « O puissante Mère ! » répéta-t-il sans trop avoir conscience de ses paroles. « O puissante Mère ! je viens, ô puissante Mère ! je viens ; mais je suis loin de la demeure. Épargnez-moi un peu ; je viens aussi vite que je puis, mais mon pied est lourd ; je ne suis pas comme d’autres, ô puissante Mère ! » Cependant il avait marché deux milles dans cet état d’excitation physique et mentale, et naturellement il se sentit très-fatigué. Il ralentit son pas, et peu à peu il revint à lui ; mais il continua, comme machinalement, à répéter : « O puissante Mère ! » « Mais, quoi donc ! s’écria-t-il soudain, où ai-je appris ces paroles ? Willis ne les a pas employées. En vérité, je dois être en garde contre ces voies étranges : Tout homme peut être enthousiaste ; l’enthousiasme n’est pas la vérité… O puissante Mère ! Hélas ! je sais où est mon cœur ! mais il faut marcher par la raison. O puissante Mère ! »
Le temps arriva enfin où Charles devait retourner à Oxford. Mais pendant le dernier mois, des scrupules s’étaient élevés dans son esprit : pouvait-il consciencieusement, dans l’état où il se trouvait, se présenter même pour son examen ? On n’avait pas, il est vrai, de signature à donner pour subir cette épreuve, mais il comprenait que les honneurs de la liste de classe n’étaient destinés qu’à ceux qui adhéraient bonâ fide à l’Église d’Angleterre. Il fit part de son embarras à Carlton, qui s’efforça de connaître à fond l’état de son esprit. Or, telles furent les données qui semblèrent résulter pour celui-ci de ses observations : Charles n’avait aucune intention de s’unir, présentement ni plus tard, à l’Église de Rome. Il sentait qu’en ce moment il ne pourrait prendre une pareille décision sans commettre une faute évidente ; s’il le faisait, il agirait simplement contre sa conscience. Dieu l’appelait-il autre part ? il n’en avait pas la certitude. Il comprenait que rien ne pouvait justifier un acte si sérieux, si ce n’est la conviction qu’il lui était impossible de se sauver dans l’Église à laquelle il appartenait ; et cette conviction, il ne l’avait point. Il n’avait pas de preuves suffisantes ni définies contre son Église pour la quitter, ni aucune idée arrêtée en faveur de l’Église de Rome, comme étant la seule Église du Christ. Cependant il ne pouvait s’empêcher de soupçonner qu’un jour il penserait autrement. Il concevait qu’un jour pouvait venir, qu’il viendrait même, où il aurait cette conviction qu’à présent il n’avait pas, et d’après laquelle il agirait naturellement, en quittant l’Église d’Angleterre pour celle de Rome. Il ne pouvait dire clairement pourquoi il anticipait ainsi, sinon parce qu’il y avait dans l’Église de Rome bien des choses qu’il croyait vraies, et d’autre part dans l’Église d’Angleterre bien des choses qu’il croyait fausses ; et puis encore, parce que, plus il avait eu l’occasion d’entendre et de voir, plus il avait eu de motifs d’admirer et de vénérer le système de Rome, et d’être mécontent, au contraire, de celui de son Église. Telles furent les remarques de Carlton à l’égard de son jeune ami. Après avoir sérieusement étudié le cas, il conseilla à Charles de se présenter pour son examen. Il agit ainsi, d’abord, parce qu’il savait les changements qui s’opèrent dans l’esprit de la jeunesse, et la difficulté pour Reding de prédire quel serait l’état de ses idées deux années plus tard. Il prévoyait, en second lieu, qu’un avis contraire eût été le moyen infaillible de tourner en conviction ses doutes actuels sur le peu de solidité de l’Anglicanisme.
L’examen de Charles eut donc lieu en son temps. Les candidats étaient nombreux. Il s’en tira d’une manière honorable, et son succès fut regardé comme assuré. Sheffield vint après lui, et il subit son épreuve avec éclat. On produisit la liste : Sheffield était au premier rang, Charles au second. Dans ces sortes d’épreuves, il y a nécessairement toujours du hasard ; mais dans le cas actuel, on peut expliquer la différence du succès des deux amis. Charles avait perdu quelque temps par suite de la mort de son père et des affaires de famille qui en avaient été la conséquence. Puis son renvoi de l’Université pendant les six derniers mois, renvoi fort peu déshonorant, lui avait fait beaucoup de tort. En outre, quoiqu’il eût étudié avec soin et persévérance, il n’avait pas concouru pour les honneurs avec le même zèle que Sheffield. Ses difficultés religieuses, particulièrement son indécision pour savoir s’il se présenterait, n’avaient pas été sans exercer une grande influence sur son application et son énergie. Comme le succès n’avait pas été le premier désir de son cœur, la non-réussite ne lui causa pas non plus une très-grande peine. Il aurait sans doute préféré le succès ; mais il jugea et sentit bientôt qu’il pouvait très-bien s’en passer.
Ensuite se présenta la question de ses grades, qu’il ne pouvait prendre sans souscrire aux Articles. Il consulta Carlton. Il n’y avait pas nécessité pour l’heure de devenir bachelier ès-arts ; que pourrait-il y gagner ? Il valait mieux différer cette démarche. Il n’avait qu’à partir et à ne pas en parler ; personne n’en saurait rien ; et si, au bout de six mois, comme Carlton le prédisait avec confiance, il se trouvait dans un état d’esprit plus calme, alors il n’avait qu’à revenir et à poursuivre son but.
Qu’allait-il faire de sa personne à présent ? Il n’y avait pas là une grande difficulté, pour l’un comme pour l’autre, d’émettre un avis. On décida qu’il serait mieux pour Charles d’étudier avec un ecclésiastique dans l’intérieur du pays. De cette manière, il pourrait à la fois se préparer aux ordres et s’éclairer sur les points qui le troublaient. Il aurait par là, en outre, l’occasion de remplir quelques devoirs du ministère, ce qui aurait pour résultat de tranquilliser et de calmer son âme. Quant aux livres qu’il devait étudier, naturellement le choix en appartiendrait à l’ecclésiastique qui serait chargé de sa direction, mais, quant à lui, ajoutait Carlton, il ne lui recommandait pas les ouvrages ordinaires de controverse avec Rome, ces ouvrages pour lesquels l’Église Anglicane est si célèbre. Il lui conseillait plutôt ceux qui étaient d’un caractère positif, qui traitaient les sujets au point de vue de la philosophie, de l’histoire ou de la doctrine, et qui développaient les principes particuliers à cette Église ; ainsi, par exemple : le grand ouvrage de Hooker, ou la Defensio et l’Harmonia de Bull, ou les Vindiciæ de Pearson, ou le magnifique travail de Jackson sur le Symbole. A ces auteurs, il pourrait ajouter Laud sur la Tradition, quoique ce dernier eût adopté la forme de controverse. Il pourrait encore lire avec fruit les Antiquités de Bingham, Waterland sur l’usage de l’Antiquité, Wall sur le Baptême des enfants, et Palmer sur la Liturgie. Il ne devait pas non plus négliger les auteurs pratiques et traitant de la dévotion, tels que les évêques Taylor, Wilson et Horne. Mais le point le plus important restait à résoudre : où devait-il se fixer ? connaissait-il dans le pays un ecclésiastique qui voulût le recevoir dans sa maison comme ami et élève ? Charles pensa à Campbell, avec qui il était dans les meilleurs rapports. Carlton approuva ; il connaissait assez de réputation ce ministre pour être certain que Charles ne pouvait se placer en des mains plus sûres.
Reding, en conséquence, fit la proposition au recteur de Sutton, et elle fut acceptée. Dès lors il ne lui restait plus qu’à payer quelques comptes, à emballer des livres laissés chez un ami, et à dire adieu, au moins pour un temps, aux cloîtres et aux délicieux ombrages de l’Université. Il partit au mois de juin, à cette époque où toute la nature étale cette beauté fraîche et suave dont les charmes avaient ravi son cœur au commencement de son séjour à Oxford, trois années auparavant.
Nous allons franchir un assez long espace de temps. Déjà, une fois, nous avons pris la liberté d’omettre deux années de la vie du héros de notre histoire ; nous nous permettons de nouveau de laisser dans l’oubli une triste période non moins longue, et le lecteur doit se transporter à l’automne de la deuxième année après celle où Charles passa son examen, sans prendre son grade[70].
[70] Le grade est conféré dans une cérémonie distincte de l’examen.
A cette époque, notre intérêt se trouve tout entier à Boughton et au presbytère de Sutton. Quant à Melford, l’ami Bateman l’avait quitté pour l’administration d’une église dans une ville manufacturière dont le district avait 10,000 âmes, et sur ce nouveau théâtre il travaillait à faire accepter à son troupeau le surplis et les chandeliers dorés. Willis avait également suivi sa voie : il avait dit adieu à sa mère et à son frère, peu de temps après que Charles fut parti pour passer son examen, et à cette heure il était dans le couvent des Passionnistes à Pennington, sous le nom de Père Louis de Sancta-Cruce.
Un soir, vers la fin de septembre, Campbell était en visite à Boughton, et il se promenait dans le jardin avec miss Reding. « En vérité, Marie, lui disait-il, je ne pense pas que ce soit un bien de le retenir. Les meilleures années de sa vie passent, sans que, humainement parlant, il y ait espoir de lui voir changer ses idées, au moins jusqu’à ce qu’il ait fait un essai de l’Église de Rome. Il est très-possible que l’expérience le fasse revenir sur ses pas. — Terrible situation, répondit Marie ! Comment pouvons-nous, même indirectement, lui permettre de faire une telle démarche ? — C’est un brave et excellent jeune homme, répliqua Campbell ; c’est un caractère d’or. Tout le temps qu’il est resté avec moi, il n’a fait aucune difficulté ; il a lu entièrement les livres que je lui ai recommandés et d’autres encore. Je l’ai trouvé toujours docile à ma parole. Vous savez que je l’ai employé dans ma paroisse ; il a enseigné le catéchisme aux enfants et m’a servi d’aumônier. Pauvre jeune homme ! déjà sa santé en souffre ; il voit qu’il n’y a pas de fin à tout ceci : l’espérance différée rend le cœur malade. — Il est si pénible de donner un appui quelconque à une démarche qu’on juge mauvaise ! dit Marie. — Mais qu’y faire ? il n’est pas nécessaire que nous lui donnions notre appui. Charles pourtant ne peut rester toujours à la lisière ; d’autant plus que nous avons fait une espèce de compromis. Il voulait aller en avant dès la fin de la première année ; je ne crus pas devoir alors vous tourmenter à ce sujet ; je me contentai de le retenir. Nous transigeâmes de cette manière : il retira son nom des registres du collége, car il n’y avait pas la moindre chance de lui faire jamais signer les Articles, et il consentit à attendre encore une année. Aujourd’hui, ce temps est plus qu’écoulé, et l’impatience le gagne. Ainsi ce n’est pas nous qui favoriserons sa démarche, c’est bien lui qui nous quittera. — Mais c’est si effrayant, repartit Marie ; et ma pauvre mère ! Je crains vraiment que cela ne cause sa mort. — Ce sera un coup écrasant, il n’y a pas de doute à cet égard ; qu’en sait-elle maintenant ? — Je ne pourrais guère vous le dire. Elle en a été positivement informée, il y a un an ; mais comme elle voit Charles si fréquemment, et toujours le même en apparence, je crains qu’elle n’ait pas pris cela au sérieux. Elle ne m’en a jamais parlé. J’imagine qu’elle pense que, dans mon frère, c’est une affaire de scrupule, d’inquiétude sans doute, mais que cela passera. — C’est à moi à le lui annoncer, Marie. — Eh bien, je crois qu’il faut le faire, repartit miss Reding en soupirant ; et puisque c’est ainsi, vous me rendrez vraiment un grand service, en m’épargnant une tâche pour laquelle je me sens incapable. Mais ayez auparavant un entretien avec Charles. Quand viendra le moment décisif, il peut être arrêté par plus de difficultés qu’il ne l’a supposé d’abord. » Tel fut le plan convenu ; et Campbell revint à Sutton, tout préoccupé de la double mission qu’il avait à remplir.
Le pauvre Charles était assis devant une fenêtre ouverte, et contemplait le paysage d’alentour, lorsque Campbell entra dans sa chambre. Le point de vue était magnifique : de hautes collines se perdaient dans le lointain, et à deux pas une rivière roulait ses flots rapides. Campbell entra sans être aperçu. Mettant la main sur l’épaule de son jeune ami, il lui demanda le sujet de ses réflexions ; Charles se retourna et le regarda avec un sourire plein de tristesse : « Je suis comme Moïse voyant la terre de la promesse, dit-il. O mon cher Campbell, quand viendra donc la fin ? — Mon ami, naturellement, ce n’est pas à moi de le décider. — Depuis longtemps, l’année est terminée : puis-je enfin suivre ma voie ? — Vous ne pouvez vous attendre, Charles, à ce que ni moi, ni aucun de nous, nous vous donnions un appui, même indirect, pour une démarche que, malgré toute notre affection pour vous, nous considérons comme une faute. — C’est me dire : Agissez par vous-même. Eh bien, j’y consens. » Campbell ne répliqua pas d’abord ; puis il dit : « Je devrai annoncer cette résolution à votre pauvre mère ; Marie pense que cela va la tuer. » Charles se cacha la figure dans ses mains. « Non, dit-il ; j’espère que ma mère et nous tous, nous serons soutenus dans cette circonstance. — Je l’espère aussi de tout mon cœur ; car ce sera un coup bien terrible pour vos sœurs. Mon cher ami, ne tiendrez-vous aucun compte de tout cela ? Considérez sérieusement la peine réelle que vous causez pour un bien qui n’est pas certain. — Croyez-vous que je n’y aie pas déjà réfléchi, Campbell ? N’est-ce rien pour un cœur comme le mien de briser ses liens d’affection, et de perdre l’estime et la tendresse de tant de personnes aimées ? Oh ! ç’a été une pensée des plus cruelles ; mais je l’ai épuisée, je l’ai bue jusqu’à la lie. Je me suis rendu familière cette perspective, et maintenant je suis tranquille : Oui, j’abandonne ma famille, j’abandonne tous ceux qui m’ont connu, aimé, estimé, tous ceux qui me voulaient du bien. Je le sais, je me rends la risée du monde et je deviens proscrit. — Oh ! mon cher ami, mettez-vous en garde contre une tentation très-captieuse qui peut s’offrir à vous dans cette circonstance. Déjà, avant cette heure, j’avais eu la pensée de vous en avertir. La grandeur du sacrifice vous aiguillonne ; vous le faites, parce qu’il vous en coûte beaucoup. » Charles sourit. « Que vous me connaissez peu ! dit-il. Si telle eût été la disposition de mon cœur, aurais-je attendu patiemment plus de deux années ? Pourquoi ne me serais-je pas précipité en avant, comme d’autres ? Vous ne pouvez nier que je n’aie agi d’une manière raisonnable et avec une volonté soumise. Mille fois j’ai écarté ce sujet de mon esprit, mais il est toujours revenu. — Je ne veux pas vous faire de la peine ni vous offenser, Charles ; mais c’est la plus malheureuse des illusions. Je voudrais vous mettre dans l’esprit qu’il se peut que vous vous abusiez. — Ah ! Campbell, quel oubli est le vôtre ! Ne savez-vous pas que cette pensée est précisément celle qui m’a retenu le plus longtemps ? Je me disais : Peut-être suis-je le jouet d’un rêve. Oh ! si je pouvais trouver un moyen sûr de sortir de mon sommeil ! Vous savez quelles espérances j’avais fondées sur le changement de mes idées à la mort de mon cher père ; ce que j’avais pris auparavant pour des convictions s’évanouit alors comme un nuage. Peut-être, me disais-je, celles-ci s’évanouiront-elles également. Mais non ; « les nuages reviennent après la pluie » ; ils sont revenus, revenus sans cesse, plus lourds que jamais. C’est une conviction enracinée en moi ; et elle se soutient, malgré la perspective de perdre une mère et des sœurs. Je me consume ici dans l’inaction, alors que je pourrais rendre ma vie utile. Et pourquoi ? parce que cette démarche m’épouvante. Dernièrement, cette conviction s’est décuplée en moi. Vous allez rire, mais laissez-moi vous faire une confidence ; dernièrement j’avais peur de monter à cheval, de me baigner, ou de faire tout autre exercice de ce genre, dans la crainte qu’il ne m’arrivât un accident, et que je ne fusse emporté de ce monde, en laissant un grand devoir non accompli. Oui, maintenant j’ai éprouvé que c’est une conviction vraie, réelle. Ma croyance à l’Église de Rome fait partie de moi-même ; je ne puis agir contre cette croyance sans agir contre Dieu. — C’est une situation des plus déplorables, certainement, répondit Campbell, qui se promenait en long et en large dans la chambre. C’est une illusion, j’en suis convaincu. Peut-être le découvrirez-vous au moment même que vous aurez accompli cette démarche. Vous vous lierez solennellement à un symbole étranger, et à peine l’engagement sera-t-il sorti de votre bouche, que le nuage s’évanouira de devant vos yeux, et que la vérité se montrera. C’est une pensée terrible ! — J’ai également songé à cette possibilité, repartit Charles, et elle a beaucoup influé sur moi. Elle m’a fait reculer. Mais aujourd’hui, je crois que cet obstacle ressemble à ces fantômes hideux qui, dans les contes de fées, obsèdent les preux chevaliers lorsqu’ils veulent s’introduire de force dans un palais enchanté. Rappelez-vous les paroles de Thalaba : « Le talisman, c’est la foi. » Si j’ai des motifs raisonnables pour croire, la croyance est pour moi un devoir. Dieu prendra soin de son œuvre. Je ne serai pas délaissé au jour du besoin suprême. La foi commence toujours avec une chance à courir, et elle est récompensée par la vue claire de la vérité. — Oui, mon cher ami, mais la question est de savoir si vos motifs sont fondés. Ma pensée est que, puisqu’ils ne le sont pas, ils ne vous serviront de rien dans l’épreuve. Vous trouverez alors, trop tard malheureusement, qu’ils étaient illusoires. — Campbell, répliqua Charles, d’après moi, toute raison vient de Dieu. Nos motifs peuvent, tout au plus, être imparfaits, mais si, après avoir prié, s’être livré à des recherches, avoir obéi, attendu, en un mot, si après avoir de notre côté rempli notre tâche, ils paraissent suffisants, c’est la voix de notre Père qui nous appelle. Dans ce cas, c’est lui-même qui nous donne la conviction. Je suis entre ses mains. La seule question qui reste est : Que veut-il que je fasse ? Je ne puis me refuser à une conviction qui me domine. La semaine dernière encore elle s’est emparée de moi tout autrement qu’elle ne l’avait jamais fait ; et, en ce moment, elle est si forte qu’attendre plus longtemps c’est résister à Dieu. Ma soumission à l’Église de Rome n’est plus, à cette heure, qu’une simple affaire de temps. Je veux, mon cher Campbell, vous quitter en paix et rester toujours votre ami. Consentez donc à me laisser partir. — Que je vous laisse partir ! sans doute, si vous alliez vous réunir à l’Église Catholique, il ne serait pas nécessaire de me faire cette demande ; mais « vous laisser partir », comment pouvez-vous l’attendre de nous, quand nous ne pensons pas ainsi ? Songez à notre position, Charles, aussi bien qu’à la vôtre ; entrez dans nos sentiments. Quant à moi, je crois fermement (et je ne vous ai jamais caché que telle est ma conviction), je crois fermement que l’Église de Rome est antichrétienne. Elle a dans son sein mille grâces, et sous plusieurs rapports elle est supérieure à la nôtre ; mais elle renferme quelque chose qui gâte tout. Je n’ai pas confiance en elle. Or, tel étant le cas, comment puis-je vous permettre de vous unir à cette Église ? Non ; c’est comme si l’on disait : Laissez-moi aller me pendre ; laissez-moi aller dormir dans un endroit fiévreux ; laissez-moi sauter dans un puits, et vous voulez que je vous permette de partir ? — Oh ! dit Charles, c’est en cela que nous différons d’une manière terrible ; nous ne pouvons nous trouver en plus grand désaccord. Pour moi, l’Église de Rome est le prophète de Dieu ; tandis que pour vous, c’est le suppôt de Satan. — Je l’avoue, telle est ma conviction. Si vous accomplissez cette démarche, vous vous trouverez dans les mains d’une Circé qui vous transformera et fera de vous une brute. » Charles rougit légèrement. « Je ne continuerai pas, ajouta Campbell ; je vous fais de la peine ; et puis, cela ne sert à rien ; peut-être ne fais-je qu’aggraver le mal. » Ils ne dirent plus un mot pendant quelques instants. A la fin, Charles se leva et se dirigea vers le jeune ministre, lui prit la main et l’embrassa. « Pendant deux ans, Campbell, vous avez été pour moi un ami dévoué et désintéressé, dit-il ; vous m’avez abrité sous votre toit ; et nous voilà sur le point d’être unis par des liens plus intimes. Que Dieu vous récompense ; mais laissez-moi partir, car le jour se lève. — C’est donc sans espoir ! Ah ! du moins, séparons-nous amis. Mais il faut que j’annonce cette triste nouvelle à votre mère. »
Dix jours après cette conversation, Charles était prêt pour son voyage : sa chambre était remise en ordre, sa valise fermée, et à la porte l’attendait le cabriolet qui devait le conduire jusqu’à la première diligence. Il devait passer par Boughton. Campbell et Marie avaient arrêté ensemble que le mieux pour lui serait de ne voir sa mère qu’au moment de la séparation, à laquelle, au reste, elle avait été préparée par Campbell lui-même. C’eût été pour la mère comme pour le fils une peine inutile de se trouver plus tôt en présence l’un de l’autre.
Charles descendit de voiture le cœur ému, et il courut à la chambre de sa mère. Madame Reding était assise près du feu et travaillait lorsqu’il entra. Elle lui tendit froidement la main ; Charles s’assit. Ils ne se dirent rien durant quelques instants. Puis, sans discontinuer son ouvrage, la mère commença : « Eh bien, Charles, dit-elle, vous allez donc nous quitter. Où et comment pensez-vous vivre, lorsque vous serez entré dans votre nouvelle carrière ? » Charles répondit qu’il n’avait songé jusque là qu’à l’importante démarche d’où dépendait tout le reste. Il y eut de nouveau un moment de silence. La mère reprit : « Nulle part, Charles, vous ne trouverez des amis comme ceux que vous aviez à la maison. » Elle continua : « Vous avez eu tout à souhait, Charles : vous avez reçu du ciel des talents, les avantages d’une bonne éducation, une heureuse position de fortune. Que d’efforts doivent faire bien des jeunes gens de mérite pour arriver où vous en êtes ! » Charles répondit qu’il avait le sentiment profond de ce qu’il devait à la Providence dans les choses temporelles, ajoutant que c’était seulement par un ordre divin qu’il les abandonnait. « Nous mettions en vous notre espoir, Charles : peut-être avions-nous trop compté sur vous. Eh bien, que Dieu vous protége ! Vous avez choisi vous-même votre voie. » Le pauvre Charles assura que personne ne saurait comprendre ce qu’il lui en coûtait pour abandonner des objets qui étaient si chers à son cœur et qui faisaient partie de lui-même : sur la terre, il n’estimait rien tant que le foyer de famille. « Mais alors, pourquoi nous quitter ? reprit la mère vivement ; il faut que vous fassiez votre volonté ! Vous agissez ainsi, je suppose, parce que cela vous plaît. — Oh ! ma mère, ma bonne mère ! si vous pouviez voir au fond de mon cœur ! Rappelez-vous ce que vous avez lu dans l’Écriture ; comment, au temps des Apôtres, on était obligé de tout quitter pour le Christ. — Nous sommes donc des païens ? Merci, Charles, je vous suis obligée pour ces paroles. » Et elle laissa tomber une larme. Charles était presque hors de lui-même ; il ne savait que répondre. Il se leva et, appuyant son coude sur la cheminée, il cacha sa tête dans ses mains. « Eh bien, Charles, ajouta-t-elle en continuant à travailler, peut-être viendra-t-il un jour… » Sa voix trembla. « Votre cher père… » Elle déposa son ouvrage. « C’est nous faire inutilement du chagrin, reprit Charles. Pourquoi resterais-je ici ? Adieu pour le présent, chère mère. Je vous laisse en de bonnes mains, non pas plus dévouées, mais meilleures que les miennes ; vous me perdez, moi, vous gagnez un autre fils. Adieu pour le présent ; nous nous reverrons quand vous le voudrez, quand vous m’appellerez : quel heureux jour que celui-là ! » Il se jeta à ses pieds, et posa sa tête sur ses genoux. La mère ne put résister plus longtemps : elle se pencha sur lui et se mit à caresser ses cheveux, comme elle faisait quand il était petit enfant. A la fin, un torrent de larmes s’échappa de ses yeux ; elles inondèrent la figure et le cou de son fils. Un moment, Charles les supporta ; puis, se levant tout à coup, il embrassa sa mère avec précipitation, et s’élança hors de la chambre. Quelques secondes après, il avait vu ses sœurs, s’était arraché à leurs embrassements, était remonté dans son cabriolet à côté de son flegmatique conducteur, et, doucement balancé dans tous les sens, il se dirigeait vers Collumpton.
Le lecteur demandera peut-être où allait Charles. Question embarrassante. Car notre jeune ami lui-même n’avait évidemment qu’une idée très-vague de ce qu’il deviendrait, du lieu même où il fixerait ses pas, et, semblable au patriarche, « il partit ne sachant où il allait ». Il n’avait jamais vu de prêtre catholique, qu’une seule fois dans son enfance, en entrant dans une église de la communion romaine ; dans le monde entier, il ne connaissait aussi qu’un seul catholique, et encore ignorait-il où il était en ce moment. Mais il savait que les Passionnistes avaient un couvent à Londres, et il était assez naturel que, tout en ignorant si le jeune père Louis se trouvait là ou ailleurs, il tournât ses pas vers San Michaele.
Cependant, par un sentiment de sollicitude pour Marie et le reste de sa famille, il ne voulut pas avoir l’air de se rendre directement à Londres. Il résolut donc d’aller à Oxford s’adresser à Carlton, et de lui demander son avis sur ce qu’il y avait à faire dans sa position présente. Il semblait également que cette démarche serait pour les siens comme une dernière chance d’éloigner ce qui leur était une calamité si cruelle.
C’est donc vers Oxford qu’il se dirigea. Comme il avait certaines affaires à régler à Bath, il s’y arrêta pour la nuit, se proposant de continuer son voyage le lendemain matin. Il avait, entre autres choses, à se procurer « le Jardin de l’Ame » et deux ou trois autres livres semblables qui pourraient lui l’être d’un grand secours dans l’acte solennel qu’il allait accomplir à son arrivée à Londres. Dans cette pensée, il entra dans une librairie religieuse de Danvers street. Pendant qu’il était occupé dans l’arrière-magasin à feuilleter quelques ouvrages catholiques, qui, pour le public religieux, avaient moins d’attrait que les brillants volumes évangéliques et anglo-catholiques mis en étalage, il entendit la porte d’entrée s’ouvrir, et, en jetant un coup d’œil, il aperçut un visage connu. C’était un jeune ministre ayant au bras une jolie femme dont la toilette annonçait une mariée de fraîche date. L’amour était dans leurs yeux, la joie dans leurs paroles ; leur démarche et leur mise annonçaient la richesse. Charles se sentit pris d’un grand malaise, à peu près comme un homme qui, atteint du mal de mer, entendrait un des passagers demander des côtelettes de porc. Il se cacha derrière une pile de gros registres et d’autres articles de papeterie. Cela ne put toutefois l’empêcher d’entendre de temps en temps les notes douces et harmonieuses de la conversation qui s’échangeait entre les deux nouveaux venus.
« Avez-vous reçu quelques-uns des bons ouvrages réimprimés dernièrement à Oxford ? dit au commis le jeune marié qui n’était autre que White. — Oui, monsieur ; mais quels sont ceux que vous désirez ? Le Recueil des anciens Théologiens, ou bien, « les Nouvelles Adaptations Catholiques ? » — Oh ! non ; pas les Adaptations ; c’est un ouvrage extrêmement dangereux. Je demande la vraie théologie de l’Église d’Angleterre : Bull, Patrick, Hooker et les autres. » Le commis alla chercher ces auteurs. — Je pense, mon chéri, que c’est contre ces Adaptations que l’évêque nous a prévenus, dit la jeune dame. — Non, pas l’évêque, Louisa, mais sa fille. — Oh ! miss Primrose, c’est vrai. Elle nous a aussi recommandé un livre ; vous rappelez-vous lequel ? — Vous vous trompez, mon amour, c’était un discours : celui de M. O’Ballaway à Exeter Hall ; mais je pense qu’il ne serait pas entièrement de notre goût. — Non, non, Henri, c’était bien un livre, mais je ne puis m’en rappeler le titre. — Vous voulez dire, peut-être, « la Nouvelle Réfutation du Papisme » du docteur Grow ; mais celui-là, c’est l’évêque qui nous l’a recommandé. »
Le commis revint. « Oh ! quelle délicieuse figure ! s’écria la jeune dame, en regardant le frontispice d’un petit volume qu’elle tenait ; voyez, mon cher Henri, qui cela vous rappelle-t-il ? — Eh bien, on a voulu représenter saint Jean-Baptiste. — Il ressemble à la petite Angelina Primrose ; ce sont ses cheveux. Je suis étonnée que cette ressemblance ne vous frappe pas. — Oui, oui, elle me frappe, mon bijou, dit White en souriant. Mais il se fait tard, vous ne pouvez rester plus longtemps exposée au grand air : vous n’avez rien pour couvrir votre cou. J’ai choisi mes livres, tandis que vous admiriez le petit saint Jean. — Je ne puis me rappeler qui lui ressemble si fort… oh ! je l’ai trouvé : c’est la tante d’Angélina, lady Constance. — Venez, Louisa, les chevaux pourraient également avoir à souffrir, retournons chez nos amis. — Ah ! mais je voulais avoir un livre ; j’ai oublié lequel. Nommez-le-moi, Henri, je serais si fâchée de ne l’avoir pas acheté ! — Est-ce le nouvel ouvrage sur le chant grégorien ? — Ah ! c’est vrai, j’en ai besoin pour les enfants de l’école ; mais ce n’est pas celui-là. — Est-ce « le Presbytère Catholique ? » « les Chants des Apôtres ? » « l’Église d’Angleterre plus ancienne que celle de Rome ? » « l’Anglicanisme des martyrs primitifs ? » « les Aveux d’un Perverti ? » « Eustache Beville ? » « le Célibat modifié ? » — Non, non, non ; mon Dieu ! quelle sotte mémoire ! — Eh bien, Louisa, vous reviendrez un autre jour ; ne restez pas plus longtemps, ma chère ; cela suffit. — Oh ! je m’en souviens ; ce sont « les Abbayes et les Abbés ». J’ai besoin de quelques idées pour la restauration des fenêtres du presbytère, lorsque nous reviendrons à la maison ; et puis, notre église, vous le savez, manque d’un porche pour les pauvres. Ce livre est rempli de dessins. » On trouva le livre, et il fut ajouté aux autres, qui avaient déjà été portés dans la voiture. « Maintenant, Louisa… — Eh bien, mon chéri, nous avons encore une course à faire. Dites à John de nous conduire chez Sharp. Nous pouvons nous y rendre par la Pépinière. Ce n’est qu’à deux pas de notre route. J’ai besoin de dire un mot à cet homme relativement à notre serre. Il n’y a pas de bon jardinier dans notre voisinage. — A quoi bon y aller maintenant ? Louisa, nous ne reviendrons pas chez nous avant un mois » ; et ce disant, White, avec une humble résignation, ordonna au cocher de les conduire chez le pépiniériste que Louisa désirait voir ; il fit en même temps entrer sa femme dans la voiture, et y monta après elle.
Dès qu’ils furent sortis, Charles respira librement. Un texte sévère de l’Écriture lui vint à l’esprit, mais il réprima tout sentiment de censure, toute pensée peu charitable, et il ne songea plus qu’aux devoirs difficiles qu’il avait à accomplir.
Le lendemain, Charles arriva à Steventon, sans aucun incident digne d’être cité. L’après-midi étant magnifique, il laissa son porte-manteau à l’omnibus, et continua la route à pied. Il fallait un certain courage pour oser, dans une circonstance si importante, affronter l’ennui de voyager seul ; ennui que ne pouvait guère adoucir la perspective de revoir une personne et un lieu qui lui étaient si chers, Carlton et Oxford.
Il avait traversé Bagley Wood, lorsque les flèches et les tours de l’Université s’offrirent tout à coup à ses yeux. Que d’aimables souvenirs elles éveillèrent en lui ! Après avoir vécu loin d’elles deux années entières, il lui était enfin donné de les revoir, mais, ô malheur ! c’était pour les perdre de nouveau et sans retour. Devant lui était le vieil Oxford avec ses collines et ses prairies aussi gracieuses et aussi vertes que jamais. A la première vue de ce lieu tant aimé, il s’arrêta, croisant les bras sur sa poitrine et incapable d’avancer. Il reconnaissait chaque collége et chaque église à son toit et à ses tourelles. L’Isis argenté, les saules au feuillage gris, les plaines immenses, les bois sombres, Shotover dans le lointain, le charmant village où il avait vécu avec Carlton et Sheffield : forêt, eau, pierres, toutes ces choses si calmes, si brillantes, il aurait pu les posséder, mais hélas ! il fallait leur dire adieu. Quelques avantages qu’il dût obtenir en se faisant catholique, il allait néanmoins perdre tous ces riches et ineffables trésors. Quoique le but auquel il aspirait fût sans doute plus élevé et plus parfait, cependant il ne pouvait espérer de retrouver ailleurs rien de semblable à ce qu’il avait maintenant sous les yeux. Il ne pourrait avoir un autre Oxford, il ne pourrait, parmi les amis de son enfance et de sa jeunesse, faire un choix pour son âge mûr. — Il arriva à cette porte si connue qui est sur la gauche, et descendit dans la plaine. Personne n’était là pour le saluer, pour sympathiser avec lui ; personne qui pût croire seulement qu’il avait besoin de sympathie, ni qu’il avait fait le sacrifice entier de toutes choses ; personne pour s’intéresser à lui, pour lui montrer de la compassion ; personne pour le défendre. Il avait beaucoup souffert, mais qui croyait seulement à ses souffrances ? Le monde l’aurait plutôt accusé d’affliger les autres, mais nul n’aurait cru à ses peines. En eût-il parlé lui-même, on lui aurait répondu durement que chacun suit son bon plaisir, et que s’il avait quitté Oxford, c’était pour une fantaisie qu’il avait plus à cœur que le reste. Mais loin de là, nul ne le connaissait ; il avait été absent environ trois années ; trois années ! c’est tout une génération. Oxford avait été sa résidence, et ce lieu si cher l’avait oublié. Il se souvenait de son respect et de son enthousiasme lors de son arrivée à l’Université ; il y était venu comme on s’approche d’un reliquaire vénéré. Il se souvenait des espérances qui, de temps à autre, lui avaient souri. Il se rappelait qu’il avait parfois rêvé un titre de résidence dans une des anciennes fondations. Un soir, il était monté à une tour avec un de ses amis pour observer les étoiles, et, tandis que son compagnon était activement occupé aux aiguilles, lui, jeune homme terrestre, il regardait les sombres cours que le gaz éclairait à ses pieds et se demandait s’il serait jamais fellow de tel ou tel collége qu’il distinguait de la masse des bâtiments académiques. Toutes ces choses étaient passées comme un songe, et il n’était plus qu’un étranger là où il avait espéré établir son foyer.
Cependant il s’approchait d’Oxford. Il vit, le long de la route, passer deux à deux des jeunes gens qui, d’un pas léger, finissaient leur modeste promenade quotidienne et arrivaient aux portes de la ville. Un objet, qui, à un mille de distance, lui avait paru une voiture à deux chevaux, vint s’offrir à ses yeux privé de son cheval conducteur. Bientôt se présentèrent dans le lointain une toque et une robe solennelles. Charles était arrivé à la grand’route avant que cette apparition fût passée à côté de lui : c’était un tuteur de collége que jadis il avait vu quelquefois. Il s’attendait à être reconnu ; mais le professeur continua sa marche, après lui avoir jeté un regard vague, incertain, qui semblait dire : Je vous ai vu quelque part, mais pourtant vous m’êtes tout à fait étranger. Charles avait traversé Folly Bridge ; des cavaliers passèrent à ses côtés ; montés sur leurs chevaux et causant à haute voix, ils reconduisaient leurs montures à leurs écuries respectives. Il se dirigea vers Christ-Church, et pénétra à Peckwater. Le crépuscule n’avait pas entièrement disparu, et le gaz s’allumait. Des groupes d’étudiants stationnaient çà et là, le plus grand nombre en chapeau, quelques-uns avec la toque, un ou deux avec leur toge par surcroît ; d’autres appelaient leurs compagnons penchés aux fenêtres d’un second étage. On voyait courir des domestiques chargés de dîners délicats, et des garçons pâtissiers portant des desserts. Des individus vêtus misérablement flânaient, accompagnés de leurs blenheims[71], sous Canterbury Gate. Plusieurs regardèrent Charles fixement, mais personne ne le reconnut. Il se hâta d’arriver à Oriel Lane. Soudain il fut très-surpris de recevoir le salut d’un passant. Il chercha de qui lui venait cette politesse ; c’était un décrotteur en retraite de son collége, à qui il avait donné parfois un schelling d’étrennes. Il atteignit High Street, et se dirigea vers l’hôtel de l’Ange. Mais qui s’avançait vers lui ? C’était l’ombre d’un Censeur. Charles éprouva un frissonnement instinctif ; mais le fantôme passa outre sans lui faire de mal. Semblable à Kehama, il vivait sous l’influence d’un charme. Il était enfin arrivé à son hôtel, où il trouva son porte-manteau tout préparé. Il choisit immédiatement une chambre, et après s’y être complétement installé, il songea à son dîner.
[71] Espèce d’épagneuls.
Notre jeune ami ne voulait pas perdre de temps, et désirait, si c’était possible, se diriger vers Londres le lendemain matin. A ses yeux, ce serait un grand point de terminer son voyage assez tôt dans la semaine pour que, le dimanche, dans le cas où il en serait jugé digne, il pût offrir ses actions de grâces dans l’immense et sainte communion de l’Église universelle, pour les bienfaits qu’il avait reçus. Il se décida en conséquence à faire une tentative ce soir même auprès de Carlton. Il espérait, s’il se rendait à son logement entre sept et huit heures, le trouver de retour du réfectoire. Dans cette pensée, il sortit tout de suite. Arrivé au collége de son ancien tuteur, il frappa à la porte, entra, passa outre et franchit les roides degrés du vieil escalier de bois. La porte extérieure était fermée. Il descendit et trouva un domestique, qui lui apprit que M. Carlton donnait un dîner au réfectoire, mais que le repas touchait à sa fin. Notre visiteur se décida à attendre.
Le domestique alluma les bougies dans le salon, et Charles s’assit auprès du feu. Un instant, il se livra à ses réflexions ; puis il regarda autour de lui pour trouver un sujet qui l’occupât. Ses yeux tombèrent sur un journal d’Oxford, daté seulement de quelques jours. « Voyons comment les choses vont ici », se dit-il à lui-même en le prenant. Il parcourut un article après l’autre ; il regardait quels étaient les prédicateurs de l’Université pendant la semaine, quels étudiants avaient pris leurs grades, quels étaient les examinateurs publics, etc., etc… lorsque son attention fut éveillée par le paragraphe suivant :
Une apostasie dans l’Église. — « Nous apprenons qu’une nouvelle victime vient de s’ajouter à la liste de celles que le poison des principes Tractariens a précipitées dans le sein de la Sorcière de Rome. M. Reding de Saint-Sauveur, fils d’un respectable ecclésiastique de l’Établissement, qui est mort après avoir mangé toute sa vie le pain de l’Église, vient enfin de se déclarer le sujet et l’esclave d’un évêque italien. Des mécomptes dans son examen ont été, dit-on, la cause déterminante de cet acte insensé. Le bruit court que des mesures légales sont préparées pour infliger les amendes du statut du præmunire à tous les apostats. Une proposition est également arrêtée pour demander à Sa Majesté de consacrer l’argent ainsi obtenu à l’érection d’un « monument commémoratif des Martyrs[72] » chez la sœur de notre Université. »
[72] Ce monument existe réellement à Oxford. Il a été érigé en 1841. C’est une glorification de Ridley, Latimer et Cranmer, trois hommes que le protestant Cobbett range à la tête de ceux dont il a dit : « C’étaient tous sans exception ou des apostats, ou des parjures, ou des voleurs publics. » Nous l’avouons, ce monument est celui qui nous a le plus péniblement impressionné à Oxford.
« Ainsi, pensa Charles, le monde, comme toujours, prend les devants sur moi. » Il se prit à chercher d’où ce bruit pouvait provenir, et il avait presque oublié qu’il attendait Carlton.
Tandis que Charles apprenait, dans le salon de son ami, jusqu’à quel point le monde s’intéressait à sa position et à ses actes, il servait au même moment de sujet de conversation à la société réunie dans le réfectoire voisin. Le thé et le café avaient déjà été servis, et les convives, s’étant levés de table, formaient un cercle autour du feu. « Quel est ce M. Reding dont il est parlé dans la Gazette de la semaine dernière ? » demandait un petit monsieur, tiré à quatre épingles, qui buvait son thé à petites gorgées et se levait sur la pointe des pieds, tout en parlant. « Vous n’irez pas chercher loin la réponse », répondit son voisin, qui, se tournant vers leur hôte, ajouta : « Carlton, qui est ce M. Reding ? — Un très-aimable et fort honnête garçon. Plût à Dieu que nous fussions tous aussi bons ! Il a travaillé avec moi durant une de ses grandes vacances ; c’est un excellent étudiant, et il doit avoir réussi dans son examen. Je n’ai plus entendu parler de lui depuis quelque temps. — Il a d’autres amis ici », dit un nouvel interlocuteur : « Je pense », se tournant vers un jeune Fellow de Leicester, « que vous, Sheffield, avez été intimement lié avec lui. — Oui, répondit Sheffield ; Vincent le connaît aussi. C’est un jeune homme de premier mérite. Je le connais parfaitement. L’assertion de la Gazette sur son compte est fausse. Je n’ai jamais vu un étudiant qui se préoccupât moins de ses succès. C’était là son plus grand défaut. — Pourtant il y a du vrai dans cette nouvelle, ajouta un autre convive. Hier, j’ai rencontré à un dîner M. Malcolm, qui paraît avoir des relations avec la famille de M. Reding ; il m’a dit que les idées religieuses de ce jeune homme l’ont jeté hors de la voie et ont gâté ses études. »
La conversation n’était pas générale ; elle se morcela en plusieurs groupes, selon que les convives se trouvaient réunis. Le sujet, non plus, n’était pas du goût de tous ; il était même plutôt pénible et désagréable à toute la société, à l’exception de deux ou trois individus curieux et difficiles, qui vivaient d’opposition au Catholicisme. En outre, à cette époque, il arrivait souvent dans de semblables réunions qu’on ne connaissait pas exactement les idées de son voisin sur cette question majeure, et qu’il s’y trouvait aussi, comme dans le cas actuel, des amis de la personne accusée ou calomniée. Puis, d’ailleurs, on avait le noble sentiment et la conviction profonde du sacrifice accompli par ces hommes qui se séparaient de l’Église d’Angleterre, ce qui empêchait d’en parler avec malveillance.
« Croyez-vous avoir beaucoup à faire pour les examens de ce trimestre ? dit un convive à un autre. — Je l’ignore. Nous avons deux étudiants qui s’en vont, deux bons élèves. — Qui vient à la place de Stretton ? — Jackson de King. — Jackson ? vraiment ? il est, je crois, très-fort en philosophie. — Oui, très-fort. — Nos étudiants connaissent bien leurs livres, mais je ne dirais pas que la philosophie soit leur vocation. — Leicester en présente quatre. — Ce sera une belle liste de classe, d’après ce que j’entends. — Ah ! oui ; à la Saint-Michel, la liste est toujours bien fournie. »
Cependant dans un autre groupe la conversation roulait sur le pauvre Charles. « Non, croyez-moi, l’article de la Gazette est plus fondé que vous ne pensez. En général, il y a beaucoup de mécomptes au fond de tous ces changements. — Pauvres diables ! ils n’en peuvent mais, dit un autre à son voisin, à voix basse. — Heureuse délivrance, après tout, repartit celui-ci ; nous aurons un peu de paix, enfin. — Eh bien, dit le premier des deux, en s’étirant et parlant en l’air, comment un homme bien élevé peut-il…? » Sa voix fut couverte par la parole grave d’un petit homme qui jusque là avait gardé le silence, et qui, passant sa tête entre les deux interlocuteurs, s’adressa d’un ton décisif à un groupe qui était plus loin : « Tout cela, dit-il, est l’effet du rationalisme ; le mouvement tout entier est rationaliste. D’ici à trois ans, tous ces hommes qui viennent d’apostasier seront infidèles. » Personne ne répondit. A la fin, un autre membre de la réunion s’avança vers l’ami de M. Malcolm et lui dit d’un ton mesuré : « Peut-être ne savez-vous pas qu’il y a là quelque chose de dérangé dans M. Reding (et il toucha son front d’une manière significative) ; on m’a assuré que c’était un mal de famille. » Une voix profonde, puissante, et résonnante comme « la grande cloche de Bow », s’éleva d’un coin de la salle, comme pour mettre fin à la conversation : « Je respecte infiniment Reding, dit-elle brusquement ; j’ai une grande estime pour lui. C’est un honnête homme ; je voudrais que d’autres lui ressemblassent. S’il en était ainsi, de même que les Puséistes se font Catholiques, peut-être verrions-nous le vieux Brownside et sa clique devenir Unitaires. Mais ces messieurs préfèrent ne pas bouger. »
La plupart des personnes présentes sentirent la vérité de cette remarque, et il y eut un moment de silence. Il fut interrompu par un individu à la voix claire et glapissante. « Avez-vous jamais ouï dire, demanda-t-il en balançant sa tête ou plutôt tout son corps, vous est-il jamais arrivé, Sheffield, d’entendre dire que ce gentleman, votre ami M. Reding, lorsqu’il était étudiant de première année, avait eu une conversation avec quelque attaché de la chapelle papiste dans cette ville, à la porte même de cette chapelle, après le départ des étudiants pour les vacances ? — Impossible, Fusby, dit Carlton en riant. — C’est très-vrai, reprit Fusby ; je le tiens du sous-maréchal, qui passait en ce moment. Depuis plusieurs années j’ai les yeux sur M. Reding. — Ce rapport paraît exact, répliqua Sheffield, car cela aurait eu lieu, au moins, voyons, il y a cinq ou six ans. — Oh ! continua Fusby, vous en verrez encore deux ou trois suivre Reding. — Eh bien, Fusby, dit Vincent, qui avait entendu par hasard et qui s’avança vers eux, vous ressemblez aux trois vieilles femmes de la Fiancée de Lammermoor qui voulaient soigner le cadavre du seigneur de Ravenswood. » Fusby s’inclina, mais ne répondit point. « Pas tous les trois à la fois, j’espère, reprit Sheffield. — Oh ! c’est tout à fait une concentration, une quintessence du sentiment protestant, répondit Vincent ; je me considère comme un bon Protestant ; mais le plaisir que vous avez à pourchasser ces messieurs est complétement sensuel, Fusby. » Le domestique du réfectoire entra en ce moment et annonça tout bas à Carlton qu’un étranger l’attendait chez lui.
« Quand pensez-vous que vos jeunes gens vous arrivent ? demanda Sheffield à Vincent. — Samedi prochain. — Ils viennent toujours tard, reprit le premier. — Oui, le collége de Christ-Church s’est ouvert la semaine dernière. — Celui de Saint-Michel s’est également ouvert, dit Sheffield : nous aussi, nous avons commencé nos cours. — Nous avons un motif pour commencer un peu plus tard ; plusieurs de nos étudiants viennent du Nord et de l’Irlande. — Ce n’est pas une raison, avec les chemins de fer. — J’apprends qu’on a commencé le nôtre, dit Vincent, je croyais que l’Université s’y opposait. — Le Pape a cédé, reprit Sheffield ; nous pouvons bien faire de même. — Ne me parlez pas du Pape, repartit Vincent ; j’en suis dégoûté, du Pape. — Le Pape ? demanda Fusby, qui venait de saisir ce mot, avez-vous entendu dire que sa sainteté vient en Angleterre ? — Oh ! oh ! s’écria Vincent, le Pape venir en Angleterre ! Je ne puis résister à cela, il faut que je parte. Bonsoir, Carlton : où est ma toge ? — Je crois que le domestique du réfectoire l’a appendue à la muraille dans le couloir ; mais vous devriez rester et me protéger contre Fusby. » Vincent ne l’écouta pas. Fusby, non plus, ne profita pas de l’avertissement ; de sorte que le pauvre Carlton, avec la certitude qu’on l’attendait chez lui, eut à soutenir une bonne demi-heure de tête-à-tête avec ce dernier, qui lui parlait in extenso du pape Grégoire XVI, des jésuites, des hommes suspects de l’Université, de Mède sur l’Apostasie, du relief Bill des Catholiques, du traité du docteur Pusey sur le Baptême, de la Justification, et de la nomination des professeurs de l’établissement Taylor.
A la fin, cependant, Carlton fut libre. Il traversa la cour à pas précipités, monta rapidement son escalier, ouvrit la porte avec empressement et se dirigea vers son salon. En ce moment, une personne se levait pour venir à sa rencontre : Impossible ! et pourtant c’était vrai. « Quoi ! Reding ! s’écria-t-il. Qui l’aurait cru ? Quel bonheur ! nous étions précisément… Quel vent vous amène ici ? » ajouta-t-il d’une voix émue ; puis, d’un ton grave : « Reding, où en êtes-vous ? — Pas encore Catholique », répondit Charles. Il y eut un moment de silence. Cette réponse disait beaucoup : c’était un soulagement, mais aussi un avis indirect. « Asseyez-vous, mon cher Reding ; désirez-vous prendre quelque chose ? Avez-vous dîné ? Quel plaisir de vous revoir, mon vieil ami ! Est-il donc vrai que nous allons vous perdre ? » Ils furent bientôt en conversation sur le grand sujet.
« Si votre résolution est prise, Reding, dit Carlton, il est inutile de parler de cela. Puissiez-vous trouver le bonheur quelque part que vous soyez ! Vous serez toujours vous-même ; oui, quoique Catholique Romain, vous serez toujours Charles Reding. — Je sais, Carlton, que j’ai en vous un ami dévoué et sympathique. Vous m’avez toujours écouté ; jamais je n’ai reçu de vous des paroles dures, à moins que je ne les méritasse. Vous me connaissez mieux que personne. Campbell a les plus aimables et les meilleures qualités de cœur. Bientôt il aura un titre de plus à mon affection ; car (je vous le confie sous le sceau du secret) il va épouser ma sœur. Il m’a souffert chez lui pendant ces deux dernières années ; jamais il n’a été dur envers moi ; au contraire, je l’ai toujours trouvé prêt quand j’ai eu besoin de causer avec lui. Et pourtant, Carlton, il n’a pas le talent d’ouvrir mon cœur comme vous. Parfois vos opinions ont différé des miennes, mais vous m’avez toujours compris. — Merci pour vos bonnes paroles, Charles ; mais, quant à moi, c’est un vrai mystère que votre séparation d’avec nous. J’entre dans vos raisons, et malgré cela je vous jure que je ne vois pas comment vous arrivez à une conclusion semblable. — Eh bien, quant à moi, Carlton, c’est aussi clair que deux et deux font quatre. Vous, au contraire, vous dites deux et deux font cinq, et vous vous étonnez ensuite que nous ne soyons pas d’accord. — Abandonnons ces choses à une puissance plus haute. J’espère, Reding, que nous ne serons pas moins amis, quand vous appartiendrez à une autre communion. Nous nous connaissons l’un l’autre ; les choses extérieures ne nous changeront pas. » Reding soupira ; il voyait clairement que sa conversion, lorsqu’elle serait un fait accompli, produirait sur Carlton les mêmes effets que sur ses autres amis. Il ne pouvait en être autrement : car lui-même était sûr d’avoir d’autres sentiments à l’égard de son ancien tuteur.
Quelques instants après, celui-ci reprit avec douceur : « Est-il donc tout à fait impossible, Reding, de vous retenir encore à la onzième heure ? Quels sont vos motifs ? — Ne discutons pas, mon cher Carlton ; j’en ai fini avec les arguments. Cependant, si je dois parler pour vous satisfaire, qu’il me suffise de vous dire que j’ai accompli vos désirs. Vous m’aviez engagé à lire les théologiens de l’Église Anglicane. Je les ai lus ; je leur ai même consacré beaucoup de temps, et maintenant je vais embrasser ce Symbole qui seul est le centre vers lequel ils convergent dans leur enseignement séparé ; le Symbole qui soutient la divinité de la tradition avec Laud, l’accord des Pères avec Beveridge, une Église visible avec Bramhall, un tribunal pour les décisions dogmatiques avec Bull, l’autorité du Pape avec Thorndike, la pénitence avec Taylor, les prières pour les morts avec Ussher ; le célibat, l’ascétisme et la discipline ecclésiastique avec Bingham. Je cherche l’Église qui, dans ces points comme dans une infinité d’autres, se rapproche le plus de l’Église Apostolique ; qui soit la continuation de cette Église des Apôtres, si toutefois celle-ci a été continuée. Or, en voyant que cette Église que je choisis est semblable à celle des Apôtres, je crois que réellement c’est la même. La raison a marché la première, la foi doit suivre. »
Il s’arrêta, et Carlton ne répliqua point ; il y eut un moment de silence. « Je vous le répète, reprit enfin Charles, il est inutile de discuter ; c’est une résolution prise après de longues et mûres réflexions. Je l’ai annoncée à ma mère, et je lui ai fait mes adieux. Tout est arrêté ; je ne puis revenir sur mes pas. — Est-ce là un bon sentiment ? répliqua Carlton d’un air de demi-reproche. — Comprenez-moi, répondit Charles ; j’en suis venu à cette résolution après y avoir gravement réfléchi. Elle est restée dans mon esprit à l’état de simple conclusion intellectuelle, pendant une ou deux années. Évidemment, à cette heure, je puis, sans encourir de blâme, changer cette conclusion en une résolution pratique. Mais nul d’entre nous ne peut assurer qu’au milieu du tourbillon du monde et des intérêts de toute espèce dont il sera assailli, il conservera toujours devant sa conscience ces convictions habituelles et déterminantes, d’après lesquelles c’est notre devoir d’agir. C’est pourquoi je dis que le temps des arguments est passé. J’agis d’après une conclusion déjà tirée. — Mais comment savez-vous, Charles, si vous n’avez pas été influencé à votre insu, pour arriver à ce résultat ? Une idée s’est emparée de vous, et vous n’avez pas été capable de la bannir. La seule preuve, la preuve nécessaire de la réalité de vos convictions serait, d’après moi, de vous les voir conserver au milieu des agitations de la vie. — Mais ces convictions ne me quittent point ; elles me dominent en tout temps et en tout lieu. — Oui, seulement, à certaines heures, comme vous l’avez avoué vous-même. Sans doute vous devez avoir une conviction profonde pour agir malgré les fâcheux effets causés par une démarche de ce genre. Considérez dans combien d’esprits vous jetez le trouble ; quel triomphe vous fournissez aux ennemis de toute religion ! quel encouragement à ceux qui pensent qu’il n’y a pas de vérité ! Songez combien vous affaiblissez notre Église ! Eh bien, d’après moi, il faut que vous ayez des convictions très-fortes pour aller en avant malgré tout cela. — Je reconnais, je soutiens, reprit Charles, que le seul motif suffisant pour justifier une telle démarche, c’est la conviction que le salut en dépend. Or, je vous parle avec sincérité, mon cher Carlton, en vous disant que je ne pense pas être sauvé si je reste dans l’Église d’Angleterre. — Voulez-vous dire que le salut n’est pas possible dans notre Église ? répliqua Carlton un peu froidement… — Non ; je ne parle que de moi-même ; ce n’est pas à moi de juger les autres. Je dis seulement : Dieu m’appelle, et je dois marcher au risque de mon âme. — Dieu vous appelle ! qu’est-ce que cela signifie ? Je n’aime pas ce langage ; c’est celui d’un dissident. — Vous n’ignorez pas que c’est le langage de l’Écriture. — Oui ; mais dans l’Écriture personne ne dit : Je suis appelé. La vocation est un acte du dehors, l’acte d’autrui, et non un sentiment intérieur. — Mais, mon cher Carlton, comment peut-on, à notre époque, arriver à la vérité, alors qu’il ne peut y avoir aucun appel du dehors ? — Dans ce cas, il me paraît que c’est un avertissement indirect, que nous devons rester où la Providence nous a fait naître. — Voilà précisément un des points de la doctrine de l’Église Anglicane que je ne puis bien comprendre. Mais pour combien d’autres sujets n’est-ce pas ainsi ? je vous le demande, Carlton : Les membres de l’Église d’Angleterre doivent-ils chercher la vérité, ou l’ont-ils reçue depuis le commencement ? La cherchent-ils eux-mêmes, ou la vérité leur est-elle transmise ? »
Carlton réfléchit un moment et parut hésiter ; il répondit ensuite que nous devions chercher la vérité. C’était une partie de nos épreuves morales que d’aller à cette recherche. « Dès lors ne me parlez pas de notre position, reprit Charles. Cette réponse, je l’attendais à peine de votre part ; mais c’est ce que la majorité des membres de l’Église d’Angleterre proclame. On nous dit de chercher, on nous donne des règles pour faire cette recherche, on nous fait exercer notre jugement privé ; mais arrivons-nous à une conclusion différente, on fait volte-face, et on nous parle de notre « position providentielle ». Il y a plus : Dites-moi, en supposant que nous devions tous chercher la vérité, croyez-vous que les membres de l’Église d’Angleterre la cherchent de la manière que l’Écriture l’ordonne ? Songez combien l’Écriture insiste sur la difficulté de trouver la vérité, sur le zèle à la chercher, sur le devoir d’en être altérés. Non, je ne puis croire que la masse du clergé anglais, la masse des résidents d’Oxford, chefs des établissements et Fellows des colléges (malgré leurs bonnes qualités, que je me plais à reconnaître), ait jamais cherché la vérité. Ils ont accepté ce qu’ils ont trouvé établi, et n’ont absolument pas exercé leur jugement privé ; ou s’ils en ont fait usage, ç’a été de la manière la plus vague et la plus superficielle. Admettons qu’ils aient consulté l’Écriture : dans quel but l’ont-ils fait ? seulement pour y trouver des preuves en faveur de ce qu’ils devaient souscrire, à l’époque où, étant sous-gradués, ils ont assisté au cours des Articles. Puis, après dîner, en prenant un verre de vin, ils parlent de tel ou tel ami qui s’est séparé de l’Église, et ils le condamnent ; bien plus (jetant un coup d’œil sur le journal placé sur la table), ils prétendent indiquer les motifs de sa conduite. Cependant, après tout, qui vraisemblablement doit avoir raison ? Est-ce cet homme qui a passé, peut-être, des années entières à la recherche de la vérité, qui constamment a demandé au ciel sa direction divine, et qui a pris tous les moyens en son pouvoir pour arriver à la lumière ? ou bien, sont-ce « les gentlemen de l’Angleterre qui restent tranquillement chez eux au sein de leur comfort ? » Non, non ; ils peuvent parler de la recherche de la vérité, du jugement privé, comme d’un devoir, mais ils n’ont jamais cherché, jamais ils n’ont exercé leur jugement. Ils restent là où ils sont, non parce que c’est la vérité, mais parce qu’ils s’y trouvent, parce que c’est « leur position providentielle », et position assez agréable par-dessus le marché. »
Reding s’était un peu animé, étant sous l’influence pénible de l’article de la Gazette. Mais, sans tenir compte de ce fait, il y avait dans sa situation assez de causes pour jeter son esprit hors de son état habituel. Il se trouvait dans la crise d’une épreuve particulière qu’il faut avoir sentie pour la comprendre : peu d’hommes vont de sang-froid à la bataille, ou se préparent avec calme à une opération chirurgicale. Carlton, d’autre part, était un homme doux et modéré qui ne prononçait pas une parole de vivacité une fois l’an. La conversation tomba. A la fin, Carlton reprit : « J’espère, Reding, que vous n’allez pas vous réunir à l’Église de Rome simplement parce qu’il y a des gens égoïstes et déraisonnables dans l’Église d’Angleterre. » Charles comprit qu’il ne se montrait pas à son avantage, et que, relativement aux motifs de sa conversion, il donnait lieu à des conjectures qu’il voulait détourner. « Il est triste, dit-il comme s’il se fût adressé un reproche, d’employer nos derniers instants en discussions. Pardonnez-moi, Carlton, si j’ai dit quelque chose de trop fort ou de trop vif. » Carlton le pensait ainsi ; il le croyait dans un état de surexcitation ; mais à quoi bon le lui dire ? Il se contenta de serrer affectueusement la main que Charles lui tendait, et il ne répondit pas.
Il dit ensuite brusquement et d’un ton sec : « Charles, connaissez-vous quelque catholique romain ? — Non ; je me trompe, je connais Willis ; mais je ne l’ai pas vu depuis deux ans. Ça été entièrement l’œuvre de mon esprit. » Carlton ne répliqua pas tout d’abord ; puis, d’un ton aussi sec et aussi brusque qu’auparavant : « Je pense donc, dit-il, que vous aurez beaucoup à souffrir quand vous connaîtrez ces gens-là. — Que voulez-vous dire ? — Vous verrez, je le crains, que ce sont des hommes sans éducation. — Que savez-vous sur leur compte ? — Je le soupçonne ainsi. — Mais qu’est-ce que cela fait à mon but ? — C’est une chose à laquelle vous devriez penser. Un ecclésiastique anglican est un gentleman ; vous pourrez avoir à souffrir plus que vous ne croyez, lorsque vous vivrez avec des hommes d’un esprit peu cultivé ou de manières communes. — Mon cher Carlton, ne parlez-vous pas de choses que vous ignorez complétement ? — Soit ; mais vous devriez y penser, vous devriez prendre la chose en considération. J’en juge par leurs lettres et leurs discours qu’on lit dans les journaux. » Charles réfléchit un moment : « Certainement, répondit-il ensuite, je n’aime pas bien des choses qui sont faites et dites par des catholiques romains ; mais tout cela, à mes yeux, n’est qu’une épreuve et une croix ; je ne vois pas comment ce fait touche à la grande question. — Non, si ce n’est que vous pourriez vous trouver comme un poisson hors de l’eau. Vous pourrez vous trouver dans une position où il vous sera impossible de vous entendre avec personne, où vous serez mis entièrement de côté. — Eh bien, reprit Charles, quant au fait, je l’ignore ; il peut arriver qu’il soit tel que vous le dites ; mais, pour moi, la valeur de votre preuve est presque nulle. Dans toutes les communions, la lie est à la surface. Ce qui me choque dans les actes publics des catholiques ne doit pas être la mesure, que dis-je ? ne peut être la mesure de l’esprit intérieur du Catholicisme. Je ne voudrais pas juger de l’Église Anglicane par Exeter-Hall, ni même d’après les mandements des évêques. Nous voyons l’intérieur de notre propre Église, et nous ne connaissons que l’extérieur de celle de Rome. La comparaison n’est pas équitable. — Mais voyez leurs livres de piété, continua Carlton, ils ne savent pas écrire en anglais. » Reding sourit, et secouant doucement la tête : « Ils écrivent l’anglais, je suppose, répondit-il, d’une manière aussi classique que saint Jean écrivait le grec. » Ici encore, la conversation fit une halte, et pendant quelques instants on n’entendit plus rien que le bouillonnement de la cafetière.
De la discussion ne devait sortir aucun bien, comme on pouvait en juger dès le principe. Chacun avait sa manière de voir, et cette vue particulière était le commencement et la fin de la controverse. Charles se leva. « Eh bien, mon cher Carlton, dit-il, il faut nous séparer ; il doit être près de onze heures. » Il tira de sa poche un petit livre, « l’Année chrétienne ». « Vous m’avez vu souvent ce volume entre les mains, continua-t-il ; acceptez-le en souvenir de moi. En mon absence, ce gage vous dira que je ne vous oublie point, mais que je pense toujours à vous. » Il s’arrêta très-ému. « Oh ! c’est très-dur de vous quitter tous pour aller vers des étrangers, reprit-il ; je ne le désirais pas, mais je ne puis m’en empêcher ; je suis appelé, j’y suis contraint. » Il s’arrêta encore ; les larmes coulaient le long de ses joues. « Ce n’est rien, dit-il en se remettant un peu, ce n’est rien ; mais elle est dure, cette heure : à peine un ami qui s’intéresse à moi ; des regards sombres, des paroles amères… Je me satisfais moi-même, en suivant ma propre volonté… Bien… » Et il se mit à regarder ses doigts et à se frotter doucement les mains. « Cela doit être, se dit-il tout bas à lui-même, il faut aller au royaume, à travers les tribulations, semer dans les larmes pour moissonner dans la joie. » Autre silence, et un nouveau cours de pensées se présenta : « Oh ! reprit-il, je crains tant, je crains si fort que vous tous qui n’allez pas en avant ne retourniez en arrière ! Vous ne pouvez rester fixes là où vous êtes. Pendant un temps vous croirez qu’il en est ainsi ; puis, vous nous ferez de l’opposition, et vous croirez encore que vous conservez votre terrain, parce que vous emploierez les mêmes mots qu’auparavant ; mais et votre croyance et vos opinions déclineront. Vous serez moins fermes. Viendra enfin un jour où ceci vous frappera : c’est que, tout en différant des Protestants, vous discutez seulement sur des mots. On nous appelle Rationalistes ; prenez garde de tomber dans le Libéralisme. Et maintenant, mon cher Carlton, vous, le seul de mes amis d’Oxford qui se soit montré patient et affectueux envers moi, adieu. Puissions-nous nous retrouver bientôt dans la paix et dans la joie ! Je ne puis aller à vous ; il faut que vous veniez à moi. » Ils s’embrassèrent avec affection. Une minute après, Charles descendait l’escalier en courant.
Charles se coucha avec un violent mal de tête. A son réveil, il souffrait encore plus fort. Il ne lui restait plus rien à faire qu’à demander sa note et à partir pour Londres. Il ne put cependant quitter Oxford sans dire un dernier adieu à cette ville chérie. Il se leva vers sept heures, et tandis que les étudiants sortaient de leurs chambres et se rendaient à leurs chapelles respectives, il fit un tour à Magdalen Walk et à Christ Church Meadow. Quelque part qu’il allât, il ne pouvait rencontrer personne, ou, du moins, peu de monde. Les arbres de Water-Walk étaient diaprés des mille couleurs de la saison et formaient des berceaux sur sa tête, tout en l’abritant sur le côté. Il atteignit Addison’s Walk, promenade qu’il avait vue, la première fois, avec son père, à son arrivée à l’Université, six années auparavant, jour pour jour. Il continua sa course plus loin encore, jusqu’à ce qu’il arrivât en vue de la belle tour[73], qui enfin se dressa majestueusement au-dessus de sa tête. La matinée était froide, et une légère couche de gelée couvrait le sol : les feuilles voltigeaient çà et là ; tout était en harmonie avec ses sentiments. Étant rentré dans les bâtiments monastiques, il ne rencontra que des servants avec des baquets de cendres, et des vieilles femmes qui emportaient les restes de la cuisine. Il traversa le Meadow et se dirigea vers le confluent du Cherwell et de l’Ists ; puis il revint sur ses pas. Une pensée traverse son esprit ! Hélas ! c’est pour la dernière fois !!! Personne ne pouvait le voir ; il jeta ses bras autour des saules qu’il affectionnait tant et les baisa. Ayant ensuite arraché quelques-unes de leurs feuilles noires, il les mit dans sa poitrine. « Je suis comme Ondine, dit-il, qui tue avec un baiser. Nul ne s’intéresse à moi ; à peine une personne qui me connaisse[74]. » Il se rapprocha encore de Long Walk. Soudain, en jetant les yeux dans cette allée, il vit une toque et une toge ; il regarda avec anxiété : c’était Jennings, il n’y avait pas à s’y tromper, et le Vice-Principal se dirigeait vers lui. Charles avait toujours eu de l’estime pour Jennings, malgré sa sévérité, mais il n’aurait pas voulu le rencontrer pour tout au monde. Que faire ? Il se mit derrière un gros orme et le laissa passer, puis il s’éloigna d’un pas rapide. Quand il eut gagné un peu de terrain, il se hasarda à tourner la tête ; mais, par cette espèce de fatalité ou de sympathie qui est si commune en pareil cas, il vit en même temps Jennings qui se tournait aussi vers lui. Charles pressa sa marche et se retrouva bientôt à son hôtel.
[73] La tour du collége de la Madeleine.
[74] Pour comprendre cette scène, il faut avoir visité Oxford. Sans être anglais, on sent que l’atmosphère de cette ville, au parfum antique et religieux, est faite pour pénétrer l’âme d’une profonde impression magique qui ne saurait jamais plus s’effacer. « Il faut plaindre l’Anglais dont la jeunesse se passe loin d’un tel séjour. Il faudrait plaindre surtout celui qui, après y avoir vécu, se souviendrait, sans émotion, de ces voûtes, de ces cloîtres, de ces ombrages, de ces chants religieux. » (Comte de Montalembert, De l’avenir politique de l’Angleterre.) — Nous avons vu nous-même un converti, ex-fellow de l’un des plus beaux colléges de l’Université, laisser couler de grosses larmes sur son visage mâle, à la lecture de la scène que le lecteur a maintenant sous les yeux. Ces larmes en disaient plus que de longs livres et sur le charme irrésistible d’Oxford, et sur le sublime sacrifice de ces hommes généreux qui, pour répondre au cri de la conscience, n’ont pas craint de s’arracher à tout ce qu’ils admirèrent et aimèrent aux beaux jours de leur jeunesse.
Chose étonnante ! quoique Charles eût aussi bien réussi que Carlton, dans « le rude assaut de leurs intelligences », la veille au soir, néanmoins cet entretien avait produit un certain malaise dans son esprit. Le temps de l’action était venu ; l’argument était passé, comme il le disait lui-même ; et revenir à la discussion c’était seulement obscurcir la claire perception qu’il avait de la vérité. Il commença à se demander si réellement il avait assez de motifs clairs et puissants pour faire la démarche qu’il allait accomplir, et la pensée lui vint qu’il perdrait le monde d’ici-bas sans gagner le monde futur. Évidemment, Carlton le croyait dans un état de surexcitation ; et si c’était vrai ! Peut-être, après tout, ses convictions étaient-elles un rêve ; sur quoi reposaient-elles ? Il essaya, mais en vain, de se rappeler ses meilleures raisons. Qui sait ? ce qu’on appelle la vérité, est-ce quelque chose de réel ? Une chose n’est-elle pas aussi bonne qu’une autre ? Dans tous les cas, n’aurait-il pas pu bien servir Dieu dans la famille où il avait été placé par sa naissance ? Il se rappela quelques lignes des Éthiques d’Aristote, empruntées par le philosophe à un poëte ancien, dans lesquelles le pauvre Philoctète, abandonné, déplore le stupide empressement officieux, comme il l’appelle, qui a été la cause de ses infortunes. Charles se demandait s’il ne s’était pas trop occupé, lui aussi, de ce qui ne le regardait point. Ne pouvait-il pas laisser les choses comme elles étaient ? Des hommes meilleurs que lui avaient vécu et étaient morts dans le sein de l’Église d’Angleterre. Et puis d’ailleurs, si, comme Campbell le lui avait dit, ses prétendues convictions s’évanouissaient au moment qu’il s’unirait à l’Église Romaine, ainsi que déjà cela lui était arrivé à la mort de son père ? Il commença à porter envie à Sheffield. Tout avait bien tourné pour son ami : un brillant succès dans son examen, une place de fellow ; et cela simplement parce qu’il avait pris les choses comme elles se présentaient, et qu’il n’avait pas couru après des visions. Charles se sentit violemment tenté, mais il ne fut ni abandonné ni vaincu. Son bon sens, disons mieux, son bon ange vint à son secours. Évidemment il n’était pas en état d’argumenter ni de juger à cette heure. Des conclusions pesées pendant plusieurs années ne devaient pas être mises à néant par les pensées d’un instant de trouble. Faisant donc un effort sur lui-même pour rejeter toutes ces préoccupations, il ne songea plus qu’à son voyage.
Comment il arriva à Steventon, il aurait eu de la peine à le dire. Mais peu à peu il se remit, et il se trouva dans une voiture de première classe sur le chemin de fer du Great-Western, s’avançant rapidement vers Londres. Il regarda autour de lui pour reconnaître ses compagnons de voyage. Le compartiment de devant était plein de voyageurs qui paraissaient former une seule société, causant ensemble avec beaucoup de volubilité et d’entrain. Des trois siéges du compartiment où il se trouvait, un seul, en face de lui ; était occupé. En considérant l’étranger, il vit que c’était un homme grave, atteignant ou ayant passé l’âge mûr. Sa figure avait cette expression fatiguée ou plutôt tourmentée que même une légère souffrance physique, si elle est habituelle, donne à tous les traits, et ses yeux étaient pâles, probablement par suite de longues études. Charles crut qu’il avait déjà vu cette figure, mais il ne put se rappeler en quel lieu ni à quelle époque. Ce qui l’intéressa davantage, ce fut le costume de l’inconnu, dont il avait rarement vu le pareil dans ses voyages. Ce costume avait un cachet étranger. Cela, joint à un petit livre d’offices que le voyageur tenait dans ses mains, fit comprendre à notre jeune ami qu’il était en présence d’un ecclésiastique romain. Son cœur commença à battre, et il fut tenté de quitter son siége ; il se sentit malade et près de s’évanouir. Peu à peu, il devint plus calme, et il voyagea quelque temps en silence, désirant et craignant toutefois de prendre la parole. A la fin, dans un moment d’arrêt à une station, il adressa quelques mots en français à l’étranger. Celui-ci parut surpris, il sourit, et d’une voix hésitante et un peu mélancolique répondit qu’il était Anglais. Charles s’excusa assez gauchement, et il y eut un nouveau silence. Parfois leurs yeux se rencontraient, et puis ils les détournaient lentement l’un de l’autre, comme deux personnes qui tâchent de se reconnaître. Mais l’étranger crut qu’il avait interrompu trop brusquement la conversation, et après quelques paroles vagues pour la rouvrir : « Probablement, monsieur, dit-il, je vous reconnais mieux que vous ne pouvez me reconnaître moi-même. A votre air, vous êtes un étudiant d’Oxford. » Charles en convint. « Bachelier ? » Il était tout près de passer maître. Son compagnon de voyage, qui n’était pas en veine de causer, continua à lui adresser différentes questions de politesse sur l’Université : « Quels colléges nomment les censeurs cette année ? Les professeurs de l’établissement Taylor sont-ils choisis ? Sont-ce des membres de l’Église d’Angleterre ? Le nouvel évêque de Bury a-t-il conservé son rang de Principal ? etc., etc. » Après ces questions, la conversation roula sur des lieux communs qui n’aboutirent à rien. Charles avait tant de choses à demander ! Mille pensées s’agitaient en lui ; son esprit en était plein. Là, en sa présence, se trouvait un prêtre catholique prêt à pourvoir aux besoins de son âme, et cependant cette occasion allait probablement passer sans résultat aucun. Après une ou deux tentatives infructueuses, il abandonna la partie et se rejeta dans son coin. Son compagnon de voyage commença, aussi tranquillement qu’il le put, à dire son office. Le temps s’écoulait ; déjà plusieurs stations avaient été franchies, et le convoi s’approchait de Londres. Cependant, l’ecclésiastique avait terminé son bréviaire, et son livre avait disparu dans une de ses poches.
Un moment après, Charles demanda tout à coup : « Comment avez-vous supposé que je suis un étudiant d’Oxford ? — Non pas précisément par votre air ni par vos manières, mais je vous ai vu descendre de l’omnibus à Steventon, et avec ce renseignement il est impossible de s’y méprendre. — J’ai entendu d’autres personnes dire la même chose ; cependant, je ne puis m’expliquer à quoi un étudiant d’Oxford peut se reconnaître. — Pas seulement les étudiants d’Oxford, mais ceux de Cambridge même se laissent deviner à leurs manières. Soldats, légistes, bénéficiers, chaque classe porte des indications extérieures auxquelles on peut la reconnaître. — Je sais des personnes qui croient que l’écriture indique la profession et le caractère. — Je n’en doute pas. La démarche est une autre indication ; mais tout le monde ne peut pas comprendre un langage si caché. Cependant, c’est un langage aussi réel que des hiéroglyphes sur un obélisque. — C’est une pensée terrible, dit Charles en soupirant, que nous nous manifestions, pour ainsi dire, chaque fois que nous respirons. » L’étranger en convint. « L’être moral de l’homme, dit-il, est concentré dans chaque instant de sa vie ; cet être moral se trahit depuis le bout des doigts jusqu’à la pointe des pieds. Peu de chose suffit pour indiquer ce qu’est un homme. »
« Je pense que je parle à un prêtre catholique ? » reprit Charles. Ayant obtenu une réponse affirmative, il demanda, avec une sorte d’hésitation, si ce qu’ils avaient dit ne démontrait pas l’importance de la foi. « De prime abord, continua-t-il, on ne voit pas comment il est rationnel de soutenir qu’il est si important d’admettre telle ou telle doctrine, d’en avoir un peu plus ou un peu moins, à moins que ce ne soit comme critérium du cœur. » La physionomie de son compagnon s’éclaircit. Il fit observer pourtant, que la foi ne se mesure pas par « le plus ou le moins » ; que, ou nous croyons toute la parole révélée, ou réellement nous n’en croyons aucune partie ; que nous devons croire sur la parole de l’Église ce que l’Église nous propose. « Mais assurément, répliqua Charles, les soi-disant Évangéliques croient plus que les Unitaires, et les ecclésiastiques de la Haute Église plus que les Évangéliques. — La question, reprit son compagnon de voyage, est de savoir si l’on soumet sa raison, implicitement, à ce qu’on a reçu comme la parole de Dieu. » Charles en convint. « Voudriez-vous donc dire, continua le prêtre, que l’Unitaire croit réellement comme la parole de Dieu tout ce qu’il professe accepter, alors qu’il ne tient aucun compte de tant de choses qui se trouvent dans cette parole sacrée et qu’il les rejette ? — Certainement, non. — Et pourquoi ? — Parce qu’il est évident que, pour l’Unitaire, le dernier régulateur de la vérité est, non pas l’Écriture, mais, à son insu, quelque vue particulière de son esprit dont il fait la mesure du livre divin. — Dès lors il se croit lui-même, si l’expression est permise, dit le prêtre, et il ne croit pas la parole extérieure de Dieu. — Sans doute. — Eh bien, pareillement, continua-t-il, pensez-vous qu’une personne ait une foi réelle en ce qu’elle regarde comme la parole de Dieu, si elle néglige, sans essayer de les comprendre, des passages tels que ceux-ci : « L’Église, colonne et soutien de la vérité » ; « Celui à qui vous pardonnerez les péchés, ils lui seront pardonnés » ; « Si quelqu’un est malade, qu’il appelle les prêtres de l’Église, et qu’ils l’oignent d’huile » ? — Oui, repartit Charles ; mais dans le fait, nous ne professons pas d’avoir foi seulement au texte de l’Écriture. Vous savez, monsieur, ajouta-t-il en hésitant, que d’après la doctrine anglicane nous interprétons l’Écriture par l’Église. C’est pourquoi nous avons foi, comme les catholiques, non simplement dans l’Écriture, mais dans toute la parole confiée à l’Église, parole dont l’Écriture elle-même fait partie. » Son compagnon sourit. « Combien y en a-t-il qui professent cette doctrine ? demanda-t-il. Mais n’insistons pas sur cette question. Je comprends la pensée d’un catholique lorsqu’il dit qu’il se guide par la voix de l’Église. Cela signifie pratiquement, par la voix du premier prêtre qu’il rencontre. En matière de doctrine, il a foi à la parole de tout prêtre. Mais quelle est-elle ? où est-elle cette « parole » de l’Église, dans laquelle croient les personnes dont vous parlez ? Quand exercent-elles leur croyance ? Bien loin que tous les anglicans s’accordent ensemble sur la foi, n’est-ce pas un fait incontestable que ce que l’un affirme, l’autre le nie ? Ainsi, un anglican, alors même qu’il le voudrait, ne peut avoir foi dans ses ministres, et nécessairement, bon gré mal gré, il fait un choix parmi eux. Comment donc la foi a-t-elle place dans la religion d’un anglican ? — Eh bien, répondit Charles, je vous assure, monsieur, que j’ai vu beaucoup de personnes (et, si vous connaissiez l’Église d’Angleterre comme moi, il ne serait pas nécessaire de vous le dire) qui, d’après la science qu’elles possèdent des Évangiles, ont une conviction absolue et le sentiment intime de la réalité des faits sacrés qui y sont contenus. Appelez cette conviction la foi, ou donnez-lui un autre nom, il n’en est pas moins vrai qu’elle est assez puissante pour influencer toute leur vie, régler leur cœur et diriger leur conduite aussi bien que leur imagination. Je ne puis croire que ces personnes soient déshéritées de la faveur de Dieu, cependant, d’après vous, elles n’ont pas la foi. — Pensez-vous que ces personnes croient et pratiquent tout ce qui leur est rapporté comme étant dans l’Écriture ? demanda le prêtre. — Sans doute, répondit Charles, autant qu’un homme puisse en juger. — Alors, peut-être, pratiquent-elles la vertu de foi. S’il y a des passages de l’Écriture auxquels elles demeurent insensibles, comme par rapport aux Sacrements, à la Pénitence, à l’Extrême-Onction, au siége de Pierre, je devrais charitablement penser que ces passages n’ont jamais été offerts ni développés à leur esprit et à leur conscience ; de même qu’il peut arriver qu’une bulle du Pape reste inconnue pendant quelque temps à une contrée lointaine de l’Église. Elles peuvent être dans une ignorance involontaire[75]. Cependant je crains qu’en prenant la nation en masse, il ne s’en trouve bien peu de ce genre. » Charles répliqua que cette réponse ne résolvait pas pleinement la difficulté. La foi, dans la position de ces personnes, n’est pas du moins la foi dans la parole de l’Église. Son compagnon de voyage ne voulut pas en convenir, il dit que ces personnes reçoivent l’Écriture Sainte sur le témoignage de l’Église, et qu’au moins elles croient la parole de Dieu et ce qui s’ensuit.
[75] Errantes invincibiliter circa aliquos articulos, et credentes alios, non sunt formaliter hæretici, sed habent fidem supernaturalem, quâ credunt veros articulos, atque adeo ex eâ possunt procedere actus perfectæ contritionis, quibus justificentur et salventur. — De Lugo, de Fide, p. 169.
« C’est pour moi un grand mystère, reprit Charles, que le retour à la vraie foi de tout le peuple anglais, en tant que nation. Les preuves en faveur de la foi sont-elles assez évidentes ? » Son nouvel ami parut surpris et assez peu satisfait. « Sans doute, répondit-il. En fait, un homme peut avoir plus de preuves pour croire à la mission divine de l’Église qu’il n’en a pour croire à la divinité des quatre Évangiles. Si donc, il croit déjà à ces livres sacrés, pourquoi ne croirait-il pas à l’Église ? — Mais la croyance aux Évangiles est une croyance traditionnelle, répliqua Charles ; cela fait toute la différence. Je ne vois pas comment une nation telle que l’Angleterre, qui a perdu la foi, peut jamais la recouvrer ; car, en matière de conversion, la Providence n’a généralement visité que des nations simples et barbares. — Les convertis du peuple romain formaient, je suppose, une grande exception. — Néanmoins, cela me paraît une immense difficulté. Je ne vois pas comment, lorsque l’édifice dogmatique a été renversé, on peut le rebâtir de nouveau. Il me semble qu’il y a dans la Révolution française de Carlyle un passage qui va à notre sujet. L’auteur déplore la folie des hommes qui détruisaient ce qu’ils ne pouvaient rétablir, ce qui demanderait des siècles et une combinaison de circonstances heureuses pour se réédifier, en un mot, un symbole extérieur reçu de tous. Je ne nie pas, Dieu m’en préserve ! l’objectivité de la Révélation, ni ce dicton, que la foi est une espèce d’illusion heureuse et utile ; mais, vraiment, l’évidence de la doctrine révélée est tellement établie sur des probabilités que je ne vois pas ce qui doit l’introduire dans une société civilisée, où la raison a été cultivée au plus haut point, et où la discussion est la pierre de touche de la vérité. Bien des hommes disent : « Oh ! que je voudrais avoir reçu une éducation catholique ! » mais, cette éducation, ils ne l’ont pas eue ; et ils se trouvent incapables de croire, malgré leur bon désir, parce que l’évidence n’est pas assez grande à leurs yeux pour soumettre leur raison. Qu’est-ce qui doit les faire croire ? » Depuis quelque temps son compagnon de voyage donnait des signes de déplaisir. Lorsque Charles s’arrêta, le prêtre se contenta de dire brièvement, mais avec calme : « Ce qui doit les faire croire ? la volonté, leur volonté. »
Reding hésitait. Le prêtre continua : « S’il y a assez de preuves pour croire à l’Écriture, et nous voyons, je le répète, que c’est ainsi, il y en a également plus qu’il ne faut pour croire à l’Église. L’évidence ne manque pas. Tout ce qu’elle réclame, c’est d’être présentée à l’esprit ou de s’y imprimer. Si, donc, la croyance ne suit pas, la faute en est à la volonté. — Eh bien, dit Charles, je pense qu’il y a un sentiment général parmi les anglicans instruits, que les droits de l’Église Romaine ne reposent pas sur une base suffisamment intellectuelle ; que les preuves, ou notes, étaient assez bonnes pour un siècle grossier, mais non pas pour le siècle des lumières. C’est ce qui me fait désespérer du progrès du Catholicisme. » Son compagnon le regarda avec curiosité, et lui dit tranquillement : « Sachez-le, il y a assez d’évidence pour une conviction morale que l’Église Catholique ou Romaine, et nulle autre, est la voix de Dieu. — Voulez-vous dire, reprit Charles, dont le cœur battait avec violence, qu’avant la conversion un homme ne peut arriver à une conviction présente, inébranlable, actuelle de cette vérité ? — Je ne sais, répondit le prêtre ; mais, au moins, il peut avoir une certitude morale habituelle, c’est-à-dire une conviction et une seule, une conviction ferme, sans rivale, ou même sans doute raisonnable, qui se présente à lui dans ses heures de solitude alors qu’il est le plus calme : et qui, dans le tumulte du monde, lui apparaît, de temps en temps, comme à travers des nuages ; une conviction ainsi formulée : « L’Église Catholique Romaine est la seule et unique voix de Dieu, le seul et unique chemin du salut. » — Alors vous pensez, dit Charles avec une émotion croissante, que cet homme n’est pas obligé d’attendre de plus éclatantes lumières ? — Il n’en aura pas, il ne peut en attendre d’autres avant sa conversion. La certitude, dans son sens le plus élevé, est la récompense de ceux qui, par un acte de leur volonté, embrassent la vérité, lorsque la nature recule lâchement. Il faut se hasarder. La foi est une chance à courir avant qu’on soit catholique ; c’est une grâce ensuite. On s’approche de l’Église par la voie de la raison, on y vit dans la lumière de l’Esprit. »
Charles exprima la crainte que bien des hommes excellents et fort instruits ne fussent tentés de trouver en défaut l’évidence du Catholicisme et de cesser toutes recherches, sur ce prétexte qu’il y a des arguments de part et d’autre. « Ce n’est pas une certaine catégorie d’hommes, répondit le prêtre, ce sont tous les Anglais qui donnent dans ce fâcheux travers. Les Anglais sont heureusement doués sous bien des rapports, mais ils n’ont pas la foi. D’autres nations, qui leur sont inférieures à beaucoup d’égards, ont cette foi. Cependant rien ne peut la remplacer : ni le sentiment de la beauté, de la majesté, ou de l’antiquité du Catholicisme ; ni l’appréciation de sa miséricorde envers les pécheurs ; ni l’admiration pour les martyrs ; ni l’estime pour les anciens Pères et pour leurs écrits. Quelques individus peuvent avoir des mœurs douces et aimables, ou un esprit de droiture qui mérite notre respect ; cependant, jusqu’à ce qu’ils aient la foi, ils n’ont pas de fondement, et leur édifice s’écroulera. Ils ne seront pas bénis, ils ne feront rien en matière religieuse, jusqu’à ce qu’ils commencent à croire sans réserve à la parole de Dieu, quelle qu’elle soit ; jusqu’à ce qu’ils se renoncent eux-mêmes ; jusqu’à ce qu’ils cessent de faire de quelqu’une de leurs idées leur propre symbole ; jusqu’à ce qu’ils obligent leur volonté à perfectionner ce qui pour leur raison peut être suffisant, mais reste néanmoins incomplet. Et lorsqu’ils reconnaîtront cette lacune en eux, et qu’ils tâcheront d’y remédier, alors ils verront beaucoup plus loin, ils seront bientôt sur la route du Catholicisme. »
Dans tout cela, il n’y avait rien de bien nouveau pour Charles ; mais il était heureux de l’apprendre de la bouche d’un autre, et surtout d’un prêtre. Il avait donc trouvé de la sympathie et une autorité : il se sentit rendu à lui-même. La conversation s’arrêta. Un moment après, il confia à son nouvel ami le motif qui le conduisait à Londres. Cette déclaration, après ce que Charles avait déjà dit, ne pouvait beaucoup surprendre son compagnon de voyage. Celui-ci connaissait le supérieur de San Michaele, et donnant sa carte à Reding, il y écrivit quelques paroles pour lui servir d’introduction auprès du bon père. Cependant ils avaient atteint Paddington, et avant que le convoi fût complétement arrêté, le prêtre, ayant pris son sac de nuit de dessous son siége et s’étant enveloppé d’un manteau, était sorti de voiture et s’éloignait d’un pas rapide.
Charles désirait naturellement accomplir son importante démarche avec tout le calme possible ; et il avait pris, à son avis du moins, les mesures les plus convenables pour atteindre ce but. Mais de semblables combinaisons tournent souvent d’une manière bien différente de ce que l’on avait espéré. C’est ce qui arriva à notre jeune ami.
Le couvent dès Passionnistes était situé à l’est de Londres ; jusque là, c’était bien. Or, Charles connaissait dans le voisinage un honnête éditeur de publications religieuses avec lequel son père avait eu des relations, et il lui avait écrit pour retenir une chambre dans sa maison. Il voulait y passer le peu de jours qu’il croyait devoir lui suffire pour préparer sa réception. Ce qui lui adviendrait ensuite, il le laissait à la sagesse de ceux entre les mains desquels il allait se trouver. C’était le mercredi ; il comptait avoir deux jours pour se disposer à la confession et se présenter ensuite à ceux qui devaient recevoir son abjuration. Le meilleur plan eût été de se rendre directement à la maison des religieux, où sans doute les bons Pères, en le logeant, l’auraient mis à l’abri de toute importunité, et lui auraient donné les avis les plus sages sur ce qu’il avait à faire. Mais nous devons lui pardonner si, en accomplissant un si grand acte, il aime à le faire à sa façon, et nous ne devons pas être sévères à son égard, quoiqu’il n’ait pas choisi la meilleure voie.
En arrivant à sa destination, Charles vit au maintien de son hôte que non-seulement sa venue était attendue, mais qu’on en comprenait aussi le motif. Probablement l’article de la Gazette d’Oxford avait été copié par les journaux de Londres. Autre contre-temps, qui ne servit pas peu à augmenter désagréablement sa surprise. En se rendant à sa chambre, il vit que le digne libraire avait un cabinet de lecture attenant à sa boutique, voisinage bien plus dangereux pour sa retraite qu’une salle de café. Il ne fut cependant pas obligé de se mêler aux différentes sociétés qui paraissaient fréquenter ce lieu, et il résolut autant que possible de ne pas sortir de sa chambre. Le reste de la journée, il l’employa à écrire à ses amis. Sa conversation du matin l’avait tranquillisé. Il se coucha calme et heureux, dormit profondément, se leva tard, et, dispos d’esprit et de corps, il tourna ses pensées vers les devoirs sérieux de la journée.
Le déjeuner fini, il consacra un temps assez long à des exercices pieux ; puis, ouvrant son pupitre, il se mit au travail. Il commençait à peine, lorsque se présenta le propriétaire de la maison, lequel, après beaucoup d’excuses sur son importunité, et des protestations qu’il ne voulait pas être indiscret, s’aventura à demander si M. Reding était catholique. La question lui avait été posée à lui-même, et il pensait qu’il pouvait solliciter une réponse de la personne la plus capable de fournir un renseignement authentique. Pour Charles, une pareille interruption était désagréable en soi, et embarrassante par la forme dans laquelle la demande avait été faite. Dire qu’il était sur le point de se faire catholique aurait été absurde ; aussi répondit-il négativement d’un ton bref. M. Mumford lui apprit ensuite que deux de ses amis désiraient s’entretenir quelques instants avec M. Reding. Charles ne pouvait faire d’objection à cette requête : il n’eût pas été compris ; et un moment après, on frappa à la porte de sa chambre[76].
[76] Après avoir consacré les précédents chapitres à réfuter l’Église Anglicane et les principales sectes qui ont eu quelque rapport avec le mouvement qu’il décrit, le R. P. Newman a voulu, avant de finir, montrer en peu de mots l’absurdité de certaines opinions, plus ou moins importantes, qui ont aussi leurs partisans en Angleterre. De là cette espèce de mise en scène de divers personnages qui viennent successivement passer devant les yeux du lecteur. Leur accorder une plus large place dans son ouvrage, eût paru à l’auteur leur faire un trop grand honneur. Quant aux importunités dont Charles est la malheureuse victime, à la veille de son abjuration, elles ne sont, croyons-nous, que trop réelles ; et plus d’un converti pourrait nous apprendre là-dessus des choses fort curieuses.
« Entrez », dit-il, et deux individus se présentèrent, tous les deux lui paraissant inconnus. Cette circonstance fut pour lui une espèce de soulagement ; car des craintes vagues et des soupçons avaient commencé à traverser son esprit relativement aux visages qu’il allait voir. Le plus jeune des deux visiteurs, aux joues arrondies, au nez retroussé vers l’œil droit, et à la voix perçante, s’avança avec assurance ; il semblait espérer d’être reconnu. Charles se souvint de l’avoir vu jadis, mais en quel lieu, il ne pouvait se le rappeler. « Je crois vous avoir vu quelque part, dit-il. — Oui, monsieur Reding, répondit l’individu à qui ces paroles s’adressaient, vous devez vous souvenir de m’avoir vu au collége. — Ah ! je me souviens ; vous êtes Jack, le marmiton de Saint-Sauveur. — Précisément, monsieur. Je vins au collége lorsque le jeune Tom obtint la place de Dennis. » Et puis avec un signe de tête solennel, notre jeune interlocuteur ajouta : « Moi aussi, j’ai obtenu de l’avancement. — Il me le semble, Jack ; mais que faites-vous ? — Ah ! monsieur, répondit l’ancien marmiton, nous ne devons parler sur ce sujet qu’avec beaucoup de gravité. » Et il ajouta d’une voix complétement inarticulée, ses lèvres ne paraissant pas vouloir se réunir : « Monsieur, en ce moment, je suis presque un ange. — Quoi ! un ange ? s’écria Charles ; oh ! je sais ; il s’agit de quelque secte, des Sandemaniens. — Les Sandemaniens, reprit Jack, nous les avons en abomination. Ce sont des niveleurs ; ils apportent avec eux le désordre et toute espèce de mauvaises œuvres. — Pardon, mais il s’agit d’une secte, quoique je ne me rappelle pas laquelle. J’en ai entendu parler. Eh bien, dites-moi, Jack, qu’êtes-vous ? — Je suis, répondit Jack, comme s’il se fût confessé au tribunal du Propréteur, je suis membre de la sainte Église Catholique. — Bien, Jack, mais ce n’est pas assez clair. Nous en sommes tous, de cette Église ; tout le monde en dit autant. — Écoutez-moi jusqu’au bout, monsieur Reding, reprit Jack en agitant sa main ; écoutez-moi, monsieur, et puis frappez. Je vous le répète, je suis membre de la sainte Église Catholique qui se réunit à Huggermugger Lane. — Ah ! je vois ; c’est le nom que les « Dieux » vous donnent, mais que font les hommes ? — Les hommes, répondit Jack, sans comprendre toutefois l’allusion, les hommes nous appellent des Chrétiens, professant les opinions de feu le révérend Edward Irving, bachelier en théologie. — Maintenant je vous comprends très-bien : vous êtes des Irvingites ; je me rappelle. — Non, monsieur, pas des Irvingites ; nous n’acceptons aucun homme pour guide ; nous allons partout où nous mène l’Esprit ; nous avons renoncé au don des langues. Mais je dois vous présenter mon ami, qui est plus qu’un ange, ajouta-t-il avec modestie, qui possède plus que la parole des hommes et des anges, puisqu’il n’est rien moins qu’un apôtre. Monsieur Reding, voici le révérend Alexandre Highfly ; monsieur Highfly, M. Reding[77]. »
[77] L’exposé des doctrines, fait ici par Jack et M. Highfly, est bien le résumé des opinions des Irvingites, secte qui s’appelle emphatiquement : L’Église catholique et apostolique. Il est probable cependant que les Irvingites, dernière expression du Méthodisme, ont subi encore des modifications ; et c’est sans doute pour cela que l’auteur fait dire à Jack qu’ils ont renoncé au don des langues. Car, dans le principe, les partisans d’Irving tenaient beaucoup à ce grand privilége, de parler subito, sous l’impulsion irrésistible de l’Esprit, une langue inconnue. On aura, enfin, compris tout ce qu’il y avait de ridicule et de scandaleux dans toutes ces extases, convulsions et inspirations désordonnées.
M. Highfly était un homme aux manières et à l’air distingués. Son langage était raffiné, et ses procédés délicats. Aussi Charles, en lui parlant, changea de ton tout de suite. Il venait, dit tout d’abord M. Highfly, trouver M. Reding par un sentiment de devoir ; et il n’y eut rien dans sa conversation qui ne s’accordât avec cette déclaration. Il lui exposa qu’il avait entendu dire que M. Reding n’était pas fixé sur ses vues religieuses, et il n’avait pas voulu perdre l’opportunité de rattacher un homme d’un aussi grand mérite à la cause à laquelle il s’était dévoué lui-même. « Je vois, répondit Charles en souriant, que je suis sur la place. — C’est le marché de Glaucus et de Diomède, répliqua M. Highfly, puisque je vous demande votre coopération. Je vous range dans la société des Apôtres. — Je me souviens, dit Charles. C’est un des caractères de votre corps, d’avoir un ordre d’Apôtres outre les évêques, les prêtres et les diacres. — Ou plutôt, reprit le gentleman, c’est notre trait spécialement caractéristique ; car nous admettons les ordres de l’Église d’Angleterre. Nous ne faisons que compléter le système de l’Église, en rétablissant le Collége des Apôtres. — Ce que je vous reprocherais, dit Charles, si j’étais porté le moins du monde à écouter vos réclamations, ce seraient les vues très-différentes que les différents membres de votre corps mettent en avant. — Il faut vous rappeler, reprit M. Highfly, que nous sommes sous un enseignement divin, et que la vérité n’est communiquée à l’Église que graduellement. Nous ne garantissons pas quelle sera demain notre croyance par celle que nous soutenons aujourd’hui. — Certainement, répliqua Charles, il m’a été dit par vos maîtres des choses que je dois regarder comme de simples opinions privées, quoiqu’elles me paraissaient avoir un plus haut caractère. — Je disais donc, reprit M. Highfly, qu’en ce moment nous rétablissons l’Apostolat des Gentils. L’Église d’Angleterre a des évêques, des prêtres et des diacres, mais l’Église, d’après l’Écriture, à davantage : il est clair qu’elle doit avoir des Apôtres. Or, d’après ce livre divin les Apôtres exerçaient la suprême autorité, et les trois ordres anglicans leur étaient inférieurs. — Je suis disposé à être d’accord avec vous sur ce point, dit Charles. — M. Highfly parut surpris et satisfait. — Nous ramenons l’Église, ajouta-t-il, à un état plus conforme à l’Écriture. Peut-être alors, pouvons-nous compter sur votre coopération pour ce but ? Nous ne vous demandons pas de vous séparer de l’Établissement, mais de reconnaître l’autorité apostolique, à laquelle tous doivent se soumettre. — Mais cela ne vous frappe-t-il pas, monsieur Highfly, repartit Charles, qu’il existe un corps de Chrétiens, et très-important certes, qui maintient avec vous, et, qui plus est, a toujours parfaitement conservé cette vraie succession apostolique dans l’Église ; un corps, veux-je dire, qui croit que, outre l’épiscopat, il y a un rang plus élevé que cette dignité, et auquel il donne le nom d’Apostolat ? — Au contraire, répondit M. Highfly, je pense que nous rétablissons ce qui est resté comme mort depuis le temps de saint Paul. Bien plus, je dirai que c’est un ordre qui n’a jamais été en vigueur, quoiqu’il fut dans les desseins du Christ dès le commencement. Vous voudrez bien vous rappeler que les Apôtres étaient juifs ; mais il n’y a jamais eu d’Apostolat des Gentils. Saint Paul, il est vrai, était Apôtre des Gentils, mais le dessein providentiel commencé en lui a été interrompu jusqu’à ce jour. Il s’en alla à Jérusalem contre l’avis solennel de l’Esprit. Maintenant, nous arrivons, nous, pour compléter cette œuvre de l’Esprit qui avait été arrêtée par l’inadvertance du premier Apôtre. »
Jack intervint dans la controverse : « Je serais très-heureux, dit-il, de savoir quelle communion religieuse, outre la nôtre, a, selon M. Reding, toujours maintenu la succession des Apôtres comme une chose distincte de l’Épiscopat. — Il est évident, répondit Charles, que je veux parler des Catholiques. La Papauté est le véritable Apostolat ; le Pape est le successeur des Apôtres, particulièrement de saint Pierre. — Nous sommes très-bien disposés envers les Catholiques Romains, reprit M. Highfly avec un peu d’hésitation. Nous avons adopté une grande partie de leur rituel ; mais nous ne pensons pas que nous leur ressemblons en ce qui est notre principe, caractéristique et fondamental. — Permettez-moi de vous dire, monsieur Highfly, répliqua Charles, que c’est une raison pour tout Irvingite (je veux dire pour tout homme qui partage vos convictions) de se faire catholique. Votre propre sens religieux vous a appris qu’il doit y avoir un Apostolat dans l’Église. Vous reconnaissez que l’autorité des Apôtres n’était pas temporaire, mais essentielle et fondamentale. Quelle était cette autorité, c’est ce que nous voyons dans la conduite de saint Paul envers saint Thimothée. Il l’établit sur le siége d’Éphèse, il lui confia une charge et, dans le fait, il était son surveillant ou évêque. Saint Paul avait le soin de toutes les Églises. Or, tel est précisément le pouvoir que le Pape réclame, qu’il a toujours réclamé, et qu’il a, d’ailleurs, revendiqué comme étant le successeur des Apôtres, quoique les Évêques puissent l’être aussi, mais dans un sens plus général[78]. C’est pourquoi les Catholiques l’appellent le Vicaire du Christ, l’Évêque des Évêques, et lui donnent d’autres noms analogues. Je pense, en outre, qu’ils le considèrent d’une manière spéciale, comme l’unique pasteur ou gouverneur de l’Église, la source de la juridiction, le juge des controverses et le centre de l’unité, parce qu’il a les pouvoirs des Apôtres, et particulièrement ceux de saint Pierre. » M. Highfly garda le silence. « Ne pensez-vous pas, dès lors, continua Charles, que, avant de venir me convertir, vous devriez vous rattacher d’abord à l’Église Catholique ? Au moins, vous me présenteriez votre doctrine avec plus d’autorité, si vous veniez à moi comme un de ses membres. Je vous avouerai même franchement qu’il vous serait plus facile de me convertir au Catholicisme qu’à votre opinion actuelle. » Jack jeta un coup d’œil à M. Highfly, comme s’il avait attendu une réplique décisive à ce qui était pour lui un nouveau point de vue ; mais M. Highfly fut d’un avis différent : « Eh bien, monsieur, dit celui-ci, je ne vois pas quel bien résulterait d’une entrevue plus longue. Votre dernière remarque, toutefois, me conduit à vous faire observer que le prosélytisme n’était pas l’objet de notre visite. Nous nous proposions seulement de vous informer qu’une grande œuvre se forme, afin d’appeler votre attention de ce côté-là, et pour vous inviter à y coopérer. Nous ne faisons pas de controverse. Nous ne désirions que vous donner notre témoignage, et puis laisser la matière à vos réflexions. Je crois, par conséquent, qu’il n’est pas nécessaire d’abuser plus longtemps de vos moments précieux. » Ce disant, il se leva ainsi que Jack, et tout en faisant force gracieux saluts et sourires, auxquels Charles répondit de son mieux, les deux visiteurs gagnèrent la porte.
[78] Successores sunt, sed ita ut potius Vicarii dicendi sint Apostolorum quam successores ; contra, Romanus Pontifex, quia verus Petri successor est, non nisi per quemdam abusum ejus Vicarius diceretur. — Zaccar. Antifebr., p. 130.
« Eh bien, il aurait pu m’arriver pis, pensa Charles. Vraiment, ils sont gentils ; ce sont des animaux bien dressés, après tout. J’aurais pu tomber sous la griffe des bêtes farouches d’Exeter-Hall. Mais, maintenant à l’ouvrage… Qu’est-ce donc ? » ajouta-t-il. Hélas ! c’était un petit coup modeste, mais bien distinct, frappé à sa porte ; il n’y avait pas à s’y tromper.
« Qui est là ? Entrez », s’écria-t-il. A ce mot, la porte s’ouvrit doucement, et une jeune dame, assez avenante et mise avec recherche, se présenta. Charles, contrarié, se leva précipitamment ; mais il n’y avait pas moyen de fuir. Il fut obligé d’offrir une chaise ; puis il attendit, tout oreilles, ou plutôt tout impatience, que l’inconnue l’informât de sa mission. Un instant la jeune dame ne parla pas. La tête penchée de côté, elle regardait le bout de son parasol, avec lequel elle décrivait lentement une circonférence sur le tapis. A la fin elle demanda, sans lever les yeux, s’il était vrai (et elle parlait doucement et de ce ton qu’on appelle spirituel), s’il était vrai, comme on le lui avait appris, que M. Reding à qui elle avait l’honneur de s’adresser fût à la recherche d’une religion plus sympathique à son cœur que celle de l’Église d’Angleterre. » Charles, contenant avec peine sa mauvaise humeur, répondit brièvement qu’il ne pouvait lui donner un renseignement sur le sujet de sa demande. La question, continua-t-elle, pouvait paraître impertinente ; mais elle avait ses raisons. Quelques-unes de ses sœurs s’occupaient de l’organisation d’un nouveau corps religieux, et l’acquisition de M. Reding, son assistance, ses conseils leur seraient particulièrement précieux, vu surtout qu’elles n’avaient pas encore parmi elles de gentleman élevé à l’Université. « Puis-je vous demander, dit Charles, le nom de la société que vous voulez fonder ? — Le nom, répondit-elle, n’est pas déterminé ; et c’est là vraiment un des points pour lesquels nous ambitionnerions le privilége de l’avis d’un homme aussi capable que M. Reding, afin qu’il nous assistât dans nos délibérations. — Et quels sont vos principes, madame ? — Ici encore, répliqua-t-elle, il y a beaucoup à faire : les principes ne sont pas fixés, non plus ; c’est-à-dire qu’ils ne sont qu’esquissés, et nous priserions beaucoup vos inspirations. Bien plus, naturellement vous auriez l’occasion, comme vous en auriez le droit, d’indiquer la doctrine à laquelle vous vous sentez particulièrement enclin. » Charles ne savait que répondre à une offre aussi large. Elle continua : « Peut-être serait-il à propos, monsieur Reding, de vous dire quelque chose de particulier sur mon compte personnel. Je suis née dans la communion de l’Église d’Angleterre ; un moment j’ai été membre de la nouvelle Connexion, et à présent, ajouta-t-elle, d’une voix languissante et d’un ton de psalmodie, en laissant tomber sa tête, à présent je suis un frère de Plymouth. » Ceci devenait trop absurde ; et Charles, qui, pendant quelques instants, s’en était amusé, commença à n’avoir qu’une pensée : par quel moyen il pourrait la mettre à la porte.
Évidemment la conversation était abandonnée à la jeune dame ; elle continua : « Nous sommes tous pour une religion pure. — D’après ce que vous me dites, reprit Charles, je conclus que chaque membre de votre nouvelle communauté a le droit de désigner une ou deux doctrines de son choix. — Nous sommes tous pour l’Écriture, monsieur, et c’est pourquoi nous ne faisons qu’un. Nous pouvons différer, mais nous restons d’accord. Cependant, c’est comme vous dites, monsieur Reding. Je tiens, moi, pour l’élection et l’assurance du salut ; une de mes dignes amies est pour la perfection, et une autre bonne sœur pour le second avénement. Mais nous désirons accueillir parmi nous toutes les âmes altérées du fleuve de vie, quelles que soient leurs vues personnelles. Je crois que vous tenez pour les sacrements et les cérémonies ? » Charles essaya de couper court à l’entrevue, en niant qu’il eût une religion à chercher, ou une résolution à prendre ; mais il était plus facile de terminer la conversation que de mettre fin à la visite. Désespéré, il se rejeta en arrière dans sa chaise, les yeux à demi fermés : « Oh ! ces bons Irvingites, pensa-t-il, braves gens qui viennent pour protester et qui s’évanouissent à la première parole d’opposition. Voilà trois quarts d’heure que celle-ci m’assomme, et je ne vois pas de raison pour qu’elle ne reste pas ici jusqu’à la fin des siècles, puisqu’elle est déjà restée si longtemps. Vraiment elle n’a pas dans sa personne les éléments du progrès ni de la décadence. Elle ne mourra jamais : que deviendrai-je alors ? »
La jeune dame, en effet, n’était pas destinée à une mort naturelle ; car, alors que le cas semblait désespéré, on entendit un bruit dans l’escalier, et, à peine le coup frappé à la porte, parut un homme grossier et niais, qui s’écria en entrant : « J’espère, monsieur, qu’il n’y a pas encore de marché fait ; j’espère que ce n’est pas trop tard. Congédiez cette jeune femme, monsieur Reding, et permettez-moi de vous enseigner la vérité ancienne, qui n’a jamais été abrogée. » Il ne fut pas nécessaire de renvoyer notre sœur de Plymouth. Car avec la même bonté qu’elle avait mise à se dilater et à s’épanouir au soleil de la tolérance de Charles, ainsi elle se retira et disparut soudain, sans qu’on pût dire de quelle manière, devant les rudes accents de l’importun ; et Reding se trouva tout à coup entre les mains d’un autre bourreau. « C’est intolérable », se dit-il à lui-même ; et se levant debout : « Monsieur, s’écria-t-il, excusez-moi, je suis particulièrement occupé ce matin, et je dois vous demander de décliner l’honneur de votre visite. — Que dites-vous, monsieur ? » repartit l’étranger ; et tirant de sa poche un portefeuille et un crayon, il se mit à regarder Charles en face et à noter ses paroles, disant à demi-voix comme il l’écrivait : « Il décline l’honneur de ma visite. » Puis, il le regarda de nouveau, tenant son crayon sur son papier : « Maintenant, monsieur ? » dit-il. Charles s’avança vers lui, et étendant son bras comme un homme qui conduit un troupeau d’oies ou de moutons, il répéta tout en regardant la porte : « Réellement, monsieur, je sens tout l’honneur de votre visite ; un autre jour, monsieur, un autre jour. C’est trop, c’est trop. — C’est trop ? s’écria l’importun ; et moi qui ai attendu si longtemps au bas de l’escalier ! Cette bégueule est restée près d’une heure ici, et vous ne pouvez maintenant me donner cinq minutes, monsieur ! — Eh bien, monsieur, répondit Charles, je suis sûr que vous venez pour un message qui sera aussi infructueux que celui de cette dame, d’ailleurs, je suis fatigué de toutes ces discussions religieuses, j’ai besoin d’être seul. Veuillez vous épargner une plus longue peine. » « Fatigué des discussions religieuses », se dit l’étranger à lui-même, notant ces paroles dans son portefeuille. Charles ne daigna pas faire attention à cette action impertinente, ni expliquer ses propres paroles ; il se prépara à lui indiquer la porte. Son bourreau reprit : « Peut-être désirez-vous savoir mon nom ? Je suis Zorobabel. »
Quoique vexé, Reding comprit qu’il ne devrait pas rejeter l’ennui de la visite précédente sur l’importun actuel ; il fit donc un effort pour répondre : « Zorobabel ! vraiment ! et Zorobabel est-il votre prénom, monsieur, ou votre nom de famille ? — L’un et l’autre, monsieur Reding, ou plutôt, je n’ai pas de nom de baptême, et Zorobabel est ma seule désignation juive. — Vous venez donc voir s’il y a quelque apparence que je me fasse juif. — Il peut arriver des choses plus étranges, monsieur ; par exemple, j’étais moi-même autrefois diacre de l’Église d’Angleterre. — Vous n’êtes donc pas juif ? — Je suis juif par choix. Après bien des prières et une longue étude de l’Écriture, je suis arrivé à cette conclusion que, puisque le Judaïsme fut la première religion, il doit aussi être la dernière. A mes yeux, le Christianisme n’est qu’un épisode de l’histoire de la Révélation. — Il n’est pas probable que vous ayez beaucoup de sectateurs avec une telle doctrine. Nous sommes tous pour le progrès, à cette heure, et non pour le mouvement rétrograde. — Je ne suis pas de votre avis, monsieur Reding. Voyez ce que l’Établissement vient de faire ; il a envoyé un évêque à Jérusalem. — Oui, mais c’est dans la pensée de rendre les Juifs Chrétiens, plutôt que pour convertir les Chrétiens au Judaïsme. — Zorobabel écrivit : « Il pense que l’évêque de Jérusalem doit convertir les Juifs » ; il dit ensuite : « Je ne partage pas votre opinion, monsieur. Au contraire, j’imagine que l’excellent évêque se propose de faire revivre la distinction entre les Juifs et les Gentils, ce qui est un premier pas vers la suprématie de ceux-là. Car si les Juifs ont jamais une place dans le Christianisme, comme Juifs, ce doit être nécessairement la première. » Charles pensa qu’il valait mieux le laisser parler à son aise. Zorobabel continua donc : « Le bon évêque en question sait bien que le Juif est le frère aîné du Gentil, et c’est sa mission spéciale de rétablir un épiscopat juif sur le siége de Jérusalem. La succession juive a été interrompue depuis le temps des Apôtres. Et maintenant, vous voyez la raison de ma visite chez vous, monsieur Reding. On dit que vous penchez vers l’Église Catholique. Je voudrais vous suggérer que vous vous trompez sur le centre de l’unité. C’est le siége de Jacques à Jérusalem qui est le vrai centre, et non le siége de Pierre à Rome. Le pouvoir de Pierre est une usurpation sur Jacques. Pour moi, le vrai Pape c’est l’évêque actuel de Jérusalem. Les Gentils ont été au pouvoir trop longtemps. A cette heure, c’est le tour des Juifs. — Vous paraissez admettre, répliqua Charles, qu’il doit y avoir un centre d’unité et un Pape. — Certainement, et un rituel aussi, mais il doit être juif. Je cherche des souscriptions pour rebâtir le Temple sur le mont Moriah. J’espère, également, négocier un emprunt, et nous aurons un capital du Temple donnant au moins, d’après nos calculs, quatre pour cent. — Jusqu’ici on a regardé comme un péché, répliqua Reding, la tentative de reconstruire le Temple. D’après vous, Julien l’Apostat aurait pris le meilleur chemin pour atteindre le but. — Son motif était coupable, monsieur, mais l’acte était bon. Le moyen de convertir les Juifs, c’est d’accepter d’abord leurs rites. Ceci est une des grandes découvertes de notre siècle. Nous devons faire le premier pas vers eux. Quant à moi, j’ai admis tout ce que l’état actuel de leur religion rend possible ; et je ne désespère pas de voir le jour où les sacrifices sanglants seront offerts sur la montagne du Temple, comme anciennement. » Ici notre étrange visiteur s’arrêta. Voyant que Charles ne répliquait pas, il ajouta d’un ton dégagé et à la hâte : « Ne puis-je pas espérer que vous souscrirez à ce projet religieux, et que vous adopterez l’ancien rituel ? Celui des Catholiques est d’hier comparé au nôtre. » Charles répondant d’une manière négative, Zorobabel coucha sur son portefeuille : « Il refuse de prendre part à notre projet », et il quitta la chambre aussi vite qu’il y était entré.
Charles n’était pas au bout de ses épreuves. Nous craignons qu’à cette nouvelle le lecteur ne frissonne, parce qu’il a, dans cette affaire, sa bonne part d’ennui. Toutefois le lecteur trouve cet adoucissement à sa position : il lit cette histoire dans un moment d’oisiveté, et Charles en subissait la réalité à une heure d’action et d’inquiétude. Il s’était donc écoulé peu de temps depuis le départ de Zorobabel, lorsque le propriétaire de la maison se présenta de nouveau à la porte. Il assura à M. Reding que ce n’était pas sa faute si les deux dernières personnes lui avaient fait visite. La jeune dame s’était faufilée à son insu, et le gentleman avait forcé le passage. Mais, cette fois, il venait solliciter réellement une entrevue pour un personnage à grandes prétentions littéraires, avec qui il avait eu quelques rapports, et qui était venu du quartier Ouest de Londres pour le seul honneur de s’entretenir avec M. Reding. Charles gémit, mais une seule réponse était possible. La journée d’ailleurs était déjà perdue, et avec une espèce de résignation triste, il donna la permission d’introduire l’étranger.
C’était un homme à la face pâteuse, d’environ trente-cinq ans, qui, tout en parlant, relevait ses sourcils et avait un sourire particulier. Il commença par exprimer la crainte que M. Reding n’eût été fatigué par ces visiteurs impertinents et inutiles, gens sans intelligence, dont le fanatisme aveugle ne pouvait inspirer que le mépris. « Je connais assez les Universités, continua-t-il, pour déclarer qu’il ne peut exister aucune affinité entre leurs membres et la masse des sectaires religieux. Vous avez eu parmi vous, à Oxford, des hommes très-éminents, appartenant à des écoles très-différentes ; cependant c’étaient tous des hommes capables, qui se sont fait distinguer par leur zèle pour la vérité, quoiqu’ils soient arrivés à des opinions contradictoires. » Reding, ignorant où il voulait en venir, resta dans une attitude expectante. « J’appartiens, continua le nouveau visiteur, à une société qui s’est consacrée à étendre parmi toutes les classes la recherche de la vérité. Tout esprit philosophique, monsieur Reding, doit avoir senti un intérêt profond pour votre parti, à l’Université. Notre société, dans le fait, vous considère comme un des agents les plus remarquables de cette œuvre si importante, et je ne puis vous offrir, individuellement, un compliment plus flatteur, à vous dont le nom a paru naguère d’une manière si honorable dans les journaux, qu’en vous nommant membre de notre Société de la Vérité. Voici votre diplôme, ajouta-t-il eu lui remettant une feuille de papier. » Charles y jeta un coup d’œil. C’était une feuille, partie gravée, partie imprimée, partie manuscrite. Un emblème de la vérité occupait le centre. Ce n’était pas un soleil radieux, ni une étoile brillante, comme on aurait pu l’attendre, mais la lune dans une éclipse totale, environnée des têtes de Socrate, de Cicéron, de Julien, d’Abailard, de Luther, de Benjamin Franklin et de lord Brougham, en guise de chérubins. Puis venaient quelques phrases disant que l’Association de la branche de Londres, faisant partie de la Société Britannique et Étrangère de la Vérité, ayant la preuve du zèle déployé dans la poursuite de la vérité par Charles Reding, Esq., membre de l’Université d’Oxford, l’avait admis à l’unanimité dans son sein, et lui avait assigné la haute et importante mission de membre associé et correspondant. « Je remercie beaucoup la Société de la Vérité, dit Charles lorsqu’il arriva au bout de la feuille, pour cette marque de son bon vouloir ; je regrette, toutefois, d’avoir quelque scrupule à l’accepter jusqu’à ce qu’on ait fait disparaître quelques-uns des protecteurs dont les têtes couronnent le diplôme. Par exemple, je n’aime pas fort me trouver à l’ombre de l’empereur Julien. — Vous respecteriez cependant son amour de la vérité, je présume, dit M. Batts. — Pas beaucoup, je le crains, monsieur, en voyant que cet amour ne l’a pas empêché d’embrasser sciemment l’erreur. — Non, non, pas l’erreur, d’embrasser ce qu’il croyait être la vérité ; et Julien, à mon avis, ne peut être accusé d’avoir déserté la vérité, puisque dans le fait il fut toujours à sa recherche. — Je crains qu’il n’y ait sur ce point une différence très-marquée entre vos principes et les miens. — Ah ! mon cher monsieur, un peu d’attention à nos principes ferait disparaître cette différence. Permettez-moi de vous offrir cette petite brochure, dans laquelle vous trouverez établies quelques vérités fondamentales, sous la forme d’aphorismes. J’appelle particulièrement votre attention sur la page 8. » Reding chercha cette page, et lut ce qui suit :
« De la poursuite de la vérité.
» 1. Il est incertain que la vérité existe.
» 2. Il est certain qu’on ne peut la trouver.
» 3. C’est une folie de se vanter de la posséder.
» 4. Le travail et le devoir de l’homme, comme homme, consistent non pas à la posséder, mais à la chercher.
» 5. Son bonheur et sa véritable dignité consistent à la poursuivre.
» 6. La poursuite de la vérité est une fin ; on doit s’y engager par amour d’elle-même.
» 7. Comme la philosophie est l’amour, et non la possession de la sagesse, ainsi la religion est l’amour, et non la possession de la vérité.
» 8. De même que le Catholicisme commence par la foi, de même le Protestantisme finit par l’examen.
» 9. Comme il y a du désintéressement à chercher, ainsi il y a de l’égoïsme à réclamer la possession.
» 10. Le martyr de la vérité est celui qui meurt en déclarant qu’elle est une ombre.
» 11. C’est le martyre de toute la vie que de changer toujours.
» 12. La crainte d’errer est la ruine de l’examen. »
Charles ne poussa pas plus loin sa lecture ; ce qui suivait avait le même caractère. Il rendit la brochure à M. Batts. « J’ai vu suffisamment, dit-il, les opinions de la Société de la Vérité pour admirer leur originalité et leur franchise ; mais, excusez-moi, je ne saurais y trouver du bon sens. Il est impossible que je souscrive à ce qui est si clairement opposé au Christianisme. » M. Batts parut contrarié. « Nous ne voulons pas, répliqua-t-il, nous opposer au Christianisme ; nous désirons seulement que le Christianisme ne s’oppose pas à nous. Il est très-fâcheux que nous ne puissions pas aller notre chemin, quand nous permettons aux autres de suivre le leur. A mes yeux, il est imprudent, dans un siècle comme le nôtre, de représenter le Christianisme comme hostile au progrès de l’esprit, et de faire des ennemis de la Révélation de ceux qui désirent sincèrement « vivre tranquilles et laisser vivre les autres ». — Mais les contradictions ne peuvent être vraies, repartit Charles. Si le Christianisme affirme que la vérité peut se trouver, ce doit être une erreur de soutenir qu’on ne peut la trouver. — Il y a de l’intolérance dans votre Christianisme, je le crois, monsieur. Vous m’accorderez, je suppose, que le Christianisme n’a rien à faire avec l’astronomie ou la géologie. Et dès lors pourquoi se mêlerait-il de philosophie ? » C’eût été inutile de prolonger la discussion. Charles réprima la réponse qui lui venait sur les lèvres, de l’alliance essentielle de la philosophie avec la religion. Il y eut un silence de plusieurs minutes, et M. Batts, à la fin, comprit cet avis indirect, car il se leva d’un air désappointé et souhaita le bonjour à notre infortuné ami.
Après la fatigue et l’agitation causées par ces conversations successives, peu importait maintenant à Charles qu’on le laissât ou non livré à lui-même, car il ne se sentait plus en état d’appliquer son esprit aux sujets dont il s’était promis de s’occuper le matin. Au départ de M. Batts, il ne fit donc aucun effort pour travailler. Il se contenta de s’asseoir devant le feu, triste, abattu, et en danger de retomber dans les pensées de trouble dont l’avait fait sortir son compagnon du chemin de fer. Lors donc qu’au bout d’une demi-heure un nouveau coup se fit entendre à la porte, il admit le postulant avec une indifférence calme, comme si la fortune avait épuisé ses plus cruelles rigueurs et qu’il n’eût plus rien à craindre. L’individu qui se présenta était un homme d’un âge mûr, au teint luisant et aux membres dodus. Il paraissait se trouver dans des conditions favorables qu’il avait su mettre à profit. Son habit noir lustré contrastait avec la couleur rose de son visage et de son cou, que n’emprisonnait pas un faux col. Son maintien était roide et solennel. Tout cela ajouté à un débit rapide lorsqu’il parlait, lui donnait un grand air de dindon de basse-cour, qui aurait frappé Reding, s’il eût été moins las qu’il ne l’était en ce moment de voir de nouvelles figures. Cet étrange visiteur, en entrant dans la chambre, jeta autour de lui un coup d’œil investigateur. « Votre très-humble, dit-il d’un ton brusque. Vous paraissez abattu, mon cher monsieur ; mais asseyez-vous, monsieur Reding, et permettez-moi de profiter de l’occasion pour vous donner quelques bons avis. Vous pouvez deviner qui je suis à mon aspect : mon air parle de soi ; je ne dirai pas davantage, je puis vous être utile. Monsieur Reding, continua-t-il, en rapprochant sa chaise de lui et en étendant sa main, comme s’il allait le secouer, n’avez-vous pas fait une méprise, en pensant qu’il était nécessaire de vous adresser à l’Église de Rome pour l’apaisement de vos difficultés religieuses ? — Je ne vous ai pas encore informé, monsieur, répondit Charles gravement, que j’eusse des difficultés. Excusez-moi si je suis brusque ; j’ai eu bien des personnes qui m’ont fait visite pour le même objet. C’est très-obligeant de votre part, mais je n’ai pas besoin d’avis. Quelle sottise que de venir ici ! — Bien, mon cher monsieur Reding ; mais écoutez-moi, reprit son persécuteur, en étendant les doigts de sa main droite et en ouvrant de grands yeux. J’ai raison, je crois d’appréhender que votre motif de quitter l’Établissement est que vous ne pouvez introduire le surplis dans la chaire et les chandeliers sur la table de communion. Or, n’en faites-vous pas plus qu’il ne faut ? Pardon, mais vous ressemblez à un homme qui ferait passer la Tamise sur sa maison, lorsqu’il a simplement besoin de nettoyer les marches de sa porte. Pourquoi vous adresser au Papisme, quand vous pouvez arriver à votre but par une voie plus facile et à meilleur marché ? Établissez-vous pour votre propre compte, mon cher monsieur ; agissez pour vous-même ; formez une nouvelle communion, six pence y suffiront ; et vous aurez alors votre surplis et les chandeliers au gré de vos désirs, sans renier l’Évangile, ou sans vous jeter dans les horribles abominations de la Grande Prostituée… » Et il se redressa sur sa chaise, les mains appuyées sur ses genoux écartés, considérant avec un air de satisfaction l’effet de ses paroles sur Reding.
« J’en ai eu assez de tout cela, répondit le pauvre Charles. En vérité, vous n’êtes qu’un de plus, monsieur, et je voudrais vous dire que vous n’avez rien de commun avec les autres ; mais je ne puis m’empêcher de vous regarder comme la cinquième, sixième, ou septième personne (je ne puis plus les compter) qui est venue ce matin me donner, avec les meilleures intentions sans doute, des avis que je n’avais pas demandés. Je ne vous connais pas, monsieur ; vous ne m’avez pas été présenté ; vous ne m’avez pas même dit votre nom. Il n’est pas d’usage de discourir sur des sujets personnels avec des étrangers. Permettez-moi donc de vous remercier de votre bonté à me faire visite, et puis, de votre nouvelle bonté à sortir. » Et Charles se leva.
Son persécuteur ne parut pas disposé à se mouvoir, ni à faire attention à ces paroles. Il attendit un moment, déploya son mouchoir avec beaucoup de délibération et se moucha ; il dit ensuite : « Kitchens est mon nom, monsieur ; le docteur Kitchens. L’état de votre esprit, monsieur Reding, ne m’est pas inconnu : vous êtes présentement sous l’influence du vieil Adam, et, en vérité, dans une triste voie. Je m’y attendais. Aussi ai-je mis dans ma poche un petit traité que je vous presserai d’accepter avec toute la sollicitude chrétienne qu’un frère peut montrer envers un frère. Le voici. J’ai la plus grande confiance dans sa vertu. Peut-être en avez-vous entendu parler. Il est connu sous la dénomination de l’Élixir spirituel de Kitchens. L’Élixir a éclairé des millions d’âmes ; et je prendrai sur moi de vous dire qu’il vous convertira dans les vingt-quatre heures. Son action est douce et agréable, et ses effets merveilleux, prodigieux, quoiqu’il ne consiste qu’en huit pages in-12. Voici une liste des témoignages donnés pour quelques-uns des cas les plus remarquables. J’ai connu moi-même cent deux cas, dans lesquels il a opéré un changement salutaire en six heures ; soixante-dix-neuf, dans lesquels son effet s’est produit en trois heures seulement ; et vingt-sept où la conversion a eu lieu immédiatement après sa lecture. D’un seul coup, de pauvres pécheurs qui, cinq minutes auparavant, ressemblaient aux démoniaques de l’Évangile, reparaissaient « vêtus et sains d’esprit ». Ainsi je suis au-dessous de la vérité, monsieur Reding, lorsque j’affirme que je vous garantis un changement chez vous dans l’espace de vingt-quatre heures. Je n’ai jamais connu qu’un seul cas dans lequel il ait paru impuissant. C’était un méchant vieillard, qui le garda dans sa main toute une journée, et en silence, sans aucun effet visible. Mais ici exceptio probat regulam, car, après plus ample information, nous découvrîmes que ce vieux pécheur ne savait pas lire. Aussi le Traité lui fut-il administré doucement par une autre personne, et avant que la lecture en fût terminée, je vous le jure, monsieur Reding, il tomba dans un sommeil profond et salutaire, transpira abondamment, et se réveilla, au bout de douze heures, créature nouvelle, parfaitement nouvelle, et mûr pour le ciel, où il monta dans le courant de la semaine. En ce moment, nous faisons des expériences plus larges sur son action, et nous trouvons que même les feuilles séparées du Traité ont un effet relatif. Et, ce qui vaut encore mieux par rapport à vous, c’est un spécifique admirable dans le cas de Papisme. Il attaque directement la matière peccante ; et toute la pourriture des sacrements, des saints, de la pénitence, du purgatoire et des bonnes œuvres est évacuée de l’âme d’un seul coup. »
Charles restait silencieux et grave, et semblait disposé à accomplir quelque grand acte d’énergie, plutôt que d’écouter un plus long bavardage. Le docteur Kitchens continua : « Avez-vous assisté à quelque discours contre la Babylone mystique, ou à une des controverses publiques qui ont eu lieu dans un grand nombre de villes ? M. Makanoise, un de mes bons amis, a lutté sur dix points avec trente jésuites, une bonne moitié de ceux de Londres, et il les a battus sur toutes les matières. Ne connaissez-vous aucune des lumières d’Exeter-Hall ? N’avez-vous jamais entendu M. Gabb ? c’est un Boanerges, un vrai Niagara de paroles : quelle vie dans sa diction ! quelle véhémence ! quelle force ! Sa voix seule suffit pour terrasser un homme. Il peut parler sept heures durant sans fatigue. L’année passée, il a parcouru l’Angleterre, débitant dans tout le pays, en long et en large, une seule, mais terrible protestation contre la sorcière apocalyptique d’Endor. Il commença à Devenport et finit à Berwick, et il se surpassa lui-même à chaque meeting. A Berwick, lieu de sa dernière représentation, l’effet fut complétement formidable. Un de mes amis l’y a entendu. Il m’a assuré, quelque incroyable que la chose paraisse, que la voix de M. Gabb avait brisé des vitres dans une maison voisine, et que deux prêtres de Baal, qui étaient à leur école d’externat, à un quart de mille environ, avaient été si maltraités par le seul écho, que l’un d’eux alla se coucher sur-le-champ, et que l’autre a marché avec des béquilles depuis lors. » Il s’arrêta un moment, puis il reprit : « Et quelle est la cause, croyez-vous, monsieur Reding, qui a produit sur eux cet effet ? C’était la connaissance que possédait M. Gabb, relativement au signe de la bête dont parle la Révélation : il prouva, monsieur Reding, et ce fut le coup le plus original de son discours, il prouva que ce signe était la croix, la croix matérielle. »
Le moment était enfin venu ; Reding ne pouvait plus y tenir, et, par bonheur, l’injure de ce cruel intrus lui fournissait les moyens aussi bien que le motif de le punir. « Oh ! dit-il soudain, alors je suppose, docteur Kitchens, que vous ne pouvez tolérer la croix ? — Oh ! non ; la tolérer ! mais c’est l’Antechrist ! — Vous ne pouvez en supporter la vue, je le soupçonne, docteur Kitchens ? — Je ne puis la supporter, monsieur ; quel vrai Protestant le pourrait ? — Alors, regardez ! » dit Charles, tirant de son pupitre un petit crucifix qu’il mit devant les yeux du docteur Kitchens. Celui-ci, tout d’un coup, se dressa sur ses pieds, et, reculant : « Qu’est-ce que cela ? » s’écria-t-il ; et son visage rougit et pâlit tour à tour : « Qu’est-ce que cela ? c’est la chose elle-même » ; et il fit un mouvement pour la saisir. « Retirez-la, monsieur Reding, c’est une idole ; je ne puis la supporter ; retirez-la. — Elle a vraiment, se dit Charles à lui-même, un pouvoir magique sur lui » ; et il la présenta encore au fougueux sectaire, tout en la tenant hors de ses atteintes. « Retirez-la, monsieur Reding, je vous en supplie ! » s’écria le docteur en reculant toujours, tandis que Charles continuait à le presser. « Retirez-la, c’est trop fort. Oh ! oh ! épargnez-moi, épargnez-moi, monsieur Reding !… Nohestan[79]… une idole !… Oh ! jeune Antechrist, démon !… C’est lui, c’est lui… Torture !… Grâce, monsieur Reding ! » Et le misérable docteur commença à s’agiter, toujours regardant le signe sacré et l’écartant de devant ses yeux. Charles, à cette heure, tenait la victoire dans ses mains. Il y avait sans doute quelque difficulté à diriger vers la porte cet impertinent visiteur de l’endroit où il était assis, mais un seul effort suffit ; arrivé là, il ouvrit avec violence l’un des battants, se précipita dans l’escalier, et se mit à enjamber deux ou trois marches à la fois. Oubliant tout alors, sauf l’objet de sa terreur, il vint fondre d’un seul trait sur deux personnes qui se disputaient pour monter, et tandis qu’il jetait l’un contre la rampe, il fit bravement rouler l’autre au bas de l’escalier.
[79] On lit au IVe L. des Rois, ch. 18. v. 4 : « … Il (Ézéchias) fit mettre en pièces le serpent d’airain que Moïse avait fait, parce que les enfants d’Israël lui avaient brûlé de l’encens jusqu’alors, et il l’appela Nohestan » — C’est-à-dire d’après d’Allioli, petit airain, petit cuivre, vil cuivre.
Charles se jeta sur sa chaise et enferma le crucifix dans sa poitrine. Il était fatigué de cette longue épreuve et de l’effort par lequel elle s’était soudain terminée. Un bruit se fit entendre à la porte, et les coups se succédèrent nombreux. Il n’y fit pas attention, et se contenta de poser ses pieds sur le garde-feu en cachant son visage dans ses mains. La sommation, tout d’abord, ne venait évidemment que d’un seul individu, mais le retard de Charles à répondre donna à un second le temps d’arriver, et bientôt il y eut une succession rapide de coups alternatifs de deux personnes. Charles les laissait frapper. A la fin, un des deux candidats rivaux à la présentation, plus hardi que l’autre, ouvrit doucement la porte. Le second, qui, après sa chute, avait grimpé en courant au haut de l’escalier, se précipita dans la chambre avant lui, en s’écriant : « Un seul mot pour la Nouvelle Jérusalem[80]. — Par charité, répondit Charles, sans changer d’attitude, par charité, laissez-moi tranquille ! Votre intention est bonne, mais je n’ai pas besoin de vous, monsieur, je n’en ai pas besoin. J’ai eu déjà, ici, l’Ancienne Jérusalem et les Apôtres juifs ; les Apôtres gentils et le libre examen ; une religion de fantaisie et Exeter-Hall. Quel est donc mon crime ? Ne puis-je mourir en paix ? Mon cher monsieur, sortez : je ne puis vous recevoir ; je suis épuisé. » Il se leva alors et s’avança vers le nouvel intrus. « Revenez une autre fois, mon cher monsieur, si vous êtes résolu à me parler ; mais, excusez-moi, j’en ai eu réellement assez pour une journée. Ce n’est pas votre faute, mon cher monsieur, si vous êtes le sixième ou le septième. » Et il lui ouvrit la porte. « Un fou vient de me renverser comme je montais, reprit avec émotion la personne à qui Charles s’était adressé. — Mille pardons pour sa grossièreté, mon cher monsieur, mille pardons, mais permettez-moi… » Et en le saluant, il le poussa hors de la chambre. Il se tourna ensuite vers l’autre étranger, qui se tenait auprès de lui en silence : « Et vous aussi, monsieur…? Est-ce possible ! » Une extrême surprise se peignit sur son visage ; C’était M. Malcolm. Les pensées de Charles prirent un nouveau cours, et ses persécuteurs furent oubliés sur-le-champ.
[80] Ces seuls mots indiquent un partisan du visionnaire Swedenborg.
L’histoire de la visite de M. Malcolm était toute simple. Amateur de bouquins, il avait souvent mis à contribution le fonds du propriétaire de Charles pour augmenter sa bibliothèque. Or, en passant par Londres pour se rendre au chemin de fer des comtés de l’Est, il était entré par hasard dans la boutique ; et, comme le digne libraire était à la hauteur de son cabinet de lecture pour le bavardage, M. Malcolm avait appris de lui que M. Reding, qui était sur le point de quitter l’Établissement, se trouvait, en ce moment, à l’étage supérieur. M. Malcolm avait donc attendu avec impatience la fin de la visite du docteur Kitchens, et peu s’en était fallu même, ce qui l’eût fort contrarié, qu’il ne fût dépassé par le bon Swedenborgien.
« Comment vous portez-vous, Charles ? » dit-il enfin, avec un peu de roideur dans ses manières. Notre jeune ami, de son côté, n’était pas moins embarrassé dans son accueil. « Vous avez eu, ce matin, un petit lever, paraît-il. Je croyais que je n’arriverais jamais à vous voir. Asseyez-vous ; asseyons-nous, et laissez-moi vous dire quelques mots. » Malgré les épreuves diverses que Charles venait de subir de la part d’étrangers, il n’y avait peut-être personne qu’il désirât moins voir que M. Malcolm. Il ne pouvait s’empêcher de l’associer, dans son esprit, avec l’image de son père. Toutefois, il ne se sentait pas disposé à lui ouvrir son cœur ni à tenir compte de ses jugements. Ses sentiments étaient un mélange de crainte par droit de prescription et de disposition amicale en même temps. C’était un attachement né d’anciens souvenirs, et un désir de rester en bons rapports avec cette vieille connaissance de sa famille, mais ce n’était ni confiance, ni amitié réelle. Il rougit comme s’il se fût senti coupable, sans comprendre clairement pourquoi. « Eh bien, Charles Reding, dit M. Malcolm, je pensais que nous nous connaissions assez l’un l’autre pour que j’aie droit à être averti de ce qui vous concerne. » Charles répliqua qu’il lui avait écrit la veille au soir. « Ah ! lorsqu’il n’y avait plus de temps pour répondre à votre lettre. » Charles repartit qu’il voulait épargner à un si bon ami… Il bégaya et ne put finir sa phrase. « Un ami, qui, naturellement, ne pouvait donner de conseils, répliqua sèchement M. Malcolm. Ces messieurs, continua-t-il, étaient-ce quelques-uns de vos nouveaux amis qui vous rendaient visite ? Ils m’ont tenu trois quarts d’heure dans la boutique, et le dernier, qui vient de sortir, a failli me jeter par-dessus la rampe. — Non, monsieur ; je ne les connais pas du tout. C’étaient les plus fâcheux des importuns. — Comme un autre paraît l’être », ajouta M. Malcolm. Charles fut vivement blessé de ces paroles, et d’autant plus qu’il n’avait rien à répondre. « Eh bien, Charles, reprit M. Malcolm sans le regarder, je vous ai connu grand comme ça ; même quand vous étiez à la mamelle. Vous étiez jadis un garçon franc et ouvert, j’ignore ce qui vous a gâté. Ces jésuites, peut-être… Ce n’était pas ainsi du vivant de votre père. — Mon cher monsieur, répondit Charles, vos paroles me fendent le cœur. Vous avez toujours été très-bon pour moi. Si j’ai erré, ç’a été une erreur de jugement, j’en suis désolé, et j’espère que vous me le pardonnerez. J’ai agi pour le mieux ; mais je me suis trouvé, comme il vous le faut comprendre, dans une situation très pénible. Il y a un an que ma mère sait ce que je méditais. — Situation pénible ! Sornette ! Que me parlez-vous de situation ? Je vous aurais raconté mille histoires sur ces Catholiques. J’en sais long sur eux. Une erreur de jugement ! vous vous moquez. Je sais bien comment arrive tout cela. Pareils faits ne me sont pas inconnus ; seulement, je vous croyais un jeune homme plus sensé. Faut-il vous citer le jeune Dalton de Sainte-Croix ? Il va sur le continent et rencontre un prêtre doucereux, qui persuade au pauvre niais que l’Église Catholique est l’ancienne et la véritable Église d’Angleterre, la seule religion digne d’un gentleman. On le présente au comte un tel, à la marquise une telle, et Dalton nous revient catholique. Il y en avait un autre. Comment s’appelait-il ? j’ai oublié son nom. Il appartenait à une famille du Berkshire. Celui-ci est séduit par un joli minois. Désormais rien ne peut le satisfaire s’il n’épouse la jeune personne qui a charmé son cœur. Mais elle est catholique et ne peut se marier à un hérétique. Aussi, ma foi, il renonce et à la faveur de son oncle et à son avenir dans le pays pour sa belle Juliette. Il y avait encore un autre exemple… mais, inutile de les citer tous. Et maintenant, je me demande quel motif vous a poussé vous-même… »
Tout cela était la meilleure justification du silence de Charles envers M. Malcolm. Ce brave homme avait ses trente ou quarante années d’expérience et, comme quelques grands philosophes, il faisait de cette expérience personnelle le critérium suprême du possible et du vrai. « Je les connais, continua-t-il, je les connais : une bande d’hypocrites et d’escrocs ! Je pourrais vous raconter d’étranges histoires que j’ai vues de mes yeux sur le continent. Ces prêtres ne méritent aucune confiance. Avez-vous jamais connu quelque prêtre ? — Non. — Avez-vous jamais vu une chapelle papiste ? — Non. — Connaissez-vous quelque chose des livres catholiques, de la doctrine catholique, de la morale catholique ? Ah ! je vous le garantis, vous ne savez pas grand’chose de tout cela. » Charles paraissait fort mal à son aise. « Eh bien, alors qu’est-ce qui vous pousse vers eux ? » Charles ne savait que dire. « Pauvre sot ! continua M. Malcolm, vous n’avez pas un mot à me donner en votre faveur. Tout ceci est une affaire de pure imagination. Vous allez comme l’oiseau au chasseur. »
Reding commença à se remettre. Il comprit qu’il devait dire enfin quelque chose, sans quoi son silence l’eût condamné. « Mon cher monsieur, répondit-il, il n’est rien qu’on ne puisse tourner contre une personne quand on le veut. Or, voyez. Si j’avais connu un prêtre quelconque, vous vous seriez écrié sur-le-champ : « Ah ! il vous a fasciné. » Si j’avais fréquenté les chapelles catholiques, « j’aurais été séduit par la musique ou l’encens ». Que pouvais-je faire de mieux que de me confier à moi-même, de marcher sous l’étendard de ma raison éclairée, de consulter les amis que je trouvais autour de moi, comme je l’ai fait, et d’attendre avec patience jusqu’à ce que je fusse sûr de mes convictions ? — Ah ! voilà votre manière, à vous, jeunes gens, reprit M. Malcolm : vous vous croyez tous infaillibles. Vous pensez, et c’est à ravir, que des têtes plus âgées ne sont rien à côté de vous. Eh bien, continua-t-il, en mettant ses gants, je vois que je ne suis pas capable de vous persuader. Pauvre et cher petit Charles, j’en suis fâché pour vous. Qu’eût dit votre pauvre père, s’il avait vécu pour être témoin de ceci ? Pauvre Reding ! quel terrible coup lui a été épargné ! Mais peut-être cela n’aurait point eu lieu. Je sais quel en sera le résultat définitif. Vous nous reviendrez ; oui, j’en suis certain et sûr. Nous vous verrons revenir, jeune insensé, après que vous aurez couru à travers champs, la bride sur le cou. Bien, bien ! cela vaut mieux que de vivre sans frein. Il faut que vous ayez votre dada. Ç’aurait pu être pire ; vous auriez pu manger votre fortune. Mais peut-être la donnerez-vous, comme tant d’autres, à quelque prêtre artificieux. C’est cruel, bien cruel : voire éducation perdue, votre avenir ruiné, votre pauvre mère et vos sœurs abandonnées à elles-mêmes… Et vous ne me dites pas un mot. » Il devint rêveur. « Quel monde de tribulations ! Adieu, Charles. Maintenant vous êtes haut et puissant ; vous voguez à pleines voiles : peut-être reviendrez-vous, un jour, avec d’autres sentiments, vers l’ami de votre père. Adieu. » Le cœur de Charles était plein, mais sa tête se trouvait fatiguée et troublée, son esprit abattu : il n’eut donc pas un mot à répondre, de sorte qu’il parut à M. Malcolm stupide ou très-réservé. Il ne put que presser chaleureusement la main que celui-ci lui abandonnait à contre-cœur, et accompagner le brave homme jusqu’à la porte de la rue.
« Cela ne finira donc jamais ! se dit Charles, en fermant la porte et en remontant l’escalier. Voilà une journée complétement perdue ; et en vérité, je ne saurais dire avec lesquels de ces importuns, étrangers ou amis, mon temps a été le moins gaspillé. J’aurais dû aller directement au couvent. » Cette dernière pensée frappa son esprit, et il se plaça devant le feu, en y réfléchissant. « Oui, dit-il, je ne différerai pas davantage. Quelle heure peut-il être ? Déjà quatre heures ! » Il réfléchit de nouveau : « Je vais aller dîner, et puis, je me sauverai bien vite chez mes bons Passionnistes. »
Le restaurant où Charles se rendit était à une certaine distance. Il ne lui fut donc possible d’arriver au couvent que vers les six heures. Ce monastère était une simple construction en briques. Les ressources étant très-restreintes, on avait dû sacrifier l’extérieur, afin de pourvoir aux dépenses de l’intérieur. L’édifice était également incomplet. Une grande église avait été construite, mais ses murailles étaient nues ; et, à part les autels qu’on y avait élevés, elle ne se faisait remarquer que par ses proportions bien prises, un sanctuaire large, de bonnes orgues et un chœur convenable. Un corps de bâtiments adjacents pouvait loger environ une demi-douzaine de Religieux ; mais la grandeur de l’église demandait un établissement plus vaste. Depuis lors sans doute les choses ont bien changé, mais nous remontons ici aux premiers efforts de cette communauté anglaise, à une époque où elle avait à peine cessé de lutter pour son existence, et où les amis et les membres ne faisaient que commencer à y arriver.
Dix années seulement s’étaient écoulées alors, depuis que le plus sévère des ordres modernes avait été introduit en Angleterre. Au milieu de la tiédeur et de l’égoïsme du XVIIIe siècle ; deux cents ans après l’époque mémorable où saint Philippe et saint Ignace, laissant de côté les austérités corporelles, dont toutefois ils étaient personnellement de si grands maîtres, avaient prêché la mortification de la volonté et de la raison comme plus nécessaire à un âge de civilisation, le père Paul de la Croix fut divinement poussé à la fondation d’une communauté plus ascétique, sous certains rapports, que les premiers ermites et les ordres du moyen âge. Quoique le jeûne, la pauvreté et le silence fussent au nombre des pratiques de mortification les plus strictement imposées à la nouvelle congrégation, c’était surtout par la rigueur de ses pénitences corporelles qu’elle se distinguait. Dans la cellule de son vénérable fondateur, sur le mont Célien, on voit encore aujourd’hui un fouet de fer, garni de clous, qui est un souvenir, non-seulement des souffrances du père Paul lui-même, mais aussi de celles de sa famille italienne. L’objet de ces mortifications n’était pas moins remarquable que leur intensité. La pénitence sans doute est, à un certain point de vue, la fin de toute mortification, mais dans l’esprit des Passionnistes l’usage de la discipline est spécialement destiné au profit du prochain. Ils appliquent leurs souffrances au soulagement des âmes du purgatoire, ou bien ils se les infligent pour réveiller la ferveur d’un auditoire inattentif. Dans leurs missions, quand leurs discours semblent ne produire aucun effet, on les a vus parfois découvrir soudain leur poitrine et leurs épaules, et se frapper de couteaux aiguisés ou de rasoirs, en criant à leur auditoire terrifié qu’ils ne feraient point miséricorde à leur chair, jusqu’à ce que ceux à qui ils s’adressaient eussent pitié de leurs âmes. Cette charité dévorante ne s’arrêta pas aux frontières de leur patrie. Poussé peut-être par un souvenir attaché à sa maison, pendant bien des années, le cœur du père Paul se dirigea vers une nation du Nord avec laquelle, humainement parlant, il n’avait aucun rapport. En face de Saint-Jean et Saint-Paul, maison des Passionnistes sur le mont Célien, s’élèvent l’ancienne église et le monastère de San Gregorio, la source pure d’où le Christianisme de l’Angleterre est sorti. Là avait vécu le grand pape qui est appelé notre Apôtre, et qui plus tard monta sur la chaire de saint Pierre. De là partirent aussi, pendant et après son pontificat, Augustin, Paulin, Juste et les autres saints qui convertirent nos barbares ancêtres. Leurs noms, qui aujourd’hui sont inscrits sur les colonnes du portique, sembleraient s’être manifestés au vénérable Paul, avoir traversé son esprit et s’y être fixés. Car, chose étrange ! la pensée de l’Angleterre se mêlait à ses prières habituelles, et dans les dernières années de sa vie, après une vision qu’il eut pendant la messe, comme s’il eût été Augustin ou Mellitus, il parlait de ses enfants d’Angleterre.
Il était assez surprenant qu’un seul Italien, au cœur de Rome, eût à cette époque l’ambitieuse pensée de faire des novices ou des convertis dans notre patrie. Mais après la mort du vénérable fondateur, l’intérêt spécial que celui-ci avait montré pour notre île lointaine se manifesta dans un autre membre du même ordre. Sur les Apennins, près de Viterbe, vivait, au commencement de ce siècle, un petit berger, dont l’esprit s’était de bonne heure tourné vers le ciel. Un jour qu’il priait devant l’image de la Madone, il eut le pressentiment qu’il était destiné à prêcher l’Évangile dans une région du Nord. Il n’était guère probable qu’un paysan romain pût jamais être missionnaire ; plus tard, il est vrai, le jeune pâtre devint frère, et puis religieux dans la congrégation des Passionnistes ; mais cela ne semblait pas augmenter pour lui les probabilités d’une mission lointaine. Cependant Dieu avait ses vues, et quoique les moyens extérieurs ne se produisissent pas, peu à peu l’impression de son enfance, restée toujours vivante, prit une forme plus caractérisée, et au lieu du Nord en général, ce fut le nom de l’Angleterre qui se grava dans son cœur. Chose étonnante ! après un certain nombre d’années, sans faire aucune démarche, puisqu’il vivait sous l’obéissance, notre paysan se trouva, à la fin, sur le bord de cette mer orageuse du Nord, d’où César, jadis, aspirait à la conquête d’un nouveau monde. Mais il était toujours aussi peu probable qu’auparavant qu’il traversât le détroit. Néanmoins cela n’était pas impossible ; aurait-il cru autrefois qu’il verrait jamais cette plage du grand Océan ?… Et arrêté sur le rivage, le bon religieux aimait à contempler les vagues agitées, et à se demander si jamais viendrait le jour où elles le porteraient vers cette Angleterre tant désirée. Ce jour arriva, non pas toutefois par suite d’aucune détermination de sa part, mais par le soin de cette même Providence qui, trente années auparavant, le lui avait fait pressentir.
A l’époque de notre récit, le père Domenico de Matre Dei était déjà familiarisé avec l’Angleterre. Il avait eu bien des peines, d’abord par manque d’argent, et puis, plus encore, par manque de sujets. Les années s’écoulaient, et soit que la crainte de la sévérité de la règle (quoique ce fût sans fondement, puisqu’elle avait été mitigée pour l’Angleterre), soit que les droits acquis des autres corps religieux en fussent la cause, sa communauté ne grandissait pas. Il se sentait presque découragé. Mais chaque œuvre vient en son temps. Enfin, les difficultés diminuèrent peu à peu, et l’on vit quelques hommes pleins de zèle, les uns nobles de naissance, d’autres distingués par leurs talents, entrer dans la communauté. Parmi eux, nous devons citer notre ami Willis, qui, à cette époque, avait reçu la prêtrise. Quoique né bien loin de Londres, il n’était pas le dernier venu. Et maintenant, lecteur, vous connaissez mieux les Passionnistes que Reding lui-même, au moment où il se dirigeait vers leur monastère[81].
[81] A ces détails si intéressants donnés par l’auteur, nous croyons devoir ajouter quelques mots.
Le R. P. Dominique de la Mère de Dieu naquit à Viterbe, le 4 août 1793. Il fit sa profession dans l’ordre des Passionnistes à l’âge de 22 ans. C’est seulement en 1840 qu’il quitta l’Italie avec trois de ses confrères pour venir s’établir à Boulogne, en France. Mais le gouvernement d’alors qu’épouvantait tout habit de moine ne permit pas à ces quatre religieux de vivre tranquillement au fond de leurs cellules. Obligés de sortir de la France, ils allèrent se réfugier à Ere, près Tournai (Belgique), et ils y fondèrent une maison. Deux ans plus tard, le P. Dominique touchait enfin à ce sol d’Angleterre si ardemment désiré. C’était le 17 février 1842. Depuis cette époque jusqu’au 27 août 1849, jour où il est mort subitement, cet admirable religieux a opéré un bien immense sur ce nouveau théâtre de son zèle. Ses vertus éminentes, surtout sa charité intelligente et douce, ont attiré à la Foi un grand nombre de protestants, parmi lesquels on compte l’auteur lui-même de Perte et Gain.
Ce pieux serviteur de Dieu a laissé de nombreux écrits, dont un seul, croyons-nous, a été traduit jusqu’à présent. C’est un ouvrage intitulé : Excellence de Marie et de son culte, en 2 vol. in-12.
Le premier objet qui se présenta à Charles fut la porte de l’église. Comme elle était ouverte, il y entra. Les fidèles arrivaient pour un office. Lorsqu’il eut passé le vestibule, la personne qui le précédait immédiatement lui présenta le bout de ses doigts qu’elle avait trempés dans un bassin d’eau placé à l’entrée. Charles ignorant le but de cette action, et se sentant embarrassé de cette ignorance, se retira de côté, et chercha un coin pour s’y réfugier ; mais tout l’espace était ouvert, il n’y avait pas moyen de se cacher. Cependant, chacun paraissait occupé de soi. Nul ne fit attention à lui, et il se sentit ainsi plus à l’aise. Il se tint debout près de la porte, et promena ses regards dans l’église. Un grand nombre de cierges s’allumaient sur le maître-autel, situé au centre d’une abside semi-circulaire. Il y avait environ une demi-douzaine d’autels latéraux. La plupart n’étaient pas éclairés. On y voyait malgré cela quelques adorateurs solitaires. Sur l’un d’entre eux était un grand crucifix antique, aux pieds duquel brûlait une lampe, et celui-là était visité par une suite non interrompue de personnes. Elles s’y arrêtaient chacune cinq minutes, lisaient quelques prières dans un tableau attaché à la balustrade, et passaient outre. A un autre autel, qui se trouvait dans une chapelle au bout de l’un des bas-côtés et qui était surmonté d’une image, brûlaient six longs cierges. En regardant avec attention, Charles reconnut que c’était une image de Notre-Dame, et que le petit Enfant Jésus tenait un rosaire. Là était déjà réunie une assemblée, ou plutôt on y célébrait un office qui lui était inconnu. C’était rapide, alternatif, monotone. Comme cet exercice pieux paraissait interminable, Charles tourna ses yeux ailleurs. Il vit deux confessionnaux, chacun environné d’un petit groupe de personnes à genoux qui attendaient leur tour pour se présenter au sacrement de Pénitence ; les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Au bas de l’église étaient trois rangées de bancs mobiles avec dossiers et agenouilloirs. Le reste de l’espace était ouvert et rempli de chaises. Mais l’objet qui attirait surtout l’attention en ce moment, c’était le maître-autel. Cependant chaque fidèle, en entrant, prenait une chaise et, s’agenouillant derrière, se mettait à prier. L’église finit par se remplir. Riches et pauvres, artisans, jeunes élégants et ouvriers irlandais, mères et enfants, tous étaient confondus, sans autre distinction que la séparation des femmes d’avec les hommes. Une troupe de garçons et de petits enfants, mêlés à quelques vieilles femmes, avaient pris possession de la balustrade du chœur, et la secouaient avec des mouvements convulsifs comme dans l’attente de quelque chose.
Quoique Reding fût resté debout, nul n’aurait fait attention à lui ; mais il vit que le temps était venu de s’agenouiller. Il alla se mettre au coin du banc le plus rapproché. A peine avait-il pris place, qu’une procession avec des cierges passa de la sacristie à l’autel. Vint ensuite quelque chose qu’il ne put comprendre, et soudain commença un chant qu’il reconnut être une litanie, aux paroles Miserere et Ora pro nobis. Une hymne suivit. L’attention de l’assemblée était si profonde, sa dévotion si ardente, que Reding pensa qu’il n’avait jamais, jusqu’à ce jour, assisté à un véritable acte de culte. Ce qui le frappa particulièrement, ce fut que, tandis que dans l’Église anglicane le ministre ou l’orgue est tout et le peuple rien, sauf le clerc qui le représente, ici c’était précisément l’inverse. Le prêtre parlait à peine ou du moins presqu’à voix basse ; mais tous, dans l’assemblée, comme un immense instrument ou Panharmonicon, ne formaient qu’une seule voix, tout en paraissant n’agir, chacun, que d’après sa propre inspiration. Ils ne semblaient avoir besoin d’aucune impulsion étrangère ni d’aucune direction, quoique dans la litanie le chœur chantât alternativement. Les paroles étaient en latin, mais on eût dit que tous en comprenaient la valeur, et qu’ils offraient leurs prières à la Sainte-Trinité, au Sauveur incarné, à la puissante Mère de Dieu et aux Saints glorifiés, avec une ardeur égale à l’énergie de leurs cantiques. Près de Charles se trouvaient un petit enfant et une pauvre femme qui chantaient de toute la force de leurs poumons. Il n’y avait pas à s’y méprendre, Reding se dit à lui-même : « Voilà une religion populaire. » Il jeta de nouveau un regard dans l’église. Comme nous l’avons dit, elle était très-simple, et l’on voyait qu’elle n’était pas finie ; mais le Temple vivant qui s’y manifestait n’avait besoin ni de sculptures délicates ni de marbres somptueux pour la parachever, « car la gloire de Dieu l’avait éclairée, et l’Agneau en était la lumière ». « Que c’est étrange ! se dit Charles à lui-même, on appelle ce culte un culte de pure forme, et cependant il paraît comprendre indistinctement toutes les classes : enfants et vieillards, gens d’éducation et peuple, hommes et femmes ; c’est l’œuvre du même Esprit en tous, qui d’un grand nombre ne fait qu’un seul corps. »
Pendant qu’il réfléchissait ainsi, il y eut un changement dans l’office. Un prêtre, ou un assistant, était monté quelques secondes sur l’autel et y avait pris un calice ou un vase qui s’y trouvait ; Charles ne pouvait voir d’une manière distincte. Un nuage d’encens s’éleva vers la voûte. Soudain tous les fronts s’inclinèrent jusqu’à terre. Que signifiait cet acte ? La vérité brilla aux yeux de Reding d’une manière terrible, mais douce pourtant : c’était le Seigneur incarné qui reposait sur l’autel, et qui était venu pour visiter et bénir son peuple ; c’était l’auguste présence qui fait d’une église catholique un sanctuaire unique ; qui en fait ce qu’aucun autre lieu ne saurait être, un lieu saint… A cette époque, les offices du bréviaire n’étaient plus inconnus à notre jeune ami, et au moment où il se prosterna sur le pavé, dans un mouvement subit d’anéantissement et de joie, quelques paroles de ces grandes antiennes, dont Willis, dans une circonstance, avait cité quelques phrases, lui vinrent sur les lèvres : « O Adonaï, et Dux domûs Israel, qui Moysi in rubo apparuisti ; O Emmanuel, Exspectatio gentium et Salvator earum, veni ad salvandum nos, Domine Deus noster. »
Après cette cérémonie, l’office ne dura plus longtemps. En relevant la tête, Charles vit que l’assemblée s’écoulait avec rapidité et qu’on éteignait les lumières. Il comprit qu’il fallait se hâter. Il se dirigea donc vers un frère convers, qui attendait pour fermer les portes, et le pria de le conduire au supérieur. Le bon frère craignait que celui-ci ne fût occupé en ce moment. Toutefois, il conduisit Charles dans une petite chambre bien propre, où notre ami, laissé à lui-même, eut le temps de rassembler ses pensées. A la fin, le supérieur parut. C’était un homme au-dessus de l’âge mûr, d’un maintien à la fois grave et bienveillant. Les sentiments de Reding étaient indicibles, mais tous pleins de charme. Son cœur battait fort, non de crainte ni d’anxiété, mais d’un frémissement de plaisir, en pensant qu’il était sous le toit d’une communauté catholique et en face d’un de ses prêtres. En un moment son trouble disparut, et il se sentit enivré de joie. A peine pouvait-il dominer son émotion ; il craignait d’être pris pour un fou. Il présenta la carte de son compagnon de voyage. Le bon Père sourit, en voyant le nom de l’ecclésiastique ; mais ce fut avec une satisfaction toute particulière qu’il lut les paroles aimables que celui-ci avait tracées au crayon. Charles ne tarda pas à s’entendre avec le supérieur. Grâce à Willis, il était déjà connu dans le couvent. Il fut arrêté qu’il logerait tout de suite chez ses nouveaux amis, et qu’il y resterait tant que cela lui conviendrait. La première chose à faire, c’était de se préparer à la confession, et l’on espérait qu’ainsi il pourrait être reçu, le dimanche suivant, dans la communion catholique. Après cet acte solennel, il aurait à se présenter à l’évêque, au moment convenable, pour lui demander le sacrement de Confirmation. Peu de temps lui suffit pour faire transporter ses bagages au couvent, et une heure après son entrevue avec le supérieur, il était assis seul, avec plumes, papier, livres, et devant un feu joyeux, dans une cellule de sa nouvelle habitation.
Quelques mots vont nous conduire à la fin de notre récit. C’était le dimanche matin vers les sept heures ; Charles avait été admis dans la communion de l’Église Catholique depuis une heure environ. Il était encore à genoux dans l’église des Passionnistes, devant le tabernacle, jouissant d’une paix profonde et d’une sérénité d’esprit qu’il n’aurait pas crues possibles sur la terre. C’était plus que le calme qui affecte sensiblement l’oreille, lorsqu’une cloche s’arrête après avoir tinté longtemps, ou lorsqu’un vaisseau, après le ballottement des vagues, se trouve dans le port. C’était une sensation si douce, qu’il se croyait reporté par le souvenir à ses plus tendres années, qu’il lui semblait recommencer l’existence. Mais il y avait plus que le bonheur de l’enfance dans son âme : il lui paraissait sentir un roc sous ses pieds ; c’était soliditas Cathedræ Petri. Il continua à rester à genoux, comme s’il eût été déjà dans le ciel, ayant le trône de Dieu en face, et les anges tout autour de lui ; comme si, en se remuant, il dût perdre cette immense faveur.
A la fin, il sentit une main légère sur son épaule, et une voix lui dit : « Reding, je vais partir ; laissez-moi vous dire adieu auparavant. » Il se retourna, c’était Willis, ou plutôt le père Louis, dans son costume sombre de Passionniste, sur lequel se dessinait un cœur blanc du côté gauche de la poitrine. Willis le conduisit de l’église à la sacristie. « Quelle joie, Reding ! s’écria-t-il quand la porte fut fermée ; quel jour de joie ! La fête de saint Édouard, jour doublement béni désormais. Mon supérieur m’a permis d’assister à la cérémonie ; vous ne m’avez pas vu, mais j’ai été présent à tout. — Oh ! reprit Charles, que dirai-je ?… la face de Dieu ! Comme j’étais à genoux, il me semblait que je ne désirais plus rien que de répéter avec le vieillard Siméon : « Maintenant, laissez-moi mourir, puisque j’ai vu votre face. » — Pour vous, cher Reding, vous sentez dans votre âme toute l’ardeur et tout l’enthousiasme d’un néophyte ; quant à moi, ces sentiments sont déjà émoussés par l’habitude. — Non, Willis, non ; vous avez pris la meilleure part de bonne heure, tandis que j’ai temporisé. Trop tard, je t’ai connue, Vérité ancienne ; trop tard je t’ai trouvée, première et unique Beauté ! — Tout est bien, mon cher ami, excepté ce que le péché rend mauvais. Si vous avez à pleurer la perte du temps avant votre conversion, j’ai à déplorer aussi de l’avoir perdu après la mienne. Vous parlez de délai : ne dois-je pas parler de précipitation ? Un Dieu bon gouverne toutes choses… Mais il faut que je vous quitte. Vous rappelez-vous mes dernières paroles, lorsque nous nous séparâmes dans le Devonshire ? J’y ai souvent pensé depuis cette époque ; elles étaient trop vraies alors. Je vous disais : « Nos voies se divisent. » Aujourd’hui elles restent encore différentes, et cependant désormais elles seront les mêmes. Nous reverrons-nous ici-bas ? qui le sait ? mais encore un peu de temps, et il y aura une réunion éternelle devant le trône de Dieu, à l’ombre de sa Mère bénie et de tous les saints. « Deus manifestè veniet, Deus noster et non silebit. » Charles prit la main du père Louis et la baisa. S’étant jeté à genoux, il reçut la bénédiction du jeune prêtre. Puis le bon père disparut par la porte de la sacristie ; et le nouveau converti rentra dans sa cellule temporaire, si heureux dans le présent qu’il ne songeait ni au passé ni à l’avenir…
FIN.
SOUVENIRS PERSONNELS
DU
MOUVEMENT D’OXFORD,
AVEC DES EXTRAITS
DE PERTE ET GAIN DU DOCTEUR NEWMAN.
CONFÉRENCE
DONNÉE
(AU MOIS DE MAI 1856) AU CLUB POPULAIRE ET CATHOLIQUE D’ISLINGTON
(A LONDRES)
PAR
FRÉDÉRIC OAKELEY,
Maître ès-arts de l’Université d’Oxford, curé de Saint-Jean l’Évangéliste
à Islingten, chanoine
du chapitre métropolitain, et ex-fellow
du collége de Balliol à Oxford.
L’origine, le développement et les résultats du grand Mouvement Religieux qui a pris naissance à l’Université d’Oxford, il y a environ un quart de siècle, et qui en moins de douze ans a donné à la Sainte Église Catholique plusieurs centaines de convertis, ont été si complétement expliqués par le docteur Newman, dans ses célèbres « Conférences sur les difficultés de l’Anglicanisme », que ce serait une témérité coupable de ma part de toucher à un sujet sur lequel, après l’illustre écrivain, on ne pourrait que divaguer ou dire des choses superflues. C’est pourquoi, dans le titre de ma Conférence de ce jour, j’ai eu soin de me renfermer dans des bornes qui me missent moi-même à l’abri de toute tentation ambitieuse, et qui vous épargnassent, à vous, mes amis, un désappointement. Mon simple dessein est de vous présenter les souvenirs personnels d’une époque de ma vie qui, après avoir donné lieu et à des regrets et à de la reconnaissance, a été couronnée par des résultats qui sont pour nous tous un sujet commun de joie. Je dois cependant, dès le début, vous mettre en garde contre la supposition qui pourrait vous faire attendre de moi un article d’autobiographie, ou ce qu’un de nos adversaires appellerait les « Aveux d’un converti ». Ce n’est pas aujourd’hui mon but. Je ne viens pas non plus vous faire « l’Histoire du Tractarianisme ». Ce que je me propose, c’est de me placer dans la position d’un témoin étranger aux faits qu’il raconte, et de considérer à mon point de vue les matières d’Oxford et les événements qui en sont sortis. Si, en traitant ce sujet, je suis obligé de rapporter des circonstances auxquelles j’ai pris part, c’est une nécessité que je dois subir ; mais je ferai de mon mieux pour remplir ma tâche avec le moins de partialité ou d’amour-propre possible.
Mes plus anciens « souvenirs personnels », relativement au premier coup porté aux vieilles habitudes religieuses d’Oxford, remontent au professorat royal du docteur Charles Lloyd, qui, vers l’année 1827, reçut de feu le ministre sir Robert Peel, dont il avait été précepteur, la charge de l’évêché d’Oxford. Le docteur Lloyd était un ecclésiastique très-instruit et de talents hors ligne. Il appartenait à ce petit nombre d’hommes qui, sous un système corrompu, se sentent assez forts pour se choisir un terrain à eux et combattre sans peur les préjugés du jour. Ayant passé une partie de son adolescence dans la société de prêtres français, il s’était formé, d’après leur conversation et leur conduite, une idée des doctrines et de la vie des Catholiques bien différente de celle qui est généralement reçue parmi les Protestants. Sans doute, sa première éducation et ses rapports avec l’Université en avaient fait un protestant ferme ; mais en prenant la fonction si délicate de professeur de Théologie, et en se trouvant disposer de l’influence que sa science et ses talents, joints à une facilité remarquable pour gagner l’affection des élèves, lui donnaient sur les étudiants de sa classe, il chercha à se débarrasser, autant qu’il put, des entraves de sa position et à se jeter, comme on dirait à Oxford, « dans une nouvelle voie ». Il choisit donc, pour sujet de son cours de Théologie l’histoire et la forme du Prayer-Book anglican, sujet qui l’amena, et ses élèves avec lui, à examiner le Missel et le Bréviaire comme étant les sources d’où ont été tirées les principales matières de ce livre de prières. Tout à coup, sans aucune cause connue, on pria M. Booker de New Bond Street de fournir aux étudiants d’Oxford tous les livres de liturgie et d’office que contenait son magasin. M. Booker était trop bon catholique pour traiter une telle demande comme une simple affaire de commerce, et, n’osant pas espérer un miracle, il crut prudemment à un complot. Par une singulière coïncidence, il arriva que j’étais le seul protestant que M. Booker connût à Oxford, et que le seul catholique que je connusse moi-même c’était M. Booker. Aussi je crois que ce fut grâce à moi que ses craintes furent dissipées et que la libre importation des missels et des bréviaires eut lieu à Oxford. Cependant, les leçons du docteur Lloyd continuaient avec un succès soutenu ; et j’ai, ou, pour mieux dire, j’ai eu naguère entre les mains un Prayer-Book anglican avec des feuillets intercalés qui contenaient des renvois aux autorités catholiques, d’après lesquelles le maître prouvait d’une manière triomphante les larges emprunts faits par les Réformateurs anglais à l’ancienne Église. Le pauvre docteur Lloyd, à qui je ne puis penser sans qu’il s’éveille en moi des sentiments d’attachement et de gratitude, tomba, bientôt après, victime de son zèle dans la cause de « l’Émancipation Catholique ». Soudain on le vit changer sa politique dans cette question brûlante, et voter avec son patron, sir Robert Peel, lorsque le ministère, en 1829, adopta ce projet de loi. Cette conduite indisposa contre lui le roi ainsi que son propre clergé. Un jour qu’il siégeait dans la Chambre des Lords (car à cette époque il était évêque), il fut pris d’une fièvre dont il mourut au bout de trois semaines, laissant à Oxford un vide qui, jusqu’à présent, n’a pu être bien comblé. Avec cet illustre professeur disparut l’étude des liturgies ; et les volumes suspects, qui avaient été importés dans un lieu si étrange et qui s’accordaient si mal avec les ouvrages des librairies d’Oxford, furent vendus ou cachés dans les rayons des bibliothèques, au moins pour un temps. La semence, toutefois, avait certainement pris racine, et elle devait porter ses fruits au moment opportun. Aux leçons du docteur Lloyd assistaient John-Henry Newman et Edward Pusey, quoique plus âgés que la majorité de la classe. Parmi ceux qui étaient un peu plus jeunes, on remarquait M. Wilberforce l’ex-archidiacre, M. Froude, feu l’évêque de Salisbury et plusieurs autres, au nombre desquels je me trouvais.
Dans toute la classe, il n’y avait personne sur qui ces leçons fissent une impression plus profonde que sur feu Richard Hurrell Froude. Bien différent de la plupart des hommes de son parti, M. Froude ne vacilla jamais dans son adhésion aux principes catholiques, ou, dans tous les cas, à des principes religieux qui étaient prodigieusement en avant de son époque. L’enseignement du docteur Lloyd, relativement aux matières de liturgie, trouva dans ce jeune homme de vingt et un ans un esprit déjà mûr pour recevoir des impressions favorables même à l’Église de Rome, et fortement contraires à la Réforme. Pendant sa vie si courte, les impressions de M. Froude devinrent chaque année plus profondes, et elles s’étaient transformées en convictions fermes et très-énergiques par le moyen d’austérités personnelles, de la retraite, de l’étude et de la prière ; lorsque enfin (comme toutes les convictions réelles et mûries) elles commencèrent à produire leur effet sur le monde. Ce qui, dans le docteur Lloyd, n’était que de simples « vues », se changeait en motifs dans M. Froude ; et ce qui, pour beaucoup d’élèves de l’illustre professeur, aurait vécu et serait mort comme une simple mode, prit de larges racines, grâce à l’influence de M. Froude, et germa dans la suite en quelque chose d’intimement et d’efficacement pratique. En effet, cela se passait à peu près à l’époque que M. Froude fit la conquête de M. Newman.
Plusieurs années après le temps auquel je me reporte, les « Traités d’Oxford » firent leur apparition[82] dans les circonstances et pour le but que le docteur Newman a pleinement développés dans ses « Difficultés de l’Anglicanisme ». Cependant, le reste d’entre nous, quoique fixés à Oxford et plus ou moins liés ensemble, nous allions chacun dans notre propre direction, qui de ce côté, qui de celui-là ; quelques-uns s’éloignant de toute pratique religieuse, d’autres embrassant une religion très-étrangère à notre éducation et à notre caractère naturel. De toutes les erreurs les plus accréditées touchant la controverse d’Oxford, il n’en est pas de plus palpable que celle qui suppose une ligue, ou une union préméditée entre ceux qui finirent plus tard par se faire catholiques. Chacun de nous, je puis vous l’assurer, nous avions nos vues individuelles qui, comme autant de lames aiguës, s’opposaient à toute vraie combinaison. Il résultait de là que, sur beaucoup de questions importantes, on nous trouvait dans des camps opposés. Nous avions tous nos occupations particulières, nos propres intérêts, des réunions différentes ; et lorsque les hommes dont les noms sont généralement les plus mêlés au Mouvement d’Oxford se rencontraient dans un salon, il y avait une certaine réserve froide et une crainte mutuelle de collision ; ce qui loin de favoriser, gênait plutôt les rapports entre nous. Aussi beaucoup des plus sincères partisans des opinions régnantes se rendaient-ils dans des sociétés où ils trouvaient sans doute moins d’essor à leur enthousiasme, mais aussi moins de danger d’être en désaccord.
[82] Le premier de ces traités parut en 1833.
Pendant ce temps, toutefois, le levain de la vraie religion montait sous la surface. Les hommes (et ils étaient nombreux) qui traitaient toute l’affaire avec mépris, et qui pensaient sérieusement que cette furore catholique était une simple fantaisie du jour, qui aurait son temps et qui s’évanouirait aussi vite et aussi complétement que l’intérêt d’un nouvel opéra ; ces hommes, dis-je, connaissaient peu l’étendue et la force de la puissance qu’ils avaient à combattre. Ils ne savaient pas quels phénomènes s’accomplissaient dans les chefs de la controverse, ces savants qui étaient, et non pas nous, la vie et l’âme de tout. Ils ignoraient quelles clartés des études patientes apportaient, chaque jour, à leur intelligence ; quelle vigueur la mortification corporelle imprimait à leur âme ; quelle maturité une marche solide donnait à leurs principes, et surtout combien le dénoûment se précipitait sous l’influence de leurs prières persévérantes. Ces observateurs bien intentionnés, mais à courte vue, tiraient leurs arguments d’opposition de ce qui, dans de semblables mouvements, se fait le plus remarquer, je veux dire des folies et des extravagances des disciples. Ceux-ci, je le crois, agirent souvent comme des aveugles providentiels, destinés à détourner l’attention de ce qu’il y avait de positif dans l’œuvre. De temps à autre, il est vrai, une circonstance venait montrer qu’il y avait, sous cette agitation, un principe plus profond et une force plus réelle qu’on ne le pensait ; mais Oxford est habitué à des troubles de ce genre, et rarement on les y a vus survivre aux grandes vacances. La controverse Hampden, la controverse Faussett, et je ne sais combien d’autres d’une moindre importance, étaient là pour prouver que les hommes qu’on avait sottement supposés morts, enterrés et oubliés, étaient, en réalité, pleins de vigueur et prêts à l’action au moment voulu. Mais le grand corps universitaire ne voyait que peu à peu, et ne voulait pas se convaincre que le cheval de bois qui s’avançait si pesamment et si majestueusement était rempli de guerriers armés de pied en cap pour la lutte. A la fin, parut le célèbre Traité XC[83]. Ce fut lui qui véritablement donna l’alarme, en proposant une interprétation des XXXIX Articles qui aurait permis de les signer en conscience aux personnes déjà fort avancées dans la voie du Catholicisme. L’esprit académique s’en émut, et il trouva, mais trop tard, que le danger imminent ne pouvait désormais être écarté par un sermon de circonstance à Sainte-Marie, ni par le renvoi d’un sous-gradué suspect. Le malencontreux Traité reçut de l’Hebdomadal Board[84] une flétrissure qui fut pour lui un imprimatur plutôt qu’un stigmate ; car le produit énorme de sa vente permit à son auteur de rassembler, sous la forme d’une excellente bibliothèque de théologie, des matériaux pour étendre le mal. Cependant la thèse de ce Traité trouva des défenseurs, et, il faut l’avouer, ceux-ci exagérèrent sa théorie touchant la signature des Articles. Ils y firent entrer toute « la doctrine romaine » (avec la plus grande pureté d’intention, j’aime à le croire) par la porte qui avait été ouverte pour admettre simplement la partie élevée de l’Anglicanisme ; et ils bâtirent sur la base du docteur Newman des conclusions que celui-ci rejetait, mais qu’il ne pouvait ostensiblement attaquer sans faire encourir à l’Établissement un danger plus immédiat que celui qu’il lui créait par son silence.
[83] On trouve une excellente analyse de ce traité dans l’ouvrage de M. J. Gondon, intitulé : du Mouvement religieux en Angleterre. — Ce traité XC parut en 1841.
[84] L’Hebdomadal Board est un comité formé de tous les chefs des établissements d’Oxford.
Il est difficile de parler de ces incidents sans vous amener à penser, mes chers auditeurs, que le docteur Newman, l’auteur de ce célèbre Traité, agissait dans un esprit d’astuce et d’insubordination. Rien ne saurait être plus loin de la vérité. Le docteur Newman croyait, d’une conviction ferme, que les Articles de l’Église d’Angleterre pouvaient être interprétés, en conscience, de la manière qu’il l’établissait, et qu’ils l’avaient été par des hommes de mérite de cette communion depuis le commencement de son histoire. Il agissait aussi entièrement en vue du système établi, et (si les autorités d’Oxford avaient connu leur véritable intérêt) en vue de l’Université elle-même. Il savait mieux que ces messieurs la profondeur et la réalité des aspirations vers Rome ; il savait également que le moyen d’encourager ces tendances, c’était d’arrêter, sans nécessité, l’interprétation des Trente-neuf Articles. J’avoue, néanmoins, qu’il était impossible de faire la tentative de donner à ce formulaire une interprétation nouvelle, quoique vraie, sans qu’il y eût un semblant de subtilité de la part de l’auteur et la certitude d’un malentendu. Mais en encourant ces conséquences, le docteur Newman faisait ce qu’il s’est montré toujours prêt à faire : il se sacrifiait à un devoir public manifeste. Si les autorités d’Oxford avaient eu assez d’esprit pour se laisser guider par le docteur Newman, et si elles avaient permis au Traité XC d’atteindre son but sans lui chercher querelle, je ne dis pas qu’elles eussent empêché les conversions subséquentes à l’Église, mais elles les auraient retardées indéfiniment. Grâces soient rendues à Dieu qui en a ordonné d’une autre manière ! Si le docteur Newman veut me permettre de lui offrir le témoignage d’une connaissance de près de trente années, relativement à un côté de son caractère, je dirai que si jamais il y eut un homme qui agît simplement en vue de l’objet placé devant lui, et qui fût dépouillé de ce qu’on peut appeler l’esprit diplomatique, cet homme c’est lui. Qu’un homme de ce genre pût être mal compris du monde, c’est un fait qui n’est ni nouveau ni inexplicable. — Il n’est pas inexplicable, parce qu’il n’y a rien qui ennuie le monde (si je puis user de cette expression familière) comme la simplicité, surtout quand il la trouve jointe à une profondeur à laquelle n’atteint pas sa pénétration ; il n’est pas nouveau, parce que ce fut le lot de saint Paul et de ses compagnons d’être regardés « comme des séducteurs, quoique sincères[85]. »
[85] II Cor. VI, 8.
Tandis qu’Oxford faisait son œuvre à sa manière, un effort du même genre, quoique indépendant, se poursuivait dans une petite chapelle qui « n’est pas à plusieurs milles » de Cavendish square[86]. Cette chapelle, qu’on a poétiquement dédiée à sainte Marguerite, ne devait certainement pas son nom à une sainte quelconque, mais à une dame titrée ; et je puis l’assurer, en 1839, alors que je la connus pour la première fois, ses antécédents et son caractère révélaient un tout autre calendrier que celui de l’Église. C’était le champ le plus stérile qu’on pût imaginer pour faire un essai de Catholicisme. Son origine était protestante au dernier degré, allant se perdre dans un siècle de ténèbres très-rapproché de nous, et pire encore que la Réforme. Le représentant de ses traditions et le type de son caractère (encore avait-il pour lui l’avantage de l’antiquité) était un vieux clerc, à perruque brune, qui avait connu l’édifice « homme et enfant », presque depuis son origine. Cet édifice avait été construit vers l’époque de la Révolution française, et avait été d’abord une espèce de temple du déisme. Après une ou deux phases de transition, il devint une chapelle à la mode, et sa chaire fut successivement occupée par des défenseurs de l’Établissement, de l’Irvingisme, de l’Anglicanisme et d’une espèce de Tractarianisme modifié. Sous la dernière administration, ce temple était presque désert. Dans cet état de choses, l’évêque jugeait complétement inutile de remplacer le ministre sortant, lorsqu’il accepta, non sans quelque crainte, je pense, une offre que lui fit Oxford d’y mettre un homme de son choix.
[86] A Londres.
Toute l’histoire de Margaret-Chapel se retrouvait dans sa construction et dans son arrangement. Des galeries garnissaient les murailles ; les bancs fermaient l’espace. Naturellement, il n’y avait pas de sanctuaire ; mais immédiatement en face de la table de communion, et de manière à la masquer, s’élevait une énorme chaire, d’où le pupitre et le banc du clerc se détachaient et venaient finir dans le corps du bâtiment en échelle décroissante de proportion. Telle était Margaret-Chapel, lorsqu’elle passa sous l’administration d’un ecclésiastique d’Oxford, dont la principale qualité pour cette charge était une ferme résolution, dût-il échouer, d’appliquer les principes religieux qu’il avait appris d’hommes qui lui étaient bien supérieurs en science et en talents.
Ces principes, on ne peut le nier, se montrèrent assez vrais et assez forts pour tenir bon contre des obstacles sérieux. Le champ de l’action, quelque désavantageux qu’il fût, donna libre carrière à des essais religieux différents de ce qu’on aurait pu tenter, même à Oxford ; et cela, tout en suivant les principes de cette ville, et surtout celui de ces principes qui a été défendu en théorie comme en pratique par le véritable fondateur de cette école, le docteur Newman. L’ordre et la beauté qu’on introduisit dans le culte divin étaient choses nouvelles pour le Londres protestant, mais l’expérience prouva combien cette innovation était en rapport avec les besoins de la nature humaine. La chapelle elle-même, malgré sa difformité, ne se montra pas aussi contraire qu’on aurait pu l’attendre à l’introduction des cérémonies. Grâce à des conseils judicieux et à de généreuses offrandes, l’intérieur de l’édifice prit un nouvel aspect. La chaire et le pupitre furent enlevés de leur ancienne position ; et le pauvre clerc prit place, à contre-cœur, dans le corps de là chapelle, sans pouvoir, toutefois, réussir jamais à chanter son amen d’un ton convenablement soumis. La table de communion, qualifiée maintenant du nom d’autel, était couverte d’un tapis cramoisi, sur lequel reposaient une croix et des chandeliers, dont les cierges non allumés restaient comme un signe permanent de l’inflexibilité épiscopale et comme l’emblème d’une espérance patiente. Les cierges, cependant, ne demeurèrent pas toujours éteints ; car périodiquement la nuit remplaça le jour, et parfois la nature vint nous favoriser d’un brouillard propice.
Tout ceci, mes amis, doit vous paraître quelque chose d’infiniment absurde. J’en conviens, je ne saurais justifier ces cierges non allumés, et encore moins cet attachement excessif pour des brouillards. Mais, à part quelques extravagances de ce genre, toute cette réforme, je vous l’assure, avait son côté sérieux et sa réalité, comme l’ont prouvé, vous l’admettez, je pense, ses résultats auxquels on ne songeait pas même alors : Margaret-Chapel a donné quelques vingtaines de convertis à l’Église Catholique, en y comprenant quatre de ses ministres successifs ; et cela, alors qu’on ne se proposait autre chose que de travailler à l’avancement de l’Église d’Angleterre. Cette chapelle a continué son œuvre, après que je l’ai eu quittée. A cette heure elle est devenue une des plus magnifiques églises du royaume, et elle est appelée, j’en suis convaincu, à poursuivre encore sa mission. D’après quelles idées ou d’après quels principes elle a été administrée depuis mon départ, c’est ce que j’ignore ; mais je sais que celui qui m’a succédé dans l’administration, et qui est encore son ministre actuel, est un homme d’une vie irréprochable, d’une très-haute probité, du plus aimable caractère et d’intentions très-droites. Aussi ne douté-je pas qu’il ne sorte beaucoup de bien des efforts sincères d’un tel ecclésiastique, quoique je ne puisse pas voir présentement de quelle manière. Il me sera plus facile de dire quelle pensée présidait à l’administration de Margaret-Chapel, lorsque j’en étais chargé. Notre principal objet était d’élever le caractère moral et religieux de notre troupeau, par le moyen d’un enseignement aussi catholique que le permettait une loyale interprétation des formulaires reçus. Nous étions persuadés que, puisque l’Église d’Angleterre était historiquement et positivement une Église nationale, il y avait place dans son sein pour toutes les phases de la religion protestante qu’on pourrait faire entrer dans ses formulaires, évidemment latitudinaires de l’aveu de tous ; et, de plus, qu’il s’y trouvait aussi de la place pour cette forme extrême d’Anglicanisme, Protestante seulement jusque-là qu’elle n’est pas Romaine. Je ne veux pas, pour l’heure, défendre cette manière de voir ; mais quelque absurde et peu justifiable qu’elle puisse paraître aujourd’hui, je crois (et c’est la seule excuse que j’apporterai en sa faveur) que c’était là, au fond, une honnête méprise. Quant à la partie liturgique de la question, nous étions convaincus que, comme les Articles de l’Église d’Angleterre donnaient une grande latitude, en ce qui touche à la vraie doctrine ; ainsi ses rubriques donnaient, également, une latitude non moins grande en ce qui regarde les cérémonies. Mais il est évident que cette interprétation de l’objet dont il s’agit, quoique vraie en thèse générale, était renversée, dans les deux cas, par ce Protestantisme d’esprit qui anime toute l’Église et toute la nation d’Angleterre : Protestantisme qui, après tout, et non pas la lettre des formulaires, est le vrai signe distinctif du caractère de la religion nationale. Le génie de l’Église Catholique s’harmonise avec ses doctrines et ses pratiques de dévotion. C’est là le véritable secret de notre force et de nos succès. La doctrine et les observances catholiques sont en tout point opposées aux maximes et à l’esprit du monde. Laissées à elles-mêmes, sans union, sans rapports visibles, sans traditions, et, par-dessus tout, sans secours surnaturels, cette doctrine et ces observances n’auront jamais de chance de succès dans la lutte avec les puissances des ténèbres. « La doctrine romaine » sans autorité, et les pratiques catholiques sans fondement, ne peuvent avantageusement lutter contre les comités paroissiaux, les Parlements et les Conseils privés. Il n’est pas nécessaire d’avoir l’œil prophétique pour prévoir que l’histoire des vingt dernières années de l’Église anglicane sera l’histoire des vingt années à venir, seulement avec une répétition plus marquée des mêmes traits. Les sentiments catholiques se développeront à l’ombre de la tolérance, et ils se répandront grâce à la lutte. Les évêques anglicans n’agiront pas jusqu’à ce qu’ils y soient contraints ; mais ils trouveront la punition de leurs délais dans la résistance vigoureuse de l’œuvre qu’ils auront à renverser. On doit les plaindre, et non pas les blâmer. La tâche qu’ils ont à remplir aurait défié les forces d’un Athanase ou d’un Ambroise. Pour des hommes tranquilles, produits de temps de calme, c’est déjà une besogne assez dure que de détruire seulement l’empire du mal ; et, cependant, les autorités de l’Église d’Angleterre ont entrepris une œuvre plus rude encore, — elles luttent avec l’Esprit de Dieu.
Me proposant de vous donner une juste idée du célèbre récit du docteur Newman, autour duquel je veux grouper toutes les observations de ma Conférence de ce jour, il m’est nécessaire de vous parler encore quelques instants de la partie esthétique (ou de fantaisie) du Mouvement. Il est certain que parmi les hommes d’un esprit raffiné, mais d’une éducation superficielle, comme il s’en trouve à nos deux grandes universités, plusieurs voulaient embrasser le côté facile du Catholicisme et repousser le côté pénible ; suivre cette religion comme sentiment, et ne pas en tenir compte comme règle. Toute une coterie de ces amateurs catholiques venait de paraître, et, soit dit en passant, je ne nierai pas que beaucoup d’entre nous ne fussent, plus ou moins, en danger de tomber dans cette grande erreur. Les uns s’attachèrent à l’architecture ; d’autres aux cérémonies, selon la pente de leur goût naturel, selon les sociétés, locales ou étrangères, avec lesquelles ils étaient le plus en rapport. La manie de l’architecture était, à bien des égards, plus élevée, plus honorable et plus populaire que l’autre ; et pour cette raison, peut-être, elle n’était pas moins dangereuse. C’est une bonne fortune pour la cause de la vérité, lorsque l’erreur se trahit elle-même. Or, tel fut précisément le cas dans les excès qui se rapportaient aux cérémonies religieuses. Des révérends furent accusés, avec assez de vraisemblance, de brûler de l’encens en guise de pastilles ; et « les fleurs sur l’autel » furent défendues avec un zèle qui aurait fait honneur à un confesseur de la foi. On racontait aussi que certains ministres avaient fait des génuflexions devant des évêques, malgré les protestations de ceux-ci, que d’autres s’étaient inopinément présentés à eux en surplis ou en chapes. On disait (et sans doute par plaisanterie, mais des plaisanteries de ce genre témoignent de réalités), on disait que la doctrine de l’intercession des saints avait été fondée sur la « prière de saint Chrysostome » qu’on trouve dans le service du matin. Ce qu’il y a de sûr, c’est que le « louez le Seigneur » avait suggéré l’introduction des neuf alléluia chantés en chœur. Un second avantage, c’est que, relativement à ces extravagances, les Catholiques Anglais, comme les étrangers, nous étaient visiblement opposés. Mais le contraire de tout cela était vrai en ce qui regarde l’engouement architectural. Le goût des cérémonies n’est nullement anglais. Tous les préjugés de la nation devaient donc s’élever contre cette nouveauté. Mais il n’en est pas de même de l’alliance du Catholicisme avec l’art. Nos magnifiques cathédrales, dont l’origine catholique est un fait d’histoire, tandis que leur destination protestante n’est qu’un simple fait de possession, sont des liens naturels entre l’ancienne religion et l’esprit national, et ce n’est pas évidemment sans raison qu’on les regardait, avec les idées qu’elles font naître, comme une base commune sur laquelle Protestants, Anglicans et Catholiques pourraient signer leur union. La grande société Camden, à Cambridge, comptait parmi ses membres des dignitaires de l’Établissement, et même un évêque. Ces messieurs, cependant, ne se proposaient qu’une renaissance religieuse. Il y a plus : les Catholiques Anglais, qui restèrent toujours en dehors des sympathies de « l’Anglo-Catholicisme », furent regardés avec faveur à cause de leur intérêt bien connu pour cette face du grand prodige Tractarien. Tout cela, naturellement, et pendant un certain temps, paraissait un avantage ; mais le docteur Newman, il n’y avait pas à s’y tromper, ne put jamais voir avec la moindre satisfaction ce résultat particulier de son œuvre, qu’il avait, au reste, prédit clairement. Il vit, dès le principe, ce que le fait prouva bientôt, que la phase architecturale du Mouvement était aussi vide que celle du rituel ; et cela, pour les raisons que nous venons de donner, et pour d’autres peut-être. Il avait toujours dit que ce serait un jour malheureux pour la cause de la vérité que celui où l’idée de la beauté extérieure de la Religion prendrait le pas sur l’idée de sa sévérité. Or, cela fit que les hommes (à la tête desquels se trouvait le docteur Newman) qui regardaient les cérémonies de la religion comme une expression de la majesté, de la beauté et de l’ordre divins, s’efforcèrent, à la même époque, avec plus ou moins de succès, de témoigner par leurs actes publics de l’importance d’une Religion sérieuse. On craignait que, une fois dépouillé du caractère particulièrement moral de l’enseignement d’Oxford, l’intérêt pour la grande œuvre manquât d’un contre-poids salutaire.
Ce qui protégea surtout Oxford contre les notions mal comprises ou superficielles, ce furent les sermons que le docteur Newman donnait, toutes les semaines, du haut de la chaire de Sainte-Marie. Ces admirables discours étaient suivis par tous ceux qui prenaient intérêt à la grande controverse, et ils fournissaient l’aliment spirituel aussi bien qu’intellectuel qui soutenait le religieux Oxford dans l’intervalle. Les esprits les plus profonds, alors même qu’ils n’en goûtaient pas encore entièrement les doctrines, y trouvaient, au moins, matière à faire des recherches. Les plus simples et les moins instruits des étudiants eux-mêmes n’y assistaient jamais sans en emporter quelque leçon inappréciable de sagesse et de vérité pratiques. Non-seulement la doctrine, mais le culte anglican aussi trouvait à Sainte-Marie une vie et une puissance nouvelles. La majesté calme et le pathétique touchant qu’on savait y répandre lui donnaient presque le cachet de vraies cérémonies. Je vois encore, à cette heure, le maintien recueilli des assistants qui annonçait des cœurs pénétrés jusqu’au fond du sentiment de leur acte religieux ; j’entends encore, avec ses chutes plaintives et ses pauses saisissantes, le chant mélodieux qui devenait pour les paroles sacrées un commentaire admirable, et qui donnait au narré de l’Écriture l’intérêt le plus haut et la réalité la plus vivante. Telles furent donc, parmi les influences rassurantes, celles qui préservèrent Oxford en grande partie d’une fausse direction.
Mais revenons à notre sujet. Les résultats de cet engouement pour l’architecture et pour les cérémonies avaient, dans les deux cas, le même cachet d’excentricité, lorsqu’ils manquaient de ces puissants correctifs moraux et religieux. Ce qui correspond proprement à l’art du moyen âge, non moins qu’aux cérémonies (comme tout le monde l’admettra), c’est le culte catholique et pas un autre ; aussi les églises bâties, d’après les modèles catholiques, pour le service protestant, sont de tous les charlatanismes le plus grotesque, parce que c’est le plus pompeux. Cependant, vers cette époque, le grand Mouvement d’Oxford, celui qui était basé sur des principes vraiment solides, et qui était environné à son centre des réalités les plus sérieuses, devait se voir accuser faussement de toutes ces applications extravagantes. Les folies des disciples zélés, mais indiscrets, ne voulurent pas s’éteindre avec les cierges, ni s’évaporer avec l’encens : elles aspirèrent à vivre sur le bronze séculaire et la pierre impérissable. Des autels sans sacrifice, des jubés qui ne cachaient pas de mystères, des niches de saints, des bas-côtés sans processions, et des sanctuaires sans la très-sainte Présence donnaient un corps à ces brillantes illusions et les perpétuaient. Des piscines ouvertes appelaient, mais en vain, les restes des éléments, casuel ordinaire du clerc. On construisait des bénitiers qui devenaient le réceptacle de la poussière et des toiles d’araignée ; des anges sculptés se trouvaient logés dans des demeures surprises de les voir ; et des démons à face hideuse s’échappaient, comme en fuyant, des porches du temple, tandis que, pour une raison contraire, ils auraient bien pu continuer à y habiter en toute sécurité.
Nous devons toutefois ajouter, en bonne justice, que les essais de Catholicisme se faisaient aussi dans une sphère plus haute. A la même époque, plusieurs établissements religieux poursuivaient leur marche avec succès, au profit de chacun de leurs membres en particulier, comme de la communauté en général ; et cela, malgré tous les désavantages effrayants du système protestant. Parmi ces maisons se faisait remarquer, au premier rang, sous tous les rapports, le collége fondé par le docteur Newman à Littlemoor[87], près d’Oxford. Si je ne me trompe, feu le R. P. Dominique, autorité de poids en ces matières, a dit, à cette époque, dans le Tablet[88], que cette institution lui rappelait les monastères catholiques de la plus rigoureuse observance. Il m’a été donné plusieurs fois de passer quelques jours dans cette aimable retraite avec le docteur Newman, et, j’aime à le proclamer, celui qui se rappelle le sentiment de calme religieux que l’âme y éprouvait ; la bibliothèque avec son vrai parfum d’ouvrages théologiques ; les lecteurs studieux qu’on voyait dans cette salle, chacun assis à une table séparée avec son in-folio ; le silence de ce lieu, rendu sensible par le mouvement monotone de la pendule placée sur la cheminée ; celui encore qui a toujours partagé le repas frugal et silencieux de la communauté, dans un réfectoire bien pauvre, ou qui a assisté aux Heures dans la sombre petite chapelle, remarquable par son grand rideau rouge, son crucifix et son air de solitude impénétrable ; — celui-là, dis-je, qui a été témoin de ce spectacle, doit reconnaître forcément qu’il n’y avait pas là de « charlatanisme. » Disons-le, c’était l’ascétisme du désert qui conduit au Christ. Et qu’un établissement si remarquable à tous les points de vue, si magistral dans sa conception, si habilement dirigé, si dépourvu, selon toutes les apparences, de tout ce qui pouvait faire naître le désir d’un changement ou l’espoir d’une amélioration ; qu’un tel établissement pût tomber tout à coup, sans pression extérieure et sans décadence intérieure, c’était là peut-être la preuve la plus évidente pour ses hôtes qu’ils n’avaient pas de « cité permanente »[89] hors de l’Église de Dieu.
[87] C’est dans cette maison de retraite que le père Newman a fait son abjuration avec deux de ses disciples, le 9 octobre 1848.
[88] Journal anglais catholique.
[89] Héb. XIII, 14.
Cependant l’état florissant et la régularité habituelle des établissements de ce genre ne devaient être ni une garantie ni une sauvegarde contre les accidents qui, comme le canon d’alarme, servaient à réveiller les plus calmes de leur sommeil, et à indiquer que quelque chose de désastreux ou de triste se passait dans le lointain. Chaque maison religieuse a besoin d’une certaine classe de personnes, qu’il était singulièrement difficile de gouverner dans l’état de choses que je décris, je veux parler des frères lais. On ne pouvait attendre de ces braves garçons qu’ils se tirassent d’affaire avec le même bonheur que leurs supérieurs en âge et en mérite ; et parfois ils devaient rabaisser le caractère de l’institution la plus florissante, mettre sa stabilité en péril par un simple acte de gaucherie, résultat naturel de leur fausse position. L’histoire suivante, qui se rapporte à ce sujet, est un fait littéralement vrai. Dans un certain établissement qui affectait la vie religieuse, c’était la coutume des supérieurs d’admettre à leur table les jeunes gens qui les servaient comme des espèces de « frères lais » ; et, je vous l’assure, ce n’était pas sans un acte de mortification de part et d’autre. Un jour frère Isaac (c’est le nom que nous donnerons à notre héros) chercha très-naturellement à échapper à la cage dans laquelle on le retenait, avec les plus pures intentions sans doute, mais avec une prudence contestable ; il voulut se marier avec une personne qui demeurait de l’autre côté de la rue. L’objet de ses affections se trouvant appartenir à un rang de la société un peu plus élevé que le sien, il devint nécessaire pour lui de rassembler et de montrer, à son plus grand avantage, toutes les preuves qui pouvaient établir qu’il était « un gentleman ». Or, parmi les nombreuses recommandations qu’il produisit en sa faveur se trouvait celle-ci, que « dans la famille au sein de laquelle il avait le bonheur de résider, ce jeune homme vivait dans les rapports les plus intimes avec les personnes de la maison, et qu’il avait l’habitude d’être un de leurs convives au dîner ».
Il y avait encore une autre forme d’illusion innocente, dont quelques esprits étaient préoccupés, et qui dépassait toutes les autres dans son absurdité presque incroyable. Il vous faut donc savoir, mes amis, que l’idée de conversion à l’Église Catholique, que plusieurs personnes encourageaient à cette époque, était, non pas celle d’une soumission partielle à son autorité, mais bien celle d’une union entre l’Église Catholique et l’Établissement, ce qu’on appelait alors, les « Églises d’Angleterre et de Rome ». Ce plan, s’il eût été exécutable, avait sans doute plusieurs avantages sur celui des conversions séparées : il faisait moins de violence à tous les sentiments nationaux, sociaux, domestiques, ou personnels ; il nous promettait la conversion en masse de l’Angleterre, au lieu de sa conversion en détail. Vous me direz, peut-être, que parmi d’autres avantages, ce plan nous aurait permis, à nous ecclésiastiques, de garder nos bénéfices. Je crois toutefois que ce point particulier en sa faveur n’eût rien ajouté auprès d’aucun de nous à ce qu’il offrait par lui-même d’attrayant.
Je vous présente ce projet sous son côté le plus beau, parce que je suis obligé de vous avouer qu’il avait conquis un corps respectable de partisans. Au reste, si vous étiez trop disposés à le critiquer, il faut que vous sachiez une chose qui rectifiera vos idées à cet égard, et qui vous empêchera de lancer toute la bordée de votre vertueuse indignation contre les pauvres Puséistes. Le fait donc est que ce grand et intéressant dessein trouva une certaine faveur auprès d’excellents catholiques. Il en eut un, cependant, qui, malgré sa profonde sollicitude pour ramener au bercail les chercheurs d’Oxford, ne voulut jamais l’encourager, ne fût-ce que pour une heure ; je veux parler du docteur Wiseman, qui désapprouva, dès le principe, toute idée d’unité catholique basée sur un pacte entre l’Église et l’Établissement. C’était toutefois une manière de voir qui, en tant qu’elle n’impliquait pas le sacrifice d’une doctrine ou d’un principe fondamental, pouvait être embrassée par tout catholique, et que quelques catholiques éminents, en effet, étaient disposés, pour un certain temps, à regarder avec faveur, ou, au moins, avec indulgence. Aussi, lorsque, d’après la tournure que ce projet prit dans la pratique, je l’appelle absurde, je désire que l’on comprenne que je ne fais pas allusion à l’idée elle-même, mais à quelques-unes des conséquences que renfermait le plan lui-même.
Or, d’une manière ou d’une autre, il nous arriva de ne pas songer, chose merveilleuse ! que, pour le succès de tout projet d’union, le consentement des deux parties est nécessaire. Comme l’Irlandais dans ses plans de mariage, nous avions « notre propre consentement » dans l’affaire : mais nous oubliions qu’il y en avait un autre à demander. Tout était pour le mieux… d’un seul côté. Non-seulement les termes d’union étaient rédigés, mais ils étaient déjà acceptés (en imagination) ; et l’on se représentait l’Angleterre, en idéal, comme une dépendance volontaire et florissante de l’Église ! Nous n’avions pas à élever des cathédrales, car elles étaient sous la main, et elles comptaient au rang des plus riches et des plus belles ; sous leurs voûtes, le culte catholique devait se trouver dans son lieu naturel. Les abbayes en ruine pourraient être facilement restaurées et devenir l’instrument de la charité envers les pauvres ; elles seraient (comme on l’a dit spirituellement) des « workhouses d’union » d’une nouvelle espèce. La réforme du personnel de l’Établissement présentait une difficulté plus grande, mais non insurmontable, pourtant. Les chapitres aussi reprendraient naturellement leur forme normale de sociétés ou de colléges religieux ; et personne ne pouvait positivement prédire quel ne serait pas l’effet moral d’une mitre, d’une crosse et d’une chape, même sur l’archevêque de Cantorbéry. La grande difficulté, toutefois, était bien moins avec les dignitaires qu’avec leurs femmes. Mais si les bons sentiments de ces dames ne les amenaient pas à désirer une séparation de biens, l’obstacle pourrait être levé, en suspendant pour un temps la loi du célibat ecclésiastique. Tout cela, il faut l’avouer, était un château en Espagne bâti sur une échelle gigantesque ; et je sens, tout en vous faisant cette description, combien il est impossible pour moi de vous persuader que je ne plaisante point. Mais je vous l’assure, sans la moindre équivoque, une bonne partie de ce que je viens de vous dire a été proposé sérieusement ; et ce qui, dans mon discours, a été naturellement ridiculisé charge fort peu le tableau de l’Église Utopique, que plus d’un fut tenté de réaliser dans l’ardeur de son jeune zèle.
Maintenant, mes amis, je vous ai mis en état, je l’espère, de goûter mon premier extrait de « Perte et Gain », livre qui, sans une certaine connaissance des temps auxquels il se rapporte, doit être absolument incompréhensible. Je n’ai pas besoin de vous dire que « Perte et Gain », quoique encore sans nom d’auteur[90], a été publiquement reconnu, comme étant son œuvre, par le docteur Newman, qui a ainsi justifié le jugement qui fit prononcer, tout de suite, à ceux qui connaissaient personnellement l’écrivain, que ce livre, d’après ses caractères intrinsèques, devait sortir de sa plume. Car dans cette peinture magistrale des personnages, dans ces esquisses si vraies de la nature humaine, dans cette plaisanterie élégante et enjouée, dans cette pureté si bien sentie de pensée et d’expression, dans cette modestie de l’auteur à passer sous silence la part qu’il a prise aux événements qu’il raconte, dans ce savoir et cette puissance d’argumentation ; de plus, ajouterai-je, dans cette bonté exubérante du cœur et dans cette charité de jugement qui distinguent cet ouvrage, ils ne tardèrent pas à reconnaître l’esprit qui naguère avait brillé d’un si vif éclat du haut de la chaire de Sainte-Marie, et la voix qui, dans le réfectoire d’Oriel, ravisait ses auditeurs, tenant, par mille charmes, dans une captivité volontaire de confiance et d’amitié, tout ce qu’Oxford renfermait d’hommes d’élite.
[90] Perte et Gain, en effet, est sans nom d’auteur dans les trois éditions anglaises ; mais le R. P. Newman a eu l’extrême bonté de nous permettre de placer son nom en tête de notre traduction.
Je vous exposais, il n’y a qu’un instant, mes amis, les résultats produits par le « Mouvement d’Oxford » sur quelques-uns de ses disciples les moins sagaces et les moins prudents ; je vous prie de vous rappeler ce que je vous ai dit là-dessus et de me permettre, en même temps, de vous faire assister à la conversation suivante, qui a lieu entre deux jeunes gens et deux demoiselles, qui s’étaient laissé prendre à ce qu’on appelle communément « le Puséisme », par le côté le plus stérile et le moins estimable. Et ici, laissez-moi vous dire, une fois pour toutes, que j’emploie ce mot « Puséisme », simplement pour ma commodité, et non parce que je l’aime. Car, d’abord, il est irrespectueux à l’égard d’un excellent homme, qui n’a jamais désiré ni mérité d’être regardé comme le fondateur de l’école de religion que ce mot désigne ; et, en second lieu, il proclame une injustice vis-à-vis d’une grande et sainte œuvre, accomplie en dehors de l’Église, en la représentant, ce qu’elle ne fut jamais de la part de la généralité de ses chefs, comme une simple entreprise calculée d’avance et faite avec un esprit de sectaire.
La scène se passe à Oxford, un jour de fête, entre 10 et 11 heures du matin. Les deux jeunes gens, White et Willis, ont déjeuné chez un de leurs amis, et, trouvant sur leur chemin une église ouverte, ils y entrent.
— Ici M. le chanoine Oakeley cite le passage qui commence par ces mots : Une vieille femme nettoyait les bancs… Jusqu’à ceux-ci : carmélites de la réforme de sainte Thérèse. V. p. 56. — Puis il continue :
L’auteur nous a dit que ces demoiselles « ne se connaissaient pas elles-mêmes » ; et peut-être quelques-uns d’entre vous suspectent déjà que l’intérêt de ces jeunes personnes, sans qu’elles s’en doutassent, ne se rapportait pas à un objet purement ecclésiastique. Supposant que tel soit le cas, ce que je me garderai bien d’affirmer, on était alors, évidemment, arrivé à un point où cet intérêt devait prendre un caractère d’inquiétude et même de tristesse. Et c’est là sans doute la raison qui fait dire à notre auteur que, tandis que la conversation s’était jusque là tenue sur la limite de la plaisanterie et du sérieux, elle prit en ce moment « un ton plus réfléchi et plus doux ».
— M. le chanoine Oakeley continue la citation ci-dessus et la poursuit jusqu’à ces mots : « tant de choses étranges, extravagantes arrivent à mes oreilles ! — Il ajoute ensuite :
On doit reconnaître qu’au moins dans cet exemple, les deux demoiselles avaient quelque chose à dire en leur faveur. Mais un des plus malheureux effets du « Mouvement », lorsqu’il était mal compris des personnes ignorantes, c’était de soulever la jeunesse contre les pères et les mères, ainsi que contre les « pasteurs et les maîtres spirituels ». Aussi le but de notre auteur, dans ce brillant passage, est sans doute de nous montrer que le bien ne saurait venir que des personnes qui cherchent la lumière au milieu de leurs perplexités d’esprit, tout en accomplissant leur devoir, avec humilité et patience, dans « l’état de vie où il a plu à Dieu de les placer ». Ne soyons donc pas surpris que ni White ni miss Bolton ne deviennent pas catholiques dans la suite de l’histoire. Au contraire, nous les voyons reparaître, au chapitre 2 de la IIIe partie, comme mari et femme, dans une position opulente et avec des vues modifiées. Willis, le moins loquace des deux amis, se fait catholique d’une manière abrupte et peu satisfaisante, mais il finit par devenir Passionniste. Quant à miss Charlotte, la plus jeune des sœurs, elle quitte la scène, sans même qu’on fasse allusion à son avenir.
Notre auteur n’est rien moins que sévère, relativement à son ancienne communion. Dans les personnes de Campbell et de Carlton, il montre les principes de l’Église d’Angleterre sous leur jour le plus favorable. Dans une sphère moins élevée, M. et madame Reding (leur fille Marie appartient à une classe plus haute), et même notre amie madame Bolton nous reproduisent avec honneur les effets de leur éducation. Tous ces personnages déploient plus ou moins les vertus calmes de famille, unies à un sentiment très-réel et très-pratique de la religion, ces vertus qui sont un résultat assez ordinaire de l’enseignement de l’Église Anglicane. Mais le caractère éminent du récit est celui de son héros, de Charles Reding. Franc, pur d’intention et plein de confiance, ce jeune homme passe du sein d’une famille chérie et de la solitude de sa paisible demeure, dans le tourbillon d’Oxford, à l’époque où le grand « Mouvement Religieux » est à son apogée. Il entre à l’Université avec un esprit candide, pensant bien de toute autorité constituée et prêt à recevoir l’instruction de toute main. Bientôt il trouve qu’au lieu de cette vérité unique qu’il est disposé à recevoir, il a à choisir entre une foule d’opinions, toutes soutenues avec une égale assurance, sans qu’aucune puisse produire une sanction de quelque valeur. Il trouve que les oracles de l’Université, lorsqu’on les interroge sur les points principaux de leur enseignement, ne peuvent donner que des réponses douteuses et renvoyer l’étudiant investigateur au jugement privé, dont celui-ci cherche précisément à secouer le fardeau. C’est ainsi que du rôle de disciple, qui est naturel à son âge et à son caractère, Charles Reding est investi brusquement de celui de juge, malgré ses répugnances et son inhabileté. Cependant, quoique très-circonspect dans ses démarches et très-consciencieux dans sa conduite, il se trouve tout à coup l’objet d’un espionnage et la victime d’un soupçon. Ses plus innocentes remarques sont recueillies à son préjudice, et les explications qu’il en donne ne servent qu’à le jeter davantage dans le discrédit. Sans qu’il le sache, on lui fait la réputation d’un « homme de parti » ; ses espérances sont brisées et son arrêt scellé. Tourmenté, mal compris, et « jeté hors de la synagogue », il se trouve, sans effort et presque sans l’avoir voulu, un enfant de la sainte Église, tel qu’un pauvre orphelin qui, longtemps le jouet des étrangers, se réveillerait tout à coup dans les bras d’une nouvelle mère. Le docteur Newman nous dit, et avec vérité, que son récit « ne repose pas sur un fait ». Charles Reding est un caractère qui, tout autant que je puis me le rappeler, n’a pas eu son modèle vivant au temps auquel il se rapporte ; mais, bien certainement, il représente une classe véritable de caractères, et son histoire, quoique une fiction, témoigne d’une vérité. Il y a eu, à notre époque, des conversions qui ont fait voir le bien sortant du mal d’une manière plus éclatante que celles qui étaient le résultat naturel de dispositions meilleures. Il y a eu des cas dans lesquels (si nous considérons la loi ordinaire de la conduite de Dieu), on ne trouve d’autres préliminaires naturels ni d’autres prédispositions à une si grande faveur, qu’une intention droite. Il y en a eu d’autres, peut-être, qui, selon toute apparence, avaient à peine cette sauvegarde contre une illusion possible. Eh bien, Dieu a tout ordonné selon sa miséricordieuse Providence ; fortifiant ce qui était bon, corrigeant ou purifiant ce qui était mauvais ou erroné ; abandonnant, hélas ! dans un petit nombre de cas, le péché d’un esprit orgueilleux à son châtiment naturel, et punissant un changement trop précipité par une apostasie malheureuse. Le prophète Osée semble parler de ces exemples funestes, lorsqu’il dit : « Ils ont semé du vent et ils moissonneront des tempêtes ; il n’y demeurera pas un épi debout ; son grain ne rendra point de farine, et s’il en rend, les étrangers la mangeront[91].
[91] Osée, VIII, 7.
Mais il y avait aussi des cas différents de ceux dont Charles Reding est un exemple. Il y avait des hommes de dispositions simples, innocentes, véritables éléments caractéristiques du Catholicisme. Ces hommes n’avaient ni désir, ni aspiration au delà de la sphère où la Providence les avait placés, jusqu’à ce que le terrain sur lequel ils paraissaient se tenir debout vînt à leur manquer, et qu’ils fussent poussés en avant par le simple instinct de leur propre conservation. Ils aimaient leurs verts cottages et leur belle terre natale. Les pays étrangers avec leur esprit remuant et leur culte étrange n’avaient pas d’attraits pour eux. Là où ils avaient toujours été, c’est là qu’ils désiraient rester toujours. A leurs yeux, les joies de l’enfance étaient celles de l’âge mûr. Mais ce n’est que dans l’Église Catholique que la réalité de la vie répond aux rêves du jeune âge ; seule, l’Église peut remplir d’un bonheur plus grand encore ces vides que le temps fait nécessairement dans le sanctuaire de nos premières joies. Avez-vous jamais lu les vers si beaux et si touchants de Cooper « sur la réception du portrait de sa mère » ? Qui ne comprend la consolation qu’un homme aussi sensible eût trouvé dans la contemplation de la sainte Vierge ! Eh bien, il y avait des âmes tendres, affectueuses et souples, qui aspiraient après quelque chose de meilleur et de plus durable que ce monde ou que les espérances d’ici-bas. Or, comment le Protestantisme, même dans sa forme la meilleure, satisfit-il jamais à ce besoin ? Par des vues terrestres, moins belles, mais non moins fugitives que celles qui s’étaient évanouies, ou par des rêves plus beaux sans doute, mais tout aussi vaporeux. « Mais », nous dit le docteur Newman, « lorsqu’un homme… » (citation jusqu’à ces paroles : « comme un disciple à son maître. » V. pag. 169.) — Après quoi M. le chanoine Oakeley ajoute :
La première des citations suivantes vous montrera Charles au sein de sa famille ; la seconde, au milieu de ses perplexités d’Oxford ; la troisième, dans son état de transition ; la dernière, enfin, dans son état de quiétude.
— Ici, premier extrait à partir de ces mots : « Charles était un fils affectueux… » jusqu’à ceux-ci : « j’aurai de l’énergie au jour venu. » V. pag. 85. — M. le chanoine Oakeley ajoute :
Le vague soupçon exprimé ici par Charles, que l’espèce de bonheur qui l’environne ne réponde pas complétement aux besoins de son être immortel, est admirablement développé dans la suite de l’histoire. La visite de M. Malcolm, « un ami de la famille », sert à donner à ce sentiment de crainte une forme un peu définie ; et ce sentiment se dessine encore mieux dans quelques conversations touchantes de Charles avec sa sœur Marie. Bientôt après, le père de Charles meurt, et alors viennent tous les tristes accessoires d’un deuil de famille. Ainsi sont brisés pour Charles les liens qui l’attachent à sa maison terrestre. Différents événements qui lui arrivent à Oxford agissent dans le même sens. Le principal de ces événements, c’est le soupçon d’excentricité religieuse auquel il se trouve exposé, et qui bientôt se termine par un fait décisif, comme l’auteur va nous le raconter.
— Extrait, depuis ces mots : « Nous devons dire au lecteur… » jusqu’à ceux-ci : « bannissement était supportable. » V. p. 189. — M. le chanoine Oakeley ajoute :
Je ne vous raconterai pas, mes chers auditeurs, les démarches, qui, au reste, ne sont ni nombreuses ni difficiles, par lesquelles Charles est amené jusque sur le seuil de l’Église Catholique. Maintenant, il n’a plus qu’une épreuve à surmonter ; mais aussi c’est la plus terrible, quoique ce ne soit pas la dernière.
— Extrait, depuis ces mots : « Charles descendit… » jusqu’à ceux-ci : « vers Collumpton. » V. p. 273. — M. le chanoine Oakeley continue :
Charles avait encore un bien rude temps à affronter avant de se trouver sain et sauf dans le port. Cependant, comme je ne me propose pas de vous donner une analyse de « Perte et Gain », ni même une critique de cet ouvrage ; mais comme mon unique but en vous le citant, c’est d’éclairer le sujet que je traite, je m’en vais au plus tôt débarrasser notre jeune étudiant de toutes ses misères.
— Citation du dernier chap. de la IIIe partie. M. le chanoine Oakeley termine sa conférence par ces réflexions :
Ces deux amis sont arrivés à l’Église catholique par des voies et à des heures différentes. Willis s’y est réuni dès le début de sa carrière. Sa démarche ne porte pas le cachet d’une délibération bien mûrie ; on la dirait le fruit de la volonté propre. Charles, qui est du même âge que le jeune converti, et qui se trouve dans les mêmes circonstances et dans les mêmes occasions, use de sa pleine liberté tout le temps de sa préparation. Il passe au crible de sa raison tout argument qu’il rencontre, et épuise toutes les alternatives. Puis il se jette dans le sein de l’Église, non-seulement sans un acte de choix, mais à peine avec un effort de volonté, tel qu’une grappe mûre qui tomberait d’elle-même dans les mains de celui qui la cueille. La première pensée de Charles, comme nous venons de le voir, c’est qu’il a tardé trop longtemps ; la crainte de Willis, après de sérieuses réflexions, c’est que, peut-être, il a agi avec trop de précipitation. Il est certain qu’on peut arriver à faire une bonne action par une fausse voie ; et des juges différents, tout en se réjouissant avec Charles et Willis de leurs conversions, jugeront d’une manière différente la marche respective par laquelle ces jeunes gens sont arrivés, chacun à sa façon, au Catholicisme. Certaines personnes disent parfois que la seule faute que commettent les convertis, c’est de ne pas se convertir plus tôt ; d’autres, au contraire, après avoir étudié des conversions particulières, les croient trop précipitées et évidemment trop peu mûries.
Les paroles que notre auteur met dans la bouche de Willis peuvent être prises, il me semble, comme exprimant sa pensée sur cette question : « Tout est bien, dit-il, excepté ce que le péché rend mauvais. » Une conversion à l’Église est l’acte le plus grand de la faveur divine sur la terre, à part le don de la persévérance ; et Dieu accorde cette grâce à qui il veut, de la manière qu’il lui plaît, au temps qui lui convient. Les uns, il les appelle à la première heure, d’autres à la onzième. Il peut arriver que celui qui s’est converti de bonne heure ait été téméraire, et que celui qui s’est converti tard ait temporisé avec la grâce ; et s’il en est ainsi, il y a un péché (plus ou moins grand) dans la conduite, quoique le résultat témoigne de la bénédiction divine. Mais dans aucun des deux cas, la faute n’a été assez considérable pour provoquer le retrait de cette grâce divine ; grâce, permettez-moi de vous le rappeler, qui apporte avec elle, parmi d’autres priviléges, celui d’obtenir le pardon de tout péché commis dans la voie même que Dieu avait marquée. Soyons donc toujours plus disposés, en jugeant les conversions individuelles, à applaudir au bienfait reçu qu’à critiquer les fautes que l’on peut avoir commises au moment où Dieu accordait ce bienfait.
Les mêmes considérations qui nous portent à juger charitablement des conversions individuelles nous font également apprécier avec indulgence le grand « Mouvement Religieux » lui-même. Pour tout catholique qui en ignore l’origine, qui ne sait pas le caractère et les intentions de ses chefs, ce Mouvement doit avoir présenté sans doute un spectacle inexplicable et peu satisfaisant. Il doit être très-difficile de comprendre pourquoi des hommes qui s’avançaient si loin n’allaient pas plus loin encore. Et de là il est arrivé que les mêmes personnes auxquelles les Protestants reprochaient d’être infidèles à leur Église, étaient accusées, au contraire, par les Catholiques de lui être trop servilement attachées. Cette anomalie, toutefois, était parfaitement intelligible pour ceux qui étaient plus rapprochés du théâtre de l’action. Ils comprenaient que le désir de rendre justice à l’Église Catholique s’accordait très-bien, jusqu’à un certain point, avec l’attachement le plus respectueux à la communion qui primâ facie avait droit à la soumission de ses membres comme étant celle qui les avait vus naître, qui les avait élevés et qui avait été pour eux, évidemment, le canal de bien des grâces. Les chefs et les disciples du Mouvement d’Oxford (ou du moins ceux à qui je fais directement allusion) désiraient seulement connaître la volonté de Dieu envers eux ; et ils tâchaient de la connaître par la seule voie légitime, celle du devoir. Le grand problème, dont ils acceptaient par anticipation les conséquences, fut résolu non par eux, mais pour eux ; et lorsque la voix de Dieu parla à leurs cœurs de manière à ne pas s’y méprendre, ils se levèrent et ils obéirent. Qu’ils lui aient obéi lorsqu’ils l’ont fait, c’est une preuve qu’ils étaient prêts à obéir dès le commencement. Les conversions, donc, viennent nous donner le véritable commentaire et l’interprétation du Mouvement. « C’est à leurs fruits que vous les connaîtrez. » Oui, ce n’a pu être que l’œuvre de Dieu qui a donné à son Église des centaines d’enfants fidèles et dévoués comme résultat direct de ce Mouvement, et des milliers comme son résultat indirect. Et cependant il est probable que nous ne cueillerons de nos jours que les premiers fruits de cette grande moisson. Je le répète, les conversions, si nombreuses et si multiformes, si indépendantes dans leur origine et si semblables dans leur résultat ; les conversions impliquant l’assujettissement de tant de puissantes intelligences, la soumission de tant de volontés opiniâtres, le sacrifice de tant de rapports aimés, l’immolation de tant d’attachements terrestres : voilà, mes amis, ce qui explique la crise religieuse d’où elles sont sorties ; comme, aussi, elles sont expliquées, à leur tour, par cette crise elle-même. L’importance du Mouvement nous est une garantie que nous pouvons compter sur ces conversions ; le nombre et la valeur des conversions nous sont des preuves manifestes de la profonde réalité du Mouvement.
A
« Les Universités et les colléges d’Angleterre sont des institutions tout à fait distinctes. Nécessité donc de se dépouiller tout d’abord de l’idée que réveille naturellement chez nous l’Université telle que nous l’avons en France.
» L’origine des Universités anglaises est de date fort reculée. Elles furent dans le principe instituées pour l’enseignement de tous, sans distinction de classes. L’origine des colléges est bien différente. Ces établissements sont dus à des fondateurs qui les ont dotés de propriétés foncières, dont la possession et la transmission se font en vertu de chartres de corporation, données à ces établissements. Mais les fondateurs les ont institués avec une destination déterminée, ou abandonnée au choix de celui qui était appelé à les diriger. Dans ces colléges, les étudiants se préparaient à recevoir plus tard le haut enseignement des Universités. Mais on vit ces derniers établissements être à peu près abandonnés, et les colléges recevoir presque exclusivement le soin d’instruire la jeunesse. Sous Henri VIII, il fut décidé que pour être admis dans les Universités, il fallait avoir d’abord été reçu dans l’un des colléges établis près d’elles. Or, les colléges étant des institutions privées, où une certaine classe, un certain nombre de personnes pouvaient seules être admises, les Universités elles-mêmes, d’institutions publiques, devinrent des institutions privilégiées.
» On vit plus tard, sous la reine Elisabeth, le grand sénéchal de l’Université d’Oxford décréter qu’il faudrait, pour être admis dans les colléges, jurer les trente-neuf Articles qui constituent les dogmes du culte anglican. Le bienfait de l’instruction était déjà devenu le privilége des nobles et des riches ; il devint alors celui d’une secte, et cet état de choses s’est continué jusqu’à nos jours.
» Les Universités ont conservé leurs professeurs titulaires qui jouissent d’énormes revenus ; mais ces messieurs, laissant aux colléges le soin de faire le cours, possèdent à peu près des sinécures. Ce sont aujourd’hui les colléges qui enseignent ; les Universités constatent seulement la science, en faisant subir les examens et conférant les différents grades. Ces établissements sont tout à fait indépendants du gouvernement, qui n’exerce pas même sur eux un droit de surveillance.
» L’Université de Londres, fondée il y a peu d’années, est établie sur des bases plus libérales. Elle diffère de celles d’Oxford et de Cambridge, en ce qu’elle n’est pas exclusivement anglicane : elle est ouverte à toutes les croyances.
» L’Université fondée à Dublin par Elisabeth, quoique basée sur les principes protestants des Universités d’Oxford et de Cambridge, est cependant moins intolérante que celles-ci, car elle admet les étudiants catholiques aussi bien que les dissidents à venir recevoir l’instruction chez elle. Mais on s’imagine aisément avec quelle répugnance des parents catholiques, en Irlande surtout, se décident à confier l’éducation de leurs enfants à des maîtres anglicans. Les Catholiques peuvent non-seulement y recevoir l’instruction, mais ils sont autorisés à habiter l’Université, et à y prendre des grades. Toutefois, ils ne peuvent devenir ni fellows ni scholars.
» A Cambridge, les Catholiques peuvent habiter les colléges et suivre les cours, mais on ne leur donne pas de grades. A Oxford, l’intolérance est absolue : les Catholiques ne peuvent ni y être instruits, ni y habiter.
» Voilà les trois systèmes aujourd’hui en vigueur dans les Universités anglaises. Il serait difficile de donner une explication satisfaisante et raisonnable de ces différences. On ne comprend pas que la présence des Catholiques Romains puisse être dangereuse à Oxford, tandis qu’elle ne l’est pas à Cambridge ; et comment on leur donne plus de liberté à Dublin qu’en Angleterre, lorsque, vu leur nombre et leur influence en Irlande, on devrait se méfier d’eux bien davantage qu’à Cambridge ou à Oxford. » Du Mouvement Religieux en Angleterre, par J. Gondon.
N. B. Depuis que M. Jules Gondon a écrit ces lignes, deux grands faits se sont accomplis : ils méritent d’être indiqués.
1o Après bien des efforts, dignes de succès, l’Irlande a enfin son Université Catholique, à Dublin même. L’inauguration de cet établissement a eu lieu au mois de novembre de l’année 1854. C’est grâce à l’énergie des évêques du pays et à la générosité des braves Irlandais que cette magnifique institution a pu être fondée. Jusqu’à présent, toutefois, l’Université n’est pas complète, puisqu’elle n’a que trois pédagogies ; mais encore un peu de temps, et elle embrassera toutes les branches des sciences humaines.
Dans la création d’une Université catholique en Irlande, nous ne pouvons nous empêcher de reconnaître la main divine ; mais où le fait providentiel nous frappe surtout, c’est dans le choix de la personne à qui a été confiée une œuvre si colossale. Qui, en effet, mieux que le révérend père Newman, pouvait connaître les besoins si étendus d’une institution semblable ? qui, mieux que lui, pouvait donner la vie à cet immense corps après l’avoir créé ? Quel autre eût possédé, au même degré, cet ascendant du génie et de la vertu qui inspire la confiance, attire le talent, féconde les œuvres, leur assure le succès, la gloire, une stabilité pour des siècles ? Que d’événements, enfin, n’ont pas dû s’accomplir, pour que le savant et pieux ex-fellow d’Oriel devînt le premier Recteur d’une Université Catholique en Irlande ? A l’époque de la conversion de son illustre ami, le docteur Pusey écrivit ces lignes dans une lettre devenue célèbre : « Et y avait là (dans le docteur Newman) un homme destiné à être un grand instrument de Dieu, propre par toutes ses qualités à réaliser de grandes choses… Il nous a quittés sans se douter de sa valeur. Il me semble qu’il a été transplanté dans une autre partie du vignoble où toute l’énergie de son puissant esprit pourra être employée, tandis qu’elle ne l’était pas chez nous. » C’est maintenant surtout que ces belles paroles se réalisent. — Qu’on nous permette de le dire, en passant : après tout ce qui a eu lieu depuis dix ans en Angleterre, la conduite du docteur Pusey reste une énigme mystérieuse ; ses anciens amis eux-mêmes ne savent comment expliquer la position que garde le savant professeur. Puisse-t-il, enfin, voir la lumière !
Quel est l’avenir réservé à l’Université Catholique de Dublin ? Le révérend père Newman va lui-même répondre : « Je vous félicite, messieurs, de la noble entreprise que vous avez si heureusement commencée. Pour moi, qui ne l’ai connue qu’après son autorisation par le Saint-Siége, je n’ai jamais, un seul instant, douté de son succès, parce qu’elle nous vient de Rome. Je ne vivrai peut-être pas assez pour être témoin de ses résultats ; mais cet avenir n’altère en rien ma confiance ; car je sais que dans une œuvre aussi importante que la vôtre, l’exécution est laborieuse, et que plus les bienfaits sont grands, plus grandes sont les difficultés. » (Discours d’inauguration, 14 nov. 1854).
Les espérances du R. P. Newman paraissent devoir se réaliser plus vite qu’on ne l’avait pensé. La première année scolaire, qui vient de finir, a eu un succès qu’on n’osait pas attendre ; outre les Irlandais, l’Université Catholique a vu dans son sein des Anglais, des Écossais et des Français. Toutes les classes de la société y ont été représentées, depuis la pairie jusqu’aux humbles scholars. Nous faisons les vœux les plus ardents pour que cette grande œuvre atteigne le but que se sont proposé les bons évêques d’Irlande en la créant. Nous lui souhaitons les succès de la nouvelle Université de Louvain, qui continue avec tant d’éclat la gloire de sa devancière. — Quand le clergé, en France, aura-t-il son Université catholique ?
2o Le Parlement a aboli, cette année (1856), les serments qui fermaient aux Catholiques les portes de l’Université d’Oxford. A la première vue, cet acte semble consacrer une grande liberté de plus ; mais, qu’on ne s’y trompe pas, dans le fait, l’accès de l’Alma Mater sera interdit comme auparavant à tout vrai Catholique. Car l’acte du Parlement ne changera rien à l’enseignement, aux pratiques et aux usages traditionnels des colléges académiques : l’atmosphère restera la même, elle sera anglicane. On peut juger de ce qui aura lieu à Oxford par ce qui se passe à Cambridge. Ici, en effet, tous les jeunes Catholiques qui désirent suivre les cours de l’Université sont absolument soumis aux mêmes règlements que les Protestants : ils doivent assister aux mêmes exercices religieux, entendre prêcher constamment une doctrine hérétique, faire depuis le matin jusqu’au soir des actes contraires à leur croyance.
Quel est, après cela, le Catholique, digne de ce nom, qui oserait envoyer son fils à l’Université d’Oxford ? Recevoir l’enseignement, à de pareilles conditions, n’est-ce pas apostasier ?
Au reste, bien des personnes ont une fausse idée des écoles mixtes du Royaume-Uni. On croit généralement, que parce qu’une école ouvre ses portes à tout le monde sans exception, l’enseignement religieux qui y est donné est tel qu’il puisse s’accommoder à toutes les croyances ; cela est une erreur. Pratiquement, chaque école a ses principes religieux qu’elle tâche d’inculquer à son auditoire. Si l’école mixte est créée par l’État, elle est tout à fait anglicane ; si elle appartient aux Wesleyens, elle enseigne le Méthodisme ; si elle doit sa fondation aux Anabaptistes, elle prêche les doctrines des Anabaptistes, et ainsi de toutes les autres.
C’est ne pas connaître l’esprit des sectaires, c’est surtout ne pas connaître le caractère anglais, que de supposer qu’il puisse en être autrement. L’Université de Londres, créée seulement depuis quelques années, semble faire exception : là, l’enseignement religieux est purement négatif. Mais pour bien apprécier cet état de choses, il faut tenir compte de deux observations qui diminuent infiniment l’importance que quelques hommes, à un point de vue très-dangereux, voudraient attribuer à l’existence de cette Université.
La première de ces observations est relative aux colléges annexés. Ces colléges, en effet, ont le droit d’élever chez eux les jeunes gens qui vont plus tard se présenter à Londres pour prendre leurs grades. Ils peuvent donc donner l’enseignement religieux qui leur convient, sans que l’Université ait rien à y voir. Le magnifique collége catholique d’Oscott est dans ce cas.
La seconde observation est relative à l’Université de Londres elle-même. L’enseignement religieux de cette université est purement négatif, c’est vrai ; mais c’est aussi un fait de notoriété publique, que les Protestants, qui ont une croyance définie, ne permettent pas à leurs enfants d’aller suivre des cours dont les professeurs peuvent impunément enseigner des doctrines antichrétiennes. Ces cours ne sont fréquentés que par des jeunes gens dont les parents vivent dans une complète indifférence en matière de religion.
B
« A Oxford, ce qu’il y a de plus rare, C’est un bâtiment qui ne soit pas historique. Toutes ces longues murailles entrecoupées de tourelles, ces toits surmontés de dômes, ces porches en ogives, ce sont des rois et des reines, des cardinaux, des ministres ou des princes qui les ont bâtis : on dirait que les simples bourgeois ont été bannis lors de la construction de la ville savante. Le voyageur est comme étourdi des grands noms que lui redit son guide, en le promenant à travers tous les magnifiques colléges. A celui de Sainte-Madeleine (car la protestante Université d’Oxford a conservé toutes les anciennes dénominations catholiques de colléges de Tous saints, de Toutes âmes ; de Corpus Christi, etc., etc.), on vous montre le tombeau du fondateur Waynflete, chancelier du malheureux Henri VI. Au Queen’s college, on vous cite Robert d’Eglesfield, confesseur de la reine Philippa d’Espagne, femme d’Édouard III. A University college, c’est Alfred, roi troubadour et guerrier, qui le premier rassembla dans ce lieu quelques enfants de la harpe et de la science.
» Plus loin, à Oriel college, vous entendez le nom d’Edward II. Balliol college redit celui de son fondateur, Jean Balliol, père de Balliol, roi d’Écosse.
» Puis vous entendez citer les patrons, les saints de la réformation protestante, le chaste Henri VII, la vierge-reine Elisabeth et le cardinal Wolsey.
» Dans ces vastes et nobles colléges, les chapelles attirent toujours l’attention des voyageurs ; c’est la partie la plus soignée. Pas une pierre ne manque à leurs voûtes, pas une feuille à leurs corniches ; les statues mêmes de ces saints que l’on n’y vénère plus sont réparées avec un soin extrême. Nous avons remarqué des têtes nouvelles remises sur les corps de sainte Ursule et de sainte Brigitte. En vérité, si, comme je le crois, le Catholicisme rentre un jour dans ses vieilles églises d’Angleterre, il n’aura à y rapporter que des tabernacles et des confessionnaux…
» Parmi les édifices sacrés de l’Université, l’église de New college est ce qu’il y a de plus cité : c’est là que nous avons admiré de beaux vitraux… On nous a montré dans le sanctuaire de cette chapelle la crosse de Wikeham, évêque de Winchester. Ce bâton pastoral est en vermeil et orné de pierres précieuses incrustées, et a sept pieds de haut ; il porte dans sa partie recourbée la figure du saint fondateur du collége. Il me semble que cette crosse doit faire un singulier effet entre les mains d’un évêque protestant.
» A Jesus college, on fait voir aux visiteurs une montre qui a appartenu à Charles Ier. Qui n’aurait cru autrefois que la montre d’un roi ne devait lui indiquer que des heures heureuses !… Et cependant cette montre lui a fait voir le 29 janvier 1648, sa dernière heure, celle de son exécution !
» Ce collége a conservé aussi un énorme étrier qui servait jadis à Elisabeth, et un bol en vermeil qui contient dix gallons et pèse 278 onces…
» Dans différents endroits nous avons vu de ces vases énormes où les Anglais aiment à faire brûler le punch pour leurs grands jours de fête et de réjouissance.
» Au musée Ashmoléen (the Ashmolean museum) fondé par Elias Ashmole, et bâti par sir Christopher Wren, il y a une foule de choses curieuses que bien des gens appellent vieilleries, entre autres :
» Un amulette, jadis porté par Alfred le Grand ; d’un côté est la figure de saint Cuthbert, et de l’autre une fleur grossièrement taillée. Les ornements sont d’or, et sur une plaque on lit en lettres saxonnes : « Alfred m’a fait faire. »
» L’épée offerte par Léon X à Henri VIII !… Le livre qui explique toutes ces curiosités dit que ce qu’il y a de plus curieux dans cette épée, c’est la poignée qui est de cristal et d’argent. Ce qui nous a semblé le plus curieux, à nous, c’est de voir cette épée donnée au défenseur de la foi par les mains d’un pape, précieusement conservée par le prince apostat !
» Le collége de la Trinité possède un magnifique calice en vermeil, jadis de l’abbaye de Saint-Alban…
» Le collége de Christ-Church déploie une belle façade de plus de quatre cents pieds ; la porte principale, flanquée de quatre tourelles, est surmontée d’une haute tour terminée en dôme. C’est au fameux Christopher Wren que l’on doit la régularité et la majesté de ce monument. La grande salle ou le réfectoire, l’escalier, le vestibule, sa voûte surtout, sont très-remarquables.
» Le réfectoire a 115 pieds de long, 40 de large et 50 de haut. Comme l’honneur de recevoir les rois d’Angleterre appartient à Christ-Church college, cette vaste salle a bien des fois reçu des convives couronnés : Henri VIII, en 1533 ; la reine-vierge, en 1566 ; Jacques Ier le bel esprit, en 1591, et, plus tard, son infortuné fils.
» En 1814, on vit sous ces nobles voûtes une bien illustre assemblée : George IV, alors prince régent ; Alexandre, empereur de toutes les Russies ; François, empereur d’Allemagne et roi des Romains ; Guillaume, roi de Prusse ; le feu duc d’York, la grande duchesse d’Oldenbourg… Oxford se souvient avec fierté de cette visite, de cet hommage rendu aux muses par des empereurs et des rois qui s’honorèrent de recevoir des diplômes de membres de son Université…
» Dans la chapelle de Christ-Church college, on montre la châsse de sainte Frideswide ; elle est surmontée d’un dais de pierre à petits pinacles gothiques d’un travail précieux…
» Les dix-neuf colléges réunis de l’Université, et les cinq halls comptent près de cinq mille étudiants…
» Dans cette Angleterre, que certaines gens nous citent sans cesse comme la terre classique de la liberté, les étudiants des Universités ne sont pas indistinctement confondus. Nous avons vu dans les réfectoires des places privilégiées pour les jeunes nobles (sons of noblemen). Le fils d’un noble, d’un homme titré a deux habits : celui des grands jours est de soie violette damassée, richement orné de galons d’or ; celui des jours ordinaires est une toge de soie noire.
» Après ces fils d’hommes titrés viennent les gentlemen commoners, qui ont deux toges de soie : l’une unie, et l’autre chargée de glands de soie noire.
» Les simples commoners ont la toge en laine et sans manches. Les nobles ont la toque de velours avec le gland d’or ; les gentlemen, en velours, mais avec un gland de soie, et les commoners, en drap noir avec une touffe de soie…
» Le premier dignitaire de l’Université est le chancelier ; on a toujours soin de le choisir dans les hauts rangs de la Société ; il faut qu’il ait été élevé à Oxford, car on veut que ce protecteur aime l’Université avec tous les souvenirs de son jeune âge.
» Le vice-chancelier, nommé par le chancelier, est tenu à résidence ; c’est lui qui, de concert avec quatre pro-vice-chanceliers, surveille tous les colléges et les halls, y maintient la discipline et l’observance des anciens statuts…
» La bibliothèque Bodleyenne[92] fondée par sir Thomas Bodley, est la plus riche et la plus remarquable de toutes les bibliothèques des différents colléges d’Oxford. Tout membre gradué a droit d’y venir étudier. On y voit un grand nombre de manuscrits orientaux : elle compte 430,000 volumes…
[92] En parcourant cette belle bibliothèque, l’année dernière, nous n’avons pas été peu surpris de voir parmi les nombreux portraits dont elle est ornée, celui d’un prêtre catholique en surplis. Notre étonnement a cessé, lorsque nous avons lu sur le catalogue le nom du personnage que cette toile représente ; c’est le père Le Courayer, si tristement célèbre. Il doit l’honneur de se trouver dans une place si étrange à son ouvrage, intitulé : Dissertations sur la validité des ordinations anglicanes.
» Je vous ai parlé du chancelier…; mais il faut que je vous cite encore une autre charge que les temps auraient pu supprimer, et que l’Université a conservée, celle de barbier ou tonsor. Le barbier est encore un personnage, les dignitaires lui doivent les égards de la fraternité, et lui donnent à souper une fois par an dans les grands appartements. Il ne frise ni ne poudre plus, il rase rarement ; mais il n’en est pas moins incorporé et immatriculé. » Lettres sur l’Angleterre, par M. le vicomte Walsh, 1829. Lettre X.)
C
Le Prayer-Book (livre de prières) est un recueil qui renferme les prières du matin et du soir, le service de la Cène, les règles liturgiques pour le Baptême, la Confirmation et le Mariage, un catéchisme anglican et les XXXIX Articles. C’est sous Charles II que l’usage de ce livre, dans sa forme actuelle, fut ordonné par la Convocation (grand conseil ecclésiastique). Le Parlement l’a enregistré dans ses actes. Aux yeux des Anglicans purs, le Prayer-Book est une autorité, c’est l’enseignement même de l’Église ; mais les esprits qui sont conséquents avec le principe du jugement privé demandent sur quoi l’on s’appuie pour donner une si grande valeur à ce livre. Les questions que ceux-ci soulèvent sur ce point ne sont pas faciles à résoudre ; disons mieux, elles sont insolubles (Voy. la lettre de Froude à M. Kèble) ; et le Prayer-Book comme la Bible elle-même, est un livre que chacun interprète à sa façon.
D
Les Halls (salles) jouissent des mêmes priviléges que les colléges ; mais ces établissements ne sont pas incorporés à l’Université. Chacun d’eux vit sous l’administration particulière d’un principal. De ces anciennes et nombreuses maisons, il n’en reste plus que cinq, savoir :
1o Hall de Saint-Edmond (St. Edmond Hall). Elle tire son nom de saint Edmond, archevêque de Cantorbéry, qui vivait sous le règne de Henri III, au XIIIe siècle.
2o Hall de Sainte-Marie (St. Mary Hall), bâtie en 1333, par Édouard II.
3o Hall du Nouvel Hôtel (New Inn Hall), bâtie en 1349, par Jean Trilleck, évêque d’Hereford.
4o Hall de Saint-Alban (St. Alban’s Hall), érigée sous le règne du roi Jean. Elle tire son nom de Robert de Saint-Alban, qui probablement la fit bâtir pour en faire son habitation.
5o Hall de la Madeleine (Magdalen Hall). Le bâtiment qui porte aujourd’hui ce nom a été construit en 1820. L’ancienne Hall du même nom se trouvait à côté du beau collége de la Madeleine. Il a fallu un acte du Parlement pour pouvoir opérer le transfert.
E
Le Monument, à Londres, est une colonne dorique, élevée en 1671, par ordre du Parlement, en mémoire de l’incendie de 1666, qui consuma presque toute la Cité. Cette colonne a 66 mètres de hauteur ; une balustrade entoure son chapiteau, et des flammes de cuivre brillent sur son sommet.
A l’époque où eut lieu l’incendie, la haine populaire attribua cette calamité aux Papistes. On prétendit qu’ils avaient voulu exterminer les Anglicans, rétablir le dogme catholique et plonger la nation dans la servitude. Une calomnie si révoltante fut gravée sur le piédestal du Monument, et elle y resta jusqu’en 1829, année de l’émancipation des Catholiques.
Pages. | ||
| Avertissement de l’auteur | ||
| Préface du traducteur | ||
PREMIÈRE PARTIE. | ||
| Chap. | Ier. L’éducation | |
| II. Les deux amis et un bachelier amateur d’architecture gothique | ||
| III. Un cœur ouvert et aimant. — Un homme à vues | ||
| IV. Le charlatanisme en religion | ||
| V. Oxford : une vue d’intérieur par un vieux don | ||
| VI. Un déjeuner assez sérieux | ||
| VII. Une controverse entre un évangélique, un néo-catholique, l’homme à vues et le bachelier | ||
| VIII. Les temps nouveaux. — Le bon vieux temps | ||
| IX. Le sermon assez élastique du docteur Brownside | ||
| X. L’homme du juste milieu et les partis d’Oxford | ||
| XI. Une rencontre | ||
| XII. Le pressentiment | ||
| XIII. Un assaut chaleureux mais prématuré | ||
| XIV. Rentrée au collége peu agréable | ||
| XV. Les XXXIX Articles | ||
| XVI. M. Freeborn, un vrai évangélique, expose sa nébuleuse doctrine | ||
| XVII. Une réunion discordante d’évangéliques | ||
| XVIII. Le deuil de famille | ||
DEUXIÈME PARTIE. | ||
| Chap. | Ier. Les partis politiques | |
| II. Partis religieux | ||
| III. Une conversion | ||
| IV. Le célibat dans l’Église anglicane | ||
| V. Le célibat est-il contre nature ? | ||
| VI. Abdication du jugement privé | ||
| VII. Le symbole de saint Athanase interprété par l’Église anglicane | ||
| VIII. Les XXXIX Articles mis en regard du symbole catholique | ||
| IX. Un système d’espionnage | ||
| X. La rustication, ou le renvoi temporaire | ||
| XI. La famille | ||
| XII. Confidence intime | ||
| XIII. Perplexités d’une bonne sœur | ||
| XIV. Les nouvelles réformes | ||
| XV. Les corruptions de l’Église romaine | ||
| XVI. Du chant grégorien et de l’architecture gothique | ||
| XVII. Questions pour celui à qui il appartient | ||
| XVIII. L’Église anglicane et l’Église romaine ne font-elles qu’une seule et même Église ? | ||
| XIX. De quelques pratiques religieuses | ||
| XX. Un beau mouvement d’enthousiasme inattendu et communicatif | ||
| XXI. L’examen | ||
TROISIÈME PARTIE. | ||
| Chap. | Ier. La cruelle séparation | |
| II. Deux nouveaux mariés déjà connus sous un autre aspect | ||
| III. L’apostasie | ||
| IV. Une conversation d’actualité | ||
| V. La conclusion pratique | ||
| VI. Le rail-way | ||
| VII. Deux irvingites, une plymouthiste et un néo-juif assiégeant une pauvre chambre | ||
| VIII. Le siége continué par un membre de la société de la vérité et par un fanatique d’Exeter-Hall | ||
| IX. Le dernier assaut | ||
| X. Le couvent des Passionnistes | ||
| XI. Le beau jour | ||
| Appendice. — Souvenirs personnels du Mouvement d’Oxford, avec des extraits de Perte et Gain du docteur Newman. — Conférence par Frédéric Oakeley | ||
| Notes | ||
FIN DE LA TABLE.
Imprimerie DE BEAU, à Saint-Germain-en-Laye.